Sommaire
Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours
Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard
Attesté dès l’Antiquité tardive et utilisé au Moyen Âge dans le cadre de la centonisation, le principe est largement repris dans les siècles suivants où l’on parle de parodie, de contrafactum ou de vaudeville, ce dernier se constituant même en genre musical. La pratique est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et cantiques populaires, des chansons spirituelles, des noëls, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes, les cabarets de chansonniers. Elle inspire encore volontiers les chansons de soldats, les chants de manifestations, de résistances, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc. L’examen des diverses pratiques engage donc à réévaluer la pertinence d’oppositions courantes mais souvent discutables comme savant et populaire, écrit et oral, citadin et rural. C’est un questionnement interdisciplinaire sur cet immense corpus qui inspire le présent ouvrage. Il apporte de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, le caractère « mineur » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, et sans jamais perdre de vue la dimension essentielle de performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports contemporains, les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les musiques de danse, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, le sens qui se dégage de l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Cet ouvrage, d’une envergure largement inédite, est le fruit de quatre journées de colloque tenues en 2021 et 2022 avec le concours des universités de Paris (Sorbonne Université, Paris Cité), Poitiers, Rouen, Reims et Tours. Il éclaire la diversité de ces corpus de manière interdisciplinaire, depuis les origines du phénomène à nos jours.
Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes, experts ou amateurs, ont composé ou composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Le mot timbre désigne ordinairement cet air connu ou supposé tel à partir duquel on écrit et l’on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, qui semble universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).

- Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques
- Alice Tacaille Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse
- Séverine Delahaye-Grélois « Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa »
Contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol
- François Picard Sur l’air du tralala.
Intertextualité et intermusicalité dans les timbres français, les avatars de La Mère Michel - Marlène Belly L’Air ne fait pas la chanson. Que ne suis-je la fougère : un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation
- Marc Clérivet Hé là-haut dans ces prés doux : une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française
- Fañch Thoraval Stanze di passione. Transtextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles)
- Nicolas Andlauer La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités
- Jean-Jacques Castéret Entre oralité et écriture : les « deux corps » du noël en Béarn et Gascogne
- Georges Escoffier La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ?
- Clément Duyck Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle)
- Bertrand Porot L’air de vaudeville comme modèle compositionnel : l’exemple d’André Campra (1660-1744)
- Julien Le Goff La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734)
- Benjamin Pintiaux Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du Temple (1750-1800)
- Claude Dauphin L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante
- Tommaso Sabbatini Airs connus et musique d’opérette dans la féerie parisienne après 1864
- Éric Sauda Réécritures de chansons au front de la Grande Guerre
- Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney Résister « sur l’air de » : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944)
- Déborah Livet La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation
- Karine Abiven et Miriam Speyer La chanson comme preuve de noblesse : le cas de La Fine Galanterie du temps (Ribou, 1661)
- Catherine Merle Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : un remarquable exemple de féminisme musical
- Romain Benini Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux
- Nils Couturier « Le temps des crises » : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle
- J.-F. « Maxou » Heintzen André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective
- Jonathan Thomas Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique
- Raphaëlle Legrand Les Voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes « sur l’air de »
- Annie Legouhy, Judith le Blanc, Patrice Mercier et Clémence Monnier « C’est quoi une goguette ? »
Conversation d’Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier avec Judith le Blanc
Chanter sur l’air de… Usages et pratiques des timbres du Moyen Âge à nos jours
Ouverture – La pratique du timbre : panorama historique d’un champ de recherches et perspectives critiques
Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes
In memoriam Georges Delarue (1926-2024)
« […] l’art de « faire du neuf avec du vieux » a l’avantage de produire des objets plus complexes et plus savoureux que les produits « faits exprès » : une fonction nouvelle se superpose et s’enchevêtre à une structure ancienne, et la dissonance entre ces deux éléments coprésents donne sa saveur à l’ensemble. Les visiteurs de l’ancienne conserverie de San Francisco, de la faculté des lettres d’Aarhus [ou des Grands Moulins de Paris, où est né le projet de ce livre] ou du théâtre de la Criée à Marseille l’ont sans doute éprouvé pour leur plaisir ou déplaisir, et chacun sait au moins ce que Picasso faisait d’une selle et d’un guidon de bicyclette. »
Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Le Seuil, 1982, coll. « Points », p. 556.
« On éprouve un vif plaisir à entendre la ritournelle d’un air qui chante déjà dans la mémoire. »
Francisque Sarcey, 1893, cité par Tommaso Sabbatini, « Airs connus et musique d’opérette dans la féérie parisienne après 1864 »
« Allez, la mèr’ Michel vot’ chat n’est pas perdu.
Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tralalala
Sur l’air du tradéridératralalala ! »
1Depuis quelques années, on constate un engouement particulier pour l’insertion de chansons dans les films ou sur la scène des théâtres. Les reprises de tubes et les chansons « sur l’air de » font irruption dans le spectacle pour favoriser la connivence avec la salle1. Marion Bierry, dans sa mise en scène du Menteur de Pierre Corneille (au programme des épreuves anticipées de français du baccalauréat et de l’agrégation de Lettres en 2025) n’hésite pas à « comédie-musicaliser » la pièce pour la rapprocher du public d’aujourd’hui. Elle adapte le texte de Corneille sur la chanson de Barbara, Dis, quand reviendras-tu ? et réécrit les paroles d’airs connus, Y’a d’la joie et Revoir Paris de Charles Trenet – Dorante est un étudiant en droit fraîchement débarqué de Poitiers à Paris –, ou Les Chemins de l’amour de Poulenc, jouant d’effets d’intertextualité2. Les tubes, ces « hymnes intimes3 » comme les appelle Peter Szendy, ont cette capacité à convoquer une mémoire individuelle et collective chargée d’affects et à « forger une communauté4 ». Les metteurs en scène jouent ainsi sur « le pouvoir de reconnaissance immédiat caractéristique du tube, ainsi que sur sa puissance de remémoration5 », mais aussi sur sa « plasticité », sa « labilité », « sa capacité à traverser le temps, les générations et les cultures », qui font de lui un matériau propice à de multiples appropriations et résistant à toute « assignation figée6 ».
2Sur tous les continents, à toutes les époques, d’innombrables poètes ont composé et composent encore leurs vers en les chantant sur un air préexistant. Les spécialistes utilisent volontiers le mot timbre pour désigner cet air connu à partir duquel on écrit et on chante de nouvelles paroles, sur l’air de… Cette pratique, peut-être universelle, a engendré un foisonnement considérable de textes et de recueils, qui relèvent à la fois du corpus poétique (ce sont des vers) et du corpus musical (ils sont destinés au chant).
3Attesté plusieurs siècles avant notre ère et déjà fort apprécié au Moyen Âge, le principe est très largement repris au cours des siècles suivants. La pratique consistant à composer et chanter sur l’air de… est commune à toutes sortes de répertoires : des chants et des cantiques savants ou populaires, des chansons spirituelles, des noëls7, des messes. On la retrouve sur la scène des théâtres, dans les sociétés de caveaux, les goguettes et autres cabarets de chansonniers. Elle inspire les chansons de soldats8, celles des détenus des camps de concentration9, les chants de manifestations10, les spots publicitaires, les banquets et autres cérémonies festives. Les motivations sont diverses : reprise d’un air à une époque où la question des droits d’auteur ne se posait pas, démarche didactique ou prosélyte sollicitant la mémoire collective, subversion parodique à visée politique, exploitation d’une chanson à succès (un tube) dans une autre langue (l’exercice peut alors relever de la traduction, de la paraphrase poétique), etc.
4Face à cet immense corpus, c’est un questionnement interdisciplinaire qui inspire le présent ouvrage. Il propose de nouveaux éclairages à la fois littéraires, historiques, musicologiques, ethnomusicologiques, sociologiques et anthropologiques sur ce procédé infiniment fécond, en remettant en question, le cas échéant, la dimension supposée « mineure » des genres auxquels cette pratique a donné naissance, sans jamais perdre de vue la visée essentielle de la performance. Sont envisagés notamment l’étude et la comparaison des sources (chansonniers édités ou manuscrits, recueils de la Bibliothèque bleue ou de colporteurs), la question des supports (petits fascicules, feuilles volantes11…), les aspects sociaux (acteurs, lieux, interprètes, destinataires) et artistiques (écriture musicale, poétique), les relations avec les différents genres musicaux, les mécanismes intertextuels et intermusicaux, la place de ce type de productions poético-musicales dans la réflexion théorique littéraire, l’usage de timbres militants, prosélytes, confessionnels ou éducatifs, les réappropriations de timbres « anciens » dans leurs différents contextes, sacré ou profane, public ou privé, de rue ou spectaculaire. Il s’agit donc du premier ouvrage de cette envergure éclairant de manière interdisciplinaire différents corpus à chanter sur l’air de…, envisagés dans toute leur diversité, depuis les premiers témoignages jusqu’à nos jours, en prenant en compte la dimension internationale du phénomène (même si le corpus en langue française est largement privilégié)12.
5Le projet de ce livre est né en 2019-2020, à l’Université de Paris, devenue depuis Université Paris Cité, dans le cadre du séminaire issu du projet IDEX-Emergence intitulé L’Air du temps, qui a réuni, quelques mois avant le premier confinement, des spécialistes de différentes disciplines intéressés par la chanson de toutes les époques, et souhaitant l’appréhender dans une perspective historique ouverte sur le temps long13. Comme la nouvelle question au programme de l’agrégation de musicologie 2020, « Composer “Sur l’air de…” : intertextualité et intermusicalité dans les genres musicaux » rejoignait nos préoccupations, nous avons rapidement décidé d’organiser un colloque sur le sujet et de lancer un appel à communications. Surpris par le succès que cet appel a rencontré et par le nombre important de propositions reçues, nous avons pu mettre en œuvre un colloque de quatre jours en deux volets14, à la mesure de l’ampleur du phénomène de la composition sur timbre, mais aussi de l’intense curiosité qu’il suscite aujourd’hui dans de nombreuses disciplines.
Les mots pour le dire : questions de terminologie
6Une première façon d’aborder le sujet est de s’interroger sur la terminologie requise. On privilégiera dans cette introduction les syntagmes « pratique du timbre », « composition sur timbre ». La question terminologique est posée dès 1979 dans un article de Robert Falck intitulé « Parody and Contrafactum. A Terminological Clarification15 » : laissant entendre que contrafactum est privilégié pour les compositions antérieures à 1500, et parodie pour les œuvres plus récentes, il retrace utilement l’histoire de ces appellations sans toutefois prescrire en définitive un choix terminologique unique jugé plus adéquat. Quelques années plus tard, dans sa somme intitulée La Musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, la musicologue Denise Launay décrit la technique du contrafactum dans un développement intitulé « Les parodies ou contrafacta », où ces termes sont employés comme des synonymes parfaitement interchangeables16. Sans vouloir ici imposer une terminologie plus rigoureuse, tentons du moins de retracer le parcours sémantique des principaux termes qui nous intéressent.
Contrafactum et contrafacture
7La musicologie allemande adopte la notion de Kontrafaktur dès le début du xxe siècle. La thèse de Kurt Hennig, Die geistliche Kontrafaktur im Jahrhundert der Reformation (1909)17, inspire l’article « Contrafactum » du Harvard Dictionary of Music en 1945. Le musicologue allemand Friedrich Gennrich contribue à élargir l’emploi du terme contrafactum dans son livre Die Kontrafaktur im Liedschaffen des Mittelalters (Francfort, 1965). La définition qu’il en donne est la plus extensive qui soit et ne comporte aucune limite chronologique : « Nous appelons contrafactum le procédé consistant à donner de nouvelles paroles à une mélodie préexistante18. » D’autres critiques préfèrent employer le terme au sens de « substitution de texte et de mélodie entre répertoire profane et répertoire religieux, ou vice-versa19 ». Par la suite, dans l’article « Contrafactum (pl. Contrafacta) » du Guide de la musique du Moyen Âge, le musicologue anglais Nigel Wilkins propose la définition suivante :
Il s’agit de la substitution d’un nouveau texte à l’ancien dans une composition vocale, sans toutefois que la musique en soit sérieusement modifiée. Cette technique se pratiquait souvent chez les troubadours et trouvères des xiie et xiiie siècles. Dans leurs œuvres, une même mélodie est souvent associée à des textes différents20.
8Le musicologue précise utilement la définition en recourant à l’idée de « composition vocale », c’est-à-dire de polyphonie de son point de vue de médiéviste (cum-ponere). Toutefois, dans un article de 2015, Christelle Chaillou-Amadieu et Anne-Zoé Rillon-Marne rappellent que contrafactum n’apparaît que dans de rares sources musicales au xve siècle ; elles émettent donc de vives réserves sur la pertinence du concept pour le Moyen Âge, mais finissent par conclure que « contrafactum est toujours employé faute de mieux21 ».
9Aujourd’hui, le terme contrafactum reste surtout employé pour les compositions sur timbre du Moyen Âge et parfois de la Renaissance22. L’usage musicologique le plus rigoureux réserve le terme à la réécriture de chansons sur des polyphonies, en partition. On peut juger son emploi plus pertinent à la Renaissance, après que Johannes Tinctoris, l’auteur du premier dictionnaire de termes musicaux, a nommé res facta ou res factae ce que nous appelons polyphonie, dans son Liber de arte contrapuncti de 147723. Sur cette base étymologique, on peut donc légitimement nommer contrafacta ou contrafactures les publications de polyphonies assorties d’un nouveau texte tel qu’on les pratique parfois au xvie siècle (au sens strict, en effet, pour qu’il y ait contrafacture, il faut qu’il y ait d’abord facture, choses faites, c’est-à-dire une première composition, et pas seulement un air). Isabelle His propose donc cette définition : « reprise à l’identique d’une polyphonie préexistante qu’on a déshabillée de son texte pour la revêtir d’un nouveau de même structure24 ».
10À propos de ces termes, on peut s’étonner au passage que l’étude de la composition sur timbre et l’emploi critique des notions de contrafactum et contrafacture aient davantage nourri jusqu’ici les études musicologiques que les études littéraires, alors qu’il s’agit principalement d’une pratique textuelle. Dans le Guide de la musique du Moyen Âge et le Guide de la Musique de la Renaissance, ouvrages pluridisciplinaires pourtant coordonnés par une collègue littéraire (Françoise Ferrand), les deux articles sur le contrafactum sont confiés à des musicologues. Alors qu’on trouve un article contrafactum dans le fameux New Grove Dictionary of music and musicians25, dans le Dictionnaire encyclopédique de la musique de l’université d’Oxford (1983 ; trad. fr. « Bouquins », 1988) ou dans le Vocabulaire de la musique de la Renaissance de Philippe Vendrix (Minerve, 1994), la plupart des dictionnaires littéraires26 n’ont pas d’entrée comparable. Seule exception, l’article « Contrafacture » du Lexique des termes littéraires (Livre de Poche, 2001), dû à Emmanuel Bury, mais qui croit devoir en limiter la pratique au Moyen Âge.
11L’historien de la musique Gérard Le Vot adopte l’un des premiers en français ce terme encore rare de contrafacture (calque de l’allemand Kontrafaktur) mais l’usage qu’il en fait n’est pas clairement distinct de la notion de parodie : « La contrafacture, d’origine toute musicale, est certainement la technique qui illustre le mieux l’emploi contrasté des registres. Par la rupture de l’accord initial entre la musique et le poème, une mélodie ancienne s’adaptant sur un texte nouveau, elle se rapproche souvent de la parodie. Le meilleur témoignage en est l’une des contrafactures (Or i parra) – de la séquence religieuse de la Nativité, Laetabundus, prose dont la mélodie se trouvera affublée d’un texte de chanson à boire, entrecoupé çà et là des exclamations latines originales […]27 ».
12Notons qu’au xvie siècle, alors que la composition sur timbre, stimulée par les progrès de l’imprimerie, connaît un essor sans précédent (on y reviendra), aucun terme spécifique ne s’impose (ni dans les dictionnaires, ni dans les titres de pièces ou de recueils, ni dans l’usage courant des amateurs) pour désigner clairement les chansons inspirées par cette technique de composition. Selon Falck, ce n’est qu’au xviiie siècle qu’on aurait senti le besoin de donner un nom à cette pratique courante28. En réalité, c’est plutôt dès la seconde moitié du xviie siècle que des termes apparaissent pour nommer ce qui s’apparente alors à un véritable phénomène de mode.
Vaudeville
13Le terme vaudeville connaît aussi une histoire complexe. Il désigne, depuis le début du xvie siècle, sous la forme « vau de ville29 » ou « voix de ville30 », une chanson monodique à couplets31, de style populaire, s’opposant aux chansons polyphoniques plus savantes32. Jehan Chardavoine, qui donne en 1576 un recueil de « voix de ville » les définit comme « chansons que l’on danse et que l’on chante ordinairement par les villes33 ». Il pointe ainsi la diffusion de ce type de chanson parcourant tous les milieux, mais aussi son style simple lié à la danse. Cette acception perdure au xviie siècle et Marin Mersenne insiste sur la facilité du vaudeville :
la chanson que l’on appelle Vaudeville est la plus simple de tous les airs et s’applique à toute sorte de poésie que l’on chante note contre note sans mesure réglée […] sans accord ou consonances des autres parties, parce que faire une chanson signifie simplement mettre en chant, ou donner le chant à quelques paroles. Or cette grande facilité fait appeler les chansons Vaudevilles, parce que les moindres artisans sont capables de les chanter […]34.
14Quand le mot en vient-il à désigner aussi plus spécifiquement un air populaire (au sens de connu d’un grand nombre de personnes) sur lequel on greffe de nouvelles paroles ? L’Art poétique (1674) de Boileau fournit peut-être l’une des premières occurrences connues de cette acception :
D’un trait de ce poème en bons mots si fertile,
Le Français né malin forma le Vaudeville,
Agréable indiscret, qui conduit par le chant,
Passe de bouche en bouche, et s’accroît en marchant.
La liberté française en ses vers se déploie.
Cet enfant de plaisir veut naître dans la joie35.
15On peut en effet hésiter ici sur le sens précis de « ce poème […] conduit par le chant » : s’agit-il simplement de l’air qui porte le texte de bouche à oreille et assure le succès de la chanson, ou bien est-ce déjà l’évocation d’une composition poétique conduite par un chant, c’est-à-dire inspirée d’un air préexistant ? Un exemple donné par le Dictionnaire de Furetière suggère qu’il a peut-être entendu cette acception nouvelle : « Chanson que le peuple chante. C’était autrefois un air de cour, maintenant c’est un vaudeville. Les chansons que l’on chante sur le Pont-Neuf, dans les rues, sont de vrais vaudevilles36. » Le mot semble donc évoquer dès la fin du xviie siècle la création de nouvelles paroles sur un air plus ancien, ici un air de cour. Cette pratique s’accompagne alors d’une visée satirique : en lien avec l’actualité, le vaudeville sert souvent à chansonner des personnalités, leurs aventures ou leurs défauts. Dans Le Vaudeville, opéra-comique allégorique de Panard de 1737, le Vaudeville est l’amant de la Foire, le fils de la Joie et de Bacchus.
16Le terme désigne également à la fin du xviie siècle l’air de musique originale qui clôt une comédie et qui comporte plusieurs couplets chantés par des solistes. On trouve ce sens sous la plume de Charles Dufresny, dramaturge et compositeur de l’Ancien Théâtre Italien et de la Comédie-Française, qui ambitionne que ses propres vaudevilles accèdent au statut de tubes. Sa Noce interrompue, en 1699, mêle les deux acceptions du terme : « les Violons jouent le Vaudeville : ensuite Adrien chante ces paroles […] Autres Couplets sur l’air : Compère Gervais37 ». La consécration pour un vaudeville final est en outre de devenir un timbre repris « sur l’air de », autrement dit un « vaudeville » dans l’autre sens du terme. Certains vaudevilles parmi les plus célèbres proviennent en effet du vaudeville (final ou non) de comédies. C’est le cas par exemple d’Adieu paniers vendanges sont faites, issu des Vendanges de Suresnes de Dancourt et Gillier, représentée le 15 octobre 1695 à la Comédie-Française et dont deux couplets sont cités in extenso dans La Clef des Chansonniers38, du Cahin Caha de Jean-Joseph Mouret, lequel provient du Tour de Carnaval de d’Allainval joué sur la scène des Italiens en 1726 et qui devient immédiatement un vaudeville très populaire39, ou du vaudeville final du Mariage de Figaro de Beaumarchais et Antoine-Laurent Bauderon40. On appelle parfois les vaudevilles à « tra la la41 », des « flonflons » du nom d’un air célèbre au point d’être devenu le terme générique qui désigne l’ensemble des vaudevilles de ce type, ou des « ponts-neufs », puisque le pont et ses alentours étaient des lieux importants de la diffusion des timbres. Dans La Rencontre des opéras de Louis Fuzelier, « Les Caractères de la Musique du Pont-Neuf [sont] composés par Monsieur Flonflon, inspecteur général de la Musique ambulante de Paris et pourvoyeur des opéras modernes42. »
Parodie
17C’est également dans le dernier tiers du xviie siècle que le mot parodie en vient à désigner le fait de mettre des paroles sur une musique préexistante43. Robert Falck relève son apparition en Allemagne dans un contexte chrétien avec les Geistliche Parodien Itzo frommen Christen zu Übung haüsslicher Andacht (Parodies spirituelles à l’usage des fidèles chrétiens d’aujourd’hui pour la prière domestique) de Gottfried Wegner, dit aussi Wegener von Dels (Cölln an der Spree, s. d., [1668-1669 ?]44). En France, Falck relève les titres Parodies bachiques, sur les Airs et Symphonies des Operas (Paris, 1695) et Nouvelles parodies bachiques melées de vaudevilles ou rondes de table (Paris, 1700-1702, 3 vol.). Grimarest explicite le terme en 1707 dans son Traité du Récitatif :
les musiciens admettent trois genres de paroles mises en musique : le récitatif ; l’air ; le canevas, ou la parodie. […] Les vers de l’air, ou du récitatif, se composent avant que d’appliquer les notes aux paroles : au contraire du canevas, ou de la parodie, qui sont des paroles que le poète applique à une musique déjà composée45.
18La parodie désigne donc à l’époque, soit des paroles nouvelles adaptées à un air connu, soit des paroles ajoutées à un morceau de musique instrumentale. En ce sens, tout vaudeville est déjà une parodie.
19C’est aussi le sens que lui donne Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de musique :
Parodie : air de symphonie dont on fait un air chantant en y ajustant des paroles. Dans une musique bien faite le chant est fait sur les paroles, et dans la parodie les paroles sont faites sur le chant : tous les couplets d’une chanson, excepté le premier, sont des espèces de parodies : et c’est, pour l’ordinaire, ce que l’on ne sent que trop à la manière dont la prosodie y est estropiée46.
20Pour Littré également, parodie désigne entre autres une « strophe lyrique composée tout exprès pour être chantée sur un air, sur une mélodie faite à l’avance. » Faut-il continuer de l’employer en ce sens ? Reconnaissons que le terme, qui fait par ailleurs l’objet de débats complexes, tant chez les musicologues que chez les littéraires47, peut prêter à confusion. Dans le langage courant, une parodie n’est pas nécessairement chantée, et dans le langage musicologique d’aujourd’hui le mot tend plutôt à désigner une composition musicale, « paraphrase contrapuntique d’un modèle polyphonique, sacré ou profane, qui inspire la création d’une nouvelle composition, notamment la messe48 ». C’est peut-être la raison pour laquelle le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey (Le Robert, 1992) juge vieillie l’acception du mot parodie qui nous intéresse : « Il a autrefois servi à désigner un texte destiné à être chanté sur une musique connue (1751). »
Timbre
21Dans le sens qui nous intéresse49, le mot timbre semble n’apparaître que dans la seconde moitié du xviiie siècle, avant d’être défini dans Les À propos de société ou chansons de Pierre Laujon (1776) : « l’on appelle timbre, en style de chansonnier, le refrain ou le vers qui sert à rappeler l’air d’une chanson50. » Quelques décennies plus tard, Capelle, fondateur du Caveau moderne, reformule la définition : « on entend par le mot timbre, la désignation d’un air quelconque, en citant le premier vers de la chanson ou du couplet qui lui a donné lieu51. » Pour un Laujon, un Capelle, ou tout autre parolier, rimeur ou adaptateur de ce monde musical, le vocable désigne donc un bref énoncé permettant l’identification de la structure musicale, le repérage de la ligne mélodique. C’est encore en ce sens restreint que l’entend le folkloriste Conrad Laforte52. Littré associe le terme à la pratique du vaudeville et de la parodie : « Premier vers d’un vaudeville connu, qu’on écrit au-dessus d’un vaudeville parodié pour indiquer sur quel air ce dernier doit être chanté. Mettre les timbres aux couplets d’un vaudeville. […] » On note que l’expression « vaudeville parodié » désigne curieusement pour Littré la pièce nouvelle (la parodie, l’hypertexte) composée en parodiant un vaudeville connu (hypotexte).
22Au début du xxe siècle, de nouveaux regards sont portés sur la définition de ce vocable : lors d’études sur les rapports textes/musiques dans le domaine de la chanson de transmission orale française, les spécialistes articulent quelque peu différemment leur réflexion. Ainsi, dans son ouvrage Notre chanson folklorique53, Patrice Coirault élargit l’acception du mot :
Dans notre sujet, timbre s’entend de tout air, vocal ou instrumental, préexistant aux paroles qui s’y joignent pour faire morceau de chant ou former une chanson. Il indique pareillement la formule verbale, plus ou moins courte, qui désigne l’air en question, quand on veut s’y référer ou bien l’utiliser à nouveau, et qui rappelle ou son premier emploi ou l’un de ses plus connus54.
23Cette nouvelle définition, double, recouvre donc aussi bien la formule « sur l’air de… » que le référent musical, la mélodie et son appellation. Bien qu’en parfait accord avec la proposition d’Hatzfeld et Darmesteter55, cette définition ne fait pourtant pas l’unanimité des folkloristes. Croyant la dégager d’éventuelles confusions dues à la présentation, sous un même vocable, de deux acceptions distinctes, Henri Davenson56 reprend à son compte la nuance terminologique proposée par Font dans ses travaux sur Favart :
On appelle vaudeville une chanson nouvelle composée sur un air déjà connu ; l’air lui-même se nomme fredon ; il est souvent désigné par le titre ou le premier vers des anciennes paroles : cette étiquette est proprement ce qu’on appelle timbre, mot abusivement employé, au sens de fredon57.
24Ce dernier terme, aux xviie et xviiie siècles, désigne en réalité les diminutions ou les ornements d’un chant, parfois dans un sens péjoratif58. C’est pourquoi, inconnu dans le sens de mélodie au lexicographe, le terme fredon ne sera que peu retenu par la postérité59.
25Enfin le TLFI désigne par ce mot timbre non pas la mention de l’incipit ou du refrain mais l’air lui-même : « Motif ou air connu sur lequel on ajoute un texte, pour créer une nouvelle chanson60. »
26C’est encore l’acception que retient Daniel Ménager dans le Lexique des termes littéraires du Livre de Poche : « Air préexistant, sur lequel on applique des paroles nouvelles61 ». L’article pourrait laisser entendre que le terme concerne surtout la chanson de la Renaissance : « on l’utilise fréquemment dans les études sur la poésie et la musique du xvie siècle. À cette époque, en effet, la chanson connaît un grand essor. » Comme les seuls exemples mentionnés sont les Chansons spirituelles de Marguerite de Navarre, les chansons de la Réforme et le « supplément musical » des Amours de Ronsard, présenté comme une entreprise sans lendemain, le lecteur pourrait croire que l’histoire du timbre s’arrête là, d’autant que le long article « vaudeville » du même lexique n’indique pas que nombre de vaudevilles sont des chansons sur timbre.
Chansonnier
27Le terme chansonnier a déjà fait l’objet d’une étude approfondie dans la thèse du lexicographe Jean Nicolas De Surmont, Chanson. Son histoire et sa famille dans les dictionnaires de langue française. Étude lexicale, historique et théorique (Berlin et New York, De Gruyter, 2010). Sans revenir ici sur les acceptions les plus anciennes (« personne gaie qui chante tout le temps » (Maurice de La Porte, Epithetes, 1571 ; ou « faiseur de chansons » au sens large, notamment « artiste qui compose des chansons, parole et musique », xviie siècle), le mot nous intéresse à double titre. D’une part, les recueils de chansons écrites sur un timbre sont souvent appelés chansonniers ou paroliers ; d’autre part, chansonniers est parfois employé pour désigner spécifiquement les auteurs et interprètes de chansons sur timbre qui se produisent dans les cabarets. Nous tenterons de mieux cerner l’histoire de ces emplois.
28L’emploi de chançonnier pour « recueil de chansons » est attesté une première fois dans l’inventaire des biens de Clémence de Hongrie (1293-1328), dressé à Paris en 1328. On peut y lire62 : « 225. Item, un chançonnier de mons. Gasse Brulé, présié 20S ». Toutefois cette occurrence demeure isolée. Il semble qu’il faille attendre ensuite quatre siècles pour trouver des nouvelles attestations de chansonnier au sens de « recueil ». Les fameux « chansonniers » dits de Maurepas (BnF, ms. fr. 12616-12659) et de Clairambault (BnF, ms. fr. 12686-12743) achevés vers le milieu du xviiie siècle ne portent pas à l’origine le titre de Chansonnier. C’est leur éditeur Émile Raunié qui les renomme ainsi un siècle plus tard63. Toutefois, la table manuscrite du chansonnier de Clairambault est intitulée « Table générale des noms et du premier vers des Chansons, qui sont dans les volumes du Chansonnier général » (BnF, ms. fr. 12737, f. 31). Comme l’indique De Surmont, ce pourrait être « l’une des premières occurrences de chansonnier pour dénommer un recueil64 », mais nous n’avons pu dater avec précision l’établissement de cette table.
29La Clef des Chansonniers ou Recueil des vaudevilles depuis cent ans et plus (Paris, Ballard, 1717) constitue un jalon important dans l’histoire de la composition sur timbre. Si la « clef » renvoie à la musique notée – comme dans la Clé du Caveau, à l'usage de tous les chansonniers français, des amateurs, auteurs, acteurs du vaudeville et de tous les amis de la chanson, par C***, du Caveau moderne (1811)65 – le mot « chansonnier » est plus ambigu. Jean-Nicolas De Surmont affirme d’abord qu’on serait en présence de la première attestation de chansonnier au sens de recueil, puis, un peu plus loin, que le titre indique « un ouvrage permettant aux chansonniers d’exercer leur activité en leur fournissant les airs et vaudevilles pour accompagner leurs textes66 ». Le mot chansonnier désigne-t-il en 1717 les recueils de chansons, ou ceux qui les utilisent ? Avouons que l’indécision demeure. Il n’est pas impossible que Ballard ait voulu jouer subtilement d’une polysémie naissante.
30À notre connaissance, les premiers livres imprimés portant le titre de Chansonnier (que n’indique pas De Surmont) sont Le Chansonnier françois ou Recueil de chansons, ariettes, vaudevilles et autres couplets choisis67 dont le premier tome paraît en 1760 ; puis Le Petit Chansonnier françois, ou Choix des meilleures chansons, sur des airs connus [s. n.] (Genève et Paris), 1778-1780 (2 vol.) compilés par Claude-Sixte Sautreau de Marsy. Signalons encore le Chansonnier républicain et le Décadaire pour la 2e année de la République française (Paris, 1793). Enfin, selon De Surmont, l’Académie consacre cet usage à la fin du siècle : « l’édition de 1798 du Dictionnaire de l’Académie française constitue la première attestation métalinguistique de chansonnier dans le sens de “recueil de chansons68”. » Le terme devient fréquent au xixe siècle, surtout sous la plume des compilateurs, dans les titres de nombreux recueils de chansons sur timbre69. Après ce succès entre 1760 et 1900, la fréquence du mot chansonnier au sens de recueil tend à décliner au cours du xxe siècle, en même temps que déclinent les « sociétés chantantes » et que progressent les techniques d’enregistrement.
31À partir du xviiie siècle également, le terme chansonnier sert à désigner spécifiquement celui ou celle qui écrit des paroles de chanson par opposition à l’auteur de la musique préexistante. Cette acception spécifique est enregistrée en 1791 par Nicolas-Étienne Framery, Pierre-Louis Ganguené et Jérôme Momery dans la partie Musique de leur Encyclopédie méthodique (Paris, Panckoucke, 1791-1818), s. v. chansonnier :
Celui ou celle qui fait des paroles de chanson. On ne le dit point du musicien, dit M. de Castilhon70 : cela vient sans doute de ce que la plupart des chansons se font sur des petits airs déjà connus, et qu’on fait une chanson d’un air qui n’avait pas cette destination primitive. Les derniers chansonniers, les plus aimables et les plus piquants de ce siècle étaient MM. Laujon et Collé71.
32C’est encore cette acception liée à la pratique de la chanson sur timbre qu’illustre en 1811 La Clé du Caveau :
il arrive quelquefois que tels airs placés dans une pièce qui ne réussit point, ou faits pour des chansons peu connues, ne font leur entrée dans le monde qu’à l’aide de nouvelles paroles ; mais on voit souvent encore que tels autres airs parfaitement bien accueillis à leur création, sont choisis par une foule de chansonniers, jaloux de leur donner un nouveau nom72.
33Selon le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey ou le dictionnaire TLFI, que cite De Surmont, l’acception aujourd’hui courante « Artiste qui chante ou dit des couplets satiriques ou humoristiques de sa composition dans les cabarets, les cafés, un caveau » ne trouverait sa première attestation connue que dans le Journal des frères Goncourt, le 21 février 1862, à propos de Gustave Mathieu :
Sur le boulevard, en revenant, Flaubert et nous, nous tombons sur un couple de gens épanouis, comme des gens après boire. C’est Montselet qu[i] nous présente son ami, le chansonnier Gustave Mathieu, une tête de Don Quichotte, sculptée dans un nœud de bois au bout d’une canne. Nous allons nous asseoir, boire et causer à la taverne de Peters73.
34Pourtant, cet usage spécifique du terme (ou un usage très voisin) est attesté bien plus tôt et plus explicitement dans de nombreux textes produits par et pour les « sociétés chantantes » où les chansonniers se produisent et rivalisent dès le début du xixe siècle. Ainsi, les premiers vers du Chœur d’ouverture de la Lice Chansonnière dit aussi Chant de la Lice composé en 1835 par Blondel n’évoquent pas explicitement la pratique du timbre mais suggèrent bien l’atmosphère des joyeuses beuveries qui rassemblent les « chansonniers » dans les cabarets, et l’art de la satire qu’ils cultivent :
Gais chansonniers et buveurs rubiconds,
L’heure est sonnée, il faut entrer en lice,
Puisque l’ivresse enfante la malice,
Sans plus tarder, saisissons nos flacons. […]
Vous que l’on voit menacer à la ronde
Les intrigants dont fourmille ce monde
De votre fronde (bis)
Lancez gaîment les pierres, mes amis :
Cependant ne tuons personne ;
Prudemment que chacun chansonne74 […].
35Ces vers établissent également le lien qui s’impose entre cette acception spécifique de chansonnier (auteur de chansons satiriques) et le verbe chansonner, fréquent aux xviiie et xixe siècles au sens de « railler dans des chansons75 », le plus souvent des chansons sur timbre.
36Quoique très répandu dès le xixe siècle, ce sens spécifique de chansonnier n’est finalement inscrit dans les dictionnaires qu’un siècle plus tard : la définition du Grand Larousse encyclopédique, « celui qui compose ou improvise des chansons, des monologues satiriques, des sketches, et qui se produit sur des scènes spécialisées, dans des cabarets » (1960), est reprise littéralement dans le Grand Robert en 1989.
37Enfin, dans un ouvrage récent à propos du Chat Noir, on trouve cette précision lexicale bienvenue :
Le chansonnier se distingue du simple chanteur par le fait qu’il est l’auteur du texte qu’il interprète sur sa propre musique ou, le plus souvent, sur une mélodie préexistante. Les textes [d’Aristide Bruant] étaient donc chantés « sur l’air de… ». L’un de ses premiers succès porte le nom même du cabaret Le Chat Noir. Le poème est écrit par Bruant sur l’air occitan Aqueros Montagnos (1884)76.
Goguette
38Enfin, c’est pendant la Restauration, au plus tard en 1818, que le terme goguette (déjà riche d’une longue histoire) en vient à désigner à Paris les « sociétés chantantes qui se tiennent dans les cabarets » (Littré), puis par métonymie le cabaret lui-même77. Après une longue éclipse, les goguettes refont leur apparition à Paris à la fin du xxe siècle. En 1992 Christian Paccoud crée dans la salle de son café La Folie en tête, dans le quartier de la Butte-aux-Cailles, la goguette de La Cour des ânes. Tandis qu’émergent avec succès de nouvelles goguettes, le Limonaire à Paris crée en décembre 2004 la Goguette des Z’énervés78, une scène ouverte qui se tient chaque lundi avec un musicien accompagnateur. C’est dans ce contexte que le mot goguette, notamment sous l’impulsion d’Annie Legouhy et des Goguettes en trio (mais à quatre)79, en vient enfin à désigner la chanson sur timbre qu’on y interprète80. Selon la définition qu’en donne David Desreumaux en 2015 : « tu prends un tube, tu gardes la musique et tu changes les paroles. Et tu as ta goguette81. »
« Chanter sur l’air de » : esquisse d’un panorama historique
39Il est courant de désigner la composition sur timbre comme un phénomène universel82. Peut-être faudrait-il nuancer cette idée, du moins s’interroger sur l’extension de cette pratique dans l’espace et dans le temps. Sans avoir ici l’ambition de proposer un véritable panorama historique qui reste à établir, on aimerait cependant poser quelques jalons en ce sens, en indiquant notamment les événements qui paraissent les indices d’une évolution des pratiques. Au passage, on donnera un aperçu des principaux travaux critiques sur chacun des corpus évoqués.
40S’il est plus que probable que la pratique de la composition de nouvelles paroles sur un air donné soit aussi ancienne que la transmission orale de chansons, il faut d’abord se demander quelles origines la tradition savante assigne à cette pratique.
Des origines très anciennes
41À notre connaissance, les plus anciens textes connus attestant la composition de paroles sur un air préexistant semblent les psaumes 22 (Vulgate 21) et 56 (55) : pour chacun d’eux, la suscription qui constitue le premier verset mentionne un timbre, « le titre de la chanson sur laquelle on chantait le psaume83 » : respectivement « Biche de l’aurore » et « La colombe du silence des éloignés » (ou « La colombe des dieux lointains », « La colombe des térébinthes lointains », selon les traductions). On sait la difficulté persistante de dater avec certitude la plupart des psaumes et les controverses des exégètes imposent la plus grande prudence84. Toutefois, ces deux textes, notamment le premier, qui semble antérieur à la destruction de Jérusalem (587 av. J.-C.), pourraient faire remonter la première attestation de la pratique du timbre au vie siècle avant Jésus-Christ voire au-delà.
42C’est ensuite en Chine que la pratique est attestée, et ce dès le haut Moyen Âge85. À partir du iiie siècle, les lettrés du Yuefu 樂府 (Bureau de la musique) organisent une collecte de chansons folkloriques dont certaines reçoivent déjà de nouvelles paroles. Sous la dynastie des Tang (618-907), plusieurs centaines d’airs sont répertoriés ; dès le ixe siècle, des lettrés composent sur ces airs, sous le nom de ci, de nouvelles paroles, le plus souvent amoureuses, parfois franchement érotiques, en respectant un schéma prosodique donné. Sous les Tang, que ce fût par dédain ou par pudeur, les lettrés répugnent à inclure les ci dans leurs propres recueils. Mais la compilation intitulée Huajian ji 花間集 (Parmi les fleurs, 940) marque une étape décisive dans l’histoire du genre : ce recueil de vers à chanter, soigneusement organisé en dix livres, constitue la première compilation de ces quzi ci 曲子詞/曲子辭 (« paroles de chanson » également dits ci 詞 (« paroles »), composés par dix-huit poètes des ixe et xe siècles. Ce travail de compilation semble un geste symbolique qui accorde au ci la dignité d’un genre littéraire86.
43Par la suite, la performance des ci devint une activité culturelle prisée par l’élite savante de la dynastie des Song (960-1279), et encore bien au-delà. À titre d’exemple, on peut citer ce conte érotique chinois du xviie siècle, Le Poisson de jade et l’épingle au phénix, où plusieurs « poèmes à chanter sur l’air… » sont enchâssés dans le récit. Dès les premières pages, l’échange des objets symboliques éponymes entre les deux héros est ainsi mis en valeur :
Détachant de sa chevelure une épingle en or ornée d’un phénix, la jeune fille prit un pinceau et composa ce poème à chanter sur l’air Amertume sur le fleuve Xijiang […]. Quand elle eut terminé, elle lui remit l’épingle […]. Xu Xuan prit le bijou avec le plus grand respect et à son tour tira de sa manche un éventail, duquel il détacha une pendeloque de jade en forme de poisson. Puis, prenant lui aussi le pinceau, il composa un autre poème à chanter sur l’air Un ciel de perdrix […]87.
44On mesure à quel point ces mentions de timbres dans le conte produisent une connivence avec le lecteur qui connaît les chansons et peut ainsi chanter en lisant à haute voix.
45En Occident, on est frappé d’observer que les auteurs de chansons spirituelles de la fin du xvie et du début du xviie évoquent des précédents très anciens, mais sans jamais remonter jusqu’à l’Antiquité classique, ni mentionner les Psaumes (dont ils ne semblent pas savoir que les suscriptions hébraïques constituent des indications de timbre). C’est donc à Ephrem de Nisibe, diacre syrien du ive siècle, que le poète Odet de La Noue attribue les premières chansons sur timbre :
Theodoret, ancien Théologien, raconte au 27e chapitre du IVe livre de son Histoire ecclésiastique, qu’environ le temps de l’empire de Valentinian & de Valens […], un certain Harmonius composa des chansons profanes accommodées à la musique fort douce, dont plusieurs furent séduits et tirés à perdition. Mais Dieu […] suscita en même temps un excellent personnage nommé Ephraim, lequel […] changea la lettre méchante des chansons d’Harmonius, et y appliqua un sens spirituel et à la louange de Dieu, remédiant (dit Theodoret) joyeusement et utilement au mal que ce poète lascif avait fait88.
46Les sources de cette information paraissent dans le traité d’un autre auteur de chansons spirituelles, le jésuite Michel Coyssard (sur lequel on reviendra), qui cite successivement l’Histoire ecclésiastique de Nicéphore (livre 9, « sur la fin du chap. 16 »), l’Histoire tripartite de Théodore le lecteur (VIII, 6), puis les deux sources principales de ces derniers, l’Histoire ecclésiastique de Sozomene (III, 15) et celle de Théodoret de Cyr (IV, 29)89. De fait, Ephrem le Syrien a composé des hymnes lyriques et didactiques (madrāšê ܡܕܖ̈ܫܐ) en strophes variées de vers syllabiques (exploitant plus de cinquante schémas métriques différents)90. Chaque madrāšâ avait son timbre dit qālâ, un air traditionnel identifié par son premier vers.
47La pratique devient courante en Occident à partir du xiie siècle. Nigel Wilkins mentionne par exemple des laude spirituali italiennes du xiiie siècle, qui adaptent « des rondeaux portant à l’origine des textes profanes français », les chansons du Red Book of Ossory (xive)91 ou encore celles du Libre Vermell catalan, élaborées selon le même principe. Pour la France, on cite les chansons mariales de Gautier de Coinci92 (ca. 1177-1236) ou l’évolution du serventois (puisque le mot finit par désigner, à la fin du xiiie siècle, une chanson en l’honneur de la Vierge, calquée sur un modèle profane)93.
Vogue de la chanson sur timbre au xvie siècle
48Selon Adrienne F. Block, « Le xvie siècle était l’âge de la parodie94. » À vrai dire, rien n’indique qu’on l’ait moins goûtée par la suite. Reste que l’essor de l’imprimerie entraîne la prolifération de recueils sacrés et profanes dont nous donnerons tour à tour un aperçu, en nous concentrant ici sur l’exemple de la production française, une production considérable sur laquelle nous souhaitons attirer l’attention.
49En premier lieu, on voit se multiplier, dès la fin du xve siècle puis durant tout le xvie et bien au-delà, des recueils de noëls, d’abord manuscrits puis imprimés (à Paris, ensuite à Lyon, mais aussi, un peu plus tard au Mans et à Angers), généralement anonymes, qui visent à stimuler la piété populaire et procèdent presque tous de la technique de composition sur timbre, à partir de chansons de transmission orale95. Le premier auteur de noëls identifié et premier auteur de noëls imprimés semble le prêcheur franciscain Jean Tisserant96.
50Sous François Ier se développe à Paris l’impression de recueils de poésies à chanter sans musique notée (dits aujourd’hui chansonniers ou paroliers) : un genre désormais bien connu grâce aux répertoires établis par Brian Jeffery97. Les imprimeurs Jean Trepperel (entre 1512 et 1525) puis Alain Lotrian (entre 1525 et 1530) publient chacun six ou sept recueils différents. Ces petits livres de poche (12 × 9 cm en général) de quelques feuillets imprimés en caractères gothiques rassemblent uniquement des textes de « chansons » strophiques, une dizaine le plus souvent, après l’indication plus ou moins précise d’un timbre. Dans ces recueils anonymes, la thématique amoureuse est majoritaire, dans une tonalité souvent grivoise, voire franchement paillarde. Nombre de ces chansons présentent une structure narrative, et certaines sont inspirées par l’actualité : il s’agit alors de commémorer un événement notable en le racontant en vers sur un air connu98.
51La production de tels chansonniers connaîtra dans la seconde moitié du xvie siècle une deuxième vogue encore bien plus féconde, illustrée par la production considérable de deux familles de libraires, les Bonfons (à Paris) et Rigaud (à Lyon). Comme l’a montré Stéphane Partiot99, les publications parallèles et souvent similaires de ces deux librairies confirment l’existence d’un véritable « genre éditorial » qui connaît un succès considérable entre 1570 et 1588 avec un pic de production en 1585 à Paris (quatre recueils). Au total, on conserve au moins 55 recueils (22 parus chez Bonfons, 33 chez Rigaud), qui donnent les paroles de près de 1 300 chansons différentes. De nombreux éléments communs rapprochent ces chansonniers : petit format, formulation identique des titres, existence de séries désignées comme telles par les titres, mise en page standardisée, reprise de textes et de timbres d’un recueil à l’autre. Cette forme éditoriale commune, qui permet aux amateurs d’identifier ces paroliers, n’évolue guère après l’abandon tardif des caractères gothiques par la veuve Bonfons en 1572.
52À qui ces ouvrages sont-ils destinés ? L’enquête de Stéphane Partiot sur les catalogues de ces deux librairies montre leur intense activité de réédition bon marché (ils produisent les livres de poche de l’époque), et la publication de manuels pratiques destinés notamment à un public varié d’étudiants, de médecins, de juristes, de commerçants, sans oublier le milieu des imprimeurs eux-mêmes. Cette bourgeoisie urbaine constitue très certainement l’essentiel du public de ces paroliers, qui peuvent bénéficier aussi d’une diffusion plus large grâce au colportage et aux foires. L’étude des chansons dites « amoureuses » révèle d’autre part la place importante dévolue à l’énonciation féminine dans ces pièces et suggère l’existence d’un public-cible de chanteuses. Enfin la fréquence des pièces polémiques, majoritairement anti-huguenotes, permet quant à elle de cibler un public catholique proche de celui qui composera la Ligue parisienne à partir de 1576.
53La nouvelle base de données Trésor des Chansons de Langue Française (TCLF 16-17) mise au point par Alice Tacaille avec différents collaborateurs (dont Karine Abiven100, Tatiana Debbagi-Baranova, Stéphane Partiot, Paméla Zuker) permettra bientôt de consulter simultanément ces différents corpus101.
54On pourrait ajouter que tous les genres du théâtre des xve et xvie siècles (mystères, moralités, farces et sotties, comédies et tragédies) font une large place à la chanson, notamment sur timbre. Comme l’écrit Estelle Doudet, « la fréquence de la musique dans les spectacles de cette époque suggère qu’existait alors un répertoire lyrique ample et varié, des hymnes liturgiques aux airs divertissants, qui circulait intensément sur les tréteaux. » Entre autres usages de la chanson, l’autrice rappelle que « la contrafacture […] permettait d’adapter un texte actualisé à un timbre célèbre102 », la notoriété de l’air « facilitant la mémorisation de nouvelles paroles » et favorisant la connivence avec le public. Dans le théâtre savant, les chœurs des tragédies humanistes de la Renaissance sont souvent des compositions sur timbre.
55Dans un tout autre registre, la production pléthorique de sonnets à la Renaissance peut également être envisagée dans cette perspective : dès lors que le « supplément musical » des Amours de Ronsard (1552-1553) a proposé des timbres pour différentes formes de sonnets103 et que les musiciens du temps rivalisent dans la composition de nouvelles polyphonies sur ces poèmes de structure standardisée, chaque nouveau sonnet épousant la forme convenable peut être appréhendé comme une composition sur timbre et chanté par les amateurs.
« Voler les beaux airs au Diable » (xvie-xviiie siècles)
56La pratique du timbre à finalité religieuse, plus précisément la composition de paroles chrétiennes applicables à des airs de chansons profanes, connaît aussi à partir des années 1530 un succès croissant. À la démocratisation de la lecture et à l’essor de l’imprimerie (qui démultiplie les exemplaires parvenus jusqu’à nous) s’ajoute ici la montée en puissance des courants évangéliques et réformés, lesquels utilisent la chanson spirituelle comme un instrument de conquête.
57À la source de la Réforme française, la propagande du réseau évangélique autour de Marguerite de Navarre exploite volontiers les formes du lyrisme profane pour les détourner dans un sens sacré104. Les premiers évangéliques français savent que beaucoup de cantiques luthériens s’inspirent aussi de chants profanes. Mathieu Malingre, pasteur à Neuchâtel, comme Marguerite elle-même et son secrétaire Clément Marot perçoivent la valeur spirituelle et l’efficacité prosélyte de telles parodies : en exploitant le succès de chansons plus ou moins légères mais connues de tous, le poète mobilise l’énergie et le plaisir du chant (individuel ou choral) pour les orienter dans le sens d’une célébration qui les purifie et les sacralise ; il offre surtout au message évangélique un support rythmique et mélodique aussi plaisant à l’oreille que familier, dont la popularité servira, dans la bouche des « simples gens », l’expression collective d’une ferveur partagée. C’est ainsi que plusieurs mélodies populaires, déjà objet de variations profanes, servent de support aux premières traductions des Psaumes esquissées par Marot dans les années 1530, le poète lui-même n’hésitant pas à couler certains de ses psaumes dans le moule formel de ses propres chansons105.
58En 1533-1534, plusieurs publications successives de l’imprimeur Pierre de Vingle à Neuchâtel exploitent la technique du timbre au service de la propagande réformée : les Noelz nouveaux de Mathieu Malingre106, Sensuivent plusieurs belles et bonnes chansons, que les chrestiens peuvent chanter en grande affection de cœur et les Chansons nouvelles demonstrant plusieurs erreurs et faulsetez du même Malingre (qui signe ses chansons sous le voile de l’acrostiche). Plusieurs de ses textes sont republiés à Genève en 1545 par Jean Girard sous le titre Chansons spirituelles, pleines de louenges à Dieu de saincte doctrine et exhortations, pour edifier son prochain, tant vieilles que nouvelles (Genève, Jean Girard, 1545107). Ce faisant, Girard lance le titre qui sera repris par Marguerite de Navarre (ou du moins ses éditeurs) : certaines des Chansons spirituelles de la reine, composées sur les timbres de chansons populaires à la mode à la cour des Valois, paraissent à Lyon en 1547 à la fin des Marguerites de la Marguerite de Princesses108. La sœur de François Ier est ainsi non seulement la première femme à publier une œuvre littéraire de son vivant, mais aussi la première femme identifiée à composer des chansons sur timbres et à les voir éditer.
59Le même Jean Girard a publié entretemps l’un des plus importants recueils de chansons spirituelles, la Chrestienne Resjouyssance du pasteur Eustorg de Beaulieu (1546), qui ne rassemble pas moins de 160 chansons, dont 121 sur des timbres connus, notamment des chansons profanes de Marot. Beaulieu n’est pas seulement le premier auteur à signer clairement ses chansons sur timbre, et à s’expliquer en détail, dans une intéressante préface, sur sa pratique ; il excelle à spiritualiser un air connu en ne changeant que quelques mots, et en conservant autant que possible les rimes. Les vers célèbres de Marot
Tant que vivrai en âge florissant,
Je servirai d’amour le dieu puissant
60sont à peine modifiés :
Tant que vivrai en âge florissant,
Je servirai le Seigneur tout puissant […].
61La XXXIVe chanson, qui explicite le procédé et la visée qui l’inspire, résonne comme un mot d’ordre lancé aux poètes :
Vous tous aussi qui mettez votre entente
À composer et à vers mesurer,
Gardez le chant, mais la lettre insolente
En autre sens veillez soudain virer,
C’est à savoir à Dieu seul honorer :
Et à cela provoquez votre Muse,
Ou autrement chacun de vous s’abuse109.
62Le succès durable de cette pratique en milieu réformé a été bien étudié notamment, et de façon très complémentaire, par Jacques Pineaux, Denise Launay, Anne Ullberg, Isabelle His et Véronique Ferrer110. Denise Launay mentionne un recueil intitulé Tiers Livre où sont contenues plusieurs chansons spirituelles tirées du recueil des meilleures, tant anciennes que modernes, composées de divers excellens musiciens, desquelles avons changé la [sic] verbe lubrique en lettre spirituelle & chrestienne. Le tout à quatre parties (Genève, Simon du Bosc et Guillaume Guéroult, 1555) ; elle y voit le « plus ancien exemple connu, imprimé » ; sans doute faut-il comprendre qu’il s’agit du premier recueil de contrafacta proprement dits, c’est-à-dire polyphoniques, imprimés avec leur musique à quatre voix (pour ne pas imposer à l’interprète une connaissance préalable des timbres). Vingt ans plus tard, l’important ensemble réalisé par le pasteur Simon Goulart sur la base des mises en musique des Amours de Ronsard par Guillaume Boni (Sonetz de P. de Ronsard, Paris, Le Roy et Ballard, 1571) et par Anthoine de Bertrand (Premier et Second Livre des Amours de Ronsard, Paris, Le Roy et Ballard, 1576 et 1578) en christianise fort habilement le discours amoureux pour le transformer en prières111.
63Le succès de ce mode de propagande mis en œuvre par les Réformés ne tarde à pas à susciter chez leurs adversaires catholiques le désir de répliquer sur le même terrain. Avant même l’éclatement des guerres de Religion, et peut-être même dès 1525, Jehan Daniel n’avait pas craint d’exploiter la tradition des noëls pour en faire une arme contre les « hérétiques » avec ses Noelz nouveaulx au sous-titre rimé :
Chansons nouvelles de nouel
Composées tout de nouvel
Esquelles verrez les praticques
De confondre les hereticques112.
64Jusqu’à la fin du siècle, de nombreux chansonniers comportent à leur tour des « chansons nouvelles » visant à diaboliser les « hérétiques », à dénoncer leurs intentions perverses, voire à encourager leur extermination par tous les moyens (bûchers, batailles, massacres). Dans la masse de ce corpus généralement anonyme, trois auteurs particulièrement combatifs se distinguent. Ils ont signé nombre de chansons ou recueils de chansons sur timbre d’une grande véhémence : Pierre Doré, Artus Désiré et Christophe de Bordeaux.
65La Chanson nouvelle contre la secte Lutheriane, sur le chant de la chanson Les Bourguignons ont mis le camp devant la ville de Peronne (Paris, Jean André, 1545) voit l’entrée en lice (encore anonyme) du prédicateur dominicain Pierre Doré. Celui-ci persiste et signe avec le recueil des Cantiques déchantées [sic] ou Cantiques dechantez (Paris, Jehan Ruelle, 1549) censé transcrire les chants du peuple parisien lors des processions accompagnant l’entrée royale à Paris de Henri II et Catherine de Médicis en 1549113.
66Si Pierre Doré fait figure de pionnier de l’usage du timbre dans la riposte catholique, l’écho de son œuvre est sans commune mesure avec le retentissement des recueils du polémiste Artus Désiré, qui prend le relais au début des guerres civiles : Le Contrepoison des cinquante deux Chansons de Clement Marot, faulsement intitulées par luy Psalmes de David (Paris, Pierre Gaultier, 1560) parodie habilement les Psaumes de Marot et de Bèze mis en musique à Genève (autrement dit le Psautier Huguenot) pour les transformer en chansons satiriques contre les « hérétiques ». Le témoignage du jésuite Michel Coyssard inscrit l’œuvre d’Artus Désiré dans la continuité d’Ephraim et témoigne de la vive inquiétude suscitée chez les protestants par le succès de ces parodies : la chose, écrit-il,
fut si très odieuse aux Calvinistes, qu’ils en achetèrent tout ce qui restait de l’impression, faite à Lyon chez Michel Jove, 1562. Auquel ils firent tous les outrages qu’ils purent, jusques à lui arracher la moitié de la barbe, et le menacer de mort, s’il la réimprimait, ce que lui-même deux ans après me raconta114.
67La même haine des Huguenots inspire les chansons du polémiste Christophe de Bordeaux, ce bourgeois parisien dont l’historienne Tatiana Debbagi Baranova a exploré l’abondante production115. Son Beau recueil de plusieurs belles chansons spirituelles (ca. 1569), où l’appellation « chanson spirituelle » se retourne contre les Réformés, est suivi du Recueil de plusieurs belles chansons spirituelles, faictes et composées contre les rebelles et perturbateurs du repos et tranquilité de ce royaulme de France, avec plusieurs autres chansons des victoires qu’il a pleu à Dieu de donner à nostre tres-chrestien roy Charles, neuvième de ce nom, Paris, pour Magdeline Berthelin, [ca. 1573] ; les timbres anciens déjà mobilisés par Pierre Doré, mais aussi les airs de chansons de Ronsard parues entre temps y servent notamment à célébrer le récent massacre de la Saint-Barthélemy. Ce sera encore le cas dans Le Recueil des chansons des batailles et guerres advenues au Royaume de France, durant les troubles, par Christofle de Bordeaux, & autres. Augmentées de plusieurs chansons nouvelles (Paris, Nicolas Bonfons, 1575). Bien d’autres chansonniers publiés par les libraires Bonfons et Rigaud pendant le règne d’Henri III (1574-1589) et les guerres de la Ligue continuent d’exploiter largement cette veine. De même, pendant la Fronde, des milliers de chansons « sur l’air de », manuscrites ou imprimées, se moqueront de Mazarin ou d’Anne d’Autriche116.
68La chanson sur timbre est ainsi devenue une arme redoutable qu’ont exploitée et surexploitée tous les camps, durant toutes les périodes de tension religieuse ou politique. Elle n’a jamais cessé pour autant d’être perçue aussi comme un précieux support de dévotion, notamment après le Concile de Trente, sous la plume des Jésuites qui sollicitent méthodiquement la mémoire chansonnière des fidèles au service de la « réforme catholique117 ». Le slogan de L’Amphion sacré en 1615 est emblématique : « au lieu d’un Cupidon, vous chanterez le saint nom de Jésus : Et au lieu de folâtres amours, les divins et éternels118. » Gabriel Pau a bien analysé l’argumentaire détaillé qui soutient la pratique jésuite de la chanson spirituelle en langue vulgaire119 avant de tenter « un panorama géographique du cantique jésuite120 ». Pour mesurer l’ampleur du phénomène, une étude plus récente de Dorothy Packer, « Collections of chaste chansons for the devout home (1613-1633)121 » recense plus d’une centaine de recueils catholiques de chants spirituels publiés entre 1578 et 1633. Parmi les recueils jésuites, l’un des plus intéressants, tant par son ampleur inégalée que par la richesse de l’appareil liminaire est La Pieuse Alouette122 attribué au père Antoine de La Cauchie, publié à Valenciennes en 1619 et 1621, par Jean Vervliet, imprimeur de la Compagnie de Jésus. Ces deux épais volumes de 409 et 411 pages n’exploitent pas moins de « 772 airs profanes », ce qui en fait « le plus important gisement de parodies » du règne de Louis XIII123.
69Cette « mode de voler les beaux airs au Diable124 », si vivace aux xvie et xviie siècles, ne se dément nullement au xviiie siècle125. Permettant d’articuler la poésie sacrée avec la musique d’opéra ou de vaudeville, la parodie continue de tirer parti d’une perméabilité entre le religieux et le profane, voire entre le religieux et le grivois. En effet les parodistes n’ont jamais reculé devant le réemploi de timbres égrillards : dans L’Amphion sacré, À Paris, sur Petit-Pont devient Le Seigneur est mon flambeau126. Après les airs de cour et les airs à boire, soucieuse de s’adapter au goût du public, l’Église se plaît à instrumentaliser les plus beaux tubes de l’Opéra et les vaudevilles pour diffuser sa doctrine et ranimer la foi des fidèles, alors même qu’elle condamne l’Opéra. Un avis au lecteur de 1712 se plaint que « les beaux vers de nos Noëls nouveaux sont aussi profanés par des chants qui ont servi et servent encore tous les jours à tant d’expressions lascives et impies. L’idée des paroles sur lesquelles un air a été premièrement fait, revient toujours dans l’esprit127 ». Bossuet, dans ses Maximes et réflexions sur la Comédie, incrimine ces petits airs de l’opéra recyclés sous forme de vaudevilles, en dévoilant ce piège de la musique qui s’insinue par les sens pour s’imprimer « dans la mémoire » :
Songez encore, si vous jugez digne du nom de chrétien ou de prêtre, de trouver honnête la corruption réduite en maximes dans les opéras de Quinault, avec toutes les fausses tendresses, et toutes ces trompeuses invitations à jouir du beau temps de la jeunesse, qui retentissent partout dans ses poésies […]. Si Lully a excellé dans son art, […] ses airs, tant répétés dans le monde, ne servent qu’à insinuer les passions les plus décevantes, en les rendant les plus agréables et les plus vives qu’on peut par les charmes d’une musique, qui ne demeure si facilement imprimée dans la mémoire, qu’à cause qu’elle prend d’abord l’oreille et le cœur128.
70On raconte que Lully lui-même, le compositeur le plus recyclé dans les recueils de parodies spirituelles de l’abbé Pellegrin, aurait eu conscience des dangers du travestissement propre aux parodies spirituelles129. Ayant reconnu une page d’une de ses compositions originellement destinées à la scène lors d’un office religieux, il aurait dit : « Seigneur, je vous demande pardon, je ne l’avais pas fait pour vous130. »
71À la faveur de tels recyclages, la circulation de la matière musicale témoigne de l’absence de frontière entre les différents types d’airs, entre ce que rétrospectivement nous avons tendance à définir comme la musique dite « populaire » et la « musique savante », mais aussi entre la musique « profane » et la musique « sacrée ». Les chansons pieuses et les cantiques servent de support à des chansons satiriques, et inversement, les airs d’opéras ou les ponts-neufs deviennent des chansons religieuses131, de même que de nombreux noëls continuent d’être composés sur des chansons profanes132. Les tables des Chansons spirituelles de l’abbé Pellegrin133 mettent sur le même plan les vaudevilles et les airs d’opéras, utilisés pour les mêmes raisons musicales et dans le même but religieux et pédagogique. Ces collections de cantiques, où parodies d’opéras et vaudevilles coexistent dans la même visée prosélyte, révèlent la porosité entre la musique des opéras et celle des vaudevilles. Dans son Histoire de l’ancien et du nouveau testament, Pellegrin utilise quatre-vingt mélodies, dont trente-trois sont tirées d’opéras de Lully, et vingt-deux sont des vaudevilles134. Dans sa seconde édition « revue, corrigée, augmentée » de Noëls nouveaux pour l’année sainte et chansons spirituelles pour le temps du jubilé et pour tout le cours de l’année, publiée en 1702, la domination de Lully est écrasante : aux côtés de timbres connus de longue date, figurent quarante-six airs de Lully, quatre références de Campra, une de Destouches et une du fils de Lully jeune et Marais. Les parodies spirituelles jouent un rôle important dans le processus de mémorisation des airs d’opéra puisque certaines de l’abbé Pellegrin peuvent compter jusqu’à vingt-six strophes135.
La vogue des airs d’opéra
72Il n’est pas anodin que Lully soit l’un des compositeurs dont les airs ont été le plus utilisés pour des parodies spirituelles :
La structure à la fois rigoureuse et close des airs de Lully, la lisibilité de leur contour mélodique et de leur conduite harmonique, ont incontestablement favorisé leur mémorisation et leur diffusion. Dès la parution d’un opéra sur la scène de l’Académie royale de musique, fleurissent les « plus beaux endroits » de tel opéra, ou bien les « airs choisis » ou les « airs à chanter ». […] on les fredonnera, on les transformera en timbres dans les recueils de chansons politiques, on les parodiera, en changeant les paroles qui deviendront bachiques ou pieuses. L’air d’Alceste, Jeunes cœurs, laissez-vous prendre, deviendra, dans les Cantiques spirituels de l’abbé Pellegrin (1701) Quel objet sur le Calvaire ! […]136.
73Ainsi un « petit air » issu de l’opéra ou une danse instrumentale peuvent être très proches d’un air populaire ou d’un vaudeville, ce qui facilite d’ailleurs leur circulation137. Titon du Tillet rapporte l’anecdote suivante :
[…] les Personnes de distinction et le Peuple chantaient la plupart des airs de ses Opéras ; les Palais et les plus beaux appartements de même que les maisons bourgeoises et les rues mêmes en retentissaient : on dit que Lully était charmé de les entendre chanter sur le Pont-Neuf et aux coins des rues avec des couplets de paroles différentes de celles de l’Opéra ; et comme il était d’une humeur très plaisante, il faisait arrêter quelquefois son carrosse, et appelait le Chanteur et le joueur de Violon pour leur donner le mouvement juste de l’air qu’ils exécutaient138.
74Avant de faire leur apparition sur la scène des théâtres, nombre d’airs servent de timbres aux Parodies bachiques éditées par Ballard (1695, rééditées en 1696). L’épître dédicatoire de Jean du Fresne à M. le Baron de Bellemond témoigne de ce goût pour la parodie des airs de Lully :
Le seul nom de Lully a rendu les opéras un objet d’admiration par toute l’Europe […] ; quoiqu’on les ait appliqués à des sujets moins sérieux, que ne le sont ordinairement les opéras, j’espère que l’enjouement dont on les a revêtus, ne les rendra pas moins agréables. […] ces parodies qui sont comme des suites de ces opéras, sont un assaisonnement à ce que le goût a de plus délicieux, et servent à relever la délicatesse des festins, qui ne sont pas des moindres effets de la grandeur et de la magnificence des Princes, que les Machines et la Symphonie139.
75L’avertissement met en exergue deux types de parodies140 : soit la textualisation d’airs purement instrumentaux, dans le but de les rendre « plus aisés à retenir », soit l’ajout d’un nouveau texte à un air qui en possède déjà un, afin de « réveiller » ou de revivifier le goût du chanteur pour l’air en question. Ce texte fournit donc l’une des premières définitions opérationnelles de la parodie musicale, qui désigne déjà à la fois le processus et son résultat, tout en mettant l’accent sur ses vertus mnémotechniques. Certaines de ces parodies bachiques ont connu un tel succès qu’elles ont donné naissance à des timbres nouveaux qui ont supplanté le timbre original ou simplement donné un timbre à des airs instrumentaux qui en étaient dépourvus. Par exemple, le vaudeville J’avais cent francs est issu d’un rigaudon du prologue d’Acis et Galatée et provient d’une parodie bachique dont il est l’incipit141. Le Démon malicieux et fin, provient d’une parodie bachique sur un menuet d’Isis142.
76Les nombreuses rééditions des Nouvelles Parodies bachiques par Ballard, dont les deux tiers « comprennent plus de cent-soixante airs parodiés, tous de la composition du plus Grand Homme que la France ait possédé pour la Musique143 », comme celles des parodies spirituelles, témoignent donc d’un phénomène de très grande ampleur. On trouve des parodies d’opéras dans les Mémoires, les journaux, les correspondances, les règlements de compte personnels144… Le Mercure rapporte en 1701, à propos d’un quatrain envoyé à Mlle de Scudéry par un certain Moreau de Mantoue, que ce même personnage « a fait une parodie sur la Loure de l’opéra d’Hésione, pour une dame de première qualité, dont le mari a un des premiers et des plus considérables emplois de l’armée ». Le Journal ajoute cette réflexion d’ordre utilitaire : « cette parodie peut convenir aux épouses tendres dont les maris doivent partir pour l’armée ». En voici le début :
Sur l’air : Aimable vainqueur etc.
Hélas, mon amour
Au son du tambour,
Ressent mille alarmes ;
Le bruit des armes
Rappelle ce jour,
Où ma constance
Éprouva l’absence […]145.
77L’air d’opéra s’infiltre donc partout, des lettres de Madame de Sévigné au Journal de Barbier ou à celui de Collé146. Dans les chansons de ce dernier, on trouve des airs parodiés de Lully147, mais aussi de Colin de Blamont148 ou de Rameau149. La musique de Rameau suscite également des parodies spirituelles : lors du service solennel que fit célébrer l’Académie royale de musique à la mort du compositeur, « plusieurs beaux morceaux, tirés des opéras de Castor et de Dardanus, furent adaptés aux prières qu’il est d’usage de chanter dans ces cérémonies, et firent verser des larmes, en rappelant aux assistants les talents de l’homme illustre que la Nation venait de perdre150 ». Dans les recueils de chansons de Coulanges, on trouve de nombreuses chansons sur des airs tirés d’opéras de Lully et Quinault : l’air C’est le dieu des eaux qui va paraître d’Isis, Quand le péril est agréable d’Atys, des « paroles sur la chaconne de Phaéton151 », une parodie pour Mlle de Coulange sur l’air de l’Adieu de Cadmus, Pendule est morte sur l’air Alceste est morte d’Alceste, Testu est vainqueur de Brancas sur l’air Alcide est vainqueur du trépas d’Alceste, Fièvre je suis sous ta loi sur l’air Amour que veux-tu de moi chanté par Arcabonne dans Amadis, J’avais cent francs sur l’air du rigaudon de l’opéra de Galatée152… Cette liste montre que les chansonniers font usage de parodies situationnelles mais aussi d’airs-vaudevilles153 sans aucun rapport avec l’hypotexte de la source opératique.
78Au xviiie siècle, les « chansons sur l’air de », vantées pour leurs vertus pédagogiques154, servent encore de véhicules à des fables de La Fontaine réécrites à partir d’un timbre155, comme aux recettes de cuisine du Festin joyeux de Lebas en 1738. Le phénomène touche toutes les couches de la société, de M. de Coulanges au vielleux du Pont-Neuf :
Trivelin
Ovide nous apprend dans ses Métamorphoses que le tendre Atys brodait des flonflons sur la vielle qui charmaient Galatée, ce qui fit qu’elle le préféra à ce grand vilain chaudronnier de Polyphème qui pour tout instrument n’avait qu’un sifflet.
Le Vielleux
C’est bien parlé, car ventrebille, nous autres vielleux, je sommes tous des Lully.
Trivelin
Bon des Lully. Vous êtes trop modeste. Les ouvrages de Lully faisaient un grand tour avant que d’arriver au Pont-Neuf qui est la pierre de touche de la bonne musique et vos chansons y arrivent de plein saut156.
79Ainsi, le succès d’un air se mesure au nombre d’avatars textuels qu’il génère. Chanter « sur l’air de » s’apparente, sous l’Ancien Régime, à un véritable « jeu de société157 ». En témoigne la multiplication des « sociétés chantantes », comme la Société du Caveau, fréquentée par Piron, Collé, Gallet, Pannard, Rameau, La Bruère ou Fuzelier où « tous les airs de Cadmus, d’Isis, de Thésée, d’Atys, d’Alceste, etc. se résolvaient en hymnes à Bacchus158 ». Si, selon Anne-Madeleine Goulet, l’air sérieux ne concerne qu’une part étroite de la société159, les airs d’opéras devenus vaudevilles se diffusent d’une sphère sociale à l’autre. Mais c’est sur la scène des théâtres que le vaudeville va devenir un medium artistique de premier plan.
Le vaudeville, matériau de prédilection des théâtres
80Au xviie siècle apparaissent les premières « comédies en chansons » sur des timbres connus : c’est le cas de La Comédie des chansons attribuée à Charles Sorel, créée en 1640160, de L’Inconstant vaincu, en 1661161, enfin de la Nouvelle Comédie de chansons, en 1662162. On y trouve des fragments d’airs de cour et des vaudevilles, un mélange typique des goûts de la société de l’époque partageant les mêmes éléments de culture d’une classe sociale à l’autre. L’emploi de ce matériau connu des spectateurs et des acteurs atteste que ces comédies étaient chantées, comme le confirme d’ailleurs la préface de L’Inconstant vaincu où l’auteur a tenté d’adapter ses vers à une interprétation musicale163.
81De son côté, la scène du Théâtre Italien exploite dès la fin du xviie siècle l’usage du chant sur timbre : dans le finale du Départ des comédiens de Dufresny (1694), Pasquariel explique la confection d’une parodie d’opéra à Arlequin : « Nous avons mis Bellérophon164 sur les airs du Pont-Neuf ; et si vous voulez être des nôtres, nous vous donnerons votre rôle, que vous chanterez à livre ouvert165 ! » Dufresny en donne les titres : Sur le pont d’Avignon, Réveillez-vous belle endormie, etc. L’emploi de ces airs vise la dégradation comique de l’œuvre cible. Ici se rejoignent les deux sens de parodie : un air composé sur… et le traitement burlesque d’un opéra.
82En sens inverse, les airs d’opéras deviennent des vaudevilles. Dans L’Union des deux opéras, Charles Dufresny fait jouer l’air des Trembleurs issu de l’opéra Isis sur une vielle ; dans Les Aventures des Champs-Élysées de L. C. D. V., représentées le 28 novembre 1693, Orphée chante six couplets « sur l’air des Trembleurs » dont les paroles, déconnectées du contexte original d’Isis166, portent la « morale » de la comédie167.
83Lors de la fermeture de la Comédie-Italienne en 1697, ce sont les théâtres forains qui font du vaudeville leur arme de survie. Confrontés aux privilèges à valeur de monopole de la Comédie-Française d’une part, et de l’Opéra d’autre part, ils n’ont le droit ni de chanter, ni de dialoguer en français. Comment contourner ces interdictions168 ? Dans les années 1710, ils inventent une sorte de karaoké avec des pièces par écriteaux qui reposent sur la participation chantante du public :
Les écriteaux étaient une espèce de cartouche de toile roulée sur un bâton, et dans lequel était écrit en gros caractères le couplet, avec le nom du personnage qui aurait dû le chanter. L’écriteau descendait du cintre, et était porté par deux enfants habillés en Amours, qui le tenaient en support. Les enfants suspendus en l’air par le moyen des contrepoids, déroulaient l’écriteau ; l’orchestre jouait aussitôt l’air du couplet, et donnait le ton aux spectateurs, qui chantaient eux-mêmes ce qu’ils voyaient écrit, pendant que les acteurs y accommodaient leurs gestes169.
84Les Forains engagent des chanteurs et chanteuses « gagistes » qui sont disséminés dans le public et l’entraînent170. L’Académie royale de musique, devant le succès croissant de ces pièces chantées par le public « sur l’air de » et devant faire face à des difficultés financières, décide de sous-traiter une partie de son privilège à une troupe foraine qui prend à partir de 1715 le nom d’« Opéra-Comique ». Moyennant une lourde redevance, la troupe peut alors chanter elle-même ses couplets « sur l’air de ». Le vaudeville, que Lesage et d’Orneval qualifient de « diamant brut171 » entre les mains des premiers auteurs de l’Opéra-Comique, devient sa marque de fabrique.
85Les avantages du vaudeville comme medium de l’écriture parodique sont nombreux. Les opéras-comiques étant souvent composés dans l’urgence de l’ouverture des Foires Saint-Germain l’hiver et Saint-Laurent l’été, le recyclage de patrons musicaux préexistant permet de disposer de moules prêts à l’emploi, d’où un gain de temps non négligeable. Autre vertu de cette technique de fabrication, le choix d’airs connus soude la complicité des spectateurs et permet d’animer le spectacle en fonction de la demande et du goût de ce public, tout en l’incitant à participer172.
86La principale caractéristique musicale du vaudeville est, en effet, sa capacité à être chanté par le plus grand nombre173. Il possède un ambitus mélodique peu large, des tonalités usuelles ou « naturelles », ne dépassant pas un dièse ou un bémol à la clé, enfin, et surtout, des rythmes de danse. En effet, presque tous les vaudevilles sont des danses, du moins adoptent leurs coupes et leurs carrures : branle, gavotte, bourrée, menuet, gigue, etc. Ces rythmes aux accents nets et à la pulsation marquée permettent une mémorisation aisée et une interprétation claire et efficace ; ils donnent également beaucoup de vivacité aux dialogues.
87Toutefois, le vaudeville n’est pas utilisé de la même manière qu’une chanson à couplets : on se sert surtout de ses premiers vers ou de son premier couplet, voire de son refrain, conférant ainsi au discours musical un aspect de « patchwork » bariolé et diversifié. En ce sens, il demande un métier particulier aux acteurs et aux actrices, assez différent de celui du chanteur ou de la chanteuse de rue ou de salon. Il requiert une grande souplesse d’interprétation qui ne repose pas sur la pure virtuosité vocale. C’est pourquoi l’Opéra-Comique engage des « répétiteurs » de vaudevilles, comme, en 1718, le compositeur Jean-Claude Gillier, attaché à cette scène174. Plus tard, en 1744, Favart recrute un acteur, M. Lefebvre, « utile pour enseigner les airs175 ». Cette remarque indique qu’en dehors du maître de musique et sans doute du premier violon, certains acteurs servaient de répétiteurs pour l’apprentissage des vaudevilles. Lefebvre devait bien les connaître, mais devait également avoir assez de facilités pour y placer les nouvelles paroles écrites par les auteurs de pièces.
88Dans le répertoire de l’opéra-comique, la provenance des mélodies est principalement de trois types : chants populaires anciens, airs issus des vaudevilles finaux des comédies, airs des divertissements d’opéras ou « airs-vaudevilles176 », et airs issus de la musique instrumentale ou de la danse. Plus on avance dans le siècle, plus le choix des timbres s’enrichit : selon Corinne Pré, « en 1716 […] sont attestés environ 180 timbres différents, dix ans après au moins 400, en 1736 le nombre monte à près de 600, en 1743 […]. Favart aurait pu théoriquement choisir entre 950 timbres177. » Si le répertoire des vaudevilles comprend un fonds stable, comme dans bien des musiques de transmission orale, il peut s’ouvrir également à des styles musicaux nouveaux, contribuant ainsi à le faire évoluer. L’Opéra-Comique mêle progressivement aux vaudevilles des ariettes originales composées par Philidor, Duni, Monsigny ou La Ruette et réinvente son esthétique. Le Procès des ariettes et des vaudevilles (Foire Saint-Laurent, 1760) de Favart et Anseaume, est une réécriture des Couplets en procès (Foire Saint-Germain, 1730) de Lesage et d’Orneval qui opposait déjà Maître Goufin, lequel voulait ponctionner l’Opéra pour trouver de nouveaux timbres, à Maître Grossel, qui défendait les anciens vaudevilles et jugeait les récents inaptes à véhiculer des émotions. Dans la version de 1760, Maître Goufin défend les ariettes et Maître Grossel les vaudevilles178. Ces ariettes à succès deviennent à leur tour des vaudevilles recyclés sur les Boulevards179.
Collections de timbres et sociétés chantantes
89Le xviiie siècle s’ouvre avec une publication chansonnière significative : La Clef180 des chansonniers ou Recueil des vaudevilles depuis cent ans et plus. Notez, et Recueillis pour la première fois par J.-B. Christophe Ballard, Paris, 1717, en deux volumes181. Certes Ballard avait coutume depuis 1694 de publier mensuellement des « Recueils182 » d’airs sérieux et à boire, des brunettes, voire des chansons à danser comme Les Rondes183, très proches dans leur inspiration du vaudeville. Mais cette entrée du vaudeville en tant que tel dans une maison si prestigieuse, possédant le quasi-monopole de la musique imprimée, indique qu’il fait partie désormais des pratiques d’une société qui aspire à plus de distinction, notamment celle des femmes, se démarquant du monde des colporteurs et des chanteurs de rue. Dans une visée commerciale, et pour ne pas choquer ce public, Ballard expurge certains vaudevilles et s’en explique : « J’ai châtié dans ce recueil des paroles un peu trop libres […]. Autrement, je serais obligé souvent de supprimer quantité d’airs qu’on chante ordinairement184. » De fait, le texte de certains airs, contenus par exemple dans les recueils de colporteurs, pouvait choquer, comme celui de Ton humeur est Catherine. Dans un recueil de colporteur de 1722, il apparaît avec un titre éloquent : « Complainte de l’amoureux Pierrot, grogneux, vaudeville paysan185 ». Le langage y est délibérément scatologique, et, à cet égard, typique d’une inspiration foraine : « L’autre jour dans les latrines / Cherchant un gant à tâtons / La petite Catherine / Mit la main sur un étron186. »
90Les deux volumes de La Clef des chansonniers avec leurs trois cents mélodies notées constituent un corpus significatif des airs populaires au début du xviiie siècle187. Des compositeurs de la sphère « savante » (comme Lully et Charpentier188) y apparaissent, aux côtés d’airs populaires anciens. Le passage de l’air chanté au statut de vaudeville va de pair avec un processus d’anonymisation, conséquence du succès. C’est également la contrepartie subie par les airs composés pour la Comédie-Française, l’ancienne ou la nouvelle Comédie-Italienne189. Mais la parution de Ballard peut aussi s’envisager comme la partie émergée de l’iceberg, tant sont nombreux les recueils manuscrits qui circulent au xviiie siècle. L’éditeur le rappelle dans l’Avertissement initial, justifiant par-là la nécessité de son ouvrage :
L’idée de ce recueil n’est pas de donner des airs tout à fait inconnus ; leur nom suppose le contraire puisque le vaudeville ne s’entend que des airs répandus dans le public. On en trouvera donc plusieurs, qui ont été imprimés dans différents recueils ; et quantité, qui peuvent être inconnus : c’est le sort ordinaire des pièces qui ont paru depuis une longue suite d’années. Les uns et les autres, quoique chéris dans leur temps, ont été dispersés jusqu’à présent : leur réunion fera sans doute un plaisir nouveau, puisqu’on en a toujours conservé les véritables noms à la tête des couplets qu’ils ont produits ; et que ces couplets, par leur grand nombre, ont formé plus de quatre volumes in-folio de manuscrits, répandus actuellement dans les plus célèbres cabinets. Quelque amusants que soient ces volumes, ils le seront certainement davantage, quand on en aura la clef ou les airs notés, dont le nombre est de trois-cents, sans lesquels par conséquent il était presque impossible d’en faire usage ; c’est à quoi je crois avoir remédié. Au reste, je n’ai point conservé de chronologie, ni d’ordre de tons dans ce recueil, ayant regardé les airs qui le composent, de même qu’un amas de clefs qui peuvent être aisément reconnues par leurs marques particulières190.
91Il fait ainsi allusion aux nombreux manuscrits où sont rassemblés quantité de couplets satiriques sur les grands et la Cour. Composés « sur l’air de Joconde », « sur l’air des Feuillantines », « sur l’air Bon bon bon que le vin est bon », etc., ces airs, supposés connus du lecteur, n’y sont habituellement pas notés. C’est cette lacune que La Clef des chansonniers se propose de combler.
92Au début du xixe siècle, on observe un tournant marqué par la publication de La Clé du Caveau à l’usage de tous les Chansonniers français, des Amateurs, Auteurs, Acteurs du Vaudeville, & de tous les Amis de la Chanson. Par C*** [= Capelle] du Caveau français, Paris, Capelle et Renand, 1811191. Par son ampleur comme par l’intensité de sa diffusion, La Clé du Caveau est l’œuvre maîtresse du genre chanson sur timbre. Rééditée sept fois entre 1811 et 1872 et sans cesse enrichie – 891 airs en 1811, 1500 à la seconde édition, en 1816, 2030 à la troisième, non datée, 2350 à la quatrième, en 1847 –, elle illustre l’émergence d’une nouvelle sociabilité populaire urbaine. Dans ses éditions de la seconde moitié du xixe siècle, l’ouvrage compte quelque 2 390 timbres. Dans son Avertissement192 Capelle précise :
J’ai cru rendre un service essentiel aux amis de la chanson […] en rassemblant par ordre de timbres […] ces airs que l’usage ou le goût ont consacrés, dont notre oreille se trouve involontairement frappée après les avoirs entendus [et qui] bravent la monotonie d’une politique absorbante et l’étiquette ennuyeuse de nos salons193…
93Ici, peu importe que l’air ait servi ou non pour d’autres chansons, il suffit qu’il soit apte à le faire. C’est dans ce but qu’il a dressé sa « table des coupes » – concept nouveau pour l’époque – car « ce tableau offre la facilité de chanter quelquefois une même chanson sur cent airs différents194. »
94Cette publication, qui vise à fournir une réserve d’airs aux chansonniers pour faciliter l’écriture de nouvelles chansons sur l’air de…, est en lien direct avec l’émergence des sociétés chantantes. La première, créée en 1729 à Paris dans le quartier de la Foire Saint-Germain, la Société des dîners du Caveau195, du nom du cabaret où se réunissent ses fondateurs, Piron, Gallet, les deux Crébillon, Pannard et Collé, suscite des émules dans les villes de province comme à l’étranger jusqu’en 1939. Cette société est, avant tout, « une société nombreuse et choisie196 » : on y entre par cooptation ou sur invitation. « On y compt[e] non seulement des chansonniers, mais des artistes, des savants, des littérateurs célèbres197… » Aux lendemains de la tourmente révolutionnaire, le maintien en est essentiellement assuré par Pierre Capelle, auteur de la Clé. Après Favart, Laujon, Vadé, d’Orneval et bien d’autres, le Caveau accueille, en 1813, le célèbre chansonnier Béranger.
95Les sociétés chantantes organisent des rencontres épicuriennes, autour de bons repas bien arrosés, agrémentés de chansons joyeuses aux refrains piquants : « Rions, chantons, aimons, buvons : / En quatre points c’est ma morale » chante-t-on au Caveau moderne. Le célèbre « Plus on est de fous plus on rit » est dû à Armand Gouffé, l’un de ses chansonniers. Les Caveaux se distancient donc, en tous points, de l’ambiance sociale des salons mondains et des expressions musicales considérées comme relevant du domaine de « l’art ». Les œuvres interprétées procèdent presque toujours de l’emprunt mélodique et de la parodie.
96Ces sociétés et les innombrables chansons qui en émanent témoignent des bouleversements sociaux post révolutionnaires, de la montée et des idées véhiculées par la classe bourgeoise, de son orientation vers une position lettrée et citadine. Loin de l’ambiance des salons jugée surfaite, loin des influences cléricales, les Caveaux cultivent une certaine forme de liberté joyeuse ; ils participent au déclin de l’aristocratie et de l’autorité de l’Église. Au reste, la position de ces sociétés, les orientations et les valeurs de référence de leurs membres les situent à la croisée de quantité d’influences : sortes de passerelles, de zones tampon entre culture de l’élite et inculture198 des plus nombreux, elles favorisent une dynamique d’interférences. Leur fonctionnement en réseaux ou en rhizomes – en souterrain, à huis clos, en parallèle des instances officielles – facilite les ramifications en provinces et à l’étranger ; il impulsera d’autres élans, celui des goguettes, par exemple, d’essence plus ouvrière. La mixité entre, d’une part, le modèle aristocratique proposé à la parodie, l’œuvre d’auteur, les repères lettrés et, de l’autre, le côté populaire, le registre grivois et satirique, l’air connu de tout un chacun, est à l’origine du succès considérable de ces groupuscules et de leurs œuvres. Ainsi, ces sociétés donnent-elles au domaine chansonnier et au principe de la composition sur timbre une remarquable impulsion, également perceptible dans l’adoption d’un lexique spécifique199 pour nommer cet art de poser un texte de circonstance sur un air fortement ancré dans les mémoires.
97Les différents Caveaux essaiment et rayonnent également par le biais des publications propres à chaque Société : revues, feuilles volantes, chansonniers, almanachs chantants200. Des manuels spécialisés sont même commercialisés pour faciliter l’entrée en matière du novice201. Dans les années qui voient le succès de La Clé du Caveau, paraissent notamment nombre de petits recueils au format de poche (in-16), conçus sur le modèle décidément tenace des premiers chansonniers imprimés du xvie siècle, en vue d’offrir aux amateurs et amatrices202 un choix de chansons nouvelles et joyeuses sur des airs connus. Parmi des dizaines d’autres, on peut s’attarder à titre d’exemple sur La Nouvelle Gaudriole de 1836, Paris, chez les Marchands de nouveautés, 1836, et sa petite sœur La Nouvelle Gaudriole de 1837 par MM. Beranger, Desaugiers, Debraux203, Arm. Gouffé, J. Festeau, J. Cabassol, Ch. Lepage, A. Gilles, Scribe, Piton, Chanu, etc.204 En 390 pages, chacun de ces petits livres de poche rassemble dans un beau désordre, gage de variété, 133 chansons agrémentées de quelques fines gravures hors-texte, illustrant telle ou telle chanson d’une petite scène galante. Le titre de chaque chanson est suivi de la mention du timbre. La majorité des timbres sont désignés par un incipit (Air : Faut il qu’un homm’ soit cornichon), ou par la mention d’un vaudeville (Air du vaudeville des maris qui ont tort ; Air : Du vaudeville de l’intérieur d’une étude) mais d’autres ont un titre de convention (Air de la croisée, de la poupée, du protecteur, de la fricassée, du mirliton, d’une galopade, etc.). Parfois la mention du timbre est suivie du nom de son compositeur : « Air du Rémouleur (de Festeau), Air de la Moune (de Debraux), Air du vaudeville de la dévote (Scribe) ». Plus rarement, on trouve les mentions « Air connu », « Air connu (de Plantade) », ou « Air nouveau », « Air nouveau d’Edouard Donné », ou encore « Musique de l’auteur des paroles » (celles-ci sont alors signées Blondel).
98Le nombre des couplets varie de quatre à douze et la grande majorité des chansons sont agrémentées d’un refrain. Leur matière ne varie guère : chansons à boire, gauloiseries plus ou moins épicées (« Vive ce beau bijou / Joujou / Que la tendresse / Dresse… »), portraits de femmes (La Faubourienne vertueuse, La Grisette, etc.), scènes d’amours champêtres (les figures de Lisette et de Lucas sont sollicitées maintes fois), railleries contre la « vertu » ou les cocus, satire des prêtres, des moines et des dévots, tirades épicuriennes à la manière d’Anacréon ou d’Horace. Le style des chansons rappelle tantôt la tradition savante issue de la Pléiade (références classiques et allusions mythologiques foisonnent dans les textes de Piton, qui était professeur et auteur d’un Horace travesti), tantôt une veine populaire ou pseudo-populaire qui rappelle davantage le théâtre de la Foire avec ses paysans naïfs et ses bergères délurées au parler rustique de comédie (« D’puis c’biau jour, j’allions godailler… », L’Amant de Village, par Legros). Même si les saillies anticléricales laissent deviner une sensibilité plus proche de la république que de la monarchie, les sujets politiques sont soigneusement évités, et plus largement toute allusion à l’actualité, ce qui donne à ces chansons une sorte d’universalité et peut leur assurer une forme de pérennité.
99Presque tous les textes sont signés du nom de leurs auteurs. On en dénombre plusieurs dizaines. Si le titre du recueil met en valeur l’illustre Béranger et quelques autres, leurs contributions sont bien moins nombreuses que celles de Piton, de Chanu ou de Blondel (plus d’une dizaine de chansons chacun). Car La Nouvelle Gaudriole privilégie à l’évidence les principaux membres de la fameuse Lice Chansonnière, dont elle paraît l’émanation. On y retrouve presque tous les adeptes de la poésie légère qui s’étaient regroupés autour de Charles Le Page pour fonder cette illustre société chantante en 1831 : E. C. Piton du Roqueray, président de la Lice, Chanu, Louis Festeau, Fosset, Blondel, Germain et Édouard Hachin. Parmi les textes les plus remarquables du recueil, on trouve justement le Chœur d’ouverture de la Lice (1835) dit aussi Chant de la Lice (paroles de Blondel et Germain, musique de Blondel seul), ou La Soirée lyrique (de Piton), précieux témoignage sur l’esprit joyeux de ces bacchanales, tout comme À un président de société lyrique (du même Piton, lui-même président). Cette société n’était guère ouverte aux femmes à l’époque ; toutefois c’est par exception une autrice, « Madame Fleury », qui signe Le Rococo, éloge ironique et fort drôle des nouveautés romantiques, sur l’air de Entendez-vous le son de la musette205 ?
100Sur cet âge d’or de la chanson, Romain Benini montre à quel point, après la Révolution française, la production chansonnière et sa place dans les sociabilités connaissent un remarquable essor206. Sur la base d’un recensement méthodique de plus de six cents chansons imprimées durant la Seconde République (1848-1851), notamment dans le périodique La République lyrique, l’auteur observe que moins d’une cinquantaine sont écrites sur un « air nouveau » (soit moins de 10 %), si bien que « la pratique du timbre semble être un élément majeur du fonctionnement sémiotique des chansons de la IIe République207. »
Le xxe siècle, ses chansonniers, ses yéyés, ses goguettes
101Selon Romain Benini, « la chanson demeure un phénomène social et artistique de premier ordre jusqu’au début du xxe siècle208. » Mais qui nierait qu’elle reste aussi durant tout le xxe siècle un phénomène social et artistique majeur ? Il est certain en revanche que l’essor des techniques d’enregistrement, l’industrie du disque et ce qu’on peut appeler la mondialisation de la musique transforment en profondeur le mode de circulation des chansons et les pratiques de sociabilité qui s’y associent. Dans ce contexte, l’usage du timbre et ses motivations se renouvellent également.
102La tradition parodique des chansonniers, qui perdure notamment à Paris dans des espaces dédiés comme le Théâtre de Dix Heures, le Caveau de la République, les Deux Ânes, le Théâtre du Coucou, trouve aussi un nouveau retentissement sur les ondes de la radio, où des émissions spécifiques lui sont parfois dédiées, comme « Le Club des Chansonniers » sur Radio Luxembourg (1958-1959), et surtout « L’Oreille en coin » (de mars 1968 à juillet 1990), qui connut chaque dimanche matin l’une des meilleures audiences de France-Inter avec une longue émission satirique consacrée à l’actualité (notamment politique) agrémentée par les meilleurs chansonniers de l’époque : Jean Amadou, Jacques Mailhot, Maurice Horgues, etc.
103Dans les mêmes années dites parfois les « Trente Glorieuses », les nouvelles vedettes de la chanson française qui profitent de l’essor de l’industrie du disque ne répugnent pas à recourir à la vielle pratique du timbre pour adapter en français les succès anglo-américains. Dans tous les styles (swing, rock’n’roll, pop, folk), les hit-parades consacrent des chansons écrites par d’habiles paroliers sur l’air de standards importés. Ainsi, les premiers succès de Claude Nougaro, Richard Anthony, Hugues Aufray, Eddy Mitchell, Sylvie Vartan209, et plus largement toute une part de la production dite yé-yé des années 1950 et 1960 procèdent de cette pratique, mise en œuvre avec plus ou moins de succès selon les cas. Cette vogue durable mériterait une étude d’ampleur qui semble n’avoir jamais été entreprise ; elle pourrait envisager le phénomène en croisant mesures quantitatives, aspects commerciaux et juridiques, poétique de la traduction et de l’adaptation, étude de réception dans les magazines spécialisés, etc. Parmi des centaines d’exemples, on peut rappeler que Le Pénitencier, chanson écrite par Hugues Aufray à la demande de Johnny Hallyday et enregistrée par celui-ci en 1964, est l’adaptation française originale d’une chanson traditionnelle américaine aux origines lointaines, The House of the Rising Sun, reprise notamment par Woody Guthrie (1941), Lead Belly (1944 et 1948), Pete Seeger (1958), Miriam Makeba (1960), Joan Baez (1960), Nina Simone (1962), Bob Dylan (1962) avant de devenir un tube du groupe The Animals, pour lequel Eric Burdon venait d’en réécrire le texte en 1964.
104Par la suite, plusieurs artistes de rock français n’hésitent pas à consacrer un ou plusieurs albums entiers à des chansons sur timbre. Trois exemples illustrent la diversité des projets artistiques qui conduisent à un tel choix.
105À la fin des années 1980, le groupe Les Bidochons, ou Rolling Bidochons, se spécialise dans les parodies des plus célèbres groupes de rock : l’auteur des paroles, Titi Wolf dit John Lenine, cultive les blagues potaches et scatologiques tout en restant au plus près des sonorités des chansons parodiées. Après plusieurs albums monographiques, leur CD Le Très meilleur des Bidochons (1996), vendu dans une boîte de camembert, regroupe leurs plus belles trouvailles : Pas d’papier water (d’après Paperback Writer des Beatles), Crêperie (Rape Me de Nirvana), Roger (Angie des Rolling Stones), Comme tu dégueules (Come Together des Beatles), Les P’tites Bites (Let It Be des Beatles), etc. Et pour qui ne l’aurait pas saisi, les artistes prennent le soin d’indiquer dans le paratexte de pochette que « Ce disque est un hommage » à leurs vedettes bien aimées.
106Francis Cabrel n’a pas besoin de telles précautions pour son album Vise le ciel ou Bob Dylan revisité (2012), dans lequel, un demi-siècle après Hugues Aufray210, il s’applique à chanter sur l’air des tubes de Dylan leur traduction française aussi fidèle que possible. Les titres suffisent à illustrer cette ambition de littéralité : Comme une femme (Just Like a Woman), D’en haut de la tour du guet (All Along the Watchtower), Je te veux (I Want you), Un simple coup du sort (Simple Twist of Fate), etc.
107Lié à une crise d’inspiration, c’est un projet similaire (et assez solitaire) qui anime en 2018 le disque Origines de Louis Bertignac (guitariste de Jacques Higelin, de Téléphone, des Visiteurs), conçu comme un hommage aux modèles divers de sa jeunesse, une sorte de thérapie en forme de retour aux sources : « pour retrouver l’enthousiasme, écrit-il, il m’est venu l’idée de traduire les textes de ces classiques et d’en faire des adaptations françaises211. » Traduction ou adaptation ? On sent bien l’hésitation que reflètent aussi les titres : J’aime tout de toi (Precious Angel de Dylan), C’est fini (It’s Over de Rod Stewart), Descends-moi (Dead Flowers des Rolling Stones), Coquine (Cocaine de J. J. Cale), etc.
108Dans chacun de ces disques, on goûtera d’autant mieux l’adaptation qu’on connaîtra et appréciera le modèle. Car ces parodies n’ont évidemment pas vocation à remplacer les originaux pour le public francophone (comme c’était le cas, par exemple, de certaines traductions d’opéras au xixe siècle) : elles offrent plutôt aux amateurs une sorte de contrepoint, ou de variation, propre à donner envie de revenir au modèle, en percevant mieux l’intérêt des textes originaux, non sans apprécier, dans le meilleur des cas, l’habileté de la transposition. De fait, c’est toujours un petit tour de force de concilier les contraintes d’une traduction fidèle et celles de la chanson sur timbre, sans se priver du charme de la rime. À l’auditeur qui aime chanter, elles permettent aussi de s’amuser à appliquer aux airs qu’il connaît ces nouvelles paroles, pertinentes ou impertinentes.
109On finira ce parcours chronologique par l’évocation de l’artiste Jean-Michel Lambé212, alias Julien Carton, pianiste et ingénieur du son, qui, en plein confinement, lance sa chaîne YouTube et adapte les paroles « Si tu cherches un peu de gaieté, si aux exams tu t’es planté, si t’en as marre de galérer, viens donc faire un tour à Lambé » de la chanson Lambé An Dro (1998) du groupe Matmatah, dont il fait partie depuis 2017 sur l’air de multiples tubes. De la contrainte du réemploi de ces mêmes paroles naît une inventivité extraordinaire dans tous les registres et sur un répertoire français et anglo-saxon d’une grande variété de Daft Punk à la Lambada, en passant par Britney Spears, David Bowie, Juliette Armanet, Francis Cabrel, Nirvana, Michael Jackson, Florent Pagny, The Beatles ou Michel Berger dont les « Quelques mots d’amour » deviennent « Quelques mots Lambé », tandis que Christine and the Queens devient « Christine and the Kouign » du nom du célèbre gâteau breton ou que Jean-Michel se rebaptise « Jean-Missel » pour chanter sur Ameno d’ERA ou « Bob Morlaix » pour chanter sur Buffalo Soldier de Bob Marley. Les reprises parodiques ont encore de beaux jours devant elles…
Questions de méthodologie et problématisation
110Chanter de nouvelles paroles sur un air préexistant est une pratique consubstantielle à l’exercice de la musique vocale, voire à son existence même. Dès lors que l’on chante d’autres vers, une seconde strophe, par exemple dans le contexte des langues romanes depuis la lyrique des troubadours et trouvères, on expérimente ce lien entre le sonore de la poésie et sa dimension purement textuelle. Mais est-ce vraiment, pour autant, chanter « sur l’air de » ? Voilà une question essentielle, que nous préférons toutefois éluder. On s’intéresse ici exclusivement aux questions posées par la production de nouveaux textes sur des mélodies préexistantes, même si certaines de ces questions, notamment prosodiques, se posent aussi quand on chante des couplets sur le même air.
111Comme ces mots chantés sont assemblés en vers, la dimension métrique impose aussi à la mélodie du timbre ses propres accents, silences, modes d’expressivité. On peut donc multiplier les approches accentuelles et métriques du lien entre le couplet musical et la strophe poétique, avec fruit bien souvent. Des exemples en seront donnés. C’est pourquoi, même si elle est évidemment liée à la musique, la composition de textes à partir d’un timbre est bien avant tout une pratique poétique, une technique de composition littéraire. Nul besoin d’avoir appris la musique ou de savoir lire une partition pour composer sur un timbre ; il suffit de connaître la chanson et les rudiments de la versification. Notre ouvrage vise donc, entre autres, à encourager les spécialistes de littérature ou de poétique à investir eux aussi ce domaine comme partie intégrante de leur champ de réflexion et de compétence.
112La pratique du timbre met en présence deux réalités bien distinctes : un texte, souvent d’auteur – chansonnier, missionnaire… –, et une mélodie préexistante supposée ancrée dans la mémoire collective. Son rôle est de servir de support à un nouvel énoncé. La rencontre, plus ou moins consciemment organisée, entre ces deux réalités est bien souvent la clé du succès et de la durabilité de la nouvelle œuvre. Même si le rapprochement entre le timbre et le nouveau poème n’est pas systématiquement travaillé, il impose une cohérence structurelle. En effet, les énoncés vocaux sont en principe syllabiques aussi la prise en compte de la possible superposition au travers de l’organisation métrique entre les deux domaines est de mise. C’est ce constat qui a conduit Pierre Capelle à organiser son ouvrage La Clé du Caveau en fonction des coupes métriques.
113La chanson strophique, principal terrain d’application de la composition sur timbre, tire de la répétition musicale de couplet en couplet un effet de confort, de reconnaissance et enfin – par conséquent – de plaisir qui renvoie au moins à deux interrogations majeures. Elles sont d’ordre anthropologique. Chanter ensemble crée des communautés temporaires, plus ou moins larges selon l’époque considérée, et cette proposition permet de méditer d’une part sur les degrés de la connivence213 et de la culture partagée à l’instant T dans un groupe, d’autre part sur l’usage que peuvent en faire ceux qui se donnent pour mission de fournir ces modèles à chanter, ceux qui se chargent de « faire chanter ». Il faut donc examiner les données de l’expression de la connivence sociale à travers les choix des airs et des thématiques textuelles qui les utilisent (par exemple des airs grivois pour chanter la défaite morale de l’ennemi), c’est-à-dire procéder à l’histoire et la critique interne des corpus, mais aussi réfléchir aux acteurs qui décident de l’usage du timbre, car le timbre n’est pas un phénomène « naturel », c’est le chanter qui l’est.
114L’usage du timbre pour un autre texte, nouveau, notamment quand il est vendu en recueil, suppose que ceux qui y font appel ont une grande confiance dans l’efficacité du procédé : c’est toute la question du cercle de sociabilité qui se crée autour de ces usages du timbre, et des motivations des uns et des autres. Ainsi dans la diffusion d’un recueil de chansons, les aspects institutionnels (quelles autorités promeuvent quels contenus théologiques ?), les dispositions prosélytiques (pourquoi utiliser le timbre plutôt que la partition notée ?), les contraintes techniques et économiques (coût et difficultés de l’impression musicale), les attentes de l’imprimeur, celles enfin des acquéreurs entrent toutes en ligne de compte et méritent de retenir l’attention. La dimension historique et sociale du timbre est donc incontournable, et distingue l’emploi du timbre de toute autre répétition de musique sous un texte différent. En un mot, il existe des acteurs et un contexte, qui méritent d’être décrits avec précision.
115On peut encore aborder la question du timbre sous un jour dialectique entre individu et communauté. Si la mémoire individuelle fonctionne très bien avec le chant répété des mélodies et la pratique des couplets dès la petite enfance, c’est à la mémoire collective que s’adressent implicitement les producteurs de répertoires sur timbres. Ceux-ci peuvent être analysés à la lumière de pratiques sociales, avec plus ou moins d’esprit de système, mais ils sont souvent également datés et ancrés dans un lieu relativement homogène, nécessairement limité dans le temps : telle ville garde la mémoire de son siège victorieux par des chansons, telle communauté célèbre la fête annuelle d’une corporation, telle famille, telle compagnie se réunit pour une célébration privée, mariage, fin de campagne militaire… L’articulation avec la dimension historique est incontournable. Elle suppose un examen attentif des sources.
Les sources et leur exploitation scientifique
116Travailler sur les timbres, c’est d’emblée s’en référer à des sources particulières. En effet, si le principe fonctionne sur la transmission orale du répertoire par un jeu de rappel à la mémoire de la ligne mélodique214, il a donné lieu à quantité d’écrits, manuscrits ou imprimés. Une fois transcrite, entrée dans le champ de l’écrit, puis dans l’univers de l’imprimé et du commerce du livre, la chanson sur timbre est en partie (en partie seulement) tributaire de ses supports, de leurs circuits de diffusion et du lectorat (ou plus largement du public) qui s’y attache. Songeons aux façons diverses dont se déclinent les différents airs tirés des opéras et opéras-comiques ; observons sous quelles formes variées ils sont rendus à « la rue », en passant par le spectacle, le feuillet volant, la besace des colporteurs, les ouvroirs des merciers qui les vendent cachés sous le drap fin…
117Au-delà des catalogues d’airs215, bien d’autres sources sont à la disposition du chercheur, qui méritent un examen scrupuleux. Certes, la somme des recueils de chansons, vaudevilles, cantiques, noëls, publiés ou laissés à l’état de manuscrit, forme une masse énorme qui peut intimider. Reste que ces livrets, souvent de petit format216, demeurent une des sources essentielles à toute recherche sur la composition sur timbre. Que ce soit au niveau du plan de l’ouvrage, du corpus proposé, de l’annexion de la ligne mélodique ou d’un simple renvoi par la mention « Sur l’air de… », que ce soit encore au niveau d’une présentation texte/musique en pleine page plutôt qu’une compilation des mélodies en fin de volume, le recueil, au travers des orientations de son auteur, nous apprend beaucoup sur la communauté dans laquelle il se doit d’être diffusé ; son adoption par les amateurs dépend de son aptitude à répondre aux canons du moment. Outre ces précieuses informations, le recueil offre, également, en préliminaire au répertoire, une introduction, préface ou avertissement. Espace privilégié où, tout comme le feront, dans les siècles suivants, les compilateurs de chansons de transmission orale217, l’auteur argumente, justifie, légitime ses choix et orientations. Généralement, il se positionne en regard de ses prédécesseurs et contemporains révélant ainsi de véritables généalogies du domaine. Espace privilégié encore quant à la présentation des caractéristiques de l’objet où, pour valider le pourquoi de sa démarche, chacun dresse, en ses propres termes, l’apologie de la poésie chantée et le bien fondé du principe de composition sur un air connu.
118Parmi les documents à exploiter, l’imagerie populaire, la feuille volante, n’est pas moins précieuse pour le chercheur dans la mesure où sa présentation participe du processus de mémorisation/transmission du répertoire. Imprimé sur du papier de peu de valeur selon les premiers procédés de reproduction en masse, sa vente accompagne, bien souvent, la performance du chansonnier218. La feuille volante propose le message à diffuser sur différents registres où le textuel, le visuel et l’interpellation du sonore se renforcent :
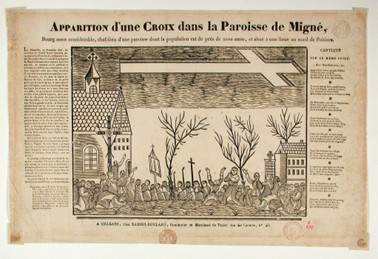
Illustration 1 : Apparition d’une croix dans la paroisse Migné, [Vienne, 1826], Orléans, chez Rabier-Boulard, no 45. « Air : Réveillez-vous, etc. »
119Ainsi, quantité de cantiques, complaintes, romances, ballades ou autres formes de chants viennent compléter l’illustration d’une image pieuse, d’un fait divers ou d’un code de bonne conduite. Certaines chansons traditionnelles sont illustrées de vignettes qui donnent à voir les étapes de la narration du poème. Pour certaines d’entre-elles, la ligne mélodique a pu être consignée :
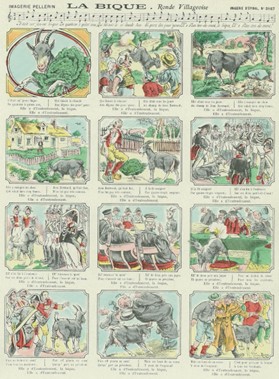
Illustration 2 : La bique, ronde villageoise, Imagerie d’Épinal, no 3167.
120La seule présence de la chanson de transmission orale, dans cet art populaire relevant essentiellement de la représentation graphique, est matière à bien des questionnements. Outre l’intérêt que peuvent présenter l’identification des thèmes, la détermination des genres chansonniers et le choix des mélodies diffusées par ce canal, la mention, sous forme illustrée, de ce patrimoine par ailleurs largement promu dans l’oralité, joue un rôle non négligeable dans les schémas de diffusion, de mémorisation et de variation / fixation du répertoire cité.
121Les sources nous renseignent aussi parfois sur les instigateurs des recueils. Le timbre comme principe de diffusion a ses artisans, ses professionnels. Ce peuvent être des pédagogues, des militants d’une cause religieuse ou politique, des savants enthousiastes témoins de pratiques orales qui les prennent en note, les classent, les collectent, espérant ou non leur assurer une forme de pérennité, ou encore des hommes d’affaires, des commerçants, des producteurs (de disque ou de radio) dont la priorité sera de vendre du papier, des microsillons, voire des « parts de marché », en répondant au mieux aux attentes supposées d’un public, d’une communauté de consommateurs. On observe des allers-retours entre cette technique somme toute simple et économique, qui se passe d’écriture musicale, et les traces écrites, notamment recueils, paroliers, chansonniers, mais aussi les catalogues, anthologies, répertoires de coupes métriques, etc.
122La position de ces promoteurs de recueils reflète également, bien souvent, fût-ce pour les contourner, les règles de conduite énoncées par les autorités. En ce qui concerne le cantique, par exemple, du concile de Trente jusqu’aux sessions œcuméniques des dernières décennies du xxe siècle, les réflexions quant à la nature des événements musicaux aptes à supporter la parole sainte ne cessent d’être objet de nouvelles révisions. Quelle sera, dans ce jeu de discussions, la position adoptée face au cantique sur timbre ? Objet de nombreuses controverses selon les époques, les auteurs ou les courants spirituels, il reste au centre des débats. Loué par les uns pour son aptitude à détourner une mélodie d’usages peu recommandables, il est vilipendé par les autres pour les connotations « vulgaires » qu’il véhicule…
123Parmi les difficultés dignes de curiosité et de réflexion, il faut revenir sur la multiplication potentielle des modes de désignation d’un même air. On l’a compris : les publications qui jalonnent la diffusion des œuvres relevant du principe de composition sur timbre sont rarement assorties d’une mélodie notée. Le plus souvent, l’air est rappelé à la mémoire de l’interprète par une formule de type « sur l’air de… » placée au-dessus du poème. Il peut s’agir de l’incipit du premier couplet, de l’incipit du refrain, ou d’un autre groupe de mots caractéristique du poème antérieur. D’où potentiellement une multiplicité de formules pour évoquer un seul et même air. Qui plus est, la même ligne mélodique peut porter un nom qui renvoie à un usage ancien ou au contraire évoquer l’un de ses emplois plus récents. Cette multiplicité a aussi, en vis-à-vis, des énoncés mélodiques totalement distincts regroupés sous une seule appellation. Ces synonymes d’appellation et homonymes de situation traduisent les permanentes mouvances propres au genre. Ils révèlent, également, la position charnière, le rôle de passerelle de ce principe compositionnel entre des espaces-temps, entre des groupes sociaux et des genres musicaux. Pour qui veut travailler sur les timbres, ils sont l’origine d’un grand inconfort et de multiples difficultés, de confusions possibles, mais aussi d’interrogations fécondes.
124Durant toutes les périodes qui ont jalonné la composition sur timbre, la transmission des lignes mélodiques s’est faite le plus souvent, parfois même exclusivement de manière orale, de bouche à oreille. En d’autres termes, si l’écrit est présent (pour les textes principalement), il n’accompagne pas l’apprentissage mélodique. C’est pourquoi les lignes varient, plus ou moins, au fil du temps mais aussi à l’occasion de leur transfert dans les genres poético-musicaux qu’elles côtoient, ou encore du fait de la re-créativité, volontaire ou non, de leurs énonciataires. Entreprise dans le courant du xixe siècle et intensifiée dans la première moitié du xxe, la sortie progressive de ce principe de transmission apparaît comme un tournant dans l’usage du timbre au moins quant au répertoire utilisé. En lien avec cette caractéristique, les lignes mélodiques ne sont que très rarement rattachables à un auteur ; aussi est-il vain de chercher leur origine. Tout au plus connaît-on la première mention de leur mise en écrit.
125Au reste, la pratique de la composition sur timbre, à laquelle tant de poètes semblent s’être exercés, a pu inspirer d’innombrables poèmes sans que l’origine parodique et le timbre soient nécessairement mentionnés. En effet, une composition inspirée par un timbre peut être copiée, imprimée, donnée à lire ou à entendre, sans que l’auteur, le copiste, l’éditeur ou l’interprète ne prennent forcément le soin d’indiquer la composition qui a servi de point de départ (parce qu’ils supposent que le lecteur la connaît ou la reconnaîtra, ou la trouvera s’il a envie de chanter le texte). Aussi, lorsque nous observons qu’un poète compose des vers sur un moule strophique pour lequel existe déjà une mélodie tant soit peu connue (cas très fréquent), on peut se demander si la nouvelle composition n’est pas née d’un chant préexistant. On parle ainsi de « parodie implicite » lorsque par exemple les dramaturges parodient des airs d’opéras sans en citer la source, tant l’opéra fait alors partie d’un socle culturel commun219.
126Cependant, pour ce qui concerne la présentation des lignes mélodiques, deux positions sont notables. La grande majorité des documents ne renvoie à l’air que sur le principe de la formule « sur l’air de… ». Retrouver la présentation de la ligne mélodique a posteriori peut alors relever d’un véritable jeu de piste qui n’aboutit pas toujours tant il est difficile de démêler la multiplicité des appellations de chaque air et sa variabilité au fil du temps et/ou des cadres d’émission et de consignation écrite. Pour autant, par un jeu de renvois, un petit nombre de recueils ou de pièces de théâtre donnent, en fin d’ouvrage, les lignes mélodiques auxquelles ils font appel. À ce titre, leur dépouillement est d’un apport très riche.
Le jeu des affects et de l’intertexte, les émotions mémorielles220
127Si l’on classe les timbres en prenant en considération non plus leur source mais leur emploi, on distinguera les usages neutres des usages signifiants voire sur-signifiants. Au xviiie siècle, les timbres a priori neutres comme Le Péril ou Réveillez-vous belle endormie sont caractérisés par leur caractère interchangeable ou polysémique221. Mais existe-t-il réellement des timbres « émotionnellement neutres », dont le sens originel – ou l’hypotexte – serait volatilisé par la répétition ? Sur ce chapitre de l’usure des timbres, la prudence est de rigueur. En effet il faut toujours avoir en tête le contexte culturel, politique ou mondain de l’époque et se rappeler que ces timbres ne sont pas exclusivement employés sur la scène des théâtres. Ainsi le timbre omniprésent de Réveillez-vous belle endormie, qui passe à juste titre comme un timbre « passe-partout », est aussi utilisé dans « les satires anti-jésuites très typiques de la société parisienne entre 1713 et 1726222 » et se colore de temps à autre de connotations satiriques. Selon Philip Robinson, ce timbre peut donc réveiller le frisson anti-jésuite. Mais il est en réalité utilisé aussi dans le domaine spirituel223. Dans ses emplois théâtraux, il peut également être exploité dans un usage discordant, c’est-à-dire a contrario, précisément pour endormir quelqu’un dans une scène de Sommeil comme dans Arlequin Atys :
L’orchestre prélude un Sommeil.
Air 44 : Réveillez-vous, belle endormie.
Quels sons touchants se font entendre ?
Je suis charmé de cet accord…
Mais le Sommeil vient me surprendre,
J’aime la musique… elle endort.
Atys endormi, le Sommeil conduisant deux Marmottes qu’il place aux deux côtés d’Atys, Songes agréables, Songes funestes224.
128En fonction de leur contexte d’insertion, les timbres signifiants peuvent donc être soit concordants, c’est-à-dire utilisés selon le principe analogique, soit discordants – ou « à contre-poil225 » –, selon le principe antiphrastique de nouvelles paroles qui entrent en contradiction avec la situation dramatique parodiée. Les parodistes jouent ainsi du contraste ou de la disconvenance entre la forme et le fond pour créer des effets de sens d’ironie dramatique, alors que la plupart des auteurs de paroles de musique s’efforcent de déterminer et de respecter « l’identité d’affect » prônée par les théoriciens de l’époque. Ces derniers insistent sur la nécessaire parenté entre mode et sens : « si l’on voulait chanter un air de guerre sur des paroles traînantes, molles et transies d’amour, cet air ne serait pas si agréable que s’il était chanté sur des paroles hardies, mâles et guerrières226. »
Il y a des airs d’une beauté si frappante, et si exquise que tout le monde en est charmé. On compose sur ces airs, on ne se lasse point de les entendre, on y accommode un grand nombre de chansons, cette variété plaît, pourvu qu’elle ne s’éloigne pas du genre de sentiment pour lequel ces airs ont été composés. Une chanson badine sur un air sérieux, et des sentiments graves sur un air badin ne sont pas supportables, si ce n’est qu’on ait dessein de faire rire par le ridicule même que ce contraste présente227.
129Certains vaudevilles sont réservés à des affects particuliers et tendent à se spécialiser dans telle ou telle fonction, s’apparentant à de véritables topoï affectifs. À ces airs s’attache dans la mémoire collective une valeur psychologique spécifique228. Déjà au xviiie siècle, les auteurs avaient conscience de ce pouvoir musical du vaudeville, sorte de « palimpseste » expressif, pour reprendre le terme de Genette229. C’est ce qu’explique l’avocat Grossel des Couplets en procès de Le Sage et d’Orneval (1729) :
Les Vieux Couplets […] sont chargés de l’essentiel, je veux dire du soin important d’exprimer les passions […]. Lequel de vos nouveaux couplets est aussi propre à faire un récit que Le Cap de Bonne Espérance […] et le vieux Joconde ? Pour bien marquer la joie, avez-vous l’équivalent d’un Allons gai, Toujours gai, D’un air gai ? Comment peindrez-vous la désolation si vous n’avez pas l’air de La Palisse230 ?
130C’est donc la qualité imitative de la musique qui est exploitée, selon la définition qu’en donne Rousseau : elle « semble mettre l’œil dans l’oreille231 ». Dans Atys travesti (1736), Carolet utilise l’air des Trembleurs, emprunté à Isis de Lully et Quinault, pour l’apparition de Cybèle, présentée comme une vieille femme, « la grand-mère des dieux », amoureuse du jeune Atys. L’air des Trembleurs évoque par ses notes répétées mécaniques, les tremblements de froid dans l’opéra de Lully, ici ceux de la vieillesse : « Air des Trembleurs : Place à Madame Cybèle, / Elle est encor fraîche et belle, / Allons tous au-devant d’elle, / C’est la grand-mère des dieux232. » La longévité de cet air de Lully est exceptionnelle puisqu’il continue à être recyclé pendant la Révolution et même jusqu’au xixe siècle233. On le voit changer de couleur politique au gré des bouleversements de l’Histoire : on le trouve notamment dans le Chansonnier Français Républicain ou recueil de Chansons, d’odes, de cantates et de romances relatives à la Révolution française, et propres à entretenir dans l’âme des bons citoyens la gaieté républicaine234. Il est régulièrement diffusé dans les recueils de chansons des xviiie et xixe siècles et figure encore dans La Clé du Caveau235.
131L’air chanté sur un timbre n’est pas un événement purement auditif, il est multi-sensoriel, témoin d’une culture vivante et orale. De la fusion du nouveau et du préexistant, de cette combinatoire originale, surgissent des images et des souvenirs propres à la culture ou à l’histoire de chacun. Ainsi, le simple syntagme Sur l’air de… convoque bien plus qu’une mélodie : il mobilise tout un hors-texte qui appartient à la mémoire individuelle et collective, charrie paroles, images et expériences antérieures. La formule Sur l’air de… est un puissant sésame qui réactive tout un vécu de réminiscences consubstantielles à l’air parodié. C’est donc aussi le point de vue de la réception, l’effet produit par ce type de pratique, l’articulation entre l’intime et le collectif qu’il convient d’interroger et que des travaux futurs permettront d’appréhender :
La question de ce qui nous réunit nous et qui est peut-être de l’ordre de l’universel – une mélodie qu’on reconnaît, qu’on peut identifier, chantonner, faire sienne – me hante : comment on est traversé par les émotions sans qu’elles se limitent à notre petit « moi » personnel236.
Timbres « migrateurs » et chansons passe-murailles
132En France jusqu’au xxe siècle, c’est bien souvent par le filtre de binômes d’opposition (écrit / oral ; citadin / rural) que se sont définies les musiques savantes occidentales et les musiques populaires (celles du peuple). Ont ainsi été masqués quantité d’espaces transitionnels, de passerelles entre les domaines, les genres musicaux, les groupes sociaux, les espaces géoculturels et temporels. La composition sur timbres, sur l’air de …, l’utilisation d’un air connu pour porter de nouvelles paroles déborde volontiers ces limites.
133Si la composition sur timbre est par essence un art (ou peut-être davantage un artisanat) populaire, c’est parce qu’elle relève d’une diffusion potentiellement large. La pratique « sur l’air de » se défie de toutes les catégorisations : ce geste de transfert, de transition, de passage, se réalise dans le franchissement de toutes les formes de frontières réelles ou inventées : savant / populaire ; écrit / oral ; citadin / rural ; profane / sacré… Qui a aujourd’hui conscience que la chanson libertine de « La Puce » interprétée par Colette Renard, Michèle Bernard ou Céline Scheen a été écrite par Alexis Piron sur un menuet composé par André-Joseph Exaudet au xviiie siècle ? C’est aussi la question de l’« interperformativité » (Niels Couturier) que le volume permet de soulever237. Par-delà la diversité des pratiques et des interprétations, la dimension souvent ludique du phénomène, la composition sur timbre ouvre la voie à des questions esthétiques fondamentales, comme celle de la relativité du lien entre le texte et la musique, voire celle de son absence de nécessité. Le timbre rend possible l’« incarnation » du texte écrit. Il constitue le lien organique entre « le corps textuel écrit » et le « corps vocal », social238.
134Le recyclage des airs, qu’ils proviennent de la rue, de l’Église, de l’Opéra, ou du répertoire de variété, est un phénomène socioculturel emblématique d’une culture musicale circulaire239 dans laquelle les échanges entre les sphères, entre la musique dite « savante » et la musique dite « populaire », mais aussi entre les pays sont nombreux et réciproques. Les théâtres, les recueils imprimés ou les périodiques, en tant que lieux de transmission – mais aussi de transformation – jouent un rôle dans la diffusion, la vulgarisation mais aussi la conservation des « airs migrateurs240 ». Par sa capacité à passer de bouche en bouche, l’air migrateur est un véhicule trans-générique, trans-séculaire, agent de perméabilité entre les frontières géographiques241, stylistiques et sociales, entre le sacré et le profane, le religieux et le grivois242.
135Finalement, le « timbre », ce n’est peut-être ni l’air, ni les noms qu’on lui donne, ni une technique précise (bien que la technicité soit indéniable), c’est l’intention de chanter ou faire chanter un nouveau texte sans aucune partition, en se servant des mélodies que le public a littéralement incorporées, mémorisées. Il est difficile de suivre la piste du devenir d’une mélodie, depuis son émanation jusqu’à sa perte. La cristallisation d’un texte inédit permet au mieux de saisir les potentialités d’un air : il apparaît comme un composé éphémère et instable, promis à d’autres états, à d’autres avatars, à d’autres histoires, à d’autres combats. « Sa plasticité auctoriale », la « puissance politique d’un chant sur timbre », la « pratique mémorielle (et parfois historique) de la musique243 », font de l’air migrateur un passe-muraille entre les sphères et entre les mondes. C’est ce qui fait aussi de lui un instrument politique privilégié et redoutable, comme en témoignent les mazarinades ou les chansonniers républicains d’hier, mais aussi les chansons chantées « sur l’air de » lors des manifestations contre la réforme des retraites244, ou le succès phénoménal des goguettes, véritables « écoles du peuple » (selon l’expression de Romain Benini) au xixe siècle et peut-être encore aujourd’hui.
1 Voir Léo Cohen-Paperman, Marco Horvat et Clémence Monnier, « Tubes, goguettes et vaudevilles. Conversation autour de la recréation de L’Île des Amazones (1718-2025) », entretien réalisé par Judith le Blanc, thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines (coord. Agnès Curel, Corinne François-Denève et Floriane Toussaint), 2025.
2 Voir Le Menteur de Pierre Corneille. Adaptation de Marion Bierry, éd. Françoise Gomez et Marion Bierry, 2022, dépôt SACD no 000435820.
3 Peter Szendy, Tubes. La Philosophie dans le juke-box, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2008, passim.
4 Floriane Toussaint, « La variété italienne comme seuil dramaturgique chez Vincent Macaigne et Anne-Sophie Pauchet », thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines, op. cit.
5 Ibid.
6 Voir Bénédicte Boisson, « Irruption et usages des tubes en danse contemporaine. Histoire et esthétique d’un phénomène récent (Alain Platel, Jérôme Bel, Latifa Laâbissi, Antonia Baehr et quelques autres…) », thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines, op. cit.
7 Voir dans le présent volume : Jean-Jacques Casteret, « Entre oralité et écriture : les “deux corps” du Noël en Béarn et Gascogne » ; et Georges Escoffier, « La Messe en Noël de Louis Grénon : la subversion tranquille d’un genre traditionnel ? »
8 Voir dans le présent volume l’article d’Éric Sauda, « Réécriture de chansons au Front de la Grande Guerre » ; et Déborah Livet, « La Résistance qui chante de Paul et Edmée Arma. Un témoignage de chansons engagées écrites sur un air connu pendant l’Occupation ».
9 Voir Chanter, rire et résister à Ravensbrück, autour de Germaine Tillion et du Verfügbar aux Enfers, dir. Philippe Despoix, Marie-Hélène Benoît-Otis, Djemaa Maazouzi et Cécile Quesney, Paris, Seuil, « Le Genre humain », 2018. Voir les ouvrages d’Élise Petit, et La Musique dans les camps nazis, catalogue d’exposition, Paris, Mémorial de la Shoah, 2023. Voir aussi Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney, « Résister sur l’air de : les chansons de prison d’Yvonne Oddon (1941-1944) » dans le présent volume.
10 Voir par exemple, dans le présent volume, François Picard, « “Chanter sur l’air de…”. Intertextualité et intermusicalité dans les genres musicaux ».
11 Voir dans le présent volume Jean-François Heintzen dit « Maxou », « André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective ». Voir aussi du même Maxou, la base de données sur les complaintes criminelles de France (1870-1940), https://complaintes.criminocorpus.org/.
12 Il s’inscrit notamment dans le sillage de Timbre und Vaudeville, zur Geschiste und Problematik einer populären Gattung im 17. und 18. Jahrhundert, éd. Herbert Schneider, Musikwissenschaftliche Publikationen, Actes du colloque de Bad Homburg, 1996, Hildesheim, Zürich, New York, Olms, 1999 ; et de Pratiques du timbre et de la parodie d’opéra en Europe (xvie-xixe siècles), dir. Judith le Blanc et Herbert Schneider, Hildesheim, Zürich, New York, Olms, « Musikwissenschaftliche Publikationen », 2014.
13 Pour une bibliographie générale sur la chanson, voir https://airdutemps.hypotheses.org/bibliographie.
14 https://u-paris.fr/cerilac/colloque-chanter-sur-lair-de-moyen-age-xxie-siecle/ Reporté à cause de la crise sanitaire, le colloque s’est tenu les 3 et 4 novembre 2021 en Sorbonne puis les 11 et 12 janvier 2022. Deux prestations musicales ont donné un aperçu de la diversité du répertoire des chansons sur timbre, du Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale : le 3 novembre la soprano Esther Labourdette, accompagnée au luth par Miguel Henry, s’est produite en Sorbonne ; puis Arnaud Marzorati, accompagné à la harpe par Pernelle Marzorati, a répondu aux sollicitations des intervenants et intervenantes pour ce concert en ligne : https://airdutemps.hypotheses.org/1734. Nous remercions les artistes pour leur collaboration à notre projet.
15 The Musical Quarterly, 65/1, 1979, p. 1-2.
16 Denise Launay, La Musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, Paris, Publications de la Société française de Musicologie, Klincksieck, 1993, p. 52. La même terminologie est employée par L. Maurice-Amour dans son article « Parodies pieuses d’airs profanes au xviie siècle », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 1960, volume 12, p. 15-29.
17 Voir Kurt Hennig, Die geistliche Kontrafaktur im Jahrhundert der Reformation. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Volks- und Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert, 1909. Réimpression : Hildesheim – New York, Georg, Holms Verlag, 1977.
18 Notre traduction.
19 Marguerite de Navarre, Chansons spirituelles, « Introduction » de Georges Dottin, Genève et Paris, Droz et Minard, 1971, p. x.
20 Guide de la musique du Moyen Âge, dir. Françoise Ferrand, Paris, Fayard, 1999, p. 446.
21 « Emprunter et créer : quelques réflexions sur le contrafactum », dans Des nains ou des géants. Emprunter et créer au Moyen Âge, dir. C. Andrault-Smitt, E. Bozoky et S. Morrison, Turnhout, Brepols, 2015, p. 59-74.
22 Voir par exemple Jean Vignes, « Chansons spirituelles, pratique du contrafactum et mise en recueil : les paradoxes de La Pieuse alouette avec son tirelire… », dans L’Unique change de scène. Écritures spirituelles et discours amoureux (xiie-xviie siècle), sous la direction de Véronique Ferrer, Barbara Marczuk et Jean-René Valette, Paris, Garnier, 2016, p. 331-364 ; et dans le présent volume Séverine Delahaye-Grelois, « “Imitar, remedar y contrahacer es una misma cosa” : contrafactum et imitatio dans la poésie du Siècle d’or espagnol ».
23 L’expression se rencontre aussi en français au pluriel : La Fleur des Noëls nouvellement notés en choses faictes…, Lyon, Jacques Moderne, 1535.
24 Isabelle His, « Le noël au cœur des polémiques confessionnelles », Polémiques en chanson, dir. Luce Albert et Mickaël Ribreau, Rennes, PUR, 2022, p. 222, n. 5.
25 Robert Falck et Martin Pick, « Contrafactum », dans The New Grove Dictionary of music and musicians, Londres, McMillan, 1980.
26 Dictionnaire des Lettres françaises (dir. Mgr. Grente), Paris, Livre de Poche, 1992-2001 ; Michèle Aquien, Dictionnaire de Poétique, Paris, Livre de Poche, 1993 ; Bernard Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires, Paris, UGE, 1984 ; Dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, 2000. Le terme ne figure pas non plus dans l’index des notions de Michel Jarrety (dir.), La Poésie française du Moyen Âge au xxe siècle, Paris, PUF, Quadrige, 2007, ou dans Guillaume Peureux, La Fabrique du vers, Le Seuil, « Poétique », 2009.
27 Gérard Le Vot, « Troubadours et trouvères », dans Histoire de la musique, dir. Marie-Claire Beltrando-Patier, Paris, Bordas, 1982, p. 59.
28 « Only in the eighteenth century was the need felt to give a name to the current practice […] », Falck, art. cité, p. 20.
29 Nicolas de La Chesnaye, La Condamnation de Banquet, dans Recueil de farces, soties et moralités du xve siècle, 1507, éd. Paul Lacroix Jacob, Paris, Adolphe Delahays, 1859 ; Classiques Garnier, 2010, p. 366.
30 Adrian Le Roy, Second Livre de Guiterre contenant plusieurs chansons en forme de voix de ville, Paris, Le Roy et Ballard, 1556 ; Jehan Chardavoine, Le Recueil des plus belles et excellentes chansons en forme de voix de ville, Paris, Claude Micard, 1576.
31 Joachim Du Bellay, Vers lyriques, préface : « ces Vaudevilles et Chansons qui se chantent d’un mesme chant », éd. H. Chamard, t. III, p. 3.
32 La Chesnaye, en 1507, différencie le « vau de ville » monodique des chansons « de musique », polyphoniques : La Condamnation de Banquet, op. cit. Voir aussi Nahéma Khattabi, « Du voix de ville à l’air de cour : les enjeux sociologiques d’un répertoire profane dans la seconde moitié du xvie siècle », Seizième siècle, no 9, 2013, p. 157-170.
33 Jehan Chardavoine, Le Recueil des plus belles et excellentes chansons en forme de voix de ville, op. cit., « Epistre au lecteur ».
34 Marin Mersenne, Harmonie universelle, Paris, Cramoisy, 1636, « Des chants », p. 164.
35 Nicolas Boileau, L’Art poétique, ch. II, Œuvres complètes, éd. A. Adam et F. Escal, Paris, Gallimard, 1966, p. 167.
36 Antoine Furetière, « Vaudeville », Dictionnaire universel, Paris, 1690, s. p.
37 Charles Dufresny, La Noce interrompue, dans Théâtre français, dir. Guy Spielmann, Paris, Classiques Garnier, 2022, t. 1, p. 512.
38 La Clef des Chansonniers, Paris, Ballard, 1717, t. II, p. 295.
39 « L’air du Cahin, Caha, eut une si grande vogue, qu’on a souvent depuis donné à cette pièce le titre de Cahin, Caha ». Laporte et Clément, Anecdotes dramatiques, Paris, Duchesne, 1775, t. II, p. 235. Le même air est aussi désigné sous le timbre de l’incipit : Dans ma jeunesse. La chanson originale de Pannard est notamment publiée dans le Nouveau Recueil de Chansons choisies, La Haye, Gosse et Neaulme, 1732, t. V, p. 146-150.
40 Voir l’édition critique de Cendrillon, opéra-comique d’Anseaume en vaudevilles avec des ariettes composées par La Ruette, Duchesne, Paris, 1759, représenté à la Foire Saint-Germain le 20 février 1759, éd. Jeanne-Marie Hostiou, Judith le Blanc et Jean-Charles Léon, dans Perrault en scène. Anthologie de transpositions dramatiques des contes merveilleux (1697-1800), dir. Martial Poirson, Montpellier, Espaces 34, 2009. Voir la captation de Cendrillon sur le site de la BnF (Les Monts du Reuil direction musicale / Judith le Blanc mise en scène) qui donne à entendre de nombreux vaudevilles.
41 Voir Benoît de Cornulier, « Les tralalas ou “syllabes non significatives” illustrés par des chansons vendéennes ».
42 Louis Fuzelier, La Rencontre des opéras, Ms. fr. 9333, fo 77. Voir J. le Blanc, Avatars d’opéras. Parodies et circulation des airs chantés sur les scènes parisiennes (1672- 1745), Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 649.
43 Selon Adrienne F. Block, parodie serait « le terme dont on se servait au xvie siècle pour désigner des textes de substitution pour la musique vocale. » (« Timbre, texte et air, ou comment le noël-parodie peut aider à l’étude de la chanson du xvie siècle », Revue de Musicologie, t. 69-1, 1983, p. 21). Cette affirmation s’appuie sur l’article de Robert Falck (« Parody and Contrafactum », art. cité, p. 5), où Block lit qu’« on rencontre ce terme pour la première fois dans le titre d’un recueil de poèmes classiques tournés en intentions chrétiennes par les techniques de la parodie, Parodiae morales (Paris, Henri Estienne, 1575) ». Mais Falck ne dit pas qu’il s’agisse là de parodies à chanter. De fait, ces Parodiae morales de Henri Estienne ne sont pas destinées à être mises en musique ; du moins rien ne l’indique, et il semble qu’elles ne l’ont jamais été : il s’agit en fait d’exercices de versification latine (reformulations diverses d’un même lieu commun moral).
44 On doit à Robert Falck (art. cité, p. 5) l’identification de ce recueil aujourd’hui consultable en ligne mais il se trompe sur le prénom de l’auteur (Gottfried et non Georg) et sur le lieu de publication (Cölln an der Spree et non Cologne sur le Rhin).
45 Jean-Léonor Le Gallois, sieur de Grimarest, Traité du récitatif (1707), Rotterdam, Veuve Johnson, 1740, p. 123-124. Cette occurrence est bien antérieure à celle de 1751 souvent donnée par les dictionnaires comme première attestation : « couplet, strophe composés pour être chantés sur un air connu » (Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, Berlin, 1751, t. 2, ch. 26, p. 100).
46 J.-J. Rousseau, art. « Parodie », Dictionnaire de musique, Paris, Veuve Duchesne, 1768 ; Genève, Minkoff, 1998, p. 367-368.
47 Voir Philippe Vendrix, Vocabulaire de la musique de la Renaissance, Paris, Minerve, 1994, article « Parodie », p. 142-143 ; Isabelle His, « Le Noël au cœur des polémiques confessionnelles », Polémiques en chanson, art. cité, p. 222, n. 5. Du côté littéraire, voir Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Le Seuil, 1982 : « Parodie : ce terme est aujourd’hui le lieu d’une confusion inévitable, qui apparemment ne date pas d’hier » (p. 19-20) ; « Le mot parodie est couramment le lieu d’une confusion fort onéreuse, parce qu’on lui fait désigner tantôt la déformation ludique, tantôt la transposition burlesque d’un texte, tantôt l’imitation satirique d’un style [= le pastiche]. » (p. 39) Voir aussi p. 41. On notera que nulle part dans Palimpsestes, G. Genette n’évoque ni l’acception proprement musicale évoquée supra ni l’acception spécifique de composition sur timbre qui nous intéresse ici. Pour l’histoire du mot parodie, voir aussi R. Falck, art. cité, p. 2-11, et Lewis L. Lockwood, « On “parody” as term and concept in 16th-century music », Aspects of Medieval and Renaissance Music, a Birthday Offering to Gustave Reese, éd. Jan LaRue, New York, W.W. Norton, 1966, p. 560-575.
48 Agostino Magro, Article « Parodie » du Guide de la Musique de la Renaissance, p. 96. Comme le montre Falck, la première occurrence connue de cette acception musicale et non textuelle est l’intitulé d’une messe à six voix de l’organiste bavarois Jacobus Paix, Parodia Mottetae Domine da nobis auxilium Thomae Crequilonis, Lauingen (Bavière), 1587.
49 Curieusement, cette acception, pourtant courante, semble ignorée du Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey, Paris, Le Robert, 1992, p. 2121. Sur la notion de timbre, sa définition et les problèmes qu’elle pose, voir aussi Romain Benini, Filles du peuple ? Pour une stylistique de la chanson au xixe siècle, Paris, ENS Éditions, 2021, p. 267-271, « La chanson à timbre ».
50 Pierre Laujon, [Préface], Les À propos de société ou chansons, t. 1, [Paris], s. n., p. vij.
51 Pierre Capelle, La Clé du Caveau, Paris, Capelle et Renand, 1re éd., 1811, p. iii.
52 Conrad Laforte, Le Catalogue de la chanson française, Chansons sur des timbres, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1983, p. vii.
53 Paris, Picard, 1942. Voir chapitre III, « L’air », p. 196-197, « Primauté des paroles, antériorité de l’air ». Coirault y revient, de manière critique, sur les définitions du timbre par ses prédécesseurs.
54 Ibid., p. 207, no 2.
55 Dictionnaire général de la langue française du commencement du xviie siècle jusqu’à nos jours, Paris, Delagrave. « Air connu sur lequel les vaudevillistes composent des couplets, et qu’ils indiquent en tête de la chanson ».
56 Henri Davenson, Le Livre des chansons, ou Introduction à la connaissance de la chanson populaire française, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1946, p. 42. Sous le pseudonyme de Davenson (1904-1977), l’historien Henri Irénée Marrou, alors titulaire de la chaire d’histoire du christianisme à la Sorbonne, offre à l’édition cet ouvrage sur la chanson traditionnelle. Engagé dans cette voie par goût personnel plus que par souci de recherche en la matière, il s’est attiré les critiques de Coirault et de ses descendants.
57 Auguste Font, Favart, l’opéra-comique et la comédie-vaudeville aux xviie et xviiie siècles, Paris, Fischbacher, 1894, p. 19.
58 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, Paris, 1690, article « Fredon ».
59 Sur ce point, voir Romain Benini, Filles du peuple ?, op. cit., p. 269, note 39.
60 https://www.cnrtl.fr/definition/timbre.
61 Lexique des termes littéraires, sous la direction de Michel Jarrety, Paris, LGF, « Le Livre de Poche », 2001, p. 444, article « timbre ».
62 Louis Douët-D’Arcq, « Inventaire après décès de Clémence de Hongrie » (1328), dans Nouveau recueil de comptes de l’argenterie des rois de France publié pour la Société de l’histoire de France, Paris, 1874, p. 64. Les hésitations de De Surmont sur la fiabilité de cette source (qu’il cite de seconde main et qu’il appelle à tort « le chansonnier de Mons ») ne paraissent pas justifiées.
63 Recueil Clairambault-Maurepas : chansonnier historique du xviiie siècle, Paris, A. Quantin, 1879-1884.
64 Jean Nicolas De Surmont, Chanson, op. cit., p. 97.
65 Éd. Pierre Capelle, Paris, Capelle et Renand, 1811. Nombreuses rééditions.
66 Jean-Nicolas de Surmont, Chanson, op. cit., p. 98 et 101.
67 [Paris], 1760-1762. 16 t. en 8 vol. in-16. Rééd. en fac-sim. Genève, Minkoff, 1971. Le fait que ce titre soit glosé suggère d’ailleurs que le mot chansonnier dans ce sens n’est pas encore courant. On peut même émettre l’hypothèse que chansonnier signifie encore ici chanteur. On notera que ce recueil comporte à la fois le texte et la musique des chansons.
68 Jean Nicolas de Surmont, Chanson, op. cit., p. 97.
69 Voir ibid., p. 98-99. Parmi les recueils ainsi intitulés on peut citer : Louis-Abel Beffroi de Reigny dit Jacques Cousin, Les Soirées chantantes ou Le chansonnier bourgeois, Paris, Moutardier, an XI-XIII [1802-1805], 3 vol. ; Chansonnier de société ou Choix de rondes, Paris, Delaunay, 1812 ; Chansonnier des grâces, Paris, Capelle et Renand, 1812 ; Chansonnier français, ou Etrennes des dames, Paris, Caillot, 1814 ; Chansonnier des pastourelles galantes, recueil de rondes anciennes et nouvelles et de chansons joyeuses, Paris, Delarue, [ca. 1815] ; Chansonnier des Dames, Paris, Louis Janet, s. d. [ca. 1820-1830] ; Henri-Léonard Bordier, Le Chansonnier Huguenot du xvie siècle, Paris, Librairie Tross, 1870 ; Chansonnier historique du xviiie siècle, Paris, A. Quantin, 1879-1884, 10 vol. ; etc.
70 Il s’agit de l’encyclopédiste Jean-Louis Castilhon.
71 Encyclopédie méthodique. Musique, t. I, Paris, Panckoucke, 1791, p. 230. De Surmont date par erreur ce texte de 1841 et commet deux erreurs de copie.
72 La Clé du Caveau, op. cit., Avertissement, p. iv.
73 Jules et Edmond de Goncourt, Journal, mémoires de la vie littéraire, éd. Robert Ricate, Paris, Fasquelle/Flammarion, 1959, t. I, p. 1023.
74 La Nouvelle Gaudriole de 1837, Paris, Chez les marchands de Nouveautés, 1837, « Chœur d’ouverture », p. 26-27.
75 Voir Jean-Nicolas De Surmont, Chanson, op. cit., p. 115-118.
76 Phillip Dennis Cate, Raphaële Martin-Pigalle, Michela Niccolai, Autour du Chat Noir, Arts et plaisirs à Montmartre 1880-1910, Paris, Skira-Flammarion-Musée de Montmartre, 2012, p. 61.
77 Sur l’histoire du mot goguette, voir Romain Benini, Filles du peuple ?, op. cit., p. 66-80, « La goguette » ; P.-J. de Béranger, « La Faridondaine. Instruction ajoutée à la circulaire de M. le Préfet de police concernant les réunions chantantes appelées goguettes. Avril 1820 », dans Chansons de P.-J. de Béranger, Paris, Perrotin, Guillaumin, Bigot, 1829, p. 210 ; Philippe Darriulat, « Chanson et identité ouvrière en France (1817-1849) », dans La Poésie délivrée, éd. Stéphane Hirschi et al., Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017.
78 Pour écouter les archives sonores de la Goguette des Z’énervés : https://goguette-des-zenerves.fr/lundis/ ; et https://goguette.bandcamp.com. En 2016, la Goguette des Z’énervés migre sur la péniche El Alamein amarrée quai François Mauriac dans le XIIIe arrondissement. On trouve également une goguette le jeudi au PIC (Petit Ivry Cabaret).
79 Voir « “Mais c’est quoi une goguette ?” : Entretien de Judith le Blanc avec Annie Legouhy, Patrice Mercier et Clémence Monnier », dans le présent volume. Les contraintes imposées par l’épidémie de Covid ont fait renouer de nombreuses personnes avec cette pratique du « chanter sur l’air de ». Lors du colloque, Martine Groccia avait montré, dans une intervention intitulée « Les Goguettes, au “Temps béni de la pandémie” : la pratique du sens, le sens de la pratique », que cette période avait été féconde pour le groupe : il a produit plusieurs goguettes « confilmées » qui lui ont valu un franc succès sur les réseaux sociaux et dans les médias, et qui l’ont définitivement sorti de l’anonymat, lui offrant un public nouveau et élargi. La goguette « T’as voulu voir le salon » en constitue le paradigme.
80 Voir https://academiedelachanson.fr/goguette/, par exemple la Goguette du Gamounet.
81 https://hexagone.me/2015/03/lheureux-mercier-comme-il-se-doit/.
82 La musicologue Isabelle His, par exemple, parle d’un « phénomène universel de recyclage », Guide de la musique de la Renaissance, dir. Françoise Ferrand, Paris, Fayard, 2011, p. 633.
83 La Bible, Traduction œcuménique, Paris, Le Cerf, 1994, p. 1305. Voir aussi Matthieu Arnold, « Le Psaume 22 chez Luther », dans Les Psaumes de la liturgie à la littérature, dir. C. Coulot, R. Heyer et J. Joubert, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2006, p. 131.
84 Charles Hauret, « Un problème insoluble ? La chronologie des psaumes », Revue des sciences religieuses, 1961, 35-3, p. 225-256.
85 Voir Zhang Rui, Du yuefu au gexing : carrière d’une poésie chantée dans la Chine du haut Moyen Âge (iiie-vie siècle), thèse de doctorat codirigée par Frédéric Wang et Valérie Lavoix, Institut national des langues et civilisations orientales (Langues O’), Paris, 2022 ; Michael A. Fuller, An Introduction to Chinese Poetry. From Canon of Poetry to the lyrics of the Song dynasty, Harvard University Center, 2018, passim ; Casey Schoenberger, Music, Mind, and Language in Chinese Poetry and Performance: The voice extended, Oxford University Press, 2024. Shen Kuo 沈括, Mengxi bitan 夢溪筆談 (Notes au fil du pinceau du ruisseau des Rêves), 1086, juan 5, tiao 95, Xielü 協律 (Les notes associées), trad. dans François Picard, « Chine, comment décrire une musique décrite comme descriptive ? », dans De l’Écoute à l’œuvre, Études interdisciplinaires, dir. Michel Imberty, Paris, L’Harmattan, coll. « Sciences de l’éducation musicale », 2001, p. 43-59.
86 Voir Huajian ji jiaozhu 花間集校註, édition annotée du Huajian ji par Yang Jinglong 楊景龍, Pékin, Zhonghua shuju, 2015. Among the flowers: The Hua-chien chi, traduit en anglais par Lois Fusek, New York, Columbia University Press, 1982. Marsha L. Wagner, The Lotus Boat: The origins of Chinese tz’u [ci] poetry in T’ang popular culture, New York, Columbia University Press, 1984. Jao Tsung-i, David J. Lebovitz, « Did Men of Song Belt Out “Tang Ci” ? An Explanation of the Poem “I Only Fear the Spring Breeze Will Chop Me Apart” », Tang Studies, no 40, 2022, p. 121-153.
87 Le Poisson de jade et l’épingle au phénix, conte anonyme, trad. Rainier Lanselle, Paris, Gallimard, « Folio », p. 21-22. Voir aussi ibid., p. 62, où deux autres poèmes sont ainsi composés.
88 Odet de La Noue, L’Uranie ou Nouveau recueil de chansons spirituelles et chrestiennes, [Genève], Jacques Chouët, 1591, Préface « À toutes personnes qui aiment Dieu et qui desirent s’esjouïr en le louant : grâce et paix, et salut par Jésus-Christ » (dans Henri-Léonard Bordier, Le Chansonnier huguenot du xvie siècle, Réimpression de l’éd. de Paris et Lyon, 1870-1871, Genève, Slatkine Reprints, 1969, p. xxxv-xxxviij).
89 Voici la traduction du passage de Théodoret : « Harmonius fils de Bardesànès ayant composé des Hymnes, où sous la beauté de la poésie il avait caché le venin de l’erreur, Ephrem en composa d’autres, qui, avec l’élégance des termes, avaient la sincérité de la piété. Ces hymnes illustrent encore aujourd’hui les Fêtes des saints Martyrs. » Michel Coyssard, Traité du profit que toute personne tire de chanter en la Doctrine Chrétienne (voir infra la référence complète note 119), p. 38-39.
90 Nombre de ces hymnes ont été traduites en français : voir Hymnes sur le Paradis, Paris, Éditions du Cerf, « Sources Chrétiennes », no 137, 1968 ; Hymnes sur la Nativité, « Sources chrétiennes », no 459, 2001 ; Hymnes pascales, « Sources chrétiennes », no 502, 2006 ; Hymnes sur le jeûne, Hymnes sur l’Épiphanie. Hymnes baptismales de l’Orient syrien, « Spiritualité orientale », nos 69 et 70, Éditions de Bellefontaine, 1996 ; Hymnes contre les hérésies, éd. et trad. par Dominique Cerbelaud, Paris, Cerf, « Sources chrétiennes », 2017, et par Flavia Ruani, Paris, Les Belles Lettres, 2018. Pour une étude récente et une bibliographie plus complète, voir Flavia Ruani, « L’art polémique d’Ephrem de Nisibe, ou comment fabriquer un hérétique grâce à la poésie chantée au ive siècle », dans Polémiques en chanson, dir. Luce Albert et Mickaël Ribreau, Rennes, PUR, 2022, p. 347-381.
91 Ce manuscrit, conservé au palais épiscopal de Kilkenny, présente soixante poèmes latins précédés de cet avertissement, premier cas, à notre connaissance de métadiscours désignant comme telle une composition sur timbre sur la transformation délibérée d’airs profanes en chansons pieuses : « Attende, lector, qu[o]d Episcopus Ossoriensis fecit istas cantilenas pro vicariis Ecclesie Cathedralis sacerdotibus et clericis suis ad cantandum in magnis festis et solaciis, ne guttura eorum et ora Deo sanctificata polluantur cantilenis teatralibus, turpibus et secularibus, et cum sint cantatores prouideant sibi de notis conuenientibus secundum quod dictamina requirunt. » (« Sache, lecteur, que l’évêque d’Ossory [le franciscain Richard de Ledrede, mort en 1360] a composé ces chants pour les vicaires de l’église cathédrale, pour les prêtres, et pour les clercs, pour être chantés à l’occasion des grandes fêtes et célébrations, afin d’éviter que leurs gorges et bouches consacrées à Dieu ne soient souillées par des chansons pleines de turpitudes mondaines ; et puisqu’ils sont chantres, qu’ils se pourvoient eux-mêmes des airs qui conviendront aux paroles. ») (The Lyrics of the Red Book of Ossory, éd. Richard Leighton Greene, Oxford, Blackwell, « Medium Aevum Monographs », 1974, p. iii-iv. Traduction de J. Vignes.
92 Voir Chansons à la Vierge, éd. J. Chailley, Paris, 1959 ; A. Drzewicka, « La fonction des emprunts à la poésie profane dans les chansons mariales de Gautier de Coinci », Le Moyen Âge, 91, 1985, p. 33-51, 179-200.
93 Voir dans le présent volume les contributions d’Alice Tacaille (« Le timbre à la Renaissance : essai de synthèse » et « La base Trésor des Chansons Françaises (TCF) XVI-XVII »), de Fañch Thoraval, « Stanze di passione. Intertextualités liturgiques entre cantasi come et libri da compagnia (xve-xvie siècles) », et de Nicolas Andlauer, « La villanelle en habits du dimanche : un air italien entre archétypes et réalités ».
94 Adrienne F. Block, art. cité, p. 21.
95 Voir infra la contribution d’Alice Tacaille. On consultera surtout Pierre Rézeau, Les Noëls en France aux xve et xive siècles, édition et analyse, Strasbourg, Bibliothèque linguistique romane, 2013. Voir aussi J. Vignes et M.-A. Colin, articles « Noël » du Guide de la musique de la Renaissance, op. cit., p. 757-759 ; Amédée Gastoué, Le Cantique populaire en France. Ses sources, son histoire, augmentés d’une bibliographie générale des anciens cantiques et noëls, Lyon, Janin, 1924 ; Henry Poulaille, Bible des noëls anciens, Paris, Albin Michel, 1952 ; Adrienne F. Block, The Early French Parody Noël (thèse de 1979), Ann Arbor (Michigan), U.M.I. Research Press, 1983 ; A. F. Block, « Timbre, texte et air, ou comment le noël-parodie peut aider à l’étude de la chanson du xvie siècle », Revue de Musicologie, t. 69-1 (1983), p. 21-54 ; Marina Fey (éd.), Noëls en français et en dialectes du xvie siècle (thèse de 2004), Lyon, Université Lyon III Jean Moulin, 2008 ; Isabelle His, « Le noël au cœur des polémiques confessionnelles », art. cité, p. 221-248.
96 Ces noëls sont conservés dans deux manuscrits de la BnF (fr. 2368 et fr. 2506) et dans un imprimé S’ensnivent [sic] les Noëlz très excelens et contemplatifz, publié par Guillaume Guerson entre 1495 et 1502, considéré comme le premier recueil de noëls imprimé.
97 Brian Jeffery, Chanson Verse of Early Renaissance, Londres, Tecla, 1971 et 1976, 2 vol. Le plus ancien recueil identifié s’intitule S’ensuyvent plusieurs belles chansons nouvelles. Et sont au nombre de iiii.xx. et dix., s. l. n. d. (malgré l’indication de 90 chansons dans le titre, le recueil n’en compte que 39). Les titres suivants sont très voisins : S’ensuyvent plusieurs Belles chansons nouvelles Et premierement […], S’ensuyvent unze Belles chansons nouvelles, S’ensuyvent xii Belles chansons nouvelles… Voir aussi Alice Tacaille, L’Air et la chanson. Les paroliers sans musique au temps de François Ier, ouvrage inédit pour l’HDR, Sorbonne Université, 2015, disponible sur HAL SHS.
98 Voir La Chanson d’actualité, de Louis XII à Henri IV, sous la direction d’Olivier Millet, Alice Tacaille et Jean Vignes, Cahiers V. L. Saulnier, no 36, Paris, Sorbonne Université Presses, 2021.
99 Stéphane Partiot, « Voulez ouyr une chanson ? » Le genre éditorial du parolier imprimé à la Renaissance : étude des publications des libraires Bonfons et Rigaud (1548-1597), thèse sous la dir. de J. Vignes, Université de Paris, 2021.
100 Karine Abiven cosigne avec Miriam Speyer une des contributions du présent volume : « La chanson comme preuve de noblesse : le cas de la Fine galanterie du temps (Ribou, 1661) ».
101 Voir la présentation par Alice Tacaille de « La base Trésor des Chansons Françaises (TCF16-17) » dans le présent volume.
102 Estelle Doudet, « Les chansons au théâtre : intermédialité et polémique aux xve et xvie siècles », Polémiques en chanson, op. cit., p. 161-175. Voir aussi Howard Mayer Brown, Music in the French Secular Theater, Harvard, Harvard University Press, 1963.
103 L’existence même de ce « supplément » à l’aube du règne poétique de Ronsard illustre la faveur dont jouit alors la pratique de la chanson sur timbre. Les amateurs sont invités à chanter la quasi-totalité des sonnets des Amours sur les mises en musique de quatre d’entre eux par Janequin, Certon, Goudimel et Muret. Voir Jean Vignes, « Poésie en musique : des Amours de Ronsard au “Supplément musical” », dans Relire Les Amours de Ronsard, actes de la journée d’étude pour l’agrégation organisée à Paris Diderot le 4 décembre 2015, dir. Nathalie Dauvois et Jean Vignes ; Luigi Collarile et Daniele Maira, Ronsard et la mise en musique des Amours (1552-1553), Paris, Garnier, 2016, avec fac-similés et partitions établies par Luigi Collarile ; Jean-Eudes Girot et Alice Tacaille, « Que me servent mes vers ? » La musique chez Ronsard, avec un supplément vocal de 22 chansons, Paris, Classiques Garnier, 2020, avec les partitions établies par Alice Tacaille, p. 456-551.
104 Un des premiers à souligner ce phénomène est Henri Léonard Bordier dans Le Chansonnier huguenot du xvie siècle, réimpression de l’éd. de Paris et Lyon, 1870-1871, Genève, Slatkine Reprints, 1969, p. xxxij-xxxiv.
105 Le Psaume X, par exemple, se chante « sus Dont vient cela », c’est-à-dire sur l’air de la chanson XIV de l’Adolescence clémentine ; le psaume CXXXVIII sur l’air de la chanson XXIV « Quand vous voudrez faire une amye », etc. Voir Clément Marot, Cinquante pseaumes de David mis en françoys selon la verité hébraïque, éd. G. Defaux, Paris, Champion, 1995, p. 264-265.
106 Voir plus loin la contribution d’Alice Tacaille. Il pourrait s’agir d’une réplique au recueil de Jehan Daniel Noelz nouveaulx Chansons nouvelles de nouel composées tout de nouvel esquelles verrez les praticques de confondre les hereticques, [1525 ?].
107 Voir aussi Recueil de plusieurs chansons spirituelles tant vieilles que nouvelles, avec le chant sur chacune : afin que le Chrestien se puisse esjouir en son Dieu & l’honorer : au lieu que les infidelles se deshonorent par leurs chansons mondaines & impudiques. [par Mathieu Malingre], s. l. s. n. 1555.
108 Voir l’édition de Georges Dottin, Genève-Paris, Droz-Minard, 1971, et Marguerite de Navarre, Œuvres complètes, dir. Nicole Cazauran, t. IX, éd. Michèle Clément, Paris, Champion, 2001. Voir aussi François Rigolot, Poésie et Renaissance, Paris, Points-Seuil, 2002, p. 209-212.
109 Chrestienne Resjouyssance composée par Eustorg de Beaulieu, jadis prestre, musicien et organiste en la faulce église papistique, et despuis ministre evangelique en la vraye Eglise. Genève, Jean Girard, 1546, Chanson XXXIV, p. 28, strophe 3. Voir la chanson complète dans Bordier, Le Chansonnier huguenot, op. cit., p. lxxxj-lxxij, pièce IV. Sur cet important recueil, voir aussi Alice Tacaille, « Eustorg de Beaulieu parodiste : la Chrestienne resjouyssance comme propagande musicale », Revue d’histoire du protestantisme, vol. 3, nos 3/4 (juillet-décembre 2018), p. 501-533 ; et Julien Goeury, « Ta chanterie pugne directement contre la charité. Normes et usages de la chanson polémique dans la Chrestienne Resjouyssance d’Eustorg de Beaulieu », Polémiques en chanson, op. cit., p. 275-293.
110 Voir Jacques Pineaux, La Poésie des protestants de langue française (1559-1598), Paris, Klincksieck, 1971 ; Denise Launay, La Musique religieuse en France, op. cit. ; Anne Ullberg, Au chemin de salvation : la chanson spirituelle reformée (1533-1678), Uppsala, Uppsala Universitet, 2005 ; Isabelle His, « Contrafactum (contrefacture) » dans Guide de la musique de La Renaissance, op. cit., p. 633-637 ; Véronique Ferrer, « La chanson spirituelle au temps de la Réforme (1533-1591) », Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, no 7, 2012, p. 43-52 ; Melinda Latour, « Disciplining Song in Sixteenth-Century Geneva », Journal of Musicology, 32, no 1 (hiver 2015), p. 1-38. On pourrait compléter ces travaux en évoquant la place des timbres dans le théâtre réformé.
111 Sonets chrestiens mis en musique à quatre parties, Genève, Jean Le Royer, 1578 ; Premier [-Second] livre de sonets chrestiens mis en musique à quatre parties, Genève, Jean Le Royer pour Charles Pesnot à Lyon, 1580.
112 Voir Isabelle His, « Le noël au cœur des polémiques confessionnelles », art. cité, p. 234-241.
113 Voir Nicolas Lombart, « Chantez tous d’exultation : modulations de la parole lyrique et célébration politique dans les Cantiques déchantez de Pierre Doré (1549) », dans Les Mises en scène de la parole aux xvie et xviie siècles, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2007 ; Pierre Tenne, « Les Cantiques dechantees de Pierre Doré : un recueil pionnier dans l’histoire du chant catholique », dans La Chanson d’actualité, de Louis XII à Henri IV, op. cit., p. 161-180.
114 Traité, op. cit., p. 40.
115 Voir Tatiana Debbagi Baranova, « Combat d’un bourgeois parisien. Christophe de Bordeaux et son Beau recueil de plusieurs belles chansons spirituelles (1569) », dans Médialité et interprétation contemporaine des premières guerres de religion, Institut historique allemand de Paris, 8-9 octobre 2012, éd. Deutsches Hist. Institut, Gabriele Haug-Moritz and Lothar Schilling, Berlin / München / Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2014, p. 135-146. Voir aussi Tatiana Debbagi Baranova, À coups de libelles. Une culture politique au temps des guerres de Religion (1562-1598), Genève, Droz, 2012 ; enfin Jean Vignes, « Chansons à massacrer. Coq-à-l’âne et chansons catholiques autour de la Saint-Barthélemy », dans Polémiques en chansons, dir. Luce Albert et Mickaël Ribreau, Rennes, PUR, 2022, p. 347-381.
116 Voir Karine Abiven, Sur l’air de la Fronde. Chansons d’actualité et révolte urbaine aux xviie-xviiie siècles, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2026, voir aussi le site créé par Karine Abiven : « Mazarinades : des écrits d’actualité pendant la Fronde » et ses enregistrements des mazarinades : https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#sur-lair-de-la-fronde-karine-abiven-mp3 et la base de données Trésor des chansons françaises 16-17.
117 Voir par exemple Michel Coyssard, Paraphrase des hymnes et cantiques spirituels pour chanter avec la Doctrine Chrestienne (1592, nombreuses rééditions jusqu’en 1608) ; Jean Gentil, Chants spirituels (Lyon, 1596) ; [Guillaume Marc ou Marci ?], Les Rossignols spirituels. Liguez en Duo, dont les meilleurs accords, nommément le Bas, relevent du Seigneur Pierre Philippes, Organiste de ses Altezes Serenissimes (Valenciennes, J. Vervliet, 1616 ; rééd. 1621 ; Cologne, 1647) ; La Despouille d’Ægipte ou larcin glorieux des plus beaux Airs de Cour apliquez à la Musique du Sanctuaire, dédié à la Reyne (Paris, Pierre Ballard, 1629) ; etc.
118 L’Amphion sacré, 1615, cité par Denise Launay, La Musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, op. cit., p. 183.
119 Voir Gabriel Pau, « De l’usage de la chanson spirituelle par les Jésuites au temps de la Contre-Réforme », dans les actes du colloque La Chanson à la Renaissance, éd. J.-M. Vaccaro, Tours, Van de Velde, 1981, p. 15-34. Pau analyse un texte théorique très riche dû au père Michel Coyssard, Traicté du Profit que toute personne tire de chanter en la Doctrine Chrétienne et ailleurs, les hymnes et chansons spirituelles en vulgaire : et du mal qu’apportent les lascives et hérétiques controuvées de Satan publié à la suite du Sommaire de la Doctrine Chrestienne mis en vers françois et des Hymnes sacrez et Odes spirituelles du même auteur (Lyon, Jean Pillehotte, 1608 ; en ligne sur Gallica). Voir aussi l’analyse plus succincte du même traité par Denise Launay, dans La Musique religieuse en France, op. cit., p. 127-129.
120 G. Pau, art. cité, p. 27.
121 Dorothy Packer, Acta Musicologia, LXI, 2, 1989, p. 175-216, voir le catalogue des recueils p. 206-210.
122 La pieuse Alouette avec son tirelire. Le petit cors, & plumes de notre Alouëtte, sont Chansons spirituëlles, qui toutes luy font prendre le vol, & aspirer aux choses celestes & eternelles. Elles sont partie recueillies de divers Autheurs, partie aussi composées de nouveau ; la plus part sur les airs mondains, & plus communs, qui servent aussi de vois à notre Alouette pour chanter les louanges du commun Createur, Valenciennes, Jan Vervliet, 1619-1621. Voir le Répertoire international des sources musicales (RISM), 1619.9 et 1621.9 ; Marc Desmet, « Les Métamorphoses de l’air de cour dans La Pieuse alouette (Valenciennes, Jean Vervliet, 1619-1621) », dans Poésie, Musique et Société : l’Air de Cour en France au xviie siècle, textes réunis par Georgie Durosoir, Sprimont, Mardaga, 2006, p. 245-262 ; M. Desmet, « Les limites d’une conception schématique : le problème de la conversion des airs profanes en airs spirituels dans La Pieuse Alouette (Valenciennes, 1619-1621) », dans Musique et schèmes, entre percept et concept, dir. Béatrice Ramaut-Chevassus, Saint-Étienne, Publication de l’université de Saint-Étienne, 2006, p. 13-45 ; Jean Vignes, « Chansons spirituelles, pratique du contrafactum et mise en recueil : les paradoxes de La Pieuse alouette avec son tirelire… », dans L’Unique change de scène. Écritures spirituelles et discours amoureux, dir. Véronique Ferrer, Barbara Marczuk et Jean-René Valette, Paris, Garnier, 2016, p. 331-364.
123 M. Desmet, art. cité, p. 23 et p. 245. D. Packer dénombre pour sa part « about 860 secular chansons, mostly airs de cour » (art. cité, p. 197).
124 Selon l’heureuse formule d’Adrienne F. Block, art. cité.
125 Voir dans le présent volume : Clément Duyck, « Parodie et prophétie. Les Poésies et Cantiques spirituels de Jeanne-Marie Guyon à Lausanne (deuxième moitié du xviiie siècle-premier tiers du xixe siècle) ».
126 Les deux versions sont enregistrées par Marco Horvat et l’ensemble Faenza dans La Semaine mystique, chants de dévotion sous Louis XIII, Alpha 103, 2006.
127 « Avis au lecteur », dans Noëls nouveaux sur les airs anciens, Paris, Jean de Nully, 1712, fo Aij.
128 Bossuet, Maximes et réflexions sur la Comédie, Paris, Jean Anisson, 1694, p. 6-8.
129 Sur la parodie spirituelle au xviie siècle, voir Herbert Schneider, « La parodie spirituelle de chansons et d’airs profanes chez Lully et chez ses contemporains », dans La Pensée religieuse dans la littérature et la civilisation du xviie siècle en France, colloque de Bamberg 1983, dir. Manfred Tietz et Volker Kapp, Paris-Seattle-Tubingen, Biblio 17, 1984, p. 69-91 ; Anne-Madeleine Goulet, Poésie, musique et sociabilité au xviie siècle. Les Livres d’airs de différents auteurs publiés chez Ballard de 1658 à 1694, Paris, Champion, 2004, p. 480 et suivantes ; Thierry Favier, « Plaisir musical et parodies spirituelles : les visages multiples de la réminiscence », dans Le Plaisir musical en France au xviie siècle, Liège, Mardaga, 2006, p. 115-127, et « Chant et apostolat en milieu mondain à la fin du xviie siècle : Bacilly et ses continuateurs », dans Le Chant, acteur de l’histoire, dir. Jean Quéniart, Rennes, PUR, 1999, p. 89-99 ; Benjamin Pintiaux, « Stratégies et dispositifs de l’écriture parodique dans les Cantiques spirituels et les Noëls de l’Abbé Pellegrin », dans La Fabrique des paroles de musique à l’âge classique, dir. Anne-Madeleine Goulet et Laura Naudeix, Centre de Musique Baroque de Versailles, Mardaga, 2010, p. 329-341. Voir aussi les enregistrements suivants : Le Concert lorrain dirigé par Anne-Catherine Bucher, Henry Desmarest, Manuscrit des Ursulines de la Nouvelle-Orléans, CD K61 (avec une présentation d’Anne-Madeleine Goulet, « les Méandres de la Foi ») ; Jean-Luc Impe et Les Menus Plaisirs de Roy, Parodies spirituelles et spiritualité en parodies, Musica Ficta, 2010 ; Marco Horvat, La Semaine Mystique, chants de dévotion sous Louis XIII, Alpha, 2006.
130 Cité par Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, Paris, Fayard, 2002, p. 248. L’anecdote vient de la Correspondance de Madame de Sévigné, Lettre du 24 juillet 1689, éd. R. Duchêne, Paris, 1972-1978, t. III, p. 651.
131 Voir par exemple les Chansons spirituelles sur des airs d’opéras tant anciens que nouveaux et vaudevilles, Paris, Le Clerc, 1701, 3 vol., de l’abbé Simon-Joseph Pellegrin.
132 Voir par exemple les Noëls de Saboly (1668-1674) sur des airs de Lully.
133 Simon-Joseph Pellegrin, Chansons spirituelles, op. cit. Voir aussi du même : Cantiques spirituels sur divers passages de l’Évangile, s. l. s. d. ; Noëls nouveaux pour l’année sainte, et chansons spirituelles propres pour le temps du Jubilé et pour tout le cours de l’année, sur des chants anciens, airs d’opéras très connus, vaudevilles choisis et chants de l’Église, seconde édition, Paris, Nicolas Le Clerc, 1702.
134 Herbert Schneider, « La parodie spirituelle… », art. cité, p. 80.
135 Par exemple « Que chacun avec moi s’avance vers la crèche », dans Noëls nouveaux, 3e recueil, Paris, Le Clerc, 1739, p. 189, sur l’air Qu’il est doux d’être amant d’une bergère aimable, Quinault et Lully, Le Temple de la Paix, 1685.
136 Catherine Massip, « L’air dans la tragédie lyrique », dans La Tragédie lyrique, Paris, Cicero éditeurs, « Les Carnets du théâtre des Champs-Élysées », 1991, p. 131.
137 Voir dans le présent volume Bertrand Porot, « L’air de vaudeville comme paradigme compositionnel ».
138 Titon du Tillet, Le Parnasse français, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1732, p. 395.
139 Parodies bachiques sur les airs et symphonies des opéras, recueillies et mises en ordre par M. Ribon, Amsterdam, suivant la copie de Paris, J. du Fresne, 1696, « Épître dédicatoire », n. p.
140 Avertissement des Parodies Bachiques : « La réputation des ouvrages de feu M. de Lully augmentant de jour en jour depuis la perte qu’on a faite de cet excellent homme, et le goût que l’on a toujours eu pour toutes les pièces de sa composition, étant aujourd’hui plus à la mode que jamais ; on a cru faire plaisir aux amateurs de la belle symphonie de leur donner ce recueil de parodies bachiques composées par diverses personnes qui se sont trouvées un talent particulier pour appliquer des paroles aux airs qui n’en ont point naturellement dans les opéras, et même pour en ajuster de nouvelles à ceux qui en ont, les premiers rendront les airs de ballets plus aisés à retenir, et les secondes réveilleront le goût que l’on a pour les autres ». Ibid., n. p.
141 Parodies bachiques sur les airs et symphonies des opéras, recueillies et mises en ordre par M. Ribon, Paris, Ch. Ballard, 1696, p. 215.
142 Parodies bachiques sur les airs et symphonies des opéras, op. cit., p. 73.
143 « Avertissement », Nouvelles parodies bachiques, mêlées de vaudevilles ou rondes de table, Paris, Ch. Ballard, 1700, vol. I, n. p.
144 Voir par exemple l’aventure de la guerre des couplets sur l’air Que l’Amant qui devient heureux du prologue d’Hésione, qui mena Jean-Baptiste Rousseau au bannissement et à l’exil. Claude et François Parfaict, Histoire du théâtre français depuis son origine jusqu’à présent, avec la vie des plus célèbres Poètes dramatiques, des extraits exacts, et un catalogue raisonné de leurs pièces, accompagnés de notes historiques et critiques, Paris, Le Mercier, Saillant, 1735-1749, vol. XIV, p. 187-214 ; Ms. fr. 12689, Recueil de chansons ou vaudevilles satiriques et historiques avec remarques curieuses, du 1er de l’an 1685 jusqu’à la fin de l’an 1689, vol. 7, p. 629-636.
145 Mercure galant, avril 1701, p. 261-262.
146 Charles Collé, Journal et Mémoires sur les hommes de Lettres, les ouvrages dramatiques et les événements les plus mémorables du règne de Louis XV (1748-1772), Paris, Firmin Didot, 1868, 3 vol. ; Genève, Slatkine reprints, 1967. En février 1749 et en mai 1749, on trouve des couplets sur l’air des Trembleurs d’Isis.
147 Ch. Collé, Recueil complet des Chansons de Collé, Paris, 1807, Les Trembleurs, t. I, p. 105 ; parodie de l’air La Beauté la plus sévère, t. II, p. 158. Dans les Chansons joyeuses, mises au jour par un ane-onyme, onissime. Nouvelle édition, considérablement augmentée, et avec de grands changements qu’il faudrait encore changer, de C. Collé, intégrées à la fin de l’Anthologie française ou chansons choisies depuis le 13e siècle jusqu’à nos jours, 1765, t. III, on trouve un couplet intitulé « Le faux serment » sur l’air Le Démon malicieux et fin (menuet du prologue d’Isis), p. 26 ; « La proposition raisonnable », et un « Impromptu » sur l’air Que le péril est agréable (d’Atys), p. 52.
148 Charles Collé, Recueil complet des Chansons de Collé, Paris, 1807 : « Parodie du Menuet d’Erato », t. II, p. 68.
149 Ibid., t. I, p. 60 ; t. II, p. 23.
150 Joseph de Laporte et Jean-Marie-Bernard Clément, Anecdotes dramatiques, Paris, Duchesne, 1775, t. II, p. 334.
151 Philippe-Emmanuel de Coulanges, Recueil de chansons choisies divisé en deux parties, Paris, Simon Benard, 1694, p. 196, 197 et p. 240-243.
152 Philippe-Emmanuel de Coulanges, Chansons choisies de M. de Coulange mises sur des airs connus, Paris, Valleyre fils, 1754.
153 Sur ce que nous appelons « air-vaudeville », voir Judith le Blanc, Avatars d’opéras, op. cit., « Troisième partie. Les airs-vaudevilles d’opéra, échos paradigmatiques d’une culture circulaire », p. 539 et suivantes.
154 Voir Marlène Belly, « La composition sur timbre : regard anthropologique sur un genre hybride », dans L. Charles-Dominique, D. Pistone et Y. Defrance (dir.), Fascinantes étrangetés, La découverte de l’altérité musicale en Europe au xixe siècle, Paris, L’Harmattan, coll. « Ethnomusicologie et anthropologie musicale de l’espace français », 2014, p. 307-323.
155 Voir Herbert Schneider, « La fable chantée sur les timbres et ses fonctions », dans Le Chant, acteur de l’histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000, p. 137-150.
156 Louis Fuzelier, La Mode, 1719, BnF, Département de la Musique, ThB 2247, p. 17. Voir Judith le Blanc, « “Je sommes tous des Lully”. Parodies d’opéras et circulation des airs chantés (xviie-xviiie siècles) », Musicologies nouvelles, no 9 : « Agrégation de Musique 2020. Intertextualité et intermusicalité, Le style concertant », Éditions Musicales Lugdivine, 2019, p. 58-66.
157 Anne-Madeleine Goulet, Poésie, musique et sociabilité au xviie siècle, op. cit., p. 428.
158 B. Level, « Poètes et musiciens du Caveau », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, no 41, mai 1989, p. 167.
159 Anne-Madeleine Goulet, Poésie, musique et sociabilité au xviie siècle, op. cit., p. 429. Il arrive aussi que certains airs sérieux se propagent sur la scène des théâtres sous forme de vaudevilles : « Grâce à La Fontaine et à ses Fables, grâce aussi à Boileau et à la satire du Repas, tout le monde connaît, de réputation, Lambert, le beau-père de Lully. Mais ce n’est pas seulement le nom de ce compositeur si justement célèbre qui est venu jusqu’à nous ; ses airs aussi lui ont survécu de la manière la plus complète, et tout le monde les chante aujourd’hui, en 1888, sans savoir qu’ils sont de lui ; par exemple : Et zon zon zon, ma Lisette, ma Lisette, […] Et lon lan la landerirette […] », A. Loquin, La Chanson française, lettre-conférence, Paul Lavigne, 1888, p. 9. Ces deux vaudevilles – resterait à vérifier qu’ils sont bien de Lambert – sont très largement répandus sur la scène des théâtres parisiens.
160 Charles Sorel (ou Charles de Beys), La Comédie de chansons, Paris, T. Quinet, 1640.
161 Anonyme, L’Inconstant vaincu, pastorale en chansons, Paris, J. Guignard, 1661.
162 Anonyme, Nouvelle Comédie de chansons de ce temps, pastorale, Paris, E. Loyson, 1662.
163 « Le Libraire à qui lira », L’Inconstant vaincu, n. p.
164 Opéra de Fontenelle, Thomas Corneille et Lully créé en 1679.
165 Dufresny, Le Départ des comédiens, dans Gherardi, éd. 1741, fac.-sim. Slatkine, 1969, vol. 5, p. 356.
166 À l’origine, dans Isis (IV, 1), cet air introduit le chœur des peuples de Scythie qui grelottent de froid.
167 « Qu’un homme entre en mariage, / Qu’il prenne une fille sage. / Qui passe en son voisinage / Pour exemple de vertu : / Fût-il rusé comme un braque, / Et sage comme un pibraque, / Un jeune fou survient : craque, / Voilà le sage cocu », Théâtre Italien de Gherardi, Paris, P. Vitte, 1717, t. IV, Les Aventures des Champs-Élysées, scène dernière. Guy du Faur de Pibrac est un moraliste du xvie siècle.
168 Voir Bertrand Porot, « Aux origines de l’opéra-comique : étude musicale du Théâtre de la Foire de Lesage et d’Orneval (1713-1734) », dans The Opéra-comique in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, dir. Lorenzo Frassa, Turnhout, Brépols Publishers, « Speculum Musicae 15 », 2011, p. 283-329.
169 Alain-René Lesage et Jacques-Philippe d’Orneval, Le Théâtre de la foire, ou l’Opéra Comique. Contenant les meilleures pièces qui ont été représentées aux foires de S. Germain et de S. Laurent : enrichies d’estampes en taille douce, avec une table de tous les vaudevilles et autres airs gravez-notez à la fin de chaque volume, Paris, Ganeau, 1724, Pissot, 1728, Gandouin, 1731-1737, 10 vol., vol. 1, « Préface », p. 19-20.
170 Sur les spectacles forains, voir aussi les rapports de police dressés à la demande de la Comédie-Française collectés par Émile Campardon : Les Spectacles de la Foire, Paris, 1877, en ligne.
171 Lesage et d’Orneval, Théâtre de la Foire, op. cit., « Préface », n. p.
172 Voir aussi dans le présent volume l’article de Julien Le Goff, « La pratique du vaudeville dans les opéras-comiques d’Alexis Piron (1722-1734) ».
173 Sur les caractéristiques musicales des vaudevilles, voir Bertrand Porot, « Aux origines de l’opéra-comique », art. cité, ainsi que le cours d’agrégation 2020-2021, en ligne.
174 Archives nationales, ET/MC/ET/VI/644, Depost, 11 mai 1718. Gillier s’engage à « faire faire les répétitions, [et à] montrer aux acteurs et actrices les airs ».
175 Po, Carton Favart I, C12, « État des engagements », Foire Saint-Laurent 1744, f. 12.
176 Voir Judith le Blanc, Avatars d’opéras, op. cit., p. 539.
177 Corinne Pré, « L’utilisation des timbres dans les pièces en vaudevilles », dans La Commedia dell’arte, le théâtre forain et les spectacles de plein air en Europe (xvie-xviiie siècles), dir. I. Mamczarz, Paris, Klincksieck, 1998, p. 138. On se reportera avec profit à la base Theaville.org qui recense 1109 vaudevilles empruntés au répertoire des parodies dramatiques d’opéras au xviiie siècle avec 2 388 occurrences notées.
178 Pour l’usage des vaudevilles dans le théâtre du xixe siècle, on pourra se reporter à l’analyse par Roxane Martin de La Musette du Vaudeville, ou Recueil complet des airs de Monsieur Doche, Paris, chez l’Auteur, 1822, 2 vol. Roxane Martin, La Féerie romantique sur les scènes parisiennes 1791-1864, Paris, Champion, 2007, p. 159-164, et « Index des airs chantés », p. 618-640.
179 Voir Benjamin Pintiaux, « Timbres, vaudevilles et pots-pourris sur le boulevard du temple (1750-1800) » dans le présent volume.
180 Par « clef/clé », on entend une compilation d’airs connus de tout un chacun et dans lequel les paroliers viennent puiser pour choisir le support mélodique de leur poème.
181 Sur cette publication et le vaudeville, voir Bertrand Porot, cours d’agrégation 2020-2021, en ligne.
182 Voir Sylvie Bouissou, « air sérieux », dans Dictionnaire de la musique en France aux xviie et xviiie siècles, dir. Marcelle Benoît, Paris, Fayard, 1992, p. 10. Ces « Recueils d’airs sérieux et à boire de différents auteurs » prennent la suite des « Livres d’airs de différents auteurs » à partir de 1658 et des « Recueils de chansonnettes » de 1675.
183 Les Rondes, chansons à danser, éd. Ballard, Paris, Ballard, 1724.
184 Ibid., [Préface], s. p.
185 Recueil des plus belles chansons et airs de cour, Paris, Vve Oudot, s. d. (ca. 1722), p. 181, en ligne sur Gallica.
186 Ibid., p. 186.
187 La Clef des chansonniers a connu une réédition en 2005 par Herbert Schneider, Musikwissenschaftliche Publikationen 25, Olms, 2005. Elle classe les vaudevilles par ordre alphabétique et en donne une version homogénéisée selon le principe de la notation musicale moderne.
188 Air du ballet d’Hercule amoureux, La Clef des chansonniers, op. cit., t. I, p. 110 : il s’agit d’un opéra de Francesco Cavalli donné en 1662 sous le titre d’Ercole amante et qui comprenait des danses de Lully. Air des Bergers du Ballet des Arts, ibid., vol. 2, p. 44 : ballet de Lully et Isaac de Benserade créé en 1663. Charpentier : t. I, p. 74, « Qu’ils sont doux bouteille ma mie », Incipit : « Qu’il est doux charmante Climène », dans Charpentier, Airs sérieux et à boire, Bulletin de la société Marc-Antoine Charpentier, no 10, 2003, p. 6.
189 Un immense travail d’attribution des vaudevilles reste à mener.
190 La Clef des chansonniers, op. cit., « Avertissement », s. p.
191 Voir Jacques Cheyronnaud, Des airs et des coupes. La Clé du Caveau, bréviaire des chansonniers. Introduction à une histoire de la chanson en France au xixe siècle, Paris, René Viénet, 2007.
192 Pierre Capelle, La Clé du Caveau, Paris, Cotelle, 4e éd., 1847, p. xii.
193 Ibid., p. xi-xii.
194 Ibid., p. xiv. Notons que Capelle attribue déjà une valeur restrictive au mot timbre : « parmi les contredanses et les rondeaux mêmes, je n’ai pris que ceux sur lesquels on a déjà fait des couplets. » (p. xiii).
195 Voir Brigitte Level, Le Caveau, société bachique et chantante 1726-1939, Paris, Presses de l’Université Paris Sorbonne, 1988, ouvrage qui rassemble une documentation très riche et de première main sur les avatars successifs du Caveau. On y trouve notamment, outre une abondante bibliographie, les plaisants « Statuts des dîners du Vaudeville » écrits sur dix airs différents, et un important choix de chansons sur timbre.
196 Pierre Capelle, La Clé du Caveau, op. cit., p. i.
197 Ibid.
198 En lien avec incultes, au sens où l’entend Patrice Coirault : ceux qui n’ont pas reçu la culture dispensée à l’élite.
199 On parle alors de coupletier ou de coupleteur pour désigner le parolier et de chansonnage pour préciser l’action de celui qui chansonne.
200 Les dix mille exemplaires des Chansons de Béranger, parus le 25 octobre 1821, se seraient vendus en huit jours.
201 Émile Debraux et F. Dauphin, Le Bréviaire du chansonnier, ou l’Art de faire des chansons, Paris, Hocquart Jeune, 1830 ; Marcel Moreau, Le Métier de chansonnier, petit manuel pratique du parolier à la portée de tous, s. l. n. d.
202 L’exemplaire de La Nouvelle Gaudriole de 1837 que nous consultons porte la mention : « Ce petit chansonnier à été donnée [sic] à mon amie Lécheneaux le 20 janvier 1837. Héloïse. »
203 Sur cet auteur, voir dans le présent volume : Romain Benini, « Chansons et politique pendant la Restauration : le cas d’Émile Debraux ».
204 Le titre fera florès : voir La Nouvelle Gaudriole de 1839. Chansons nationales, grivoises, facetieuses et bachiques, même éditeur, 1839 ; La Nouvelle Gaudriole : recueil de chansons bachiques, grivoises et facétieuses, 1857 ; La Nouvelle Gaudriole : choix des meilleures romances, chansons et chansonnettes en vogue, illustrée de dix dessins et augmentée de dix chansons avec musique, 1869 ; La Gaudriole Chansonnier joyeux, facétieux et grivois, s. d. [1879]. En quarante ans la liste des auteurs a un peu évolué : Béranger, Désaugiers, Collé, A. Gouffé, L. Festeau, J. Cabassol, Jacquemard, Aug. Gilles, H. Simon, Albert-M. Dauphin, Moineaux, etc.
205 Pour une autre autrice de cette période, voir Catherine Merle, « Chansons et timbres chez Constance de Salm (1767-1845) : Un remarquable exemple de féminisme musical ».
206 Romain Benini, Filles du peuple, ENS Éditions, 2021.
209 Pour des exemples précis, voir les notices consacrées aux artistes concernés dans Nouveau Dictionnaire du Rock, dir. Michka Assayas, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2014, 2 vol.
210 Aufray chante Dylan (1965), repris et augmenté dans Aufray trans Dylan (Arcade, 1995).
211 Louis Bertignac, Jolie petite histoire, Paris, Le Cherche-Midi, 2022 ; Pocket, 2023, p. 274.
212 Nous remercions Floriane Daguisé de nous avoir fait découvrir Jean-Michel Lambé.
213 Sur cette notion, voir Ariane Bayle, Mathilde Bombart et Isabelle Garnier (dir.), L’Âge de la connivence : lire entre les mots à l’époque moderne, Cahiers du GADGES, no 13, 2015, en particulier l’introduction : Ariane Bayle, Mathilde Bombart et Isabelle Garnier, « La connivence, une notion opératoire pour l’analyse littéraire », p. 5-35.
214 Voir dans le présent volume Marc Clérivet, « Hé là-haut dans ces prés doux. Une adaptation de la notion de timbre à la chanson de transmission orale de langue française »
215 Voir par exemple Mélodies en vogue au xviiie siècle. Répertoire des timbres de Patrice Coirault, révisé, organisé et complété par Marlène Belly et Georges Delarue, Paris, BnF Éditions, 2020.
216 Pour répondre à l’aspect pratique d’une maniabilité facile, d’une mise en poche commode et probablement, également, d’un coût moindre.
217 Ce principe commun entre recueil de cantiques et recueil de chansons de tradition orale n’a rien d’un hasard de construction. Pour une présentation des préfaces des compilations chansonnières voir Jacques Cheyronnaud, Mémoires en recueils. Jalons pour une histoire des collectes musicales en terrain français, Montpellier, Office Départemental d’Action Culturelle, 1986, p. 31-34.
218 Voir dans le présent volume l’article de Jean-François Heintzen dit « Maxou », « André Dusastre (1897-1960), l’un des derniers chansonniers ambulants, immortalisé par Détective ».
219 Voir notamment Judith le Blanc, Avatars d’opéras, op. cit. ; et Parodies d’opéras sur la scène des théâtres parisiens (1672-1745). Annexes de l’ouvrage Avatars d’opéras, 2015.
220 Voir Judith le Blanc, « Émotions mémorielles et voix chantée à l’Opéra- Comique », European Drama and Performance Studies, no 17 : « Les Émotions en scène (xviie-xxie siècle) », dir. Sabine Chaouche et Laurence Marie, Paris, Classiques Garnier, 2021/2, p. 315-337. Voir aussi Romain Benini, Filles du peuple, op. cit., p. 271-307, « Timbre et intertexte ».
221 Sur cette polysémie du timbre, plus généralement, voir dans le présent volume la contribution de Marlène Belly, « L’air ne fait pas la chanson : Que ne suis-je la fougère, un timbre dans la multiplicité de ses contextes d’énonciation ».
222 Philip Robinson, « L’Opéra-Comique en vaudevilles : parodie et usure des séries », dans Séries parodiques au siècle des Lumières, dir. Sylvain Menant et Dominique Quéro, Paris, PUPS, 2005, p. 171. Voir aussi du même, « Les Vaudevilles : un médium théâtral », Dix-huitième siècle, no 28, 1996, p. 431-447.
223 Voir par exemple chez Pellegrin, Noëls nouveaux et cantiques spirituels, 7e recueil, Paris, N. Le Clerc, 1728, p. 503 : « La Fuite de S. Joseph en Égypte. Sur l’air : Réveillez-vous belle endormie. Un Ange à la faveur d’un songe / Du bon Joseph frappe les yeux ; / Ce n’est pas un brillant mensonge ; / L’éclat qu’il voit descend des cieux ».
224 Arlequin Atys, Parodies du Nouveau Théâtre Italien, Paris, Briasson, 1738, vol. III, p. 187.
225 Le Temple de L’Ennui, Fuzelier, Théâtre de la Foire, vol. II, p. 267. « Le dieu de l’Ennui. – Comment, morbleu : Allons, gai, d’un air gai, dans le Temple de l’Ennui ! Voyez un peu l’impertinent. Il faut que vous soyez des acteurs de la Foire. Ces coquins-là placent toujours leurs vaudevilles à contre-poil ». Voir Françoise Rubellin, « Airs populaires et parodies d’opéra : jeux de sens dans les vaudevilles aux théâtres de la Foire et à la Comédie-Italienne », dans L’Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au xixe siècle, dir. Agnès Terrier et Alexandre Dratwicki, Symétrie et Palazzetto Bru Zane, 2010, p. 163-176.
226 M. Mersenne, « Des Chants », Proposition V. Cité par G. Durosoir, « Timbre et geste créateur : compatibilités et antinomies », dans Timbre und Vaudeville, op. cit., p. 31.
227 J.-P. de Crousaz, Traité du beau, Amsterdam, chez François L’Honoré, 1715, p. 294-295.
228 Marlène Belly, « Grignion de Montfort : Dialogue en cantique ou l’oralité au service de la foi », dans Le Chant acteur de l’histoire, dir. Jean Quéniart, Rennes, PUR, 1999, p. 65-76.
229 Sur cet aspect, voir Bertrand Porot, « Palimpseste, sens caché et sens signalétique : le vaudeville au xviiie siècle », dans Énigmes, canons, allégories dans la musique ancienne », Le Jardin de musique, Paris-Sorbonne, à paraître (voir la version de l’auteur).
230 Le Sage et d’Orneval, Le Théâtre de la Foire, op. cit., vol. 7, p. 343.
231 J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, op. cit., art. « Imitation », vol. I, p. 400.
232 Denis Carolet, Atys travesti, dans Atys burlesque, parodies de l’opéra de Quinault et Lully à la Foire et à la Comédie-Italienne (1726-1738), éd. Françoise Rubellin, Montpellier, Espaces 34, 2011, p. 213.
233 Voir H. Schneider, Dictionnaire de la musique en France, op. cit., art. « Isis » : « Avec les Trembleurs, Lully inventa la manière de peindre des personnages tremblant de froid, souvent imité entre King Arthur de Purcell, les Saisons de Vivaldi jusqu’à Tarare de Salieri », p. 361-362.
234 « Machineurs politiques, / Illuminés fanatiques, / Peuples d’histrions cyniques, / Nous rions de vos desseins : / Malgré vos efforts iniques, / Et vos indignes rubriques, / Chez nous les vertus civiques / Valent bien vos souverains. / […] Aux Anglais, faisons la nique, / Et que le peuple italique / Entonne notre cantique, / L’effroi de tous les tyrans : / Nous irons du pôle arctique, / Jusqu’au bout de l’Antarctique, / Proclamer la République / À tous les peuples souffrants », Chansonnier Français Républicain ou recueil de Chansons, d’odes, de cantates et de romances relatives à la Révolution française, et propres à entretenir dans l’âme des bons citoyens la gaieté républicaine, Paris, Débarle, IIIe année de la République Française, p. 20-21, en ligne sur Gallica.
235 La Clé du Caveau, op. cit., no 731.
236 Mathieu Bauer, « Théâtre et musique : montage et décloisonnement », entretien réalisé par Christophe Triau, Théâtre-Musique. Variations contemporaines, Alternatives théâtrales, no 136, novembre 2018, p. 26.
237 Voir dans le présent volume Niels Couturier, « “Le temps des crises” : timbres et intertextualité comique dans la chanson fin-de-siècle ».
238 Voir notamment dans le présent volume, Jean-Jacques Castéret, « Entre oralité et écriture : les “deux corps” du Noël en Béarn et Gascogne ».
239 Ibid.
240 Judith le Blanc, Avatars d’opéras, op. cit., p. 651.
241 Claude Dauphin montre que les airs circulent par-delà les mers et jusqu’à Saint-Domingue : voir « L’acclimatation des airs français dans les opéras créoles de l’ancienne colonie de Saint-Domingue et des premières décennies de l’Haïti indépendante » dans le présent volume.
242 C’est ce télescopage entre le profane et le sacré que permet notamment de faire entendre le petit spectacle de La Puce – derrière les murs du couvent qui a été créé à Langres au Festival Lumières en musique 2024. Voir Judith le Blanc, « Derrière les murs du couvent. Parodies (anti)spirituelles », dans De la conversation au conservatoire, dir. Aurélie Zygel-Basso et Kim Gladu, Paris, Hermann, 2014, p. 217-240 ; « Redonner vie au répertoire en vaudevilles du xviiie siècle : contraintes, béances et libertés », Littératures classiques, no 91(3), 2016, p. 173-186 ; et J. le Blanc, F. Daguisé et L. Macé, « De La Religieuse au Couvent » dans Julie, Suzanne et les arts, Actes de la journée organisée à l’université de Rouen dans le cadre du programme d’agrégation (Diderot, La Religieuse et Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse), éd. Karine Abiven, Floriane Daguisé, Judith le Blanc et Laurence Macé, © Publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », no 17, 2023, en ligne.
243 Voir dans le présent volume l’article de Jonathan Thomas (« Le chant sur timbre, une ressource pour la mobilisation politique ») qui montre que le carnet de chant produit contre la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche « sert une politisation de la mémoire des affects populaires » ; et Raphaëlle Legrand, « Les voix rebelles : vingt ans de création de chansons féministes sur l’air de ».
244 Voir le « Nous on veut vivre ! » des Rosies lors de la manifestation du 19 janvier 2023 sur « I will survive ».
Actes publiés par Marlène Belly, Judith le Blanc, Bertrand Porot, Alice Tacaille et Jean Vignes, avec la collaboration de Claire Sicard
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 32, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2036.html.
Quelques mots à propos de : Judith le Blanc
Maîtresse de conférences en littérature et arts
Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI
Spécialiste de l’opéra baroque français, du théâtre musical et de la chanson, Judith le Blanc est maîtresse de conférences à l’Université de Rouen Normandie en littérature et arts et membre du CÉRÉdI. Elle est notamment l’autrice d’Avatars d’opéras. Parodies et circulation des airs chantés sur les scènes parisiennes (Garnier, 2014, prix de l’essai du prix des Muses Singer-Polignac 2015), a codirigé Pratiques du timbre et de la parodie d’opéra en Europe (- siècles), Olms, 2014 ; Fontenelle et l’opéra. Rayonnement et métamorphoses (PURH, 2021) ; Le Théâtre de Michel-Jean Sedaine. Une œuvre en dialogue (PUPS, 2021), Spectacles du crime féminin en Europe : théâtre, musique, cinéma (PURH, 2025), édité Les Acteurs de bonne foi de Marivaux (Folio, 2015) et Le Malade imaginaire de Molière (GF, 2020). Elle est membre du comité de rédaction de la revue Théâtre/Public depuis 2019, pour laquelle elle a codirigé les dossiers « La Scène lyrique : échos et regards », « Musique ! » et « Baroque au présent ». En tant que dramaturge et metteuse en scène, elle se met régulièrement au service du spectacle vivant.
Quelques mots à propos de : Marlène Belly
Maîtresse de conférences, ethnomusicologue, domaine francophone
Université de Poitiers, CRIHAM
Quelques mots à propos de : Bertrand Porot
Professeur émérite de musicologie
Université de Reims, CERHIC
Bertrand Porot est professeur émérite à l’université de Reims. Il est rattaché au Centre d’Études et de Recherches en Histoire Culturelle (CERHIC). Ses recherches portent sur l’opéra, l’opéra-comique et les spectacles forains en France, sur la vie musicale des xviie et xviiie siècles ainsi que sur les musiciennes, dans une perspective d’études de genre. Il a publié près de cent articles scientifiques, articles de dictionnaire et préfaces. Il a co publié Les Interactions entre musique et théâtre, L’Entretemps, 2011, Musiciennes en duo, Compagne, fille, sœur d’artistes, Presses universitaires de Rennes, 2015 et Quelles musiques pour la piste ?, Presses universitaires de Rennes, 2023.
Quelques mots à propos de : Jean Vignes
Professeur émérite de littérature française de la Renaissance
Université Paris Cité, URP CERILAC
Jean Vignes, professeur émérite de littérature française de la Renaissance à l’Université Paris Cité (ex-Paris Diderot, Paris 7), ancien président de la Société française d’étude du xvie siècle (SFDES), ancien directeur de l’UFR Lettres Arts Cinéma (LAC) à UPC, a lancé le projet IDEX L’Air du temps en 2019. La plupart de ses travaux portent sur la poésie française du xvie siècle, notamment l’œuvre des poètes de la Pléiade ; il dirige l’édition des Œuvres complètes de Jean-Antoine de Baïf (Honoré Champion, 5 volumes parus). Il a dirigé ou codirigé notamment les collectifs :
La chanson d’actualité, de Louis XII à Henri IV, dir. Olivier Millet, Alice Tacaille et Jean Vignes, Cahiers V. L. Saulnier, no 36, Sorbonne Université Presses, 2021, 376 p.
Chanson, histoire, mémoire, dir. Jean Vignes. Écrire l’histoire (CNRS Éditions), no 22, septembre 2022.
Chanter la poésie XVe-XVIe siècles, dir. Jean Vignes, RHR, no 95, décembre 2022.
Quelques mots à propos de : Alice Tacaille
Maîtresse de conférences HDR
Sorbonne Université, Institut de Recherche en Musicologie Iremus-CNRS, UMR 8223
Alice Tacaille, musicologue spécialiste des xve et xvie siècles, est maître de conférences émérite de Sorbonne Université. Ses projets de recherche croisent l’histoire, l’analyse musicale, l’anthropologie, et sont souvent aidés des sciences numériques pour baliser des sujets dont les réponses se trouvent cachées dans la multitude : l’histoire et l’analyse des corpus monodiques (psaumes calvinistes, mélodies des Frères moraves, corpus grégoriens dans les mystères du xvie siècle, mélodies profanes du xvie siècle…) avec le projet Carnet de Notes, l’inventaire et l’indexation des corpus sans partition (sur HAL, et bientôt publié dans TCLF 16-17), qui font écho à sa thèse statistique sur l’évolution quantitative des cantus firmi grégoriens dans les motets [para-]liturgiques de l’école dite franco-flamande (xve-xvie s.) (1994). L’alliance entre des techniques historiques liées à la période médiévale tardive – par exemple la paléographie musicale, et les nouveaux outils de la réflexion actuelle en sciences humaines permet de franchir des limites théoriques indésirables, entre manuscrits et débuts de l’édition musicale, entre régions également, entre nations et enfin entre confessions, pour mieux s’orienter dans les rapides évolutions et la circulation intense des productions de l’art musical au début de l’époque moderne.
Elle a enseigné en collège, présidé l’agrégation de Musique, dirigé l’UFR de musique et musicologie, fondé et dirigé la revue Jardin de Musique, communiqué et publié sur les questions relatives à la monodie de la Renaissance – plutôt française – au sens large, la chanson comme le chant religieux, et participé à de nombreuses rencontres avec ses collègues littéraires, historiens, musiciens et danseurs.
Publications :
Alice Tacaille, « Chanter sans partition à Paris vers 1500 : les paroliers sans musique », dans Olivier Millet, Luigi-Alberto Sanchi (dir.) Paris, carrefour culturel autour de 1500, Cahiers V. L. Saulnier 33, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2016.
Alice Tacaille, Catherine Perrier, « La tradition orale et les chansons du manuscrit de Lucques (Lucca, Biblioteca Statale di Lucca, ms. 2022), dans Chansons et rondes à trois pas. Traditions normande, bretonne et vendéenne, Fontenay-le-Comte, Robin Joly - Compagnie Outre Mesure, oct. 2019.
Alice Tacaille, « Eustorg de Beaulieu parodiste : La Chrestienne resjouyssance comme propagande musicale », Revue d’histoire du protestantisme, 2018, 3/III-IV-2018.
Alice Tacaille, Jean-Eudes Girot, « Que me servent mes vers ? » La musique chez Ronsard, avec un supplément vocal de 22 chansons, Paris, Garnier, 2020.
