Sommaire
Corneille : un théâtre où la vie est un jeu
I. Scène théatrale et parties de jeu
sous la direction de Liliane Picciola
no 1, 2021 À la mémoire de Jean-Claude Guézennec
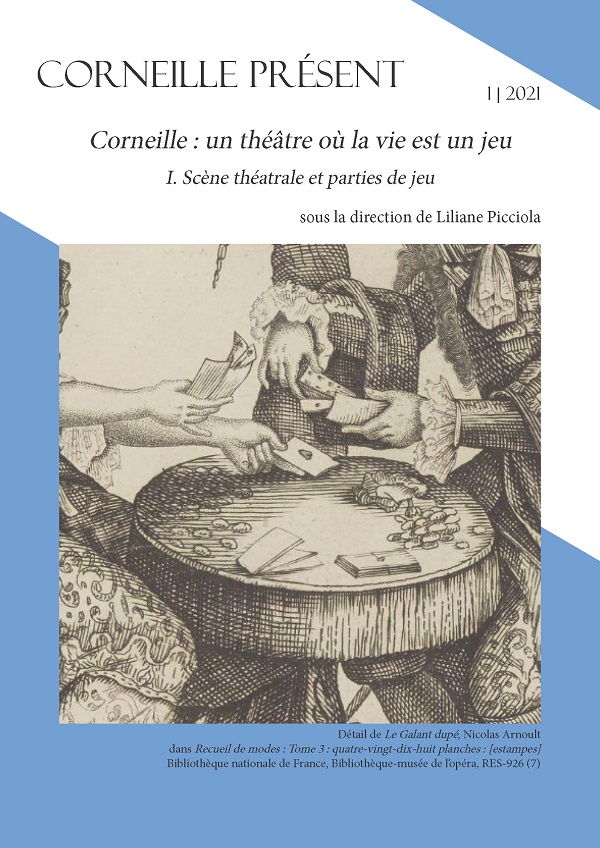
- Liliane Picciola Introduction
- Première Partie : L’intérêt d’amour pensé comme partie de jeu
- Liliane Picciola Prélude : représentation d’une partie de cartes chez les honnêtes gens
- Sandrine Berrégard Les règles du jeu dans Mélite : stratégies auctoriales et fictionnelles
- Françoise Poulet Le théâtre ou la « maison des jeux » : règles et stratégies du compliment dans quelques comédies et tragédies cornéliennes
(La Galerie du Palais, Le Menteur, La Place Royale, Rodogune, La Mort de Pompée) - Flavie Kerautret « Tout mettre au hasard ». Aléatoire et goût du risque dans Le Menteur et sa Suite
- Estampe tirée de Les Jeux et Plaisirs [Plaisris] de l’Enfance
- Deuxième partie : Corneille en figure de « preneur » : de nouvelles règles pour des jeux dramaturgiques insolites
- Liliane Picciola Prélude : l’ostentation du goût du jeu dans les paratextes cornéliens
- Tiphaine Pocquet Joueur de métier, joueur « primitif » : réflexions sur Clindor, Matamore, et la production du rire dans L’Illusion comique
- Séverine Reyrolle Le poète de L’Illusion comique « seul contre tous » : des hasards et calculs cornéliens aux jeux d’écrans dans deux mises en scènes contemporaines de la comédie
- Jörn Steigerwald Corneille maître du jeu ou la dramatologie novatrice de Rodogune
- Hendrik Schlieper Sophonisbe : alea et agôn, genre tragique et gender. Les en-jeux diversifiés de la politique et de l’amour
- Troisième partie : De la compatibilité de l’héroïsme et du jeu
- Liliane Picciola Prélude : une théorie du héros-joueur selon le jésuite Gracián
- Yasmine Loraud Jeu et héroïsme dans le théâtre sérieux cornélien : intergénéricité et complexité des caractères héroïques
- Liliane Picciola Des parties de mariage aux parties de pouvoir : lucidité féminine et choix de jeu dans deux comédies et deux tragédies cornéliennes
- Cécilia Laurin et Sélim Ammouche Faire jouer les limites du jeu : les provocations agonistiques dans la dramaturgie cornélienne
- Conclusion
- Liliane Picciola Conclusion
- Myriam Dufour-Maître Hommage à Jean-Claude Guézennec
Troisième partie : De la compatibilité de l’héroïsme et du jeu
Des parties de mariage aux parties de pouvoir : lucidité féminine et choix de jeu dans deux comédies et deux tragédies cornéliennes
Liliane Picciola
1Le développement de la vie sociale au xviie siècle semble avoir favorisé la pratique de nouveaux jeux de cartes combinant effets du hasard et résultats du calcul1, notamment l’ambigu, le hoc, où les brelans ont beaucoup de valeur, et le reversi : le premier réunit de trois à six joueurs, et le dernier quatre joueurs ; le nombre de participants, supérieur à celui du jeu plus ancien du piquet et de la triomphe (deux joueurs seulement), semble refléter la fréquentation grandissante des belles assemblées de salon. Parmi les jeux plus traditionnels, tandis que la prime se trouvait désormais incluse dans l’ambigu, le tarot paraît être resté, comme à l’origine, un des plus prisés des élites d’Italie, d’Espagne et de France. De même que le reversi, il se jouait le plus souvent à quatre, même si Marolles envisage des parties à trois2. De plus, les Mémoires du marquis François de Sourches (1639-1716) témoignent, à propos du reversi3, qu’une partie impliquait davantage de participants que de joueurs, les intervenants visibles servant parfois les intérêts de gens plus nombreux qui avaient misé avec eux et qui surveillaient, pendant tout le cours du jeu ou de temps à autre, la manière dont leurs représentants réagissaient par leur stratégie au hasard de la donne et des substitutions après écart ainsi qu’aux actions des autres joueurs. Ainsi il était fréquent qu’un joueur se fît relayer à la table de jeu, provisoirement ou définitivement : on disait que le remplaçant « tenait le jeu » du premier4.
2La forme la plus extérieure des parties, si l’on considère leur durée, d’environ trois heures, le nombre de leurs acteurs effectifs, principaux ou secondaires, et la présence de spectateurs, plus ou moins passionnés et intéressés – souvent pécuniairement – par l’action, coïncide ainsi avec celle d’une pièce de théâtre à l’époque, mais il semble qu’on puisse mettre également en rapport le déroulement d’un jeu et l’action dramatique : rôle du hasard, délibérations intérieures, blocages et incertitudes, surprises, coups réalisés. Le sujet même des œuvres dramatiques nous semble présenter maintes analogies avec la pratique du jeu, soit parce que, sciemment, mais avec plus ou moins de légèreté, certains personnages appréhendent les épisodes de leur vie comme des moments ludiques, soit parce que le dramaturge développe l’action en recréant, parfois à un haut degré de gravité, la dynamique de jeux particuliers – certains d’entre eux n’étant pas exempts d’un certain affichage moral puisque les cartes à jouer servaient souvent d’appui pédagogique5.
3Lorsqu’on les examine de près, on est frappé par l’abondance du lexique du jeu dans les comédies de Corneille. Dans ce genre « bas », les personnages, et pas seulement ceux de modeste condition, dont on connaît la rareté chez notre auteur, recourent volontiers à un langage imagé, qui puise dans les gestes de la vie courante, en accord avec la représentation d’une « action commune » pour reprendre l’expression de Corneille6. On sait que la spécificité de la comédie cornélienne consiste à montrer la « conversation des honnêtes gens » ; or ces honnêtes gens jouaient beaucoup, notamment depuis le règne du roi Henri IV, adepte dépensier du brelan et du reversi7. Il semble donc légitime, en première approche, de mettre en relation la récurrence de ces références au jeu en soi et la nature de l’action comique : rappelons que, dans le Discours de l’unité et des parties du poème dramatique, Corneille la réduit à une quête de satisfaction des désirs de protagonistes amoureux8.
4De fait, depuis plusieurs siècles, les rapports entre un chevalier et une dame s’étaient trouvés associés à la pratique du jeu, les documents iconiques montrant notamment des couples occupés à une partie d’échecs9. Cependant au xviie siècle, c’étaient les nombreux jeux de cartes venus d’Espagne, qui faisaient désormais fureur : ainsi leur lexique spécifique trouve souvent sa place dans la bouche des acteurs de comédie On rappellera ici la publication, aux alentours de 1650, de la Description universelle du royaume de Galanterie, dont une des quatre provinces est celle du Jeu. Il va de soi que le seul fait de jouer aux cartes – car les rivières qui arrosent cette province portent exclusivement des noms de jeux de cartes10 – fait partie de la vie galante. Néanmoins il convient de considérer que dans ce pays, dont la capitale est Coquetterie, ce qui n’augure pas de relations franches, toute la pensée des relations sociales, et notamment des relations entre hommes et femmes – la province de Jeu se situant à la droite de la province d’Amour, aux nombreux itinéraires périlleux –, se trouve irriguée par cette pratique ludique. La fin heureuse d’une comédie consiste en principe dans la réunion d’amants que les aléas de la vie, voire les caprices de certains, ont séparés le temps de l’action. Le plus souvent, le dénouement propose même un double mariage, le second assemblant, dans une sorte de symétrie et pour créer une forme de conjouissance, deux êtres qui ne s’y étaient pas préparés. Vu ce contexte de la galanterie, quelle place l’imaginaire du jeu prend-il dans la pensée des relations amoureuses et la réalisation de ces mariages cornéliens ? Alors que, dans les belles assemblées, on voyait souvent des dames aux tables de jeu, de quelle manière les héroïnes des comédies de Corneille s’engagent-elles ou se trouvent-elles engagées dans une partie ? Comment la considèrent-elles ? Quelle est leur façon de jouer ? Peuvent-elles y gagner ? Nous interrogerons sur le sujet l’action et les dialogues de La Veuve, et de La Place royale.
5On découvre que dans la tragédie, si le lexique emprunté au jeu est moins fréquemment employé, moins riche et moins précis que dans les comédies, Corneille place dans la bouche de ses personnages certaines expressions récurrentes qui relèvent non exclusivement mais essentiellement de l’univers des cartes : on y trouve essentiellement le terme de « jeu », l’idée de « hasarder », l’expression « il y va », et, plus actives, les notions de « point » à marquer et de « coup ». Selon notre auteur, la dignité tragique « demande quelque grand intérêt d’état, ou quelque passion plus noble et plus mâle que l’amour, telles que sont l’ambition ou la vengeance » et, si l’image du jeu est peu présente pour évoquer l’amour, sauf dans une perspective d’ambition matrimoniale, elle sert en revanche à penser des préoccupations plus graves, notamment la politique, qui devient le sujet11 favori des tragédies cornéliennes à partir de la composition de Cinna.
6La dignité du genre implique la présence de personnages de très haut rang pour assumer ces intérêts d’État. Le jésuite Baltasar Gracián (1601-1658), un des rares auteurs espagnols à trouver grâce auprès des lettrés français, et notamment d’une autorité comme Bouhours, a souvent recouru, dans El Heroe et dans El Discreto12 surtout, à l’allégorie du jeu afin de tracer aux héros, de rang royal ou seulement éminent à la Cour, le chemin à suivre pour dominer les autres, pour justifier, voire renforcer, leur domination et leur rayonnement autrement que par des moyens militaires : au cours d’une action scénique on peut justement représenter les coups de cette nature dans une grande économie de moyens et dans le respect d’une vraisemblance matérielle. Ces procédés peuvent parfois surprendre, car, à l’instar des manières de gagner dans un certain nombre de jeux, ils reposent sur la dissimulation et même sur la ruse. De ces moyens, contrairement à la force et à la stratégie des armes, les femmes de l’univers tragique peuvent également disposer, qu’elles soient ou non de rang royal.
7Les personnages féminins occupent une place de plus en plus importante dans la dramaturgie cornélienne, au fur et à mesure que les sujets tragiques y deviennent plus ouvertement politiques et que l’action physique des héros masculins s’y trouve empêchée13. On se demandera de quelle main celles qui ne sont ni reines ni appelées à le devenir peuvent disposer, dans des parties historico-politiques telles que peut les envisager un auteur formé par des maîtres jésuites, donc d’une grande proximité de pensée avec Gracián. Selon les jeux précis auxquels les actions peuvent s’assimiler, quelle est la marge de réactivité qui leur est-elle spécifiquement laissée ? Alors que leur défaite stricto sensu paraît difficilement envisageable dans une dramaturgie héroïque, à quelles conditions peuvent-elles au moins faire bonne figure à l’issue du jeu ou, mieux, le mener ? Nous prendrons nos exemples dans deux tragédies aussi différentes que Cinna et Héraclius, une dramaturgie simple d’un côté, une dramaturgie implexe de l’autre.
Doris (La Veuve) au jeu de cartes, au jeu d’échecs, au jeu d’épingles
8Le couple principal de La Veuve semble au départ peu concerné par le jeu car, selon un des schémas de la pastorale, l’obstacle au bonheur amoureux n’est placé sur le chemin de leur vie que par les amants eux-mêmes. Si l’héroïne éponyme et son timide amant Philiste se tiennent ainsi éloignés de cet univers ludique, leur couple en formation se trouve en revanche indirectement impliqué dans des parties où d’autres qu’eux s’engagent.
9C’est peut-être obscurément pour entendre Philiste lui déclarer son amour sous une forme détournée – lui dire que personne d’autre qu’elle ne saurait le charmer – que la riche Clarice veut s’assurer qu’il n’entend pas gagner le cœur de Bélinde et/ou de Chrysolite : il s’est en effet montré très aimable avec elles chez Daphnis, ce qui a quelque peu attisé la jalousie de la jeune veuve éponyme. Comme il fait comprendre qu’il n’est attiré que par elle, Clarice émet l’hypothèse qu’en amour, abordé comme un jeu, il pourrait dissimuler : « Tu serais assez fin pour bien cacher ton jeu14 » (v. 351). La métaphore réfère forcément à une partie de cartes et non pas à un jeu d’échecs : aux cartes, on a souvent intérêt à dissimuler son habileté, en feignant soit de ne pas savoir bien jouer (si le « jeu » est conçu dans un sens dynamique), soit de disposer de cartes médiocres (si le mot est synonyme de « main ») ; aux échecs les pièces sont visibles et les mêmes pour les deux joueurs, l’opération intellectuelle restant, quant à elle, toujours cachée. Philiste, avec une sorte de haut-le-corps, énonce aussitôt sa conception de l’amour vrai, qui s’éloigne de toute manipulation, de tout calcul (et par là de tout espoir de gain), donc de l’univers du jeu de cartes : pour lui, l’amour est flamme et rend même asocial en l’absence de l’être aimé. Par là, il écarte en réalité les deux types de jeu, échecs comme cartes : dans le Tristan en prose, la puissance de l’amour, comme celle de l’amour mystique, se dit dans l’accord du chant et de la harpe, et non pas dans une partie d’échecs, qui suppose étapes et calculs. Bien que fréquentant les salons, le couple principal de cette comédie exprime ainsi sa différence, mais aussi sa crainte de la contamination des sentiments par l’univers moderne du jeu.
10Les autres personnages se trouvent en revanche engagés dans un tel monde et l’un d’eux menace sournoisement les vœux de bonheur de ces amants exceptionnels qui refusent de s’y intégrer : il s’agit d’Alcidon. Lorsque Philiste fait l’éloge de la patience et du long service pour obtenir des faveurs d’une dame comme Clarice, ce prétendu ami répond au vers 47 dans un registre qui n’est pas celui dont use l’amant à l’ancienne de la jeune veuve : « Ce n’est pas là mon jeu ». Pour Alcidon, l’amour s’assimile bien à une partie de cartes, dans laquelle il avoue même faire preuve d’« impatience » (v. 86) ; en quelque sorte, il prétend emporter des plis sans que jamais Doris, censée être son amante d’après la liste des acteurs, ne soit en mesure de lui opposer une carte plus forte que la sienne. Pas question pour lui du service d’amour : « Doris n’aura jamais de quoi / Asservir sous ses lois des gens faits comme moi » (v. 108). Par ailleurs, tandis qu’à l’instar de son comportement d’amoureux, Philiste vit sa relation à ses amis comme une fraternité à toute épreuve (voir le vers 976) entre cavaliers / chevaliers, la notion de « foi » apparaissant comme fondamentale pour lui (voir le vers 944), Alcidon n’a pas la même pratique : il fait preuve en amitié de la même froideur et des mêmes calculs qu’en amour. Dès le vers 141, il se vante auprès de la nourrice de ce que celui qui se croit son ami soit « pipé du fard de son [mon] langage » ; or ce sont les dés ou les cartes qui se pipent15, et la vieille use du même lexique pour l’encourager dans sa double entreprise de tromperie de Doris et de son frère au vers 152 : « Joue aussi bien ton jeu que je jouerai le mien. » « Jouer son jeu » signifie que l’on tire tout le parti possible et des cartes dont on dispose effectivement, et de ce qu’on sait être le jeu des autres, voire qu’on induit en erreur l’imagination de ses partenaires. Il est caractéristique du comportement d’Alcidon qu’il étende la métaphore du jeu à la pratique du compagnonnage chevaleresque. S’il est vrai que le lexique des cartes et le lexique du combat armé, l’agôn, coïncident parfois – comme dans l’expression « rompre le coup » –, Alcidon s’entend à contaminer les rapports entre chevaliers modernes par le poison subtil des jeux de cartes, auxquels il se livre comme prétendu amoureux. Le code courtois veut qu’un chevalier qui souhaite hautement gagner une dame recherchée par un autre défie son adversaire en duel ; Alcidon, lui, par le truchement de la nourrice, s’efforce d’abord d’amener Clarice à sa table de jeu, i.e. les réunions qu’il organise, pour la gagner (« v. 507 : « Pratiquez-en quelque autre », suggère la vieille à sa maîtresse). C’est pourquoi cette complice emploiera encore l’expression « couvrir son jeu » au vers 1474 pour désigner dans son aveu final et le comportement d’Alcidon à l’égard de Doris et celui qu’il observe à l’égard de Philiste. Alcidon ne vit pas dans l’univers de la courtoisie mais dans celui d’une galanterie mal entendue, qui annonce celle d’Acaste et Clitandre dans Le Misantrope.
11La jeune Doris se trouve ainsi obligée de s’asseoir à une table de jeux qui réunit des jeunes gens nubiles, parmi lesquels il faut compter Célidan et Florange, bien que ce dernier n’apparaisse pas sur scène puisque son aspect n’est qu’évoqué, d’une part grâce à un divertissant récit de Doris, d’autre part grâce à une citation plaisante de ses propos placée dans la bouche de cette dernière mais aussi dans celle de Géron. Cet agent joue en quelque sorte pour Florange, et, sur ordre du jeune homme, le déclare prêt à se contenter de la faible dot que la famille de Doris peut mettre au jeu alors qu’il est lui-même « fort riche ». Dans cette partie, Philiste entend influencer les gestes de sa sœur pour faire gagner Alcidon, Chrysante conseille sa fille, et Florange se trouve derrière Géron, l’organisation rappelant ces tableaux où l’on voit les joueurs se concerter avec des témoins de la partie16.
12Doris estime qu’à ce jeu, le hasard de la donne ne lui est guère favorable : « Qu’aux filles comme moi le sort est inhumain », s’exclame-t-elle au vers 1570. Au jeu, le terme « sort » n’est pas insignifiant. Sa donne, ce sont sa mère, son frère, et son peu de fortune qui la lui ont fabriquée, lui laissant une marge de manœuvre bien mince. Peu de cartes hautes, et pourtant elle a dû miser bien trop fort pour son goût, sa dot n’étant nullement en cause selon elle : « Il y va du reste de ma vie », soupire-telle au vers 1587. Rappelons que l’expression « il y va » relève expressément du lexique du jeu (on parle, au reste, de « vade »). Si Clarice, elle, peut se permettre de ne pas s’engager dans une telle partie, c’est qu’elle a déjà été mariée et que, veuve, elle est maîtresse d’elle-même.
13Selon les peintres, des figures suspectes rôdent souvent autour des joueurs de cartes. C’est ainsi qu’on peut considérer le personnage de la nourrice, déjà évoquée, qui assiste Alcidon17. Cette confidente de l’héroïne éponyme est rémunérée par celui-ci pour des services divers : elle surveille sa maîtresse, elle surveille Philiste, mais elle surveille aussi Doris. Du fait qu’elle reçoit une bourse de lui à la fin de la scène 2 de l’acte II, après qu’elle a révélé ce qu’elle sait de Doris et de Florange, l’image que le corrupteur offre de lui-même au spectateur est bien endommagée18. Pour récompenser ainsi la nourrice, il doit par ailleurs disposer de plus de moyens que Philiste, même s’il est évident que Chrysante ne l’envisage pas comme le futur gendre le plus argenté. Vu le niveau moyen de sa fortune, Alcidon ne serait-il pas attiré, en fait, par la richesse de Clarice ? Superficiellement intéressé19 par la partie dans laquelle il est engagé et qui doit lui valoir in fine la spirituelle sœur de de son ami, ne cherchant qu’à marquer quelques points sur elle en remportant certains plis, il ne brille pas par l’efficacité de sa stratégie pour gagner rapidement l’avenir misé de la jeune fille : « Son âme a deux visages » (v. 177), dit de lui Doris, qui perçoit bien qu’il ne s’implique pas suffisamment dans le jeu. Il ne se préoccupe guère de la manière dont d’éventuels rivaux manient leurs propres cartes. Certes, Célidan, pourtant épris de Doris, ne lui fait apparemment pas concurrence et joue même en sa faveur, mais Alcidon ne surveille guère non plus le riche Florange, puisqu’il n’a même pas conscience qu’un autre participant puisse avoir beau jeu face à lui. L’intérêt d’Alcidon, au sens fort du terme, se trouve ailleurs. On note en effet que, s’il dit, une seule fois, qu’il « brûle » pour Clarice (v. 109), aucune parole tendre ni admirative de sa beauté ne lui est plus prêtée ensuite quand il évoque la jeune femme, pas même en monologue : ainsi Corneille suggère-t-il discrètement qu’Alcidon est en fait appâté par la fortune de la veuve du riche Alcandre. Sur la carte du royaume de Galanterie, le chef-lieu de la province du Jeu s’appelle Intérêt… À l’idée qu’il pourra épouser Clarice, Alcidon, induit en erreur par Célidan, déclare : « j’aurai mon compte » (v. 1693). Doris ne cherche pas davantage à gagner la mise d’Alcidon qu’il ne cherche à gagner la sienne et ils ne s’opposent, l’un à l’autre, que de faibles cartes : « Nous nous entrepayons d’une même monnoie » (v. 182).
14En surveillant le jeu, la nourrice ressemble à la servante du fameux Tricheur à l’as de carreau de Georges de La Tour ; elle aide à la manœuvre, non pour permettre à Alcidon de tricher, mais pour lui permettre de quitter la partie du « mariage de Doris » sans s’attirer l’opprobre. Les informations qu’elle a su tirer de Géron concernant le consentement donné par la jeune fille à Florange, qui l’a fait demander en mariage par son agent, équivaut à un regard indiscret sur les cartes de cette dernière et sur sa manière de les jouer. Cette rebelle sœur de Philiste a en effet dans sa main de quoi s’opposer aux rivaux d’Alcidon : la promesse faite à son frère constitue comme une carte haute à leur opposer. Ne pas l’utiliser revient à la placer dans son écart, comme négligeable. Ainsi Doris semble-t-elle, selon une procédure commune à la majorité des jeux de cartes d’alors, laisser sciemment Florange emporter un pli. Via Géron, ce prétendant consacre au jeu l’attention qu’Alcidon ne lui prête pas et, sincère à défaut d’être séduisant, le « nouveau venu des universités » se trouve placé en très bonne position pour gagner toute la partie. Mal lotie à ce jeu, la sœur de Philiste, sans tricher vraiment, se contente de favoriser qui sa mère lui désigne. Au moins essaie-t-elle de se distraire dans une partie où elle pense ne pouvoir que perdre quelque chose, malgré la faiblesse de son engagement.
15L’enlèvement de Clarice en son jardin révèle en Alcidon, qui l’a organisé avec l’aide de la nourrice, un piteux cavalier. Un Méléagant enlevant Guenièvre se mesurait ensuite à Lancelot, venu délivrer la reine du royaume de Logres ; pas d’agôn, en revanche, entre Philiste et Alcidon, puisque ce dernier ne revendique pas le rapt de Clarice, et que, lorsqu’il vient s’opposer à son ex-ami l’épée à la main, c’est d’une part en se plaignant qu’on ait tenté de lui prendre Doris, dont il n’a cure, d’autre part en prenant bien soin qu’un tiers, en l’occurrence Célidan, puisse les séparer. Alcidon n’est qu’un simple calculateur de salon.
16Soupçonneux depuis qu’Alcidon a formulé son projet d’enlèvement de Clarice, Célidan se désabuse lui-même grâce à quelques questions bien posées : il change de camp et délivre Clarice, passant de l’univers du jeu de cartes, celui d’Alcidon, à celui de l’amour courtois, auquel, tel Philiste, il semblait déjà prédisposé par sa manière de vivre l’amitié et son effacement délicat devant ce qu’il pensait être le bonheur d’un ami. Grâce ce « coup si glorieux », que constitue, selon la formule de Philiste, la délivrance de Clarice, il mérite la reconnaissance de l’amant de celle-ci : il espère bien avoir trouvé là un chemin pour obtenir la sœur de son débiteur. Si cet itinéraire ne tient guère compte de l’autonomie de la personne de la jeune fille, il convient cependant de noter que Célidan ne fait pas valoir le service rendu à Philiste auprès de sa mère pour obtenir un retour, mais bien ses sentiments anciens à l’égard de Doris ; il rappelle aussi le respect qu’il a montré devant l’engagement de cette dernière à Alcidon ; enfin le peu de cas qu’il fait d’une absence de dot semble rassurant quant à son estime de la personne qu’il épouse. De surcroît, ne réclamant Doris comme « guerdon » que sur l’insistance de Philiste à le récompenser, le cavalier refuse de s’imposer à la jeune fille et se déclare prêt à renoncer à user de l’autorité de Chrysante sur sa fille : « Employer contre vous son absolu pouvoir ! / Ma flamme d’y penser deviendrait criminelle » (v. 1798-1799).
17Alors qu’Alcidon l’avait pressenti pour reprendre son jeu quand il quittait la partie, au prétexte que Doris avait favorisé Florange, et qu’il avait alors été repoussé avec force, Célidan est pourtant accepté par la jeune fille quand Philiste ne s’oppose plus au mariage, après qu’Alcidon a posé le masque : certes, le couple qu’elle va former avec lui in fine, ne saurait s’assimiler à l’union fusionnelle de Clarice et Philiste ; du moins Doris apprécie-t-elle l’ensemble des procédés de Célidan, puisqu’il ne cache rien. C’est à ses seuls talents et à sa patience qu’il a pu la gagner, non pas à l’issue d’une partie de cartes où se seraient mêlés hasard, stratégie, et ruse, mais au terme d’un jeu d’échecs, sans intervention du sort, toutes les pièces du jeu de chacun étant visibles et égales : Célidan l’emporte, mais Doris ne se trouve défaite que par sa condition de femme, bien obligée de se marier, et, reconnaissant le « mérite » de Célidan (v. 1991), elle fait preuve de « raison » (v. 1992) et de « jugement » (v. 1994). Célidan gagne la partie d’échecs dans laquelle il parvient à l’entraîner. Cependant Doris, en le suivant dans ce nouveau jeu, n’a pas perdu la face au précédent. Plus personne ne s’occupe ni ne parle du trompeur20 une fois qu’il a prononcé le mot « Adieu », au vers 1957, ce qui marque la pire des exclusions, que la jeune fille avait prononcée, elle, depuis longtemps Ce qui est alors notifié par la dramaturgie même au personnage et au public, c’est l’insignifiance profonde de celui qui ne jurait que par les vilaines manières montrées dans les jeux qui le permettent, et que Doris a su démystifier.
18L’exemple de La Veuve montre comment l’imaginaire du jeu, volontiers sollicité par les hommes, reflète en fait la condition des femmes dans la société du xviie siècle. Clarice constitue l’exception qui confirme la règle. La formation du couple de Célidan-Doris révèle cependant que certains jeux, donc certaines pratiques, restent plus favorables aux femmes ; on perçoit toutefois leur caractère désuet. La force de Doris, dans la vie comme au jeu, est de savoir se garder de toute passion. Elle n’a, certes, gagné ni au jeu de cartes d’Alcidon, ouvert aux fourberies, ni au jeu d’échecs de Célidan, qui, quoique plus franc, ne « laissait à [s]es yeux rien à dire à [s]on cœur » (voir le vers 1585). Consciente du peu de choix laissé à une fille par sa condition (v. 1960), elle estime beaucoup n’avoir rien perdu au jeu imposé, en n’étant contrainte d’épouser ni un idiot ni un fourbe cynique, et avoir préservé en quelque sorte son autonomie car Célidan la respecte ; s’il n’a guère eu le temps de lui « rendre service », il n’est ni « brutal », ni « sauvage », comme elle le redoutait au vers 1567. Dans la seule partie modeste où elle entendait s’engager, elle peut dire avoir « tiré son épingle du jeu21 », ce qui lui permet de continuer de sourire et de rester par là un personnage de comédie.
19Il semble que Corneille se soit souvenu d’elle en créant le personnage de Philis dans La Place royale. En revanche, Angélique diffère d’elle en tout point.
Angélique (La Place Royale) : du refus du jeu de stratégie au va-tout
20Comme Alcidon, le personnage d’Alidor, dans La Place royale, recourt beaucoup au lexique du jeu et, en matière de sentiments, il se comporte, lui aussi, comme à une table où une partie se tiendrait. Apprenant que son ami ne veut pas épouser Angélique, bien qu’il l’aime et en soit aimé, Cléandre émet l’hypothèse qu’il préfèrerait avoir pour maîtresses des femmes mariées, et par là peu aliénantes ; l’amoureux extravagant s’en défend, certes, mais en envisageant d’emblée la relation aux dames comme un jeu (v. 299-30022) :
Et le jeu m’en déplaît quand on fait à tous coups
Causer un médisant et rêver un jaloux.
21Il semble que cette idée du jeu régisse toutes ses relations affectives. C’est encore en de tels termes qu’il conçoit son avenir amoureux dans son monologue final, une fois Angélique partie s’enfermer dans un cloître (v. 1586-1589) :
Nous feindrons toutefois pour nous donner carrière,
Et pour mieux déguiser nous en prendrons un peu,
Mais nous saurons toujours rebrousser en arrière,
Et quand il nous plaira nous retirer du jeu.
22Non seulement le mot « jeu » conclut cette stance, mais l’expression « en prendre » désigne un geste bien connu des joueurs. En effet dans La Maison académique des jeux, « prendre » signifie régulièrement qu’ayant écarté23 une ou plusieurs des cartes de son jeu, on les remplace par une ou des cartes d’un talon, soit personnel, soit collectif. On appréciera la métaphore, le geste évoqué par Alidor confinant au cynisme : il s’agit de feindre de vouloir se marier, en s’efforçant d’améliorer sa main comme pour emporter la mise de quelque jeune fille nubile, d’entretenir ses espoirs quelque temps, puis de cesser brusquement de jouer… On note aussi la réticence exprimée par « un peu » qui souligne que sa participation, grâce à laquelle il peut toutefois « se donner carrière » (i.e., selon le premier dictionnaire de l’Académie, « se réjouir et se laisser emporter à l’inclination que l’on a de dire ou de faire quelque chose, selon toute l’étendue de son désir »), ne saurait être que brève : elle ne sera prise que dans les conditions du dilettantisme, et sans considération de la personne.
23Ces vers du dénouement éclairent le comportement antérieur d’Alidor. Dans sa pensée, au jeu social de l’amour et du mariage, dans lequel son amante ne se sent pas impliquée alors qu’elle l’est forcément – on peut supposer qu’elle ne cesse de « passer » –, il a eu la chance d’avoir en main une carte haute, précieuse, sans doute à l’effigie « parfaite » d’Angélique, et qui lui permettait d’emporter la mise de celle-ci. « L’amoureux extravagant » s’est néanmoins montré déterminé, à la fin de l’acte I et au cours de l’acte II, à se « retirer du jeu » : il a quitté Angélique au terme d’une cruelle scène de rupture et il a laissé Cléandre continuer la partie à sa place, lui abandonnant ou le laissant reprendre les marques qu’il y avait apportées. Cependant, contrairement à sa prévision, et alors que ce fantasque Alidor passait du rôle d’acteur au rôle d’observateur, se réjouissant d’avance des levées qu’allait désormais effectuer son ami Cléandre et s’apprêtant en quelque sorte à jouer par personne interposée, voilà que le réactif Doraste a renversé le cours de la partie et s’est révélé au vers 629 sur le point de la gagner : le prétendu alter ego d’Alidor a en effet perdu une assez bonne carte à cause de la pose de celle de Philis, jouant pour son frère, et à laquelle il a bien fallu réagir. Ainsi, malgré une main pourtant médiocre puisqu’il est indifférent à Angélique, Doraste a remporté un premier pli, de gros rapport en points, sous la forme de fiançailles agrémentées d’un bal, et il s’est mis en bonne posture pour gagner toute la partie, à savoir un mariage effectif avec Angélique.
24Cette fois, pour s’assurer la possession d’Angélique, il faut sortir de l’univers du jeu : Cléandre, que la surprise inhibe trop longtemps24, veut disputer Angélique à la loyale, en duel, ce qui le ramène à l’univers franc et médiéval dans lequel nous avons estimé que se plaçait, à divers égards, le couple principal de La Veuve. Alidor conseille le rapt consenti plutôt que le duel, car la méthode permettrait, selon lui, de mieux augurer de l’avenir, duquel il tient à rester témoin : seule la possession de la personne physique d’Angélique est censée pouvoir l’emporter sur la parole donnée, et par ses parents et par elle-même, à Doraste. Ce qui explique sans doute que l’extravagant donne ce conseil, c’est qu’il implique d’abord une victoire sentimentale sur Angélique, qui ne peut être remportée que par ses propres soins : il faut faire passer la jeune fille du ressentiment à l’amour. Alidor engagera donc avec elle une sorte d’agôn argumentatif et émotif, et l’idée de cet agôn lui plaît. Voilà les conditions dans lesquelles il décide de revenir au jeu, de « reprendre de l’amour » – comme, pour d’autres, il reprendra plus tard des cartes de galanterie dans le talon – « afin d’en donner mieux » (v. 760), tout étant chez lui calcul et stratégie. Angélique, d’abord toutes griffes dehors, finit par consentir à son propre enlèvement et, au vers 906, l’extravagant peut se vanter de son succès avec ostentation : « Que ne peut l’artifice et le fard du langage ». L’agôn lui procure alors la jouissance de la victoire, une sorte de griserie de la puissance25, proche de la passion de celui qui gagne de grosses sommes au terme d’une partie difficile et au cours de laquelle il a montré une grande habileté stratégique.
25Néanmoins, dans la scène 1 de l’acte IV, le vainqueur organise encore, en idée cette fois, une nouvelle confrontation entre son amante et lui : il ne l’a en effet emporté sur la rancœur d’Angélique qu’en échange d’un gage, mais, la jeune fille ayant imprudemment reporté à plus tard la remise de sa promesse écrite, il conserve encore la liberté de tricher sur ledit gage. Il doit lutter alors contre la touchante image d’une Angélique pleine de tendresse et de confiance, qui lui lancerait paradoxalement un défi, telle un « preneur » dans divers jeux mêlant hasard et calcul, et, organisant cet agôn en pensée, dans la crainte qu’elle n’y « triomphe » (v. 985), il s’associe dans la défense son ami Cléandre, auquel il a promis de la céder, l’amitié l’aidant contre l’amour : « Angélique le perd, nous sommes deux contre elles » (v. 986).
26Devant un tel joueur, un tel stratège, Angélique, la bien-nommée, se trouve fort mal munie. Corneille ne lui a prêté ni la plasticité ni la lucidité d’une Doris. Cette dernière, ouverte à la société, participant à ses bals, à ses assemblées, observait le comportement d’Alcidon ; bien qu’elle ne disposât que de cartes plutôt basses, elle savait jouer ses modestes mains, et, pour perdre le moins possible, réfléchissait à celles des autres. Ici, alors que tout jeu constitue une simulation de combats et de rivalités, Angélique se déclare rétive à quelque simulation que ce soit, notamment quand Philis la lui réclame pour son frère, afin d’adoucir ses douleurs : « Accorde un faux remède à des douleurs si vraies / Trompe-le, je t’en prie » (v. 102-103). En plus figé, sa manière de voir l’amour hors de la sphère sociale rappelle celle de Philiste et de Clarice car, au vers 90, elle dit percevoir sa relation avec Alidor comme « l’union de deux âmes ». Cependant, au contraire de la jeune veuve, elle se révèle incapable de se placer un tant soit peu à distance ce qu’elle vit. Bref, elle fuit la moindre forme de jeu social, et Doraste le sait bien : « Sa fuite n’est l’effet que de mon arrivée », commente-t-il amèrement au vers 114. Philis a au reste critiqué dès le vers 29 le comportement d’Angélique, qui serait capable de renoncer même aux douceurs de son amitié avec elle pour privilégier cette relation fusionnelle et exclusive avec son amant : « Tu vis d’un air étrange et presque insupportable. » Les multiples amours esquissées, voire fictives, auxquelles se prête Philis, ses badineries, se révèlent hors de la portée de l’imagination d’Angélique, tout comme l’idée qu’Alidor pourrait ne faire que galantiser Clarine, et elle parle le langage ancien de l’offense, de la honte. Lorsque son amant la blesse et la dévalorise, ce n’est même pas elle qui manœuvre au jeu pour favoriser un autre amant : étrangement passive, elle ne soupçonne pas que Philis va prendre l’offensive pour Doraste.
27Pire : une fois engagée par dépit, mais officiellement, à ce dernier, elle ne se bat guère contre l’argumentation d’Alidor quand il revient vers elle, elle oublie qu’il n’a considéré sa relation avec elle que comme un jeu, pratiqué au reste malhonnêtement, et que « la foi des Amants est un gage pipeur26 », comme elle l’avait pourtant discerné au vers 339 : alors qu’elle semblait avoir ainsi compris que son amant s’impliquait peu dans le rapport amoureux, elle accepte d’être enlevée. Cependant sa propre vie, qu’elle vivait jusqu’à la trahison d’Alidor sans réfléchir, lui apparaît bien désormais comme une partie de jeu, mais celle dont elle parle n’est pas de celles auquel se prête son amant : elle envisage un jeu où il ne faut qu’« hasarder » ; aucune manœuvre, aucune combinaison possible dans cette partie dont elle imagine bien les risques. Comme certains aventurent tout leur argent au jeu, Angélique expose à l’inquiétante Fortune non seulement son honneur (v. 868), mais tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle a, répétant « il faut tout hasarder » aux vers 897 et 904, comme tétanisée. Le vers 868, « Mon honneur en tes mains prêt à se hasarder », révèle qu’elle conçoit même Alidor, comme une incarnation du hasard, dont il a, au reste, les caprices… Dans son amour pour ce dernier, depuis sa feinte infidélité et ses cruelles critiques à son endroit, s’est toutefois glissée une méfiance qui fait prendre à sa manière de miser l’aspect d’une attirance irrépressible vers le vide, d’une ilinx consciente et presque « voluptueuse », pour reprendre le qualificatif employé par Roger Callois27, dans son abandon au gouffre (v. 893-898) :
Que promets-tu, pauvre aveuglée ?
À quoi t’engage ici ta folle passion ?
Et de quelle indiscrétion
Ne s’accompagne point ton ardeur déréglée ?
Tu cours à ta ruine, et vas tout hasarder
Sur la foi de celui qui n’en saurait garder.
28La première étape de l’enlèvement échouant, elle découvre qu’Alidor, lui, ne hasarde rien du tout, ni lui-même, puisqu’il n’a pas participé à l’enlèvement manqué, ni la personne de celle qu’il dit aimer : « Un bien si précieux se doit-il hasarder ? » (v. 1151). Comme il ne réagit pas pour l’arracher à Doraste, elle lui reproche la prudence qu’il revendique au vers 1117, ses « précautions » (v. 1159) : si Alidor aime le jeu, il ne se comporte certes pas en adepte du risque, même pour complaire à Cléandre et sauver en sa faveur celle qu’il lui a promis. Si, au vers 1165, il finit par prononcer, au mode impératif, le même verbe qu’Angélique, « hasardons tout », c’est contraint, forcé, et trop tard, juste avant de s’échapper. De surcroît, elle découvre qu’il avait truqué le sort en la faisant enlever par et pour Cléandre.
29Il se peut qu’Alidor fuie justement tout ce qui peut lui sembler aléatoire : dans les jeux de relance, où l’on peut exercer un certain contrôle quand on a beau jeu, est-on sûr de la mise à laquelle correspondent les marques qu’on va gagner ? Les plus fiables lui paraissent de peu d’aloi pour l’avenir28. Avec le mariage, on quitte un jeu pour un autre, plus périlleux…. Au contraire, Angélique, capable seulement de s’engager tout entière dans des parties où seul le hasard intervient29, se retire de cette salle de jeux mondains, sophistiqués, éphémères, dans lesquels elle ne saurait rentrer et auxquels elle a compris qu’Alidor participait en dilettante : sortant, par la nature que Corneille lui a conférée, de l’univers comique des aristocrates, elle quitte l’action et la scène pour rentrer au couvent, Certains personnages peuvent toutefois porter sur sa naïveté et son impulsivité un regard mi-amusé mi-compatissant.
30Une autre héroïne de Corneille se révèle consciente de ne pouvoir que hasarder, mais comme elle vit dans le monde de l’Histoire, ce que l’on perçoit chez Angélique comme passivité, voire aveuglement volontaire, apparaît plutôt comme lucide courage chez elle. Il s’agit d’Émilie, prise dans le tournant du siècle d’Auguste et dans le jeu politique. L’enjeu, c’est l’avenir de Rome, pour la domination duquel misent forces républicaines et puissance augustéenne.
Émilie (Cinna) : du refus du jeu de reversi à la cession du quinola
31Dès la scène d’ouverture de cette tragédie qui fit la gloire de Corneille, et pendant tout l’acte I, Auguste est présenté comme l’ennemi à abattre, celui qui a déclenché la guerre civile. Bien qu’il se soit révélé le plus fort, au prix de nombreuses vies humaines, Émilie et Cinna semblent vouloir perpétuer contre lui un agôn qui n’a rien de ludique. Cependant on apprend par Fulvie que l’empereur essaie depuis quelque temps de pacifier Rome, que les agôns se limitent désormais à des affrontements de conseils dans une sorte de cour. On se rapproche ainsi de la configuration d’un jeu, inégal au reste, car l’empereur garde une totale maîtrise de la donne, l’exercice d’un pouvoir tyrannique revenant à incarner le hasard dans la distribution des cartes de faveur ou de défaveur30, et il peut à tout moment se servir d’armes-cartes hautes, dont les autres ne disposent pas, quand il entend prendre une mesure et qu’elle est trop discutée ; au fond, le pli lui revient à volonté. On comprend que la fille de Toranius et le descendant de Pompée n’aient guère envie de se prêter à de telles parties.
32Tous deux font cependant mine d’y participer et ils s’en servent même à l’occasion. Émilie feint, et elle participe d’apparemment bonne grâce à ces jeux d’Auguste au point que nul ne saurait lui prêter de mauvaises intentions contre celui « qu’elle aime comme un père », aux dires de Maxime (v. 702) : les faveurs impériales lui valent quelques levées, des points, çà et là, Auguste lui donnant de temps à autre de bonnes cartes, mais elle réserve ses gains pour changer la nature de la partie, comme elle l’indique aux vers 79-80 : « Et des mêmes présents qu’il verse dans mes mains / J’achète contre lui les esprits des Romains31. » Comme Angélique, Émilie n’approuve que les grandes prises de risque, même s’ils ont été calculés au mieux par son amant.
33Elle a conscience qu’en contribuant à transformer en affrontement armé une partie dans laquelle les joueurs seront dupés et les cartes pipées, elle « hasarde » bien plus que de l’argent comme elle l’indique par une périphrase dès le vers 8 (« ce que je hasarde ») : d’abord pas moins que la vie de Cinna (v. 119-120 et v. 127), si l’on arrête sa main avant qu’il n’ait frappé. L’enjeu, si le digne « coup » (v. 136) réussit, n’est pas de s’emparer du pouvoir après l’assassinat d’Auguste mais de connaître « la douceur de venger [ses] parents » (v. 107) – parmi lesquels son propre père –, de servir les « intérêts publics » (v. 106), de restituer aux citoyens et aux optimates « la liberté de Rome » (v. 110) et d’acquérir « la gloire qu’on remporte à punir les tyrans » (v. 108) ; aussi Émilie est-elle bien consciente que derrière elle se trouvent aussi d’autres miseurs32 de leur propre vie : tous les républicains. Elle-même, que son sexe éloigne de cette partie armée, pratique d’une certaine façon l’ilinx, en fermant les yeux : « Tu vois bien des hasards, ils sont grands, mais qu’importe » (v. 126). Dans cette partie armée jouée par les conjurés de sexe mâle, elle a non seulement investi des fonds mais sa propre personne ; pour le dire, elle use d’une métaphore courtoise, issue du langage des tournois : « Sa tête est le seul prix dont il peut m’acquérir » (v. 56).
34Cependant au début de l’acte II, lorsqu’il apparaît sur la scène, l’empereur se dit tenté de renoncer au trône, de quitter ce qu’il perçoit désormais comme une organisation de rôles obligés dans laquelle il est amené à éliminer un par un tous ceux qui s’opposent à son pouvoir : l’Empire n’a en quelque sorte plus de réalité à ses yeux car son éclat lui est apparu comme trompeur. Maxime le pousse vers cette solution du renoncement ; Cinna argumente au contraire pour qu’il continue à gouverner, Émilie et lui ayant mis au point leur stratégie dans un certain type de configuration du jeu politique, auquel ils ne participent que pour l’interrompre. Auguste finit donc par accepter de conserver le pouvoir mais, non content de le percevoir comme une illusion, à l’instar du Sigismond de Calderón dans La vie est songe, il veut changer les règles de ce qui, au bout du compte, au bout de de sa vie, ne peut se révéler qu’une partie de jeu : il bouleverse totalement le fonctionnement politique institué jusqu’alors. Ces nouvelles règles, qui prennent le contrepied des habitudes de penser, de gouverner et d’être gouverné, devaient immanquablement suggérer aux joueurs du public de Cinna, les parties de reversi. En effet, la dynamique de ce jeu du « à l’envers » coïncide avec celle du programme que se donne Auguste dans cette tragédie : les autres devraient s’y adapter et l’empereur lui-même s’y tenir.
35Le reversi dénote assurément un certain goût du paradoxe, puisque le grand nombre de levées opérées avec des cartes hautes y fait perdre, alors que, dans les autres jeux, il fait gagner33 : écraser les autres de la puissance de ses cartes est ici contre-productif ; or qu’un puissant ne veuille plus exercer sa puissance constitue bien un phénomène de monde à l’envers. « Ne considérez point cette grandeur suprême » (v. 397), demande Auguste à Maxime et Cinna qu’il a convoqués à la fin de l’acte I. Néanmoins, monarque absolu qui ne veut plus triompher, désirant « faire part » du pouvoir, il découvre peu à peu que la partie est délicate pour lui : volens nolens, il dispose de beaucoup de cartes hautes et va devoir s’ingénier à ne pas les jouer. Aussi commence-t-il « d’écarter » en se défaisant de ce qu’on pourrait appeler deux cartes d’oppression. L’offre qu’il fait à Cinna de lui donner Émilie pour épouse vise à adoucir pour cette dernière la douleur de la perte de son père, qu’il a exécuté, et à effacer jusqu’au souvenir de cet acte oppressif ; dans la mentalité d’alors, un époux tient lieu de père à une orpheline, et Auguste, confirmant cette bonté, pourra dire à cette dernière au vers 1714 : « Te rendant un époux, je te rends plus qu’un père. » Il réduit également son propre pouvoir en faisant Maxime gouverneur de Sicile. Pour autant sa main reste forte.
36D’abord mal à l’aise pour participer à ce nouveau jeu politique qui rend caduque une stratégie de détournement du jeu curial habituel pour passer à l’organisation d’un meurtre, Cinna finit par souhaiter jouer ces parties de reversi autour de l’empereur, avec Maxime, Émilie, et d’autres, selon les sujets de consultation, le but d’Auguste restant d’emporter l’amour de son peuple en sortant des cartes basses. Il n’en va pas de même de la jeune Égérie des républicains, qui estime que ses gains en vengeance seront forcément inexistants à ce jeu-là. La découverte de la conspiration, trahie par Maxime, est une mise à l’épreuve pour Auguste : la connaissance du projet d’attentat semble mettre en échec son projet réformateur et le ramener à sa tentation de renoncer purement et simplement à toute forme de jeu, qui suppose une cour pacifiée, soit en se donnant la mort (voir la récurrence du « Meurs », dans son monologue de la scène 2 de l’acte III), soit en renouant avec une politique autoritaire et répressive. C’est alors Livie qui lui prédit l’échec de la violence et l’incite, au fond, à mettre réellement en place son nouveau jeu, dont il n’a pas encore pu appliquer les règles, s’étant limité à l’écart. L’impératrice le ramène au très politique reversi dont Émilie l’éloigne objectivement par ses manœuvres sur Cinna. En prêtant à l’empereur le peu amène vers 1245 : « Vous m’avez bien promis les conseils d’une femme », à l’intention de son épouse, Corneille propose, de façon tout à fait étrangère à l’Histoire, un Auguste incapable de soupçonner qu’une femme puisse prendre le parti de la violence et valorisant par là a contrario l’originalité du comportement d’Émilie ; à en croire l’empereur, les joueuses seraient ainsi censées se comporter autrement que les joueurs dans les parties politiques, ce que dément tout le théâtre cornélien ultérieur, à l’image de la réalité curiale de son temps. En demandant à son époux de la laisser gagner dans un épisode d’agôn conjugal, et, au reste, par une référence explicite au jeu, Livie initie Auguste à cette partie de politique inversée dont il rêvait : « Je ne vous quitte point / Seigneur, que mon amour n’ait obtenu ce point » (v. 1259-1260) ; si l’impératrice gagnait, son époux perdrait le pli et se trouverait en bonne voie dans sa partie de reversi… À la fin de l’acte IV, l’empereur s’arrête un temps, suspendant toute réflexion stratégique : « Le Ciel m’inspirera ce qu’ici je dois faire » (v. 1258).
37Connaissant les noms de tous les conjurés, pensant que Cinna ment, Auguste ne paraît pas clairement décidé, quand commence l’acte V, à sortir du jeu de modération qu’il avait choisi à l’acte II car il développe devant Cinna des arguments d’ordre moral comme pour obtenir de lui des regrets, qui pourraient l’amener à pardonner. Devant le fier refus de Cinna, qui cherche peut-être à protéger Émilie, il se peut qu’Auguste se propose encore la douceur, le « Fais ton arrêt toi-même, et choisis tes supplices » du vers 1561 étant peut-être inspiré par le désir de contredire ensuite la sévérité du héros éponyme à son propre égard. Émilie, elle, reste le personnage qui veut empêcher le jeu de reversi de se tenir comme prévu. C’est une héroïne qui voit loin. En rendant impossible, par ses provocations, la tenue de l’étonnante partie que l’empereur se proposait peut-être encore, Émilie rêve au fond d’une sorte de retour à la guerre civile, que pourraient déclencher son supplice et celui de Cinna. Son projet est clair lorsqu’à Livie, qui lui reproche son argumentation, elle répond au vers 1618 : « Je parlais pour l’aigrir et non pour me défendre. »
38Cependant, au jeu du reversi, il existe une possibilité qui n’est réservée qu’à ceux dont, la puissance en cartes est si forte qu’elle leur ôte tout espoir d’éviter les levées : l’opération appelée proprement « faire le reversi ». Sorel énonce ainsi la règle :
Celuy qui a toutes cartes hautes en fon ieu, peut sans en témoigner rien, entreprendre de faire le Reuersis, qui est à dire de leuer luy seul toutes les cartes du ieu, sans que pas-vn des joueurs en leve seulement aucune main, & faisant-ce Reuersis, il gagne non seulement la Poule, mais mesme on luy rend, si quelqu’vn l’auoit prise, & outre ce, chacun des joueurs luy donne deux marques, selon qu’il est arresté au commencement du ieu34.
39Comment Auguste peut-il gagner en prenant le contrepied de sa stratégie primitive tout en se maintenant dans le même jeu ? En changeant la nature de sa force, en remplaçant la force physique de ses licteurs et de ses légions par la force morale, qui lui appartient en propre.
40De fait, après un éclair d’extrême humilité qui lui fait paradoxalement et intimement toucher son but (v. 1693-1694 : « En est-ce assez, ô ciel, et le sort pour me nuire / A-t-il quelqu’un des miens qu’il veuille encore séduire »), il récupère cette souveraineté qui le mettait sur la voie de la perdition dans cette curieuse partie, où il se trouvait acculé à l’usage de la violence, qui aurait valu nombreuses levées au jeu. En effet, en exerçant soudain le pouvoir sur lui-même (avec le fameux « Je suis maître de moi comme de l’univers »), il change véritablement la nature de son autorité sur les autres. Il se montre cette fois bien décidé à faire toutes les levées : chacune de celles qui concernent les dix conjurés qu’il a nommés « Procule, Glabrion, Virginian, Rutile, / Marcel, Plaute, Lénas, Pompone, Albin, Icile » et auxquelles il ajoute les cas de Cinna, Maxime et Émilie : « Commençons un combat », propose-t-il, de manière étonnante, au vers 1705. De fait, il va surprendre et contrarier, tout le monde par une générosité pleinement volontaire, avec un brio quasiment autoritaire (v. 1707-1708), ce que souligne la répétition du verbe vouloir à la première personne : « Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler ; / Je t’en avais comblé, je t’en veux accabler. » Par là, il impressionne, en faisant preuve non de mollesse, mais de cette mansuétude politique qu’il percevait comme trop féminine, et il gagne cette position d’empereur sage et serein à laquelle il aspirait. Par cette forme de renversement du cours du jeu qu’il avait choisi, assumant soudain sa prééminence, il gagne désormais sur toute la ligne, en s’imposant par de nouveaux moyens : il ne se donne plus un profil bas mais au contraire, dans une nouvelle acception de sa puissance, il impose sa rayonnante indulgence, son impérial pardon. C’est bien réaliser là un reversi, un acte d’empereur inattendu, et qui est encore mieux considéré que d’avoir réussi le plus faible nombre de levées.
41Émilie se rend la première. Comment l’expliquer ? Femme, si elle se distinguait par sa faconde imprécatoire, elle ne détenait en réalité, pour faire renoncer Auguste à son jeu curial habituel ou amélioré, qu’une carte importante : son profond accord avec Cinna. Dans l’avant-dernière scène de la tragédie, après les dissensions de l’acte III, on entend les amants dans une sorte de duo de martyrs après la querelle35 : « Ensemble nous cherchons l’honneur d’un beau trépas, / Vous vouliez nous unir, ne nous séparez pas » (v. 1655-1656). L’amour, les valeurs du cœur, même nées dans une haine commune, constituaient la seule force d’Émilie contre Auguste.
42Il convient ici d’évoquer l’importance, au jeu du reversi, du valet de cœur, qu’on appelle le quinola : c’est une carte intéressante mais dangereuse, bivalente. Si elle est utilisée en renonce, quand on ne peut suivre dans une couleur demandée, que l’on « coupe », elle constitue une opposition d’ordre supérieur, elle donne la victoire, assurant la mainmise sur la poule, donc sur tout ce qui a été mis au jeu. En revanche, si elle est utilisée parce qu’on n’a qu’elle pour suivre sur du cœur, elle fait au contraire perdre la partie :
Il n’est pas permis d’escarter du ceur, par la raison qu’il faut tâcher à sauver la Poule, & forcer celuy qui a le Quinola entre les mains de le jetter sur la Carte de cœur que l’on jette sur la table, pource que quand on fait sortir ce Quinola, celuy qui le fera jetter sur la Carte de Cœur qu’il jouë, oblige celuy qui donne le Quinola, de luy payer quatre marques ou jettons, & quelquefois vn à chacun des joüeurs, quand il est convenu36.
43Les « hautes bontés » (v. 1715) d’Auguste, exprimées par la couleur du cœur, importantissime au jeu du reversi puisqu’il est ainsi impossible de l’écarter, ont fait céder la carte majeure qu’Émilie détenait. L’empereur a bel et bien « forcé le quinola », comme l’indique la définition de Sorel. Il faut ici rappeler l’origine de cette considération inaccoutumée qu’on accordait au valet de cœur : c’était une manière d’exprimer de l’estime à celui qui servait une dame. Au début de la tragédie, Cinna et Émilie communiaient dans leur opposition violente à Auguste : le héros éponyme semblait ainsi aimé pour la nature sauvage du service rendu à sa dame. Au début de l’acte III, cette passion se trouve comme privée de nourriture haineuse par les preuves qu’Auguste donne à Cinna d’un amour d’une autre espèce, celui d’un monarque pour son peuple. Quand, à la fin de l’acte V, elle constate le stupéfiant reversi de l’empereur, qui métamorphose l’oppression par la violence en oppression par les bienfaits, « l’adorable furie », qui venait pourtant de se déchaîner avant l’arrivée de Maxime, n’en est plus une : elle prend la parole comme au jeu elle poserait un quinola pour répondre par le cœur au « cœur » demandé par l’empereur, irrésistible ; c’est ce qui apparaît dans le « et » par lequel Émilie commence la réplique qui répond à l’empereur. L’expression « je me rends » exprime par ailleurs qu’elle cède à une contrainte irrésistible.
44Celui qui fait le reversi et, en plus, force le quinola est considéré au jeu comme un véritable triomphateur car la chose est extrêmement rare. Voilà qui s’accorde à la célébration finale de l’empereur par Livie. Dans l’enthousiasme de cette célébration, on oublie de mesurer les défaites, comme si tous les partenaires bénéficiaient du rayonnement qui émane du vainqueur. Le parallèle entre l’action de Cinna et le jeu du reversi confirme les réserves qu’à l’instar de Guez de Balzac, dans la première version de sa fameuse lettre à Corneille sur Cinna37, on pouvait ressentir à l’égard de cette « Bacchante de la liberté et de la vertu », l’expression ne se révélant pas fort élogieuse : Corneille cherchait vraisemblablement à les inspirer. Faut-il penser qu’en perdant au reversi (« je me rends »), Émilie, dont l’amour admiratif pour Cinna la rendait inhumaine, s’est humanisée, voire féminisée en se mettant à aimer et admirer Auguste ? Forçant le quinola, Auguste l’amène également à payer des jetons à Cinna, à qui elle en voulait, à Maxime, considéré comme traître…
Léontine : vers la victoire au tarot tragique par la patiente dissimulation
45Lorsque le sujet d’une tragédie est centré sur une figure de tyran en plein exercice de son pouvoir brutal, la configuration de l’action ressemble assez naturellement à celle d’une partie de tarots, dans laquelle un joueur qui estime sa main très forte lance un défi aux trois autres en déclarant combien de points il compte atteindre pour rafler le maximum de marques. Contre lui, les autres joueurs, associés, se constituent en défense, à l’instar des protagonistes qui doivent s’opposer à la réalisation des desseins d’un personnage central, puissant, et redoutable : ils disposent de peu de temps pour le faire, justement parce qu’il est tout-puissant et que ses ordres peuvent être exécutés rapidement ; de surcroît, rappelons que le temps d’une partie coïncide à peu près avec celui d’une représentation, elle-même reflétant un écoulement de vingt-quatre heures. Par ailleurs, comme dans les autres jeux, mais peut-être plus au tarot qu’ailleurs, les cartes ne pouvaient guère être perçues autrement que comme liées à l’histoire, à la puissance, à la société. Critiquant les livres d’Étienne Pasquier et notamment un passage concernant le jeu d’échecs, le jésuite François Garasse lui opposait en effet une interprétation du jeu de tarots comme reflet de la société, et il écrivait ainsi à leur sujet :
Je dirais que le jeu des tarots représente une république mieux que les échecs [ce qu’avait prétendu Pasquier] ne représentent la cour d’un roi ; aux tarots il y a de tous états comme dans une république ; il y a des deniers pour récompenser les bons ; il y a des épées pour la défense de la patrie ; il y a des chevaliers, des sergents, des bateleurs, des triomphes, des empereurs, des papes et des fous ; qui voudrait moraliser cela, ferait un livre plus gros que les Recherches de maître Pasquier38.
46Enfin, les enseignes françaises (trèfle, cœur, pique et carreau), dites aussi couleurs, ou les enseignes latines (épées, coupes, bâtons et deniers), mais encore plus les vingt-deux tarots ou triomphes, dits également « à tout », et plus tard « atouts », se voyaient souvent prêter une sorte de signification morale, voire spirituelle, trois des arcanes majeurs correspondant notamment à des vertus cardinales : Tempérance, Justice, Force. À l’instar de Garasse, beaucoup d’autres, notamment à la fin du siècle, le Père Ménestrier, jésuite lui aussi, ont voulu voir des possibilités de « moraliser » dans les enseignes, les couleurs, les noms donnés aux rois, aux chevaliers, aux dames… Ainsi le développement de l’action pouvait-il être perçu par les spectateurs avec une sensibilité proportionnelle à leur expérience de cette dynamique de jeu et à l’imprégnation de l’iconographie des cartes par l’Histoire et les emblèmes.
47Quelle correspondance peut-on établir entre la force potentielle d’une main de tarot et les possibilités d’intervention d’un personnage dans l’action ? Disposer d’une force armée, officielle ou clandestine, correspond forcément à une carte haute. Cependant bénéficier d’une aura d’estime, voire d’amour, dans le public équivaut également à une assez bonne carte car celle-ci, au-delà de sa valeur intrinsèque, est source de dynamisme dans le jeu. Par ailleurs, des vertus personnelles de réflexion, d’endurance, d’imagination, peuvent renforcer tel défenseur mal pourvu en cartes et amener les détenteurs de cartes hautes à les jouer mal. Sauf données historiques extraordinaires dont peut s’inspirer une tragédie, la donne ne pourvoit guère les héroïnes tragiques de la force armée, rarement de l’aura de la gloire, mais il arrive qu’elles disposent des vertus évoquées : elles peuvent se révéler très efficaces quand elles utilisent habilement l’une et / ou l’autre.
48Cependant, quand, au jeu, on est associé contre un preneur, il est bien difficile de deviner d’emblée la nature des cartes que les autres défenseurs ont en main et la manière dont ils vont les jouer ; de même, surtout dans les pièces implexes, il est particulièrement délicat aux divers acteurs de pénétrer les données dont les autres personnages, fussent-ils leurs alliés, disposent et de deviner leurs réactions à l’événement.
49À l’acte I d’Héraclius, Phocas, tyran d’usurpation, règne depuis douze ans sur Constantinople. Prenant la parole le premier dans la tragédie, il énonce son intention d’augmenter encore sa puissance, de valoriser son règne en contraignant Pulchérie, la seule des enfants du défunt empereur à laquelle il ait fait grâce, d’accepter un mariage avec son fils. Le but de l’empereur-usurpateur est d’assurer à son pouvoir terrorisant une sorte de légitimité, une véritable dignité impériale, grâce à une descendance dont la noblesse ferait oublier sa propre roture39. Les joueurs de tarot40 peuvent le percevoir aisément comme le preneur, qui estime avoir en sa main assez de puissance – grâce à des cartes hautes et sans doute des « longues » – pour s’engager sur ce contrat élevé. Il court néanmoins un danger de chute, comme au jeu, quand on ne parvient pas à remplir un contrat : un tumulte est en train de se produire dans Constantinople et il veut justement se prémunir de telle révoltes en réalisant d’urgence, pour se rendre plus populaire, le mariage de son fils avec la fille de feu le légitime empereur.
50Trois raisons essentielles stimulent la résistance de Pulchérie : fille d’empereur, elle n’admet pas d’obéir à l’ordre d’un usurpateur qui a, de surcroît, décimé sa famille41 ; elle refuse le pseudo-Martian parce qu’il est le fils de Phocas ; elle est éprise de Léonce, fils de Léontine. Cependant ce n’est pas contre cette seule réticence féminine que le tyran doit combattre. Pourtant isolée, comme seule survivante de sa famille, Pulchérie trouve en effet dès l’acte I des renforts que le spectateur n’attend pas a priori : celui qu’on croit fils du tyran, qu’on découvre paradoxalement vertueux, refusé comme époux mais estimé de la princesse, et celui qu’on croit fils de la patricienne Léontine censée avoir livré à Phocas son plus jeune frère, Héraclius. Ce n’est pas seulement la haine du tyran qui les fédère en « défense » : ils se trouvent unis par des liens extrêmement serrés. Le pseudo-Martian et pseudo-fils de Phocas est frère de lait du pseudo-Léonce, qui vit chez Léontine ; les deux jeunes hommes sont d’autant plus inséparables que ce pseudo-fils de Léontine a sauvé à la guerre la vie de celui de l’usurpateur ; l’amour attachant Pulchérie à Léonce, les trois jeunes gens se trouvent donc étrangement et étroitement associés, comme ceux que le fonctionnement du jeu de tarots unit, dans un « seul contre tous ». Phocas s’étonne et s’irrite de cette union inattendue de Pulchérie et de son fils contre son projet (v. 75-7842) :
Pulchérie et mon fils ne se montrent d’accord
Qu’à fuir cet hyménée à l’égal de la mort,
Et les aversions entre eux deux mutuelles
Les font d’intelligence à se montrer rebelles.
51Phocas parlant ici le premier, les autres doivent répondre à sa demande : il exige donc qu’on fournisse dans une couleur, en quelque sorte qu’on lui livre des cartes, assimilables à des êtres (Pulchérie, après les enfants de l’empereur Maurice). Pour « prendre », il commence par poser devant chacun des défenseurs une carte haute, à laquelle celui-ci doit en quelque sorte obéir en fournissant dans sa « peinture », pour nous exprimer comme Marolles. Le tyran se sent sûr d’emporter tous les plis à venir car, tyran d’usurpation et d’exercice, il possède dans son jeu, grâce à la donne, des honneurs élevés et des triomphes. On supposera qu’à ce stade de l’action, le tyran pouvant tout sauf sur les âmes, mais cherchant aussi à savoir d’où vient cette menace de la survie d’un fils d’empereur légitime, il tend une carte figurant parmi les « honneurs » : dans la mesure où l’on accordait alors beaucoup d’attention à ce qui était représenté sur les cartes et pas seulement à leur valeur, c’est avec une certaine logique qu’on pourrait imaginer qu’il appelle les autres à fournir à César, roi de carreau43. Le carreau (ou le denier) est en effet une couleur que la plupart des interprètes de la symbolique des cartes voient comme un sens de la Terre, du matériel, de l’argent, de préoccupations assez basses en somme : Phocas est sans noblesse.
52Pulchérie, au départ, peut sembler placée dans la même situation qu’Émilie, puisqu’elle a bénéficié des faveurs d’un empereur arrivé au trône par la violence : il l’a élevée et en princesse. Néanmoins elle n’est considérée par Phocas que comme un ventre utile, capable de conférer un certain lustre à son règne par la dignité d’une fille d’empereur, transmissible à l’enfant qu’elle mettrait au monde : au jeu, il vise au moins à faire tomber la dame qui semble pouvoir se trouver dans la main de la princesse, parmi les honneurs, mais elle ne saurait l’en enrichir. Elle ne répond à la contrainte que par une carte très basse, des mots méprisants, dans l’enseigne demandée.
53Le pseudo-Martian semblant faire entrer son alter ego, le pseudo-Léonce, quand Phocas le laisse avec Pulchérie pour la décider, le trio de défense se concerte mais à demi-mots seulement car, sur scène comme au jeu, la communication se révèle délicate. Lorsque le pseudo-Martian (en réalité Héraclius) affirme à Pulchérie ainsi qu’au pseudo-Léonce (en réalité Martian) sa solidarité contre le projet de Phocas, il ne peut qu’employer un langage crypté, de même qu’aux tarots un membre de « la défense » plus subtil que les deux autres essaie, par certaines sorties de cartes, ou telle expression orale convenue, de leur faire comprendre quel est son propre jeu et ce qu’il a saisi du leur. Pour les partenaires, l’interprétation reste difficile. Ainsi des vers 331-335, adressés par le héros éponyme à Pulchérie pour lui signifier de quelles cartes il dispose lui-même :
[…] pour vous servir d’appui,
J’ai peine à reconnaître un père encore en lui
Je ne suis plus son fils s’il en veut à vos jours,
54ou des vers 355-359, destinés à Léonce et à la fille de Maurice pour leur indiquer qu’il connaît leur main :
Je te connais, Léonce et mieux que tu ne crois :
Je sais ce que tu veux et ce que je te dois.
Son bonheur est le mien, Madame, et je vous donne
Martian et Léonce en la même personne.
C’est Martian en lui que vous favorisez.
55Quant à Léonce, il domine mal son jeu, classant mal ses cartes : il ne « se connaît » pas, pour reprendre l’expression employée par Corneille dans sa didascalie, et d’autant moins que son prénom, Léonce, semble l’unir à Léontine.
56Dans l’acte I, ce frère de lait du l’héritier légitime du trône prouve paradoxalement son amour pour Pulchérie en poussant Martian-Héraclius à l’épouser, malgré ses propres sentiments pour cette princesse, et à céder à l’exigence du tyran, pourvu qu’elle ait la vie sauve ; on peut voir dans ce geste la pose sacrificielle – car il s’agit d’une carte assez haute – d’un chevalier de carreau44, i.e. de denier, la figure rappelant la vaillance montrée par ce personnage au combat. En effet, contrairement aux auditeurs qui, eux, ne disposent pas des précisions fournies par la liste des acteurs ni des didascalies, les lecteurs comprennent déjà, qui est en réalité ce pseudo-fils de Phocas, tels quelques observateurs privilégiés et particulièrement bien placés de la partie ; mais Léonce, lui, ignore le risque d’inceste entre son ami et Pulchérie, qui sera révélé au public, mais non pas à lui, au début de l’acte II. Quant à Martian-Héraclius, le spectateur de la tragédie-partie imaginera volontiers que la couleur qui domine dans son jeu est le cœur, comme il le dit en s’adressant à Phocas : « J’ai du cœur » ; ce vers 281 renvoie à sa vaillance et à sa capacité de prendre les armes. Il est en effet impossible d’envisager que Corneille ait pu écrire ce quart de vers sans songer à la parodie que Boisrobert avait faite du Cid pour amuser Richelieu et qu’a rapportée Tallement des Réaux : « Rodrigue, as-tu du cœur ? – Je n’ai que du carreau45. » Lier cette scène à une partie de cartes semble donc bien fondé. Héraclius ne peut cependant opposer « sa » couleur au tyran car, au jeu de tarots, on doit ou fournir dans la couleur demandée ou couper par une triomphe. Devant la puissance évidente de Phocas en ville et dans son palais, Martian-Héraclius doit éviter de jouer ses triomphes trop tôt. Il fournit donc le plus bas possible, dans la couleur demandée par Phocas pour l’amadouer, mais néanmoins un peu plus haut que Pulchérie, pour éviter d’irriter celui qu’il traite en pseudo-père : il use à l’égard du tyran de termes moins méprisants que ceux de la princesse.
57Ainsi, à la fin de l’acte I, Phocas semble toujours en position de force pour réaliser son projet et gagner la partie mais la levée qu’il a effectuée est de faible valeur. Il est par ailleurs loin de soupçonner la nature des cartes détenues par ses adversaires, qui sera révélée à l’acte II. Du temps s’étant alors écoulé, comment la défense peut-elle réagir à la nouvelle carte-menace glissée par le tyran et que l’on considérera de même hauteur, à défaut de même couleur, que celle qui avait été posée par lui à l’acte I ?
58En fait, le deuxième acte révèle que la partie est bien plus complexe qu’elle n’a semblé dans le premier ; on découvre une défense plus forte qu’elle ne le paraissait car les premiers défenseurs sont relayés par des joueurs de grande qualité, qu’on ne s’attendait pas à voir intervenir dans l’action.
59Apparaît d’abord Léontine, qu’on pouvait croire capable de « tenir le jeu » du preneur puisque réputée avoir livré le plus jeune fils de Maurice à Phocas : dès la scène 1, l’on découvre qu’elle a en réalité trompé le tyran et sacrifié son propre enfant à la folie meurtrière de celui-ci pour sauver la descendance de Maurice ; de plus, ayant élevé ensemble le fils de l’empereur et le fils du tyran, elle n’a pas rendu son fils au tyran une fois qu’ils sont devenus adultes mais lui a substitué celui de Maurice. La main d’Héraclius est donc une main forte car il a pour lui la légitimité, la confiance du tyran, sa proximité avec lui ; par ailleurs Léontine est là pour la jouer, au moins aussi bien que lui, sinon mieux, quand le besoin s’en fait sentir du côté des paroles.
60Devant l’imminence du péril, qu’accroît l’enflement de la rumeur concernant la survie de l’héritier légitime de l’empire, le véritable Héraclius, lors de la scène 2, se montre tenté de se révéler46, ce qui équivaudrait à sortir une de ses triomphes, pour galvaniser les énergies populaires. Cependant au jeu comme à la guerre, il est imprudent de s’opposer trop tôt à l’ennemi / au preneur en révélant une partie de ses forces avant d’avoir bien recensé ce qu’elles peuvent produire, en particulier dans leur conjugaison avec celles des alliés ; d’où la répétition dans la bouche de Léontine, pour qualifier l’attitude d’Héraclius du verbe « hasarder » (v. 464 et 498), qui rappelle l’enjeu. Le héros éponyme finit par reconnaître le risque encouru (v. 531 : « Je ne me suis voulu jeter dans le hasard ») et il accepte de se contenter de jouer provisoirement assez bas, comme Léontine le lui demande dans les vers 459-460 : « Et puisqu’aucun soupçon ne dit rien à Phocas, / Soyez encor son fils, et ne vous montrez pas. »
61Léontine constitue donc non seulement une figure du savoir mais celle de la prudence. Forte de ses secrets, elle semble dominer ce moment de la partie : « J’aurai trop de moyens d’arrêter sa furie » (v. 462). Aussi Héraclius lui cède-t-il sa main au vers 538 : « Disposez des moyens et du temps de le [le trône] prendre » car elle revendique la maîtrise du devenir du héros éponyme : « Vous régnerez par moi, si par moi vous vivez. / Laissez entre mes mains mûrir vos destinées » (v. 496-497). L’image des mains s’accorde à l’emploi d’une expression fort usitée au jeu pour désigner le fait d’empêcher un joueur d’opérer la forte levée qu’il escomptait : « Je romprai bien encor ce coup s’il vous menace » (v. 486). La conduite du jeu par Léontine ne va pas toutefois jusqu’à pouvoir éviter les impondérables, qui existent toujours au jeu. Elle peut être surprise : c’est ce qui arrive lorsqu’Exupère, connu comme ennemi de Phocas, fait irruption. Elle doit calculer avec, dans son camp, une donne différente de ce qu’elle avait imaginé, mais qui paraît pouvoir renforcer la défense. Elle sait néanmoins qu’une bonne carte peut se révéler dangereuse si elle est mal jouée, que chaque joueur dispose d’une autonomie (v. 745-746), et qu’il est difficile de tout prévoir : « Et, lorsque le hasard me flatte avec excès, / Tout mon dessein avorte au milieu du succès. »
62En se ralliant sans illusion aucune au mythe d’un Héraclius survivant47 et en étant au reste soupçonnée par Phocas de l’avoir forgé et d’organiser en sous-main une rébellion, Pulchérie appuie objectivement l’action d’Exupère, dont le père a, comme le sien, été immolé par le tyran (II, 3, v. 581) Quand ce personnage apparaît à l’acte II, dont Pulchérie est absente, il semble y réaliser ses vœux et « tenir son jeu » : chez Léontine, il montre un billet de Maurice qui désigne en Léonce un prince survivant et il indique que c’est lui qui dirige les mutins qui pourraient se mettre au service du prétendu fils de Maurice. Néanmoins, pour ne pas éveiller les soupçons de Phocas, il ne joue pas une carte haute mais, modestement, une carte basse, qu’on imaginera dans la couleur demandée par le tyran, laissant Léonce-Martian donner le signal de l’insurrection contre le tyran : il part simplement « attendre » (v. 688). Léonce-Martian, assume moralement son nouveau rôle d’Héraclius mais, malgré sa bravoure et quoiqu’il déteste le tyran et se sente investi de la mission d’agir en justicier pour ce qu’il croit sa famille, il ne réagit pas de manière impulsive ; il réfléchit, il songe à une solution d’urgence et de prudence à la fois pour sauver Pulchérie, qu’il pense désormais sa sœur : elle consisterait à lui faire épouser « Martian », le pseudo-fils du tyran (v. 717-720). Sa décision revient à contrer le roi de Phocas par une des triomphes, qu’on supposera être la très méditative Papesse (tarot 2), si l’on en juge par toutes les représentations qu’on peut en voir dans les jeux de l’époque et par la perplexité que le personnage exprime à Léontine, qui dans sa grande finesse analyse bien son comportement : « Il sauve en reculant ce qu’il croit mieux détruire » (v. 756).
63Dans cet acte II, on découvre en ce personnage féminin mal appréhendé par le spectateur dans l’acte I, une infinie capacité de combativité, de dissimulation et de constance. Malgré ce que sa fille Eudoxe a révélé de la double substitution d’enfants à laquelle elle a procédé afin de faire vivre l’héritier de Maurice dans le palais impérial, on entend avec surprise cette dévouée patricienne confirmer les dires du billet de Maurice alors que les propos qu’elle tient ensuite à sa fille les démentent encore. Voilà qui augure d’un maniement si hautement stratégique des cartes que Martian-Héraclius lui a laissées sur sa demande qu’Eudoxe s’en étonne avec quelque indignation et sans que sa mère ne consente à s’expliquer. Dissimulatrice, mais sachant aussi par la douleur autrefois endurée ce qu’est le lien de nature, Léontine connaît les cartes que l’ex-Léonce a en main après la révélation d’Exupère, et elle en redoute le maniement (v. 753-754) : « Sur le point de frapper, je vois avec regret / Que la nature y forme un obstacle secret ». Il n’est en tout cas pas temps pour elle de dévoiler ses « atouts ». Elle compte simplement encourager Exupère sans passer elle-même à l’action-révélation de ses bonnes cartes et comme posant au jeu une dame, une « amazone48 », de la couleur qu’avait demandée le tyran pour ne pas attirer l’attention. La patience est une qualité quand on joue. Léontine, qui a fait preuve de la plus extrême endurance, peut montrer cette qualité-là.
64S’étant déclaré, au cours de cet acte II, prêt à s’opposer au tyran par les armes et attirant vers lui toutes les attentions, Léonce-Martian a en quelque sorte remporté le pli de l’acte sans tapage. Au début du troisième49, stimulé par Pulchérie il semble devoir prendre l’initiative de l’action et affirme sa valeur en décidant de déclencher l’insurrection contre Phocas. On peut le voir là poser la triomphe symbolique de l’Empereur (tarot 4). C’est alors qu’Exupère, pourtant perçu comme attaché à la défense, arrive en même temps que Phocas : le patricien semble à ce moment jouer contre les siens, puisqu’il a dénoncé Héraclius en la personne de Léonce. Au jeu des tarots, on dessert son camp lorsqu’on répond en dessous d’une triomphe (ici l’Empereur) en posant la lame du Bateleur, appelée également le Petit parce qu’elle porte le numéro 1, ce qui en fait la première des triomphes. Si jusqu’au terme du jeu, Exupère l’avait gardé dans ses cartes – i.e. le jeu de Pulchérie, qui ne parle jamais dans la même scène que lui dans cet acte – il aurait rapporté dix points à chaque membre de son équipe et en aurait fait perdre trente au tyran, auquel il risque au contraire d’apporter la victoire par ce geste insensé. De fait, grâce à ce renfort inattendu d’Exupère, Phocas croit pouvoir éliminer toute forme d’opposition en faisant exécuter le prétendu Héraclius. Si sa Mort (tarot 12) semble triompher ici, l’observateur du jeu sait que les cartes de Léontine pourraient néanmoins bientôt l’emporter. Par ailleurs, vu l’échange qui suit avec Amyntas, on peut soupçonner Exupère d’avoir manœuvré en fournissant avec le Petit : il a assurément de meilleures cartes parmi les triomphes mais cette pose ne le laisse pas soupçonner. « De la dissimulazione onesta50 »…
65On note qu’Héraclius et Léontine sont totalement absents de cet acte III, tout comme Phocas l’était de l’acte II, sa menace n’en ayant pas pour autant été éliminée et ayant même créé les conditions du jeu. La mention par Léonce, se croyant Héraclius, des potentialités d’intervention du héros éponyme et de sa dévouée gouvernante quand il est emmené par les gardes, réintroduit l’espoir : « Le Ciel par d’autres mains vous en daigne affranchir ! » (v. 997). Il convient en effet de rappeler que ces deux-là disposent de la carte suprême en détenant et vérité et personne de l’empereur-héritier ; ils n’ont jusqu’alors posé aucune des triomphes de leur main, pour éviter de faire comprendre ce qu’elle contient. Aussi peut-on estimer que leur absence de cet acte équivaut à la pose de l’Excuse, insaisissable dans son cheminement comme dans sa logique51, et imprenable.
66En compensation, l’acte IV, jusqu’à la scène 3 incluse, sera l’acte du véritable Héraclius. Phocas, qui a effectué la levée précédente grâce à la Mort, se montre pressé d’en finir avec la famille de Maurice et croit son avenir assuré : il se sent sûr de « prendre » en présentant le Chariot, prêt à se lancer dans la carrière, et qui figure bien sa situation puisque Pulchérie illustrera sa descendance. Il est freiné dans son élan par son pseudo-fils, le héros éponyme, que la scène 1 a révélé conscient de l’impossibilité de prendre la tête d’une opposition armée puisque tout le monde croit que le fils de Maurice est un autre, de surcroît emprisonné et bientôt condamné. Il oppose donc au tyran heureux l’obstacle des paroles, et lui révèle un nouveau mystère du passé pour empêcher une injustice et ne pas voir le fils du tyran exécuté à sa place. Son intervention correspond à la pose de la triomphe de la Justice, supérieure en valeur au Chariot : elle est figurée par une femme (Thémis ?) portant une balance, qui pèse les conséquences des actes, qui réfléchit avant d’agir. Le vrai Martian, lui, n’a pas, n’a plus, de triomphes à poser. Prisonnier du tyran, se trompant sur son identité, il se trouve littéralement empêché d’agir, presque effaré par la manière dont son frère de lait a décidé de mener son jeu, et l’on pourra imaginer qu’il se défausse avec un honneur, faible à côté des triomphes du Chariot et de la Justice, mais non sans dignité. Pour la défense, les prises de parole d’Exupère sont extrêmement intéressantes : loin de lutter contre l’argumentation d’Héraclius, comme sa récente « trahison » le faisait attendre, il exprime une incertitude, une hésitation qui vaut pose de la carte de l’Amoureux indécis, la triomphe 6, inférieure, certes, à la lame de la Justice et au Chariot mais de nature à déstabiliser le tyran, qui regarde alors l’ensemble du jeu sans le comprendre, ce que sa longue réplique, qui résonne comme un monologue dans les vers 1361-1388, fait sentir.
67Au regard de cette partie tendue, l’arrestation de Léontine vaut début d’un nouveau tour de cartes, qui s’arrêtera au milieu de l’acte V avec l’annonce de la mort du tyran, Exupère se révélant plus fort que lui. Quand Léontine, capturée, est amenée à Phocas, le véritable Héraclius, qui avait remporté le pli précédent grâce à sa révélation et neutralisé le tyran, lui laisse la parole, donc son jeu : « Mais ne le laissez pas dans l’erreur davantage » (v. 1396). C’est alors que celle qui a gouverné les deux princes potentiels use de la force de son secret, dont on sent bien que la torture ne viendrait pas à bout. Sa fermeté l’emporte sur tous en bloquant la situation, en empêchant le lion de dévorer sa ou ses proies ; on sait que cette patricienne est imbattable en matière de force morale. Évidemment c’est la triomphe de La Force (tarot 11) qui correspond au coup qu’elle joue ici pour Héraclius. La représentation de cette triomphe est d’autant plus intéressante qu’elle représente une femme en train d’empêcher la gueule d’un lion de mordre. On comprend le symbole : la carte évoque bien plus une force mentale qu’une force physique. De surcroît, Léontine porte justement un nom qui rappelle son aptitude à dominer le fauve, leo, leonis signifiant « lion » en latin. En livrant au bourreau son propre enfant au lieu de celui de l’empereur Maurice et en dissimulant pendant des années les identités respectives des deux garçons qu’elle a élevés, elle a prouvé un caractère extrêmement puissant, qui allie réactivité, détermination, et endurance hors du commun. On sait que, même prisonnière, elle apportera la même détermination à conserver son secret, qui empêche Phocas de dévorer aussi bien Héraclius que Martian.
68Certes, Phocas continue de disposer de la force armée, qui peut mettre fin à la pure lignée de Maurice mais il risque surtout d’éteindre la sienne : la force silencieuse de Léontine le jette dans des abîmes de perplexité bien plus profonds encore que la Justice opposée à son Chariot par son pseudo-fils Martian ; aussi chaque coup contre le faux Héraclius peut-il être arrêté quand le cri du véritable rappelle la lame de Léontine, empêchant la main meurtrière d’Octavian de s’abattre. Néanmoins, une fois rassuré parce que la révolte populaire en faveur du prétendu héritier de Maurice serait matée, le tyran renonce à tout sentiment de paternité et menace la défense d’exécuter les deux héros qui revendiquent l’identité d’Héraclius : faute de fils, il épousera lui-même Pulchérie afin de rouvrir la gueule du lion que Léontine empêchait de déchirer. Envisager d’exécuter son propre fils ne peut correspondre qu’à la présentation de la haute lame 15, celle du Diable, ne fût-ce que pour son inévitable valeur symbolique. Aussi Phocas devrait-il ensuite ne voir arriver au jeu qu’une défausse, que présente le personnage le plus émouvant de cet acte V : Léonce-Martian. À ce stade de l’action, ce personnage continue en effet de se trouver objectivement le plus mal loti car il ne dispose plus d’aucune certitude intérieure, d’aucune force52 – d’aucune triomphe. Il le dit dans des termes qui traduisent un extrême désarroi (v. 1816-1820) :
Madame : dans le cours d’une seule journée,
Je suis Héraclius, Léonce et Martian,
Je sors d’un empereur, d’un tribun, d’un tyran.
De tous trois ce désordre en un jour me fait naître,
Pour me faire mourir enfin sans me connaître.
69Cette défausse pourrait consister dans un honneur qui lui resterait, peut être un écuyer. Pulchérie, qui répugne à la feinte alors que les deux frères de lait y songent pour tromper Phocas, ne parvient pas à prendre de décision, à se saisir de ses cartes. En fait, sa main se trouve reprise par celui qui, contrairement à ce qu’elle pensait, tenait fidèlement son jeu : Exupère.
70Quand survient la nouvelle de l’assassinat du tyran par ce dernier, l’on comprend que les efforts conjoints et successifs du dévoué patricien, de Pulchérie, d’Héraclius, de Léontine et de Martian, constituant, à eux tous, la défense, ont ainsi payé, dans le temps, qu’ils ont ménagé le moment de la présentation du tarot décisif. Certes, dans la dernière scène de l’acte IV, comme Phocas avait cédé sa place au patricien pour interroger Léontine, Exupère avait laissé entendre qu’il utiliserait une très haute carte au profit des opposants au tyran, et, malgré les mépris de sa prisonnière, il avait annoncé au vers 1509 : « Si vous ne me croyez, craignez ce que je puis. » Néanmoins, comme au jeu, les risques pris par le patricien en faisant arrêter celui qu’il croyait Héraclius étaient grands. Corneille le souligne plaisamment dans l’Examen de sa tragédie : « Quand il découvre Héraclius à Phocas et le fait arrêter prisonnier, son intention est fort bonne, et lui réussit, mais il n’y avait que moi qui lui pût répondre du succès » (nos italiques). De fait, le meurtre de Phocas équivaut à l’apparition opportune, sur la table de jeu, de la carte très haute du Jugement (tarot 20), qui châtie les méchants, qui annonce la fin d’un cycle, celui de la tyrannie, et la résurrection, celle de la lignée de Maurice. Cette carte, obtenue lors de la donne qu’a bien voulue l’auteur, est certes plus forte encore que celle de Léontine, qui, femme, n’a pu disposer d’armes pour tuer, mais le Jugement n’a pu s’imposer que grâce au geste ancien de sacrifice et de constance inouïe qui a sauvé Héraclius, grâce à l’exemple de parfaite dissimulation donné de tout temps par la patricienne, grâce à celui de sa patience, y compris celle qui a consisté à endurer des soupçons, non mérités, de sa fille, de son fils, et même d’Héraclius, grâce à la stratégie, non sans risques mais sans faille, de cette admirable joueuse, qui a su éviter au héros éponyme de mal jouer son jeu sous l’effet d’une excessive vertu.
71Au jeu, de même que dans l’action, la situation de chacun doit être éclaircie, il faut bien compter tous les points afin de confirmer la défaite du tyran par la restauration assurée de la dynastie légitime : Pulchérie, qui a repris son jeu des mains du modeste Exupère, se voit investie d’une fonction de révélation, comme l’Étoile, la lame 17, qui brille dans la nuit, puisqu’elle connaît l’écriture de sa mère, l’Impératrice. En lui remettant le billet de cette dernière, postérieur à celui de Maurice, et qui désigne sans équivoque l’héritier de l’Empire, Léontine ouvre tous les possibles après le meurtre de Phocas. Ce billet équivaut à la plus haute des triomphes, le Monde, la lame 22, symbolisant l’aboutissement harmonieux d’un projet, la richesse de l’avenir.
72On comptera parmi les composantes de la Force évoquées plus haut l’action éducative que la patricienne a réalisée et qui confirme sa ressemblance avec la belle figure du tarot 11 (v. 1434-1436 avec nos italiques) ; Léontine se vante de cette action prestigieuse :
C’est du fils d’un Tyran que j’ai fait ce Héros,
Tant ce qu’il a reçu d’heureuse nourriture
Dompte ce mauvais sang qu’il eut de la Nature !
73Que, dans les derniers vers de la tragédie, Héraclius, héros éponyme, empereur désormais, donne à son frère de lait, qui ne joue plus qu’en défausse, le nom définitif de Léonce constitue une véritable célébration de Léontine, dans une sorte d’acte de justice qui lui rend un fils qu’elle avait sacrifié.
74Ainsi des zones d’ombre apparaissent dans la comédie quand le regard précocement lucide de Doris ou tard désabusé d’Angélique se porte sur les jeux en lesquels les personnages masculins transforment les rapports sentimentaux : au pire, à s’y jeter sans prudence et sans calcul, comme la seconde, les filles perdent tout ; au mieux, elles « tirent leur épingle du jeu » et s’y amusent, comme la première. Dans une sorte de continuité avec ces dramaturgies, l’Émilie de Cinna manifeste encore une grande réticence à participer à un jeu curial dont les joueurs peuvent gagner un peu en raisonnant bien, et répugne plus encore à une partie de reversi : si elle feint avec peine de participer au premier, c’est pour mieux pouvoir y mettre fin et se livrer au hasard de ce qui serait un acte de reprise de la guerre civile. L’issue du nouveau jeu imposé par le héros hors normes qu’est le premier empereur fait néanmoins voir une « Bacchante » (selon Guez de Balzac) contrainte de céder un valet de cœur, et finissant par s’oublier dans l’admiration du vainqueur. En revanche, en Léontine une grande joueuse donne sa mesure, à la manière gracianesque : par sa combativité, sa dissimulation, sa constance, sa pénétration des sentiments d’autrui, par un art incontestable de la manipulation, elle joue quand et comme il faut les cartes qu’elle a en main, tenant néanmoins le jeu d’un autre, auquel elle s’est dévouée jusqu’au sacrifice, ce qui la rend extrêmement émouvante, par réflexion. De ce dernier aspect seront quasiment privées, sous la plume de Corneille, d’autres héroïnes-stratèges appelées, elles, à jouer leur propre jeu parce qu’étant reines ou susceptibles de l’être : Sophonisbe pourra encore toucher mais in fine, Aglatide et la reine Pulchérie beaucoup moins. Leur jeu n’en paraîtra que plus voyant.
1 On n’évoquera pas ici les jeux de pur hasard comme le lansquenet, très en vogue sous Louis XIII, ou le hoca, apparu en France en 1654. En revanche, aux échecs, encore pratiqués, seuls le calcul et la réflexion déterminent le déplacement de pièces semblables en valeur et en nombre pour chacun des deux joueurs, et assurent la victoire : nous n’exploiterons de cette situation de jeu que la valeur symbolique qui lui avait été prêtée au Moyen Âge et qui pouvait rester une référence en matière de rapports amoureux.
2 Rappelons que l’on doit à l’abbé de Marolles l’édition, en 1637, de la première règle de ce jeu de tarot, qui atteste de l’actualité de sa pratique.
3 Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV [1681-1686], éd. G.-J. Cosnac et de É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1883, t. I.
4 Sur cette multiplicité des miseurs et la succession des joueurs sur une même main, voir Laurent Thirouin (« La marquise au jeu du roi », dans Madame de Sévigné (1626-1696.) Provence, spectacles, « lanternes », Actes du Colloque International du Tricentenaire de la mort de Mme de Sévigné, Grignan, Association d’Action Culturelle des Châteaux Départementaux de la Drôme, 1998), ainsi que les Mémoires du Marquis de Sourches, très précis : « Le 21 de septembre [1682], le Roi […] vint dîner à La Ferté et coucher à Montfort l’Amaury, où il commença à jouer au reversi, pour amuser la Reine et la cour pendant le voyage ; les acteurs du jeu étoient le Roi qui étoit associé avec la Reine, M. le duc de Créqui, et le marquis de Beringhen, son premier écuyer, pour tenir son jeu en son absence, Monsieur, Dangeau, Xaintrailles et Langlée » (p. 198). Autre confirmation fournie par ces Mémoires, à la date du 1er novembre 1686 : « Ce fut alors que Sa Majesté résolut, pour donner quelque amusement à sa cour […], d’y jouer elle-même un très gros jeu au reversi, pour lequel chaque joueur feroit un fond de cinq mille pistoles. Les joueurs dévoient être le Roi, Monseigneur, Monsieur, le marquis de Dangeau et Langlée, maréchal des logis des camps et années du Roi. Mais, comme les avances étoient considérables, les joueurs s’associèrent avec plusieurs personnes de la cour ; et le Roi même eut la bonté d’en mettre quelques-uns de part avec lui, entre autres M. le comte d’Auvergne, M. le marquis de Béringhen, son premier écuyer, et le maître des requêtes Chamillard lesquels devoient tenir le jeu de Sa Majesté, quand elle donneroit son temps à de meilleures occupations » (Ibid., p. 510).
5 Voir Thierry Depaulis, Les Cartes à jouer au portrait de Paris avant 1701, Paris, Le Vieux Papier-Issy-les-Moulineaux, Musée de la carte à jouer, 1991, p. 8-10.
6 Dans le Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique de 1660 (Corneille, Trois discours sur le poème dramatique, éd. B. Louvat et M. Escola, Paris, Garnier-Flammarion, 1999, p. 73).
7 Dans une lettre du 29 septembre 1680, depuis sa demeure des Rochers, Madame de Sévigné racontait à Madame de Grignan : « Nous ne laissons pas d’avoir fort souvent trois tables de jeu, un trictrac, un hombre, un reversi ».
8 Par opposition à la tragédie dont la « dignité […] veut donner à craindre des malheurs plus grands que la perte d’une maîtresse » (Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique, éd. citée, p. 72).
9 Quand, dans le Tristan en prose, se rendant auprès du roi Marc, les héros boivent accidentellement le philtre d’amour, ils sont en train de se distraire sur le bateau en y jouant. À la partie d’échecs suivante, Iseut perd. Plus tard, elle tient une partie d’échecs avec le roi Marc, qu’elle ne saurait aimer d’amour. Si l’on suit Jacques Berchtold, dans « L’échiquier et la harpe » (Médiévales, no 11, 1986, À l’école de la lettre, dir. Anne Berthelot, p. 31-48), le jeu d’échecs, envisagé par lui dans le Tristan de Gottfried, révèle une certaine vanité des occupations du monde mais d’autre part, limité à lui-même, il signale à la fois une absence d’érotisme et d’effusion d’âme dans les rapports des joueurs. Il existe aussi des parties d’échecs entre chevaliers : elles figurent le combat guerrier.
10 Voir l’introduction générale.
11 À l’instar de Corneille, on entend ici par sujet non seulement le thème mais l’ensemble de la fable dramatique, incluant situations et rebondissements.
12 Voir le prélude à la présente troisième partie du volume.
13 Georges Forestier a particulièrement bien mis en lumière ce type de dramaturgie dans son Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre, Paris, Klincksieck, 1996.
14 Nous suivons pour La Veuve, l’édition procurée par Claire Carlin dans Corneille. Théâtre complet, vol. 1, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 415-594.
15 On pipait notamment les cartes en les écornant afin de les reconnaître. On pouvait aussi attirer une carte à soi avec une sorte de colle posée sur le bouton de son costume.
16 Voir, dans l’introduction à ce volume, l’illustration no 12.
17 Voir, dans l’introduction, l’évocation de certains tableaux de Rombouts ainsi que la note 54.
18 Certes, on peut soupçonner cette dernière d’être payée aussi par le timide amant de Clarice, auquel elle sert d’« agente » selon Alcidon. Aucune réalité scénique ni verbale ne vient toutefois corroborer cette hypothèse, Philiste ne cherchant qu’à connaître le bon moment pour déclarer sa flamme alors qu’il se sait aimé ; fût-elle exacte, il ne récompenserait la nourrice qu’à proportion de sa mince fortune, qui le dissuade de demander Clarice en mariage.
19 La lettre de Madame de Sévigné étudiée par Laurent Thirouin et que nous citons dans l’introduction à ce volume révèle que la distraction au jeu était fréquente et que la force d’un joueur comme Dangeau était de faire preuve d’une extrême attention au passage des cartes.
20 Corneille n’insère pas même de didascalie pour indiquer sa sortie.
21 L’expression provient d’un jeu particulièrement simple et amusant, dont on trouvera une représentation dans ce volume, par laquelle nous concluons la première partie : elle reproduit une gravure en taille-douce de Bouzonnet et Claudine, tirée de la série Les Jeux et plaisirs de l’enfance, d’après Jacques Stella (Paris, Stella, 1657). Dans plusieurs villages du midi de la France, on voyait des enfants, surtout des petites filles, s’amuser à un jeu appelé Joch de las agullas (jeu des aiguilles ou des épingles). Les fillettes faisaient un tas de sable ou de terre dans lequel elles cachaient chacune une épingle. Lançant une pierre l’une après l’autre, elles démolissaient le tas : les épingles qui apparaissaient étaient gagnées par l’enfant qui avait jeté la pierre. S’il ne se découvrait qu’une seule épingle, la petite fille qui l’avait gagnée s’écriait alors : Bé ! jo hé trait la méouna agulla del joch (« Bon ! moi j’ai tiré mon épingle du jeu »), ce qui signifiait qu’elle ne pouvait perdre, qu’elle avait préservé sa mise de départ. La partie finissait lorsqu’il n’y avait plus d’épingles dans le tas de sable. Cette locution, déjà présente au xvie siècle, était très répandue au xviie siècle.
22 Nous suivons pour La Place Royale, l’édition procurée par Jean de Guardia dans Corneille. Théâtre complet, Paris, Classiques Garnier, 2017, vol. 2, p. 109-202.
23 On écarte les cartes « inutiles », selon le Thresor de la langue francoyse (1606) de Jean Nicot, à l’article escart ou « meschantes », selon le Dictionnaire de l’Académie française (1694), à l’article Escart.
24 Son monologue de réaction aux fiançailles d’Angélique s’étend du vers 644 au vers 707.
25 « Et si pour un ami ces effets je produis, / Lorsque j’agis pour moi, qu’est-ce que je ne puis ? »
26 L’épithète « pipeur », initialement dévolu à une technique de chasse, renvoie assurément au jeu, comme on a pu le voir dans les propos que Doris tient sur Alcidon.
27 Les Jeux et les hommes, op. cit., p. 45.
28 Voir les vers 235-244 : « Angélique me charme, elle est belle aujourd’hui, / Mais sa beauté peut-elle autant durer que lui ? / Et pour peu qu’elle dure, aucun me peut-il dire / Si je pourrai l’aimer jusqu’à ce qu’elle empire ? / Du temps qui change tout les révolutions / Ne changent-elles pas nos résolutions ? / Est-ce une humeur égale et ferme que la nôtre ? / Un âge hait-il pas souvent ce qu’aimait l’autre ? »
29 On note qu’avant l’organisation de sa fuite avec Alidor, Angélique s’était déjà livrée au hasard, comme elle l’indique à Doraste aux vers 1180-1181 : « Je fis armes de tout afin de me venger, / Tu t’offris par hasard, je t’acceptai de rage. »
30 Comme Albert Camus l’exprime dans Caligula : « Demain il y aura fléau. »
31 Nous suivons pour Cinna, la version du texte fournie dans Corneille. Œuvres complètes, t. 1, éd. G. Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 902-969.
32 Voir notre note 3.
33 On peut lire dans La Maison des jeux de Sorel (Paris, Étienne Loyson, 1665) p. 74 : « La seconde [règle est], que celuy qui fait & leve le moins de cartes, où il n’y ait as, Valets, Dames ou Roys, est payé par celuy qui en a le plus levé, d’autant d’argent qu’il y en auoit à la Poule, & c’est ce qu’on appelle payer le Talon, à celuy qui est le dernier en cartes, ou autre qui n’a rien levé. »
34 La Maison des jeux académiques, éd. citée, p. 76.
35 L’émulation dans l’aspiration à la mort se retrouvera chez Théodore et Didyme, dans Théodore.
36 La Maison des jeux académiques, éd. citée, p. 75.
37 Dans l’édition séparée que Corneille donna de Cinna en 1646.
38 François Garasse, Les Recherches des Recherches et autres Œuvres de Me. Estienne Pasquier pour la defense de nos Roys, contre les outrages, calomnies et autres impertinences dudit Autheur, Paris, Sébastien Chappelet, 1622, p. 222.
39 Il a été proclamé empereur par des soldats mutins.
40 Selon Thierry Depaulis, l’apogée du succès du jeu se situe entre 1630 et 1650.
41 Non content d’avoir fait périr l’empereur et tous ses descendants mâles, Phocas lui a ensuite ôté sa mère, l’impératrice qu’il a fait mourir parce qu’elle s’opposait au mariage de sa fille avec le fils du tyran.
42 Nous suivons pour Héraclius la version du texte fournie dans Corneille. Œuvres complètes, t. 2, éd. G. Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, p. 351-430.
43 Selon Ménestrier, ce roi symbolisait l’Empire romain, et la dynastie julio-claudienne. Nous remarquons par ailleurs que le nom de celui qui franchit le Rubicon en ne désarmant pas ses légions à son entrée dans Rome, et qui fonda par là la première dynastie impériale de Rome, conviendrait au jeu de celui qui est devenu empereur à Constantinople en se faisant acclamer par les légions.
44 Rappelons que le jeu de tarots, de soixante-dix-huit cartes, comporte, outre les vingt-deux arcanes majeurs, quatre honneurs, et non pas trois, dans chaque bande, contrairement aux autres jeux de cartes.
45 Historiettes, éd. A. Adam, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, tome I, p. 400, « Boisrobert » : « Pour divertir le Cardinal et contenter en contenter en même temps l’envie qu’il avait contre Le Cid, il le fit jouer en ridicule par les laquais les laquais et les marmitons. Entre autres choses, en cet endroit où don Diègue dit à son fils : « Rodrigue, as-tu du cœur ? », Rodrigue répondait : « Je n’ai que du carreau. »
46 « Jugez s’il n’est pas temps de montrer qui nous sommes » (v. 449). L’impatience de jouer s’exprime encore au v. 476 : « Montrons Héraclius au peuple qui l’attend. »
47 Voir les vers 241-243 : « Mais la soif de ta perte en cette conjoncture / Me fait aimer l’auteur d’une belle imposture, / Puisqu’il se dit son fils, il veut lui ressembler. »
48 Nous reprenons ici la désignation des dames par l’abbé de Marolles dans sa règle du jeu des tarots. Elle paraît bien adaptée au caractère de Léontine.
49 Elle n’accepte d’épouser celui qu’ils croient toujours fils du tyran qu’une fois Phocas éliminé.
50 Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta [Napoli, 1641], a cura di Salvatore Silvano Nigro, Torino, Einaudi, 1997.
51 C’est parmi les lames du tarot le Mat, dit également le Fou.
52 À ce stade de l’action, Léonce-Martian continue en effet de se trouver le plus mal loti car il ne dispose plus d’aucune force, Martian-Héraclius bénéficiant encore de l’affection que le tyran lui a portée ainsi que d’une certitude plus ancrée de son identité, tandis que Pulchérie a pour elle sa faculté de transmettre le sang de Maurice.
sous la direction de Liliane Picciola
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Revue Corneille présent », n° 1, 2021
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1232.
Quelques mots à propos de : Liliane Picciola
Université Paris-Nanterre
EA 1586 – CSLF / EA 3229 – CÉRÉdI
Liliane Picciola, agrégée de Lettres classiques, docteur d’État, est Professeur émérite de littérature française à l’université Paris-Nanterre. Ses recherches portent surtout sur le théâtre du xviie siècle et l’influence exercée par les comedias sur la poétique dramatique de divers auteurs français, comme dans son Corneille et la dramaturgie espagnole (G. Narr, 2002). Actuelle présidente du Mouvement Corneille, elle a publié de très nombreux articles sur cet auteur et dirige la nouvelle édition de son théâtre aux Classiques Garnier, pour lesquels elle a donné l’édition critique de La Galerie du Palais (2014), de L’Illusion comique, et du Cid (2017), de Cinna, La Mort de Pompée, Le Menteur, La Suite du Menteur (à paraître), ainsi que celle de quatre pièces de Thomas Corneille : Les Engagements du hasard, Le Feint astrologue (2015), Le Berger extravagant, et Les Illustres ennemis (2021). Elle a dirigé le volume Baroque ou bizarre ? Avatars de la bizarrerie aux xvie et xviie siècles (France, Espagne, Italie), Presses Universitaires de Paris Ouest, 2016.
