Sommaire
Corneille : un théâtre où la vie est un jeu
I. Scène théatrale et parties de jeu
sous la direction de Liliane Picciola
no 1, 2021 À la mémoire de Jean-Claude Guézennec
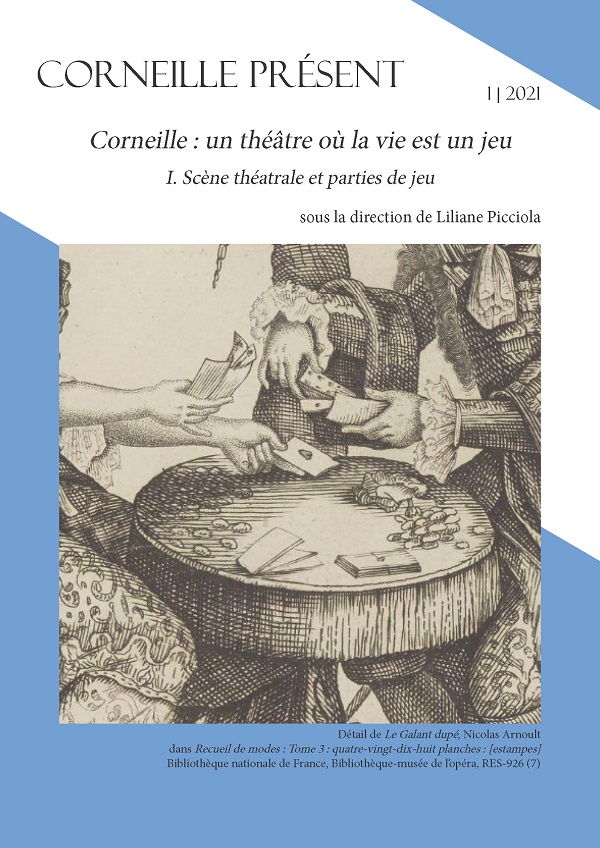
- Liliane Picciola Introduction
- Première Partie : L’intérêt d’amour pensé comme partie de jeu
- Liliane Picciola Prélude : représentation d’une partie de cartes chez les honnêtes gens
- Sandrine Berrégard Les règles du jeu dans Mélite : stratégies auctoriales et fictionnelles
- Françoise Poulet Le théâtre ou la « maison des jeux » : règles et stratégies du compliment dans quelques comédies et tragédies cornéliennes
(La Galerie du Palais, Le Menteur, La Place Royale, Rodogune, La Mort de Pompée) - Flavie Kerautret « Tout mettre au hasard ». Aléatoire et goût du risque dans Le Menteur et sa Suite
- Estampe tirée de Les Jeux et Plaisirs [Plaisris] de l’Enfance
- Deuxième partie : Corneille en figure de « preneur » : de nouvelles règles pour des jeux dramaturgiques insolites
- Liliane Picciola Prélude : l’ostentation du goût du jeu dans les paratextes cornéliens
- Tiphaine Pocquet Joueur de métier, joueur « primitif » : réflexions sur Clindor, Matamore, et la production du rire dans L’Illusion comique
- Séverine Reyrolle Le poète de L’Illusion comique « seul contre tous » : des hasards et calculs cornéliens aux jeux d’écrans dans deux mises en scènes contemporaines de la comédie
- Jörn Steigerwald Corneille maître du jeu ou la dramatologie novatrice de Rodogune
- Hendrik Schlieper Sophonisbe : alea et agôn, genre tragique et gender. Les en-jeux diversifiés de la politique et de l’amour
- Troisième partie : De la compatibilité de l’héroïsme et du jeu
- Liliane Picciola Prélude : une théorie du héros-joueur selon le jésuite Gracián
- Yasmine Loraud Jeu et héroïsme dans le théâtre sérieux cornélien : intergénéricité et complexité des caractères héroïques
- Liliane Picciola Des parties de mariage aux parties de pouvoir : lucidité féminine et choix de jeu dans deux comédies et deux tragédies cornéliennes
- Cécilia Laurin et Sélim Ammouche Faire jouer les limites du jeu : les provocations agonistiques dans la dramaturgie cornélienne
- Conclusion
- Liliane Picciola Conclusion
- Myriam Dufour-Maître Hommage à Jean-Claude Guézennec
Troisième partie : De la compatibilité de l’héroïsme et du jeu
Jeu et héroïsme dans le théâtre sérieux cornélien : intergénéricité et complexité des caractères héroïques
Yasmine Loraud
1Au xviie siècle, le terme de « jeu » désigne, si l’on s’appuie sur le Dictionnaire de l’Académie Française de 1694, une « recreation », un « passetemps », une « action gaye & folastre, par laquelle on se divertit, on se resjouit » ; le même ouvrage cite l’expression figée : « ce n’est pas jeu d’enfant », pour désigner « une chose serieuse, à laquelle il faut bien penser, dont on ne peut pas se desdire1 ». Dans l’acception qui inclut les jeux de société, le jeu suppose l’instauration d’un cadre doté de règles propres, formant une illusion de réalité plus ou moins consistante, à laquelle adhèrent les participants pour se divertir, jusqu’à ce qu’ils décident d’y mettre un terme. Parfois, cependant, l’on peut être impliqué dans un jeu sans son consentement, le divertissement des uns naissant de la tromperie d’une ou plusieurs victimes et marquant la supériorité des joueurs conscients. Le jeu, ainsi, a partie liée avec le rire, et l’absence de conséquences des actions posées, liée à l’irréalité de l’univers dans lequel il s’inscrit ; comme Florence Dupont l’a montré à propos du théâtre à Rome2, la notion est particulièrement pertinente pour rendre compte de l’art théâtral, qui suppose la conscience que les paroles prononcées et les actes accomplis sur scène n’auront aucune incidence sur le monde réel. Mais l’idée de jeu implique également celle de stratégie ; peut relever du jeu ce qui, dans un univers régi par des lois strictes, met à l’épreuve l’habileté, physique ou intellectuelle, qui donne la victoire. Le terme, dans un sens dérivé, s’emploie dans un contexte militaire, déjà à l’époque.
2Le Dictionnaire universel de Furetière donne ainsi l’expression « jeu beau », pour qualifier l’attitude d’un comédien qui « jouë bien son rolle3 ». Cependant, la logique de la tragédie, dans la conception qu’Aristote en lègue à « l’âge classique » (C. Delmas4), se différencie de celle du jeu en deux points majeurs. Le premier est l’émotion associée. Alors que le jeu est « gai », la tragédie doit provoquer la crainte et la pitié, émotions paradoxalement rendues agréables par la déréalisation propre au théâtre, certes, ce qui n’empêche pas que l’on ne rie pas devant le spectacle qu’elle propose. Le second est propre à la définition que Corneille en donne dans ses Discours, lorsqu’il revendique la nécessité d’un « péril de vie, de pertes d’États, ou de bannissement5 », pour appeler une pièce « tragédie ». De tels dangers semblent ne laisser que peu de place non seulement au ludique en soi, mais aussi à des situations et des mots susceptibles de créer une distanciation, et le sentiment que l’action n’est qu’un jeu. Ces éléments sont en effet contraires à la tension dramatique extrême impliquée par le péril, et à l’héroïsme que réclame la nécessité de s’y confronter. En revanche, l’importance de la thématique politique, dans un genre dit « miroir du prince », enseignant aux Grands leurs devoirs, principalement sous la plume de Corneille, appelle la représentation du jeu entendu comme stratégie, pouvant impliquer ou non de masquer son véritable caractère.
3Le théâtre sérieux cornélien, au sens d’ensemble des pièces n’appartenant pas au genre de la comédie au sens moderne, qui englobe les comédies héroïques, singularisées par un « grand intérêt d’État6 » sans risque d’effusion de sang, et les tragédies, présente de nombreux éléments relevant du jeu, notamment le recours à l’ironie, à la stratégie, à la feinte, et l’adoption d’un rôle autre que le sien. Nous pouvons alors nous demander de quelle manière ceux-ci participent de l’intergénéricité propre aux pièces, et quels liens ils entretiennent avec l’héroïsme que les œuvres donnent à admirer au public ; de quelle façon, en amenant ce dernier à compter les coups, comme le spectateur d’une partie de jeu, ils mettent cet héroïsme à distance. Le terme sera ici pris au sens strictement éthique de générosité, grandeur d’âme extraordinaire, par laquelle le personnage suscite l’admiration du spectateur, ébloui par sa vertu morale.
4Nous interrogerons tout d’abord l’apparente incompatibilité du motif du jeu avec le théâtre sérieux, a fortiori tragique ; ce dernier, si l’on en croit la critique, admet mal la feinte et la ruse, plutôt réservées à la comédie, procédés qui déshéroïsent aussi bien, même s’ils n’excitent pas le rire, ceux qui les emploient que leurs victimes, comme le montrent les premières pièces de Corneille. Ensuite, nous envisagerons la manière dont ses œuvres suivantes, plus conformes aux exigences ultérieures, associent déshéroïsation (risquée ou vécue par le personnage), à deux paradigmes relevant du jeu au sens large, le déploiement de l’illusion manipulatrice, et le recours à une forme particulière de feinte impliquant la dissimulation d’une intériorité dont le public est par ailleurs au courant ; le second permettant paradoxalement l’irruption d’une légèreté comique dans des interactions sérieuses. A contrario, nous verrons que le recours à des formes diverses de jeux par le héros véritable, témoigne d’une habileté caractéristique de sa vertu extraordinaire, tout en soulignant la fragilité de sa position.
Intergénéricité et conscience du non-réel dans le premier théâtre sérieux cornélien
5Les nombreuses entrées définitionnelles du mot « jeu », qui remplissent trois pages du Dictionnaire de Furetière7, montrent la polysémie du terme. L’auteur, notamment, précise que le terme « se dit figurément de plusieurs choses par relation au jeu », par exemple, « à la guerre », « l’attaque, la bataille8 ». L’analyse linguistique de l’époque témoigne donc d’analogies possibles entre des situations tout à fait sérieuses, voire mortelles, et le jeu. De fait, le terme s’emploie, de façon spécifique, pour désigner des divertissements réglés, créant des configurations particulières, auxquelles doivent répondre, chez les participants, des stratégies montrant l’excellence de leur talent. La notion oscille donc entre le sérieux d’une conduite réfléchie, et la légèreté du divertissement. Nous verrons que cette ambigüité a des conséquences sur la manière dont le genre tragique peut admettre l’insertion du jeu dans ses intrigues.
6Tout d’abord, ce dernier, comme l’ont notamment montré Georges Forestier9, et Bénédicte Louvat-Molozay10, gagne en spécificité esthétique entre les années 1630 et 1660, période dans laquelle s’inscrit une grande partie de la production sérieuse cornélienne. Tandis que, sous la plume de critiques comme l’abbé d’Aubignac, le genre mixte qu’est la tragi-comédie se voit dénier jusqu’à son existence, la pression de la régularité tend à éliminer des œuvres sérieuses tout trait qui pourrait relever de la comédie. Plus tard, cependant, les œuvres galantes de Quinault et Thomas Corneille menacent cette pureté théorique, qualifiées qu’elles sont par La Bruyère de « tissu de jolis sentiments », parsemé de « mots » « quelquefois assez plaisants pour faire rire », et dans lesquelles seule la « dernière scène » fait voir « enfin du sang répandu11 ». Face à ces dernières, les pièces de Corneille font figure de modèle d’une tension tragique constante, impliquant un risque de mort continu, au lieu de se terminer par une effusion de sang inopinée, venant causer le malheur de personnages qui n’étaient pas forcément en situation de la redouter. Des caractères héroïques viennent répondre à la violence de ces situations tragiques, dans lesquelles l’amour, et la légèreté des jeux qu’il occasionne, restent toujours au second plan.
7Dans les œuvres de jeunesse de l’auteur, néanmoins, cette pureté générique ne se retrouve pas. La première tragédie de Corneille, Médée, « flirte avec insistance avec la tragi-comédie, voire la comédie » (C. Delmas12), et l’auteur, qualifiant son « style » de « fort inégal13 », reconnaît son éloignement des modèles d’Euripide et de Sénèque quant à la tonalité d’une grande partie de sa pièce. Jason et Créüse, avant d’être les victimes de la terrible vengeance de Médée, se comportent en jeunes premiers de comédie, évoluant dans un univers ludique où aucun acte posé n’a de poids, où l’astuce suffit à se tirer de tout. L’attitude du jeune prince, qui décrit ses principes de vie à Pollux dans la première scène de la pièce, tient des « jeux désinvoltes et néanmoins intéressés de l’inconstance amoureuse déjà mis en œuvre dans les comédies antérieures de Corneille » (C. Delmas14). Jason, en effet, « accommode [s]a flamme au bien de [s]es affaires », contrairement aux « amants vulgaires15 » qui se laissent porter par leurs sentiments spontanés ; comme les jeunes premiers comiques, notamment celui de La Suivante, il cherche d’abord en ses amantes les biens et le pouvoir qu’elles peuvent lui apporter, les abandonnant au gré de ses intérêts. Plus grave encore, la relecture qu’il fait de son héroïsation passée, réduit cette dernière à l’aboutissement d’une stratégie de conquête amoureuse de la fille du roi de Colchide :
Ce peuple que la terre enfantait tout armé,
Qui de vous l’eût défait, si Jason n’eût aimé16 ?
8Par ses propos mêmes, le Jason de Corneille s’exclut de l’univers héroïque, il n’a accompli aucun exploit, et s’est contenté de « cajoler Médée », pour « gagner la Toison17 ». Cette dénégation d’un statut de héros, au profit de celui d’amant astucieux, va de pair avec un refus d’écouter les avertissements de son ami sur les périls qui le menacent ; dans une existence ludique où les femmes abandonnées sont impuissantes, rien n’est à craindre de leur « courroux inutile18 ». Un peu plus loin dans le dialogue, le personnage retrouve certes l’ethos sénéquéen de celui qui se veut avant tout un père, disant à propos de ses enfants : « Eux seuls m’ont fait résoudre, et la paix s’est conclue19. », ce qui a pu conduire Jacques Scherer à ne voir en sa « psychologie », qu’une simple « servante de l’intrigue20 ». En fait, cette imprécision même du caractère, cette absence de cohérence dans les motivations (revendiquées ou décelables par le spectateur) contribue à rejeter Jason du côté de la comédie, dans son rôle d’« inconstant21 », comme dans le jeu d’acteur qui s’y rattache. Chez Sénèque, le dialogue central mettant en présence les époux séparés est précédé d’un monologue de lamentation tragique de Jason, dans lequel il revendique son amour paternel. Au contraire, la scène 2 de l’acte III, qui précède cet entretien chez Corneille, montre le jeune homme en train de solliciter l’entremise de Nérine, pour obtenir à Créüse la robe de Médée, et se termine sur deux vers : « Mais la voici qui sort ; souffre que je l’évite : / Ma rencontre la trouble, et mon aspect l’irrite22. », qui supportent un jeu de scène dans lequel le prince s’enfuit, tandis que la voix de Médée le rappelle. Un tel échange, comique, ridiculise Jason, suggérant qu’il tente de quitter la scène avec une précipitation indigne du personnage tragique23. Une part essentielle du tragique de la pièce réside d’ailleurs dans l’impuissance de la demi-déesse Médée à « fléchir les volontés d’un homme24 », et de son irréductible attachement pour un faux héros qui se conduit en servus currens. De même, le jeu entre dans le rôle de Créüse, qui ne s’héroïse ni en amante, ni en princesse. Elle déploie pour obtenir la robe de Médée « un manège de coquetterie digne de la comédie » (C. Delmas25), piquant la jalousie de son amant en le comparant à l’objet : « J’en eus presques envie aussitôt que de vous26 », et se jouant d’Égée en justifiant ses promesses rompues par des « sophismes de haute politique » (C. Delmas27). La stratégie de l’ambitieux laisse ici la place à l’amusement de l’enfant gâté, qui croit facile et sans conséquences de s’adonner à la manipulation. Cette conduite indigne de son rang, d’ailleurs, tout autant que sa faute envers Médée, lui aliène le spectateur, comme Corneille le reconnaît lui-même.
9Ces éléments de basse stratégie ou de comportements ordinaires, voire désinvoltes, s’opposent ainsi dans Médée au sérieux de la grandeur héroïque et de la responsabilité politique qui devraient caractériser Jason et Créüse ; créant une distance entre l’action et le spectateur, ils font percevoir la tragédie comme un jeu qui va se terminer, à la manière d’une partie à plusieurs joueurs. Symptomatique d’un rapport léger à l’existence, que démentira le surgissement du tragique, il se traduit scénographiquement par de multiples jeux de scène : prompte retraite, discours manipulateurs plus ou moins habiles…, en décalage avec la gravité que demande la tragédie, et dans une certaine mesure le genre sérieux.
10De fait, la tragi-comédie, si elle accepte pleinement les conduites ludiques des serviteurs qui ont fonction de contrepoints comiques, et les pardonne volontiers à la jeunesse des premiers acteurs, peine à les admettre chez les figures royales, surtout après 1630, tandis que la régularité commence à s’imposer. Il faut savoir que « le personnage de roi est l’emploi tragique par excellence », même si l’on trouve des monarques dans les comédies, et qu’il impose un « jeu » d’acteur qui « devait se stéréotyper », caractérisé par une « attitude de hauteur outrée » (J.-Y. Vialleton28). Le rôle bannissait par nature les « actions gaies et folâtres », l’amusement désinvolte qui déshéroïse les amants coupables de la Médée cornélienne. Reste à savoir s’il exclut de même la manipulation et le discours mensonger, par lequel on se joue de l’autre, en le confrontant à une fausse réalité. Le problème se posera au sujet de Don Fernand dans Le Cid, écrit par l’auteur deux ans après Médée : le comportement du toi castillan à l’égard de Chimène scandalise le principal adversaire de Corneille, Scudéry. Le monarque, voulant deviner si la jeune fille ressent encore de l’amour pour celui qui a mis à mort son père, lui tend un piège en lui annonçant la mort du jeune homme : « Si de nos ennemis Rodrigue a le dessus, / Il est mort à nos yeux des coups qu’il a reçus29 ; […] ». Chimène, qui demande la tête du héros par devoir, surprise de ce malheur, s’évanouit. Le propos du roi est ainsi le support d’un jeu de scène spectaculaire, qui révèle la passion de la dame, contre la volonté de cette dernière. L’action n’a rien de léger, et ne vise à amuser ni les personnages, ni le public. Cela n’empêche pas Scudéry de la qualifier de « plus méchante finesse du monde30 », et d’affirmer que, le Roi se comportant comme un « enfant qui serait bien enjoué », « le Poète lui ôte sa Couronne de dessus la tête pour le coiffer d’une Marotte31 ». Pour le critique, recourir à la feinte et abuser ses sujets est un manquement invraisemblable à la dignité royale, même si cela est fait dans une noble intention. Chapelain aura beau jeu de répondre que « plusieurs grands Princes » « n’ont pas fait difficulté d’user de feintise dans leurs jugemens » « quand ils ont voulu descouvrir une verité cachée32 », et d’opposer le vrai de l’Histoire politique à cet injuste reproche, force est de constater qu’un tel jeu de scène ne rend pas Don Fernand admirable au spectateur. Pour autant, cette manière de procéder souligne avec pertinence la fragilité de la position politique d’un souverain qui avoue à Rodrigue : « Et j’ai moins de pouvoir, que tu n’as de mérite33 », ainsi que la prudence avec laquelle il gère cette dernière. S’enquérant des sentiments de Chimène, il évite toute tyrannie à l’égard de la jeune fille, tout en ménageant en Rodrigue un appui pour son trône. Ni indigne, ni ridicule, il agit en bon roi, mais le recours même à la feinte souligne à quel point la pièce ne le met pas en situation d’héroïsation.
11L’examen des figures de Créüse et de Don Fernand nous a permis de montrer en quoi le recours au jeu, au sens de manipulation d’un autre personnage par création d’une fiction de réalité plus ou moins consistante, apparaissait indigne ou du moins problématique lorsqu’il était le fait d’une figure souveraine ; et cela, même lorsque la personne royale trompe son interlocuteur pour le bien du royaume, et sans intention de s’en divertir. Dire le faux, se jouer de l’autre, fût-ce avec une prudence consommée, semble déshéroïser le prince, qui accepte ainsi de n’affirmer son pouvoir que par le biais d’une médiation. Nous verrons plus loin comment Corneille transformera cette source de risque de dégradation éthique en une arme du héros dans ses pièces ultérieures. Intéressons-nous maintenant à ce qu’il advient de la victime du jeu ; celle-ci, humiliée à des degrés divers, se voit privée de tout accès à l’héroïsme, faute de prise sur la réalité. Dans Médée, la lucidité d’Égée devant les manœuvres de Créüse n’empêche pas le roi d’Athènes de se lancer dans une expédition punitive imprudente qui le conduit directement en prison. Son monologue de la scène 4 de l’acte IV le montre se déniant à lui-même toute dignité tragique, et reconnaissant avoir voulu s’héroïser à faux à partir d’un rôle de comédie : « Un vieillard amoureux mérite plus de blâme / Qu’un monarque en prison n’est digne de pitié34. » Si Égée est ridiculisé sans être trompé par la désinvolte Créüse, à l’inverse Chimène est abusée par la ruse de Don Fernand sans exciter le rire ; elle n’en déchoit pas moins de son ethos de jeune fille noble fidèle à la mémoire de son père en montrant spectaculairement, aux yeux de toute la Cour, sa passion interdite. Quoi qu’il en soit, l’irruption du jeu dans le théâtre sérieux, au sens de manipulation de l’autre par le déploiement d’une illusion, exclut (au moins temporairement) l’héroïsme de la scène, et introduit dans le contexte tragique une brèche comique.
Jeu et déshéroïsation dans le théâtre sérieux cornélien de la maturité
12La production sérieuse de Corneille après Le Cid exclura ces situations dans lesquelles un personnage se joue trop évidemment d’un autre, fragilisant l’image de ce dernier (et la sienne), au détriment de la dignité exigée par la tragédie, qui devient rapidement le genre roi du théâtre. Le jeu subsiste cependant sous deux formes : le déploiement d’une stratégie, et l’endossement possible d’un rôle, par lequel le personnage masque ses vraies intentions.
13Dans Médée, le rapport de Jason à l’existence était celui d’un jeu stratégique dans lequel des réussites successives en matière de séduction devaient lui assurer gloire et bonheur ; le tragique faisait irruption dans le plan de ce joueur très audacieux. La désinvolture disparaît des tragédies ultérieures, celle-ci étant peu conforme à l’image qui doit être donnée des personnages. Cependant l’action tragique ne s’opère pas forcément (et uniquement) dans l’immédiateté de l’élan passionnel. Celui-ci clôt souvent l’œuvre, notamment dans le cas d’un dénouement sanglant, mais les « acheminements35 » qui y mènent peuvent accueillir des stratégies, des plans concertés ; genre politique, la tragédie met sur scène les manœuvres qui assurent le pouvoir des Grands. La Rodogune de Corneille est une pièce emblématique de cette association entre passion furieuse, et « jeu stratégique » (Th. Pavel36) dans lequel Cléopâtre essaie de se maintenir sur le trône, en éliminant l’héroïne éponyme, sa rivale. La structure du jeu s’impose à l’action, car les deux femmes ne peuvent agir directement l’une contre l’autre, et sont obligées de solliciter l’appui des héritiers du trône, Antiochus et Séleucus, pour s’affronter. Les deux ennemies sont ainsi, comme l’explique Thomas Pavel, comparables aux « rois des jeux d’échecs », qui ne peuvent directement mener d’offensive l’un contre l’autre ; mais elles substituent à la passivité des pièces figurant les souverains l’habileté des joueurs virtuoses, tentant de mettre à profit les règles qui leur sont imposées pour gagner la partie. En résulte une complexification de l’âgon, Rodogune et Cléopâtre ne s’affrontant jamais directement (aucune grande scène ne les oppose l’une à l’autre en les laissant seules en scène), mais essayant chacune de vaincre l’autre par l’intervention des deux princes. Des partenariats pourraient alors se nouer, solidarisant chaque homme à l’une des femmes, dans une configuration de deux contre deux rappelant celle du jeu de paume ; ce ne sera pas le cas, les deux frères refusant l’âgon, et créant ainsi une « situation bloquée ».
14Le parallélisme n’est pas total, cependant. Le début de la pièce montre Cléopâtre mettre en place les conditions de l’affrontement, tandis que Rodogune s’y refuse. La jeune femme, avouant à Laonice : « J’oublie, et pleinement, toute mon aventure37 : […] », fait sans effort oblation de toute idée de vengeance pour les offenses qu’elle a subies. Mais en même temps, elle redoute avec raison la fatalité de la mise en place d’un jeu d’affrontement. Ce dernier sera en effet instauré par Cléopâtre, dans une scène de manipulation de ses deux fils axée non sur le mensonge direct, mais sur une tentative de reconstruction intellectuelle du passé les excitant à la vengeance contre Rodogune. Dans cette pièce implexe, les événements antérieurs pèsent sur l’action, et peuvent aisément faire l’objet d’une réinterprétation biaisée lorsqu’ils sont racontés à ceux qui ont été tenus à l’écart. L’impitoyable Cléopâtre, obsédée par le pouvoir et son statut de reine, se présente, dans son discours à ses fils ouvrant la scène 3 de l’acte II, comme une mère héroïque prête à tout pour garder le trône à ses légitimes héritiers : « mon amour pour vous fit tout ce que je fis38 […] ». Le mensonge cependant, porte sur les motivations de la reine, et non sur les événements eux-mêmes ; elle avoue son remariage et le meurtre de son mari. Elle attribue cependant ce crime à l’influence pernicieuse de Rodogune : « Et dans cette embuscade, où son effort fut vain, / Rodogune, mes fils, le tua par ma main39. », alors même qu’on sait, par Laonice, que le mariage de Nicanor avec la princesse parthe n’était qu’un accord politique. Pour autant, contrairement à l’attente du public, elle n’exige pas de ses deux fils de tirer collectivement vengeance de la jeune femme, mais veut les impliquer dans une sorte de jeu pervers, où l’aptitude au crime qualifie un gagnant dont le trône est le prix. Ce défi exerce une pression déshéroïsante sur les jeunes gens qui prouvent leur vertu en le refusant. Mais il est tout aussi corrupteur pour la principale menacée, Rodogune, qui va mettre en place une contre-stratégie. Celle-ci est expliquée par Corneille. La « proposition » « indigne d’une personne vertueuse40 », qu’elle fait aux deux princes de venger leur père en tuant leur mère pour gagner son amour, ne serait pas l’instauration d’une épreuve où le crime permet d’obtenir la femme aimée, mais un essai de renforcement de la « situation bloquée » (G. Forestier41), les vertueux refusant solidairement d’agir face au désir criminel de la reine, et triomphant d’elle par ce refus collectif du jeu. La Rodogune mise en scène, cependant, ne présente pas une si constante pureté d’intention. Même si elle n’invoque devant les frères que son devoir mémoriel envers le roi tué, et qu’elle reconnaît devant Antiochus qui offre de lui sacrifier sa vie, que la vengeance qu’elle évoque ne peut s’accomplir vertueusement : « Votre refus est juste, autant que ma demande42, […] », elle sent se réveiller en elle ses « sentiments étouffés de colère, et de haine43 », lorsqu’elle apprend la mise en place du jeu dont son meurtre est l’épreuve. La stratégie de Cléopâtre entraîne ainsi la déshéroïsation de son ennemie, tentée par le crime. Il complique de même l’héroïsation des jeunes gens.
15Séleucus se caractérise par un refus radical du jeu politique, auquel il tente de rallier Antiochus : « Dérobons-nous, mon frère, à ces âmes cruelles, / Et laissons-les sans nous achever leurs querelles44. » On donne ici le même sens à l’expression que Roger Caillois lorsqu’il écrit : « En politique, dans l’intervalle des coups de force (où on ne joue plus le jeu), existe de même une règle d’alternance qui porte tour à tour au pouvoir et dans les mêmes conditions les partis opposés. » De fait, Séleucus ne rejette pas seulement ici le recours à la violence, mais toute confrontation au problème politique que pose une succession dynastique troublée. Ce faisant, il n’accomplit pas son devoir de prince, et montre par son choix au public qu’il n’est pas le vrai roi. Au niveau de la progression de l’action, cependant, son attitude d’évitement supprime tout péril d’affrontement tragique entre les frères, et assure le pouvoir légitime d’Antiochus, à la manière de la pratique de l’abandon au jeu d’échecs, par laquelle l’acceptation de la défaite par un camp entraîne naturellement la victoire de l’autre. Antiochus, lui, témoigne de sa dignité royale par son effort pour ramener sa mère à la vertu, tout en y maintenant sa fiancée. Il perd cependant sa constance devant la coupe empoisonnée par sa mère, que seule Rodogune le décourage de boire.
16Un « jeu rituel » (Th. Pavel45) est instauré par la reine pour asseoir son pouvoir. De fait, Cléopâtre ne déclenche pas d’hostilités désordonnées, mais mène « un jeu de terreur », « avec pompe et rigueur » (Th. Pavel) ; malgré sa passion haineuse, une certaine rationalité préside à ses actions, et, sans nul désordre, l’étau tragique enserre les jeunes premiers. Il limite leurs possibilités d’héroïsation ; leur lucidité ne les protège des tentations ni du crime, ni de la faiblesse, et ils ne sauvent leur gloire que l’un par l’autre. Cependant, le jeu politique n’est pas qu’un piège tendu à son adversaire dans le cadre d’une stratégie, il est également rôle endossé, adoption d’un paraître pour conforter une position politique. Déjà, la maladroite tentative de manipulation de Créüse à l’égard d’Égée, dans la Médée, impliquait le jeu d’un rôle de princesse toute à ses devoirs politiques : « L’amour de mon pays et le bien de l’État / Me défendaient l’hymen d’un si grand potentat46 », et d’une fille seul soutien d’un « père un peu sur l’âge47 ». La jeune femme, toute à une passion coupable qui lui coûtera la vie, et dans laquelle son père a le tort de l’encourager, n’adhère cependant pas au discours que lui suggère son « adresse », pour satisfaire son « inclination48 ». D’ailleurs, son prétendant délaissé n’y croit pas une seconde, et tente de tirer d’elle une aussi prompte vengeance que si elle l’avait insulté.
17La situation est plus complexe pour ce qui est de certains personnages des comédies héroïques de Corneille, Tite et Bérénice et Pulchérie, qui ont de commun avec Médée d’admettre une certaine mixité de ton, associée cette fois à un heureux dénouement. Ce genre nouveau, dont Corneille se veut l’inventeur, laisse une place importante aux jeux de pouvoir qui entourent le mariage d’un souverain ; sans péril de mort (tout au moins dans le temps immédiat de l’action), les pièces opposent les exigences de l’amour à celles de la politique. Dans les deux précédemment cités, les prétendants sincèrement épris du souverain se voient opposer des rivaux dont le caractère se laisse analyser sous le prisme d’un faux héroïsme. Domitie, dans Tite et Bérénice, comme Aspar, dans Pulchérie, masquent les entreprises que leur dicte leur excessive ambition sous le voile d’un devoir envers eux-mêmes. Il ne s’agit pas cependant d’une hypocrisie totale, ces personnages arrivant à se convaincre eux-mêmes que ce serait un affreux déshonneur pour eux d’être écartés du rang suprême ; le public, tout en n’adhérant pas au discours des personnages, est invité à croire à une relative sincérité de leur attitude. Sa cohérence fait l’objet d’une construction minutieuse tout au long de la pièce, qui s’appuie sur les habitudes de spectateur de l’auditoire. De fait, dans la tragédie régulière du xviie siècle, notamment sous la plume de Corneille, l’héroïsme tend à prendre la forme non de la vertu extraordinaire caractéristique des genres nobles, mais de la fidélité d’un personnage aux devoirs de son rang dans une situation de crise, au prix du sacrifice de leur vie ou de leurs passions. Or, Domitie et dans une moindre mesure Aspar, ont des rangs ambigus. La première décrit son illustre origine à sa confidente par cette formulation ambivalente : « En naissant, je trouvai l’Empire en ma famille49, […] », qui suggère la vraisemblance de son droit à régner sans pour autant l’établir. Le paradoxe est que ce « droit imaginaire50 » est susceptible de créer pour Tite un danger politique réel, d’autant que Domitie appuie sa revendication illégitime d’un vrai courage, forçant l’empereur à « l’aimer » ou « l’immoler51 ». Les Romains, sans la reconnaître héritière du trône, la souhaitent en outre comme impératrice. De même, Aspar, dans Pulchérie, identifie sa « gloire52 », qu’il affirme devant Irène, et le « besoin de l’État53 », qu’il invoque à Pulchérie, à l’ambition intéressée qui le pousse à vouloir accéder au trône en en écartant Léon. Vaillant général, il est un candidat crédible au rang d’empereur, un peu plus que le jeune homme, mais moins que d’autres ; rien ne l’autorise à exiger le trône.
18Si Antiochus et Rodogune s’héroïsent ensemble en refusant les rôles criminels que l’adhésion au jeu de Cléopâtre, ou l’organisation d’un jeu contraire, leur imposeraient, les antagonistes des comédies héroïques cornéliennes défendent leurs projets ambitieux en endossant des rôles héroïques, dans lesquels ils identifient leur accès au pouvoir à un illusoire devoir. Leur fausseté, cependant, est percée à jour assez facilement par les autres personnages, conduisant à leur humiliation, voire à leur ridiculisation. Se voulant guinder au-dessus de leur rang réel, ils sont rejetés dans l’univers de la comédie. Domitie se voit ainsi raillée par Domitian qui l’aime, lorsqu’elle lui demande, justement au nom de son amour, de faciliter son mariage avec l’empereur. Il lui reproche de ne pas s’appliquer à elle-même l’exigence d’amour désintéressé qu’elle fait peser sur lui, puisqu’elle ne nourrit pas pour Tite une « stérile ardeur qui s’attache au mérite54 », mais ambitionne bien de l’épouser pour accéder au trône. De même, il perce à jour la fausseté de ses revendications patriotiques : « Ah, que le nom de Rome est un nom précieux / Alors qu’en la servant on se sert encor mieux55 […] ». Si la jeune femme obtient le dernier mot de l’entretien, sa dernière réplique manifeste une « jalousie56 » (soulignée par Domitian à la scène suivante), qui témoigne de la fragilité de sa position ; subissant la tyrannie contradictoire de son ancien amour pour son interlocuteur, et de son ambition politique, Domitie perd le contrôle d’elle-même. Face à Tite, la fière réplique par laquelle elle clôt l’entretien : « Mais en m’ôtant l’honneur, n’épargnez pas ma vie57 », masque mal l’entière dépendance de son sort au choix de l’empereur. Contrairement à Bérénice, que son noble refus rend maîtresse de son destin, Domitie peut se voir ôter l’honneur, et, si elle accède au trône au dénouement, son absence de la scène la réduit au rang d’objet des décisions des autres. Figure plus dégradée encore, Aspar se voit infliger un camouflet par Pulchérie, qui ne nomme l’époux que les manœuvres de son interlocuteur l’ont contrainte à choisir, qu’après un long éloge de celui-ci :
Léon vous faisait peine, et j’ai dompté l’amour
Pour vous donner un maître admiré dans la cour,
Adoré dans l’armée, et que de cet Empire
Les plus fermes soutiens feraient gloire d’élire.
C’est Martian58.
19Aspar, surpris par cette révélation, est ridiculisé aux yeux du public : son plan est déjoué. De fait, il aura, tout au long de l’action, cru et fait croire avoir en main un jeu prometteur, alors que ses cartes étaient médiocres. Il n’avait aucun des atouts nécessaires pour se rendre empereur, n’ayant ni le cœur de l’impératrice, ni un parti puissant à ses côtés ; toute son action n’a abouti qu’à empêcher Léon de l’être, en orientant le choix de Pulchérie vers un candidat indiscutable. Celle-ci souligne cruellement la vertu politique du mari qu’elle s’est choisi, en comparaison avec l’ambitieux qu’elle nargue, ennemi dont elle ne fera, au dénouement, qu’un pur objet de la « faveur incertaine » d’une souveraine, qui s’affirme face à lui à même de « régler son destin59 ». Ainsi donc, le jeu d’un faux rôle héroïque semble écarter, dans les comédies héroïques de Corneille, de l’accès à un héroïsme véritable, et ravaler le personnage à n’être que l’objet des décisions des vrais héros. Si la ridiculisation plus ou moins accentuée, ainsi que l’entière dépendance aux décisions des autres, vient attester de l’infériorité éthique des faux héros, le mérite au contraire des véritables généreux s’atteste dans leur évitement d’un rôle ridicule, en ce qu’il correspond à une topique comique. Ce rôle, dans le jeu stratégique qui ordonne l’action de la pièce, correspond à une position de faiblesse structurelle, qui le prive de toute possibilité de gagner. Désirant alors éviter le statut honteux de perdant, le personnage refuse ostensiblement de jouer ; il passe son tour, voire feint de dédaigner la mise. Ainsi, l’Éryxe de Sophonisbe est soucieuse de se conduire en reine, en évitant d’endosser le rôle comique de l’amante délaissée et possessive à l’égard de qui ne l’aime plus. Citant la maxime : « Une femme jalouse à cent mépris s’expose60, […] », elle met à distance la posture de récrimination ridicule que le public s’attendrait à lui voir adopter et, en ne disputant pas Massinisse à la Carthaginoise, sauve ainsi la dignité convenable à son rang. De même, dans Pulchérie, Martian souhaite à tout prix éviter le rôle topiquement comique de vieillard amoureux, dans lequel sa passion pour la jeune femme pourrait le faire aisément glisser ; c’est le seul des principaux personnages à ne pas prétendre à la main de l’impératrice. Là encore, une maxime (« L’amour en mes pareils n’est jamais excusable61, […] ») sert au personnage à mettre à distance un type de comportement qu’il refuse, affirmant par là sa nature de héros véritable, digne à la fois du trône et de celle qu’il aime.
Dissimulation ou tricherie : la feinte, un moyen de remporter la mise digne d’un héros ?
20Qu’il s’agisse de l’implication, volontaire ou non, dans un jeu stratégique, ou bien de l’endossement d’un rôle permettant de cacher ses intentions véritables (les deux pouvant être couplés), le jeu est généralement associé, dans l’œuvre sérieuse de Corneille, à la déshéroïsation, sous la forme d’une ridiculisation ou tout au moins d’une dépréciation de l’image du personnage qui y participe. Il arrive cependant que le recours à la feinte, permettant de gagner malgré de mauvaises cartes initiales, devienne un moyen d’action du héros, au service de l’affermissement de sa position politique. Plus paradoxalement, il peut servir de chemin vers l’héroïsme à un personnage peu admirable au début de la pièce.
21À travers les personnages d’Éryxe et de Martian, nous avions vu que l’héroïsme d’un personnage de généreux, susceptible de lui attirer l’admiration du public, pouvait s’affirmer par la mise à distance du rôle ridicule (tenant des topiques comiques), dans lequel la situation le force : la femme jalouse, le vieillard amoureux… Cette mise à distance suppose toutefois de masquer ses sentiments spontanés (du moins une partie d’entre eux), donc de jouer en partie un rôle. De manière plus radicale, dans la tragédie d’Agésilas, atypique, par sa légèreté de ton, son hétérométrie, et l’importance de la thématique amoureuse par rapport aux enjeux politiques, la figure d’Aglatide manifeste son héroïsme par l’adoption d’un rôle originairement comique, celui de la belle indifférente, à l’exemple de la Phyllis de La Place Royale qu’Emmanuel Minel qualifie de « reine de comédie62 ». De la partie qui se joue, où chaque dame cherche à obtenir l’époux que son cœur a choisi, elle refuse le gain implicitement proposé, et donc les règles, revendiquant ne chercher dans le mariage que l’accès au trône. De fait, le statut actantiel d’Aglatide est, au début de la pièce, le plus ravalé qui soit, puisque c’est le seul personnage féminin qui aime sans être aimé. Si, d’après le « modèle héroïque » de Philippe Sellier, la « séduction63 » singularise la figure héroïque, elle ne peut en être une. Pourtant, le dénouement, à travers la solennité de la parole royale dans les deux dernières répliques d’Agésilas, consacre son triomphe amoureux et politique. En particulier, la construction en parallélisme de ces deux vers : « Sachez que Sparte voit sa Reine en Aglatide, / À qui le Ciel en moi rend son premier Amant64 » lui attribue ces deux caractéristiques héroïques que sont la séduction et la souveraineté. Entre les deux, Aglatide aura su retourner sa situation, et transformer son image aux yeux du spectateur, qui la voit d’autant plus digne d’un trône dans la patrie des héros par excellence, qu’elle a affirmé son ethos de reine héroïque.
22Or, cette affirmation ne s’est pas faite par des discours solennels de constance stoïcienne, mais au contraire par le biais du jeu. La configuration du début de l’action se rapproche en effet du jeu de hère, défini par Furetière comme un « jeu de cartes, où on ne donne qu’une carte à chaque personne. On la peut changer contre son voisin ; & celuy à qui la plus basse carte demeure perd le coup65. » Elpinice et Aglatide reçoivent en Cotys et Spitridate une distribution de maris, tandis que l’amour d’Agésilas pour Mandane en fait un époux pressenti pour cette dernière. Pourvu du seul amant non royal, Aglatide va tenter de manipuler sa sœur aînée, puis la Persane, pour que chacune lui cède le souverain dont elle ne veut pas. Cependant, elle n’a pas tous les atouts de son côté pour remporter sa partie, et « l’obéissance66 » galante qui asservit les deux souverains à la Persane, ne va pas jusqu’à les porter à épouser sa rivale. Dans une position extrêmement fragilisée, Aglatide, pour préserver son image en péril et en fin de compte ses intérêts, va recourir à une forme de bluff : au milieu des passions contrariées qui font manifestement souffrir tous les autres, elle adopte un rôle d’insensible, qui ne s’intéresse qu’à sa gloire et à son ambition politique.
23Celui-ci, d’abord souligné par son père Lysander : « Aglatide est d’humeur à rire de sa perte, / Son esprit enjoué ne s’ébranle de rien67 ; […] », est ensuite critiqué par l’amante passionnée Mandane, qui lui reproche « […] la froide galanterie / D’affecter par bravade à tourner son malheur / En importune raillerie68 ». La jeune femme explique elle-même sa conduite à sa sœur en lui confiant ses maximes de vie : « La joie est bonne à mille choses / Mais le chagrin n’est bon à rien69 ». Ce faisant, elle évite un rôle topique, auquel devrait la forcer sa situation, celui de l’amante délaissée de la tragédie élégiaque, dont elle moque les excès tout en marquant sa singularité :
J’en connais plus de vingt qui mourraient en ma place,
Ou qui sauraient du moins hautement quereller
L’injustice de la Fortune ;
Mais pour moi qui n’ai pas une âme si commune70, […]
24Il faut attribuer à ces propos une valeur métapoétique ; en situation d’abandon amoureux, Aglatide refuse le suicide tragique ou la lamentation pathétique. Son « inépuisable enjouement71 » est une manifestation d’héroïsme en mode mineur ; se jouer de tout, c’est montrer galamment la supériorité de sa force d’âme sur le sort, et défier en quelque manière ce dernier. Comme d’autres héros cornéliens, la jeune femme se refuse à éveiller la pitié, pour mieux s’attirer sinon l’admiration, du moins l’estime du spectateur. Ce dernier est incité à faire d’autant plus cas du personnage, et de sa maîtrise de lui, que les commentaires de son entourage, notamment de la lucide Mandane : « Son cœur l’en désavoue, et murmurant tout bas72… » laissent supposer une passion aussi sincère que dissimulée pour le roi de Sparte. Ce n’est d’ailleurs que confrontée à celui-ci que la jeune femme s’exprime enfin avec sérieux, d’abord pour écarter en une sentence lapidaire le discours de reproches qui devrait être attendu d’elle : « L’amour doit être libre, et vous êtes mon Roi73 », pour mieux affirmer à son ancien amant les honneurs qu’il lui doit : « Mais puisque jusqu’à vous vous m’avez fait prétendre, / N’obligez point, Seigneur, cet espoir à descendre74, […] ». La réaction du roi est toute d’admiration. Le dénouement heureux oppose l’amour héroïque qui l’unit à la jeune Spartiate, à la virtualité d’amour tragique (non réciproque, et susceptible d’amener le trouble dans l’État), qui l’attachait à Mandane et aurait pu achever l’action sur un irrémissible conflit entre Lysander et lui, prélude à la guerre civile.
25Feindre l’indifférence, cependant, ne sert qu’à masquer les fragilités de la position d’Aglatide, sans participer d’une stratégie qui vise sciemment à tromper la partie adverse. Le cas n’est pas le même lorsqu’un personnage cherche à défendre sa position en faisant croire qu’il est un autre et en se jouant ainsi de son interlocuteur et de son déficit de savoir ; dans ce cas, l’habileté stratégique s’apparente à la tricherie, et peut pourtant être le fait d’un héros véritable. La générosité n’adopte ainsi pas toujours le modèle de l’affirmation directe de soi, mais peut s’accorder avec certaines modalités de la feinte, notamment celle consistant à dissimuler que l’on est partie prenante du jeu. Nicomède en est un exemple. Dans son Examen, Corneille en décrit l’action en dépeignant une psychomachie dans laquelle la « grandeur de courage » serait combattue par la « politique75 ». Le personnage éponyme, allégorie de cette « grandeur de courage », sur le mode épique, oppose aux pièges qui lui sont tendus non seulement sa vaillance, mais également son habileté. Le début de l’action présente une structure similaire à celle du jeu des tarots, dans lequel, au cours d’une donne, l’un des joueurs (le Preneur), est opposé à tous les autres qui forment une équipe (les Défenseurs).
26Ici, Nicomède est opposé, dès le début de l’action, à l’ensemble des autres figures de pouvoir, Prusias, Arsinoé (par l’influence qu’elle a sur son mari), Flaminius, représentants de la « Politique ». Son retour à la Cour pour revendiquer Laodice est un défi qu’il leur lance, affirmant sa volonté de succéder à son père en souverain indépendant, héritant de la totalité du royaume, et s’alliant à une reine. La jeune femme et Attale, eux, sont sans pouvoir réel ; ils sont les enjeux de l’affrontement des autres. Cela dit, cet affrontement s’opérant indirectement, au commencement du moins, Laodice et Attale peuvent y « tenir le jeu76 » respectivement de Nicomède, et de Prusias et Flaminius. C’est le cas dans la scène 2 de l’acte I, dans laquelle chacun revendique la puissance de ses alliés pour refuser ou réclamer le mariage qui pourrait l’unir à l’autre. Présent sur scène aux côtés de sa fiancée, Nicomède pourrait défier directement son frère, et à travers lui le camp qu’il représente ; ce n’est pas ce qu’il fait. Profitant du fait qu’Attale, ayant été élevé à Rome, ne le connaît pas, il ne révèle pas tout de suite qui il est. Parlant de lui à la troisième personne, il se fait passer pour un membre de la suite de Laodice, qui se permettrait de donner une leçon au prétendant non souhaité. Ce dernier s’en indigne, et signale l’inconvenance de la situation à la reine d’Arménie : « Si cet homme est à vous, imposez-lui silence, / Madame, et retenez une telle insolence77. » Pour bien comprendre l’effet de cette ruse sur le public, il faut se rappeler que dans le théâtre sérieux de l’époque, les personnages principaux, censés être de haut rang, ne paraissent sur le théâtre qu’accompagnés d’une suite de personnages subordonnés, censés ne pas parler78. Le spectateur sait, lorsque Nicomède cache son identité, que c’est bien son aîné qui s’adresse à Attale ; mais ce dernier, qui l’ignore, souligne avec vraisemblance cette rupture de la bienséance théâtrale. Le fait qu’il s’adresse à Laodice, et non à l’inconnu qui lui fait la leçon, montre bien qu’il ne l’accepte pas. Du point de vue de Nicomède, ce jeu de rôle entre dans une stratégie dans laquelle il commence par menacer effectivement son frère sans hasarder une confrontation ; le détour imagé par la métaphore du siège : « La place à l’emporter coûterait bien des têtes, / Seigneur, ce conquérant garde bien ses conquêtes79, […] » pour évoquer le cœur de Laodice, n’empêche pas une réponse directe et brutale au défi lancé par Attale. Tout le dialogue vise une déstabilisation du jeune homme ignorant des manœuvres de cour, qui culmine dans la réplique par laquelle Nicomède ouvre la scène suivante, en s’adressant à sa belle-mère :
Instruisez mieux le Prince votre fils,
Madame, et dites-lui, de grâce, qui je suis.
Faute de me connaître, il s’emporte, il s’égare,
Et ce désordre est mal dans une âme si rare80, […]
27L’ironie est cinglante, puisqu’il retourne contre son frère le reproche de « désordre », que ce dernier lui adressait, et fait rejaillir sur Arsinoé le manque d’éducation de son fils. Le héros ne cherche cependant pas qu’à humilier son frère, mais veut également lui faire sentir l’incohérence des codes de comportement selon lesquels il se conduit. La quasi tricherie de Nicomède est bénéfique, il se sert d’un mensonge par omission pour dévoiler une vérité. De fait, si Attale se considère comme prince, il doit respecter l’engagement entre Laodice et son aîné. S’il se pense un citoyen romain, il lui faut alors trouver une épouse à Rome ; la formule ironique : « Aux Rois qu’elle méprise abandonnez les Reines81, […] », cherche à faire sentir à Attale que Rome qui lui a accordé la dignité de citoyen, ne le considère pas vraiment comme tel, puisqu’elle ne lui applique pas les mêmes exigences qu’aux autres. La suite de l’action va permettre à Attale de se rendre compte de cette réalité déplaisante, et d’opposer aux manœuvres de Rome son propre jeu stratégique en délivrant son frère pour permettre le dénouement heureux. Converti à la générosité par Nicomède, Attale devient un héros de la « Politique », capable d’affranchir son pays quand la « Grandeur de courage » ne suffit plus.
28La feinte consistant à se poser comme indifférent à la mise, voire extérieur au jeu, peut être une arme du héros pour défendre sa position dans un jeu stratégique (ne serait-ce qu’en préservant son image). Cette technique permet à Nicomède de mettre Rome en échec, en se ralliant son frère, et à Aglatide de regagner le cœur d’Agésilas et d’accéder au trône de Sparte. Plus paradoxalement, une tricherie caractérisée peut contribuer à l’accès à l’héroïsme d’un personnage dont la conduite et/ou les intentions sont contestables au début de la pièce. Alors même qu’il feint une attitude vertueuse pour mieux faire tomber son ennemi dans un piège (méthode fort éloignée de celles d’un héros, et qui ne peut être subsumée sous une conception même très étendue de l’habileté), il crée les conditions de sa transformation progressive en véritable généreux. Le cas est rare dans les œuvres de Corneille, et les figures concernées suscitent plus l’attachement que l’admiration sans failles du spectateur.
29Dans Cinna, le phénomène concourt à l’atmosphère providentielle de la pièce. Le personnage éponyme, alors qu’il voudrait mettre à mort Auguste pour satisfaire la vengeance d’Émilie, et rétablir la République à Rome, se retrouve, au début de l’action, à convaincre l’empereur qui hésite à abdiquer, de conserver le pouvoir ; le conjuré espère ainsi justifier la mise à mort de son ennemi. Pour maintenir les conditions de ce qu’il croit être une héroïsation incontestable, Cinna va élaborer une stratégie perverse : faire croire à Auguste qu’il est indispensable à l’État pour mieux le mettre à mort comme tyran. Il s’agit de maintenir à tout prix l’empereur dans le jeu politique pour mieux lui infliger une défaite sanglante ; moralement contestable, la feinte fait du personnage un tricheur.
30En même temps cependant, aux yeux du spectateur érudit, elle l’assimile à Mécène, ancien conseiller du souverain qui l’avait convaincu de garder le pouvoir après sa victoire contre Antoine, au lieu de le rendre au Sénat ; le discours d’éloge et de défense du régime monarchique que Cinna prononce emprunte en effet ses arguments à celui de son vertueux prédécesseur. Corneille, par là, « brouille […] les frontières entre Cinna et Mécène82 ». Le traître doute progressivement de la pertinence de son comportement, et reconnaît comme véritable le discours qu’il tenait par stratégie politique. De plus, il agit (contre son intention) pour le bien de Rome en permettant le maintien d’Auguste au pouvoir. Ses intentions coupables sont ainsi contrebalancées, au début de la pièce, par une action vertueuse (répétant une précédente action semblable), aux yeux du public d’Ancien Régime. Par ailleurs, l’argumentation déployée par Cinna, semble agir sur l’esprit de celui qui la prononce sans y croire : la « superposition des deux figures prépare […] la conversion de Cinna83 ». À la fin de l’œuvre, le jeune opposant, bénéficiaire de la grâce d’Auguste et élevé au rang de consul, devient le héros serviteur du trône qu’il était au début de l’œuvre par son discours ; pour autant, la figure admirable, qui pose l’acte héroïque central de la pièce, est bien l’empereur, et non le jeune premier. C’est Auguste qui, jouant contre les règles de la politique, réalise un triomphe inattendu et transforme le tricheur Cinna en allié vertueux.
31Le problème se pose différemment dans Othon, tragédie de l’impossible héroïsation conjuguée à une réussite politique indéniable. Tout le pathétique de l’œuvre consiste dans la « stratégie de la théâtralité » qu’est obligé d’adopter le héros pour survivre face à « la Cour84 », entité malfaisante qui empêche toute extériorisation de son héroïsme intérieur. Celle-ci le contraint à feindre l’amour, auprès de Plautine, puis de Camille, sa position dans le jeu politique n’étant tenable qu’avec une alliée. L’effet en est cependant bien différent la première et la seconde fois. L’« adroite et prompte servitude85 » qui l’avait poussé, dans le passé fictionnel, à faire la cour à la fille de Vinius, lui ouvre la voie, dans le présent apparemment désespéré de l’action, à une héroïsation galante à défaut d’héroïsation politique. De fait, alors qu’il croit ses ennemis vainqueurs, Othon, refusant tout jeu, conserve pour seule valeur l’amour qui l’unit à Plautine, y cherchant les « douceurs de mourir en Amant véritable86 ». Au contraire, son attitude auprès de Camille est trouble. Le jeune homme mène un jeu qu’il se refuse à assumer, et qui paraît à la suivante de Plautine trop parfait pour être crédible, celle-ci soulignant « un effort de mémoire, / Qu’il était plus aisé d’admirer que de croire87 ». Réticent à tromper, tricheur malgré lui, Othon aide pourtant la princesse à s’illusionner, et ne réparera qu’imparfaitement sa faute au dénouement en lui « jur[ant] » « une amitié fidèle au défaut de l’amour88 ». Figure imparfaite de l’Histoire, Othon était particulièrement difficile à ériger en héros de tragédie à la fois vraisemblable (fidèle à ce que l’on sait du vrai personnage), et bienséant (répondant aux attentes éthiques du public89). Corneille y parvient en mettant en scène avec finesse le rapport complexe du personnage au jeu stratégique et théâtral qui permet de survivre à la Cour, fait de virtuosité dans sa pratique et de réticence à s’y livrer, jusqu’à la victoire finale qui le rend inutile, mais conduit au remplacement du discours triomphal attendu, en une tirade de réconciliation et d’apaisement. Othon, pourtant vertueux, ne pourra être empereur à la manière d’Auguste.
32Fortement associé au ludique, le thème du « jeu » semble s’opposer, dans sa définition même, à la nature du genre sérieux, dont la tragédie constitue la forme la plus élevée dans la classification du temps. Cependant, l’idée d’une stricte distinction entre registres grave et comique, si elle s’esquisse avec le renouveau du théâtre à l’antique à la Renaissance, ne s’impose pas encore totalement à la production littéraire lorsque Corneille débute sa carrière de dramaturge. Non seulement dans Le Cid, d’abord conçu comme une tragi-comédie, mais également dans Médée, tragédie imitée de Sénèque, le jeu a toute sa place. Le terme peut englober le rapport stratégique à l’existence de certains personnages, ou les pièges qu’ils se tendent les uns aux autres, mais également des attitudes d’amusement désinvolte qui ne se retrouveront plus par la suite, et qui font une grande partie du tragique de Médée par exemple, Jason et Créüse ne mesurant pas le danger qui pèse sur eux. La querelle du Cid questionne l’acceptabilité de ce type de procédés, et le personnage de Don Fernand se trouve vertement critiqué par Scudéry pour sa manière de se jouer de Chimène. Dans ces premières expérimentations cornéliennes, jeu et héroïsme apparaissent assez antinomiques ; le personnage qui joue déroge aux exigences de grandeur que les bienséances attachent à son rang, et celui dont on se joue apparaît également déshéroïsé. Dans la production cornélienne ultérieure, même si la part du ludique est singulièrement réduite, la déshéroïsation continue de s’attacher à l’idée de jeu. Le jeu stratégique de l’antagoniste tyrannique vise à priver de leur vie, de leur pouvoir et de leur gloire les personnages positifs, et l’épreuve héroïque consiste pour eux à échapper aux conséquences délétères de celui-ci. De même, la parade des ambitieux qui se déguisent en héros d’État, pour s’imposer dans le jeu politique, déprécie leur image aux yeux du public et aboutit parfois à leur ridiculisation. Cependant, notamment sous la pression des stratégies de leurs ennemis, d’indubitables héros peuvent développer des contre-jeux ; Nicomède fait ainsi échec et mat à la stratégie romaine en se ralliant Attale, et la tragédie des frères ennemis devient celle de la réconciliation familiale. Sans aller jusque-là, certains personnages affirment leur nature héroïque et défendent leur position dans le jeu politique, en oblitérant les manifestations extérieures topiques de leur dynamique passionnelle, constance qui se veut négation du tragique et éveil de l’admiration au lieu de la pitié. Dans certaines situations particulières, la tenue d’un discours vertueux, sans adhésion intérieure, contribue à l’accès du personnage au véritable héroïsme, la stratégie devenant moyen de poser des actes généreux ; sans toutefois que ces figures suscitent une admiration pleine et entière.
33Ainsi, tout en relevant de l’intergénéricité par l’incrustation en contexte sérieux, de motifs et de jeux de scène issus de la comédie, le jeu apparaît dans l’œuvre cornélienne à la fois comme un vecteur du tragique et un moyen ambigu et dangereux de juguler celui-ci. Imitation vraisemblable du monde politique, la tragédie, par le jeu entendu comme mise en place d’une stratégie et recours à la feinte, montre ainsi la misère des Grands ravalés au statut de figures ridicules, ou forcés à la corruption éthique ; ainsi que les démarches héroïques qui combattent ces dynamiques de dégradation de l’ethos. L’héroïsme oppose aux jeux et mensonges politiques, ses contre-jeux, par lesquels il trompe l’apparente fatalité. Selon le degré de pathétique de la pièce, cette réponse inclut une part de culpabilité de celui qui l’adopte, dont aucun acte généreux ne peut tout à fait le défaire ; ou se veut, au contraire, expression d’un choix de la « joie », que Corneille opposerait en sourdine à la « tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la Tragédie90 », défendue par Racine. Cette émotion anti-tragique viendrait faire pièce au pathétique modéré de l’abandon amoureux (réel ou supposé), là où la force d’âme combattrait celui, plus intense, de la violence intrafamiliale.
34La figuration du bonheur en contexte sérieux est un trait distinctif de l’œuvre cornélienne, qui contribue notamment à la spécificité esthétique de ses comédies héroïques. Ce genre, en effet, fait admirer l’héroïsme éthique d’une figure de souverain qui, en sacrifiant ses aspirations amoureuses, et en renonçant au mariage qu’elle désire, met fin à un conflit et établit le bonheur public. Elle y trouve une source paradoxale de joie qui se confond avec la gloire ainsi atteinte, et se distingue de la satisfaction des honnêtes passions privées qui fait le bonheur du personnage de comédie.
1 Dictionnaire de l’Académie françoise dédié au Roy (Le), 1694 [Première édition] dans Corpus des dictionnaires de l’Académie française : du xviie au xxe siècle, éd. Susan Baddeley, Simone Benharnou, Liselotte Biederlnann-Pasques…[et al.] ; avec la collaboration de Claude Blum, Philippe Derendinge, Laurence Plazenet…[et al.] ; présentation par Bernard Quemada, Paris, Classiques Garnier Numérique, 2007, p. 5 843 / 11 561.
2 Florence Dupont, L’Acteur-roi ou Le théâtre dans la Rome antique, Paris, Les Belles lettres, « Realia », 1986.
3 Antoine Furetière, Dictionnaire Universel, La Haye et Rotterdam, Arnout et Reinier Leers, 3 tomes, 1690. Voir Antoine Furetière, Dictionnaire Universel [Ressource électronique], Paris, Classiques Garnier Numérique, « Dictionnaires des xvie et xviie siècles », p. 10 367/19 245.
4 Christian Delmas, La Tragédie de l’âge classique : 1553-1770, Paris, Seuil, « Écrivains de toujours », 1994.
5 Pierre Corneille, Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique, dans Œuvres complètes, tome III, textes établis, annotés et présentés par Georges Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, p. 124.
6 Pierre Corneille, Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, p. 124.
7 Antoine Furetière, Dictionnaire Universel, éd. citée, p. 10 367/19 245.
8 Ibid.
9 Georges Forestier, La Tragédie française. Passions tragiques et règles classiques, Paris, Armand Colin, « U Lettres », 2010.
10 Bénédicte Louvat-Molozay, L’« Enfance » de la tragédie (1610-1642). Pratiques tragiques françaises de Hardy à Corneille, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, « Theatrum mundi », 2014.
11 Jean de La Bruyère, Les Caractères, introduction et notes d’Emmanuel Bury, Paris, Librairie Générale Française, « Le Livre de poche. Classique », 2004.
12 Christian Delmas, « Médée, figure de la violence dans le théâtre français du xviie siècle », Pallas. Revue d’études antiques, année 1996, no 45, p. 219-228.
13 Pierre Corneille, Examen de Médée, dans Œuvres complètes, tome I, textes établis, présentés et annotés par Georges Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980.
14 Christian Delmas, « Médée, figure de la violence dans le théâtre français du xviie siècle », art. cité.
15 Pierre Corneille, Médée, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, I, 1.
16 Pierre Corneille, Médée, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, I, 1.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, bibliographie revue et mise à jour par Colette Scherer, Saint-Genouph, Nizet, impr. 2001, cop. 2001.
21 Christian Delmas, « Médée, figure de la violence dans le théâtre français du xviie siècle », art. cité.
22 Pierre Corneille, Médée, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, 1980.
23 Voir, au sujet des déplacements du personnage tragique, Jean-Yves Vialleton, Poésie dramatique et prose du monde. Le comportement des personnages dans la tragédie en France au xviie siècle, Paris, Honoré Champion, « Lumière classique », 2004.
24 Pierre Corneille, Médée, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, III, 3.
25 Christian Delmas, « Médée, figure de la violence dans le théâtre français du xviie siècle », art. cité.
26 Pierre Corneille, Médée, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, II, 4.
27 Christian Delmas, « Médée, figure de la violence dans le théâtre français du xviie siècle », art. cité.
28 Jean-Yves Vialleton, Poésie dramatique et prose du monde, op. cit., p. 177.
29 Pierre Corneille, Le Cid, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, IV, 5.
30 Georges de Scudéry, Observations sur le Cid, dans La Querelle du Cid, 1637-1638, édition critique intégrale par Jean-Marc Civardi, Paris, Honoré Champion, « Sources classiques », 2004, p. 401. Le terme de « finesse » admet le sens, d’après le Dictionnaire de l’Académie de 1694, de « ruse, astuce », et « se prend presque tousjours en mauvaise part ».
31 Ibid., p. 401.
32 Jean Chapelain, Les Sentiments de l’Académie française sur la tragi-comédie du Cid, dans La Querelle du Cid, 1637-1638, éd. citée, p. 990.
33 Pierre Corneille, Le Cid, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, IV, 3.
34 Pierre Corneille, Médée, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, IV, 4.
35 Selon le terme même de Pierre Corneille, dans le Discours des trois unités, d’action, de jour et de lieu, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, p. 175.
36 Thomas Pavel, « Rodogune. Jeu rituel », Littérature no 71, année 1988, p. 120-126.
37 Pierre Corneille, Rodogune princesse des Parthes, dans Œuvres complètes, tome II, textes établis, annotés et présentés par Georges Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, I, 5, v. 319.
38 Ibid., II, 3, v. 562.
39 Ibid., II, 3, v. 629-630.
40 Pierre Corneille, Examen de Rodogune princesse des Parthes, dans Œuvres complètes, tome II, éd. citée, p. 202.
41 Georges Forestier, Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre, Paris, Droz, 2004, p. 215.
42 Pierre Corneille, Rodogune princesse des Parthes, dans Œuvres complètes, tome II, éd. citée, IV, 1, v. 1220.
43 Ibid., III, 3, v. 855.
44 Ibid., III, 5, v. 1091-1092.
45 Thomas Pavel, « Rodogune. Jeu rituel », art. cité.
46 Pierre Corneille, Médée, dans Œuvres complètes, tome I, éd. citée, I, 5.
47 Ibid.
48 Ibid., I, 4.
49 Pierre Corneille, Tite et Bérénice, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, I, 1, v. 79.
50 Ibid., II, 1, v. 419.
51 Ibid., II, 1, v. 430.
52 Pierre Corneille, Pulchérie, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, I, 5, v. 331.
53 Ibid., IV, 3, v. 1289.
54 Pierre Corneille, Tite et Bérénice, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, IV, 3, v. 1224.
55 Ibid., IV, 3, v. 1209-1210.
56 Ibid., IV, 4, v. 1279.
57 Ibid., V, 3, v. 1588.
58 Pierre Corneille, Pulchérie, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, V, 4, v. 1583-1587.
59 Ibid., V, 7, v. 1757-1758.
60 Pierre Corneille, Sophonisbe, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, II, 1, v. 508.
61 Pierre Corneille, Pulchérie, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, II, 1, v. 405.
62 Emmanuel Minel, Pierre Corneille. Le héros et le roi. Stratégies d’héroïsation dans le théâtre cornélien. Dynamisation de l’action et caractérisation problématique du héros, Paris, Eurédit, 2000.
63 Philippe Sellier, « Le Cid et le modèle héroïque de l’imagination », dans Essais sur l’imaginaire classique, Paris, Champion Classiques, 2005.
64 Pierre Corneille, Agésilas, dans Œuvres complètes, tome II, éd. citée, V, 9, v. 2117-2118.
65 Antoine Furetière, Dictionnaire Universel, La Haye et Rotterdam, Arnout et Reinier Leers, 3 tomes, 1690. Voir Antoine Furetière, Dictionnaire Universel [Ressource électronique], op. cit., p. 10 238 / 19 245.
66 Pierre Corneille, Agésilas, dans Œuvres complètes, tome II, éd. citée, IV, 4, v. 1570.
67 Ibid., II, 5, v. 724-725.
68 Ibid., IV, 5, v. 1596-1598.
69 Ibid., II, 7, v. 840-841.
70 Ibid., II, 6, v. 761-764.
71 Ibid., II, 7, v. 835.
72 Ibid., IV, 5, v. 1599.
73 Ibid., V, 9, v. 2072.
74 Ibid., V, 8, v. 2073-2074.
75 Pierre Corneille, Examen de Nicomède, dans Œuvres complètes, tome II, éd. citée, p. 642.
76 Voir introduction générale.
77 Pierre Corneille, Nicomède, dans Œuvres complètes, tome II, éd. citée, I, 2, v. 183-184.
78 Voir à ce sujet Jean-Yves Vialleton, Poésie dramatique et prose du monde, op. cit., p. 228-239.
79 Pierre Corneille, Nicomède, dans Œuvres complètes, tome II, éd. citée, I, 2, v. 139-140.
80 Ibid., I, 2, v. 241-244.
81 Ibid., I, 2, v. 180.
82 Marion Bellissime, « La réception de Cassius Dion chez Corneille : le débat Agrippa-Mécène (Histoire romaine, livre 52) et le débat Cinna-Maxime (Cinna, II, 1) », Tangence, no 116, 2018, p. 77-92. Disponible en ligne à l’adresse : https://doi.org/10.7202/1051080ar, page consultée le 30 novembre 2021.
83 Ibid.
84 Georges Forestier, « De la politique, ou la stratégie du mensonge dans Othon », dans Pierre Corneille, Othon, éd. et notes par José Sanchez ; préf. Alain Niderst, José Sanchez, Georges Forestier, Jacques Morel… [et al.], Mugron, J. Feijóo, 1989.
85 Pierre Corneille, Othon, dans Œuvres complètes, tome III, éd. citée, I, 1, v. 29.
86 Ibid., IV, 1, v. 1186.
87 Ibid., II, 1, v. 409-410.
88 Ibid., V, 8, v. 1831-1832.
89 Voir également à propos du personnage l’article de Georges Forestier, « Corneille, poète d’histoire », Littératures classiques, Supplément au no 11, janvier 1989 : Corneille, Le Cid, Othon, Suréna, p. 37-47. Disponible sur la toile à l’adresse : https://doi.org/10.3406/licla.1989.1184, page consultée le 30 novembre 2021.
90 Jean Racine, Préface à Bérénice [1689], dans Œuvres complètes 1, Théâtre, poésie, éd. présentée, établie et annotée par Georges Forestier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 450.
sous la direction de Liliane Picciola
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Revue Corneille présent », n° 1, 2021
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1227.
Quelques mots à propos de : Yasmine Loraud
Collège Gounod, Saint-Cloud
UMR 8599, CELLF 17-18 – Sorbonne Université
Yasmine Loraud, ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris (2009-2013), agrégée de Lettres modernes, a soutenu à l’Université de la Sorbonne, sous la direction de Georges Forestier, un doctorat de littérature française sur Corneille et l’héroïsme. Modèle héroïque de l’imagination et éthique du héros dans la tragédie au xviie siècle en janvier 2021. Elle occupe les fonctions de professeur de français au
