Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
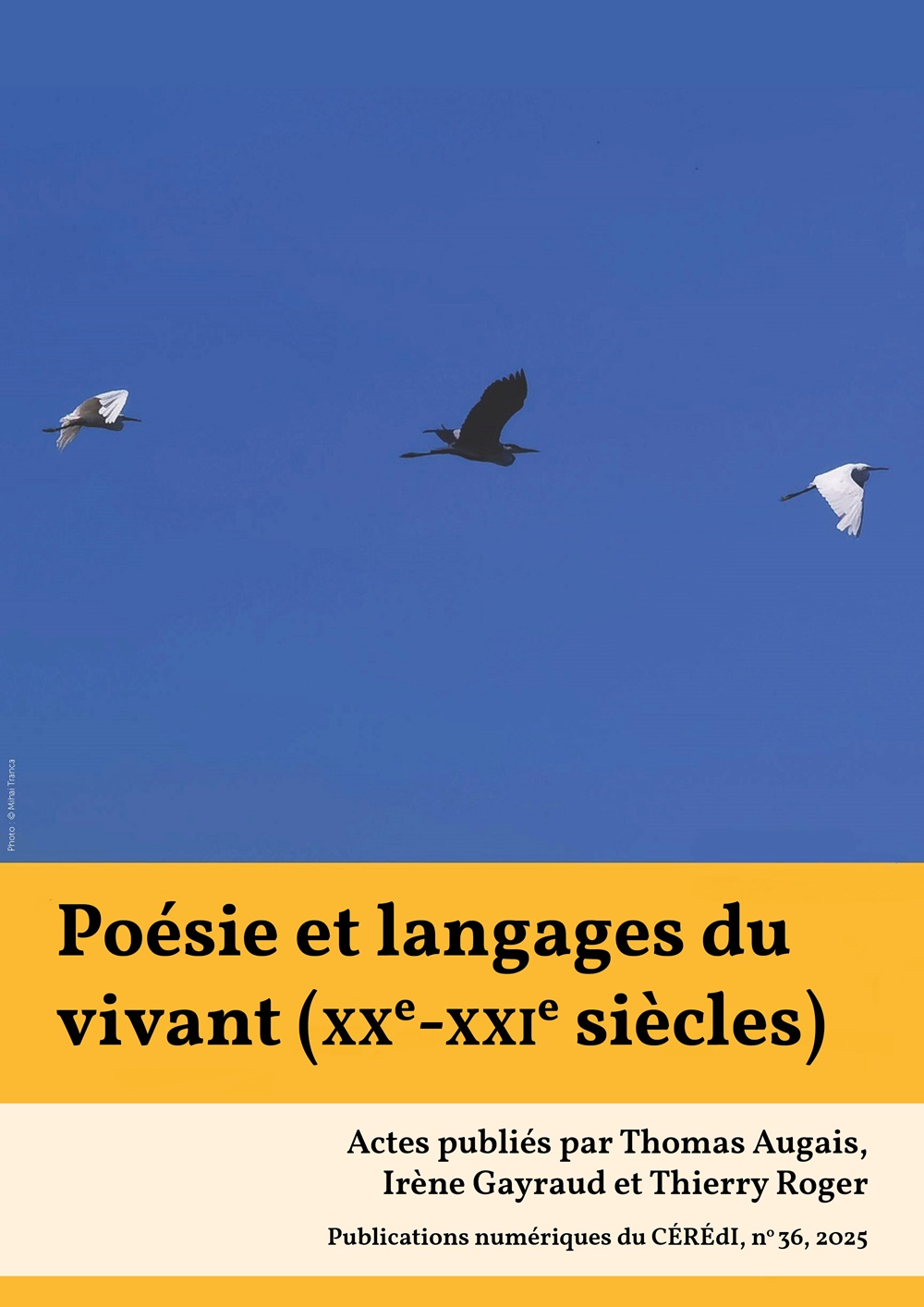
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
Anne Gourio
Approche de la parole, essai de Lorand Gaspar publié en 1978, propose une définition de la langue poétique originale, étroitement corrélée aux découvertes alors récentes dans le domaine des sciences du vivant : une relation d’identité entre « le texte poétique » et « le texte de la vie » est posée, soutenue par une assise scientifique. Mais cet essai est aussi parcouru de tensions entre lisibilité et illisibilité du vivant, que l’article analyse à partir de deux images : la trame et la trace. Avec elles, il esquisse une étude de l’œuvre poétique conçue comme un écheveau de lignes vives.
Approche de la parole, an essay by Lorand Gaspar published in 1978, proposes an original definition of poetic language, closely correlated with the then-recent discoveries in the life sciences: a relationship of identity between “the poetic text” and “the text of life” is posited, supported by a scientific foundation. But this essay is also permeated by tensions between legibility and illegibility, which the article analyzes using two images: the weft and the trace. With them, it sketches out a study of the poetic work conceived as a skein of living lines.
1La Lisibilité du monde, somme du philosophe allemand Hans Blumenberg1, fait entrer en tension la métaphore du « livre du monde », d’ascendance théologique, et le projet heuristique de déchiffrement de la nature, analysé au contraire comme un symptôme du désenchantement du monde et de la sécularisation de celui-ci. Si le basculement progressif de l’un à l’autre présente certaines implications attendues (le sens du texte n’est plus d’ordre métaphysique ni d’origine révélée ; l’auteur, en la figure du Créateur, en disparaît), Blumenberg choisit toutefois de s’attacher à une autre incidence : l’exigence de connaissance désormais adressée à la réalité suscite, en réaction à celle-ci, le désir de faire du monde l’objet d’une expérience. Ce dernier point éclaire bien des reprises poétiques du « livre du monde » aux xxe et xxie siècles : de Saint-John Perse et René Char à Vénus Khoury-Ghata, les signes poétiques découverts dans les strates de terre, sur les plages de sable, dans les arabesques des végétaux ou le ballet dessiné par le vol des oiseaux s’offrent comme des esquisses volatiles de sens, et résultent davantage d’expériences subjectives nées de l’imaginaire du poète que du déchiffrage d’un texte du monde immanent.
2Mais Blumenberg consacre le dernier chapitre de sa somme à un bouleversement épistémologique majeur qui vient perturber ces repères. La révolution introduite par la découverte du génome ouvre de toutes nouvelles perspectives : « Pour la première fois, le procédé de l’écriture a ainsi trouvé un correspondant précis dans la nature : présenter une diversité presque infinie de variations de sens à l’aide d’un petit nombre d’éléments2. » Désormais, le « livre du monde » n’est plus tout à fait une métaphore : il renvoie à une réalité attestée scientifiquement, celle du déchiffrement d’un code propre à chaque être vivant. Cette fracture épistémologique forme précisément le cœur de l’essai que Lorand Gaspar, poète et médecin, passionné par les sciences du vivant, consacre en 1978 au langage poétique, Approche de la parole3. L’essai propose une définition de la langue poétique originale, et atypique pour l’époque, étroitement corrélée aux découvertes alors récentes dans le domaine des sciences du vivant : une relation d’identité entre « le texte poétique » et « le texte de la vie4 » est posée, soutenue par une assise scientifique. Or cet essai est dans le même temps parcouru de multiples tensions, tensions qui ne sont pas sans évoquer le tiraillement entre connaissance et expérience évoqué par Blumenberg, mais aussi la complexité des relations entre poésie et langages du vivant. On sait que les recherches actuelles en biologie et en éthologie mettent au jour des formes de langage du vivant autres, qui invitent à élargir les contours de la raison et lancent des pistes en direction du genre poétique. Approche de la parole, publié en 1978, pourrait bien, à travers ses multiples tensions, nous mener déjà vers des hypothèses de cet ordre.
3C’est une enquête que nous souhaitons donc ouvrir autour de l’essai de Lorand Gaspar. Pour ce faire, nous nous proposons d’exploiter deux images, la trame et la trace, qui seront les fils directeurs de notre cheminement. Elles permettront de mettre en lumière ce qui, au cœur même d’Approche de la parole, entame l’hypothèse d’une parfaite lisibilité du sensible : là où le poète souhaite lire le tissu du vivant, il doit s’en remettre à une trame ajourée, là où il cherche des signes, il ne recueille que des traces. L’une et l’autre images nous conduiront ensuite, à travers les recueils poétiques cette fois, à découvrir les manifestations sensibles de ce (ou ces) langage(s) du vivant et à esquisser une poétique des lignes vives.
« Le texte de la vie » : exploration d’une trame notionnelle
4Entrelaçant dès sa première page les lexiques du langage et de la matière5, Approche de la parole fait évoluer la nature de ce rapprochement au fil de son déroulement. Le préambule de l’essai s’ouvre sur l’expérience du biologiste qui, « auscult[ant] le mouvement intime de la vie », s’appuie sur « l’alphabet de la matière », ce « syllabaire qui la précède de quelques milliards d’années6 ». Ce qui, dans cette première page, prend un tour métaphorique – « l’alphabet » et le « syllabaire » sont ici des images rendant compte de la structuration première de la matière – gagne un autre statut dans la première partie de l’essai. Intitulée « L’Ordre improbable », celle-ci puise dans les recherches de l’époque en biochimie moléculaire, génétique, épigénétique les matériaux permettant d’offrir au propos liminaire une justification scientifique. La démonstration fait intervenir deux échelles : celle de l’organisation interne de chaque cellule ; celle de l’interaction des cellules entre elles. L’une et l’autre forment pour Gaspar des langages, la première par la chaîne de ses propres composantes (molécules associées en acides aminés, eux-mêmes regroupés en protéines constituant les brins d’ADN – sorte de « puzzle mobile7 » constitué d’unités minimales disposées selon un ordre propre à chacun), la seconde par les effets de combinatoires entre cellules d’un même organisme ou d’organismes différents. Cette structuration de la matière par le génome constitue donc un langage premier et universel qui, unifiant le vivant, offre les conditions de possibilité d’un échange entre tous les êtres, reposant sur une lisibilité généralisée :
La totalité du monde vivant parle le même « langage ». Toute organisation vivante, bactérie, protozoaire, ou homme, est capable de « lire » presque sans erreur le « texte génétique » inscrit dans un acide désoxyribonucléique8.
5Lorand Gaspar va jusqu’à étendre le champ de son analyse à la matière inorganique, ce qui forme l’une des particularités de son approche, manifeste également dans ses recueils poétiques, qui placent la « parole » sur le même plan d’immanence que la matière minérale : « Tout ce qui en ce monde vient à une forme le fait selon un langage. Toute structure organique ou inorganique représente un message émis par un jeu d’ordonnances9 ».
6Cette charpente de la matière, qui constitue la trame de l’argumentaire de Lorand Gaspar, est significativement l’objet de formulations proches, réitérées au fil des pages, qui reproduisent et semblent même attester – par ces retours mêmes – la présence sous-jacente de cette structuration première du vivant. Notons que Gaspar soutient aussi l’hypothèse corollaire : le langage humain « s’inspire […] de l’ordre du vivant » par son « organisation arborescente, son développement à ramure, les relations dynamiques de ses éléments10. » Cette seconde hypothèse n’est pas neuve dans l’histoire de la linguistique : elle nous ramène au paradigme naturaliste de la linguistique de la fin du xixe siècle et aux métaphores physiologistes prisées, par exemple, par Arsène Darmesteter, dont l’influence sur la pensée surréaliste du langage est attestée11. Mais une fois associée, comme le fait Gaspar, à la première, elle gagne en fermeté épistémologique. L’ensemble de l’essai joue, dans cette perspective, sur un entrelacement systématique des deux lexiques en mobilisant régulièrement ces deux versants : la matière est un langage ; le langage humain est structuré comme un organisme et représente un moment de l’évolution du langage de la matière. Nulle différence de nature, en somme, entre l’un et l’autre.
7Un second domaine intervient dans ce soubassement notionnel, qui vient éclairer le titre de la première partie (« L’Ordre improbable ») : celui de la thermodynamique, qui conçoit le vivant à partir de la notion d’énergie. Le vivant construit, grâce à l’énergie qui lui est inhérente, des ordonnancements de plus en plus complexes au fil de son évolution, ordonnancements en lutte contre l’entropie à l’origine du désordre. Or, selon le « second principe » de la thermodynamique, le désordre est « probable » et l’ordre « improbable » ; la vie est par conséquent « improbable ». L’intérêt essentiel de cette référence à la thermodynamique est ici d’attirer la pensée de la matière, mais aussi du langage – selon le principe d’identification posé par l’essai –, dans un vaste champ d’énergies : non seulement le langage est structuré comme le vivant, mais il est parcouru de forces, d’influx, d’élans perpétuellement menacés.
8Les effets de ce soubassement scientifique sont capitaux. Le premier est d’asseoir la pensée unitaire de Lorand Gaspar, par ailleurs marquée sur ce point par le spinozisme12 : le poète défend l’unité du vivant et du non-vivant, la circulation et le dialogue entre les règnes et entre les genres. Cette pensée unitaire trouve dans le « tissu », on le sait, son image privilégiée. Dans Approche de la parole, cet entre-tissage généralisé affleure tout particulièrement dans le choix des quatre planches graphiques illustrant l’édition de 1978 : la proximité visuelle entre les dessins de Michaux en frontispice, la partition d’une partita de Bach, le fragment de la « formule chimique développée d’un acide nucléique » et le dessin par l’auteur d’un « ARN ribosomien d’après une photographie au microscope13 » témoigne du continuum entre l’art et le langage de la matière. Cet aspect est d’autant plus net que les planches viennent surprendre les attentes ménagées par l’essai : la section de l’essai dont l’orientation est la plus nettement scientifique, « L’Ordre improbable » est surplombée par la partition de la partita de Bach, quand les sections plus poétiques, « Langue natale » puis « Chant », le sont par les planches graphiques scientifiques. Le second effet de ce soubassement notionnel est de rendre possible une énergétique de la langue, qui rejaillit du reste directement sur le traitement de la métaphore récurrente du « tissu » : « Il y a une veine d’énergie qui est langue, qui chemine continue depuis les dispersions cosmiques et plissements géologiques aux tissages de la vie14. » Au tissu fini le texte gasparien préfère le mouvement de tissage et de détissage de ses unités premières15. L’image de la trame, en outre, est elle aussi souvent teintée par cette énergétique :
Le texte poétique est le texte de la vie, élargi, travaillé par le rythme des éléments, érodé, fragmentaire par endroits, laissant apparaître des signes plus anciens, trame d’ardeur et de circulation16.
9Le troisième effet, résultant du précédent, est de ruiner une conception mimétique de l’écriture poétique, conception selon laquelle le poème serait chargé de « déchiffrer » le texte du monde et de s’en faire le traducteur. La poésie, au contraire, relève d’une pratique qui prend pleinement part aux mouvements du vivant, dont elle reçoit l’énergie et qu’elle alimente en retour de sa propre énergie – on en mesurera le prolongement dans les recueils. Notons que, sur ce fond continuiste, l’essai s’applique toutefois à ménager quelques différences entre langage de la matière et langage humain. Il le fait par exemple en reprenant la distinction entre « signal » (dans le langage chimique) et « signe » (du langage humain17) ; mais là encore, le passage de l’un à l’autre reste continu et s’inscrit dans un devenir :
Puis le signal chimique devient signe. Il perd de sa rigueur mais gagne en mobilité, en maniabilité. Appel, avertissement, parade rituelle, chant18.
10Sans doute la particularité de l’écriture d’Approche de la parole constitue-t-elle la mise en œuvre manifeste, et le prolongement abouti, de cette spécificité des signes : l’essai entrelace une prose scientifique et une prose poétique, non pas selon un jeu d’alternances ordonnées ou de marquèterie, mais selon des effets de glissements, qui conduisent sans heurt certains paragraphes de l’une à l’autre19. Ce jeu de distinguos sur fond de continuité renforce finalement, on l’aura compris, la thèse continuiste de l’essai : le vivant est un, ses langages se répondent, tout en étant porteurs de distinctions que Lorand Gaspar prend soin de ménager.
11Reste que l’essai, dans le même temps, semble aussi combattre cette belle lisibilité du monde étayée par un soubassement scientifique. C’est là une difficulté d’appréhension essentielle pour le lecteur, dont il s’agit d’éclairer les manifestations et les enjeux.
Traces à travers la trame
12L’image de la trame, qui court dans l’essai, est souvent convoquée au point de rupture de cet entre-tissage généralisé, point qui vient fragiliser la lisibilité du vivant, à moins qu’il ne vienne esquisser une autre forme de lisibilité qui intéressera précisément la langue poétique.
13Nombreuses sont les reprises de cette image qui inversent les postulats mis au jour dans le premier temps de cette étude. Ainsi, lorsqu’invitation est lancée à « laisse[r] apparaître la trame dénudée d’une chaude et charnelle ignorance20 » : quand la trame assurait la continuité sensible mais aussi intelligible des êtres, il s’agit de la mener à une « charnelle ignorance » et d’estomper le tissage dans l’image de la « dénud[ation] ». Très souvent, du reste, la trame est rapportée au corps et associée à la nudité (le poète médecin pense au tissu organique). Parfois même il s’agit, par un mouvement de retour en amont, de ménager une ouverture à travers cette trame : « Allant aux fibres du tissage, aux sources de la chimie, regarder par cette trouée maladroite la lente migration du paysage21. » On le comprend, l’image du tissage reste, à travers la reformulation « aux fibres du tissage, aux sources de la chimie22 », étroitement liée au soubassement scientifique de l’essai, mais Gaspar replace ce dernier dans le cadre d’une raison élargie qui en dessine aussi les limites : en menant le regard vers les « fibres », vers les « sources », il s’agit de proposer une percée à travers ce tissage, percée qui puisse rendre visible (et non pas lisible) « la lente migration du paysage ». Par la poésie, « le tissu vivant est mené à sa faille23 ».
14Une réflexion semble donc se chercher dans ces formules, réflexion sur la possibilité d’un accès, par la poésie, à une rationalité élargie qui enfreigne les limites du langage. Cette expression n’est pas la seule, qui introduit tout un ensemble de tensions et de réticences nuançant l’étayage scientifique de l’essai et accompagnant une tentative de définition du poétique dans les blancs, les trouées, les esquives et les limites de la rationalité. Ce regard tourné vers l’amont pourrait être l’effet d’une influence qui marque fortement l’essai dans sa phase préparatoire, et qui disparaît ensuite. La rédaction d’Approche de la parole, qui s’est étirée sur une dizaine d’années, a donné lieu à un ensemble considérable d’avant-textes. Patrick Née, qui les a explorés24, signale les très nombreuses citations recopiées dans les textes de Heidegger et de son traducteur Jean Beaufret. Cette imprégnation heideggerienne subsiste fortement dans le titre final de l’essai – qui croise « Acheminement vers la parole » (1959, traduction de Jean Beaufret en 1976) et « Approche de Hölderlin » (traduction en 1962) –, comme elle teinte par ailleurs la charge contre la technique qui court dans l’essai, mais elle est surtout manifeste dans la tendance forte à définir la langue poétique comme un « jeu natif de la langue25 », une « langue natale26 », « une saveur d’aube27 », « une lueur d’origine28 », au plus près d’une origine qui s’esquive. Le préambule est très marqué par cette isotopie, qui domine par ailleurs la deuxième partie de l’essai intitulée précisément « Langue natale ». Dans sa version finale, Approche de la parole opère un dépassement manifeste de l’influence heideggérienne, qui s’accorde mal du reste avec l’hypothèse, développée dans l’essai, d’un langage généralisé du vivant.
15Étrangement toutefois, ce regard porté vers l’amont se double d’un autre, qui prend une direction a priori opposée. Une attention récurrente, manifeste en particulier dans les passages en prose poétique, est portée aux résidus, aux poussières, à ce qui subsiste d’une réalité organique ou inorganique :
Ni instrument, ni ornement, [la langue de poésie] scrute une parole qui charrie les âges et l’espace fuyant, fondatrice de pierres et d’histoire, lieu d’accueil de leur poussière […]. Elle est cette arrière-cour délabrée, envahie d’herbes, les murs couverts de lichens, où s’attarde un instant la lumière du soir29.
16La réflexion sur le vivant, certes, le cède ici au paradigme historique et archéologique, mais l’image de la trace permet toutefois de les unifier : avec Lorand Gaspar, la « langue de poésie », inscrite dans le temps immense d’une Histoire de la matière dont elle est partie prenante, pourrait être abordée comme un ensemble de traces – traces de l’Histoire, de l’aventure humaine, mais aussi des espèces naturelles qui l’ont traversée et modelée. Un passage de l’essai opère sur ce point un distinguo éclairant ; il oppose l’appétence de certains humains pour un « langage abstrait » qui n’est « jamais soumis aux incertitudes de l’expérience sensible » et la spécificité des poètes :
D’autres, porteurs de « traces » plus anciennes et plus vastes que celles d’un vécu individuel, plus fragiles et plus virulentes que les relevés de nos mesures, continueront à ressentir et à enrichir les rapports sensibles entre choses du monde soumises au même morcellement, à la même errance, sillonnées d’un même élancement de langue qui inexplicablement les disperse et les rassemble30.
17La circulation entre langages humain et non humain ne s’énonce plus avec la même assurance, elle passe par un ensemble de nuances et de retenues, qui entament le principe de continuité dominant par ailleurs l’essai. Morcellement, fragmentation, dispersion du sens, poétique des traces tendent à engager les effets d’un temps long, qui ménagent la possibilité d’un effacement, ou au moins d’un estompage, de ce « texte de la vie ». Soumis aux lois physiques de la matière, celui-ci est lui aussi gagné par des formes d’usure et d’érosion. La trace tend bel et bien à introduire un principe de discontinuité, lié à l’entropie, comme elle fragilise la lisibilité du sensible.
18Il serait dès lors tentant de proposer une lecture des tensions de l’essai à partir de cette poétique de la trace. Le même essai entremêle prose scientifique et prose poétique, syllabaire de la matière et trouée hors du langage, l’ensemble constituant un tissu ajouré qui, à un niveau métatextuel, pourrait bien prolonger ou reproduire ces traces du vivant, entre lisibilité et illisibilité, transparence et opacité, continuité et discontinuité. Il est également possible d’appréhender, dans cette perspective, le sens d’une autre référence philosophique convoquée dans l’essai : à la présence implicite, mais prégnante, de Heidegger – qui vient, comme on l’a vu, nuancer l’apport scientifique de l’essai – s’ajoute une référence plus inattendue. La troisième partie de l’essai s’ouvre, en épigraphe, sur la célèbre formule de Wittgenstein : « Ce qui s’exprime dans le langage, nous ne pouvons l’exprimer par lui31. » La phrase introduit une brusque trouée hors du continuum qui dominait la pensée du langage de Gaspar et, sur le plan philosophique, une forme de contradiction des références délibérément assumée. Mais l’ensemble de ces tensions n’est sans doute pas sans ramener paradoxalement au soubassement scientifique et sans venir le compléter. De fait, Gaspar a le souci d’intégrer à sa démonstration-méditation sur la poésie les dernières avancées de la physique moderne, celles qu’amènent en particulier les travaux en physique quantique reposant précisément sur le principe d’une discontinuité inhérente à l’énergie de la matière. Or la physique moderne, comme la poésie, « fait effraction dans un domaine où la logique du langage tourne court32 ». Sans doute est-ce là, comme on va le voir, que se loge la possibilité du poème et que se situe le dialogue de celui-ci avec le vivant.
19L’essai de 1978 suit ainsi un mouvement oscillant qui n’est pas seulement l’expression de sa lente genèse et des influences diverses qui ont modelé son écriture. Cette courbe, qui oscille entre continuité de la trame et ouvertures ménagées entre ses mailles, retour vers la double source du vivant et du langage et attention portée aux effets d’érosion, permet précisément d’appréhender les recueils de Gaspar dans leur relation spécifique aux langages du vivant.
Un entrelacs de lignes vives
20Ce parcours, nécessairement rapide, ne pourra relever que des tendances d’ensemble. Un premier constat naît à la lecture des recueils : ceux-ci laissent paradoxalement peu de place aux « langages » des animaux (qui sont du reste peu présents chez Gaspar, exception faite du domaine ornithologique) ou des végétaux, au regard de l’importance considérable que prend cette réflexion sur le langage dans l’essai de 1978, et plus largement dans la pensée de Gaspar. Une des raisons en serait que l’écriture poétique ne prend pas pour objet le(s) langage(s) du vivant ; elle en est, dans son influx, son énergie, son élan, la manifestation même. Ce n’est pas là, toutefois, la seule raison.
21De Gisements (publié en 1968) à Derrière le dos de Dieu (recueil de 2010), l’œuvre de Gaspar fait affleurer l’équivalent de tracés33 premiers, émergents, inchoatifs, dont la particularité principale est qu’ils traversent indifféremment les règnes du vivant et les champs du sensible, parcourant le monde naturel comme une trame active que le poème porte à l’expression. Sur ce point, citons d’abord l’une des toutes dernières pages d’Approche de la parole, qui en offre un exemple très développé :
Fibres du bois, lignes d’un champ gravitationnel que traverse la lumière, plis de l’eau glabre sous le frôlement soudain de la brise, histologie vivante du cerveau, d’une rétine ou d’un tégument, veines d’un bois et d’une pierre, usure des roches sur le chemin des eaux de ruissellement, dessins de turbulences qui naissent dans l’air. Ces textures, ces signes, ces « langages », qui se forment et se transforment selon une dynamique de communication fusionnelle, sont des écritures dont le bonheur et le désastre viennent de ce qu’elles n’interprètent pas : elles se contentent d’agir en échangeant, en combinant, en dispersant, leurs mouvements, leur matière, leur potentiel34.
22Fibres, veines, dessins : voilà précisément ces lignes qui strient les champs du vivant et du non-vivant en se déployant à des échelles très diverses, de l’intériorité du cerveau aux turbulences du ciel. Significatif est l’emploi du terme de « texture », adossé à « signes » et « langages » (terme significativement modalisé par les guillemets), pour sa proximité sonore et étymologique avec le terme de « texte » : il suggère le caractère palpable de ces signes encore engainés dans la matière. Importante, aussi, est la distinction faite entre « l’interprétation », refusée, et « l’action » : c’est bien l’effet de ces lignes qui l’emporte sur l’hypothèse du sens.
23Cette page se poursuit dans les recueils, et en particulier dans le tout dernier, Derrière le dos de Dieu, publié en 2010, dont le statut est un peu particulier : il rassemble des poèmes dont il n’est pas certain que Lorand Gaspar les aurait tous publiés en l’état. Cette hypothèse suggère que ces lignes vives appartiennent à une phase précoce de l’élaboration du poème. Dans ce dernier recueil affleurent en effet ces tracés à peine esquissés, ces fibres de sens tout juste déposées dans le texte, mais dessinant la possibilité d’un lien entre les êtres. Un poème, titré « Sahra. Tissus de roches et de corps », est ainsi bâti sur une alternance systématique de motifs minéraux et corporels, l’ensemble étant unifié par les « nervures », les « faisceaux », les « capillaires », les « réseaux », les « plissements35 ». D’autres s’ouvrent à une plus large diversité d’espèces vivantes :
Résilles lacis rhizomes réseaux
De lignes en torsades en tresses
Étendent des nervures dans l’infini
invisibles sinon dans les corps
cailloux quasars et coquelicots
peau contre peau – ramures de nerfs,
d’arbres, d’éclairs, d’eaux et de vents
imbriqués sans bornes dans le pain
des mondes qui augmente et se dissout
dans nos images36
24On aura remarqué le rôle que remplit ici l’écriture poétique qui prend part à cette unité du vivant au moyen de ses propres ressources sonores : « dans les corps / Cailloux quasars et coquelicots ». Ces tracés visuels et sonores gagnés par l’énergie sont bel et bien l’expression d’une nature naturante à laquelle l’écriture poétique participe elle aussi. La priorité, dans cette perspective, tient non à l’élucidation d’un hypothétique sens, mais à l’effet de cet écheveau de lignes sur l’ensemble du vivant qu’il dynamise. Car c’est la mobilité, on l’a dit, qui caractérise en premier lieu ces réseaux dans les textes poétiques de Gaspar (« réseau mobile de cris, de lueurs / de nœud d’images d’un flux continu37 »), du « lavis des vols d’hirondelles » aux « empreintes fugitives du vent dans les sables38 » :
Écriture ample, d’un seul trait qui démontre sa source et son élan – martinets –
Se dépliant par d’immenses caresses, épousant les pleins, les creux et les failles du corps invisible des vents.
Tant de tiges qui s’élancent, se plient et se déplient, se cassent sans se rompre, d’un même mouvoir en lui-même enraciné […]39
25Cet ensemble de lignes vives n’est pas sans susciter des échos dans l’anthropologie comparée des lignes proposée par Tim Ingold : « la vie est […] un composite tissé avec les innombrables fils que produisent des êtres de toutes sortes, humains et non-humains, se déployant ainsi à travers cet entrelacs de relations dans lesquels ils sont pris40. » Et comme chez Ingold il s’agit pour Gaspar de ramener la ligne à sa puissance native en « remont[an] à l’époque où la ligne était encore un geste41 ».
26Reste à cerner plus précisément la relation de ces lignes au langage. Si ces tracés suscitent des effets de proximité troublants avec les lignes d’écriture, ils déçoivent toutefois systématiquement le désir de déchiffrement. Là où l’œil veut lire, il ne perçoit que des traces subsistantes ; là où il veut accéder à un sens total, il ne saisit que des bribes, des brisures, des fragments dénoués. Les images poétiques sont sur ce point évocatrices, dans les registres visuel comme sonore : « des mots décousus, d’oreille à oreille, que recoud un secret42 » ; « parole brisée, flocons de voix dans le gel […] la pensée décousue dans les bruits de la mer43 » ; « cris inaudibles de millions d’insectes44 ». Sur ce point, un rapprochement pourrait être tenté avec une proposition de Vinciane Despret dans Habiter en oiseau. Analysant les traces visuelles ou olfactives laissées par les mammifères, elle opère un détour par le champ de la rhétorique : les mammifères, qui « ont fait le choix de la présence évoquée » « sont passés maîtres dans l’usage de la métaphore in absentia45 ». Ce régime de présence / absence est précisément celui qu’adopte le texte poétique, en particulier dans l’époque moderne et contemporaine. Faisant naître un sens dérobé et allusif, le texte poétique s’apparente au bruissement du sensible, à ses chuchotements insaisissables, à ces traces laissées mystérieusement par des êtres passés furtivement. L’écriture de Lorand Gaspar nous semble donner corps à cette hypothèse, et ce d’autant plus que ces motifs de traces sensibles engagent souvent une temporalité longue, elles qui sont logées loin dans la roche et dans les replis de la matière – la biologie s’y mêle alors à l’archéologie, l’organique à l’inorganique. C’est très net par exemple dans les textes de Sefar consacrés aux peintures pariétales du Tassili : « Dans les grottes dort la mémoire / de l’eau, des barques et des danses / d’un chuchotement de verdure46 », ou dans un poème consacré aux peintures rupestres de Jabbaren : « Sans cette dureté rocheuse, le tressaillement qui est langue / La braise du buisson, la voix / jusqu’à l’infond des ténèbres47 ». La profondeur du temps renforce ainsi cette part d’illisibilité et concourt elle aussi à la spécificité du sens poétique, un sens suggestif dérobant son référent ou l’ayant peut-être perdu.
27De telles lignes visuelles et sonores, étroitement liées au motif récurrent du bruissement48, engagent l’hypothèse d’un sens qui ne soit pas exclusivement sémantique, mais qui fasse une large place à l’expérience. Tout un travail pourrait s’engager ici sur le rôle des sonorités, sur le jeu des blancs, sur le recours systématique à la synesthésie comme autant de manifestations au moyen desquelles le poème gasparien accueille et prolonge ces langages du vivant. Ces lignes vives nous renvoient en outre, et pour finir, à ce que Jean-Christophe Bailly analyse comme une dimension essentielle du langage « qui n’est pas seulement de communication ou de désignation, mais qui est celle d’un chant, c’est-à-dire d’un accompagnement du monde49 ». L’écriture poétique, pour Gaspar, relève indéniablement d’une telle démarche de participation ou d’accompagnement. Nombreux sont les poèmes qui, à l’instar des textes de Baptiste Morizot50 aujourd’hui, invitent à l’écoute, à l’attention, à une forme de disponibilité orientée en direction du vivant – démarche qui, en tant que telle, trace elle aussi une nouvelle ligne entre les êtres vivants :
Accompagne […] le vent qui construit ses gestes avec l’arbre, la colline, la plaine, les vagues. L’oiseau qui érige la trame de l’air en son vol, le vacillement du bleu51
Bonheur de suivre les dessins intimes / du mouvoir sans fin dans ses intimes nervures / tissage d’une feuille, d’un cerveau / l’empreinte fugitive du vent dans les sables / écriture qui traverse sans s’interrompre / les corps, les choses qu’un rien déchire52
28Que conclure de cette brève circulation dans les recueils sinon que l’écriture poétique opère la jonction parfaite entre les deux images de la trame et de la trace qui ont guidé cette étude ? Cet entrelacs de lignes vives, qui offre les conditions de possibilité d’une circulation et d’un échange entre les êtres (vivants et non-vivants), se présente comme la trame d’une expression généralisée du vivant, trame qui prolonge, dans les recueils, la démonstration scientifique d’Approche de la parole. Cette trame, pour autant, ne livre pas un sens transparent et total : seules des traces subsistent, dont l’écriture poétique, dans sa puissance suggestive, offre le parfait prolongement. Sans doute est-ce dans la relation entre cette force unifiante et cette dispersion du sens que l’écriture poétique et le vivant, finalement, s’accordent si étroitement.
29Ainsi la pensée poétique de Lorand Gaspar offre-t-elle un exemple stimulant du dialogue entre les disciplines, qui débouche non sur des distinctions nouvelles entre la rationalité scientifique d’une part, une expression poétique qui s’en libérerait de l’autre, mais sur l’entrelacement de l’une et l’autre dans des formes de langage croisant leurs apports respectifs. En cela la pensée de Lorand Gaspar annonce les recherches actuelles sur les langages du vivant, mais en marquant sa spécificité. Sa particularité pourrait tenir à l’emploi au singulier de l’expression « langage du vivant », qui renvoie à l’origine commune de ces formes d’expressivité naturelle. La question de la lisibilité en tant que telle est finalement, avec Gaspar, esquivée au profit d’une double orientation, vers l’amont – ses conditions de possibilité – et vers l’aval – les effets de celle-ci.
1 Hans Blumenberg, La Lisibilité du monde [1981], traduit par Pierre Rusch et Denis Trierweiler, Paris, Éditions du Cerf, 2007.
2 Ibid., p. 386.
3 Lorand Gaspar, Approche de la parole, Paris, Gallimard, 1978.
4 Ibid., p. 87.
5 Sur les relations entre Lorand Gaspar et les sciences, nous renvoyons d’abord aux travaux décisifs de Dominique Combe, « Lorand Gaspar et le poème scientifique » dans Lorand Gaspar, dir. Daniel Lançon, Mazères, Le Temps qu’il fait, 2004, « Cahier 16 », p. 216-223 ; Maxime Del Fiol, Lorand Gaspar. Approches de l’immanence, Paris, Hermann, 2013, p. 112-150 ; Patrick Née, Lorand Gaspar. Une poétique du vivant, Paris, Hermann, 2020, p. 285-403.
6 Lorand Gaspar, Approche de la parole, op. cit., p. 9.
7 Ibid., p. 26.
8 Ibid., p. 36.
9 Ibid.
10 Ibid., p. 27.
11 Voir l’ouvrage de Raphaëlle Hérout, Surréalisme, résister, réinventer la langue, La Fresnaye-Fayel, Éditions Otrante, 2021, p. 164.
12 Voir sur ce point : Maxime Del Fiol, « Une rencontre capitale : Spinoza », dans Lorand Gaspar. Approches de l’immanence, op. cit., p. 174-211.
13 Approche de la parole, op. cit., p. 21, 102, 122.
14 Ibid., p. 110.
15 Voir sur ce point : Patrick Née, « Le tissage naturel », dans Lorand Gaspar. Une poétique du vivant, op. cit., p. 86-96.
16 Approche de la parole, op. cit., p. 87. Nous soulignons.
17 Mais aussi langage animal, dans une perspective qui annonce l’écosémiotique et la zoosémiotique.
18 Approche de la parole, op. cit., p. 31.
19 Voir sur ce point : Maxime Del Fiol, « Du tressage à la continuité », dans Lorand Gaspar. Approches de l’immanence, op. cit., p. 61-69.
20 Ibid., p. 13.
21 Ibid., p. 56.
22 Nous soulignons.
23 Ibid., p. 65.
24 Patrick Née, « Le travail de l’essai. Approche de la parole », dans Lorand Gaspar, archives et genèse de l’œuvre, dir. Anne Gourio et Danièle Leclair, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 231-250.
25 Approche de la parole, op. cit., p. 59.
26 Ibid., p. 99.
27 Ibid., p. 90.
28 Ibid., p. 88.
29 Ibid., p. 11.
30 Ibid., p. 86.
31 Ibid., p. 101.
32 Ibid., p. 105.
33 Nous utilisons ce terme sans supposer, toutefois, que ces « tracés » soient intentionnels.
34 Approche de la parole, op. cit., p. 142.
35 Lorand Gaspar, Derrière le dos de Dieu, Paris, Gallimard, 2010, p. 78.
36 Ibid., p. 39.
37 Lorand Gaspar, Apprentissage, Paris, Deyrolle, 1994, p. 54.
38 Id., Derrière le dos de Dieu, op. cit., p. 41.
39 Id., Patmos et autres poèmes, Paris, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 2004, p. 185. Sur le vol des oiseaux, voir les pages de Patrick Née qui étudient leurs relations avec la pensée chinoise : « Calligraphies aériennes », dans Lorand Gaspar. Une poétique du vivant, op. cit., p. 179-189.
40 Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Bruxelles, Zones sensibles, 2013, p. 10.
41 Ibid.
42 Lorand Gaspar, Égée Judée, Paris, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 1993, p. 144.
43 Id., Patmos, op. cit., p. 20.
44 Id., Derrière le dos de Dieu, op. cit., p. 26.
45 Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes sud, « Babel », 2019, p. 38.
46 Lorand Gaspar, Patmos et autres poèmes, op. cit., p. 97.
47 Id., Derrière le dos de Dieu, op. cit., p. 33.
48 Un « bruissement à l’écart du dicible » (Ibid., p. 92), « Bruissement de la vie soudain rétablie en sa fluidité native, en son congé de discours » (Ibid., p. 115)
49 Jean-Christophe Bailly, L’Élargissement du poème, Christian Bourgois éditeur, 2015, p. 199.
50 En particulier : Baptiste Morizot, Raviver les braises du vivant : un front commun, Arles et Marseille, Actes Sud et Wildproject, 2020.
51 Lorand Gaspar, Approche de la parole, op. cit., p. 125.
52 Id., Derrière le dos de Dieu, op. cit., p. 56.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2085.html.
Quelques mots à propos de : Anne Gourio
Université de Caen Normandie
LASLAR – UR 4256
Anne Gourio est Maître de conférences en littérature française du xxe siècle à l’Université de Caen Normandie, spécialiste de poésie moderne et contemporaine. Elle consacre ses travaux à la matière élémentaire en poésie (Chants de pierres, ELLUG, 2005 ; Écrit sur l’écorce, la pierre, la neige. Les supports matériels du poème, co-dir. avec Cécile Brochard, Elseneur no 36, Presses Universitaires de Caen, 2021), à la fascination des poètes pour l’immémorial et aux relations entre langage et monde sensible (La poésie, au défaut des langues (dir.), Elseneur no 27, Presses Universitaires de Caen, 2013) : de la notion de livre du monde, elle fait à présent évoluer ses travaux vers les lignes du monde naturel.
