Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
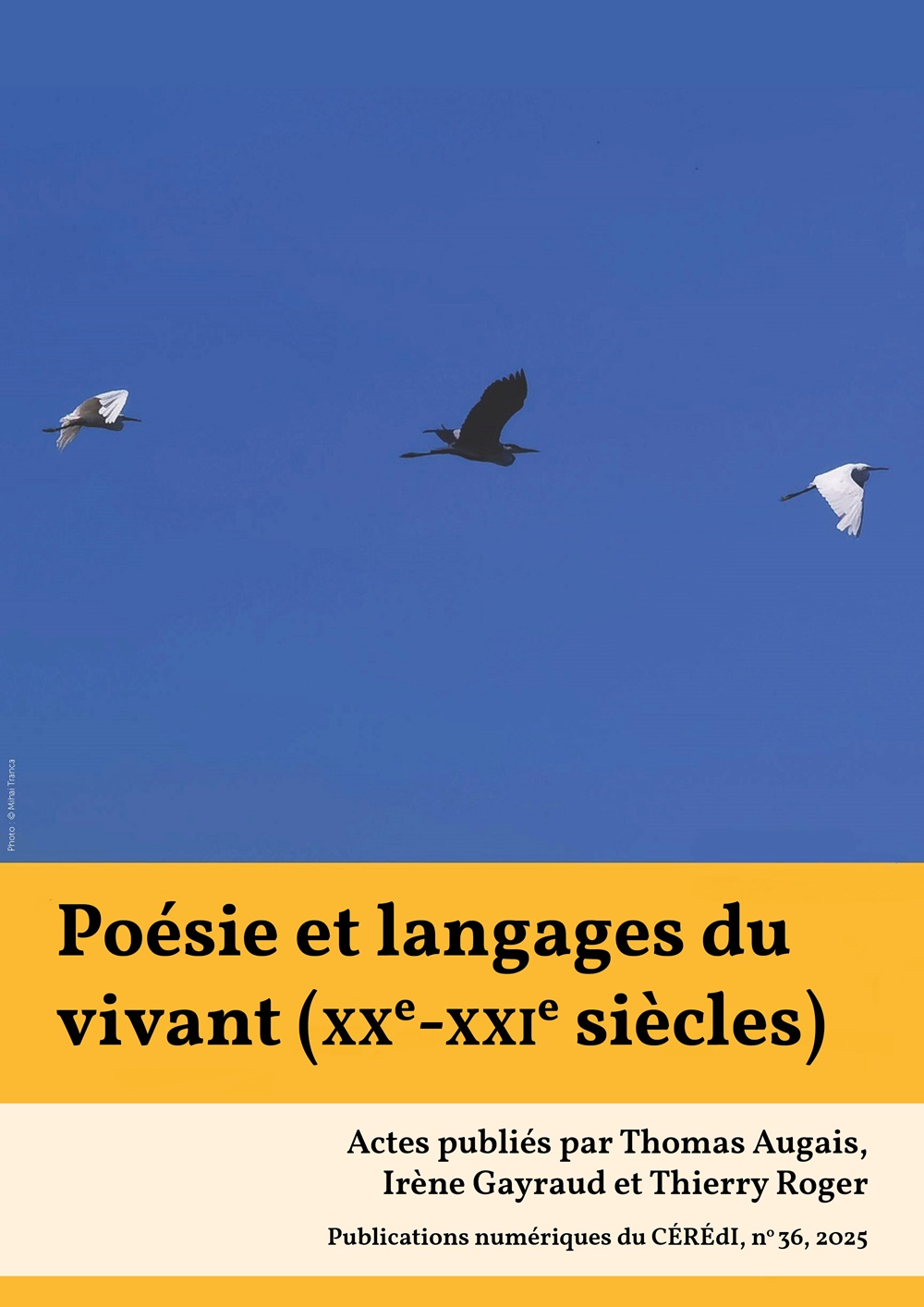
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
François Chanteloup
Introduction
1On oublie parfois que le poète suisse romand Gustave Roud (1897-1976) a consacré une très grande partie de sa vie au travail de traduction : traduction « alimentaire », qui lui permettait de subvenir à ses besoins, ou traduction « élective », qui le faisait se tourner vers des œuvres ou des poètes qui le touchaient particulièrement, et qui fécondaient son propre univers poétique1. Parmi les poètes traduits, il faut évidemment citer Novalis et Hölderlin, que suivront Rilke et Trakl. De nos jours, si l’œuvre de Roud peine toujours à sortir des frontières suisses, il importe néanmoins de reconnaître l’existence d’une « actualité Roud », symbolisée par la publication des œuvres complètes en 2022. Le mérite de cette édition scientifique, en plus de redonner à lire des textes devenus pour certains d’entre eux difficilement accessibles, est de consacrer un volume à part entière aux traductions de Roud, l’une des parties de son œuvre qui commençait peu à peu à s’éclipser.
2Cependant, c’est une traduction un peu particulière que nous aimerions évoquer dans ces lignes : non plus celle consistant à traduire une langue – humaine – dans une autre langue, mais plutôt celle qui s’attache à transposer d’autres formes de langage. Or, nous touchons avec cette expression à un aspect fondamental de l’œuvre de Gustave Roud, à savoir l’intérêt constant suscité par les autres formes de vie, les autres « manières d’être vivant » dirait Morizot2 : de différentes façons en effet, Roud a essayé de faire valoir une poétique plus-qu’humaine, c’est-à-dire une poétique qui, ne se limitant pas à la seule expérience de la condition humaine, tâche de prendre en compte tous les existants. C’est en cela que l’attention du poète est donnée à l’ensemble des phénomènes, à l’ensemble de ce qu’il appelle lui-même des « faits de nature3 » : tous les signes perçus deviennent des « faits » dans la mesure où ils sont reçus comme un matériau nourrissant l’énigme métaphysique.
3Ces « vérités du monde4 », comme Roud les appelait aussi, apparaissent donc dans sa poésie comme autant de « faits » qu’il s’agit d’élucider – grâce à une démarche qu’il nous faudra préciser. Ces « faits » en question (au sens large de : « ce qui existe, ce qui constitue la réalité5 ») composaient l’univers quotidien de Roud, marcheur et homme de la campagne, qui fut étroitement lié au monde des arts – et des lettres en particulier – mais qui a constamment fait le choix de conserver un certain retrait social, en revendiquant notamment une nette préférence pour la ruralité. C’est d’ailleurs probablement cette position géographique et ce contact permanent avec le dehors qui lui ont permis de mener ses échanges avec ce que nous appelons désormais « le vivant » – que Roud désignait volontiers du terme général « nature », en hésitant fréquemment entre minuscule et majuscule initiale, en ajoutant régulièrement des guillemets, et en soulignant l’insuffisance d’un substantif imprécis car trop vaste6.
4Mais avant d’entrer véritablement dans le vif du sujet des tentatives de traduction roudiennes, un mot tout de même de la traduction en tant que telle. Si, dès le début, nous avons utilisé ce parallèle entre la traduction « littéraire » (la traduction d’ouvrages écrits dans des langues humaines) et la traduction des langages du vivant, c’est qu’un certain nombre de similitudes autorise selon nous ce rapprochement. Comme l’écrit très justement Raphaëlle Lacord, qui signe l’appareil critique du volume de Traductions : pour Roud, « la traduction poétique s’apparente toujours à une folie, une entreprise à peine réalisable7 ». On se souvient peut-être de la fameuse affirmation du linguiste Roman Jakobson : « la poésie, par définition, est intraduisible. » Et Jakobson d’ajouter : « Seule est possible une transposition créatrice8. »
5C’est justement dans cette brèche que s’inscrit Roud, pour qui traduire la poésie a en effet quelque chose d’impossible, mais qu’il faut tout de même tenter, pour répondre à cet appel d’une voix étrangère qui demande à être relayée. Au départ de toute traduction littéraire, il y a pour Roud une voix « qui l’interpelle9 ». On comprend bien, dès lors, en quoi il y a création, ou recréation. Si nous avons parlé plus haut de traduction « élective », c’est que l’entreprise de Roud est « motivée », comme le dit Claire Jaquier, « par une démarche d’identification » qui, de fait, « exclut le souci de la littéralité, de la différence ou de l’étrangeté textuelles au profit d’une recherche des équivalences10 ». Or, il nous semble, comme nous voudrions le montrer, que de telles considérations sur la traduction, qui ne sont certes pas nouvelles, font néanmoins écho aux recherches les plus contemporaines qui s’attachent à poser à nouveaux frais la question des langages du vivant.
6De fait, on trouvait déjà chez Walter Benjamin ce rapprochement entre traduction littéraire et traduction du monde vivant. Élisabeth de Fontenay relève ainsi qu’à la « manière prométhéenne11 » qui a fini par s’incarner en un « humanisme techniciste et destructeur du donné », Benjamin opposait « une autre manière d’évoquer la condition humaine », celle qui faisait de tous les êtres humains des traducteurs en puissance : « ce sont les hommes et non pas seulement les poètes qui sont appelés à se mettre à l’écoute de la nature afin d’entendre et de traduire son langage. » Traduire « le silence des choses et des bêtes » est une bien « tâche », ainsi que l’écrit l’autrice du Silence des bêtes, qui cite alors Benjamin : « Le langage muet de la nature “doit être comparé à un secret mot d’ordre que chaque sentinelle transmet dans son propre langage12” ». Un secret mot d’ordre : c’est comme cela que Roud ressent et reçoit autant les appels de certains poètes étrangers, que ceux des non-humains, en constante recherche de nouvelles sentinelles.
Des continuités qui entremêlent monde du langage et langage du monde
Traduire et interpréter : un substrat théorique
7Parmi les recherches qui s’interrogent sur les langages du vivant, celles de Baptiste Morizot s’imposent, qui avancent l’idée que notre cosmologie se caractérise par un « sentiment de solitude cosmique », entraînant une inévitable « angoisse » face « au silence du monde13 ». Dans une telle cosmologie, il n’y a « rien à voir, c’est-à-dire ici rien à traduire : pas de sens à interpréter14». Or, pour Morizot, ce sont avant tout des faits culturels, qui ont permis « de fantasmer un silence, de créer le silence assourdissant des espaces infinis » dit-il en faisant référence à Pascal. Parmi ces faits, on pourrait citer :
la mise à distance des communautés biotiques, des points de vue spatiaux (l’enracinement dans les villes), ontologique (le refus de reconnaître une consistance ontologique à tout ce qui n’est pas humain) et technique (l’instrumentalisation généralisée du vivant par les modernes15).
8Toutefois, le propos de Morizot consiste à dire que, si l’on cherche à faire le chemin inverse, et que l’on essaye de renouer avec ce vivant que l’on a réifié, tout redevient possible. « Car », précise le philosophe, « il y a des significations partout dans le vivant : elles ne sont pas à projeter, elles sont à retrouver, avec les moyens qui sont les nôtres, c’est-à-dire traduire et interpréter16 ». Directement à la suite de cela, Morizot appelle à « reprendre langue avec le vivant » : et pour ce faire, il faut, dit-il, « des interprètes, des truchements, des entre-deux ». Ou des poètes, pourrait-on ajouter, si l’on se réfère à la vieille tradition qui fait du poète « le véritable interprète de la nature17 ».
9Dans tous les cas, la communication avec le monde, avec les non-humains, est bien considérée comme « possible » : « elle a toujours eu lieu, elle est ourlée de mystère, d’énigmes inépuisables, d’intraduisibles aussi, mais enfin de malentendus créateurs18. » C’est bien sûr ce terme d’« intraduisibles » qui va nous intéresser, d’autant plus que Morizot précise, à propos de ces « caractères des vivants » qu’il juge « intraduisibles » : « Cela ne veut pas dire qu’il est impossible de les traduire, mais au contraire qu’on ne peut jamais cesser de les traduire, de les retraduire autrement, pour faire justice à leur intime altérité19. » Dès lors, il convient de nous demander comment s’exprime, chez Roud, cette « poétique du traduire20 » : quelles expressions prend-elle ?
Un monde qui ne demande qu’à répondre
10Avant toute autre chose, il nous faut préciser que l’esthétique générale de Gustave Roud tourne autour de cette question de la traduction, ou de la lisibilité, puisque l’entreprise du poète carrougeois consiste à donner son attention au monde pour tâcher de le lire correctement, d’en interpréter les multiples signes, afin de parvenir à une intelligence, une compréhension subtile du vivant. Roud réactive d’ailleurs fréquemment la métaphore du livre de la nature21 : il compare par exemple les mélanges colorés des champs à des « phrases22 » aux syntaxes bien particulières ; les éclairs quant à eux sont des « hiéroglyphes instantanés », c’est-à-dire « une écriture de feu23 » ; et quand le brouillard s’en prend au paysage, celui-ci se disloque en « lettres séparées24 ». Bref, celui qui se qualifie lui-même de « vague épeleur de paysages25 » s’est attaché, année après année, « à lire et relire l’écriture horizontale des collines26 », sans pour autant voir ces collines, parmi lesquelles il vivait, comme un grimoire désanimé, mathématique, dont il faudrait seulement parvenir à dégager les lois.
11Autrement dit, il n’y a pas de relation unilatérale (où un sujet tenterait de trouver le sens d’un décor, d’un vaste objet figé et passif), mais une vraie relation – c’est-à-dire un échange réciproque entre deux pôles. Pour évoquer ces « correspondances enivrantes » entre le moi et le « monde extérieur », Roud parle précisément de « Double échange » : « il faisait de mes pensées des images, je lui donnais un sens27. » On voit donc que, si le sujet lyrique donne un sens au monde, il lui emprunte également des images, des formes, qui nourrissent sa propre existence. Ce qui compte alors, plus que le seul moi ou le seul monde, c’est bien la relation qui s’établit entre les deux. Pour cela néanmoins, il faut que le moi limite son emprise et ne se place pas devant le monde comme devant quelque chose de purement extérieur, mais plutôt comme un processus en perpétuel mouvement, fait de multiples entités, donc de multiples interlocuteurs.
12Souvenons-nous de ce que dit Tim Ingold, au moment où, dans Marcher avec les dragons, il évoque ce fameux livre de la nature, en citant notamment le texte essentiel de Galilée. Et Ingold d’avancer l’idée que l’évolution de la lecture des textes, passant de l’oralité médiévale (et notamment l’oralité murmurée de la lecture monastique), à la lecture silencieuse moderne, est allée de pair avec le progressif mutisme du monde. Ingold écrit : « Manifestement, à mesure que les pages perdaient leur voix avec l’avènement de l’époque moderne, le livre de la nature était lui aussi plongé dans le silence. Et de fait, il ne nous parle plus et ne nous dit plus rien28. » Le livre de la nature « ne nous dit plus rien », à nous les occidentaux semble dire Tim Ingold, ou à nous les modernes : car c’est seulement pour l’ontologie naturaliste29, mise au jour par Descola, que le livre de la nature demeure lettre morte. Il n’en est pas ainsi dans toutes les cosmologies, ni même au sein du naturalisme : que ce soit dans l’éthologie contemporaine ou dans les esthétiques romantiques, la nature est pleinement signifiante – et légitime à nourrir un dialogue.
13Et de fait, le monde de Roud n’est pas un monde muet : en témoigne par exemple cette définition de la poésie, donnée au beau milieu d’une prose écrite au tout début de la guerre, en octobre 1939, et qui contient cette phrase : « La poésie (la vraie) m’a toujours paru être […] une quête de signes menée au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre, interrogé, il est vrai, selon telle ou telle inflexion de voix30. » Ces quelques mots contiennent une grande part de la poétique de Roud, puisque constamment, dans chaque texte, affleure cette intuition selon laquelle le monde propose un ensemble de signes – sous la forme d’une parole (la voix des vivants et des éléments) ou d’une écriture (les formes des collines et les figures des oiseaux dans le ciel). Seulement, il est indispensable d’être perméable à ce dialogue potentiel : il s’agit de savoir disposer de ce qui est donné, pour entrer en contact avec ce monde prêt à délivrer une réponse – à condition que la question soit la bonne, et soit correctement posée.
14Ce qui est certain c’est que le monde, dans une telle conception, n’est plus une chose passive qu’il convient de décrypter comme un programme mathématique voire informatique, mais devient un véritable agent, qui cherche de lui-même à établir le contact. En ce sens, la poétique de Roud ne s’inscrit plus dans un cadre naturaliste, mais le déborde largement, et contient autant des implications analogistes qu’animistes (Descola, à ce titre, rappelle régulièrement que chaque être humain porte en soi, dans des proportions diverses, les quatre analogies) : certains non-humains sont « perçus comme dotés d’une intériorité analogue à celle des humains (une âme, une subjectivité, une intentionnalité31) », tandis que sont multipliés les « réseaux de correspondances permettant de […] connecter » les « existants32 ».
15Dans les deux cas, on voit tout de suite la différence qu’il peut y avoir entre une attitude consistant à projeter son moi dans le monde, et à lire celui-ci à l’aune de celui-là (une attitude naturaliste que l’on a pu imputer à un certain romantisme), et à l’inverse une attitude consistant à interroger sans relâche un monde dont on perçoit les signes et le fait même qu’il s’exprime, sans pour autant statuer définitivement sur le sens des paroles en question33. C’est bien en cela que le sujet qui se place ainsi vis-à-vis du monde, c’est-à-dire dans une posture d’échange, d’ouverture, sans a priori et sans projection de son intériorité sur le monde extérieur, se retrouve nécessairement en face d’un cortège d’intraduisibles.
16Or, devant cette impossibilité de fixer un sens, la tentation du désespoir peut être grande, et elle se lit parfois chez le sujet lyrique roudien, qui s’exclame (avec un très fort intertexte mallarméen34) :
Qu’est-ce que ce monde veut dire ? Et s’il n’a pas de réponse à nous donner, pourquoi feint-il sans trêve un discours ? Maintenant comme jadis, cette fuite et cette présence simultanées à mes pieds de l’eau perpétuelle murmurent indéfinissablement quelque chose et je sursaute quand le merle me scande (c’est bientôt la nuit) une question indubitable35.
17Si le monde « feint », ne faut-il donc voir en lui qu’une succession d’apparences et de faux-semblants ? Il faut peut-être plutôt comprendre : il y a une « réponse » (à découvrir) parce qu’il y a « discours ». Autrement dit, c’est en raison de la perception manifeste de la présence d’un discours que naît l’existence cachée d’une réponse : l’explicite désigne l’implicite. Bien sûr, sous le vocable commode de « monde », ce sont toujours de vastes et multiples composantes, qui s’expriment et s’incarnent dans les textes.
18Pour Roud en effet, même si l’on retrouve plusieurs fois chez lui l’expression « tout signifie36 », c’est-à-dire que tout, pour celui qui sait lire, est signe, certaines réalités bénéficient néanmoins d’un statut privilégié : c’est le cas des oiseaux, qui apparaissent chez Roud comme des messagers, au même titre que les papillons. Mais alors que les papillons s’expriment principalement par leurs couleurs (et le moment de leur apparition), les messages des oiseaux, eux, s’incarnent principalement dans leur chant, et l’on comprendra sans peine que cette possibilité d’expression leur vaut un surplus non pas nécessairement d’intérêt, mais de sens, car leur parole peut être plus facilement décryptée, dans la mesure où elle se rapproche davantage des moyens de communication humains. C’est en ce sens que le « territoire chez la plupart des oiseaux est un site de spectacularisation », comme l’écrit Vinciane Despret : « il est le lieu par lequel l’oiseau peut être vu et entendu37. » En d’autres termes, le chant des oiseaux a une fonction biologique, mais aussi, dans le même temps, une fonction artistique, ce qui renvoie aux termes utilisés par Adolf Portmann, le zoologiste suisse spécialiste des formes animales : « Habituons-nous […] à voir dans beaucoup d’aspects de l’apparence des animaux supérieurs une “joie pour les yeux” et des formes “faites pour être vues38”. » Dès lors, le sujet lyrique se saisit de ces formes rencontrant sa propre intériorité – et compose avec elles.
La voix du vent et la voix de l’eau
19Cependant, avant de rejoindre les oiseaux, un mot sur le vent et sur l’eau. L’intérêt acoustique de Roud se porte en effet autant sur les composantes multiples de la biophonie (« les sons provenant de sources biologiques non humaines39 ») que sur celles de la géophonie (« les sons naturels non biologiques40 »). Dans les deux cas, l’attention du poète prend en compte un matériau sonore : il s’agit d’accueillir les sons les plus divers, en les considérant tels qu’ils sont, c’est-à-dire sans la couche d’interprétation qui menace de les recouvrir instantanément. C’est dans un second temps seulement qu’advient la tentative herméneutique consistant à les transposer en mots : et c’est à ce moment-là que les sources auditives commencent à se distinguer nettement. Les oiseaux bénéficient par exemple d’un registre plus varié que l’eau, et finiront par représenter, nous le verrons, certaines paroles bien précises. Le vent quant à lui se fait plus abscons encore, plus indéchiffrable. Toutefois, quelle que soit l’origine de la parole que le poète se sent inexplicablement invité à traduire (et qu’il perçoit, déjà, comme parole), les précautions prises sont les mêmes, car il s’agit de bien traduire, et non de proposer une équivalence bancale ou, pire, une simple transcription. C’est fort de cette prudence que le sujet lyrique s’adresse directement au vent, dans une prose intitulée « D’un carnet de juin », publiée en 1931 :
Que vas-tu chuchoter de tes millions de feuilles murmurantes ? Je ne veux plus te prêter un langage. J’attends. Que de fois déjà n’ai-je pas vainement senti (comme on sent un souvenir flotter tout près des rives de la mémoire et replonger au néant) quelques syllabes confuses surgir à peine hors de ton chant, essayer une réponse en balbutiements aussitôt dispersée ou brisée par une pause sans merci41 !
20Dans cet extrait significatif, il faut déjà noter, tout simplement, l’adresse à la deuxième personne, et la volonté de ne pas parler à la place de, ou de moins la volonté de rester au plus proche de ce qui est dit. Le sujet lyrique ne veut pas « prêter » un langage au vent, mais comprendre le propre langage du vent, dans toute son altérité, dans toute sa complexité. Tentative qui paraît vouée à l’échec, puisque toujours ce langage-là se dérobe, dissimule son sens, ou se tait. Or, le mouvement du sujet lyrique demeure constamment similaire à celui qui s’exprime dans notre extrait : il tend toujours à essayer malgré tout, en dépit des échecs successifs – qui ne sont d’ailleurs pas de simples échecs, car Roud lie plusieurs fois la voix du vent à sa propre voix poétique, notamment lorsqu’il écrit : « Quand mai et le vent rendent une voix aux forêts, cette voix éveille la mienne42. »
21Ce qu’évoque la façon dont Roud prend en compte le vent, c’est également l’une des idées principales développées dans Comment la terre s’est tue, de David Abram – idée que l’on peut lire dans le passage suivant :
En affirmant que les autres animaux possèdent leurs propres langues et que même le bruissement des feuilles d’un chêne ou d’un bosquet de trembles est en lui-même un genre de voix, les peuples de culture orale lient leurs sens aux sons et aux gestes sans cesse changeants de la terre où ils habitent ; ils s’assurent donc que leur manière de parler reste informée par la vie de cette terre43.
22Significativement, nous retrouvons alors la question de l’oralité, que nous avions soulevée plus haut de manière un peu différente avec Tim Ingold : mais dans les deux cas l’oralité s’oppose à un rapport muet au monde, et emblématise – voire incarne – une relation, un échange avec des phénomènes perçus comme de légitimes interlocuteurs. Chercher à comprendre, à décrypter ce que dit le vent, ou ne serait-ce que l’écouter avec attention, c’est déjà sortir de la solitude cosmique moderne : c’est passer « de l’ennui à l’enquête44 ».
23De semblables questionnements parcourent également le motif de l’eau. Roud évoque fréquemment ce qu’il appelle la « parole-chant du ruisseau45 », qu’il compare à un « long récitatif monotone46 » et qu’il confond souvent, volontairement ou non, avec des paroles humaines murmurées dans le lointain. C’est le cas notamment dans le passage suivant :
Sous l’arc des aulnes, le ruisseau brise et brouille aux pierres noyées toute une écume de syllabes, se reprend soudain avec d’étranges rires de gorge, change de voix et de reflets, double au miroir d’une seconde l’épi rose d’un épilobe, puis détaille distinctement une phrase si proche de l’humain que je m’épuise à la vouloir saisir47 […].
24Ici, on pourrait dire que la parole-chant du ruisseau nourrit la prose poétique, dans la mesure où le travail sur les sonorités paraît directement inspiré des sons émis par l’eau. Quelques lignes plus haut, le sujet lyrique se comparait déjà à « un hôte dont la parole s’embarrasse48 » : or, les allers-retours entre la parole humaine et la parole du ruisseau créent alors comme une indistinction temporaire. Les frontières deviennent poreuses, tant l’eau est caractérisée par les ressemblances humaines qui semblent en émaner. Le travail poétique, qui s’incarne ici dans le procédé classique de l’harmonie imitative, multiplie les dédoublements (« l’épi rose » / « épilobe »), comme pour suggérer par le son le miroir que créent les reflets de l’eau.
25Le retour des mêmes sonorités (« brise » et « brouille ») peut évoquer quant à lui la présence disséminée des pierres heurtant le cours de l’eau. Si le sujet qui perçoit le paysage sonore reste statique, il entendra à peu de choses près la même phrase indéfiniment reprise ; mais s’il devient mobile le long de ce même paysage (en l’occurrence le long de la Carrouge, le ruisseau que Roud fréquentait régulièrement), alors se lèveront plusieurs phrases qui iront se complexifiant, jusqu’à former un paragraphe, ou plutôt un discours, car l’oralité demeure. On observe d’ailleurs que le ruisseau est explicitement abordé comme le serait un discours humain, avec un sémantisme d’ordre linguistique, qui s’intéresse à la parole (par opposition à la langue) : il est question d’une « écume de syllabes », mais aussi de « voix », de « phrase », et même de « rires », ce qui élargit plus encore le spectre de la comparaison – le ruisseau acquérant par là une autre manifestation humaine, qui dépasse la seule parole.
26Ce que l’on peut également remarquer, plus largement, ce sont les diverses variations qui caractérisent l’eau, laquelle, si on l’écoute bien, est faite de nuances et de reprises, ses différences de débit alimentant ainsi les différences de rythme qui peuvent caractériser une phrase poétique ou une période rhétorique. C’est en ce sens que David Abram voit dans le langage non seulement un « phénomène purement mental », mais aussi « une activité sensuelle, corporelle, née de la réciprocité et la participation charnelles ». De cela découle l’affirmation suivante : « nos manières de parler ont certainement été influencées par bien d’autres gestes, sons et rythmes que ceux de notre seule espèce49. » Par la mention des « sons » et des « rythmes », nous dérivons doucement vers l’univers musical, et rien de surprenant à cela. L’éco-acousticien Jérôme Sueur remarque d’ailleurs que, dès qu’il s’agit de qualifier ou de décrire un environnement sonore naturel, nous avons presque systématiquement recours à « la terminologie musicale tant notre vocabulaire pour les sons de la nature est pauvre et celui pour la musique est riche50 ».
27Roud n’y échappe pas, lui, grand amateur de musique classique, sans cesse attentif aux « thèmes51 » des merles ou au « déroulement rythmique du chant52 » des alouettes. Dans les proses de Roud, l’enveloppement des Umwelten les uns dans les autres s’exprime ainsi, pour une grande part, par les enchevêtrements de plusieurs sources auditives, qui créent des paysages sonores complexes. « L’enclave » par exemple, le texte qui ouvre le recueil Le Repos du cavalier, présente une accumulation de notations auditives simultanées, qui se répondent les unes les autres :
Quand midi sonne à cent clochers, quand le ciel tout entier se fait bronze au battement des cloches profondes, on entend à tous les étages de l’air les oiseaux distincts, la buse là-haut sous les nuages, le geai dans un brusque envol coléreux, le bouvreuil qui a reçu des morts suppliants, pour les défendre de l’oubli, une seule note perce-cœur, une seule, et là tout près, entre la nappe de feuilles mortes et la branche la plus basse tout ailée de feuilles fraîches, un rouge-gorge à l’œil aussi rond que sa voix53.
28Le sujet lyrique compartimente ses perceptions, cherchant à distinguer les différentes voix pour mieux les entendre, comme on peut le faire des instruments d’un orchestre. Et pourtant, c’est bien un entrelacement qui emplit l’air, tant les multiples sons paraissent jouer de concert. En témoigne l’association sonore du pivert et du « bûcheron de mai » : « la serpe aux doigts, il tranche à petits coups, contre-pointés de temps en temps par un pivert au bec vif, les branchages couchés à ses pieds54. » Ce sont précisément ces ensembles que Roud se plaisait à écouter, à relever, et à reconstruire dans ses poèmes. Tim Ingold rappelle d’ailleurs qu’Uexküll lui-même, déjà, dans son texte fondateur, « compar[ait] le monde de la nature à la musique polyphonique, un monde dans lequel la vie de chaque créature équivaut à une mélodie en contrepoint55 ».
Sortir du soliloque, ou comment dialoguer avec le vivant
Des animaux messagers ou prophètes : contre la nature muette
29Il semble même quelquefois que la parole poétique soit une continuation du chant des oiseaux, et inversement. Roud convoque fréquemment l’alouette, en s’inscrivant dans la longue tradition littéraire (étudiée notamment par Bachelard) qui fait de l’alouette un symbole de la poésie. Dans ces moments-là, les « alouettes délirantes », comme Roud les appelle, « donnent une voix, comme le poète, à la jubilation secrète du pays tout entier56 ». À l’inverse, comme on l’a déjà vu, la parole poétique peut s’appuyer sur des réalités naturelles, sur des langages du vivant, pour naître et se déployer. Le meilleur exemple à donner est peut-être issu du roman du Bruno Pellegrino, qui met en scène, de manière fictive donc (mais avec de longues recherches préalables), l’existence quotidienne de Roud. Au milieu d’un passage où il met en scène l’écriture du poète, Pellegrino imagine : « Un passereau lui donne le début d’une phrase, il enchaîne, insère un verbe, mesure ses adjectifs, huile les charnières, compte les temps57. »
30L’attention au monde, chez Roud, peut légitimement être reliée à la création poétique, à condition de ne pas s’en tenir là, puisque les oiseaux jouent dans l’œuvre roudienne un rôle plus important encore : ils sont, selon Roud, les messagers du monde des morts, et plus précisément les messagers des morts aimés, qui cherchent à entrer en contact avec les vivants. Ce qui n’est pas sans rappeler la pratique ancienne de l’ornithomancie, caractérisée de la manière suivante par Marielle Macé :
L’ornithomancie, la divination par les oiseaux, c’était peut-être surtout la pratique d’hommes qui se savaient effectivement voisins d’autres vivants, cohabitants d’un même monde, qui s’en mêlaient, cherchaient, se préoccupaient du ciel, tendaient l’oreille dans/à la forêt, et essayaient d’en faire quelque chose58.
31Or, Roud se mêle de ces chants, puisqu’il fait des oiseaux les messagers des morts. On retrouve cette intuition dans pratiquement tous ses recueils, et l’on peut en suivre pas à pas l’évolution : car peu à peu l’intuition se fait certitude, et elle débouchera sur l’écriture de Requiem, le livre de deuil écrit par Roud plus de trente ans après la mort de sa mère.
32Dans l’intervalle, comme pour le vent, comme pour l’eau, Roud pressent que les oiseaux veulent s’exprimer, veulent dire quelque chose, veulent entrer en contact avec lui, et l’on sent parfois une tension extrême entre la volonté des oiseaux de partager un secret qu’eux seuls détiennent, et le sujet lyrique qui perçoit cette volonté-là mais ne parvient pas à comprendre ce que les messagers s’acharnent à dire. Évidemment, il n’est pas question d’étudier une telle disposition avec les lunettes du « naturalisme » (au sens de Descola), au risque de réduire de tels discours à de vaines et archaïques croyances. Mais il importe néanmoins de se demander dans quelle mesure il n’y a pas, ici, projection, et interprétation illusoire.
33Rappelons à ce propos que Baptiste Morizot, en incitant à traduire « les intraduisibles », insistait aussi sur la nécessité de se confronter à ce qu’il appelait des « malentendus créateurs59 ». Se tromper, ou assumer sa subjectivité et les biais qui l’accompagnent, aboutit parfois à créer quelque chose d’inespéré, ou à découvrir quelque chose d’inexploré – pensons à la sérendipité. De sorte que nous pourrions précisément interpréter cette tentative de Roud comme un potentiel « malentendu créateur » : ce qui ne signifie pas qu’il y ait pure et simple incompréhension, mais plutôt que cette tentative de traduction débouche, dans tous les cas, sur un surplus de sens et de relation. On pourrait presque faire le parallèle avec ces contresens dont parle Proust dans le Contre Sainte-Beuve, quand il déclare : « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu’on fait sont beaux60. »
34Si l’on effectue un transfert de sens (peut-être excessif), et que l’on évoque à présent le livre de la nature, la question suivante jaillit : est-il permis, donc, d’y lire tout ce que l’on veut ? Roud estime que la réponse est négative : avant d’interpréter les signes de telle ou telle manière, et de mettre tel ou tel sens derrière le chant de certains oiseaux, le poète a d’ailleurs parcouru un long chemin existentiel, et il a fallu que se précise en lui la « suprême décantation61 » qu’il évoque dans Requiem. Être traducteur du vivant réclame en cela une responsabilité similaire à celle qui régit la posture du traducteur littéraire : le matériau premier est extérieur à celui qui traduit, lequel doit donc s’acharner à le restituer du mieux possible, au risque de le trahir. En se désolant – comme il le fait souvent – du caractère définitivement intraduisible de toute poésie, et en critiquant sans cesse ses propres traductions, jugées insuffisantes, Roud maintient un haut niveau d’exigence.
35L’acte de traduire implique d’accepter et d’assumer le danger de ne transposer qu’imparfaitement la voix d’autrui ou celle du monde. Et, de fait, le doute est constitutif de l’acte poétique de Roud, lequel remet continuellement en cause ses pouvoirs : de sorte qu’il y a chez lui une forte ambivalence entre, d’un côté, les certitudes métaphysiques qu’apportent le chant de certains oiseaux – et qui culminent par exemple dans le magnifique dialogue avec une hirondelle, dans un passage central de Requiem – et, de l’autre côté, le doute constant, le manque de confiance envers ses propres perceptions et envers ses capacités à traduire puis à transmettre ces perceptions via le langage poétique. D’où une quête sans cesse recommencée, visant à s’approcher toujours plus d’une traduction idéale, qu’elle concerne un texte ou le monde, afin adhérer au réel.
36Il peut d’ailleurs être judicieux de remarquer que cette quête, chez Roud, s’assimile quelque peu avec le « pistage » tel que le décrit Morizot (nécessité d’une certaine « sensibilité » et accès à d’« autres formes de vie ») : « Le pistage, au sens large d’une sensibilité enquêtrice envers le vivant, est une expérience très nette d’accès aux significations et aux communications des autres formes de vie62. » Cependant, la mise en parallèle du couple quête / enquête permet également de saisir les spécificités respectives des démarches de Morizot et de Roud : aux résonnances empiristes qui animent les enquêtes du premier (lequel revendique clairement l’influence de la philosophie pragmatiste), répond la portée spirituelle de la quête menée par le second63. À la recherche méthodique et rationnelle est préférée l’énergie de l’intuition.
37De plus, contrairement à Morizot, les préoccupations de Roud ne se sont pas tournées vers des considérations éthologiques : ce qui l’intéresse n’est pas tellement la manière dont les autres vivants communiquent entre eux, mais bien la manière dont il peut y avoir des communications entre différents Umwelten, entre différents mondes qui à première vue ne communiquent pas ensemble. Or, ce dialogue interspécifique fait signe vers l’une des caractéristiques majeures du chamanisme, mise au jour notamment par Eliade, par exemple quand il écrit : « Apprendre le langage des animaux, en premier lieu celui des oiseaux, équivaut partout dans le monde à connaître les secrets de la Nature et, partant, à être capable de prophétiser64. » La poétique roudienne fait signe à maintes reprises vers le statut de chaman, sans y faire toutefois de référence directe.
38Dans une lettre à Maurice Chappaz, l’un de ses amis-poètes, Roud confesse par exemple :
J’écoutais il y a un instant une fauvette qui a recommencé hier déjà à chanter merveilleusement et j’avais l’impression que chacune de ses notes délicieuses éclatait de vérité, à la fois lourde de sens et intraduisible… Ce chant me rappelle ce que l’on entend en soi devant ces instants privilégiés où la « communication a lieu65 ».
39Chez Roud, il y a donc constamment une tension entre l’évidence d’une signification, et l’impossibilité de la traduire. Et pourtant, on l’a vu, Roud s’y risque : au risque justement de plier un peu le sens, ou d’activer une signification au détriment d’une autre. Dans tous les cas, le poète s’efforce de montrer combien « l’univers entier est perfusé de signes66 », pour reprendre l’expression de Peirce. Il s’efforce aussi de faire honneur à cette profusion de signes, de sens plus ou moins donné, plus ou moins caché, en essayant, comme il le dit, de s’« ouvrir aux signes67 », ce qui passe parfois par une participation sensorielle à la « chair du monde68 », et par une fusion plus ou moins engagée. Le corps, participant de « l’indivision du sentant et du senti69 », est ce qui mène au signe : celui-ci est en effet second, puisqu’il naît des sensations elles-mêmes.
40Pensons en particulier au texte intitulée « Point de vue », dans lequel figure le passage suivant :
Voyez cet homme, dit la rivière, qui ne sait pas quitter son orgueil d’homme en venant à nous, et qui veut comprendre avant que de sentir ! Qu’il se fasse rivière, et il n’essaiera plus d’épeler en vain mon langage. – Qu’il devienne un arbre, dit l’arbre, et il saura ce que disent le vent et la terre, et le poids de cette chaude robe d’or que le soleil nous donne et nous retire au seuil de la nuit ! […] Souviens-t’en : tu ne comprendras rien à quoi tu n’aies d’abord profondément ressemblé70.
41Ce que rappelle ce texte, c’est la nécessité de ne pas s’en tenir à ce que l’on a pu appeler la « conscience objectivante71 », qui ne cesse de séparer le moi et le monde. Au contraire, se lover dans d’autres formes de vie (du moins, là encore : tenter de s’y lover) est un moyen d’aller à leur rencontre, et de ne plus les considérer comme de simples objets extérieurs à connaître et à appréhender par l’intellect, mais comme des sujets à part entière. Ce qui nous amène alors aux fleurs, qui ont passionné Roud tout au long de sa vie, et que nous voudrions aborder par cette notion de « responsivité » annoncée dans notre titre.
Passer du « langage des fleurs » symbolique à la relation responsive
42La « responsivité », concept développé par le sociologue Hartmut Rosa, désigne une forme de relation au monde idéale, « qui se caractérise par le sentiment de pouvoir produire des effets sur un “vis-à-vis”, une entité identifiée comme extérieure et alter, et par la perception d’une réaction de celle-ci en réponse à mon action, qui m’affecte en retour72 ». Récemment, l’historienne de l’art Estelle Zhong Mengual a cherché à adapter cette notion au cadre plus restreint des rapports entretenus par les humains avec le monde vivant. Dans un contexte « naturaliste » par exemple (toujours au sens anthropologique de Descola), on peut avancer que notre relation au monde n’est pas « responsive », dans la mesure où tout ce qui est extérieur et différent est considéré comme incommensurable et éloigné de nous par une différence irréductible sur le plan de l’intériorité73.
43Au contraire, les fleurs, chez Roud, sont constamment approchées d’une manière qui, tout en ne négligeant pas leur évidente différence, insiste également sur les zones de ressemblances qui peuvent déboucher sur un espace de compréhension. Roud parle fréquemment par exemple du « visage74 » des fleurs, de leur « regard75 », de leur qualité de présence qui n’a rien à envier à une présence humaine. Régulièrement, il utilise le pronom « quelqu’un76 », pour désigner les fleurs, qu’il individualise, qu’il regarde une par une – et avec certaines d’entre elles s’élaborent de silencieux dialogues. Ces impressions très fortes, Roud se sent presque obligé de les traduire dans son propre langage, tant il sent que les fleurs lui parlent, et envoient des signes que personne ne s’occupe de recevoir ou de prendre en considération.
44C’est pourquoi renaît chez Roud le désir fou du « langage des fleurs ». Cependant, Roud prend le contrepied de cette tradition « héritée du xixe siècle77 », comme il prend le contrepied du « lyrisme floral », dénoncé déjà par Rimbaud. Claire Jaquier indique d’ailleurs : « Face à cette poésie mièvre et éculée, il arrive à Roud de faire l’éloge du langage rigoureux de la botanique78. » C’est particulièrement vrai dans les textes épars qui forment aujourd’hui la Petite flore, un ensemble qui n’a jamais été publié comme tel du vivant de Roud, mais qu’on peut lire à présent dans les Œuvres complètes.
45Dans ces textes, qui s’attachent au « mystère végétal », et à son « énigme silencieuse, perdue parmi l’immense énigme du créé79 », Roud propose des portraits de fleurs très stimulants, dans le sens où ces portraits ne se fondent pas uniquement sur un « rapport sentimental et symbolique aux plantes », que Zhong Mengual dénonce comme des « simulacres de responsivité », parce qu’il y a bien plus « soliloque » que « dialogue80 ». Elle précise :
Pour qu’il y ait responsivité, il ne suffit pas d’avoir l’impression vague que le monde nous dit quelque chose. Il faut être confronté à un vis-à-vis autonome, « qui est indisponible, qui nous résiste et nous tient tête », ce qui est évidemment absent du rapport poético-symbolique, caractérisé par l’unilatéralité, où je ne reçois en écho que ce que j’ai moi-même projeté dans le monde. C’est un rapport au monde vivant « amputé de moitié » – un rapport au monde vivant sans le monde vivant81.
46Or, le langage que cherche à traduire Roud est précisément un « langage sans “comme”, sans la docilité du symbole82 », ce qui donne des textes extrêmement riches et parfois déroutants, mêlant observation scientifique, méditation poétique et remarque historique. En somme, on peut dire qu’il y a là une relation responsive aux fleurs puisqu’elles ne sont pas appréhendées comme de simples symboles ou de simples espaces de projection commode (comme une page blanche prête à recevoir une intériorité) : Roud prend plutôt acte d’une différence fondamentale, d’une altérité, sans chercher à la résoudre – c’est-à-dire l’annuler – mais en essayant au contraire de s’approcher, si peu que ce soit, du mystère de ce type de présence, de cette modalité d’être étrangère.
Conclusion
47Plus largement, on pourrait dire que l’œuvre de Roud est l’une des quelques œuvres qui, au xxe siècle, ont contribué à « déchirer le mythe moderne du mutisme de l’univers83 », pour reprendre une dernière expression de Morizot. À leur manière, et dans leur volonté sans cesse renouvelée d’aller à la rencontre des différents langages du vivant en dépit de leur caractère intraduisible, les proses de Roud incitent à se confronter à l’altérité relative d’autres formes de vie, en cherchant à dépasser l’altérité absolue par quoi on les a souvent résumées. Assumant le risque de mal traduire, Roud traduit quand même, avec les outils dont il dispose, et avec la sensibilité qui est la sienne.
1 Pour un aperçu biographique, on pourra se référer à la publication récente de Daniel Maggetti, Stéphane Pétermann & Claire Jaquier, Gustave Roud. L’univers pluriel de la poésie, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2022.
2 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes Sud, 2020.
3 Gustave Roud, Œuvres complètes, Genève, Zoé, 2022, 4 vol. Les références à cette publication apparaîtront dans le corps du texte. Le numéro de la page sera précédé d’une lettre majuscule renvoyant à l’un des volumes en question : « P » pour les Œuvres poétiques, « C » pour le volume de Critique, « J » pour le Journal 1916-1976 et « T » pour les Traductions. Ici, voir P 1372.
4 Ibid.
5 Trésor de la langue française informatisé, CNRTL, entrée « fait ».
6 Voir par exemple : « La nature (ce mot commode et vague ici par souci de brièveté) […] » (C 827). Ou encore : « disons pour simplifier la “nature” » (Gustave Roud & Jacques Chessex, Correspondance 1953-1976, éd. Stéphane Pétermann, Gollion, Infolio, 2011. Lettre de Roud, datée du 23/07/56, p. 51).
7 T 11.
8 Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, trad. Nicolas Ruwet, Paris, Minuit, 1963, p. 86.
9 T 11. L’expression est de Raphaëlle Lacord.
10 Claire Jaquier, « Gustave Roud traducteur : écriture et signature du texte étranger », dans Approches de l’œuvre de Roud, dir. Doris Jakubec, Lausanne et Carrouge, Association des Amis de Gustave Roud, 1987, p. 45-46.
11 Élisabeth de Fontenay, « D’un silence à l’autre », dans Le grand orchestre des animaux, dir. Gilles Bœuf, Bernie Krause, Hervé Chandès et al., Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2016, p. 48. Les citations suivantes sont issues de la même page.
12 Walter Benjamin, « Sur le langage en général et sur le langage humain », dans Œuvres, Paris, Gallimard, 2000, t. I, p. 157-159.
13 Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Arles Actes Sud, 2018, p. 158-160.
14 Id., Manières d’être vivant, op. cit., p. 20.
15 Id., Sur la piste animale, op. cit., p. 158-160.
16 Id., Manières d’être vivant, op. cit., p. 35.
17 Pierre Hadot, Le Voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature, Paris, Gallimard, 2004, p. 210.
18 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 35.
19 Ibid., p. 60. Morizot retrouve ici des formulations singulièrement proches de celles par lesquelles Barbara Cassin qualifie la notion d’« intraduisible » dans la « Présentation » du Dictionnaire des intraduisibles : « Parler d’intraduisibles n’implique nullement que les termes en question, ou les expressions, les tours syntaxiques et grammaticaux, ne soient pas traduits et ne puissent pas l’être – l’intraduisible, c’est plutôt ce qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire. » Voir Barbara Cassin (dir.), Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Seuil, 2019, p. XVII.
20 Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós, Qui parle ? (Pour les non-humains), Paris, PUF, 2022, p. 257.
21 Voir notamment, sur la question, Bruno Belhoste, Histoire de la science moderne, Paris, Armand Colin, 2016, en particulier le chapitre 5, « Le livre de la nature », p. 133-165. Pour une approche davantage littéraire, on pourra se référer à Thierry Roger, « La lisibilité du monde. Mallarmé et la tradition du liber naturæ », dans Le Retour du comparant. La métaphore à l’épreuve du temps littéraire, dir. Ariane Ferry et Xavier Bonnier, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 333-365. Enfin, pour une synthèse plus globale, on se reportera au livre déjà cité de Pierre Hadot, Le Voile d’Isis.
22 J 81.
23 J 498.
24 P 433.
25 P 1152.
26 P 1168.
27 P 202.
28 Tim Ingold, Marcher avec les dragons, trad. Pierre Madelin, Bruxelles, Zones sensibles, 2013, p. 471.
29 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2015.
30 P 792.
31 Philippe Descola, L’Écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature, Paris, Quæ, 2011, p. 86. Descola caractérise ici l’animisme.
32 Ibid., p. 87. Descola évoque à présent l’analogisme.
33 Empreinte de spiritualité, la poésie de Roud n’entretient cependant qu’un lien distant avec la religion, comme le souligne Stéphane Pétermann : « Si Roud a conservé les mots et les formes propres à l’éducation protestante, il ne retient rien ou presque du contenu théologique qui est au cœur de celle-ci. […] Héritier d’une piété paysanne très caractéristique de la société vaudoise de son temps, Roud entretient un rapport assez éloigné avec la chose religieuse. » Voir l’« Introduction » de Requiem, P 1237-1238.
34 « Mallarmé, qui était tout le passé fut aussi tout l’avenir par ce grand principe qu’il nous enseigne : devant toute chose, se demander : qu’est-ce que cela veut dire ? » Il s’agit ici d’une note de 1913 de Paul Claudel. Voir Œuvres en prose, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 511. Dans ses jeunes années, Roud a été un fervent admirateur et de Mallarmé et de Claudel.
35 P 827.
36 J 482.
37 Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes sud, 2019, p. 34.
38 Adolf Portmann, La Forme animale, trad. Georges Remy, Paris, La Bibliothèque, 2013, p. 43.
39 Bernie Krause, Le Grand Orchestre animal, trad. Thierry Piélat, Paris, Flammarion, 2013, p. 92.
40 Ibid.
41 P 334-335.
42 P 319.
43 David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens, trad. Didier Demorcy et Isabelle Stengers, Paris, La Découverte, 2013, p. 326.
44 Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, Arles, Actes Sud, 2021, p. 85.
45 J 854.
46 P 663.
47 P 1260.
48 Ibid.
49 David Abram, Comment la terre s’est tue, op. cit., p. 113.
50 Jérôme Sueur, Histoire naturelle du silence, Arles, Actes Sud, 2023, p. 108.
51 Georges Nicole et Gustave Roud, Correspondance 1920-1959, Gollion, Infolio, 2009, p. 1198. Lettre de Roud, datée du 19 avril 1957.
52 J 1028-1029.
53 P 1142.
54 P 1143.
55 Tim Ingold, Marcher avec les dragons, op. cit., p. 257. Cf. Jakob von Uexküll, Mondes animaux et monde humain, Paris, Gonthier, 1965, p. 132-137.
56 P 556.
57 Bruno Pellegrino, Là-bas, août est un mois d’automne, Genève, Zoé, 2018, p. 239. Bruno Pellegrino, qui a activement collaboré à l’édition des Œuvres complètes de Gustave Roud, a également reçu de nombreux prix en tant qu’écrivain, notamment pour le roman dont il est question ici – lequel a beaucoup contribué à l’extension du public roudien.
58 Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, Corti, 2022, p. 133.
59 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 35.
60 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, 1987, p. 297-298.
61 P 1273.
62 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 139.
63 Alors que le substantif « enquête » est pratiquement absent de son œuvre, le terme de « quête » irrigue les différents recueils de Roud. On peut notamment citer un passage d’« Hommage. Toute-puissance de la poésie (Scène) », texte qui peut être considéré comme un art poétique : « Comprenez-moi. Saisissez enfin le sens de ma quête infinie ! » (P 657).
64 Mircea Eliade, Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Paris, Payot, 1968, p. 92.
65 Maurice Chappaz et Gustave Roud, Correspondance 1939-1976, Genève, Zoé, 1993, p. 363. Lettre de Roud, datée du 21 juin 1972.
66 Cité par Gabriel Vignola, « Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en littérature », Cygne noir, no 5, 2017, p. 22.
67 P 1387.
68 Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 192.
69 Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, dans Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2010, p. 1595.
70 P 828.
71 Marcel Raymond, « Notes sur les activités mystiques », dans Littérature Histoire Linguistique. Recueil d’études offert à Bernard Gagnebin, Lausanne, L’Âge d’homme, 1973, p. 23.
72 Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, op. cit., p. 94.
73 Par opposition avec ce que Descola appelle la physicalité, c’est-à-dire l’ensemble des « contraintes matérielles systématiques ». Voir L’Écologie des autres, op. cit., p. 94. Le naturalisme se définit alors « par la discontinuité des intériorités entre humains et non-humains et la continuité des physicalités » (ibid., p. 85).
74 P 939.
75 P 1221.
76 P 567.
77 P 920.
78 Ibid.
79 P 946.
80 Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, op. cit., p. 95.
81 Ibid., p. 96.
82 P 937.
83 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 106.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2072.html.
Quelques mots à propos de : François Chanteloup
François Chanteloup est Doctorant à l’Université de Lausanne. Il étudie l’œuvre du poète suisse romand Gustave Roud, à qui il a consacré plusieurs articles. Ses recherches portent principalement sur l’inscription de l’animalité dans les textes poétiques, à la lumière des champs transdisciplinaires récents que sont la zoopoétique et l’écopoétique.
