Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
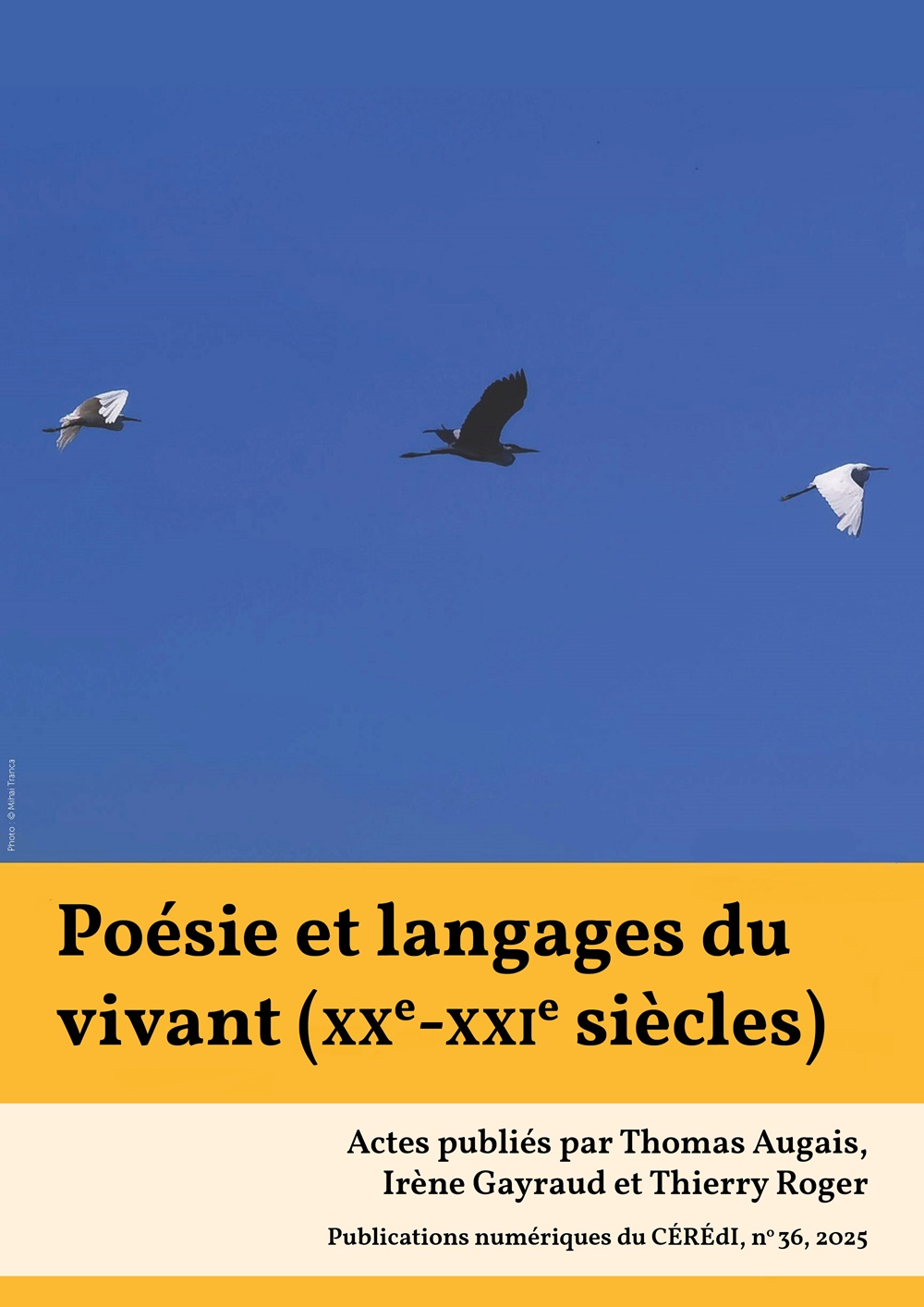
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Les oiseaux, les voyelles et les rivières
Marielle Macé
« alauda
lodola
il ne me reste que toi
dis-moi tes voyelles, à la verticale du mot invisible, je suivrai tes
instructions, les consonnes c’est mon affaire »
Dominique Fourcade, flirt avec elle, 2023.
1Les sons, les mots et les phrases qui servent à parler des oiseaux1 ont des propriétés remarquables, un éclat particulier, une drôlerie, et une force d’animation incomparable. C’est comme si, avec ces voisins singuliers, la langue était mise au défi d’essayer de toucher au vivant, de faire quelque chose avec des vivants pleins de sens, de prendre l’air en se frottant à des états singuliers de vie. En sorte que la question (l’énigme, pour beaucoup d’entre nous) du langage des oiseaux, est prise en charge et redoublée dans nos langues par la manière dont on parle d’eux, qui est singulière, ardente, et qui constitue en fait un territoire très spécifique au sein de chacune des langues.
2Avec les oiseaux (comme avec beaucoup de sujets de la nature) vient d’emblée dans la langue l’évidence de la profusion, le plaisir de la profération et l’emportement de la liste : c’est une sorte de fête verbale, ouverte par eux dans nos propres phrasés. Dans chaque langue les noms d’oiseaux et les noms de chants d’oiseaux sont d’une richesse prodigieuse. Et ça veut dire beaucoup, que les noms et les verbes d’oiseaux engendrent une telle abondance lexicale. C’est déjà un partage de la scène du sens avec eux, une façon de courir après leur propre expressivité, de s’y laisser prendre et de s’y laisser transformer, ranimer.
3L’invention de l’ornithologie moderne a d’ailleurs d’abord été une passion des mots : « un travail de linguistes2 », un savoir né et nourri d’une dépense de parole, attentif à tout ce que les hommes disent des oiseaux, à tout ce que les oiseaux sont capables de faire dire aux hommes qui les côtoient, et qui a poussé les savants à écouter les chasseurs, les paysans, les oiseleurs, à interroger les langues communes, à laisser traverser le savoir par d’autres états de discours, poésie comprise.
4Les oiseaux (nous) nichent aussi dans la parole donc. De cette conviction, l’ornithologie était en quelque sorte la preuve… avant qu’elle ne se transforme en art de la description autonome et de la classification, abandonnant ce lien fondateur à la parole et à sa dépense, à la traduction, à la citation, au désir, à la fable.
|
|
*** |
|
5Ce que les oiseaux font et déposent dans le monde, ce qu’ils nous font, ils le font en effet d’emblée à nos langues, dans nos langues et à nos voix. C’est comme si, par le plaisir et la surprise qu’on a à le tenir dans la bouche, le chant de l’oiseau était déposé, ou relancé, dans la façon dont on parle de lui, au long d’une avalanche de désignations, de verbes, de vers, de traductions, de gloses et de phrases. Ce que les oiseaux ont à dire aujourd’hui qu’ils tombent vient aussi dans ce grand éclaboussement.
6Les noms d’oiseaux sont par exemple si singuliers « qu’on voudrait les traiter comme des noms propres3 » : des noms d’individus à part entière, et dont l’appel saurait les faire paraître. (C’est ce que soutenait Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage : « les noms propres et les noms d’espèces faisant partie du même groupe, il n’existe aucune différence fondamentale entre les deux types4 ».)
7En 1970, Ted Hughes publiait Crow5, « corbeau » en anglais, où le grand oiseau noir ouvrait ses ailes légendaires en clamant effectivement son nom propre. Tout au long du recueil, l’oiseau répète en la formant dans sa gorge toute la noirceur du monde, « hissant le drapeau noir de lui-même ». Les traducteurs de Ted Hughes en français, Jacques Darras et Valérie Rouzeau, n’ont d’ailleurs pas traduit ce nom, et l’ont laissé sonner comme ça dans notre langue, parce que c’est un nom propre justement, mais sans doute aussi parce qu’il va déjà très bien avec le « criaillement », le « croassement » français :
Au commencement fut Cri
Qui engendra Sang
Qui engendra Œil
Qui engendra Peur
Qui engendra Aile
Qui engendra os
Qui engendra granit
Qui engendra violette
[…] Qui engendra Adam
Qui engendra Marie
Qui engendra Dieu
Qui engendra rien
Qui engendra jamais, jamais jamais jamais
Qui engendra Crow le criard
Il réclame du sang des larves des croûtes n’importe quoi
Coude nu tremblant dans la crasse du nid…
8(cr- cr- cr-cr-) : c’est une généalogie infernale, les débuts d’un monde catastrophé et entièrement consonantique que chante « Crow le criard ».
|
|
*** |
|
9Car les mots par lesquels on parle des oiseaux, par lesquels on a des oiseaux plein la bouche, ne sont pas seulement abondants, débordants ; ils ont aussi une forme remarquable.
10Il y a notamment une morphologie particulière aux verbes désignant les chants d’oiseaux, une morphologie particulière dans la langue (une zone, un territoire à part) mais aussi une morphologie particulière à chaque langue (comme si chacune des langues humaines avait rendez-vous avec elle-même, avec ses pentes phonétiques, ses dispositions et ses limites, lorsqu’elle se frotte aux chants d’oiseaux).
11En français, langue faiblement accentuée (pratiquement sans accents à l’échelle du mot), ce sont des redoublements de syllabes qui viennent avec les chants d’oiseaux (et même des redoublements de redoublements, car ces verbes vont souvent à plusieurs, se répondant, se répandant) : le corbeau croasse, coraille, graille, le canard cancane, canquette, la corneille craille, criaille, graille, le coucou coucoue ou coucoule, la poule caquette, cocaille, coclore, codeque, le hibou bouboule, bubule, hue, hulule, miaule, tutube, le pigeon caracoule, roucoule, la huppe pupute ou pulule… Un verbe peut d’ailleurs valoir pour plusieurs espèces, et une espèce appeler plusieurs verbes.
12C’est un vertige de jeux phonétiques, on le voit ; de jeux en effet, c’est-à-dire de joie prise à parler et à se lancer dans la formation et la déformation du lexique, comme on entrerait dans la langue pour la première fois, avec quelques syllabes hésitantes et drôles, modestement combinées : le hibou bouboule, le coucou coucoue, ils bégaient les deux petites composantes phonétiques dont ils disposent, ils proposent leur modeste syllabaire. – Il faudrait d’ailleurs dire ce que les verbes désignant les voix et les cris animaux doivent à la manière dont on les adresse aux petits enfants quand on leur apprend à parler et à se servir de leur propre langue, c’est-à-dire à leur rapport étroit aux formes hypocoristiques.
13C’est en partie une affaire de mimétisme, d’harmonie imitative, pour des verbes souvent construits à partir d’onomatopées. Ainsi le pigeon roucoule, roucoue, caracoule, et c’est comme un passage direct dans la langue du son qu’il produit, tel qu’on l’entend, tel que notre oreille le perçoit, tel que notre système phonétique peut le transposer : rhrhrhrh-lhlh’, khrh-khrh-lhlh’. Dans l’arbitraire du langage, on dirait que les mots-oiseaux ouvrent à un état un petit peu moins arbitraire ; pas forcément lié à une rêverie sur l’origine, mais plutôt à l’appel d’une parole plus riche, plus juste.
14Mais l’idée de mimétisme ne rend pas entièrement compte de cette animation. En français donc les pigeons « roucoulent ». Mais en anglais they coo, en italien tubano6 – l’anglais peut jouer de la longueur des voyelles, l’italien comme souvent du déplacement de l’accent tonique… Et ce n’est pas alors que les pigeons roucoulent en anglais, en italien ou en français, c’est qu’ils font quelque chose à chacune des langues, sollicitent ses ressources phonétiques à elle, ses capacités et ses incapacités, qu’ils les exagèrent, les révèlent aussi. On peut dire que les verbes « vocalisent » les chants d’oiseaux, nous les font passer dans la voix par la langue, et que dans la forme de ces verbes chaque langue règle selon ses caractéristiques phonétiques et morphologiques une sorte de conversation avec les oiseaux.
15C’est d’ailleurs sur la mise au travail de ce genre de propriétés que repose la vraisemblance et l’effet des noms imaginaires. On connaît la gigantesque liste par laquelle Valère Novarina (après Henri Michaux) a conclu l’immense imprécation de son Discours aux animaux :
la limnote, la fuge, l’hypille, le scalaire, le ventisque, le lure, le figile, le lépandre, la galoupe, l’encret, le furiste, le tion, le narcile, l’aulique, la gymnestre, la louse, le drangle, le fugile, le ginel, le tripa, le semelique, le lipode, l’hippiandre, le plaisant, la cadmée, la fuyau, la gruge, l’étran, le plaquin, le dramet, le vocifère, le lèpse, le huseau, la grenette, la galéate, la sorme7…
16Et ainsi de suite pendant de longues pages.
17Ce sont des espèces imaginaires, et des néologismes donc, mais qui sont « construits avec un sens particulièrement raffiné des structures phonologiques, graphiques et grammaticales du français8 ».
18La manière dont nous parlons des oiseaux, ce n’est pas une singerie, un faire-semblant ou une approximation, ce n’est pas non plus un dialogue, autour d’un code commun ; c’est une tentative d’écho : ça montre « comment le langage inscrit dans la voix des hommes l’écho, qui n’est pas la trace, de la manière dont le langage des oiseaux s’inscrit dans leur gosier ». Il y a là quelque chose de l’ordre du contre-don, comme s’il nous fallait répondre à et répondre de la manière dont les oiseaux font, bien mieux que nous sans doute, sonner le monde. Un écho, un répons : notre tribut à ce qu’aura fait leur chant.
|
|
*** |
|
19Et ce rendez-vous des oiseaux avec et dans la langue est accentué en français par une donnée merveilleuse (une chance, une joie de plus) : le mot « oiseau » contient toutes les voyelles ! (Comme « moineau » d’ailleurs, ou comme Boileau). Ponge l’a remarqué9, Jean-Christophe Bailly l’a redit : « en français selon son orthographe étrange […] le mot pour bird, Vogel, uccello, ave ou niao, le mot oiseau contient toutes les voyelles de l’alphabet, ce qui en fait une sorte de chant intégré ou latent10. » (Et Lacan soulignait qu’en allemand, oiseau c’est Vogel, presque voyel.) On peut ajouter, comme me l’a dit Dominique Quelen, grand poète d’oiseaux lui aussi, qu’aucune des voyelles ici ne se prononce « au naturel », toutes reformées, prises dans des formations orthographiques raffinées, et dirigées vers la performance de la parole, prises dans sa réalisation sonore et son événement plastique.
20C’est peut-être l’occasion de repenser à la façon dont la philosophie antique approchait l’énigme des langues d’oiseaux. Dans l’Histoire des animaux Aristote pose la question d’une façon assez particulière : il la construit au plan phonétique, et même de l’appareil phonatoire, c’est-à-dire de la capacité physiologique d’articulation de syllabes (plutôt par exemple qu’au plan des représentations mentales). C’est étonnant, c’est passionnant. Demander si les oiseaux « parlent », ici, ce n’est en effet préjuger ni de ce qui se passe dans leur tête, ni de la précision (ou de l’intérêt) de ce qu’ils se disent entre eux, c’est demander ce qu’ils peuvent former dans la bouche, dans la « gorge », avec la langue et avec le souffle. Le langage, pose Aristote, c’est « l’articulation de la voix par la langue » ; et il l’entend au sens physiologique : l’articulation du flux vocalique par l’organe-langue, c’est-à-dire l’articulation des voyelles par des consonnes – et, de proche en proche, l’articulation des syllabes dans la phrase. Et au sujet des oiseaux, Aristote hésite, il envisage longuement d’accorder aux petits oiseaux chanteurs et aux bêtes qui ont une langue plus large et mobile que les autres, une certaine forme de dialektos, c’est-à-dire de « langage articulé11 ».
21Il y a donc un rendez-vous singulier entre les oiseaux et les voyelles, qui constituent le cœur même de la voix, de la vocalité. D’ailleurs, si Ponge adorait que le mot « oiseau » contienne toutes les voyelles, il ne se satisfaisait pas du « s » central. « Le mot oiseau : il contient toutes les voyelles. Très bien, j’approuve. Mais à la place de l’s, comme seule consonne, j’aurais préféré l’l de l’aile : oileau, ou le v du bréchet, le v des ailes déployées, le v d’avis : oiveau12. » (Le v me plaît aussi à moi, le v de l’avis, l’oiseau latin, qui est aussi le v d’avec ; mais j’aime bien le « s » qui sonne comme un « z », le « z » des zozios.)
22Récemment, Jacques Roubaud a publié un poème-oiseau tout en Z. Le Z, la consonne drôle, la consonne gaie, celle des zozios en effet, des zanimaux, mais aussi du zézaiement enfantin, du pluriel, et encore des bourdonnements de tout ce qui vole, qui fuse et zigue-zague. (En publiant Citizen Do [citoyen do-minique] en 2008, Dominique Fourcade a précisé qu’il lui fallait le dire ainsi, en anglais, citizen, pour éviter le Y de « citoyen » qui arrête le mot et le plante trop droit, au profit du Z qui lance quelque chose devant soi ; et puis, le Z est sans aucun doute aussi, à l’oreille d’aujourd’hui, celle des zones, des Zad, des Zomia, zones sensibles et critiques, le Z qui zèbre bravement les territoires en lutte, agace l’oreille, et n’est pas près de cesser de se faire entendre).
Les Oiseaux dans les zarbres
Zézayent ou s’essayent
S’essayent à zézayer
Dans les zarbr’ leurs zaziles
Les Oiseaux si zabiles
Zabil’s à zézayer
Zabil’s à gazouiller
Les Oiseaux ils zarrivent
Ils arrivent des ziles
Des zuzin’s des zéglizes
Des zindes des zébrides
Zé des ziles marquizes13 […]
23Et Jacques Demarcq précise lui aussi que son travail a, au fond, toujours consisté à rajouter des consonnes aux vocalisations des oiseaux14.
|
|
*** |
|
24Et il y a plus encore ; car en français c’est aussi par les voyelles que les rivières coulent dans la parole. Cela fait sonner dans nos phrases les noces de l’oiseau et des cours d’eau. Les oiseaux, les rivières, les voyelles, voilà qui fait venir dans cette langue-là (et c’est sûr qu’il y a d’autres noces dans d’autres langues) tout un paysage de flots et de rives, un monde poreux d’existences que la parole longe, allonge et où elle verse à son tour.
25Je dis qu’en français c’est aussi par les voyelles que les rivières coulent dans la parole, parce que nos noms de cours d’eaux sont eux aussi une véritable parade vocalique ; pas tout à fait celle, si animée et drôle, des oiseaux : non, une fête à voix basse, dans la douceur de phonèmes amuïs, étirés, liquides, qui jouent à l’eau avec la langue, disparaissent et ressurgissent, comme le courant qui s’enfuit.
26Pourquoi ? Avant toute choses grâce à l’e muet, cette drôle de syllabe, propre à notre langue : car la plupart des noms de rivières en français font entendre cette espèce de syllabe-fantôme, ce demi-silence, cette suspension d’une voyelle dans le souffle qui vide et remplit la voix, et la remplit et la vide et la remplit à nouveau : la Loue, l’Erdre, la Loire, la Sèvre, l’Aube, la Belle, la Prée, la Vie… « Cette peur et cette lumière / ce mi-silence au travers de nous / tout ça le nom de la rivière / à mi-voix le tient suspendu15 ». C’est un poète, Ludovic Janvier, qui le dit, dans un recueil intitulé Des rivières plein la voix.
27Un grand linguiste, le bien nommé Martinet (forcément !) – à qui l’on doit d’ailleurs la théorie de la double articulation qu’Aristote avait préfigurée avec sa théorie des langues ocelles comme empire des voyelles – Martinet, donc écrivait de l’e muet qu’il était un « lubrifiant » phonique16. Et l’e muet, ce n’est vraiment pas rien en français. C’est l’un des pivots de la métrique, c’est ce qui (avec d’autres phénomènes d’élongation ou de condensation des voyelles, la diérèse et la synérèse) ouvre la possibilité du vers compté. La langue française est faiblement accentuée, encore une fois, et la possibilité métrique n’y repose donc pas essentiellement sur une répartition des accents, mais sur le décompte des syllabes, on l’a appris à l’école. En sorte que la logique du vers français17 repose en partie sur cette particularité phonologique du e muet et sur « la liberté […] qu’il introduit dans la prosodie », ouvrant une brèche entre l’œil et le souffle, entre le vers écrit et la prononciation ; une patience, une coulée, une suspension qui jazze la langue. – Mallarmé : « J’ai toujours pensé que l’e muet était un moyen fondamental du vers18. »
28L’eau n’est jamais loin quand les oiseaux surviennent, ni les oiseaux quand c’est l’eau qui serpente dans le paysage. Cette fraternité des oiseaux et des rivières, en français, inscrit donc son évidence et sa vigueur à même la langue, et dans les voyelles de la langue fait venir avec les oiseaux tout le « pays », tout un paysage de rivières, un monde sensible de choses et d’existences que la parole longe et où elle verse à son tour.
29Je cite Ludovic Janvier, c’est :
le nom d’un paysage entre les règnes
où la parole chante entourée d’eau
les rivières s’appellent par les vols d’oiseaux19
30Génial Ludovic Janvier donc qui dit qu’en français parler réclame une rivière et trouve une rivière appelée par les oiseaux. Il est rejoint par Jacques Darras, qui compose un fantastique cycle de la Maye, au gros débit, et qui écrit ici son « tribut à l’Oise » (l’Oise évidemment, l’Oise-eau).
J’aime l’Oise.
La rivière Oise.
J’aime les rivières dont le nom est fait de voyelles.
Avez-vous déjà remarqué comme les rivières françaises étaient voyelles.
Toutes voyelles.
Comme si le temps se solidifiait liquide en elles.
Comme s’il se solubilisait en terre fluide identifiable.
Cheminant suivant les pentes propices de la géographie.
Comme s’il allait lui-même à l’eau.
À la mer océane.
Par la fluidité des voyelles qui sont dans nos bouches.
Les voyelles.
Salives solubles.
Salées, à peine.
Prenons l’Eure.
L’Eure est un exemple d’évidence presque trop facile.
Le nom de l’Eure coule de source.
L’Eure est une rivière tout en e muets20 […]
31Noms d’oiseaux et noms de rivière versent ainsi les uns dans les autres, comme la preuve d’un compagnonnage ; mieux, comme la proclamation éloquente (et douce) de tout un milieu. Un milieu : une histoire de réussite, des êtres qui ont su vivre les uns avec les autres, auprès des autres, par les autres. Encore une preuve : « l’Aronde, affluent de l’Oise qui arrose un village où, par oisiveté ! je me suis laissé prendre au spectacle des hirondelles, tire son nom du celtique ara, l’eau, nullement du latin hirundo21 ».
|
|
*** |
|
32Jean-Christophe Bailly a intitulé L’Oiseau Nyiro un bestiaire poétique des animaux menacés. L’oiseau « Nyiro » pourtant n’existe pas. « Mais lorsqu’on entend pour la première fois le nom de la rivière qui traverse la rivière de Samburu et qui s’appelle l’Uaso Nyiro, on pense à lui. » On pense à lui, on le rêve, il se prouve. De la rivière découle l’oiseau imaginaire. Et dans cet oiseau-rivière inexistant, « détruit » peut-être, se survivent déjà les animaux bien réels qui continuent d’exister mais qui sont appelés à s’éteindre, et qui raniment déjà un peu en lui leur souvenir – comme si l’oiseau Nyrio était, avant l’heure et tout en attachements fantastiques, à lui seul, l’arche vibrante de ces espèces en danger22.
|
|
*** |
|
33Les oiseaux, leur beauté, leur merveille, on y est donc aussi attachés par la langue. Mais voilà que les voyelles se taisent. La disparition ou même simplement la méconnaissance du chant des oiseaux est la mesure sonore de ce qui arrive à notre environnement tout entier : de ce qui nous arrive.
34Je crois que le poème est là pour soutenir l’audace de ce rendez-vous entre les oiseaux et notre parole, pour contester la perte, maintenir le lien en langue, souligner, exagérer, démultiplier, entretenir la façon dont les oiseaux occupent notre propre voix et la raniment. Il n’est pas là pour penser le mystère propre à la langue des oiseaux, mais pour dire leur façon d’habiter si vivement la nôtre, d’y faire des choses, d’y changer quelque chose. La poésie n’est ni zoologue, ni sémiologue ; elle est zoophile, biophile, sémiophile, logophile, écouteuse, audacieuse, exagérante… Elle fait en sorte que les choses du monde (qui le font déjà) continuent d’éclabousser notre parole, y fassent leurs phrases-vies, avec et dans les nôtres. De ce point de vue, les oiseaux sont un peu aussi à l’abri dans nos langues, « à couvert23 » dans notre parole : ou plutôt ils peuvent l’être, si l’on s’en donne la peine – si l’exercice de la parole prend sa part d’une écologie des liens et des subsistances.
1 Cet article reprend en grande partie, et poursuit, des réflexions précédemment développées dans : Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, José Corti, coll. « Biophilia », 2022.
2 Michel Jourde, La Voix des oiseaux et l’Éloquence des hommes. Sens et fonction des manifestations sonores de l’oiseau dans la littérature française des xvie et xviie siècles, Thèse, Université Bordeaux III, 1998, p. 65.
3 Martin Rueff, « Des oiseaux, qu’ils reviennent », Po&sie, nos 167-168(1), p. 7-34.
4 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.
5 Ted Hugues, « Crow », dans Poèmes 1957-1994, trad. Jacques Darras et Valérie Rouzeau, Paris, Gallimard, 2009.
6 Je dois ces exemples à Martin Rueff, « Des oiseaux, qu’ils reviennent », art. cité.
7 Valère Novarina, Le Discours aux animaux, Paris, POL, 1987, p. 321.
8 Michel Arrivé, « Pour un dialogue avec Valère Novarina, à propos de giromitres, de centaures et de quelques autres objets »,dans Mélanges en l’honneur de Ivanka Popova-Veleva, Ivis, Université de Veliko-Tarnovo, 2013, p. 261-273.
9 Francis Ponge, « Notes prises pour un oiseau » [1938], repris dans La Rage de l’expression, Paris, Poésie/Gallimard, 1976.
10 Jean-Christophe Bailly, Éric Poitevin, Le Puis des oiseaux, Paris, Le Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2016.
11 Voir notamment : Jean-Louis Labarrière, Langage, vie politique et mouvement des animaux, Paris, Vrin, coll. « Études aristotéliciennes », 2004 ; et « Aristote, Martinet et Madame Rossignol », Po&sie, vol. 167-168, nos 1-2, 2019, p. 53-62.
12 Francis Ponge, « Notes prises pour un oiseau », op. cit.
13 Jacques Roubaud, « Les oiseaux chantent », Po&sie, vol. 167-168, nos 1-2, 2019, p. 266-267.
14 Jacques Demarcq, La Vie volatile, Caen, NOUS, 2020.
15 Ludovic Janvier, Des rivières plein la voix (Promenade), Paris, Gallimard, coll. « L’arbalète », 2004.
16 André Martinet, La Description phonologique, avec application au parler franco-provençal d’Hauteville (Savoie), Genève / Paris, Droz / Minard, 1956.
17 Voir Le Vers français. Histoire, théorie, esthétique, textes réunis par Michel Murat, Paris, Honoré Champion, 2000.
18 « Lettre à C. Mauclair », voir Mallarmé chez lui, Paris, Grasset, 1935, p. 113.
19 Ludovic Janvier, Des rivières plein la voix, op. cit., p. 97.
20 Jacques Darras, L’Indiscipline de l’eau. Anthologie personnelle 1988-2012, Paris, Gallimard, coll. « Poésie/Gallimard », 2016, p. 191.
21 Jacques Demarcq, Les Zozios, Caen, NOUS, 2008, p. 26.
22 Jean-Christophe Bailly, L’Oiseau Nyiro, Genève, La Dogana, 1999, n. p.
23 L’oiseau est « à couvert sous les phrases, qui vous le font voir, qui vous font le voir, et le voir lui », pose Dominique Meens (Mes langues ocelles, Paris, POL, 2016).
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2110.html.
Quelques mots à propos de : Marielle Macé
EHESS
CNRS
Marielle Macé est Directrice de recherches au CNRS, Directrice d’étude à l’EHESS, et écrivaine. Ses livres portent sur les relations entre les formes littéraires et les formes de la vie dans la période moderne et contemporaine.
Elle a publié notamment : Façons de lire, manières d’être (Gallimard, 2011, rééd. TEL 2022), Styles. Critique de nos formes de vie (Gallimard, 2016), Sidérer, considérer. Migrants en France (Verdier, 2017), Nos cabanes (Verdier, 2019), Une pluie d’oiseaux (José Corti, 2022), et Respire (Verdier, 2023).
