Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
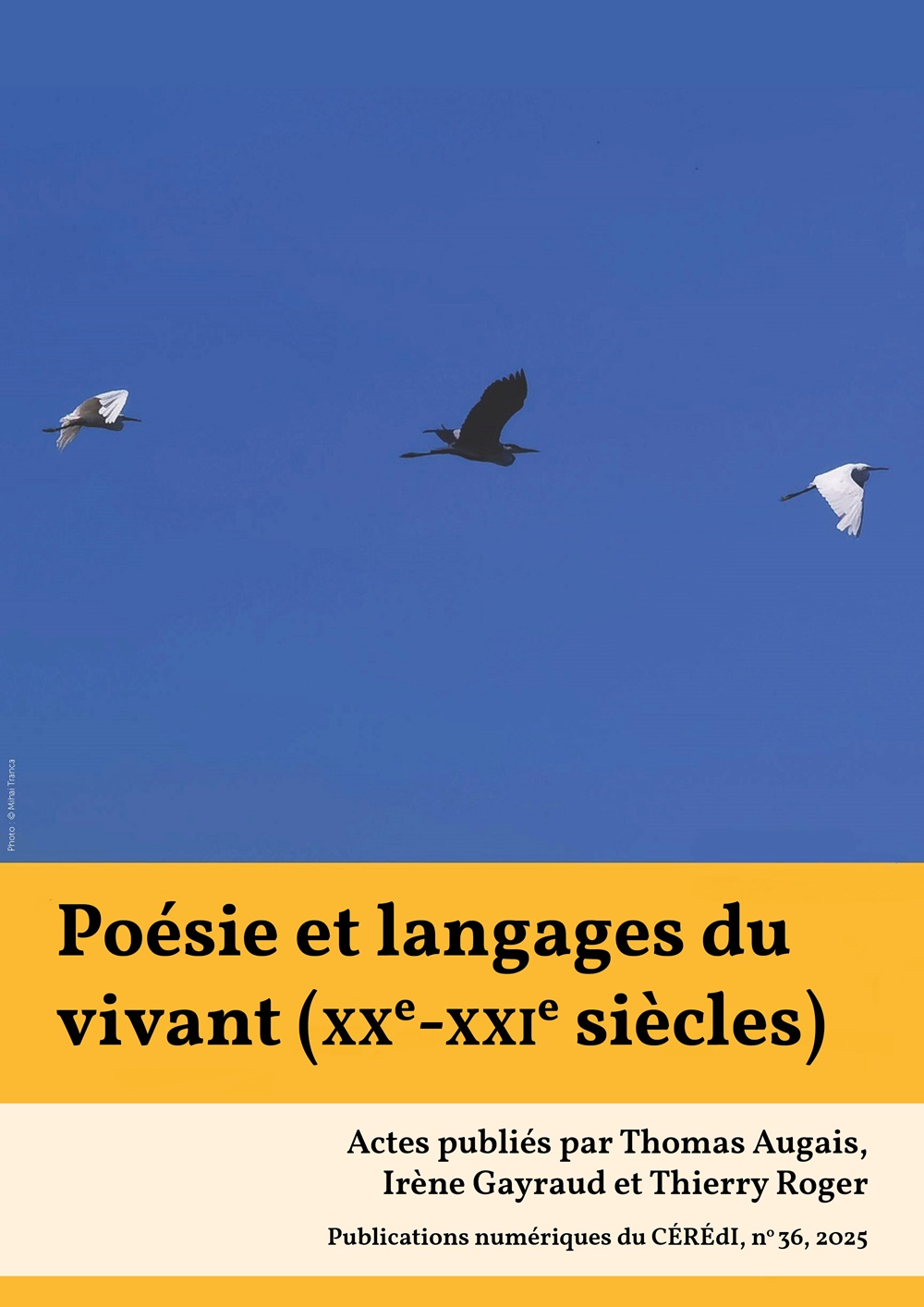
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Poésie prédatrice ?
Marik Froidefond
1« J’ai vu ça et un ours s’est coincé dans ma tête1 » : c’est en ces termes que Greta Thunberg relate comment, après avoir vu un documentaire sur la fonte des glaciers perturbant le milieu de l’ours polaire, son combat écologique a commencé. À l’origine de la présente réflexion sur les grands prédateurs en poésie, il y a, sinon un ours « coincé » dans la tête, en tout cas l’intuition qu’un vaste corpus de poèmes émanant de langues et d’aires géographiques et culturelles extrêmement diverses devrait exister, et pourrait composer une poésie des pelages, des allures et des cris (toutes ces formes animales2 qui modèlent un territoire et s’imbriquent en une « immense pelote échevelée du vivant3 » comme dirait Jean-Christophe Bailly, formes animales dont Maurice Merleau-Ponty, grand lecteur d’Adolf Portmann, dit bien à quel point elles peuvent inspirer l’art4), tout autant qu’une poésie des serres, des griffes et des crocs. À cette intuition d’un vaste répertoire d’exemples permettant de croiser poésies occidentales et poésies autochtones, s’ajoute l’intuition qu’en entrant dans le poème, ces animaux auraient la capacité d’en bouleverser férocement la forme et la langue, que ce soit par les rythmiques fauves et les élancements carnassiers transcrits dans le vers, le triple rouleau du grand crocodile marin noyant sa proie, le piqué de l’aigle, le pas élastique et patient de la panthère, l’enroulement du boa constricteur, le grognement de l’ours ou le feulement et la robe tachetée du guépard – autant de langages du vivant donc, de styles et de phrasés pour reprendre la proposition stimulante de Marielle Macé5, informant le rythme du poème, sa syntaxe, sa matière sonore ou sa forme. Suppositions cependant imprudentes. Une première exploration d’anthologies de poésie européennes et américaines, mais également africaines, amérindiennes, sibériennes, aborigènes et de maintes revues d’ethnopoésie s’avère en effet étonnamment déceptive : rien ou presque, pas l’ombre d’un tigre, d’un requin, à peine une trace de loup, de jaguar ou de coyote rôdant dans ces poèmes.
2Le constat est un peu désarçonnant. Les grands prédateurs seraient-ils des tricksters ? C’est-à-dire des rusés, des fripons, des « décepteurs », qui hantent nos imaginaires, nous fascinent et nous effraient, mais qui se cachent quand on les cherche, qui s’esquivent et disparaissent, y compris des textes, quand on les y traque ? A trickster : à la suite de Levi-Strauss6 et des anthropologues américains, c’est ce terme qu’utilise la philosophe écologiste Val Plumwood7, qui, en 1985, a survécu contre toute probabilité à une attaque de crocodile marin, un des plus grands prédateurs de l’homme, alors qu’elle faisait du canoë en Australie. Avec ce mot, elle rappelle que dans les récits mythologiques d’aborigènes australiens et des Égyptiens de l’Antiquité, le crocodile juge sévèrement la prétention des êtres humains à dominer le monde, et en particulier à se croire en dehors de la chaîne alimentaire. Val Plumwood a raconté cette expérience dans Dans l’œil du crocodile, récit de sa survie à partir duquel elle développe une réflexion plus large sur le sens des vies humaines prises dans la biomasse. Un récit-essai donc, auquel fait écho à bien des égards celui de Nastassja Martin, Croire aux fauves (Verticales, 2019), écrit après sa rencontre avec un ours dans le Kamtchatka. On pourrait ajouter quelques exemples du même acabit. Mais ces exemples sont peu nombreux, et ce pour une raison contondante : si pour un grand nombre d’animaux, « vivre, en effet c’est […] traverser le visible en s’y cachant8 », cette manière d’habiter le territoire en se dissimulant au regard concerne particulièrement les grands prédateurs. Ces « animaux mangeurs d’homme9 », on ne les voit pas, on ne les rencontre pas, « les cercles d’effroi et d’agressivité sont si serrés qu’il n’est guère possible de les franchir 10», à moins de faire preuve de témérité et d’oublier impudemment qu’on fait partie de la chaine alimentaire. Si Val Plumwood a survécu, c’est parce qu’au lieu de céder à la terreur, elle a arrêté de se débattre et s’est laissé filer, immobile, dans le courant – acte de « courage diplomatique11 » qui l’a poussée, selon Baptiste Morizot, à « envisager les enjeux de sa propre dévoration » au lieu de laisser « la peur réagir par l’agression aveugle ».
3Cela ne veut pas dire qu’hormis ces quelques récits de survie et les grandes fictions épiques du xixe siècle comme Moby Dick ou Les Travailleurs de la mer, il n’existe aucun texte ni poème qui évoque les grands prédateurs. Des textes existent mais ils évoquent plutôt des non-rencontres. C’est le cas d’abord des mythes ou des fables qui mettent en scène et en mots des lions, tigres, ours ou crocodiles. Ces mythes sont innombrables dans les littératures autochtones, mais ils sont surtout le lieu de projections symboliques et allégoriques pour parler des humains ou des divinités, bien plus que des animaux : « toujours un discours de l’homme, sur l’homme12 » et « pour l’homme » résume Derrida qui se méfiait des fables dans lesquelles il voyait un « apprivoisement anthropomorphique » et une « domestication » des animaux. Non-rencontre aussi si on pense aux textes qui évoquent la présence invisible de ces bêtes à travers les traces qu’elles laissent sur le territoire (empreintes de pas, de griffes, restes de proies). « Je laisse mes traces / sur tous les chemins / mais nul n’ose me suivre. / J’ai tué / le chasseur maladroit, / détruit des récoltes, / dévoré des enfants / et le sein de leurs mères 13» : dans ce « chant du jaguar » guarani, la présence du félin est d’autant plus terrifiante qu’il reste invisible et qu’on ne trouve de lui que des traces de son carnage. C’est aussi le cas dans les pages d’Aldo Leopold sur le grizzli : « personne n’avait jamais vu le vieil ours, mais par les printemps boueux on pouvait voir ses incroyables traces au pied des rochers […] sa personnalité dominait tout le paysage. […] J’eus l’occasion de voir un jour l’une de ses victimes. La tête et l’encolure de la vache étaient réduites en bouillie14 ». La même omniprésence invisible du jaguar fait frémir : « Nous n’en vîmes jamais le bout de la queue, mais sa personnalité dominait le paysage ; aucun animal vivant n’oubliait la possibilité de sa présence car le prix de la négligence était la mort. […] [S]es griffes étaient capables de tuer un bœuf et ses crocs de cisailler l’os comme une guillotine ». Dans les deux cas, Leopold déplore ensuite la disparition du grand prédateur et la perte irrémédiable pour l’écosystème. Selon Morizot, « la pulsion d’élimination des superprédateurs15 » résulte en partie d’un « tabou » qui consiste à « interdire et minimiser toutes les conditions par lesquelles nous serions de la biomasse à disposition des autres ». Si ce tabou vaut surtout pour la culture occidentale (« le fait d’être mangé ne déclench[ant] pas les mêmes psychoses » dans d’autres ontologies, « la terreur à l’égard du fait d’être consommé n’est donc pas universelle »), les grands prédateurs n’ont pas pour autant été épargnés dans les autres cultures. Avant même le réchauffement climatique, le braconnage, organisé ou clandestin, est une première raison factuelle qui explique aussi son effacement progressif des poésies autochtones. Dans les poésies occidentales, c’est également sous le signe de la non-rencontre que le prédateur observé dans une réserve, un cirque ou un zoo16 est évoqué, comme la panthère du poème de Rilke (« Der Panther ») au regard « lassé » (« müd ») et hagard derrière ses barreaux du Jardin des plantes17, qui rappelle celui des lions en cage peints en 1967 par Gilles Aillaud, « malheureuse image / Des rois chus lamentablement18 » qu’évoquait déjà Apollinaire dans son Bestiaire en 1911. Si les cages n’empêchent pas complètement les artistes de recueillir et restituer quelque chose du « style » félin (le vers de Rilke « Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte » s’efforce par exemple de transcrire la démarche souple et languide de la panthère), cela reste limité (comment dire la puissance nerveuse et bondissante de cet animal quand il vit dans un état carcéral qui l’en prive ?). Réserve, cirque et zoo ne reviennent certes pas au même, mais même dans une réserve, où les animaux évoluent dans les conditions les plus proches de l’état sauvage, l’humain qui s’y aventure ne les rencontre pas.
4C’est ce qu’explique très bien Gérard Wacjman dans son essai Les Animaux nous traitent mal écrit après une rencontre avec trois lionnes dans une réserve africaine, ou justement plutôt une « non-rencontre19 », comme il le dit explicitement, qu’il a pris comme une gifle lorsqu’il s’est rendu compte que ces trois lionnes cherchées durant des heures dans la savane, ne jetaient même pas un regard au groupe de touristes arrivé en pétaradant : « comme si nous n’existions pas. […] Un dur désenchantement. Rencontre du type zéro20. » Elles regardent « ailleurs, tendues fixement vers un point lointain de l’espace […] ». Cette indifférence totale conduit Wacjman à s’interroger sur notre « passion de voir les animaux21 », ces raisons pour lesquelles leur monde nous attire, nous fascine, nous qui avons « mis le monde sous surveillance22 » et voulons être les « sentinelles de la terre », mais qui devons bien admettre que regarder ces animaux est le « seul pouvoir qui nous reste sur eux », quand nous sommes pour eux « un objet d’indifférence quand [l’animal] est rassasié23 ». Nous cherchons à enregistrer le chant des orques, à comprendre les parades amoureuses des pumas, nous réalisons des documentaires, des études scientifiques poussées, à « inventer toutes sortes de dispositifs […] pour regarder les animaux24 », mais ces bêtes regardent ailleurs. « Plus la passion écologique nous prend, plus la profonde indifférence des bêtes nous chagrine. Il y a du dépit amoureux là-dessous. On s’enivre d’amour pour les bêtes parce qu’en vérité nous aimerions qu’elles nous aiment25 », souligne Wacjman. « Faute de nous aimer, nous aimerions au moins que les animaux nous craignent, au moins un peu26. » Mais là encore c’est un leurre. En vérité, si les animaux vulnérables restent rarement indifférents aux êtres humains et modifient leur comportement à leur voisinage, les grands prédateurs, quant à eux, ne nous regardent pas « avec plus de crainte que si nous étions un troupeau de bousiers ou une giclée de poussière ». C’est-à-dire qu’ils plissent simplement les yeux pour regarder ailleurs.
5L’indifférence des grands prédateurs à notre endroit provoquerait donc notre « dépit amoureux » ? Cette hypothèse fait d’abord sursauter et sourire. Puis elle semble, à la réflexion, de plus en plus convaincante. De l’amour à la volonté de domination, la frontière est parfois bien mince. Au même titre que tous les « dispositifs » que nous inventons pour observer, filmer, enregistrer les bêtes, leur consacrer des poèmes est peut-être aussi une façon de nous enivrer d’amour pour elles, d’attendre un regard en retour, et d’« essayer de prendre un peu de pouvoir sur cette engeance orgueilleuse27 ». Quand cela échoue, quand les bêtes font les « belles indifférentes », que nous ne pouvons pas les rencontrer pour « prendre pouvoir sur elles » (à moins de finir dans leur gueule), alors, par impuissance ou dépit amoureux peut-être, nous tournons le regard. Puisque « nous ne sommes pas dignes de leur regard », puisque « en vérité, les bêtes nous traitent mal », autant nous taire. Ou nous contenter d’utiliser leur nom, comme Python pour désigner un langage informatique. On peut voir dans ce dépit une explication, ou l’hypothèse d’une explication, du constat déceptif lié à l’absence presque totale des grands prédateurs (ces tricksters, ces « décepteurs ») dans la poésie.
6Hormis les quelques récits de survie et les textes qui évoquent les restes de leurs proies en bouillie, des poèmes ont bien sûr été écrits sur ces bêtes : le xixe siècle a tout de même la luxuriance d’une jungle où se côtoient le tigre de Blake, le lion de Sully Prudhomme, le jaguar de Leconte de Lisle, le fauve d’Heredia – autant de poèmes qui charrient les fantasmes de l’exotisme colonial. Mais dans tous ces cas, les poèmes parlent moins de la bête considérée pour elle-même que des fantasmes ou de la terreur qu’elle inspire quand elle fait de l’homme sa proie. C’est aussi le cas, malgré le grand écart culturel extrême, dans certains chants et mythes autochtones qui font la part belle aux prédateurs et peuvent être appréhendés comme des rituels d’apprivoisement, selon Charles Stépanoff. Dans Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l’humain (La Découverte, 2024), l’anthropologue développe des réflexions très intéressantes sur cette notion et sur la façon dont les rêves du chasseur peuvent ainsi préluder à la rencontre avec l’animal chassé (parfois un jaguar ou un autre grand prédateur) : il est possible « que l’exploration mentale des mondes des animaux sauvages par le rêve, l’imagination et le rituel ait encouragé et facilité les expériences d’intersubjectivité que constituent les apprivoisements28 ». Certains chants et mythes autochtones pourraient être analysés de cette façon, comme prélude à la rencontre, dans une perspective propitiatoire29. Citant Carlos Fausto (« les rêves sont une île de domesticité dans un océan de prédation30 »), Stépanoff commente : « sur cette île, il est possible de faire d’un jaguar son ami. Dans l’histoire humaine, les adoptions d’animaux nourris matériellement et celles de chimères oniriques soignées rituellement se sont probablement alimentées et enrichies réciproquement31. » En dehors des chants de chasse, c’est surtout dans les chants chamaniques que les grands prédateurs sont évoqués : comme l’explique Stépanoff, l’apprivoisement des animaux sauvages « apparaît clairement comme un modèle de relation aux esprits », que ce soit en Sibérie, où les « esprits-maîtres sont souvent représentés chevauchant des animaux sauvages comme des tigres », « les esprits du ou de la chamane appart[enant] comme les animaux sauvages au monde non humanisé », ou en Amazonie où « les chamanes achuar […] revendiquent comme animaux apprivoisés des anacondas et des jaguars noirs qui sont beaucoup trop dangereux pour qu’on leur offre effectivement l’hospitalité dans les villages indiens » : « le chamanisme accomplit un apprivoisement de l’impossible, un prolongement rêvé des apprivoisements accomplis au village. » Ces analyses disent à quel point ces évocations des grands prédateurs, que ce soit dans les chants et les mythes autochtones ou dans les poèmes européens, parlent davantage des fantasmes de peur ou de domestication qu’ils inspirent que de ces animaux eux-mêmes.
7Avec les bêtes, d’une certaine façon, ce serait elles ou nous. On est fasciné par elles, on traque leur regard par maints dispositifs en espérant désespérément que cette attention soit réciproque (« Ah que baleine (me) pense32 ! » s’exclame Fabienne Raphoz dans Blanche baleine). Mais quand on comprend qu’il n’en est rien ou qu’on ne peut pas avoir la mainmise sur elles, que l’apprivoisement est impossible, alors la confrontation avec ces bêtes – ces bêtes elles-mêmes, dans leur littéralité, dépouillées de leurs vêtements allégoriques – devient impossible (au sens que Bataille donnait à ce mot dans « Histoire de rats33 »), l’écriture est coupée.
8Est-ce à dire que, sortis du fantasme colonial, il ne serait pas possible d’écrire de poème sur les prédateurs de l’homme ? Voire (si c’est eux ou nous), que l’écriture poétique serait une sorte de prédation, ou d’équivalent sublimé de la prédation (ou du moins de la domination, comme on a pu dire que la peinture pariétale des tigres aux dents de sabre était une façon de les figer sur la paroi des grottes et, par le dessin, d’annuler ou de s’approprier leurs forces ? « Par la figuration des animaux quelque chose est soustrait de la violence […] l’image prend la violence […] puis elle la dépose […] dans l’accalmie [et] le noir revenu de la grotte34 » écrit Jean-Christophe Bailly dans Le Versant animal. Une transmutation de forces du même ordre se jouerait peut-être dans l’écriture poétique. Pierre-Henri Castel, dans Le Mal qui vient, explique que dans ce « temps de la fin35 » qui serait le nôtre, où il ne semble pas possible de mener une « paisible vie profonde » en alliance avec la nature, il nous resterait quelques ultimes offensives à mener : il faudrait pour cela avoir « des crocs et des griffes » et « travailler à se rendre inintimidables », ce qui n’est possible selon lui que si on s’emploie à redonner sens à la « vitalité pulsionnelle » plutôt qu’à l’étouffer, et à avoir parfois un « recours froid, ferme, et réfléchi, à la violence ». Peut-être est-ce cela qui se joue dans ce qui nous occupe : une « vitalité pulsionnelle », à crocs et à griffes, parfois violente, dont la poésie s’armerait, mais à l’égard seulement des animaux sur lesquels l’humain a l’ascendant.
9En effet, s’il n’y a pas ou peu de poèmes sur les grands prédateurs, le regard des poètes se porte en revanche volontiers sur les prédateurs plus petits qui ne peuvent pas dévorer les humains et qu’on peut regarder à loisir : aigles, condors, faucons traversent ainsi régulièrement la poésie du xxe siècle et sont montrés dans l’exercice de leur puissance, comme dans le poème de Georges Oppen où le faucon tient dans ses serres une petite bête pantelante, brisée36, ou celui de Raymond Carver où un « aigle » remonte du canyon avec une morue de cinquante centimètres entre ses serres, rappelant aux hommes « un ordre des choses ancien et plus féroce37 ». Nombreux sont aussi les poèmes consacrés aux hiboux et aux coyotes, dans la poésie amérindienne notamment. Ainsi cette « chanson pour la danse du coyote » : « Le museau contre la terre / le coyote chante sa chanson, / il tourne et tourne / quand il a faim, / il scrute le paysage, […] / Le coyote cherche, cherche / un lièvre quand il a faim ; / puis il saute, danse, crie, chante. » Sans parler des plus petits encore, les micro-prédateurs, qui prolifèrent dans la poésie occidentale moderne et contemporaine : araignées, serpents, guêpes, moustiques, mangoustes, cobras ou lombrics qui « mâche[nt], digère[nt] et fore[nt]38 », comme ceux que Jacques Roubaud évoque dans son bestiaire, ou que Françoise Raphoz « écoute […] remuer39 » dans ce qui grouille sous terre. Ces animaux attirent et font frémir, mais l’inquiétude reste maîtrisée : l’homme peut observer et exercer un ascendant sur ces micro-prédateurs sans trop de difficulté ; le poème est possible, il peut bien s’imaginer « finir / en pelote / de réjection / au pied / du pin40 », cela reste fantasmatique.
10Bien plus nombreux encore sont cependant les poèmes consacrés non pas aux petits prédateurs, mais aux animaux considérés comme des proies par l’homme. Proies réelles d’abord – ces animaux que l’homme tue pour les manger : ainsi « la couleuvre d’eau » de Roubaud, qu’on « attrape sans façons / dans le ruisseau qui remue » (« ton sang bat sous ta peau nue / ton cou gonfle d’indignation / quand t’emmènent les garçons / vers le village41. »), ou bien l’huître, l’escargot ou la crevette, pour s’en tenir aux trois animaux du Parti pris des choses. Si Ponge, dans ces poèmes, insiste sur la leçon de beauté que ces animaux, par leur forme, peuvent nous délivrer, dans les trois cas, il ajoute que ces animaux sont comestibles pour l’homme : gibier au sens propre, mais aussi plus largement « farouche gibier de contemplation42 », qu’il faut « évoquer avec précaution » jusqu’à « l’atteindre enfin par la parole au point dialectique où se situent sa forme et son milieu ». De la proie réelle à la proie symbolique, le glissement pointé par Ponge est crucial pour notre propos : l’écriture serait donc une chasse, et le poète un chasseur, ou un « poète-pécheur » qui traque l’anguille (comme dit Roubaud43) ou l’esturgeon « avec ses barbillons qui pendent44 » et « ses grosses lèvres somnolentes » (comme celui dont le ferrage monstrueux est décrit par Carver, si gros que les hommes qui le ferrent doivent atteler des chevaux qui restent un moment « cloués sur place »). Gibier, poisson ou encore bétail auquel les poètes consacrent régulièrement des textes – par exemple les « bœufs ruminant leurs psaumes45 » « de la voix la plus puissante et la plus basse jamais entendue » utilisés comme comparants des moines dans Pensées sous les nuages de Philippe Jaccottet, bœufs à la plénitude compacte, patiente, farouche, déployant comme une « basse continue46 » sur le paysage, dont parle Jean-Christophe Bailly dans Le Dépaysement, qui rappelle celle du veau décrit avec tant d’empathie par Karl Moritz dans « Anton Reiser », comme si toutes ces bêtes oubliaient l’abattoir auxquelles elles sont destinées47. La douceur qui entoure ces bêtes, souligne Jean-Christophe Bailly avec justesse, « s’inscrit sur » un fond de « violence : “être sous la main de l’homme” aura été le plus souvent pour les bêtes une épreuve48 ». On pense, à l’extrême, au poème de Ponge « Le morceau de viande » (Le Parti pris des choses) et au « Pitié pour la viande ! » de Deleuze à propos de Bacon : « la viande n’est pas une chair morte, elle a gardé toutes les souffrances49 », elle « est la zone commune entre l’homme et la bête, leur zone d’indiscernabilité ». On comprend dès lors que si la poésie n’arrive pas bien à parler des grands prédateurs, c’est sans doute parce qu’elle est prise elle-même par une pulsion prédatrice, mais que cette tension vers cette « zone d’indiscernabilité » qu’est la viande, le poème parvient tout de même à la dire. En un sens, par cette voie-là, le poème interroge le mythe que s’est forgé l’homme occidental d’être en dehors de la chaine alimentaire (et qui n’existe pas dans d’autres cosmologies, comme par exemple dans le chamanisme sibérien qui repose sur l’idée d’une circulation de la chair50).
11L’intérêt pour les animaux de proie se confirme dans les poèmes qui évoquent des animaux que l’homme tue simplement pour tuer : les bisons décimés par les colons dans les réserves indiennes, puissamment évoqués par la poétesse Anishinaabe Kimberly Blaeser dans Résister en dansant (éditions des Lisières, 2020), le taureau dont le torero orchestre la mort selon un art et un rituel réglés, dont parle par exemple Ludovic Degroote dans son recueil josé tomas (Éditions Unes, 2014), les perce-oreilles surgis d’un gâteau au rhum, décrits d’abord avec ébahissement et admiration par Raymond Carver, puis avec dégoût et rage51. Outre ces animaux, les poèmes affectionnent aussi les animaux de proie potentiels ou symboliques. On peut inclure dans cette catégorie tous les animaux que le poème s’efforce de « saisir » – ces animaux qui fascinent et qui échappent, qui surgissent avec une densité de présence extraordinaire puis se dérobent au regard. Ce sont ces animaux dont parle si bien Jean-Christophe Bailly dans Le Versant animal et le Parti pris des animaux, qu’on ne peut qu’entrapercevoir fugacement et dont le poème peut transcrire la furtivité d’un geste, d’une allure, d’un mouvement ou d’une silhouette. On pense bien sûr ici aux nombreux poèmes consacrés aux cerfs, biches ou chevreuils (dont Anne Simon dit qu’ils sont emblématiques de la littérature animalière contemporaine et peut-être de la mélancolie qui lui est propre52, comme l’illustre par exemple Traité de la mélancolie de Cerf de Christian Doumet53), mais aussi aux poèmes consacrés aux anguilles qui filent entre les doigts (Roubaud), aux baleines (Fabienne Raphoz) ou aux loutres qui retenaient l’attention de Walter Benjamin dans Enfance berlinoise et dont Kimberly Blaeser ne cesse de dire l’agilité dans son recueil Résister en dansant, et bien sûr aux poèmes encore plus nombreux sur les oiseaux54.
12Tous ces animaux ont été pris dans les rets de nombreuses projections mythologiques, allégoriques, ou lyriques, voire « couver[ts] de clichés clinquants55 » comme le dit Pierre Alferi du rossignol. Dans la poésie contemporaine, ces animaux restent affectionnés par les poètes qui cherchent désormais à les saisir en eux-mêmes et pour eux-mêmes, dans leur littéralité et leur furtivité. On peut toutefois se demander si ce faisant ces poètes ne continuent pas à exercer une sorte de prédation à leur égard, par le simple fait de les nommer, d’essayer de les mettre en mots et de chercher à transcrire leur langage ou leur « style » dans le poème, y compris quand « ça fait silence56 ». L’expression est de Fabienne Raphoz qui dit vouloir « saisir l’alternance des silences et des langues57 » ou « saisir le vol d’une raie manta58 », « tracer le maintien sur roche du lynx » et « arrimer en roche son chant tigré59 ». Les mêmes verbes reviennent, significativement : « saisir », maintenir, « arrimer ». Ainsi, quand Pierre Vinclair consacre dans La Sauvagerie (Corti, 2020) une séquence de poèmes aux animaux en voie de disparition, ces poèmes sont-ils une façon de faire exister ces animaux et de les sauver de la disparition en les sauvant de l’oubli (selon l’idée que nommer c’est faire exister), ou bien sont-ils des cages qui nomment, figent et immobilisent sur le papier et dans une forme et un mètre, à l’instar de la taxidermie et des collections d’animaux naturalisés ? Dans Le Détail du monde (Seuil, 2019), Romain Bertrand pointe les pratiques mortifères du naturalisme qui, pour connaître, a besoin d’entailler et tuer, et il appelle à la place de ses vœux une connaissance par la caresse, comme la poésie sait la pratiquer. Mais ce pacifisme de la poésie qu’il avance, pour être un moindre mal, n’est peut-être pas si pacifique…
13Envisager les choses sous cet angle a au moins pour mérite de détonner par rapport aux soupçons dont la poésie est plus souvent la cible, notamment quand on l’accuse d’avoir, depuis Mallarmé, une « action restreinte » au papier. Ici, c’est le reproche inverse qui se dessine : n’y aurait-il pas dans l’écriture l’exercice d’une violence, une force de domination ou de domestication à l’œuvre, voire une tentative de réduction et de figement (notamment de la vie animale), par le biais des mots et de la forme ? On trouve certes dans les poèmes des types de rapports aux animaux variés, de l’animal pur prétexte et objet d’énumération (comme dans La Sauvagerie de Vinclair) à la quête d’un rapport qui se rapprocherait davantage de l’ornithologie que de la domestication (comme dans Jeux d’oiseaux dans un ciel vide de Fabienne Raphoz). Mais malgré cette variété, tous ces poèmes semblent avoir pour trait commun d’engager toujours peu ou prou un rapport naturaliste à l’animal qu’ils considèrent, comme si tenter de saisir quelque chose du langage et de la vie des bêtes par le biais du poème était finalement toujours se mettre en chasse de ce « gibier farouche » comme disait Ponge, et tenter d’en faire un « objet », l’épingler comme un trophée de mots, de rythmes et de sons.
14Que faire alors ? Pour éviter cela, faut-il se taire et laisser vaquer les bêtes, arrêter de croire qu’on peut parler « à la place » d’elles comme le demandait Deleuze60 et que leur écoute peut transformer et ouvrir de nouvelles voies d’écriture poétique ? Ponge met en garde contre la tentation du silence : il faut parler des choses et des êtres non-humains, c’est le silence qui est dangereux61. Deleuze ne dit du reste pas le contraire : il préconise de ne pas parler « à la place » des bêtes, mais plutôt à côté d’elles. Tous les travaux récents de zoocritique semblent aller dans ce sens (même si ces derniers concernent pour l’instant assez peu la poésie) et suggérer que cette chasse via le poème non seulement n’est peut-être pas si violente, mais pourrait avoir un certain nombre de bénéfices, à la fois pour la connaissance des mondes animaux, pour nous-mêmes, et pour la poésie.
15Nous n’allons pas déplier ces triples bénéfices ici. Ouvrons plutôt une piste : renversons la formulation et l’angle de vue en considérant non pas que le poème se mettrait en chasse des animaux et en serait le prédateur, mais plutôt qu’il aurait la possibilité de se laisser envahir, pénétrer, contaminer par eux, jusqu’à former une zone trouble où quelque chose d’autre peut advenir.
16« Envahir » d’abord, pour suivre la recommandation que Ponge adresse au contemplateur : il faut, dit-il, refuser de « considérer comme un mal l’envahissement de sa personnalité par les choses62 ». C’est la condition nécessaire pour nous faire sortir de la « rainure63 » humaine. Osons ici un grand rapprochement entre deux poétiques très différentes, la perspective objective de Ponge et la perspective subjective de Michaux : remplaçons « choses » par « animaux », remplaçons « personnalité » par « poème », et nous voici très près de « l’envahissement » et de l’« intervention » que préconise Henri Michaux dans le poème du même nom :
Intervention
Autrefois, j’avais trop le respect de la nature. Je me mettais devant les choses et les paysages et je les laissais faire.
Fini, maintenant j’interviendrai.
J’étais donc à Honfleur et je m’y ennuyais. Alors résolument j’y mis du chameau. Cela ne paraît pas fort indiqué. N’importe, c’était mon idée. D’ailleurs je la mis à exécution avec la plus grande prudence. Je les introduisis d’abord les jours de grande affluence, le samedi sur la place du Marché. L’encombrement devint indescriptible et les touristes disaient : « Ah ! ce que ça pue ! Sont-ils sales les gens d’ici ! » L’odeur gagna le port et se mit à terrasser celle de la crevette. On sortait de la foule plein de poussières et de poils d’on ne savait quoi.
Et, la nuit, il fallait entendre les coups de pattes des chameaux quand ils essayaient de franchir les écluses, gong ! gong ! sur le métal et les madriers !
L’envahissement par les chameaux se fit avec suite et sûreté64. […]
17Ce type d’intervention et d’envahissement que tente Michaux est proche de celui que décrit Deleuze quand il appelle au « devenir-animal65 ». Devenir-chameau, devenir-tique ou ours, ce n’est évidemment pas se transformer en ces animaux, mais tendre asymptotiquement vers eux. Car ni le poète, ni le poème ne se métamorphoseront jamais en chameau. Mais ils peuvent s’ouvrir à son altérité, se laisser envahir par quelque chose de lui (une allure, le « gong gong » du pas, une puanteur, pour en rester à l’exemple de Michaux), et s’en trouver ainsi modifiés en profondeur.
18D’une certaine façon, Jean-Christophe Bailly ne dit pas autre chose dans ses deux essais sur les animaux quand il appelle à se laisser « pénétrer66 » par les mondes des animaux et leurs modes d’êtres, par exemple ceux des singes (qu’il faut « accueillir d’une manière ou d’une autre » pour « tenter de faire bouger la frontière67 » comme il l’écrit dans le poème liminaire du Parti pris des animaux), ou celui du faucon pèlerin comme s’y essaie J. A. Baker dans ses poèmes68 (il ne s’agit pas d’un « devenir-pèlerin », formule trop expéditive, mais plutôt d’une « déposition progressive de la façon humaine de regarder69 » pour se laisser gagner par « d’autre modes du percept »).
19Cet envahissement par l’animal peut évidemment prendre bien des formes. De la simple écoute et observation au devenir-animal presque chamanique décrit par Nastassja Martin (en quelque sorte habitée par l’ours ou l’esprit de l’ours qui l’a dévorée), l’éventail exploré par les écrivains qui acceptent de se laisser « toucher » par l’animal est large. Tous les poèmes ici évoqués font l’expérience d’une frontière entre l’humain et l’animal qui n’est pas aussi étanche qu’on pourrait l’imaginer : leurs auteurs expérimentent des modalités d’envahissement, d’hybridation, et même disons d’« ingestion et digestion », qu’il semble possible de penser à partir du modèle du parasite ou du microprédateur. Là encore Michaux est d’une grande aide :
L’araignée royale détruit son entourage, par digestion. […] La digestion prend du digéré des vertus que celui-là même ignorait […].
Bien souvent elle approche en amie. Elle n’est que douceur, tendresse, désir de communiquer, mais si inapaisable est son ardeur, son immense bouche désire tellement ausculter les poitrines d’autrui (et sa langue aussi est toujours inquiète et avide), il faut bien pour finir qu’elle déglutisse.
Que d’étrangers déjà furent engloutis ! […] Plus l’autre se débat, plus elle s’attache à le connaître. Petit à petit elle l’introduit en elle et le confronte avec ce qu’elle a de plus cher et de plus important, et nul doute qu’il ne jaillisse de cette confrontation une lumière unique70.
20Ce texte peut être lu de deux façons et orienter la réflexion dans deux directions.
21Selon une première lecture, cette araignée royale serait le poème, qui ingère et digère les animaux qui l’entourent, s’incorporant leurs vertus et leurs « intensités vitales » (Deleuze) pour les faire siennes (par exemple la compacité lourde des bœufs qui devient bourdonnement nasal dans « Le mot joie » de Philippe Jaccottet, le glissement du serpent qui s’insinue dans le poème de René Char « Le Serpent » (La Paroi et la prairie, 1952) par les voltes et contrevoltes de sifflantes, la « grâce frémissante 71 » du cerf qui infléchit le phrasé de Christian Doumet dans son Traité de la mélancolie du cerf, la légèreté acérée de l’hirondelle qui provoque la découpe angulaire des vers de Ponge72). Cette « ingestion » se fait soit sur un mode agressif et prédateur (on rejoint là l’hypothèse de départ sur le poème prédateur, mu par la double pulsion du sexe et de la faim73 puisque, si on suit Michaux, ces deux convergent dans la bouche avide qui désire et qui mord, comme celle de l’araignée de Michaux ou du « poète lombric » de Roubaud qui « mâche, digère et fore avec conscience74 »), soit sur un mode mineur, comme quand Guillevic écrit : « J’ai logé dans le merle / je crois savoir comment / le merle se réveille et comment il veut dire / la lumière, du noir encore, quelques couleurs75. »
22Selon une deuxième lecture du poème de Michaux, ce serait l’inverse : le poème serait la proie de l’araignée royale (et plus largement des animaux), qui s’introduirait avidement en lui. De cette pénétration et ingestion, jaillirait une « lumière unique 76 », comme dans le deuxième Chant de Maldoror, quand Lautréamont raconte l’accouplement avec un requin femelle, furieuse et affamée, la requine pénètre l’humain, l’humain pénètre la requine, « les bras et les nageoires entrelacés77 » comme des sangsues, ne formant « bientôt plus qu’une masse glauque ». De cet « accouplement long, chaste et hideux », zone trouble où toutes les frontières se brouillent, naît le poème.
23Les deux lectures du poème de Michaux sont à vrai dire compatibles, et rappellent la remarque de Derrida sur l’interversion permanente des rôles dans la prédation : « Je ne sais plus qui […] je suis ou qui je chasse, qui me suit et qui me chasse. Qui vient avant et qui est après qui. Je ne sais plus où donner de la tête78. » Est-ce le poème qui pénètre l’animal, ou l’animal le poème ? À vrai dire peu importe, si ce n’est la zone d’indiscernabilité qui en résultent. Cette pénétration réciproque et cette inversion ne signifient cependant pas que l’un devient l’autre et l’autre devient l’un, comme le souligne du reste Deleuze quand il parle du devenir-animal. Il s’agit moins d’un échange réciproque que d’un voisinage. Le poème pénétré par l’araignée ne devient pas araignée, mais devient quelque chose d’autre, de nouveau et d’unique.
24On trouve des variantes moins terrifiantes de ce genre d’accouplement dans la prédation, de voisinage et d’interversion des rôles, par exemple dans le recueil récent de la poète italienne Anna Milani, Géographie de steppes et de lisières : à force d’observer les animaux, une « étrange sensation d’amplitude79 » gagne le Je poétique, elle sent un « espace intérieur augmenté […] [au sein duquel elle a] l’impression de pouvoir se déplacer avec la grâce et la circonspection du cerf », comme si une « nouvelle chambre s’était ouverte » dans sa cage thoracique. Ici ce n’est plus le Je qui loge dans un merle comme chez Guillevic, mais l’inverse : dans son corps, entrent peu à peu les rapaces (« Dans l’étendue de mon souffle, le faucon fait son apprentissage. L’aigle plane 80»), un loup (qui « grogne dans l’embranchement de [son] épaule81 »), « un oiseau a niché dans mon dos, sous l’épaule gauche, entre l’omoplate et la septième vertèbre dorsale. Depuis le commencement de cette cohabitation, je me questionne sur la nature hybride de mon corps82 », « dans ma topographie, j’enregistre : escarpements et falaises, versants ombreux sur lesquels s’abritent les chevreuils83 ». Comme chez Lautréamont, cet envahissement par l’animal a pour conséquence d’élargir et même d’effacer les frontières du Je poétique (« Je me laisse infiltrer par une langue qui signifie au-delà des contours84 »), et d’agir en profondeur sur l’écriture : la langue s’hybride, le vers se distend, le rythme fluctue et semble adopter l’allure et le tempo de l’aigle, du bison et du loup qui pénètrent successivement le poème, s’y greffent et le modifient, tel un parasite qui modifie le comportement de l’hôte qu’il infecte, ou comme le « hérisson naïf et globuleux [d’Eric Chevillard] [qui] se met en travers de vos phrases, son corps fait obstacle 85».
25Dans La Nuit remue, le poème qui suit « La vie de l’araignée royale » raconte qu’Emme a un parasite qui ne le lâche plus, qui s’est accroché à son ventre par les dents alors qu’il nageait dans le fleuve : la tête de « la chose86 » (telle une « marmotte ») a disparu dans sa chair, sa « succion » avide transforme la vie d’Emme, elle s’allonge, perd toutes ses branches et « dev[ient] comme un ver de terre, nue et molle ». On sait que Michaux poussera ce genre de rêverie métamorphique jusqu’à l’invention d’animaux fantastiques. Mais avant cela, il y a ce moment trouble de l’envahissement, quand le sujet se laisse contaminer par l’animal (araignée, parasite-marmotte ou fourmi) : « […] je perdis les limites de mon corps et me démesurai irrésistiblement. / Je fus toutes choses : des fourmis surtout, interminablement à la file, laborieuses et toutefois hésitantes. C’était un mouvement fou. […] Je m’aperçus bientôt que non seulement j’étais les fourmis, mais j’étais aussi leur chemin87. »
26Être les fourmis et leur chemin88… On comprend en effet que la contagion gagne le sujet mais aussi l’écriture : Michaux dit en note qu’il écrit et invente « nerveusement » mots et animaux, selon ce « mouvement fou », laborieux, nerveux des fourmis. Le sujet et l’écriture ne deviennent donc pas à proprement parler « fourmi », ou « vers de terre », mais nerveux, ou nus et mous comme des fourmis ou comme un vers de terre. Zoomorpher n’est pas essayer de se transformer en animal, mais « dégoupiller au maximum nos capteurs sensoriels et imaginaires89 » pour le contrefaire, explique Anne Simon ; ou, pour reprendre les mots de Deleuze : « ça veut dire écrire comme un rat trace une ligne, ou comme il tord sa queue, comme un oiseau lance un son, comme un félin bouge, ou bien dort puissamment90. »
27Si Deleuze convoque ici avec insistance la comparaison pour décrire ce voisinage fécond que l’écriture peut arpenter et expérimenter, d’autres penseurs ou poètes en appellent plutôt à l’extraordinaire puissance de la métaphore, dont Michel Deguy par exemple faisait le ferment de la poésie, tout en se méfiant du mauvais usage qui peut conduire le poète à basculer avec sa proie dans un « monde-image91 » et substituer « rêves » et « faux-semblants » au réel. Comparaison ou métaphore, peu importe ici : dans tous ces cas, c’est un transport qu’expérimentent les poètes, un déplacement asymptotique vers l’animal, ou plutôt vers les animaux puisque c’est justement la formidable diversité des modes d’êtres animaux qu’il leur est permis d’explorer par la poésie – poème-fourmi, poème-araignée (celui de Ponge est particulièrement intéressant92), « poème-baudroie93 » (qu’appelle de ses vœux Fabienne Raphoz), ou poème-cobra (comme celui qu’écrit le poète portugais Herberto Helder en 1977, tout en « alvéoles94 », « veines », « ventricules » qui crépitent et « venin blanc [qui] jaillit sous « l’énergie de la peur », et qui les conduit à « pousser le langage »). Écrire, dit Deleuze, « c’est forcément pousser le langage et la syntaxe jusqu’à cette limite. La limite qui sépare le langage du silence. […] Il faut être toujours à la limite qui vous sépare de l’animalité mais justement de telle manière qu’on n’en soit plus séparé. […] Il faut être à la crête, à la limite de ce qui sépare de l’animalité 95». Pour le poète, « être à la crête » consisterait dès lors à convoquer toutes les ressources du langage et du vers (métaphore, syntaxe, mais aussi ressources sonores, rythmiques, graphiques) et parvenir à se situer sur cette ligne d’équilibre toujours précaire entre la tension vers l’animal (ce mouvement de préhension de l’objet convoqué, caractéristique de la tentation prédatrice de la poésie, qu’il s’agisse de prédation objective comme chez Ponge ou de prédation onirique comme chez Michaux, pour s’en tenir à deux exemples occidentaux très différents) et l’accueil (quand la poésie, dans un mouvement de réceptivité, tend à se faire proie du dehors). À cette double condition seulement, le poème pourrait se tenir « sur la crête96 » qui à la fois le sépare de l’animal et le relie à lui, et nous « ouvrir à d’autres manières d’être au monde, qui ne seront jamais les [nôtres] mais qui n’en transfigurent pas moins [nos] propres modes d’être ». C’est en ce sens qu’il faut comprendre ce dont parle Deleuze et qu’expérimentent si intensément les poètes,
ce devenir animal, d’un devenir qui ne soit ni d’imitation, ni de domestication, mais de “côtoiement”, de croisements et de transformations réciproques entre nous et ces animaux qui voient, que l’on voit, […] que nous ne comprenons pas et qui nous donnent pourtant à penser autrement eux-mêmes, et à travers eux, les plantes, la vie, la nature toute entière.
28À partir d’une telle expérience, sans doute serait-il alors possible d’envisager une « nouvelle éthique », centrée non sur l’animal ou sur l’homme, « mais sur la rencontre de l’homme et de l’animal, et leur manière énigmatique de partager un monde commun », ainsi qu’une nouvelle politique, « peut-être une sorte de politique de la ligne de crête » ouvrant la voie à de nouvelles discussions et à de « nouveaux combats » comme le suggère Pierre Zaoui.
29Bien que ce projet de réflexion sur les grands prédateurs en poésie se soit avéré déceptif par rapport aux intuitions de départ, il n’est donc pas pour autant caduc. Il a au moins pour mérite de montrer qu’il est possible et fécond d’envisager ensemble des poésies et des poétiques extrêmement diverses, parfois même orthogonales, issues des cultures occidentales et autochtones. Cette diversité, et les multiples façons qu’ont les poètes de pousser le langage et la syntaxe jusqu’à leur limite pour arpenter le voisinage de l’animalité, vaut pour les nouvelles perspectives éthiques et politiques qu’elle pourrait bien ouvrir, mais elle vaut aussi, et peut-être d’abord, pour les expériences ordinaires et très singulières « d’une énigme, d’un écart et d’un amour premiers97 » entre nous et ces animaux qu’elle restitue.
1 Voir à ce sujet Laurence Bertrand Dorléac, Un ours dans la tête. Greta Thunberg, Paris, Gallimard, 2022.
2 Je reprends ici l’expression d’Adolf Portmann (La Forme animale [Die Tiergestalt, 1948], traduit par Georges Rémy, Paris, Éditions La Bibliothèque, 2013).
3 Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal, Paris, Bayard, 2007, p. 124.
4 « L’art et la pensée modernes reconsidèrent avec un intérêt renouvelé les formes d’existence les plus éloignées de nous, parce qu’elles mettent en évidence ce mouvement par lequel tous les vivants et nous-mêmes essayons de mettre en forme un monde qui n’est pas prédestiné aux entreprises de notre connaissance et de notre action » (Maurice Merleau-Ponty, Causeries, « Exploration du monde perçu. L’animalité », établies et annotées par Stéphane Ménasé, Paris, Seuil, 2002, p. 39).
5 Marielle Macé, « Styles animaux », L’Esprit créateur, vol. 51, no 4, « Face aux bêtes », hiver 2011, p. 97-105.
6 Claude Levi-Strauss, Anthropologie structurale [1963], Paris, Plon, 1958, p. 248.
7 Val Plumwood, Dans l’œil du crocodile. L’humanité comme proie [2012], traduit par Pierre Madelin, Paris, Wildproject, Domaine sauvage, 2021.
8 Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, Paris, Bourgois, 2007, p. 26.
9 Baptiste Morizot (Sur la piste animale, Arles, Actes Sud, Mondes sauvages, 2018, p. 65) reprend ici la formule de David Quammen (Monster of God. The Man-Eating Predator in the Jungles of History and the Mind, New York, W. W. Norton & Company, 2004).
10 Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal, op. cit., p. 56. Ibid. pour les citations suivantes.
11 Baptiste Morizot, Sur la piste animale, op. cit., p. 66.
12 Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, Paris, Galilée, 2006, p. 60. Ibid. pour les citations suivantes.
13 Cristian David López et José Luis García Martín (dir.), « Jaguarete purahéi, Canto del jaguar », Guarani purahéi, Cantos guaraníes, Impronta, 2012.
14 Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables, traduit par Jean-Marie Le Clézio, p. 174 pour le grizzli, et p. 185 pour le grand jaguar.
15 Baptiste Morizot, Sur la piste animale, op. cit., p. 68. Ibid. et page suivante pour les citations suivantes.
16 Voir à ce sujet Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, op. cit., p. 27.
17 « Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe / so müd geworden, daß er nichts mehr hält. / Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt. » (« Son regard du retour éternel des barreaux / s’est tellement lassé qu’il ne saisit plus rien. / Il ne lui semble voir que barreaux par milliers / et derrière mille barreaux, plus de monde. »), première strophe du poème de Rainer Maria Rilke, « La Panthère. Jardin des Plantes à Paris », écrit en 1902 et repris dans Le Vent du retour (traduit de l’allemand par Claude Vigée), Arfuyen, 2005.
18 Guillaume Apollinaire, « Le Lion », Le Bestiaire, ou Cortège d’Orphée, Espaces et signes, 2024, p. 13 : « Ô lion, malheureuse image / Des rois chus lamentablement, / Tu ne nais maintenant qu’en cage / À Hambourg, chez les Allemands. »
19 Gérard Wacjman et Tania Mouraud, Les Animaux nous traitent mal, Paris, Gallimard, 2008, p. 10.
20 Ibid., p. 14. La citation suivante est tirée de la même page.
21 Ibid. p. 30. Sur ce sujet voir aussi John Berger, Pourquoi regarder les animaux ?, traduit par Katya Berger Andreadakis, Paris, Héros-limite, 2011.
22 Ibid., p. 24. Les citations qui suivent sont extraites des pages 24 et 25.
23 « Essayez de regarder un crocodile droit dans cet œil qui flotte juste au-dessus de la surface de l’eau du marécage. Y percevez-vous la reconnaissance de votre humanité ? Vous êtes pour lui un objet d’indifférence quand il est rassasié, une proie à dévorer lorsqu’il a faim. » (William E. Connolly, « Voices from the Whirlwind », cité par Val Plumwood, en exergue au chapitre I « Rencontre avec le prédateur » de Dans l’œil du crocodile, op. cit., p. 27).
24 Gérard Wacjman, op. cit., p. 15.
25 Ibid., p. 30.
26 Ibid., p. 36. Ibid. pour la citation suivante.
27 Ibid., p. 31. Les citations suivantes sont tirées des pages 30 et 31.
28 Charles Stépanoff, Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l’humain, Paris, La Découverte, 2024, p. 151.
29 Sur la question de la chasse, des rapports paradoxaux entre chasse, protection et compassion, et sur la figure du « prédateur empathique », voir aussi Charles Stépanoff, L’Animal et la mort. Chasse, modernité et crise du sauvage (Paris, La Découverte, 2021), qui a notamment l’intérêt de proposer des comparaisons entre les cosmologies et les pratiques des Even ou des Tuwa et celles des paysans français.
30 Carlos Fausto, Warefare and Shamanism in Amazonia, Cambridge University Press, 2012, p. 192. Sur ce sujet, voir aussi Carlos Fausto, Le Jaguar apprivoisé. Essais d’ethnologie amazonienne (trad. d’E. de Vienne), Presses Universitaires du Midi, 2024.
31 Charles Stépanoff, Attachements, op. cit., p. 151. Toutes les citations qui suivent sont tirées des pages 151 et 152.
32 Fabienne Raphoz, Blanche baleine, Paris, Héros-Limite, 2017, p. 28.
33 Georges Bataille, « Histoire de rats », L’Impossible, Paris, Minuit, 1962.
34 Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal, op. cit., p. 24.
35 Pierre-Henri Castel, Le Mal qui vient. Essai hâtif sur la fin du temps, Éditions du Cerf, 2018 ; cité par Jean-Claude Pinson, Pastoral. De la poésie comme écologie, Seyssel, Champ Vallon, 2020, p. 144. Les citations qui suivent sont extraites de la même page.
36 « Leaving the house each dawn I see the hawk / Flagrant over the driveway. In his claws / That dot, that comma / Is the broken animal: the dangling small beast […] » (« Quittant la maison chaque jour à l’aube je vois le faucon / Flagrant au-dessus de l’allée. Dans ses serres / Ce point, cette virgule / L’animal brisé : pantelante la pauvre bête […] », Georges Oppen, « Ouvrier », Les Matériaux [1962], dans Poésies complètes, traduit par Yves di Manno, Paris, Corti, 2011, p. 77).
37 Raymond Carver, « Aigles », Poésies, traduit par Jacqueline Huet et al., Paris, Seuil, « Points », 2015, p. 167.
38 Jacques Roubaud, « Le lombric », Les Animaux de tout le monde, Paris, Seghers, 2022.
39 Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous, Paris, Héros-Limite, 2021, p. 18.
40 Ibid., p. 90.
41 Jacques Roubaud, op. cit., « La couleuvre d’eau », p. 51.
42 Francis Ponge, « La crevette », Le Parti pris des choses, Paris, Gallimard, « Nrf Poésie », 1997, p. 87. Ibid. pour les citations suivantes.
43 Jacques Roubaud, op. cit., « L’anguille », p. 23.
44 Raymond Carver, « L’esturgeon », Poésie, op. cit., p. 416. Les citations qui suivent sont tirées du même poème.
45 Philippe Jaccottet, « Le mot joie », Pensées sous les nuages [1983], dans À la lumière d’hiver, Paris, Gallimard, « Nrf Poésie », 2004, p. 130.
46 Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement. Voyages en France, Paris, Seuil, 2011, p. 417.
47 Voir à ce sujet Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal, op. cit., p. 51.
48 Ibid., p. 141.
49 Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, Éditions de la Différence, 1981, p. 30. Ibid. pour la citation suivante.
50 Baptiste Morizot, dans Sur la piste animale (Actes Sud, 2017), explique que dans cette culture, quand elles sentent la mort venir, les personnes âgées vont dans la forêt et laissent leur dépouille aux animaux carnivores, qui eux-mêmes deviendront gibier. Il cite à ce propos l’anthropologue Roberte Hamayon : « Le système d’échanges dont le chasseur est le preneur assure la circulation des chairs entre les mondes : d’abord celle, crue, du gibier dont le rituel ramène le meurtre à une prise de viande qui nourrit l’homme, et, au terme du circuit, celle, morte, de la dépouille du chasseur qui retourne à la surnature. » (Sur la piste animale, op. cit., p. 153).
51 Raymond Carver, « Perce-oreilles », Poésie, op. cit., p. 247 : « L’espace d’une minute, je fus si ahuri que je ne savais pas si je devais les tuer, ou quoi. Puis la rage me saisit, et / je les ai emplâtrés. Écrasés pour en exprimer la vie avant qu’un seul puisse m’échapper. Ce fut un massacre. Pendant que j’y étais, j’ai retrouvé et détruit l’autre, réduit en bouillie. Je commençais à peine que tout était déjà fini. J’affirme par là que j’aurais pu continuer indéfiniment, / à m’acharner sur eux. S’il est vrai que l’homme est un loup pour l’homme, alors des perce-oreilles, que peuvent-ils espérer quand la soif de sang monte ? »
52 Anne Simon, Une bête entre les lignes, Essai de zoopoétique, Éditions Wildproject, 2021, p. 236.
53 Christian Doumet, Traité de la mélancolie de Cerf, Seyssel, Champ Vallon, 1992.
54 À ce sujet, voir la magistrale étude de Marielle Macé (Une pluie d’oiseaux, Corti, 2022) et l’extraordinaire répertoire de poèmes qu’elle cite.
55 Pierre Alferi, « Le rossignol d’Emmanuel », Vacarme, no 36, été 2006, p. 81.
56 « ô comment dire cela, comment dire cela qui fait silence dans les bois ? » (Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous, op. cit., p. 88)
57 Ibid., p. 84.
58 Fabienne Raphoz, Blanche baleine, op. cit., p. 14.
59 Ibid., p. 13.
60 L’Abécédaire de Gilles Deleuze. A comme Animal (documentaire produit par Pierre-André Boutang, 1995).
61 Voir notamment le court texte daté du 1er mars 1942 « Je suis un suscitateur » : « Ceux qui n’ont pas la parole, c’est à ceux-là que je veux la donner » (Francis Ponge, Nouveau Nouveau Recueil, volume I : 1923-1942, Paris, Gallimard, 1992, p. 187).
62 Francis Ponge, « Introduction au galet », Le Parti pris des choses, op. cit., p. 175.
63 Francis Ponge, « Braque ou l’Art moderne comme événement et plaisir », Le Peintre à l’étude, Œuvres I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 138.
64 Henri Michaux, Mes propriétés, dans La nuit remue, Paris, Gallimard, « Nrf Poésie », 1998, p. 143.
65 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 284-381.
66 Le verbe est employé à plusieurs reprises dans les deux essais (le Parti pris des animaux, op. cit., p. 32 et p. 94, et Le Versant animal, op. cit., p. 29).
67 Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, op. cit., p. 24.
68 J. A. Baker, Le Pèlerin (The Peregrine, 1967), Paris, Gallimard, 1989 ; commenté par Jean-Christophe Bailly dans Le Parti pris des animaux, op. cit., p. 116.
69 Jean-Christophe Bailly, Le Parti pris des animaux, op. cit., p. 117. Ibid. pour la citation suivante.
70 Henri Michaux, « La vie de l’araignée royale », La nuit remue, op. cit., p. 37.
71 Christian Doumet, Traité de la mélancolie du cerf, Seyssel, Champ Vallon, 1992, p. 15.
72 Francis Ponge, « Les hirondelles ou Dans le style des hirondelles » (1951-1956), dans Pièces, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », I, 1999, p. 795-796.
73 « Après la quête de la nourriture, les actes de la reproduction sexuée constituent l’autre grande contraction vitale du monde animal » (Jean-Christophe Bailly, Le Versant animal, op. cit., p. 105).
74 Jacques Roubaud, « Le lombric », Les Animaux de tout le monde, op. cit., p. 10.
75 Eugène Guillevic, « Habitations », Sphères, Paris, Gallimard, 1963, p. 57.
76 Henri Michaux, « La vie de l’araignée royale », op. cit.
77 Comte de Lautréamont, Œuvres complètes, Les Chants de Maldoror, Paris, Gallimard, « Nrf Poésie », 1993, p. 111. Les citations suivantes sont extraites de la même page.
78 Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, op. cit., p. 27.
79 Anna Milani, Géographie de steppes et de lisières, Paris, Cheyne éditeur, 2022, p. 22. Ibid. pour les citations suivantes.
80 Ibid., p. 26.
81 Ibid., p. 34.
82 Ibid., p. 37.
83 Ibid., p. 44.
84 Ibid.
85 Éric Chevillard, Du hérisson, Paris, Minuit, 2002, p. 22.
86 Henri Michaux, « Emme et son parasite », La Nuit remue, op. cit. p. 59. Ibid. pour les citations suivantes.
87 Henri Michaux, « Encore des changements », Mes propriétés, op. cit., p. 122.
88 On pense ici au « Grand Atlas de la désorientation » de Tatiana Trouvé, présenté au Centre Pompidou en 2022, qui superposait au sol plusieurs cartographies correspondant à différentes trajectoires (la carte olfactive des loups dans le parc de Yellowstone, des circuits de fourmis, des spirales de neutrinos…). Le visiteur était invité à emprunter ces différentes pistes, à marcher comme une fourmi, comme un loup, sans cesser toutefois d’être l’humain que nous sommes.
89 Anne Simon, Une bête entre les lignes, op. cit., p. 84. Elle évoque notamment les tentatives d’immersion physique parfois hilarantes de Charles Foster dans le monde concret d’un martinet ou d’une loutre.
90 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues [1977], Paris, Flammarion, 1996, p. 90.
91 J’emprunte cette expression et les suivantes à Yves Bonnefoy, dans « La présence et l’image », Débat no 20, mai 1982, p. 153. Les termes cités suivants sont extraits du même article.
92 Francis Ponge, L’Araignée, Paris, Aubier, 1952.
93 Fabienne Raphoz, Blanche baleine, op. cit., p. 35.
94 Herberto Helder, « Cobra » (1977), Le Poème continu (1961-2008), Paris, Gallimard, « Nrf Poésie », p. 145. Les citations qui suivent sont extraites des pages 145 et 153.
95 L’Abécédaire de Gilles Deleuze. A comme Animal, op. cit.
96 Pierre Zaoui, « Sur la crête », Vacarme, no 43/2, printemps 2008, p. 1. Ibid. pour les citations suivantes.
97 Ibid.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2021.html.
Quelques mots à propos de : Marik Froidefond
Marik Froidefond est Maîtresse de conférences en littérature comparée à l’Université Paris-Cité où elle codirige l’axe de recherches « Poésies, Arts de la Voix, Oralité » du CERILAC. Ses travaux portent sur les poésies moderne et contemporaine et les relations entre la poésie et les arts (musique et peinture principalement). Poursuivant une réflexion sur la poésie et les arts face au vivant et au non-vivant, elle a codirigé un ouvrage collectif sur Le végétal dans l’imaginaire contemporain (PUS, 2015) et consacre actuellement ses recherches aux éléments.
