Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
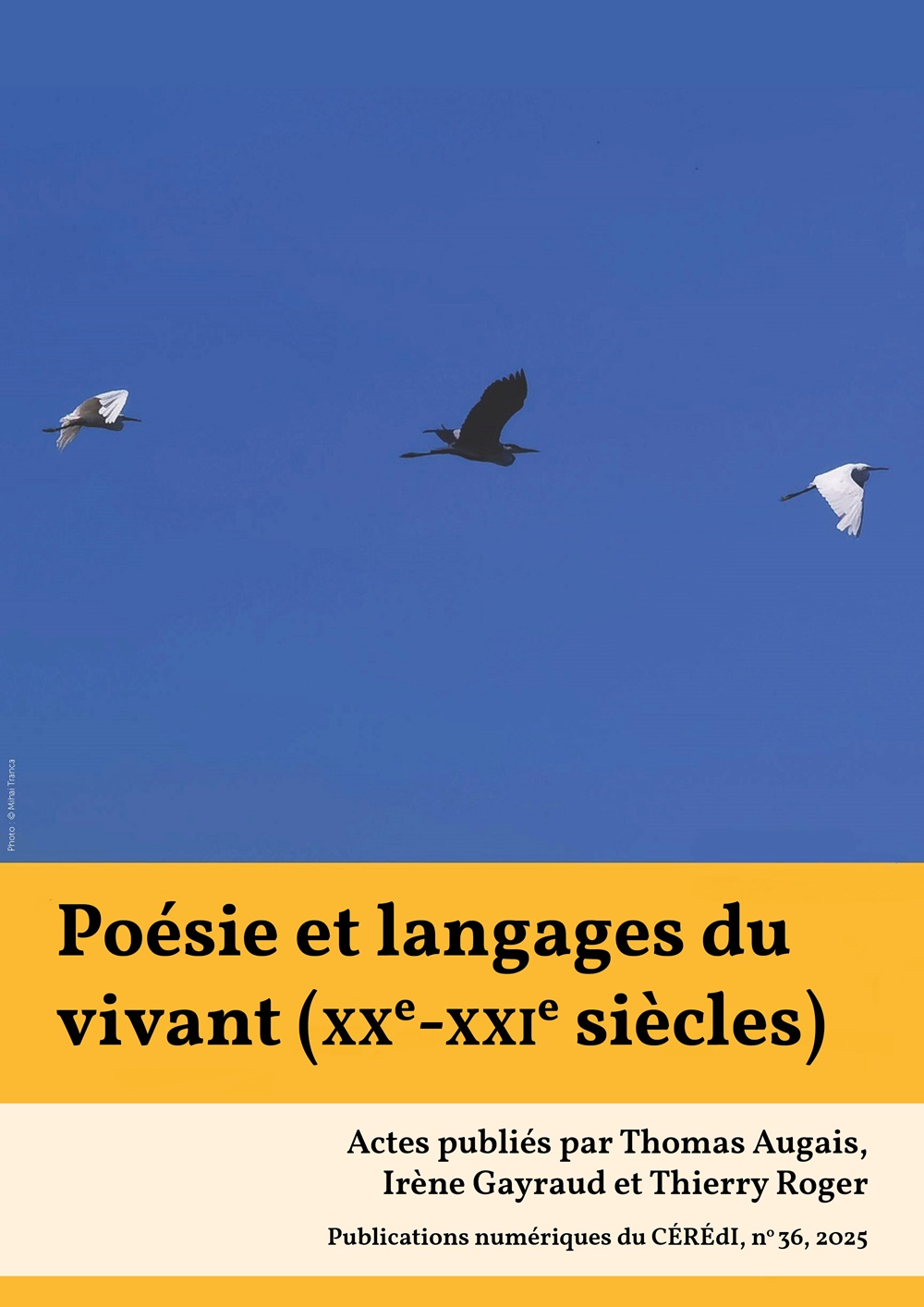
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
Mireille Mérigonde
1L’écocritique et l’écopoétique étudient dans une perspective littéraire le rapport entre poésie et langages du vivant1. Notre réflexion portant plus particulièrement sur le « faire sens » des formes de vie, nous avons choisi une troisième voie, celle de l’écosémiotique d’inspiration énonciative, ouverte par l’écosémioticienne Nicole Pignier, qui définit ainsi la discipline :
L’écosémiotique telle que nous l’envisageons considère la vie du sens dans son lien au vivant. Le sens est questionné en tant que tension continue entre la nature à savoir l’oikos, la Terre / biosphère accueillant la vie et la culture qui émerge des liens créatifs, perceptifs entre des communautés humaines et des lieux vivants2.
2Au xxe siècle, une réflexion très aboutie sur le rapport entre langage et vivant a été menée par le poète, essayiste et critique littéraire Jean Tortel (1904-1993). Il s’est détaché très tôt du structuralisme pour s’investir dans la poésie écophénoménologique des Jardins-Neufs en Avignon3. Si la notion d’« arbitraire » apparaît à maintes reprises dans sa poétique, ce n’est pas au sens strictement saussurien du terme, comme absence de causalité entre les deux faces du signe, le signifiant et le signifié4, mais plutôt du point de vue du sujet discursif plongé dans un « arbitraire » des formes sensibles du monde5. De même, la « vie des signes6 » envisagée par Saussure dans la société n’est assurément pas celle que nous propose Jean Tortel. Le poète porte un regard nouveau sur la relation de l’homme à la Terre et sur le vivant non humain. Dès lors, l’écriture poétique ne se vit plus comme une lutte contre la rhétorique mais comme un processus vivant d’actualisation de l’expérience sensible, pour une « multisignification7 ». Dans cette écopoétique qui se cherche, c’est toute la question du signe qui est remise en cause.
3Dans le cadre de cet article, nous nous proposons de mettre en perspective l’évolution de sa pensée, innovante et souvent en avance sur son temps, avec les théories prévalentes du signe. Nous établirons tout d’abord une épistémologie sommaire du signe naturel à travers les théories du langage car c’est dans le cadre de sa naturalisation que s’est développée l’analogie entre la langue et la vie au xixe siècle puis, au xxe siècle, entre le langage et le vivant. Nous rappellerons ensuite que sa « biologisation » a été opérée par l’écosémiotique anglo-saxonne mais aussi en France sous l’influence de la linguistique énonciative en « sémiotisant » la vie, dès le fonctionnement de la cellule. Nous terminerons en montrant que si la sémiotique de Sebeok et de ses successeurs zoo- et phytosémioticiens a largement ouvert les mondes de signification aux autres formes du vivant, c’est à travers l’influence énonciative que la linguistique et l’écosémiotique françaises accordent à leur tour le signe à l’ensemble du vivant, animal et végétal. Sur ce point, les poètes ont toujours eu une franche longueur d’avance, Jean Tortel et son ami Francis Ponge en première ligne, et nous pouvons considérer que leur poésie est un enseignement sur le signe. Nous conclurons en présentant la conception non déterministe du « signe ambiant » de l’écosémioticienne Nicole Pignier pour qui il y a bien « signe » et non « signal » dans les énonciations et échanges du vivant non humain, conception à laquelle s’accorde la poétique ancrée, sensible, « vivante » et plurielle de Jean Tortel.
La naturalisation des signes
Tortel et le livre de la nature
4Jean Tortel sait voir la poésie hors la poésie, dans le monde naturel et ses signes énigmatiques. Dans Les Villes ouvertes la signification est un sol à « gratter » pour qu’il délivre son histoire et ses mystères8. Durant ses vérifications au jardin, la perception conduit l’esprit à rechercher une cause, à interpréter, à donner un sens : les transformations du végétal renseignent sur la saison, une trace sur le sol est l’indice du passage d’un animal, la présence de nuages ayant certaines caractéristiques peut annoncer un orage prochain. Dans De mon vivant, Tortel ouvre à nouveau le « livre de la nature » mais en le déchargeant de tout poids symbolique :
De quelque part venue
Tu voudrais une trace
À suivre le matin
Quand les chemins sont neufs9.
5Le poète redécouvre ce que Baptiste Morizot appelle « l’art du pistage » : « Le pistage, au sens large d’une sensibilité enquêtrice envers le vivant […] est une expérience très nette d’accès aux significations et aux communications des autres formes de vie. » Selon Morizot, le pistage est l’expérience d’une réunification du corps et de la raison :
Pister est une expérience décisive pour apprendre à penser autrement car, lorsqu’on est dehors à flairer les indices, on ne se débarrasse pas de la raison pour devenir plus animal (dualisme moderne avec inversion du stigmate), on est simultanément plus animal et plus raisonnant, plus sensible et plus pensant10.
6Baptiste Morizot constate que « Cet art de lire s’est perdu : on “n’y voit rien” et il y a un enjeu à reconstituer des chemins de sensibilité, pour commencer à réapprendre à voir11. » Chez Tortel comme chez Morizot, il existe donc indéniablement des signes issus de la nature, des signes intentionnels ou non intentionnels, qui s’offrent à l’interprétation du corps sentant-percevant. Toutefois, comme Jean Tortel n’a de cesse de le montrer, la signification n’est pas un donné mais un construit qui se fait et se défait au gré des mouvements imprévisibles :
Il suffit de quelques gouttes.
D’un bruit lointain qui nous avise.
De rentrer d’attendre le feu.
De l’avancée prodigieuse l’air noir.
Le tourbillon des feuilles pour.
Que tout soit faussé certains mots.
Terre et ciel n’ont plus de sens.
Espace aussi sans doute qui.
Montre quelques entrailles illisibles.
Reste une chose celle qui.
N’a que les noms inventés par la peur12.
7La vérité poétique réside dans l’expression de la relation sensible et souvent déstabilisante entre le « je » ambiant, le monde et la naissance du poème, dans cette coexistence et cette coévolution avec l’altérité saisie dans le monde naturel.
Petite épistémologie des signes naturels
8L’histoire philosophique de ces signes naturels est retracée par Sylvain Auroux dans Théories du signe13 et dans les ouvrages d’Umberto Eco, Sémiotique et philosophie du langage14 et Le Signe15. Umberto Eco les définit de la sorte :
Les signes naturels sont ceux que nous utilisons pour reconnaître quelque chose ou en inférer l’existence. Ainsi, de la fumée nous fait déduire qu’un feu a été allumé. Les signes artificiels sont ceux qui sont utilisés par des êtres humains pour communiquer avec d’autres êtres humains, sur la base de conventions16.
9Ces distinctions remontent à Aristote, notamment dans De l’interprétation, où l’on trouve les termes sumbolon qui renvoie au signe linguistique (le mot, la phrase) et sêmeion17 qui désigne un signe qui s’interprète par inférence18. Saint-Augustin (354-430) propose quant à lui dans Enseigner le christianisme, la distinction signes non intentionnels (ou “naturels”) / signes intentionnels :
Parmi les signes, certains sont naturels, d’autres sont intentionnels. Naturels sont les signes qui font connaître quelque chose au-delà d’eux-mêmes, à partir d’eux-mêmes, sans volonté ni désir de signifier, comme la fumée quand elle signifie le feu. Elle fait cela, en effet, sans vouloir signifier, mais grâce à l’observation et à l’expérience, on sait qu’au-dessous il y a un feu, même si n’apparaît que la seule fumée. La trace du passage d’un être animé relève de la même catégorie et le visage d’un homme en colère ou affligé signifie un état d’esprit, même sans la volonté de la personne irritée ou affligée ; même chose pour toute autre émotion, même si nous ne faisons rien pour la révéler. […] Les signes intentionnels sont ceux que les êtres vivants s’échangent pour faire connaître, autant qu’ils le peuvent, leurs émotions, leurs sentiments ou n’importe laquelle de leurs pensées ; et pour celui qui fait un signe, la seule raison de signifier, c’est-à-dire de faire des signes, c’est la volonté d’aller rechercher et de faire passer dans l’esprit d’autrui ce qu’il a dans l’esprit19.
10Au xviiie siècle, dans son Essai sur l’origine des connaissances humaines, Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780), le philosophe du « sensualisme », fonde sa théorie du signe sur une classification tripartite : les signes accidentels (liés à nos idées dans certaines circonstances), les signes naturels (les cris qui expriment les sentiments) et les signes d’institution20. Dans la synthèse qu’Umberto Eco propose dans Le Signe, les signes naturels
seraient les signes sans émetteur intentionnel, provenant donc d’une source naturelle, et que nous interprétons comme symptômes et indices (comme les taches sur la peau, qui permettent au médecin de diagnostiquer certains troubles hépatiques, les bruits de pas annonçant la venue de quelqu’un, le nuage annonciateur de pluie). Les signes naturels sont aussi dits expressifs lorsqu’ils sont les symptômes de dispositions psychologiques, comme les signes involontaires de joie : mais la possibilité même de la simulation indique à suffisance que même les signes expressifs sont les éléments d’un langage socialisé, analysables et utilisables comme tels21.
Perception et signification
11La phanéroscopie (du grec phaneron, « le phénomène ») est une « théorie des catégories ou phénoménologie » chez le sémioticien et pragmaticien Charles Sanders Peirce. Pour lui, le percept est une forme de signe :
Mais le meilleur exemple est celui des odeurs, car les odeurs sont des signes de plus d’une façon. On observe communément que les odeurs rappellent de vieux souvenirs. Ceci est dû, je crois, en partie au moins, que cela vienne des connexions particulières du nerf olfactif ou d’une autre cause, au fait que les odeurs ont une tendance remarquable à se « présenter », c’est-à-dire à occuper tout le champ de la conscience, si bien qu’on vit presque, sur le moment, dans un monde d’odeurs. Or, dans la vacuité de ce monde, il n’y a rien qui empêche les suggestions de l’association. Voilà une première façon, par association de contiguïté, dont les odeurs sont particulièrement aptes à agir comme signes. Mais elles ont aussi un pouvoir remarquable de faire penser aux qualités mentales et spirituelles. Ceci doit être un effet de l’association par ressemblance, si, dans l’association par ressemblance nous incluons toutes les associations naturelles d’idées différentes. Ce que je ferais certainement, car je ne vois pas, autrement, en quoi pourrait consister l’association par ressemblance22.
12C’est le biologiste Von Uexküll (1864-1944) qui a mis en avant la relativité des perceptions et la multiplicité des interprétations dans Milieu animal et milieu humain avec l’exemple désormais bien connu de la tique : « Le signe perceptif des raisins secs laisse totalement froide la tique, tandis que le signe perceptif de l’acide butyrique joue dans son milieu un rôle remarquable23. » Chez Merleau-Ponty, qui avait lu Uexküll, le corps comprend ainsi un autre langage, une « prose du monde » constituée de percepts issus du monde naturel dont il se saisit avec des organes sensibles. Sa conception phénoménologique du signe et de la signification n’est pas en contradiction totale avec la conception duale du signe saussurien, mais l’envisage sous un nouvel angle, absolument non déterministe :
Le pouvoir expressif d’un signe tient à ce qu’il fait partie d’un système et coexiste avec d’autres signes et non pas à ce qu’il aurait été institué de Dieu ou de la Nature pour désigner une signification. […] La signification des signes, c’est d’abord leur configuration dans l’usage, le style des relations inter-humaines qui en émane ; et seule la logique aveugle et involontaire des choses perçues, toute suspendue à l’activité de notre corps, peut nous faire entrevoir l’esprit anonyme qui invente, au cœur de la langue, un nouveau mode d’expression24.
13Ce qu’il confirme dans les notes « En marge » sur le langage :
Mais la signification et le signe sont de l’ordre perceptif, non de l’ordre de l’Esprit absolu. […] il y a une question de savoir comment penser la consommation présomptive du langage dans le non-langage, dans la pensée. Mais ces deux faits ne sont pas autre chose que le fait même de la perception et de la rationalité ; du logos du monde esthétique25.
14Merleau-Ponty ne conçoit l’émergence du sens qu’en situation et dans la co-présence d’un je et d’un alter ego. Ce que nous relevons de capital, c’est qu’il n’y a pas de « pré-donné » de la signification mais sa construction. Ainsi, de « La prose du monde » à la « Sémiotique du monde naturel » de A. J. Greimas, il n’y avait qu’un pas. Lorsqu’il ouvre Sémantique structurale, Greimas déclare, en semblant quelque peu s’excuser ou se justifier :
nous proposons de considérer la perception comme le lieu non linguistique où se situe l’appréhension de la signification. […] Tout en reconnaissant nos préférences subjectives pour la théorie de la perception telle qu’elle a été naguère développée en France par Merleau-Ponty, nous ferons remarquer cependant que cette attitude épistémologique semble être aussi celle des sciences humaines du xxe siècle en général26.
15Le monde naturel est défini dans le Dictionnaire raisonné de la théorie du langage de Greimas et Courtès : « Nous entendons par monde naturel le paraître selon lequel l’univers se présente à l’homme comme un ensemble de qualités sensibles, doté d’une certaine organisation qui le fait parfois désigner comme “le monde du sens commun27”. » L’essai « Conditions d’une sémiotique du monde naturel » traite du langage gestuel mais suivant Hjelmslev qui a montré que chaque culture opère son propre découpage du sensible, Greimas précise que « les signes naturels renvoient à autre chose qu’à eux-mêmes, mais que cette relation référentielle […] possède des articulations différentes variables en fonction des communautés culturelles envisagées ». Les « relations structurales » des signes naturels sont ainsi différentes selon les cultures28. Pour le sémioticien qu’il soit d’obédience greimassienne ou peircienne, dès le niveau de la perception, il y a donc signification29 mais, comme l’a relevé Umberto Eco, dans la sémantique greimassienne, le signe étant « socialisé », il n’y a pas de véritable opposition nature / culture, ce que Édeline et Klinkenberg résument par « Percevoir, c’est sémiotiser30 ». Mais, comme le poème de Jean Tortel cité plus haut nous le rappelle, la perception est soumise aux aptitudes perceptives, à des aléas et ajustements. La totalité du sens reste souvent une idéalité. Le sémioticien et écrivain Pierre Ouellet considère lui aussi que le signe peut être « énigmatique par la perception partielle que l’on en a ». Il révèle alors un monde imparfait (au sens de Greimas31) et c’est de cette « faille dans le paraître » que surgissent tous les « simulacres » de la fiction On ne sera pas étonné que Pierre Ouellet soit l’un des rares sémioticiens à avoir étudié et fait honneur à Jean Tortel dans ses recherches32.
La « biologisation » des signes
16Carita Klippi a retracé l’histoire du naturalisme linguistique et en a montré l’importance jusqu’au début du xxe siècle. Le linguiste allemand Schleicher affirmait ainsi en 1863 :
Les langues sont des organismes naturels qui, en dehors de toute volonté humaine et suivant les lois déterminées, naissent, croissent, se développent, vieillissent et meurent ; elles manifestent donc, elles aussi, cette série de phénomènes qu’on comprend habituellement sous le nom de vie33.
17Mais lorsque Saussure fait allusion dans le Cours de linguistique générale, publié en 1916, à l’étude future de la « vie des signes au sein de la société », il emploie le terme « vie » de manière purement métaphorique. Les textes du Cours ne sont en aucune façon dans la continuité des théories organicistes du xixe siècle.
18On retrouve, de même, chez Jean Tortel, ce rapprochement alors coutumier en linguistique entre le mot et un être vivant. Dans Le Trottoir de trèfle, les mots sont décrits comme les parties d’un corps, reliées avec leurs « attaches » : « Les petits éléments grammaticaux non signifiants qui semblent jouer un rôle catalyseur sont des attaches (on dirait des bouts de ficelles), des tendons qui articulent l’organisme subitement structuré » puis il fait allusion au vers, « la matière verbale infirme devenue corps34 ». Dans Ratures des jours, un passage sur la figure de rhétorique nous la présente d’abord en termes biologiques, comme un corps, un ensemble de cellules :
La rhétorique est l’art de transformer un événement psycho-physique en matière verbale. Matière verbale ou l’organisme des figures qui sont des espèces de cellules ou, plutôt, organisation en figures de ces espèces de cellules qui sont ce qu’on appelle à présent morphèmes et phonèmes.
19mais pour ensuite préciser
Le mot « figure » est lui-même une métaphore, une organisation sémantique. C’est pourquoi la rhétorique comprend non seulement les « figures » classiques mais encore toute espèce de dispositions verbales, ponctuation, blancs, majuscules, etc.35
20Ajoutons que l’analogie entre le fonctionnement des mots et des cellules se retrouve en sémantique (avec les notions de noyau ou molécule sémique). S’il récuse le parallèle, il y a pourtant, pour Tortel, du vivant dans le langage mais, comme le suggère l’importance accordée à l’« évènement psycho-physique » initial, il est dans le vécu de l’expérience phénoménologique de l’art et, tout particulièrement dans l’écriture poétique. Les mots ont une corporéité mais la vie réside dans la relation établie entre le scripteur et la matérialité des mots qui affecte, comme les autres formes matérielles, la sensibilité et le corps du poète. Elle réside également dans le hasard des relations et la créativité qui en résulte. Le « vivant du langage », comme nous l’avons expliqué lors d’un congrès à Bordeaux sur la question du « vivant comme effet de sens » dans les arts, est proche de la conception d’Émile Benveniste pour qui « vivre le langage36 » s’entend dans la créativité du discours.
21Le néologisme fort inélégant de « biologisation » nous permettra de distinguer l’intégration du signe dans l’ordre du monde naturel dont nous venons de rappeler les grandes lignes de l’assimilation des processus biologiques au fonctionnement des signes que l’on observe ces dernières décennies dans les sciences du vivant. Le rapprochement entre le fonctionnement des cellules et des mots est en effet repris au xxe siècle en biosémiotique mais dans une tout autre perspective, celle de l’aptitude à produire de la signification. La « biologisation » du langage revient ici à retrouver les processus sémiotiques de la signification dans le vivant. C’est le cas, notamment, dans les travaux de Kalevi Kull, Klaus Emmeche ou Jesper Hoffmeyer. Elle conforte l’existence d’un fonds commun qui réunirait l’ensemble du vivant tant sur le plan cellulaire qu’expressif. Dans Introduction to biosemiotics, les auteurs expliquent que, pour la biosémiotique, « toutes les créatures vivantes sont des systèmes sémiotiques37 ». Édeline et Klinkenberg vont en ce sens : « les deux approches, biologique et sémiotique, concordent donc pour identifier vie et sémiose, et ce à un niveau très élémentaire38. » De même, le sémioticien Denis Bertrand et le biologiste Bruno Canque partent de l’hypothèse qu’il y a « des niveaux d’homologie » entre « phénomènes biologiques » et « processus discursifs » et que le langage « pourrait constituer un concept transversal au monde vivant capable de rendre compte de sa matérialité, de sa processualité, ainsi que de son évolution39. » C’était la position du neurobiologiste et théoricien de l’énaction Francisco Varela pour qui « le couplage structurel avec l’environnement ne se réalise pas seulement au niveau de l’individu, mais aussi à plusieurs autres niveaux, allant de la cellule à la population, et sur la base de cycles complets de vie40 » et qui a affirmé : « le langage parlé du sujet se rapproche du langage acté de la cellule41. » Bruno Canque et Denis Bertrand avancent l’idée qu’il y aurait des formes d’énonciation et de cognition dans le fonctionnement de la cellule et font un rapprochement entre cette « praxis énonciative » de la génétique et l’écriture :
Ainsi, l’écriture, par-delà l’oralité, assure la jonction la plus serrée entre la semiosis et le bios. Elle est à la fois décision et inscription, réservoir d’expression, exigence de mémoire : par la matérialité du sens détachée de sa source et déposée sur un support, elle est fondatrice d’une connaissance transmissive et partageable42.
L’ouverture du signe à l’ensemble du vivant
Du symbolisme au naturalisme
22Il faut le reconnaître, dans sa progression vers le vivant, Tortel a eu quelque peine à oublier la tradition symboliste. Dans Cheveux bleus (publié lorsqu’il a 27 ans, mais il y a des poèmes écrits plus tôt, par exemple « Gordes » à 25 ans, en 1931), fleurs et jardins symboliques et mystiques sont omniprésents avec des réminiscences mallarméennes comme le lys, les roses d’Eucharis, les iris. On constate néanmoins une présence déjà très marquée de la nature, de la végétation et de la joie ressentie en son sein. C’est une poésie lyrique, souvent invocatrice et rhétorique. Dans plusieurs recueils, on observe chez Tortel cette tension entre présence et rhétorique. En 1955, dans Naissances de l’objet, Tortel s’engage dans une nouvelle écriture, le programme poétique est lancé : « Nous irons tuer la rose », projette-t-il dans « Raisons du poème43 », signifiant la mort des symboles attachés à la rose. Elle devient ainsi, dans le recueil, présence au monde provocante et née de la lumière. Dans Élémentaires, dès le premier poème, « À partir d’une fleur », la fleur est une forme, un agencement, un double dans un miroir et étrangement cette fois-ci sans senteur associée ; elle est à nouveau un rappel mallarméen de la fleur comme représentation d’une absente. Tortel dit la disparition de l’objet dans les mots, dans le mouvement impersonnel d’une relation poétique : « quelqu’un l’emporte en son obscurité ». Plus loin, cependant, il a besoin de retrouver ce « corps perdu parmi trop de reflets » et y parvient grâce à la prise de conscience du rôle de la lumière. Ici, en effet, la lumière est perçue, mise en exergue comme articulation signifiante ; elle finira ensuite, elle aussi, par se « dénuder » de sa métaphore pour devenir pur phénomène qui précède l’émergence. Une étape pour une nouvelle voie (voix) poétique. « À partir d’une fleur », donc. Alain Pailler observe que le mot « fleur » se raréfie à partir de Relations comme le recours au symbolique et qu’apparaissent à la place les démonstratifs « cela » et « ça44 ». Il s’agit en effet pour Tortel de regarder d’abord la fleur pour ce qu’elle est :
Le commencement de la fleur
C’est elle-même et c’est merveille
de l’y laisser45
23Son existence même est source d’éblouissement :
Toute fleur dans sa volonté d’être
Éblouit le voyant qui n’a qu’à s’incliner46
24Avec Les Saisons en cause, advient une vision littéraire renouvelée de la fleur, perçue dans son lien à la terre, avec un regard quasi-naturaliste. Elle est reconnue comme être vivant qui a sa part d’altérité et des aptitudes appréciatives fondatrices de sa force (elle « balance ») et de sa forme de vie (dotée d’un « bulbe », elle est à la fois « ouverte » et « close » et elle « persiste ») :
La fleur hors de ce là dérange.
Elle persiste au vent se montre
Séparée creuse
(Ouverte ou close) courbe.
Elle balance une chair innumérable
Un corps jamais exactement nommé
(Ce qu’on regarde)
Dans l’air couleurs
Issues d’un filtrage
Souterrain graine
Ou (tulipe) bulbe
Enfoui dans l’hiver47.
25Ceci fait partie d’un projet qui cherche à renouer avec la concrétude des choses et à retrouver le lien à la nature dépouillé de ses oripeaux symboliques, dans une forme d’éco-cosmo-poétique. Alain Pailler considère qu’« Entre tous aiguisé au réel, le regard de Jean Tortel s’avance vers le monde d’avant la parole que perpétue le règne végétal48 ». En ce domaine, rappelle à nouveau Alain Pailler, « le tournant, c’est Relations » :
À l’origine de cette parole se trouve un substrat non verbal. Le monde qui, pour nous, n’a peut-être d’existence que s’il est désigné, existe antérieurement à la parole de ce poète et persiste extérieurement à celle-ci. Les relations de Tortel au végétal nous le rappellent constamment, de même que l’être-au-monde ne commence qu’avec la prise de parole qui aboutira à la figuration du monde49.
Dilemmes…
26Jusqu’où est-on en droit d’aller, quelle limite ne faut-il pas dépasser pour rendre compte de cette vitalité, somme toute plus complexe que ne semblait l’entendre en son temps la philosophie ou le discours rationnel des scientifiques ? La poésie de Tortel est faite de constats, fuites, rétractations mais revient constamment sur la question. À l’image des scientifiques de cette dernière décennie, Tortel a reconnu les formes de l’intentionnalité du végétal dans ses textes mais a souhaité – en naturaliste qui se voulait objectif – rester au plus près de leur physiologie et morphodynamisme. Il y a, on le note à plusieurs reprises, une forme de réticence, un recul inquiet et rationnel face à cette révélation possible, une intuition d’un autre langage dans le monde naturel. Cela fait partie de ce qu’on a pu appeler les « contradictions » ou « tensions » de l’auteur. Lorsqu’il répond à l’« interrogation » du monde vivant, le poète ne pense pas toujours établir une véritable communication. Dans le texte suivant, il récuse toute forme d’intentionnalité allant dans ce sens. L’arbre ne réagit pas à ses actions, ses émotions ; il reste silencieux malgré l’action violente exercée contre lui :
Scintillante avec joie
Ou s’arrachant à soi-même
La même branche
Mais révoltée.
Métaphorique puisque
Révolte ou joie sont mes empreintes
Sur le bois muet50.
27La poésie de Tortel ne cesse pourtant sinon d’attester du moins d’interroger cette capacité à communiquer du végétal vivant, qu’elle soit représentée comme langue, écriture ou parole :
À quelle question répondre
Si passe trop près le vent
Quand les nuées se déchirent
Au-dessus des arbres mous
Cela va s’abattre
En grêlons décharnés
Nulle réponse quand l’arbre
Est emporté avant qu’il ait frémi51
L’arum fleurit.
Blanche et noire,
Toute violence est passagère,
Scintille et disparaît.
La brume
Attend l’orage ou le beau temps.
Et s’il se parle ici
C’est qu’il existerait
(En ce conditionnel incohérent)52.
28Il peut distinguer des « signaux » mais n’en reçoit pas l’« information » :
Celui qui cherche
Une route quelconque
Va vers ce que je dis
C’est vers ce que je dis
Peut-être vert parmi les corps
Dont les signaux diurnes
N’informent pas53.
L’« extension » du langage
29Il y a, malgré son incompréhension, une dimension scripturale accordée aux éléments naturels : pour lui, cela ne fait aucun doute, « Le vert est tracé ». Il est même, avance Pailler, un « punctum » au sens barthésien du terme, qui « condense une énergie », « lieu agrégatif d’une force » qui « peut prétendre prendre place […] parmi un “empire des signes54” ». Nous lisons ainsi, dans Limites du regard :
La tourmente est verdâtre.
Le crayon sauvage du vent
Rature l’espace, recouvre
Les plantes incertaines,
Texte déjà violet, jaune,
Proche de son éclat55.
30Pailler met en exergue le fait que dans Instants qualifiés, les branches de l’arbre ne sont pas « agies » par le vent mais qu’elles ont le « pouvoir d’écrire l’espace » et qu’elles deviennent « métaphore du vers, du tracé, voire de la main traçant / écrivant56 ». Comme cette dernière, la branche « Dérange les brefs espaces / À traverser57 ». Dans Solutions aléatoires, le végétal devient support d’écriture du feu :
La pampe est raturée de noir et si le vent
Se lève la maison
Peut-être brûlera […]
Pour mimer une encre au-delà
Des arbres dont les verticales
Portent très haut le drap
Pourpre enroulé craquant58.
31Dans sa thèse, le critique littéraire avait rapproché Tortel et Ponge, ce dernier évoquant également « l’écriture des végétaux59 » :
Parlant des arbres, Ponge pense qu’« Ils ne sont qu’une volonté d’expression […] ils ne s’occupent qu’à accomplir leur expression, ils se préparent, ils s’ornent, ils attendent qu’on vienne les lire ». Ponge compare le mode d’expression des animaux et des plantes : « L’expression des animaux est orale, ou mimée par des gestes qui s’effacent les uns les autres. L’expression des végétaux est écrite, une fois pour toutes […]. Chacun de leurs gestes laisse […] une présence, une naissance irrémédiable et non détachée d’eux 60. »
32Comme Francis Ponge, Jean Tortel a aussi pensé la spécificité du végétal dans ses facultés étonnantes à communiquer sans paroles, à être divisible sans mourir et à resurgir de sa mort :
Écrire simplement : ça se casse. Essayer de reprendre toute quotidienneté à zéro, et sans lui infliger d’autre valeur que celle de pouvoir être transportée dans le langage. Reprendre à partir du végétal, parce qu’il n’est pas inerte, comme est la pierre, et parce qu’il est disponible, étant sans parole propre. Déjà l’animal parle assez pour qu’à partir de lui, l’anthropomorphisme soit inévitable.
Disponible : pas exactement ; mais maniable en tant que tel sans qu’il se dé-figure par l’action qui s’exerce sur lui ; cependant que le végétal émet assez de signes émouvants pour se maintenir à la limite de l’objet qui devient corps. Il contient et projette assez visiblement les météores, soleil, ombre, pluie, vent, qui l’affectent, pour être un messager cosmique irremplaçable, sans pour cela se prévaloir d’aucun message. Je peux donc, en l’amenant dans mon espace, le détruire (arracher, froisser les feuilles, couper les branches, cueillir, manger) tout en le laissant intact, car il repousse. Il supporte donc mieux qu’un autre l’exercice de la parole dans sa contradiction élémentaire : destruction – érection61.
33Jean Tortel prête également un grand intérêt au monde animal. Dans Les Solutions aléatoires nous rencontrons « des chouettes qui relient à l’origine de l’écoute62 » et le monde animal traverse le champ de présence tortellien : il y a souvent, par exemple, des chiens qui aboient et des chats qui miaulent dans les poèmes. Dans Limites du regard, ce sont les insectes qui sont observés. Tortel était un fervent lecteur de l’entomologiste Fabre. Dans le poème suivant, il est fasciné par la danse érotique des insectes autour des fleurs durant la pollinisation :
La fleur est humide
Elle est une chose lourde
Ronde fermée sans lumière
À l’intérieur
Seul un insecte s’insinue
Comme il s’enfoncerait dans l’eau
Il faut descendre aveugle dans la fleur
Oublier tout attendre qu’elle éclate
Dans le rouge et dans le parfum
Mystérieux qui la composent63
34D’abord imprégné par la pensée essentialiste occidentale (comme Husserl et Merleau-Ponty), Tortel accepte ensuite le non-savoir sur « l’être » puis se rapproche, selon nous, d’une épistémologie écosémiotique. Tortel prend conscience d’une autre forme de communication possible entre les êtres vivants, qui ne passerait pas par les mots : une communication non symbolique. Il retrouve cette conviction chez plusieurs poètes : La Fontaine64, les Romantiques et, parmi ses contemporains, Jean Tardieu, Eugène Guillevic, Francis Ponge et René De Solier, dont la lecture lui a été vivement recommandée par Ponge. Selon Tortel, La Fontaine avait déjà tout compris lorsqu’il affirmait : « Tout parle dans l’Univers / Il n’est rien qui n’ait son langage65. » Tortel récuse finalement l’idée d’une communication purement figurative qui résulterait, par exemple, d’une personnification de la nature car l’échange est signifiant :
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas métaphoriquement que les Romantiques exigent de la nature une réponse ou que La Fontaine entendait le langage universel. Même s’il n’était qu’un écho de la parole humaine renvoyée par un mur, cet aller-retour multiplierait la signification de celle-ci.
35Avec Tardieu et son personnage, le professeur Froeppel, Tortel conçoit parfaitement que les hommes ne sont pas les seuls à communiquer au sein du monde naturel :
Et si le langage, en effet, est le seul moyen de communication possible entre les esprits, n’est-ce pas cet informe balbutiement qui doit être appelé de ce nom ? Peut-être un néant. Et si les sophistications en vue de communiquer étaient une dérision et leur résultat un mensonge ? En réalité les hommes ne peuvent parler entre eux que par le langage qui s’absente de soi. Cette hypothèse est épouvantable si elle n’est pas absurde. Ou bien alors le langage organisé qui n’aide pas à la communication mais qui la gênerait plutôt, n’est qu’une sorte de jeu, grâce auquel un petit nombre d’individus s’exercent à être orgueilleux.
Pour éviter d’être enfermé dans un dilemme, il suffit parfois de lui tourner le dos. Il n’empêche qu’on ne saurait sans s’inquiéter, passer sur une question que se pose le professeur Froeppel. « Serait-ce que l’homme, se demande-t-il, subit en permanence la tentation d’abolir en lui le langage ? » Le professeur Froeppel est un héros que Jean Tardieu conduit à la découverte de « l’infra-langage » et d’une entente secrète, entente qui ne règne pas seulement entre les hommes, se dit le professeur, mais s’étend à la nature entière : « Les signes, les avertissements, les mots de passe étaient partout : dans l’agitation des feuilles, dans la forme et la couleur des nuages, dans une tache de soleil, sur un mur, dans l’aboiement d’un chien66.
36Le minéral aurait lui aussi son « infra-langage ». C’est ce qui semble suggéré dans Des corps attaqués, dans « Insituable est le lieu » :
Cri de plâtre ou fissure
Les morceaux se rejoignent
Seuls.
Cela paraît en ordre
Devant et rien.
Les gestes de la pierre.
Une certaine respiration
Qu’un craquement continuera
Au cœur des lignes, des forces67.
37Pour comprendre et accepter cela, l’homme ne doit plus juger l’univers à l’aune de lui-même. L’anthropocentrisme est un obstacle réel qui ne permet pas d’accéder à la réalité des choses : « L’homme est ainsi, que tout est son masque ou que sur tout il pose un masque, qui est lui68. » La notion de langage doit donc être étendue. C’est ce que prône Tortel en 1946 dans les Cahiers du Sud dans « Dégradation et extension du langage » après sa lecture de De Solier (entendue comme un refus d’anthropocentrisme, la « dégradation » du langage est un phénomène positif) :
Et il est possible que la dégradation en signes conventionnels de la parole vivante constitue la première phase de son extension, la première manifestation de cette entente. Une première marche. On a l’air de descendre… Du poème aux mots, des mots au cri ou au rire ; de là, aux gestes. À partir de ce moment, l’homme commence à parler aux choses à leur façon. Il a suffisamment aboli en lui ce qui faisait son « honneur » pour se retrouver au niveau du monde.
Geste du paysan, du marin, de celui qui a un métier, qui façonne le bois, qui soulève un fardeau. Déjà certains animaux le comprennent ? Peut-être les plantes. Peut-être un jour, les murs eux-mêmes… Il n’est plus séparé de son univers. Il est admis dans la ronde. Il participe au langage total69.
38En 1946, ces questions sont encore problématiques dans les sciences et la linguistique mais le poète entérine l’existence du langage animal, suppose celui des plantes, et dans sa poésie ultérieure, il questionne la capacité à communiquer du vivant. L’écriture écosituée permet de porter un regard neuf sur les forces remarquables, quoique paradoxales et énigmatiques, du végétal. Le poète oublie le symbolisme des corps végétaux et conçoit leur ipséité sans anthropomorphisme ni anthropocentrisme. Il découvre le « langage muet » des plantes. Les végétaux, en effet, savent aussi énoncer, ils ont le pouvoir d’inscrire leurs traces, d’écrire l’espace et de faire le sens du jardin ; ils émettent des signes, entre eux ou vers le monde animal et procurent sensations, émotions et leçons de vie ou de mort à l’homme. L’expérience des Jardins est une confrontation à la philosophie des pré-socratiques et une acceptation de la mort à laquelle végétaux et humains sont soumis. Le poète devient ainsi un sujet ambiant qui renoue et co-énonce avec le vivant.
Conceptions du signe, aujourd’hui, dans les sciences du vivant et les sciences du langage
39De manière assez surprenante, comme nous l’avons expliqué dans un précédent article, la philosophie et la linguistique ont longtemps porté un regard anthropocentré et dominant sur l’animal et le végétal70. La linguistique fut encore plus réticente. À la fin du xxe siècle, la zoosémiotique, issue des travaux de Thomas A. Sebeok ouvre des perspectives intéressantes en prenant appui sur les travaux de Charles Sanders Peirce et sa triade index, icône, symbole71. Sebeok accorde une place prépondérante à la fonction indexicale de la communication animale sans exclure toutefois les deux autres :
[la] triple fonction d’un signe chimique est bien illustrée par la substance d’alarme de la fourmi pogonomyrmex badius […]. Lorsqu’une bouffée de cette phéromone est libérée, la réponse (à faibles concentrations) est une simple attraction, c’est-à-dire que le signe remplit une fonction indicielle […]
Si le danger persiste, le signal se propage. Le signe fonctionne comme une icône dans la mesure où le signal varie proportionnellement à la croissance ou à la diminution des stimuli de danger. La structure moléculaire de la substance d’alarme ne ressemble en rien à l’alarme qu’elle représente. Le lien entre le signe véhicule et son objet dépend de ce que Peirce appelle une « connexion habituelle » entre les deux, et satisfait donc sa condition de symbole (notre traduction)72.
40Depuis, l’éthologie animale étudie également les gestes et postures et le rôle de l’émotion dans la communication. La phytosémiotique propose également, dans la voie peircienne, une conception de la communication végétale. L’écueil principal de ces théories est leur usage fréquent et frileux du terme « signal » qui rappelle le propos de Benveniste sur les abeilles : « ce n’est pas un langage, c’est un code de signaux73 ». Au tournant du xxie siècle, cette théorie du signal, appliquée au vivant non humain, est encore usitée en éthologie74 et reste présente chez Catherine Kerbrat-Orrechionni qui a cependant réfléchi à la communication animale (en la pensant dans le cadre du schéma de la communication de Roman Jakobson, des tours de parole et des actes de langage75). Pour l’écosémioticienne Nicole Pignier, le signal est un terme qui vient des télécommunications et appartient à la technique. Le signal est « gérable par une machine » et ne relève pas du vivant76. En 2022, la sémioticienne Astrid Guillaume va dans le même sens, réfute à nouveau la position de Benveniste et prend parti pour le « langage des abeilles77 ». Concernant les végétaux, la communication externe et interne des plantes est décrite par le botaniste et biologiste Francis Hallé dans Éloge des plantes78. Kalevi Kull, pour sa part, a défini l’objectif de la phytosémiotique : l’étude des « phénomènes sémiotiques qui sont spécifiques aux plantes » en établissant un parallèle entre « besoin » et « sémiose79 ». Nicole Pignier va plus loin et dote les végétaux de facultés co-énonciatives : « ils énoncent au sens où ils manifestent quelque chose d’eux-mêmes à leur milieu » dans une « co-énonciation créative et non déterministe avec l’Oikos80 ». La modalisation des énoncés se traduit dans des tensions appréciatives qui naissent dans les interrelations. Ainsi, pour Nicole Pignier, le « signal chimique des SVT est un signe81 ». La signification naissant d’une relation synesthésique à un milieu donné, l’écosémioticienne pense que « les facultés du vivant à énoncer, à manifester quelque énoncé au sein de leur milieu relèveraient d’une différence de degrés davantage que de nature82 ».
Conclusion
41Dans notre recherche en écosémiotique, la question du signe nous a conduite à considérer avec Jean Tortel qu’il y a signe pour tous les ordres du vivant. Lorsque le poète arguait que l’émotion est la forme première et proto-linguistique de la communication, il aurait certainement adhéré, pensons-nous, à l’idée d’une théorie générale des signes étendue à l’ensemble du vivant. Au fil de notre recherche nous avons constaté que les réflexions menées tout au long de sa carrière remettaient en question les conceptions du signe les mieux installées. Mais, surtout, il a proposé une poétique positive qui nous apprend à regarder autrement la nature, tout particulièrement le végétal, et qui permet d’élargir notre perspective sur les formes de vie et les mondes de sens. À nous de poursuivre cette « extension du langage », de nous ouvrir à d’autres mondes de signification et, ainsi, de mieux les comprendre, mieux les respecter, et mieux « co-énoncer ».
1 Par exemple, Pierre Schoentjes, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, Marseille, Wildproject, 2015 ou Scott Knickerbocker, Ecopoetics. The language of nature, the nature of language, University of Massachusetts Press, 2012. Nous notons l’intérêt de l’écocritique comme celui de l’écopoétique et n’entrons pas dans la polémique qui tend à les opposer dans leurs visées et leur éthique. Sur ce sujet, le lecteur peut se référer à l’article de Stéphanie Posthumus, « Écocritique : vers une nouvelle analyse du réel, du vivant et du non-humain dans le texte littéraire », dans Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes, dir. Guillaume Blanc, Élise Demeulenaere et Wolf Feuerhahn, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 161-179. Le lecteur peut également consulter l’article de Michel Collot, dont nous partageons l’opinion lorsqu’il estime cette controverse excessive, dans Michel Collot, « Écocritique vs écopoétique ? », Essais critiques, Acta fabula, vol. 24, no 6, 5 juin 2023.
2 Nicole Pignier, « Fondements d’une écosémiotique. Vie du sens, sens du vivant ? » dans Construire le sens, bâtir les sociétés, dir. Lamine Ouédraego et Joseph Paré, Paris, Connaissances et Savoirs. Itinéraires sémiotiques, 2021, p. 43.
3 Nous lisons ainsi, dans Ratures des jours, en date du 19 mars 1969 : « D’où vient que le mot “structure” vient si tardivement sous la plume et après tant d’autres qui le cernaient si gauchement ? C’est que ça m’embête de l’employer aujourd’hui, c’est-à-dire au moment de l’idéologie et de l’écriture où il se fourre partout. » Jean Tortel, Ratures des jours, journal 1955-1969, Marseille, André Dimanche, Ryoân-ji, 1994, p. 134.
4 Dans la théorie de Ferdinand de Saussure, le signe linguistique associe un concept (le « signifié ») à une « image acoustique » (le « signifiant », l’« empreinte psychique du son »). Le signe est arbitraire et immotivé : il n’y a pas de relation de causalité ou de nécessité entre les deux faces du signe. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Éditions Payot et Rivages, « Grande bibliothèque Payot », 1916, 1972, 1985, 1995, p. 100 et p. 108-113.
5 La notion d’« arbitraire » chez Jean Tortel a été étudiée par Lucie Bourassa, « Tout encore à dire : figurations du langage chez Jean Tortel », dans « Relire, relier Jean Tortel » (textes réunis par Catherine Soulier, actes du colloque 19-20 avril 2011, Université Paul Valéry, Montpellier III), revue Triage, supplément 2013, Tarabuste éditions.
6 « On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie générale ; nous la nommerons sémiologie (du grec sēmeîon, « signe »). Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut dire ce qu’elle sera ; mais elle a droit à l’existence, sa place est déterminée d’avance », Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, chapitre 3 : « Objet de la linguistique », éd. citée, p. 33.
7 Jean Tortel, Progressions en vue de, Montrouge, Maeght, 1991, p. 51.
8 Id., Les Villes ouvertes, Paris, Gallimard, 1965, p. 9.
9 Id., De mon vivant, « Passage des hommes », Marseille, Cahiers du Sud, 1942, p. 85.
10 Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Marseille, Actes Sud, « Babel Essai », 2021, p. 139.
11 Ibid., p. 40. Pascal Quignard dans Mourir de penser, « dernier royaume IX », Paris, Folio, 2016, p. 20-24, fait également se rejoindre pensée et sensibilité dans la trace : « Penser, c’est renifler la chose neuve qui surgit dans l’air qui entoure. »
12 Jean Tortel, Arbitraires espaces, Paris, Flammarion, 1986, p. 69.
13 Sylvain Auroux, La Philosophie du langage, Paris, PUF, « Premier cycle », première édition, 1996.
14 Umberto Eco, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF, « Quadrige », première édition française, 1988, première édition italienne, 1984.
15 Umberto Eco, Le Signe, Bruxelles / Paris, Édition Labor / Le livre de poche, « biblio essais », 1988.
16 Ibid., p. 23.
17 Aristote, Organon, « De l’interprétation », traduction de 1963 de Jean Tricot, éditions Les échos du maquis, chapitres 2-4.
18 C’est un type de signe que le sémioticien François Rastier replace dans le paradigme indiciaire. François Rastier, « De la signification au sens. Pour une sémiotique sans ontologie », juin-septembre 2003 [en ligne],
19 Saint-Augustin, Œuvres complètes, 3, Philosophie, catéchèse, polémique, « Enseigner le christianisme », Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 33-34.
20 Au xviiie siècle, l’abbé Batteux distingue également « signes arbitraires » et « signes naturels » : « Le Brun et Quinte-Curce ont peint tous deux les batailles d’Alexandre. Celui-ci avec des signes arbitraires et d’institution qui sont les mots ; l’autre avec des signes naturels et d’imitation qui sont les traits et les couleurs. » Mais l’abbé Batteux s’intéresse à l’imitation et au vraisemblable dans les arts. Les signes naturels ne sont pas les signes directement produits dans la nature. Voir Abbé Batteux, Principes de littérature, 5e édition, Paris, Saillant et Nyon, 1774. Ouvrage disponible sur le site Gallica de la BNF.
21 Umberto Eco, Le Signe, éd. citée, p. 48.
22 Charles Sanders Peirce, Écrits sur le signe, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 1978, p. 125.
23 Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain, traduit par Charles Martin-Fréville et préface de Dominique Lestel, Paris, Bibliothèque Rivages, 2010, p. 48.
24 Maurice Merleau-Ponty, La Prose du monde, Paris, Gallimard, 1969, p. 111.
25 Ibid., p. 52-53.
26 Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, Paris, PUF, 1986, p. 8-9.
27 Joseph Courtès, Algirdas Julien Greimas, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, PUF, 2013, p. 233.
28 Algirdas Julien Greimas, Du sens. Essais sémiotiques, « Conditions d’une sémiotique du monde naturel », Paris, Seuil, p. 63-82.
29 Voir également Jacques Fontanille, « La base perceptive de la sémiotique » dans Signs and Signification, Language Forum series in semiotics 1, vol. 1, New Delhi, Gill. Manetti, Bahri publications, 1999.
30 Francis Édeline, Jean-Marie Klinkenberg, « Pourquoi y-a-t-il du sens plutôt que rien ? », Signata, no 2 : « Abrégé de sémiogénétique », 2011, p. 281-313.
31 Allusion à Algirdas Julien Greimas, De l’imperfection, Paris, Pierre Fanlac / Seuil, 1991.
32 Voir les nombreuses références à Jean Tortel dans Pierre Ouellet, Poétique du regard. Littérature, perception, identité, Limoges, Pulim, « Septentrion », 2000.
33 Carita Klippi, La Vie du langage : la dynamique linguistique en France de 1864 à 1916, Lyon, ENS éditions, 2010, p. 92.
34 Jean Tortel, Le Trottoir de trèfle, Marseille, André Dimanche, Ryoân-ji, 1980, p. 65.
35 Jean Tortel, Ratures des jours, journal 1955-1969, Marseille, André Dimanche, Ryoân-ji, 1994, p. 73.
36 Note manuscrite d’Émile Benveniste à la BnF, PAP 24129 que l’on peut lire dans Émile Benveniste. 50 ans après les Problèmes de linguistique générale, sous la direction d’Ottavi et Irène Fenoglio, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2019, p. 22.
37 Marcel Barbieri (éd), Introduction to Biosemiotics. The New Biological Synthesis (livre dédié à Thomas Sebeok), 2007.
38 Francis Édeline, Jean-Marie Klinkenberg, « Pourquoi y-a-t-il du sens plutôt que rien ? », art. cité, p. 281-313.
39 Denis Bertrand, Bruno Canque, « Sémiotique et biologie. Le “vivant” sur l’horizon du langage », Signata, no 2 : « Abrégé de sémiogénétique », 2011, p. 195-220.
40 Francisco Varéla, Le Cercle créateur, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2017, p. 67.
41 Ibid., p. 220.
42 Denis Bertrand, Bruno Canque, « Sémiotique et biologie » dans La Sémiotique en interface, dir. Amir Biglari et Nathalie Roelens, Paris, Kimé, 2017, p. 597-608.
43 Jean Tortel, Naissances de l’objet, Marseille, Cahiers du Sud, 1955, p. 137-138.
44 Alain Pailler, Figures d’un monde végétal. Approches de Jean Tortel, Thèse de troisième cycle. Montpellier III, 1985, p. 168.
45 Jean Tortel, Limites du regard, Paris, Gallimard, 1971, p. 31.
46 Ibid., p. 36.
47 Jean Tortel, Les Saisons en cause, Marseille, Ryoân-ji, 1987, p. 89.
48 Alain Pailler, Figures d’un monde végétal. Approches de Jean Tortel, op. cit., p. 240.
49 Ibid., p. 249.
50 Jean Tortel, Instants qualifiés, Paris, Gallimard, 1973, p. 33.
51 Jean Tortel, Limites du regard, éd. citée, p. 14.
52 Ibid., p. 117.
53 Jean Tortel, Précarités du jour, Paris, Flammarion, 1990, p. 77.
54 Alain Pailler, Figures d’un monde végétal. Approches de Jean Tortel, op. cit., p. 139.
55 Jean Tortel, Limites du regard, éd. citée, p. 113.
56 Alain Pailler, Figures d’un monde végétal. Approches de Jean Tortel, op. cit., p. 143-144.
57 Jean Tortel, Instants qualifiés, éd. citée, p. 59.
58 Id., Les Solutions aléatoires, Marseille, éditions Ryoân-ji, 1983, p. 75-76.
59 Alain Pailler, Figures d’un monde végétal. Approches de Jean Tortel, op. cit., p. 154.
60 Ibid., p. 149.
61 Jean Tortel, Ratures des jours, éd. citée, p. 228.
62 Id., Des solutions aléatoires, éd. citée, p. 79.
63 Id., Limites du regard, éd. citée, p. 35.
64 Avec France Farago, nous retiendrons qu’au xvie siècle également, « loin de devoir être subsumé sous le concept de l’artifice et de la culture, le langage doit être appréhendé en tant que nature ». Elle cite à l’appui Michel Foucault qui rappelle, dans Les Mots et les Choses, que le langage ne semblait alors pas étranger aux choses du monde mais au contraire résider parmi elles, « parmi les plantes, les herbes, les pierres et les animaux ». France Farago, La Nature, Paris, Armand Colin, « U. Philosophie », 2000, ch. 10, p. 201-213.
65 La Fontaine, Épilogue, Livre XI, fable 10, citée par Jean Tortel dans « Dégradation et extension du langage », d’abord paru dans Cahiers du Sud, no 282, 2e semestre 1946 puis repris dans Le Trottoir de trèfle, éd. citée, p. 17.
66 Jean Tortel, Le Trottoir de trèfle, éd. citée, p. 17 pour les deux citations.
67 Id., Des corps attaqués, Paris, Flammarion, 1979, p. 99.
68 Id., Le Trottoir de trèfle, éd. citée, p. 18.
69 Ibid., p. 19.
70 À quelques exceptions près en philosophie avec Montaigne, Voltaire, Derrida. Voir notre article : Mireille Mérigonde, « Transition écologique, transition littéraire ? Une vision renouvelée de la communication du vivant dans les Sciences et les Humanités », Actes du congrès de l’Association Française de Sémiotique, 2022, https://doi.org/10.25965/as.8519, page consultée le 7 avril 2025.
71 Nous louons Philippe Descola lorsqu’il déclare qu’Eduardo Kohn a jeté « les bases d’une sémiologie trans-espèces » et que son livre est « un essai à la fois philosophique et poétique sur ce que c’est pour un signe d’être vivant ». Voir Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Vers une anthropologie au-delà de l’humain, Le Kremlin-Bicêtre, Zones sensibles, 2017). Mais nous regrettons que Philippe Descola ne fasse pas honneur aux travaux antérieurs sur la communication animale, tout particulièrement ceux de Thomas A. Sebeok dont nous conseillons la lecture de « On chemical signs » dans Essays in semiotics, dir. Julia Kristeva, Josette Rey-Debove, Donna Jean Umiker, Berlin, De Gruyter Mouton, 1971, ch. 35, p. 549-559.
72 Thomas A. Sebeok, « On chemical signs », art. cité, p. 551 : « this triple function of a chemical sign is well illustrated by the alarm substance of the ant pogonomyrmex badius […]. When a puff of this pheromone is released, the response (at low concentrations) is simple attraction, that is, the sign performs an indexical function […] if the danger persists, the signal spreads. The sign functions like an icon in that the signal varies in proportion as the danger stimuli wax or wane. The molecular structure of the alarm substance in no way resembles the alarm “it stands for”. The link between the sign vehicle and its object depends on what Peirce calls a “habitual connection” between the two, and therefore satisfies his condition for a symbol. »
73 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1966, chap. V : « Communication animale et langage humain », l’article débute en ces termes : « Appliquée au monde animal, la notion de langage n’a cours que par abus de termes. On sait qu’il a été impossible jusqu’ici d’établir que les animaux disposent, même sous une forme rudimentaire, d’un mode d’expression qui ait les caractères et les fonctions du langage humain », p. 55-62.
74 Voir Anne-Sophie Darmaillacq et Frédéric Lévy (coord.), Éthologie animale. Une approche biologique du comportement, Louvain-la-neuve, Deboeck Supérieur, 2019.
75 Comme Baptiste Morizot dans Manières d’être vivant, Postface d’Alain Damasio, Arles, Actes sud, « Mondes sauvages », 2020. Voir Catherine Kerbrat-Orecchioni, Nous et les autres animaux, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2021.
76 Nicole Pignier, « Fondements d’une écosémiotique. Vie du sens, sens du vivant ? », dans Construire le sens, bâtir les sociétés, op. cit., p. 52.
77 Astrid Guillaume, « La sémantique et la sémiotique au service du langage animal », dans Regards sur l’animal et son langage, sous la direction de Sandra Contamina et Fernando Copello, Presses universitaires de Rennes, 2022, p. 115.
78 Francis Hallé, Éloge de la plante. Pour une nouvelle biologie, Paris, Éditions du Seuil, 1999.
79 Kalevi Kull, « Introduction à la phytosémiotique : botanique sémiotique et systèmes de signes végétatifs », dans Sign system studies, Université de Tartu, 2000.
80 Nicole Pignier, « Fondements d’une écosémiotique. Vie du sens, sens du vivant ? », art. cité, p. 46.
81 Ibid., p. 52.
82 Ibid., p. 47. Voir également Nicole Pignier, « Le sens, le vivant ou ce qui nous relie à la Terre », Interfaces numériques, 1/2020 [en ligne] : « Notre approche écosémiotique nous amène à questionner le périmètre de l’énonciation et à l’élargir aux capacités des êtres vivants dans leur ensemble », p. 3. Sur sa conception de l’intentionnalité comme « tension appréciative », voir p. 4-5.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2099.html.
Quelques mots à propos de : Mireille Mérigonde
Mireille Mérigonde est Professeur de Lettres, Docteur en Sciences du langage et Chercheur associé au CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques à la FLSH de Limoges). Elle a publié des articles sur la représentation du vivant dans les arts et la littérature et ses enjeux : « George Sand et le sens du vivant. Lecture écosémiotique de trois récits champêtres : La Mare au Diable, François le champi, La Petite Fadette », Cahiers George Sand, 2024 ; « L’art écologique selon Paul Ardenne : extensions et limites d’un genre », Visible, 2024 ; « Transition écologique, transition littéraire ? Une vision renouvelée de la communication du vivant dans les sciences et les humanités », Actes du congrès de l’Association Française de Sémiotique, 2022, https://doi.org/10.25965/as.8519.
