Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
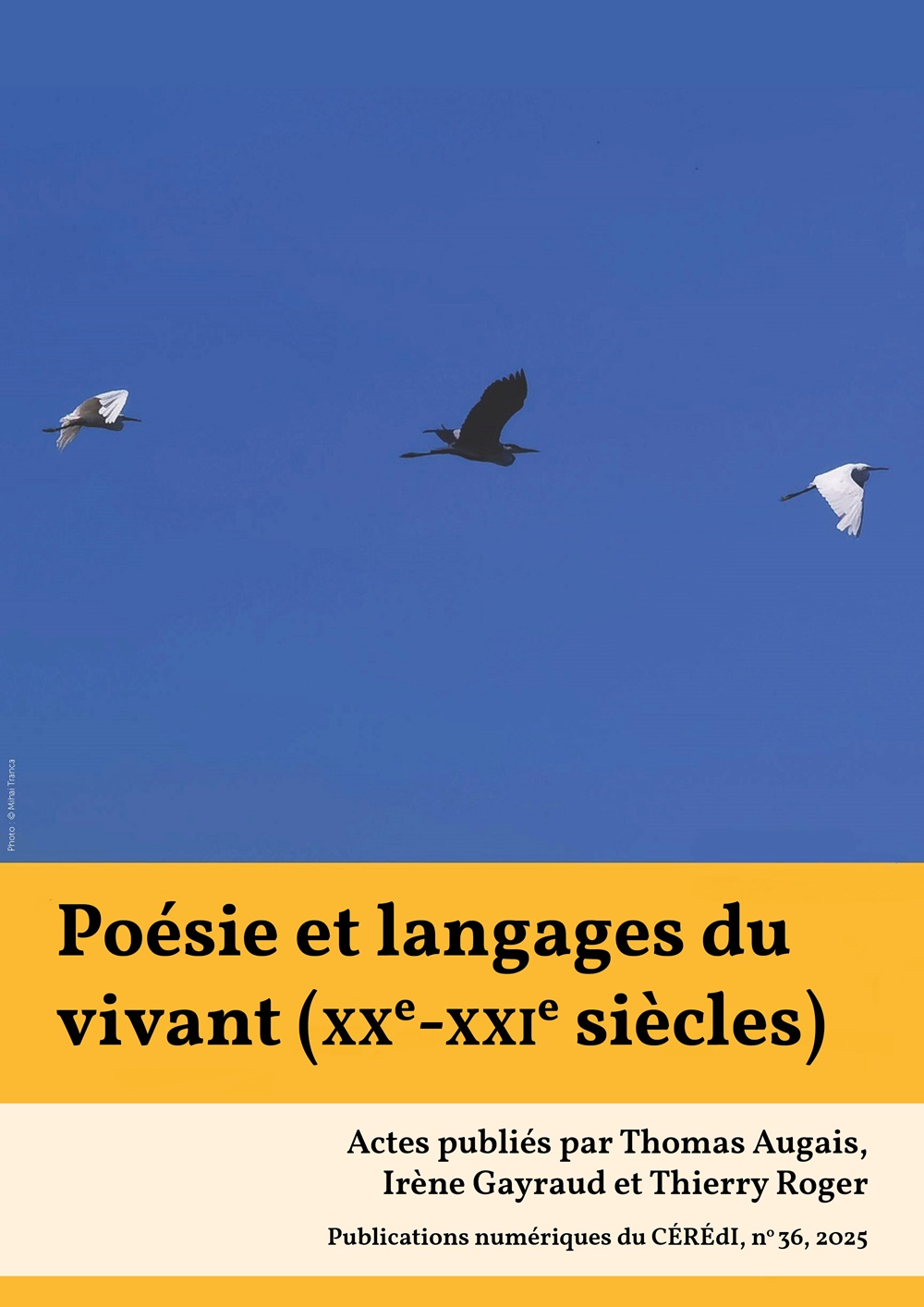
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Introduction
Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
1On a touché au langage ! L’instrument ancien, privilège hautain de l’homo loquens, impavide houlette du berger de l’Être, est-il en train de nous filer entre les doigts pour servir de pâture aux loups et aux agneaux, de perchoir aux perroquets ou même rouler encore plus loin dans la confusion végétale ou la nuit minérale ? C’est à une telle question que souhaiterait réfléchir ce volume.
2Les études dans les domaines de l’écocritique et de l’écopoétique connaissent en effet depuis quelques années une nette accélération, accompagnant les travaux des anthropologues et des philosophes (Bruno Latour, Philippe Descola, Baptiste Morizot, Vinciane Despret) qui nous conduisent à remettre en question l’opposition entre nature et culture. Parallèlement, les travaux des biologistes, des éthologues, des spécialistes de la communication animale et même végétale nous conduisent de jour en jour à réévaluer la notion même de langage, et posent un grand nombre de questions sur les rapports entre le langage humain et les autres formes de langage. Ils conduisent à s’interroger sur la « fin de l’exception humaine1 », pour reprendre les mots de Jean-Marie Schaeffer.
3Cet ouvrage a pour vocation de remettre la poésie au premier plan dans ces recherches, qui ont pour l’instant été très centrées sur la fiction romanesque et l’essai, alors que la poésie ne cesse de s’interroger sur l’articulation entre le langage et le réel, et que l’imaginaire poétique ne se satisfait pas des frontières entre les règnes. Ce désintérêt relatif – des études écocritiques aux études écopoétiques – pour la poésie est doublement paradoxal : d’une part, la poésie est un genre qui a dès l’Antiquité placé au cœur de ses préoccupations le rapport à la nature, ainsi que le lien entre la parole du sujet lyrique et le chant du monde, ce que souligne Michel Collot :
La poésie […] constitue le chemin le plus direct qui s’offre au langage pour revenir à l’oïkos, au lieu de notre séjour, parce que la structure rythmique du vers lui-même […] est une réponse aux propres rythmes de la nature, un écho au chant de la terre elle-même2.
4D’autre part, de nombreux poètes contemporains produisent, en parallèle de leurs œuvres poétiques, des essais qui mettent au jour la vocation écologique, écopoétique ou géopoétique de leur travail (Michel Deguy3, Jean-Claude Pinson4, Jean-Christophe Bailly5, Pierre Vinclair6, Fabienne Raphoz7, Kenneth White8, Gary Snyder9…) Cette multiplication d’écrits réflexifs venus des poètes eux-mêmes révèle un besoin de théorisation et d’exploration, loin de tout irénisme, « de la poésie comme écologie » face à la « catastrophe » devenue « indépassable10 ». Dans le domaine de la zoopoétique, ouvert par les travaux pionniers d’Anne Simon11, une première thèse, celle de Flora Souchard, Poésie et Dynamique animale. Jules Supervielle, Saint-John Perse, René Char a été soutenue en 2019. Le colloque de Toronto sur « Le rugissement de la langue. Poésie et animalité » (11-12 mai 2023), organisé par Mendel Péladeau-Houle et Patrick Thériault, nous montre qu’une dynamique s’amorce. Quant au mot « écopoésie », il fait son entrée en 2024 dans le Dictionnaire du lyrique sous la plume de Marielle Macé12, qui esquisse une définition en lien avec le nature writing américain et l’anthropologie de la nature chère à Philippe Descola. La notice donne un premier corpus (de Virgile à Aurélie Foglia, Sophie Loizeau, Fabienne Raphoz, Pierre Vinclair, en passant par Ponge, Deguy, et la théorisation de Jean-Claude Pinson), et tente une rapide périodisation (« moment pastoral », « moment « troubadour », « moment romantique »). Notons cette remarque décisive ici : l’écopoétique du poème engage « une réflexion sur la “logie” de l’écologie ».
5Cherchant à capter l’élan du vivant dans leur corps et dans leur langue, les poètes éprouvent leur pouvoir au point où leur moi s’illimite. Face au vivant perçu dans son extériorité, il arrive au contraire qu’ils rencontrent également leurs limites, cherchant de quelle manière le verbe poétique pourrait retenir quelque chose de la complexité des intrications du monde naturel, de la fugitivité des phénomènes. C’est alors par la conscience critique du langage, qu’aura manifestée au plus haut point la poésie depuis Mallarmé que celle-ci rencontre le vivant, justifiant de prêter attention à ce que les poètes ont à nous apporter dans ce domaine. L’ensemble des textes rassemblés ici n’aura donc pour horizon que de préciser l’éventail des relations que peuvent nouer expressivité du vivant et expressivité du poème. Cette attitude critique du poète revient d’abord à identifier le risque qui conduirait le langage humain à se couper de la vie, alors qu’il est peut-être dans sa nature (osons le terme), linguistiquement, de prendre un tel chemin. Patrick Suter le rappelle dans son article. Certes, « vue par les poètes, toute fleur […] peut […] entraîner une extension de la sensation ou de la compréhension de la vie ». Cependant, d’un certain point de vue mallarméen-blanchotien, la langue met à mort le vivant par le concept : « le mot fleur n’est qu’une trace d’encre sur le papier. » Pour le dire autrement, « le poème écrit et imprimé échappe aux cycles de la vie ». Il faudrait donc constamment garder à l’esprit ce constat, au risque de verser dans une « écologie des signes » dissociée d’une « écologie de la vie ». La retenue d’un Philippe Jaccottet pourra alors servir de guide pour fonder « une relation avec le monde du vivant impliquant que ce dernier ne soit pas subsumé par la parole humaine ».
6Les poètes de L’Éphémère, amis de Jaccottet, ont en effet cherché des issues à cette mise à mort du vivant par le concept, ils ont cherché « l’entraînement du concept sur la voie qui en franchit l’horizon13 ». Par ailleurs, ces auteurs ne considèrent pas l’écrit comme un figement définitif mais comme l’étape d’une œuvre en cours, toujours à reprendre, faisant leur la formule de Giacometti : « Des essais, c’est tout14 ! » La poésie par ailleurs sort du livre, le développement des lectures publiques et performances poétiques remettent la physiologie au premier plan. Pour André du Bouchet, la lecture silencieuse et la lecture à haute voix sont d’abord l’épreuve d’une matérialité : matérialité de la page pour la lecture, sa blancheur, son grain, les multiples chocs visuels presque imperceptibles de la typographie et de la mise en page… Matérialité du son lors de l’écoute : le grain de la voix, le souffle, l’articulation et la phonation, les accidents de terrains consonantiques et les couleurs vocaliques… Par l’acte de la lecture, lorsque les mots à l’aveugle nous parviennent en tant qu’auditeurs, il y une relation qui se reconfigure, se remet en jeu dans le grand jeu du monde en mouvement. Ce qui importe à André du Bouchet dans l’expérience de l’écoute, ce n’est pas le moment où le lecteur devient capable de conceptualiser ce qu’il a pu entendre, c’est plutôt de proposer un équivalent sonore à la « relation colorée d’un tenant et d’un bloc15 » qui l’attire dans la peinture d’un Tal Coat ou d’un Bram van Velde. Le poétique, vu comme « écho-système », économie de la Rime du vivant, a donc un rôle décisif à jouer au sein de ce qui doit être pensé comme une « écologie générale » (Patrick Suter).
7Les avancées des sciences du vivant semblent rencontrer certaines intuitions poétiques. « Que serait la biologie sans les poètes ? », s’interrogeait Francis Hallé citant Ponge et Valéry. Or, ces deux poètes ont interrogé de manière critique les rapports entre langage et corporéité :
La poésie, écrit Valéry dans ses Cahiers, préside aux rapports du langage avec le corps en tant que le mouvement et les variations de l’énergie dégagée par l’excitation verbale entrent en échange réciproque avec les sensations auditives, les significations, les images16.
8Familier des laboratoires des biologistes, comme l’a rappelé Hugues Marchal, Valéry a entrepris de montrer dans son Discours sur l’esthétique que « la Poïétique, étude de la production des œuvres, autant que l’Esthésique, étude des sensations, [devaient] se pencher sur les “racines psychiques et physiologiques17” de ces deux activités18 ». Il ajoute dans ses Mélanges (1939) :
Le plus grand poète possible – c’est le système nerveux.
L’inventeur du tout – mais plutôt le seul poète19.
9Le regard poétique sur le vivant commence donc par l’attention au vivant en soi, à soi-même en tant que vivant, pour se porter à partir de cette expérience intime vers le vivant hors de soi, prenant alors le parti « des choses », comme y invite Ponge, mais plus généralement des êtres animés comme inanimés, mimosa, crevette ou galet. Et de même qu’il s’agissait pour Hubert Damisch de « prendre langue avec l’image20 », ce ne pourra être que pour prendre langue avec le vivant, considérant que la langue n’est peut-être qu’un des domaines du vivant, hors de toutes frontières préétablies. Mais à partir de quoi, pour le poète, prendre langue avec le vivant ? Un tel passage des langages du vivant aux langues humaines ne peut se faire, d’après Michel Collot, sans « médiations » : « L’une d’entre elles est peut-être, pour les hommes comme pour les animaux, la perception, qui convertit le monde naturel en un monde sensible doué de sens ». Michel Collot rappelle alors que la phénoménologie de Merleau-Ponty a fait de la perception un « point de passage » entre Nature et Logos, dans la mesure où c’est « par la nature en nous que nous pouvons connaître la Nature, et réciproquement, c’est de nous que nous parlent les vivants21 ». Il ne s’agit plus dès lors pour les poètes qu’il analyse dans une perspective écophénoménologique
d’imiter une natura naturata mais d’inscrire la poiesis dans le mouvement créateur de la natura naturans, pour donner au poème un dynamisme délivré des contraintes et des régularités, une forme toujours en transformation et faire de lui non plus le reflet d’un cosmos immuable, mais un chaosmos.
10Dans les démarches poétiques de nombreux poètes dont il est question dans ce volume, la nature reste néanmoins considérée comme une interlocutrice à l’altérité de laquelle il faudrait parvenir à ouvrir le langage humain. Les peintres ont ouvert la voie à d’autres types de démarches en rompant avec la figuration. N’ont-ils pas délaissé l’antique tradition de la mimèsis en souhaitant s’affranchir d’une certaine approche conceptuelle du réel, affirmant que l’imitation d’une nature extérieure à soi devait laisser place à un geste pictural impulsé par l’effraction hors de soi d’une force naturelle intérieure, c’est du moins la voie suivie par exemple par le courant dit de « l’abstraction lyrique22 » ? De même dans l’œuvre de Gherasim Luca, c’est la langue elle-même bousculée par la force projective de l’expression poétique qui devient l’alpha et l’oméga du rapport au vivant, sans se faire le lieu d’un quelconque discours sur la nature ni même d’une volonté de la décrire, de la traduire ou simplement de rendre compte des perceptions sensorielles liées à la rencontre avec le dehors, comme le fait par exemple André du Bouchet dans ses Carnets. L’article d’Alexis Messmer dans ce volume propose d’éclairer un tel rapport au langage chez le poète roumain – dont il rappelle qu’il a étudié la chimie à l’Institut Polytechnique de l’Université de Bucarest de 1930 à 1932 – à partir des notions de « métabolisation » et d’« autopoïèse ». Les transformations que ce poète fait subir au lexique et à la syntaxe relèveraient d’une « dynamique vivante », celle qui bouleverse le jeu des formes en d’incessantes métamorphoses, le fonctionnement de la langue étant pensé comme analogue au fonctionnement du vivant, comme le démontre par exemple l’analyse morphosyntaxique du poème « Prendre corps23 » débutant en ces termes : « Je te flore / Tu me faune ». Alexis Messmer propose alors de transposer dans la sphère linguistique le concept-clé de la biologie de Jacob von Uexküll24 pour envisager un « Umwelt discursif » : « Cet Umwelt serait donc le monde subjectif médié par la langue d’un être parlant et de sa communauté linguistique, c’est-à-dire la manière de percevoir et d’interpréter des énoncés. »
11Plus généralement, comment peut-on penser le langage humain à partir de l’évolutionnisme biologique ? On sait par exemple qu’un poète comme Lorand Gaspar tend à abolir toute distinction de nature entre la matière animée et la matière inanimée, que pour lui pierres et animaux sont traversés par le même « texte » de la vie. Ce poète a par ailleurs prêté une grande attention au geste des artistes – Zao Wou Ki, Henri Michaux, T’ang Haywen – dans leur capacité à s’insérer dans ce qu’il nomme le tissage du vivant. Or, l’article d’Anne Gourio sur Lorand Gaspar et celui de Barbara Bourchenin sur l’artiste Jean Dupuy proposent tous les deux de considérer les lumières nouvelles que projettent certaines œuvres contemporaines sur des notions venues d’un temps où l’ensemble du vivant trouvait son unité et son sens dans le verbe divin d’un Dieu créateur, celles de livre du monde, de signature des choses. Loin de tout ésotérisme, Lorand Gaspar rejette l’idée d’un Dieu créateur et transcendant pour une vision résolument immanente de ce que peut être la genèse, non une création in illo tempore, dans un geste unique, mais une création ininterrompue, sans cesse reprise25. Dans son article, Anne Gourio nous propose de revenir à la « lisibilité du monde » telle que l’envisage Hans Blumenberg26, c’est-à-dire comme un « projet heuristique de déchiffrement de la nature », pour souligner la révolution que constitue pour ce philosophe comme pour le poète la découverte du génome : « Désormais, le “livre du monde” n’est plus tout à fait une métaphore : il renvoie à une réalité attestée scientifiquement, celle du déchiffrement d’un code propre à chaque être vivant. » Anne Gourio nous propose donc de relire Approche de la parole (1978), ce livre où le poète-médecin Lorand Gaspar27 refait tout le chemin de la molécule d’ADN jusqu’à la parole poétique pour montrer que le langage de l’homme est « organiquement lié au langage de la vie28 » et qu’il n’y a même pas lieu de séparer l’animé et l’inanimé : « Je ne vois pas d’interruption entre le langage de la matière, celui de la vie, le discours de l’homme et celui de la société29. » La « structuration de la matière par le génome », au niveau interne de la cellule comme au niveau de « l’interaction des cellules entre elles » constitue donc aux yeux de Gaspar, indique Anne Gourio, « un langage premier et universel qui, unifiant le vivant, offre les conditions de possibilité d’un échange entre tous les êtres, reposant sur une lisibilité généralisée ». Cela n’implique pas pour autant un accès du poète à la transparence totale du sens. En effet, « Là où l’œil veut lire, il ne perçoit que des traces subsistantes », le texte poétique, davantage qu’à un décodage, s’apparente alors « au bruissement du sensible, à ses chuchotements insaisissables, à ces traces laissées mystérieusement par des êtres passés furtivement ». La poésie, même celle si scientifiquement consciente de Lorand Gaspar, n’est-elle alors qu’une façon de replonger la science lampadophore dans la nuit du non-savoir ? Elle n’aborde le langage que par ses failles, ses trouées, consciente des blancs par lesquels ce langage respire : le décryptage des langages du vivant doit donc toujours avoir pour corollaire la conscience réaffirmée de la part d’indécryptable de toute vie, par laquelle elle échappe au langage et paradoxalement le maintient vivant par cet acte même. Barbara Bourchenin nous invite elle aussi à nous interroger sur la « lisibilité du monde » à partir des œuvres de Jean Dupuy, artiste en quête d’une « litholinguistique », d’un « langage des pierres » lorsqu’il glane des galets en forme de lettres pour les assembler en poèmes. Mais c’est pour souligner quant à elle que si pour Giorgio Agamben, la signatura rerum rend le signe intelligible, Jean Dupuy en livrant les pierres formant lettres qu’il glane dans la nature à un processus d’anagrammatisation continue vise moins la résorption du sensible dans l’intelligible que l’horizon d’un « continuum » entre langage humain et langage lithique :
Les anagrammes, en tant qu’agencements et images précaires dont la signature est éphémère, n’existent que dans le maintenant de la lecture. Pour parler avec Walter Benjamin, anagrammes et poèmes de galets existent comme des images dialectiques : on ne peut les lire que si l’on se tient dans leurs constellations, entre l’agencement passé et l’agencement présent de leurs lettres et de leurs pierres.
12Ainsi l’horizon poétique est-il moins celui d’un décryptage que d’un « partage du sensible30 » et l’occasion pour le poète-artiste de « co-signer » une œuvre avec la nature, semant le trouble quant aux sources de la poésie.
13Les travaux actuels de l’écocritique et de l’écopoétique, souvent minés par le simple thématisme ou le pur environnementalisme, doivent alors en venir à une interrogation en profondeur sur le signe. Le travail des poètes a-t-il contribué à faire émerger la conscience qu’anthropos et les vivants non humains partagent la même « sémiosphère » ? Il s’agit également ici de faire dialoguer des chercheurs en littérature et des chercheurs en langue française pour penser la question de la coupure sémiotique. Ce dialogue qui s’amorce aurait vocation à s’ouvrir, dans le futur, à des biologistes, des éthologues. Peut-on penser un éco-système linguistique ? Quelles limites lui donne-t-on, s’il faut lui en donner ? Pour Gabriel Vignola, « l’écocritique s’est constituée sur la faille épistémologique classique qui veut que nature et culture s’opposent31 », à partir notamment d’un corpus de textes issus des nature writings qui laisse apparaître cette dichotomie32. Or, l’écologie « nous invite […] à transformer le regard que nous posons sur la théorie littéraire » ; Vignola plaide donc quant à lui pour l’approche écosémiotique qui permet de « problématiser la question du langage, de la représentation et de la littérature différemment, dans une perspective inspirée des modèles de l’écologie telle qu’elle se développe en sciences naturelles33 ». Ainsi la sémioticienne spécialiste de littérature anglaise Wendy Wheeler invite-t-elle à remettre en question la conception binaire du signe saussurien et l’approche structuraliste d’une littérature considérée comme un « univers autosuffisant34 » pour privilégier la sémiotique peircienne qui inscrit la langue dans le « continuum évolutif35 » d’un univers tout entier « perfusé de signes36 ». Il convient ainsi de voir quels rapports le signe verbal, pourtant « conventionnel », mais pris dans le poème, peut entretenir avec la tradition des « indices », ces « signes naturels37 ».
14Si la jeune discipline de la linguistique a eu une influence majeure sur la littérature du xxe siècle, en particulier dans sa période textualiste, cette autre période que nous vivons actuellement, marquée par l’émergence de l’écopoétique, ne peut être pensée sans tenir compte d’un âge nouveau de la linguistique, ouvert par les frémissantes recherches de l’écosémiotique. Susciter un dialogue, une confrontation de points de vue entre chercheurs en littérature et chercheurs en linguistique sur ces questions nous a paru fondamental, et cela a pu être amorcé grâce à la présence dans les journées dont sont issues ces actes38 d’Astrid Guillaume, fondatrice de la Société française de Zoosémiotique, Professeure au département de langue française de Sorbonne Université et de Mireille Mérigonde, Docteure en sciences du langage de l’université de Limoges. Nos savoirs sur les langages du vivant n’en sont qu’à leurs balbutiements mais les découvertes de jour en jour plus étonnantes de la science incitent à suspendre notre jugement face à certaines certitudes qui avaient pu être les nôtres dans le passé. Sur ce terrain encore mouvant que nous choisissons d’explorer, la voix des poètes mérite d’être confrontée aux travaux de certains linguistes, comme a entrepris de le faire Mireille Mérigonde avec le poète Jean Tortel dans son « écosémiotique du poète-jardinier » (pour reprendre la formule qui sert de titre à sa thèse). « Poésie et langages du vivant », cette formule est-elle une provocation de notre part ? Force est de constater qu’elle ne fait pas consensus. Toujours a-t-elle le mérite d’ouvrir le débat. Le présent livre ne donnera pas une vision univoque de cette discussion mais laissera la place à une diversité de points de vue.
15Ainsi, Michel Collot refuse l’idée développée par Lorand Gaspar d’un monde vivant parlant dans sa totalité le même langage et pense que le titre de ce livre, en laissant croire que c’est le cas, ne peut être que source de « confusion ». S’appuyant sur Benveniste39, Michel Collot préfère maintenir une distinction entre les « langages animaux » et le « langage humain » :
[Les langages animaux] véhiculent des informations, des intentions et des émotions liées à une situation, non des significations abstraites du contexte d’énonciation, comme peut le faire le logos humain, dont le fonctionnement ne relève pas seulement de l’information et de la communication mais du symbole.
16S’appuyant sur la sémiotique de Thomas Sebeok et sur les travaux de l’écosémioticienne Nicole Pignier, Mireille Mérigonde montre quant à elle que ces chercheurs ont « ouvert les mondes de signification aux autres formes du vivant » : « c’est à travers l’influence énonciative que la linguistique et l’écosémiotique françaises accordent à leur tour le signe à l’ensemble du vivant, animal et végétal. » Plus en accord avec Lorand Gaspar également, grand lecteur des travaux des biologistes et des neurologues40, Mireille Mérigonde s’appuie sur les travaux des biosémioticiens, en particulier Édeline et Klinkenberg pour avancer que « les deux approches, biologique et sémiotique, concordent donc pour identifier vie et sémiose, et ce à un niveau très élémentaire41 ». C’est pourquoi le sémioticien Denis Bertrand et le biologiste Bruno Canque partent de l’hypothèse qu’il y a « “des niveaux d’homologie” entre “phénomènes biologiques” et “processus discursifs” et que le langage “pourrait constituer un concept transversal au monde vivant capable de rendre compte de sa matérialité, de sa processualité, ainsi que de son évolution42” ». Pour Astrid Guillaume, il doit bien être question de « langage43 » animal et non de « signal », ce terme relevant d’après elle d’une linguistique anthropocentrique. Quant à la dimension du symbolique, la zoosémiotique issue des travaux de Thomas A. Sebeok – prenant appui sur les travaux de Charles Sanders Peirce et sa triade index, icône, symbole44 – ne l’exclut pas, comme le montrent ces réflexions de Sebeok sur la fourmi, dans un passage que traduit Mireille Mérigonde :
[la] triple fonction d’un signe chimique est bien illustrée par la substance d’alarme de la fourmi pogonomyrmex badius […]. Lorsqu’une bouffée de cette phéromone est libérée, la réponse (à faibles concentrations) est une simple attraction, c’est-à-dire que le signe remplit une fonction indicielle. […] Si le danger persiste, le signal se propage. Le signe fonctionne comme une icône dans la mesure où le signal varie proportionnellement à la croissance ou à la diminution des stimuli de danger. La structure moléculaire de la substance d’alarme ne ressemble en rien à l’alarme qu’elle représente. Le lien entre le signe véhicule et son objet dépend de ce que Peirce appelle une « connexion habituelle » entre les deux, et satisfait donc sa condition de symbole45.
17Doit-on aller par conséquent vers une « théorie générale des signes étendue à l’ensemble du vivant » ? C’est le chemin que choisissent d’emprunter désormais certains linguistes, en résonance avec de nombreuses intuitions poétiques.
18« Où va l’herméneutique ?46 » se demandait Iona Vultur dans la revue Critique en 2015; il faudrait donc répondre ici : vers le vivant sensible et sensé des éthologues, des philosophes et des poètes, qui peuvent se retrouver autour d’un certain « paradigme indiciaire », délaissant la preuve pour pister la trace, complétant l’explication déductive par l’interprétation abductive, moins intellectualiste, la pensée par cas, tendue entre empathie et distance, comme le montre « l’enquête » empirico-philosophique d’un Baptiste Morizot47 : « un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver » disait René Char. N’est-ce pas rejoindre Édouard Glissant, qui fonde ses conceptions poétiques sur la continuité du vivant dans ses dernières œuvres ? En s’appuyant sur la biologie de la signification de Jakob von Uexküll, l’écosémiotique postule que « la langue et, dans un second temps, la littérature, constituent un horizon de signification symbolique qui se déploie à l’intérieur de l’Umwelt48 humain et qui contribue à modeler l’expérience subjective du monde49 ». C’est l’un des enjeux de l’analyse de l’œuvre de Gustave Roud proposée par François Chanteloup, visant « la manière dont il peut y avoir des communications entre différents Umwelten, entre différents mondes qui à première vue ne communiquent pas ensemble », dans la perspective d’un dialogue interspécifique, qui prendrait acte d’une « altérité relative », et non « absolue » du vivant animal.
19Sans renouer avec les vieux démons du cratylisme, nous comprenons aujourd’hui que le langage humain ne peut pas être pensé comme séparé du continuum évolutif qui l’a fait naître. David Abram et Paul Shepard ont avancé l’hypothèse d’une « co-évolution des formes naturelles et des langages des hommes50 », inspirant la zoopoétique, qui explore la manière dont « les syntaxes de nos langues répondent à une grammaire de la vie51 ». En s’appuyant sur les études portant sur la « coévolution préhistorique des langages humains et des styles sonores ou gestuels des animaux », Anne Simon, nourrie par la pensée symbiotique d’Erwin Straus, celle du sentir, avance que l’être humain n’est pas « purement anthropomorphique » mais aussi « primatomorphique, mammomorphique et plus généralement biomorphique ». Pour Philippe Jousset aussi, « le principe qui préside à l’engrènement du logos sur la physis est d’abord celui d’un prolongement52 ». La voie est ouverte pour une relativisation de l’arbitraire du signe, en particulier à partir des travaux de Dominique Lestel s’efforçant de penser une « métabolisation des formes animales par les langages humains53 ». Le moment est venu de sortir d’un logocentrisme humain condamnant les non-humains à n’être que des aloga, afin de prendre la mesure des sèves qui ont nourri ce renouveau contemporain dans la manière d’envisager les rapports entre le langage humain et un monde trop souvent qualifié de « muet » ou de « silencieux » dont on ne cesse de découvrir à quel point il est saturé de sons, cris, appels, signaux, constituant des signes. L’article de Bronwyn Louw s’intéresse aux rapports entre logosphère et biosphère à partir de l’idée que la poésie permettrait de faire advenir une relation symbiotique entre l’écologie des signes et l’écologie générale, à contre-courant de ce qui s’observe habituellement dans les rapports entre l’homme et le vivant : une « sympoétique ». C’est entre les lichens et le poète italien Camillo Sbarbaro que se forme cette « sympoétique », terme dérivé du néologisme « sympoïèse » forgé par Donna Haraway. La cueillette des lichens, organismes « à l’immense inventivité figurale », révèle dans l’œuvre de Sbarbaro son potentiel heuristique, et ouvre la voie à une nouvelle forme de citation, la citation-lichen, au sein du poème s’écrivant avec eux.
20En deçà des langages du vivant, il y a les formes, et cette « apparence inadressée » chère à Adolf Portmann, penseur de l’esthétique animale de pure parure. Merleau-Ponty tire de sa lecture de Portmann cette très belle définition anti-utilitariste de la vie, redécouverte comme Natura artifex : « puissance d’inventer du visible54 », notion qui résonne dans le texte de Marie Vigy consacré à Henri Michaux. L’universitaire relit cette œuvre à partir de la révélation, dès les années 1920, en Équateur, de « l’exubérance des plantes », quand ces êtres dotés d’une « altérité radicale » se voient célébrés « comme des vivants expressifs, sociaux et poreux aux émotions ». L’expérience de la flore tropicale permet de recomposer le corps propre, l’ascendance et l’identité, dans la mesure où elle « met à mal les frontières de l’individu », tout en faisant surgir excroissances lyriques et copia rhétorique dans la prose du récit de voyage. Ce seront ensuite des propositions formelles que le signe poétique et le signe graphique pourront tout à la fois chanter et prolonger, jusqu’à ce que l’esprit de Michaux renchérisse par l’imaginaire lui-même exubérant, créateur d’« hapax végétaux ». Le poème du langage continue alors par d’autres moyens le poème de la vie, placé sous le signe de la « liberté évolutive ».
21Quant à Patrick Suter, il rappelle l’importance de la morphologie végétale dans la poétique du style et l’économie générale de l’œuvre, à toutes les échelles, de la syllabe au livre, en passant par la phrase, chez un Flaubert ou un Claude Simon. Il y a un continuisme des modèles avec ces productions littéraires, car
ce qu’elles montrent par la même occasion, c’est que la culture peut ne pas être élaborée dans l’ignorance des échos et des symétries à l’œuvre dans l’écologie générale, mais au contraire dans la conscience qu’elle est au fond membre de la nature, dont elle a quelque chose à apprendre.
22Notre question serait aussi : quel rôle assigner à la poésie dans cette tâche consistant à écouter ou faire entendre le vivant ? Quelle orientation privilégier : re-présenter, donner la parole, traduire, dire, montrer ? Chaque verbe compte ici dans sa singularité. Par quelle opération poétique saisir la « vérité du vivant » ? « Décrire, narrer, enseigner », en réhabilitant « l’universel reportage » décrié depuis Mallarmé ? Documenter ? Faire parler ? Parler de, parler avec, parler pour ? Émilie Frémond se propose d’explorer ce versant à partir d’un corpus rassemblant différentes réalisations poétiques contemporaines d’un parti pris des animaux conçu hors « ventriloquie », dans un dialogue critique ou ironique avec la tradition du poème didactique comme avec le savoir de l’histoire naturelle (Julien Blaine, Jacques Demarcq, Tristan Félix avec Maurice Mourier, et Raphaël Saint-Remy avec Benjamin Bondonneau). Un genre émerge alors, la « buffonnade », qui déplace les lignes de partage entres les espaces de création (poème, dessin, performance) comme entre les espèces en évolution, sans craindre de « corriger » Buffon ou Darwin. Par ailleurs, ces dispositifs animés instaurent un « parlement » où « l’animal jadis muet, disséqué par le regard ou par le scalpel, se met à parler », livrant ainsi une sorte de « droit de réponse ». Par rapport à l’épistémè de l’histoire naturelle, le poème contemporain, héritier des avant-gardes et de leur critique du livre, opère un changement de paradigme : sortie de la vue et sortie du verbocentrisme.
23Ajoutons que les sciences du vivant qui étudient ce que Konrad Lorenz appelle dans Les Oies cendrées la « sémantisation55 », nous conduisent donc à reposer aujourd’hui autrement la question médiévale du liber naturae, de la « lisibilité du monde », du « pan-sémiotique56 », question qui n’a jamais cessé d’intéresser les poètes herméneutes de la Terre, de Hugo à Jaccottet en passant par Baudelaire, Mallarmé, Claudel, et d’autres, nous l’avons rappelé avec Anne Gourio. Le monde non-humain toujours-déjà parle, derrière le visible (langage du divin, voix de l’Être), puis dans la chair du visible : langage du vivant. Comment envisager alors les survivances et les transformations, au sein des sociétés modernes, de l’ontologie « analogiste » décrite par Philippe Descola ? Il ne serait pas infondé de considérer une certaine expérience poétique comme le lieu propre de la « sphère de résonance57 » chère au sociologue Hartmut Rosa, en réponse à la « chosification » généralisée imposée par le système capitaliste, qui peut se formuler aussi par l’idée que « le monde devient sourd58 ». Les proses de Gustave Roud analysées par François Chanteloup illustrent parfaitement cette remise en cause, par le regard poétique, de la « conscience objectivante » (Marcel Raymond), séparatrice. La quête des « signes » venus d’un monde dès lors tiré de son mutisme illusoire, mythe « moderne », fait émerger « un matériau nourrissant l’énigme métaphysique » d’une présence douée d’expressivité : oiseaux, vent, eaux vives. Renouant avec la figure du poète interprète, Roud inscrit sa recherche au coeur même d’une « géophonie » et d’une « biophonie ». C’est le chant mélodieux et aquatique du rossignol que tend à accueillir la poésie de Philippe Jaccottet, qui fait de cet « oiseau invisible » une véritable figure structurelle. Fabio Berlanda, pour sa part, rappelle en effet combien ce motif, riche d’une longue tradition poétique et mythologique, s’inscrit dans le tissu sonore de la langue, et permet de quitter la négativité du nocturne pour nourrir la recherche lyrique d’une « voix sans mélancolie », manière d’imaginer ici un Jaccottet heureux, resté fidèle à un certain tropisme ascensionnel. Ce rossignol, saisi en tant que tel, dans sa valeur intrinsèque, ne fait que chanter : « le triste passé de Philomèle est laissé de côté, pour se concentrer sur la beauté du chant. »
24Il faut de fait penser la place du langage humain dans la phonosphère, dans les « paysages sonores naturels », comme y incite Bernie Krause59. L’article de Marielle Macé prolonge l’invitation de son récent livre Une pluie d’oiseaux à « dégonfler l’arrogance de la parole humaine », et questionne les rapports entre énonciation humaine et expression animale en mettant en relation les « langues ocelles60 » et les noms d’oiseaux, les sifflottis et les onomatopées, pour nous inciter à nous remettre en bouche le monde. Sans envisager, lorsque nous parlons des oiseaux, de « code commun » ou de véritable « dialogue », Marielle Macé engage plutôt une « tentative d’écho », écho de leur langue dans la nôtre. Élargissant sa réflexion à l’usage des voyelles, l’autrice tisse alors « les noces de l’oiseau et des cours d’eau », en pensant une fraternité toute vocale entre eux. Marik Froidefond, quant à elle, choisit le versant de la férocité, en s’attachant aux langages animaux des prédateurs, afin d’interroger la façon dont la poésie les travaille au cœur de ce qui serait peut-être une « transmutation de forces », ou un envahissement du poème par l’animal. Son article propose en outre une ouverture vers des corpus poétiques non occidentaux, afin d’esquisser les différences d’articulation entre poésie et langages du vivant selon les aires culturelles.
25Cet ouvrage ouvre enfin une réflexion traductologique. Certes, la possibilité (et la difficulté) de pratiquer la traduction inter-espèces est envisagée par des traductologues61 et des sémioticiens62, mais les tentatives de transposition des langages non-humains en poésie sont encore largement à explorer. On attend les réponses concrètes, stylistiques, formelles, polyphoniques, sonores à ce « besoin d’une langue qui ne soit pas trop humaine, qui ne soit pas exclusivement humaine63 » exprimé par le poète Kenneth White. La traduction poétique des non-humains pourrait-elle être une voie pour imaginer un logos non-logocentrique ? Notre époque est celle d’une grande déstabilisation du langage. Pour l’écrivain Camille de Toledo, attentif à la biosémiotique, c’est « la notion même de langage qui est en train de se déplacer ». Prenant appui sur la pensée des intraduisibles de Barbara Cassin, il en appelle alors à un « continuum du traduire » capable de répondre à ces secousses sismiques lézardant la table d’écriture, si cette table est notre sol. Nombre d’écopoètes contemporains sont également traducteurs, et le terme de « traduction » revient sans cesse sous leur plume pour définir leur travail d’inscription dans le poème des langages du vivant, que l’on pense à Philippe Jaccottet, Fabienne Raphoz, ou encore Jacques Demarcq. L’entreprise apparemment impossible de traduction de signes « intraduisibles64 », implique non pas qu’il ne faille pas tenter de les traduire, mais au contraire qu’il faut s’y essayer encore et encore, comme on suivrait une piste65. Élisabeth de Fontenay, qui appelle à une pratique de l’empathie ou de l’Einfülhung comme voie possible vers la traduction du « parler des bêtes », s’interroge :
Ce qu’Antoine Berman a nommé L’épreuve de l’étranger ne reçoit-il pas sa signification la plus exigeante dès lors que le langage se risque à cet affolant franchissement, à cette transgression de la sacro-sainte ligne de démarcation entre l’homme et l’animal66 ?
26De la difficulté à traduire peuvent précisément jaillir des potentialités poétiques nouvelles, un défi qui ouvre la langue : « les chants d’oiseaux défient ma langue67 », confesse Fabienne Raphoz dans Parce que l’oiseau. De même, l’éclairage apporté par François Chanteloup sur la « quête » de Gustave Roud souligne combien le poète suisse cherche à « sortir du soliloque » pour « dialoguer avec le vivant », sans jamais pouvoir se déprendre d’une « tension entre l’évidence d’une signification, et l’impossibilité de la traduire ». Dans le murmure du vent ou le chant de l’oiseau, une nécessité se fait jour : « répondre à cet appel d’une voix étrangère qui demande à être relayée ». Quant au « buffonnades » étudiées par Émilie Frémond, elles peuvent user de stratagèmes « mimologiques » variés pour « traduire la littérature en oiseau », et non l’inverse (Jacques Demarcq), ou incarner une « humanimalité » qui ouvre un dialogue entre espèces, le « cham’âne » et le poète « bêtifiant » échangeant leur position (Julien Blaine). Deux voies se dessinent en conclusion de l’article : inventer une quasi-langue ou bien feindre de recueillir des traces, « pensée traductive » ou « pensée indiciaire ».
27Le vaste article d’Alix Borgomano s’interroge aussi sur la possibilité de « traduire quand même », dans une tension entre lisibilité et illisibilité du vivant. À travers la poésie de Jody Gladding, qui se donne explicitement comme la traduction des lignes laissées dans le bois par des scolytes, et celle de Wendy Burk, qui transcrit ses entretiens avec divers arbres de l’Arizona, c’est toute une reconsidération des distinctions entre langages humains et non-humains qui se donne à lire. La traduction des non-humains substitue « l’imagination de ce qui est possible à l’exigence de fidélité à ce qui est probable ».
1 Jean-Marie Schaeffer, La Fin de l’exception humaine, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 2007.
2 Michel Collot, Le Chant du monde dans la poésie française contemporaine, Paris, José Corti, 2019, p. 156.
3 Michel Deguy, Écologiques, Paris, Hermann, 2012 ; L’Envergure des comparses. Écologie et poétique, Paris, Hermann, 2017.
4 Jean-Claude Pinson, Pastoral. De la poésie comme écologie, Seyssel, Champ Vallon, 2020 ; Autrement le monde, Joca Seria, 2015 ; Habiter en poète, Seyssel, Champ Vallon, 1995.
5 Jean-Christophe Bailly, L’Élargissement du poème, Paris, Christian Bourgeois, 2015 ; Le Parti pris des animaux, Paris, Christian Bourgeois, 2013.
6 Pierre Vinclair, Agir non agir, éléments pour une poésie de la résistance écologique, Paris, José Corti, 2020.
7 Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, Paris, José Corti, coll. « Biophilia », 2018.
8 Kenneth White, On The Atlantic Edge. A Geopoetics Project, Dingwall, Sandstone Press, 2006 ; Geopoetics. Place, Culture, World, Glasgow, Alba Editions, 2003 ; Le Gang du Kosmos. Poétique et politique en terre américaine, Marseille, Wildproject, 2015 ; Au large de l’Histoire, Marseille, Éditions Le Mot et le Reste, 2015.
9 Gary Snyder, The Practice of the Wild, San Francisco, [North Point Press, 1990], Shoemaker & Hoard, 2003 ; traduction en français par d’Olivier Delbard, La Pratique du sauvage, Monaco, Éditions du Rocher, 1999 ; A Place in Space: Ethics, Aesthetics and Watersheds: New and Selected Prose, Counterpoint Press, 1996 ; traduction en français par Christophe Roncato Tounsi, Le Sens des lieux – Éthique, esthétique et bassins-versants (anthologie de 28 essais), Marseille, Wildproject, 2018.
10 Jean-Claude Pinson, Pastoral. De la poésie comme écologie, op. cit., p. 9.
11 Voir en particulier Anne Simon, Une bête entre les lignes, essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, 2021.
12 Marielle Macé, « Écopoésie », dans Dictionnaire du lyrique. Poésie, arts, médias, dir. Antonio Rodriguez, Paris, Classiques Garnier, 2024, p. 89-91.
13 Yves Bonnefoy, « Le regard et les yeux », dans Remarques sur le regard, Paris, Calmann-Lévy, 2002, p. 26.
14 Note manuscrite d’Alberto Giacometti datant de novembre 1965 publiée en fac-similé dans L’Éphémère no 1, 1967, p. 102.
15 André du Bouchet, « Tal Coat : conférence de Winterthur », dans La Peinture n’a jamais existé – Écrits sur l’art (1949-1999), édition établie, préfacée et annotée par Thomas Augais, Paris, Le Bruit du Temps, 2017, p. 437.
16 Paul Valéry, Cahiers, XI, Paris, C.N.R.S., 1957-1961, p. 562
17 Id., Œuvres, tome I, éd. Jean Hytier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957, p. 1311.
18 Hugues Marchal, « Physiologie et théorie littéraire », Fabula / Les colloques, « Paul Valéry et l’idée de littérature », dir. William Marx, 2011, URL : http://www.fabula.org/colloques/document1416.php, page consultée le 8 avril 2025.
19 Paul Valéry, Œuvres, tome I, éd. Jean Hytier, p. 335.
20 « Prendre langue avec l’image », dit Hubert Damisch à propos du Caravage et de Poussin. Cité par Louis Marin, Détruire la peinture [1977], Paris, Flammarion, 1997, p. 7-8.
21 Maurice Merleau-Ponty, La Nature : notes, cours au Collège de France, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 267.
22 Patrick-Gilles Persin (dir.), L’Envolée lyrique, Paris 1945-1956, catalogue de l’exposition présentée du 26 avril au 6 août 2006 au musée du Luxembourg, Paris, Skira, 2006.
23 Gherasim Luca, « Prendre corps », dans Héros limite suivi de Le Chant de la carpe et de Paralipomènes, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », no 364, 2001, p. 288-298.
24 Voir Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot et Rivages, 2010 [1934], p. 33-40.
25 Lorand Gaspar, Sol absolu, Paris, Gallimard, 1972, p. 98.
26 Hans Blumenberg, La Lisibilité du monde [1981], traduit par Pierre Rusch et Denis Trierweiler, Paris, Éditions du Cerf, 2007.
27 Voir Anne Gourio, « Les Feuilles d’hôpital de Lorand Gaspar, pratique citationnelle et dialogisme médical » dans La Figure du poète-médecin (xxe-xxiesiècles), sous la direction de Thomas Augais, Martina Diaz, Julien Knebusch et Alexandre Wenger, Genève, Georg, 2018.
28 Lorand Gaspar, Approche de la parole, Paris, Gallimard, 1978, p. 10.
29 Ibid., p. 12.
30 Expression de Jacques Rancière, voir Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique éditions, 2000.
31 Gabriel Vignola, « Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en littérature », Cygne noir, no 5, 2017, URL : http://revuecygnenoir.org/numero/article/vignola-ecocritique-ecosemiotique, page consultée le 7 octobre 2020.
32 « L’un des rares chercheurs à s’être engagé dans une telle démarche interdisciplinaire, alliant l’écologie scientifique à la critique littéraire, est [Dana] Phillips. Citant Bruno Latour et Richard Rorty, Phillips soutient qu’il importe de montrer les rapports de continuité entre nature et culture », ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Charles Sanders Peirce, The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 5, ed. C. Hartshorne & P. Weiss, Cambridge, Harvard University Press, 1931-1935, p. 448.
37 Voir Denis Thouard, « Indice », dans L’Interprétation. Un dictionnaire philosophique, dir. Christian Berner et Denis Thouard, Paris, Vrin, 2015, p. 231-235.
38 « Poésie et langages du vivant (xxe et xxie siècles) », journées d’étude organisées par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger, Sorbonne Université, 2 juin 2023 ; Université de Rouen, 27 septembre 2024.
39 « Communication animale et langage humain », paru dans le no 1 de la revue Diogène en 1956 et repris dans ses Problèmes de linguistique générale.
40 Voir Maxime Del Fiol, « La bibliothèque de Lorand Gaspar » dans Lorand Gaspar et la matière-monde, textes réunis par Marie-Antoinette Bissay et Anis Nouairi, assistés par Patrick Née, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 349-380.
41 Le Groupe µ, Francis Édeline et Jean-Marie Klinkenberg, « Pourquoi y a-t-il du sens plutôt que rien ? Abrégé de sémiogénétique », Signata, no 2, 2011, p. 281-313, URL : http://journals.openedition.org/signata/729, page consultée le 23 août 2025.
42 Denis Bertrand et Bruno Canque, « Sémiotique et biologie. Le “vivant” sur l’horizon du langage », Signata, no 2, 2011, p. 195-220, URL : http://journals.openedition.org/signata/667, page consultée le 23 août 2025.
43 Astrid Guillaume, « La sémantique et la sémiotique au service du langage animal », Regards sur l’animal et son langage, sous la direction de Sandra Contamina et Fernando Copello, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, p. 115.
44 Thomas A. Sebeok dont nous conseillons la lecture de « On chemical signs » dans Essays in semiotics, dir. Julia Kristeva, Josette Rey-Debove, Donna Jean Umiker,Berlin, De Gruyter Mouton, 1971, ch. 35, p. 549-559.
45 Ibid., p. 551.
46 Critique, nos 817-818, juin-juillet 2015, dossier dirigé par Iona Vultur.
47 Ce déplacement vers l’herméneutique est mis en évidence dans la postface que l’auteur de Sur la piste animale donne à Habiter en oiseau de Vinciane Despret (Arles, Actes Sud, 2019, p. 203).
48 Voir Gabriel Vignola, art. cité : « Jakob von Uexküll a élaboré le concept d’Umwelt, concept clé de la biosémiotique qui réfère au fait que chaque espèce, que chaque individu au sein de chaque espèce, perçoit son environnement en fonction de ce qui lui est significatif aux fins de sa survie et d’après les sens que lui confère son anatomie. »
49 Ibid.
50 Anne Simon, Une bête entre les lignes, essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, 2021, p. 104. Voir David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie du sens [1997], trad. Didier Demorcy et Isabelle Stengers, Paris, La Découverte, 2013 ; Paul Shepard, Thinking animals: Animals and the Development of Human Intelligence, Athens, University of Georgia Press, 1978.
51 Anne Simon, Une bête entre les lignes, essai de zoopoétique, op. cit., p. 105.
52 Philippe Jousset, Anthropologie du style. Propositions, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, p. 28.
53 Dominique Lestel, L’Animal singulier, Paris, Seuil, 2004, p. 59.
54 Maurice Merleau-Ponty, La Nature, op. cit., p. 324.
55 Konrad Lorenz, Les Oies cendrées, Paris, Espaces Libres, 2022, p. 143.
56 Umberto Eco, « Les métaphysiques pan-sémiotiques », dans Le Signe, Paris, Le Livre de Poche, 1998, p. 189-196.
57 Hartmut Rosa, Accélérons la résonance. Pour une éducation en Anthropocène. Entretiens avec Nathanaël Wallenhorst, Paris, Le Pommier, 2022, p. 45.
58 Ibid., p. 50.
59 Estelle Zhong Mengual, « Bernie Krause, Chansons animales et cacophonie humaine : manifeste pour la sauvegarde des paysages sonores naturels », Critique d’art [En ligne], « Toutes les notes de lecture en ligne », URL : http://journals.openedition.org/critiquedart/23240, page consultée le 23 août 2025.
60 Dominique Meens, Mes langues ocelles, Paris, P.O.L, 2016.
61 Michael Cronin, Eco-Translation. Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene, London, Routledge, 2016.
62 A. Guillaume, Ch. Tremblay, P. Frath, G. Chapouthier et L. Nagle, « La traduction interculturelle humaine et animalière. Contacts interdisciplinaires pour traduire les animaux », dans La Traduction dans une société interculturelle, dir. N. Bond, F. Bossier et D. Louda, Paris, Hermann, 2022.
63 Kenneth White, La Traversée des territoires : une reconnaissance, Marseille, Le Mot et le Reste, 2017, p. 124.
64 Barbara Cassin, Le Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles, Paris, Seuil, 2004.
65 Baptiste Morizot, « Les animaux intraduisibles », Billebaude, no 14 : « Mondes sonores », 2019, p. 56-66.
66 Élisabeth de Fontenay et Marie-Claire Pasquier, Traduire le parler des bêtes, Paris, L’Herne, 2008, p. 31.
67 Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, Paris, José Corti, coll. « Biophilia », 2018, p. 106.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2081.html.
Quelques mots à propos de : Thierry Roger
Thierry Roger est Maître de Conférences en Littérature française du xxe siècle à l’Université de Rouen Normandie, et membre du CÉRÉdI. Ses recherches portent sur Mallarmé et son héritage, les questions d’herméneutique, les usages de la poésie, ainsi que l’écocritique (« habitation poétique du monde » et histoire littéraire de l’idée de « nature »). Principales publications : L’Archive du Coup de dés, Classiques Garnier, 2010 ; La Muse au couteau. Lecture des Amours jaunes de Tristan Corbière, PURH, 2019 ; Spectres de Mallarmé, avec B. Marchal et J.-L. Steinmetz, Hermann, 2021 ; Le Poète et le Joueur de quilles. Enquête sur la construction de la valeur de la poésie (xive-xxie siècles), avec O. Gallet, A. Lionetto, S. Loubère, et L. Michel, PURH, 2023 ; L’Air des livres. Respirations, inspirations, dir. Thierry Roger, Les Carnets du vivant, 1, 2024. http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1555.html. Il vient d’achever une anthologie à paraître aux PUR, Littérature et condition terrestre, de Ronsard à Gary.
Quelques mots à propos de : Thomas Augais
Thomas Augais est Maître de conférences en littérature des xxe et xxie siècles à la Faculté des Lettres de Paris, Sorbonne Université, membre du CELLF 19-21 (UMR 8599). Ses recherches portent sur le rapport au réel dans le dialogue entre les écrivains et les artistes au xxe siècle. Il a publié notamment Alberto Giacometti et les écrivains, Paris, Classiques Garnier, 2017, ainsi qu’une édition critique de La Peinture n’a jamais existé d’André du Bouchet, Le bruit du Temps, 2017. Il travaille également sur les rapports entre poésie et médecine : Le Geste chirurgical (xxe-xxie siècles), en collaboration avec Julien Knebusch, Chêne-Bourg (Suisse), Georg, 2020. Dans le domaine de l’écopoétique, il a co-dirigé avec Florian Alix le numéro 3 de la revue Reconnaissances XXI/XX (Classiques Garnier, octobre 2022) autour de la question suivante : « Faut-il en finir avec l’anthropomorphisme ? »
Quelques mots à propos de : Irène Gayraud
Irène Gayraud est Maîtresse de conférences en littérature comparée à Sorbonne Université et membre Junior de l’IUF. Elle mène une activité de recherche-création : écriture (poésie, roman) et collaboration avec des compositeur·ice·s de musique contemporaine. En poésie, elle a notamment publié Passer l’été (La Contre allée, 2024) et Téphra (Al Manar, 2019). Elle a publié en 2019 l’ouvrage Chants orphiques européens : Valéry, Rilke, Trakl, Apollinaire, Campana et Goll aux Classiques Garnier. En collaboration avec Christophe Mileschi, elle a traduit les œuvres poétiques de Dino Campana (Points, 2016). Elle traduit la poétesse chilienne Gabriela Mistral aux Éditions Unes (Essart, 2021 ; Pressoir, 2023 ; Poème du Chili, 2025). Ses recherches en écopoétique portent sur l’écoute, la perception et la traduction sonore du monde en poésie.
