Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
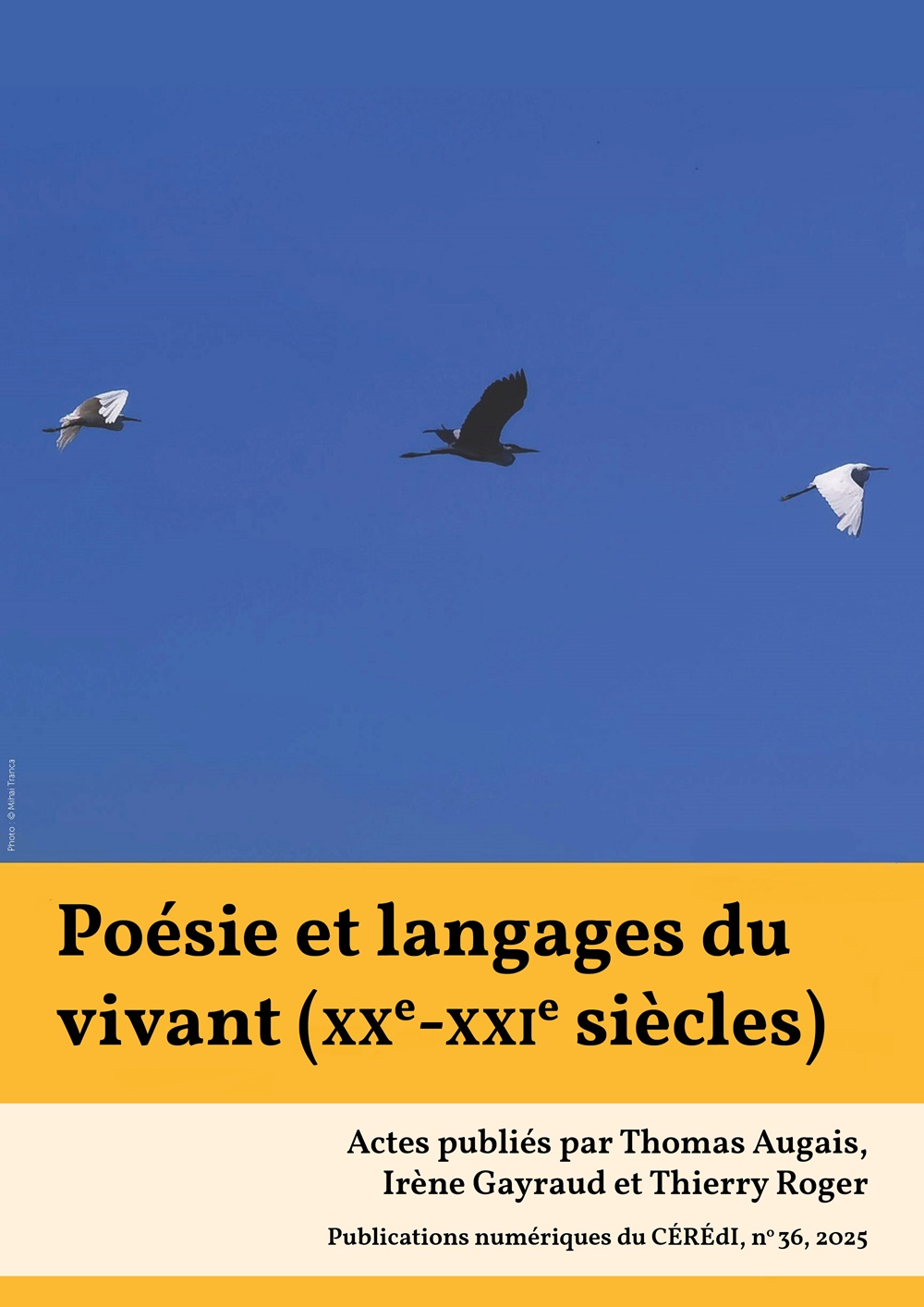
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
Fabio Berlanda
1L’œuvre de Philippe Jaccottet est traversée de motifs récurrents. Cela ne signifie toutefois pas que ceux-ci soient présentés de la même manière, au fil de son cheminement poétique. Pour approcher son désir fondamental d’« effacement1 », Jaccottet a laissé une œuvre à la stratigraphie formelle très diversifiée (notes, poèmes, essais, traductions, poèmes en prose, récits, articles de journaux). Ces multiples voies d’expression ont un dénominateur commun, une disponibilité essentielle qui s’étend aux différentes modalités de perception de l’altérité, surtout du monde naturel. Il convient, à ce stade, d’introduire le cas du rossignol, qui constitue un problème esthétique de premier plan : comment parler d’un animal rarement visible, mais principalement perceptible à l’ouïe2 ? Comment écrire d’un chant ? Comment localiser une voix dans l’espace, et comment rendre, par conséquent, cet espace disponible au lecteur ? Le rossignol, précisément en vertu de son chant prodigieux, a toujours peuplé mythes et légendes, en se chargeant ainsi d’un univers symbolique millénaire. Les poètes qui l’ont évoqué sont innombrables : Philippe Jaccottet s’inscrit dans la lignée presque éternelle des artistes qui, chacun à leur manière, ont accueilli en eux la fascination du rossignol et se sont mis à son écoute pour essayer de la retranscrire. Néanmoins, Jaccottet opère un déplacement notable. Son écriture lie un souci d’écartement du sujet à une intense volonté de représenter l’instant. La rencontre avec le rossignol éclairera cet acheminement poétique, qui sera au cœur de notre étude.
2Après avoir contextualisé certains des motifs les plus anciens qui irriguent l’imaginaire occidental du rossignol, nous entendons analyser certaines réfractions classiques dans l’œuvre de Jaccottet. La contribution vise enfin à analyser les ressources employées par le poète de Grignan pour s’accommoder du chant du rossignol et s’écarter d’une subjectivité qui prend le pas sur l’objet.
Temps et espace du rossignol
3Dans l’impossibilité de rendre compte d’une tradition aussi riche3 dans toute sa complexité, nous nous limiterons à examiner seulement les aspects de la mythologie du rossignol qui s’avèrent essentiels pour l’analyse de certains textes de Philippe Jaccottet. On retrouve des traces de cet oiseau dans un réseau de références qui s’étend d’Homère à Hésiode et Sophocle :
[dans] l’Odyssée […], au chant XIX, Pénélope évoque Aédon, fille de Pandaréos, qui chante et pleure « sur Itylos, son fils, qu’elle a tué / par méprise d’un coup d’épée ». La fille de Pandaréos porte le nom grec du rossignol – aèdōn : étymologiquement « chanteur, chanteuse », […] et elle chante sa douleur « dans le feuillage innombrable des arbres » (v. 520). La métamorphose en oiseaux de Philomèle et Procné, filles de Pandion, nous renvoie sans doute à Hésiode qui, dans Les Travaux et les Jours, désigne l’hirondelle comme fille de Pandion (v. 518), et à Sophocle, qui a consacré aux deux sœurs la tragédie intitulée Térée, dont les fragments conservés évoquent la ruse de Philomèle (v. 581-595b)4.
4C’est donc à partir de l’Odyssée, Les Travaux et les Jours et Térée qu’Ovide puise le matériau pour sa version – la plus connue – dans le livre VI des Métamorphoses5. En outre, il n’est sans doute pas inutile de préciser que les passages de l’Odyssée cités sont ceux traduits par Philippe Jaccottet lui-même. Le rossignol porte donc en lui tout justement l’ADN de Philomèle – nom qui le poursuit jusque dans sa dénomination (« rossignol philomèle ») – et son triste mythe de femme violée. C’est pourquoi les Anciens nous ont transmis l’idée qu’il s’agissait d’un oiseau qui « pleure si suavement6 », idée renforcée par de nombreux auteurs, comme Shakespeare et T. S. Eliot, pour n’en citer que quelques-uns. Mais l’aspect sur lequel nous voudrions nous concentrer davantage concerne l’espace et le lieu où le rossignol est traditionnellement situé. Dans le passage précédent, il se trouve « dans le feuillage innombrable des arbres » ; de même, à la lecture des Géorgiques de Virgile, on trouve Philomèle sous l’« ombre d’un peuplier », où elle passe « la nuit à pleurer7 ». On peut remarquer que le rossignol a donc une localisation précise : l’ombre, parmi les feuilles, bien caché comme s’il ne voulait pas être découvert ; mais, surtout, son chant se déroule la nuit. Ce n’est pas un hasard si cet animal, dans les langues germaniques occidentales, porte les marques de cette tradition dans son nom : nightingale, nachtigall, nachtegaal, nattergal, etc. ; qui dérivent tous de l’union de « niht », « nuit » et « galan », « chanter ».
5Le mythe parvenait donc à s’intégrer parfaitement à ce qui était déjà visible dans le monde. Car il est tout à fait vrai que le rossignol chante au crépuscule, qu’il a tendance à se cacher dans les buissons et le feuillage, et qu’il possède l’un des chants les plus variés et fascinants que l’on puisse entendre8. Les auteurs grecs et latins avaient correctement situé le rossignol dans son habitat, bien que cet aspect ait été associé à la métamorphose de Philomèle et à son désir de se cacher. Comme le démontre cet extrait d’un guide moderne :
Rossignol. Luscinia megarhynchos. C’est le « vrai » rossignol, celui au chant le plus mélodieux, qui a trouvé une place dans la littérature et l’imaginaire populaire. Il niche dans les bois et les bosquets avec un sous-bois abondant, souvent à proximité de l’eau mais aussi dans des habitats plus secs avec des fourrés denses ; parfois dans les jardins et les vergers9.
6Un autre élément constamment associé au rossignol est ici mis en avant : la présence d’un cours d’eau à proximité. Liée généralement aux pleurs de Philomèle, l’association du chant au murmure de l’eau est un motif récurrent dans la poésie de tous les siècles. À titre d’exemple, ces vers d’Alphonse de Lamartine illustrent les aspects canoniques de la représentation littéraire du rossignol :
Mais pourquoi chantais-tu ? – Demande à Philomèle
Pourquoi, durant les nuits, sa douce voix se mêle
Au doux bruit des ruisseaux sous l’ombrage roulant !
Je chantais, mes amis, comme l’homme respire,
Comme l’oiseau gémit, comme le vent soupire,
Comme l’eau murmure en coulant10.
7Ces quelques références permettent d’esquisser une reconstruction sommaire de l’imaginaire collectif que nous avons du rossignol, ou, pour reprendre le terme de poiesis, de la manière dont il s’est fait dans notre imagination.
8Il suffit d’aborder l’œuvre de Jaccottet11 avec un regard sensible, pour remarquer à quel point la présence des oiseaux est bien plus qu’un thème récurrent. Dès l’enfance, comme le rappelle Jean-Luc Steinmetz, Jaccottet manifestait une affinité particulière pour le monde aérien : sa chambre était « tapissée des couvertures d’une revue, Les Ailes12 ». Mais c’est dans les toutes dernières pages du post-scriptum de La Clarté Notre-Dame13, que nous trouvons une déclaration de poétique décisive à ce sujet, inspirée par quelques vers de Hölderlin et datée du 7 juin 2020 :
Donne-nous une eau innocente
Oh donne-nous des ailes.
Voilà de manière très extraordinaire, réunis en si peu de mots, les deux messagers privilégiés de la poésie : les oiseaux, et l’eau vive14. […]
9Ces lignes, importantes d’un point de vue herméneutique, attirent l’attention sur la présence récurrente des créatures ailées et des cours d’eau dans l’œuvre. Ainsi, elles autorisent, sur le plan philologique, une recherche à rebours sur ce sujet. L’extrait, cependant, parle de manière générale d’« oiseaux », sans faire référence spécifiquement au rossignol, bien qu’il en fasse inévitablement partie. Or, l’aspect saillant se cache derrière « l’eau vive » : comme nous l’avons vu, c’est près des cours d’eau que le rossignol a tendance à nicher, et son chant mélancolique a été souvent thématisé avec le murmure des ruisseaux. Afin de bien comprendre ces aspects fondamentaux, nous commencerons par examiner chronologiquement les apparitions du rossignol dans l’œuvre de Jaccottet.
Pour une « Fabrique du rossignol »
10Le poème « Lettre du vingt-six juin », publié dans le recueil L’Ignorant en 1958, tire son titre d’une correspondance échangée avec Gustave Roud le 26 juin 1954. Cette lettre contient une première version du poème, que Jaccottet dit avoir écrite avec le « double désir de fêter les vingt-trois ans d’Anne Marie [son épouse] et de répondre sans retard à votre si amicale prière15 ». Il ajoute un élément crucial : « voyez, aussi, l’influence de l’hexamètre16. » Et de fait, confirmant cette influence, dans une lettre du 15 octobre de la même année, il glisse une remarque significative : la naissance de son fils Antoine « n’empêche pas l’Odyssée d’avancer : chant XIX17 ! » Or, ce même chant relate le mythe d’Aédon, que nous avons cité précédemment18. Ainsi, la correspondance met en lumière deux éléments essentiels pour la lecture du poème : l’influence formelle des auteurs classiques et la présence thématique du mythe de Philomèle.
Que les oiseaux vous parlent désormais de notre vie.
Un homme en ferait trop d’histoires
et vous ne verriez plus à travers ses paroles
qu’une chambre de voyageur, une fenêtre
où la buée des larmes voile un bois brisé de pluie…
La nuit se fait. Vous entendez les voix sous les tilleuls :
la voix humaine brille comme au-dessus de la terre
Antarès qui est tantôt rouge et tantôt vert.
*
N’écoutez plus le bruit de nos soucis,
ne pensez plus à ce qui nous arrive,
oubliez même notre nom. Écoutez-nous parler
avec la voix du jour, et laissez seulement
briller le jour. Quand nous serons défaits de toute crainte,
quand la mort ne sera pour nous que transparence,
quand elle sera claire comme l’air des nuits d’été
et quand nous volerons portés par la légèreté
à travers tous ces illusoires murs que le vent pousse,
vous n’entendrez plus que le bruit de la rivière
qui coule derrière la forêt ; et vous ne verrez plus
qu’étinceler des yeux de nuit…
*
Lorsque nous parlerons avec la voix du rossignol19…
11Du point de vue formel on peut observer que, dans un contexte de vers libre, une silhouette traditionnelle reste néanmoins perceptible. Ainsi, on peut compter neuf vers de douze syllabes et cinq de dix sur un total de vingt-et-un vers, les autres oscillant entre sept et quatorze syllabes. Comme il ressort de la correspondance, il s’agit d’une réminiscence métrique, très caractéristique des premières œuvres de Jaccottet. De plus, les reprises anaphoriques en début de vers en « qu » (que, quand, qui) contribuent à la structure du poème. On remarque également une allitération du son [u], présent vingt-quatre fois dans le texte (vous, sous, écoutez, soucis, nous, oubliez, jour, toute, pour, tous, pousse, coule). Cette sonorité sombre20 s’accorde avec l’ambiance nocturne évoquée par la phrase « la nuit se fait ». Cependant, la recherche d’un chant, d’une « voix » (mot présent quatre fois), est poursuivie par l’utilisation des timbres plus clairs21, qui contrebalancent ces timbres « crépusculaires ». En effet, on trouve presque symétriquement vingt-cinq occurrences du son [i] (vie, histoires, verriez, voyageur, brisé, pluie, nuit, tilleuls, brille, qui, bruit, soucis, arrive, oubliez, briller, nuits, illusoires, rivière, yeux, rossignol). À ces éléments s’ajoutent les phrases déclaratives et impératives, qui confèrent au poème un ton exhortatif, caractéristique de la recherche d’altérité qui traverse l’œuvre de Jaccottet.
12En ce qui concerne les thèmes, dès le premier vers, nous voyons que ce sont les oiseaux qui parlent de « notre » vie, et non l’inverse. Jaccottet est dans les prémices de son « effacement22 » : les voix humaines, les préoccupations, les larmes, la mélancolie sont encore bien présentes. Il ne lui est pas encore tout à fait possible de percevoir le « bois brisé de pluie », car ce n’est qu’en nous dépouillant des dynamiques trop humaines que nous pourrons entendre « le bruit de la rivière qui coule derrière la forêt » et peut-être avoir la possibilité de voir « étinceler des yeux de nuit ». La focalisation sur la mélancolie, par ailleurs, témoigne de la persistance du motif de la tristesse, classiquement associé au chant de Philomèle, qui exprime sa douleur et son deuil23. La troisième occurrence du terme « voix » est en effet portée par le rossignol dans le dernier vers, mais dans une dynamique qui est en réalité peu typique de la poétique de Jaccottet. Ici, en effet, il ne parvient pas à « s’écarter » et souhaite que ce « nous » puisse un jour parler comme le rossignol. Il y a encore, en substance, un « attachement à soi24 », bien que problématisé : la « buée des larmes » sépare le poète d’un « bois » parallèlement mouillé par la pluie. Jaccottet avait, d’ailleurs, déjà entamé une pratique d’annotation pour s’approcher toujours plus de ce « bruit de la rivière », près de laquelle, souvent, figure aussi le rossignol.
13Dans le texte En chemin25 de 1962, précisément dans le paragraphe intitulé « Oiseaux aperçus au printemps », nous découvrons des oiseaux « ivres, aveugles, peut-être féroces » évoluant en groupe, à qui l’on demanderait en vain leur secret. Jaccottet y oppose : « Le chant du rossignol, [qui] en revanche, offre à la nuit une longue grappe d’eau26 », marquant ainsi la première occurrence explicite où les deux « messagers privilégiés de la poésie : les oiseaux, et l’eau vive27 » se trouvent si étroitement associés. Toutefois, pour mieux saisir cet aspect, nous ferons un bond jusqu’en mai 1979, bien que le poète évoque également le rossignol dans d’autres passages antérieurs28. Le poète fait cette rencontre :
[…] au bord du ruisseau invisible, entre des haies de broussailles, […] là-dedans le chant des rossignols – la triple liquidité (du chant, du ruisseau et des feuillages commençants). […] Simple, mais comme dit Plotin : « Comment parler de ce qui est absolument simple29 ? »
14Dans ce passage, Jaccottet expose de manière essentielle les aspects fondamentaux de sa quête poétique. Un ruisseau, des buissons, le chant des rossignols : des éléments inéluctablement ancrés dans le réel, et pourtant le souci de trouver les mots justes qui puissent les dire sans les altérer. Cette forme de respect essentiel et de recherche d’une « justesse de voix30 » accompagne son expérience poétique depuis ses débuts ; celle-ci est ici exprimée par la bouche de Plotin. Jaccottet esquisse donc une première observation précieuse : partir d’une liquidité non pas matérielle, mais sonore (ruisseau, rossignol, broussailles commencent tous trois par une sorte de murmure). En juin de la même année, peut-être au nom de la justesse tant recherchée, il note ce qu’écrit Buffon, naturaliste de la fin du xviiie siècle : « du rossignol, il écrit qu’il chanterait, le jour, en rêvant. “Les rossignols se cachent au plus épais des buissons31”. »
15Avec le temps, le chant et les cours d’eau se retrouvent associés de plus en plus fréquemment. Dans Beauregard, il écrit :
un peu partout s’élève le chant des rossignols cachés, si semblable à de l’eau qui ruisselle, au bruit d’une fontaine exaltée ; c’est comme si on marchait parmi de nombreuses fontaines sans les voir, dans ce large vallon bordé de chênes32.
16Il s’agit à nouveau d’un texte écrit en mai (1976), ce qui renforce l’association avec le traditionnel chronotope printanier, et constitue probablement une allusion aux haïkus qui l’ont fasciné et dont il a présenté une transcription33. Outre cet aspect, on remarque que Jaccottet choisit délibérément de concentrer son observation sur un phénomène décrit depuis l’Antiquité : un chant caché dans la végétation. Un autre aspect tout à fait traditionnel est celui de l’eau, qui ici se détache de l’association mélancolique avec les pleurs. Le poète préfère en effet « l’eau vive34 » des fontaines, des ruisseaux. Et c’est précisément sur cette étroite relation avec l’élément aquatique que Jaccottet insiste, se permettant des envolées plus vivaces. Le chant invisible transporte comme le jet d’eau d’une fontaine, tout en restant proche du bois de chênes d’où il provient, sans aspirer à d’autres dimensions.
17En avril 1985, on trouve une connexion moins directe, mais qui mérite néanmoins d’être signalée. Jaccottet réfléchit à Music for a while d’Henry Purcell, chantée par Alfred Deller. La voix du contre-ténor est comparée à « un oiseau venu d’ailleurs, montant et descendant, virevoltant dans l’air natal », et « elle désaltérait sans vous priver de votre soif35 ». Ces passages témoignent de la forte tendance du poète de Grignan à associer les motifs aquatiques et les motifs musicaux. Ce lien est d’ailleurs confirmé dans la suite dédiée à Purcell dans Pensées sous les nuages, où il définit le compositeur comme un « tisserand des ruisseaux surnaturels36 ». Après les références musicales, la note d’avril 1985 s’interrompt par un astérisque, pour ensuite reprendre avec une phrase emblématique : « Nuit. Les rossignols, ou ruisseaux amoureux37 ». Une fois de plus, la référence se tourne vers une eau en rien mélancolique ni plaintive ; au contraire, le triste passé de Philomèle est laissé de côté, pour se concentrer sur la beauté du chant.
18Un passage plus tardif38 permet de comprendre à quel point la présence du rossignol, associé aux cours d’eau, est récurrent dans l’œuvre de Jaccottet :
À cinq heures et demie du matin, sorti dans la brume d’avant le jour, j’entends le rossignol, le ruy-señor espagnol, l’oiseau dont le chant est un ruisseau.
C’est comme si, après quelques pas hésitants, la voix montait en douce vrille d’eau dans l’ouïe et dans le ciel.
*
[…] la voix des premiers rossignols, plus invisibles encore que les eaux […]39.
19Ce qui est remarquable, ce n’est pas seulement la persévérance avec laquelle Jaccottet revient au rossignol, mais surtout la façon dont chaque annotation s’écarte légèrement de la précédente, dans une progression bien cohérente. Ici, le jeu de mots décompose « ruiseñor » (rossignol en espagnol), en faisant le seigneur des « ruy », en référence aux initiales du mot français « ruisseau », étant donné la proximité des occurrences. L’attention portée à la musicalité est évidente, surtout dans l’expression « douce vrille d’eau dans l’ouïe ». Cette harmonie imitative prend une dimension particulière lorsqu’on la compare à la description du chant du rossignol rapportée par les ornithologues : « Voix : Chant puissant et mélodieux, bien reconnaissable par la séquence de sifflements détachés en crescendo, ‘lu lu liu liu li li’40. » Le « crescendo » bien se conjugue à la métaphore ascensionnelle41 d’une eau vibrante et douce : une fois de plus, il ne s’agit donc pas d’une eau triste qui descend, comme le peuvent être les pleurs.
La recherche constante d’une « voix sans mélancolie »
20Il convient maintenant de se pencher sur un passage qui propose une relecture d’un hypotexte incontournable : l’Ode à un rossignol de John Keats.
Ce que j’ai pensé cet été après avoir lu l’Ode à un rossignol de Keats dans la belle traduction de Bonnefoy : que le chant du rossignol était encore tellement autre chose.
[…] Oui, c’est un poème parmi les plus beaux ; mais auquel échappe tout de même la spécificité de la voix du rossignol, l’essence de sa magie. Celle que j’ai tenté de saisir une première fois dans une des Notes du ravin.
Chez Keats, le chant du rossignol joue sa partie dans le concert de la nuit d’été ; mais il est plus encore la projection hors de soi, ou le réveil au-dedans de soi, d’une grande mélancolie42.
21Pour Jaccottet, le passage contenu dans Notes du ravin43 représente donc son approche la plus significative du sujet, à travers la synthèse d’un chant qui monte comme de l’eau dans l’ouïe et le ciel. Or, il est intéressant de noter qu’il ne mentionne à ce propos ni la « Lettre du vingt-six juin » ni les autres annotations présentes dans ses carnets. Peut-être est-ce parce qu’il est conscient qu’en critiquant Keats, il critique aussi le « Je » de L’Ignorant, qui partageait, à cette époque, avec le poète anglais une vision subjective du rossignol. Car si le poète anglais écrivait « Fade far away, dissolve, and quite forget / What thou among the leaves hast never known / The weariness, the fever, and the fret / Here, where men sit and hear each other groan44 », Jaccottet, dans L’Ignorant, nous parlait de « buée des larmes », du « bruit de nos soucis », de « crainte » et de « mort45 ». Lui aussi se laissait aller à projeter sur le chant de l’oiseau ses propres tourments, mais comme on l’a vu, il entreprendra par la suite un cheminement de détachement progressif de cette approche. C’est seulement après des années d’insistance et de recherche du mot juste qu’il a compris que le chant du rossignol en soi n’est pour aucun humain, ne porte aucune douleur : il est chant et rien d’autre. Il a donc voulu entreprendre un chemin de simplification du langage, ardu et long, une quête de toute une vie. Cette évolution, perceptible dans ses notes de La Semaison et ses poèmes de la maturité, témoigne d’une volonté de se rapprocher à l’oiseau sans projections personnelles. Le 29 décembre 2000, un an après sa « première » tentative de saisir l’essence magique de la voix du rossignol dans Notes du ravin, Jaccottet compose le seul poème en vers d’Et, néanmoins, intitulé « Rossignol ». Véritable aboutissement d’un travail de longue haleine, ce poème offre une synthèse essentielle de sa quête poétique. Lisons-le :
Oiseau toujours caché,
voix qui toujours nous ignore
comme elle ignore la plainte,
voix sans mélancolie.
Voix unie à la nuit,
voix liée à la lune
comme à sa cible candide
ou au bol qui la désaltère.
(Comme on l’aura poursuivie,
celle qui ne fuit que la nuit !)
Tendre fusée qui s’élève
en tournant dans l’obscur,
de toutes les eaux la plus vive,
fontaine dans les feuillages.
(Comme on l’aura regardée,
celle que ne vêt que la nuit !)
Ruisseau caché dans la nuit46.
22Le dépassement de la douleur est particulièrement manifeste, à travers une dé-anthropomorphisation qui s’affirme dès le deuxième vers, marquant une nette évolution par rapport à ses premiers recueils. La singularité réside dans le renversement d’une caractéristique traditionnellement attribuée à Philomèle / rossignol (qui pourtant reste bien caché) : la mélancolie. La « voix », métonymie de l’oiseau invisible, est un véritable élément structurant ; elle revient en fait sous la forme de l’anaphore quatre fois en début de vers, tandis que « nuit » clôt quatre autres vers en un parallélisme saisissant. L’allègement du vers, amorcé dès Airs grâce à la découverte du haïku, témoigne également de cette volonté de ne pas se sentir contraint au vers traditionnel, tout en préservant une forme d’ordre. On observe une prédominance de l’octosyllabe, le vers le plus long ne comptant que neuf syllabes. La récurrence de certains sons, comme l’insistance du /i/ ou de la consonne /l/, contribue également à cette structuration. Elle suggère également une tentative de rapprochement continu avec cette voix insaisissable, un travail que Jaccottet approfondit depuis les Notes du Ravin. L’écho du « lu lu liu liu li li47 » est perceptible dans des expressions telles que « mélancolie » ; « unie à la nuit » ; « liée à la lune » ; « cible candide » ; « celle qui ne fuit que la nuit » ; « la plus vive ». Cette harmonie imitative du chant du rossignol est particulièrement remarquable. On peut observer un autre jeu phonétique dans « nous ignore48 », qui, dans ses sonorités, si on le prononce à voix haute, est proche de « rossignol ». La figure féminine entre parenthèses pourrait être une réminiscence de Philomèle, allégée et rendue quasi fantomatique, dans un souvenir nocturne difficile à interpréter. Un autre aspect intéressant est l’omission d’un quatrain49 qui, comme souvent dans la poétique de Jaccottet, faisait référence aux hésitations d’une voix. Dans ce cas, la voix ne veut pas être incertaine, désirant accompagner le chant caché qui l’a suscitée.
23Jaccottet, dans la section éponyme de Ce peu de bruits (que l’on estime dater de 200750), après être revenu sur Keats, reprend en prose la quasi-totalité des éléments évoqués dans le poème « Rossignol » d’Et, néanmoins. On y retrouve la voix qui ne s’adresse pas à nous51, qui s’élève vers le ciel52, sans mélancolie53, bien distincte de celle des autres oiseaux54, indissolublement liée à la nuit55, à l’eau56 et à la lune57, cachée58, un baume pour l’ouïe59. Jaccottet parvient finalement à unir « les deux messagers privilégiés de la poésie60 » dans la figure unique du rossignol, accueillant – non sans difficulté – la tradition multiséculaire dont cette petite créature est encore aujourd’hui porteuse. Son cheminement poétique traverse et dépasse un siècle, et, comme nous l’avons vu, les obstacles initiaux face aux aspects canoniques du rossignol n’ont pas manqué. Qu’importe : la « flèche61 » a été décochée, et quiconque, désormais, peut ouvrir ces pages et lire cette « tendre fusée qui s’élève » dans un mouvement éternellement ascensionnel.
Bibliographie
24Bachelard Gaston, L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris, Libraire José Corti, 1943.
Baratay Éric (éd.), Aux sources de l’histoire animale, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.
Clébert Jean-Paul, Bestiaire fabuleux, Paris, Albin Michel, 1971.
Ferrage Hervé, Philippe Jaccottet, le pari de l’inactuel, Paris, PUF, 2000.
Finck Michèle, Werly Patrick (dir.), Philippe Jaccottet : poésie et altérité, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2018.
Gely-Ghedire Véronique, Haquette Jean-Louis et Tomiche Anne (dir.), Philomèle. Figures du rossignol dans la tradition littéraire et artistique, Clermont-Ferrand, P. U. Blaise Pascal, 2006.
Jaccottet Philippe, Roud Gustave, Correspondance 1942-1976, éd. José-Flore Tappy, Paris, Gallimard, 2002.
Jaccottet Philippe, Œuvres, éd. José-Flore Tappy et al., Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2014.
Jaccottet Philippe, La Clarté Notre-Dame, Paris, Gallimard, 2021.
Keats John, Poesie, éd. Silvano Sabbadini, Milan, Mondadori, 2016.
Lamartine Alphonse de, Œuvres poétiques complètes, éd. Marius-François Guyard, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1963.
Mathieu-Castellani Gisèle, Le Rossignol poète dans l’Antiquité et à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2016.
Maulpoix Jean-Michel, Pour un lyrisme critique, Paris, Éditions Corti, 2009.
Mullarney Killian, Svensson Lars, Zetterström Dan, trad. it. Andrea Corso, Marco Gustin e Alberto Sorace, Guida degli uccelli d’Europa, Nord Africa e Vicino Oriente, Rome, Ricca Editore, 2012.
Ovide, Les Métamorphoses, éd. et trad. Georges La Faye, Paris, Les Belles Lettres, 1965.
Petrarque, Canzoniere, éd. Marco Santagata, Milan, Mondadori, coll. « I Meridiani », 1996.
Starobinski Jean, La Beauté du monde. La littérature et les arts, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2016.
Steinmetz Jean-Luc, Philippe Jaccottet, Paris, Seghers, 2003.
Thelot Jérôme, La Poésie précaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1997.
Tomiche Anne, Métamorphoses du lyrisme. Philomèle, le rossignol et la modernité occidentale, Paris, Classiques Garnier, 2010.
Vidal Jean-Pierre, Philippe Jaccottet. Pages retrouvées. Inédits. Entretiens. Dossier critique. Bibliographie, Lausanne, Éditions Payot, 1989.
Virgile, Les Géorgiques, éd. et trad. Eugène de Saint-Denis, Paris, Les Belles Lettres, 1982.
Vischer Mathilde, Philippe Jaccottet traducteur et poète : une esthétique de l’effacement, Lausanne, Presses universitaires romandes, coll. « Centre de traduction », 2003.
1 Ce désir affleure à plusieurs reprises dans son œuvre. Pensons, par exemple, à deux passages bien connus tels que « je l’accepte : il faut s’effacer tout à fait » (Philippe Jaccottet, « La promenade sous les arbres », Œuvres, éd. José-Flore Tappy et al., Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2014, p. 114. Désormais, sauf indication contraire, les références aux œuvres de Jaccottet renvoient toutes à l’édition de la Pléiade, indiqué par Œ), et « L’effacement soit ma façon de resplendir » (« Que la fin nous illumine », L’Ignorant, Œ, p. 161). Mathilde Vischer évoque d’ailleurs une « esthétique de l’effacement » dans Philippe Jaccottet traducteur et poète : une esthétique de l’effacement, Lausanne, Presses universitaires romandes, coll. « Centre de traduction », 2003.
2 Pour une analyse de la problématique de la représentation de la voix chez Jaccottet, voir Irène Gayraud, « “Écoute donc encore” : l’écoute comme ouverture vers l’altérité dans l’œuvre de Philippe Jaccottet », dans Philippe Jaccottet : poésie et altérité, dir. Michèle Finck, Patrick Werly, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2018, p. 77-96.
3 Pour une analyse des liens entre le rossignol et la littérature, nous renvoyons à Jean-Paul Clébert, Bestiaire fabuleux, Paris, Albin Michel, 1971, p. 333-335 ; Véronique Gély-Ghedire, Jean-Louis Haquette et Anne Tomiche (dir.), Philomèle. Figures du rossignol dans la tradition littéraire et artistique, Clermont-Ferrand, P. U. Blaise Pascal, 2006 ; Anne Tomiche, Métamorphoses du lyrisme. Philomèle, le rossignol et la modernité occidentale, Paris, Classiques Garnier, 2010 ; Gisèle Mathieu-Castellani, Le Rossignol poète dans l’Antiquité et à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2016 ; Michel Jourde, « Le rossignol à l’étude : représentations, descriptions et techniques au début de l’époque moderne », dans Aux sources de l’histoire animale, éd. Éric Baratay, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, p. 93-101.
4 V. Gély-Ghedire, J.-L. Haquette et A. Tomiche (dir.), Philomèle…, op. cit., p. 7.
5 Cf. Livre VI, v. 424-674. (Ovide, Les Métamorphoses. Tome II, éd. et trad. Georges La Faye, Paris, Les Belles Lettres, 1965, p. 16-24).
6 « Quel rosignuol, che sì soave piagne ». (« Ce rossignol, qui pleure si suavement », Petrarque, « Sonnet CCCXI », Canzoniere, éd. Marco Santagata, Milan, Mondadori, coll. « I Meridiani », 1996, p. 1206. Les traductions des textes en langue italienne sont par nos soins, sauf indication contraire).
7 Cf. Livre IV, v. 511-513. (Virgile, Les Géorgiques, éd. et trad. Eugène de Saint-Denis, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 75).
8 Ce chant se caractérise par une incroyable diversité de timbres, allant des sifflements cristallins aux roucoulements doux, en passant par des trilles rapides et complexes. Le rossignol excelle dans l’art de l’improvisation, enrichissant sans cesse son répertoire. Voir Giacomo Costalunga, Carolina Sánchez Carpena, Susanne Seltmann, Jonathan I. Benichov, Daniela Vallentin, « Wild nightingales flexibly match whistle pitch in real time », Current Biology, Volume 33, Issue 15, 2023, p. 3169-3178.
9 « Usignolo. Luscinia megarhyncos. Questo è il ‘vero’ usignolo, con il canto più bello, che ha trovato un posto nella letteratura e nell’immaginazione popolare. Nidifica in boschi e boschetti con abbondante sottobosco, spesso in vicinanza dell’acqua ma anche in habitat più asciutti con densi arbusteti; a volte in giardini e frutteti. » (Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterström, trad. it. Andrea Corso, Marco Gustin e Alberto Sorace, Guida degli uccelli d’Europa, Nord Africa e Vicino Oriente, Rome, Ricca Editore, 2012, p. 276).
10 Alphonse de Lamartine, « Le poète mourant », dans Œuvres poétiques complètes, éd. Marius-François Guyard, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1963, p. 147.
11 Dans un souci de concision, certaines dynamiques largement étudiées par la critique (telles que la poétique du « peu de chose », la « justesse de voix », la « précarité » ou les réflexions sur « l’attachement à soi ») seront considérées comme acquises. Pour un aperçu sur des aspects cruciaux de la poétique de Jaccottet, voir, à titre d’exemple : Jérôme Thélot, « Philippe Jaccottet, ou la poésie précaire », dans La Poésie précaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 121-147 ; Hervé Ferrage, Philippe Jaccottet, le pari de l’inactuel, Paris, PUF, 2000 ; Jean-Michel Maulpoix, « Portrait du poète en ignorant », dans Pour un lyrisme critique, Paris, Éditions Corti, 2009, p. 203-214 ; Jean Starobinski, « Philippe Jaccottet. Parler avec la voix du jour », dans La Beauté du monde. La littérature et les arts, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2016, p. 784-792.
12 Jean-Luc Steinmetz, Philippe Jaccottet, Paris, Seghers, 2003, p. 14.
13 Livre publié à titre posthume, il rassemble les écrits les plus récents que nous puissions trouver de Jaccottet.
14 P. Jaccottet, La Clarté Notre-Dame, Paris, Gallimard, 2021, p. 42-44.
15 Philippe Jaccottet, Gustave Roud, Correspondance 1942-1976, éd. José-Flore Tappy, Paris, Gallimard, 2002, p. 241.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 242.
18 Voir supra, note 4.
19 Philippe Jaccottet, « Lettre du vingt-six juin », L’Ignorant, Œ, p. 157.
20 Même si des mots comme « jour » dénotent de la lumière, nous ne pouvons pas ignorer ce que Mallarmé disait à propos de cette « perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscurs ici, là clair » (Stéphane Mallarmé, « Crise de vers », dans Œuvres complètes. Tome II, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 208).
21 Ibid., loc. cit.
22 Voir supra, note 1.
23 Voir supra, note 3.
24 « 1954. Mai. L’attachement à soi augmente l’opacité de la vie. Un moment de vrai oubli, et tous les écrans les uns derrière les autres deviennent transparents, de sorte qu’on voit la clarté jusqu’au fond, aussi loin que la vue porte ; et du même coup plus rien ne pèse. Ainsi l’âme est vraiment changée en oiseau. » (P. Jaccottet, La Semaison. 1954-1967, Œ, p. 335.)
25 Le texte a été publié en août 1962 sur la NRF, et figure dans Jean-Pierre Vidal, Philippe Jaccottet. Pages retrouvées. Inédits. Entretiens. Dossier critique. Bibliographie, Lausanne, Éditions Payot, 1989, p. 76-78, ainsi que dans les Appendices du volume de la Pléiade (Œ, p. 1309-1311).
26 P. Jaccottet, « En chemin », « Appendices », Œ, p. 1310.
27 Voir supra, note 14.
28 « D’autres encore commencent un vrai chant : serait-ce déjà les rossignols ? Ce sont des notes assez claires qui se succèdent à la même hauteur, mais prêtes, dirait-on, à risquer des variations ; et en effet elles s’y essaient, s’élevant soudain à un ton supérieur, mais toujours par groupes uniformes, sur un rythme lui aussi uniforme. » (P. Jaccottet, Éléments d’un songe, Œ, p. 329) ; « 1962. Mai. Tout cela le soir, et les premiers trilles du rossignol. » (P. Jaccottet, La Semaison. 1954-1967, Œ, p. 367) ; « 1966. Mai. Rossignols dans tous les buissons. » (Ibid., p. 391) ; « 1966. Juin. […] grillons et chouettes, rossignols, seuls bruits qui durent. Baignons dans cette eau laiteuse ne serait-ce qu’un instant, avant d’être rabroués. » (Ibid., p. 397) ; « 1967. Mai. Alouettes avides. Rossignol couleur de sable, de cendre, le plus sonore des oiseaux. » (Ibid., p. 411) ; « 1977. Juin. Des genêts, des rossignols, les derniers sans doute. » (P. Jaccottet, La Semaison. Carnets 1968-1979, Œ, p. 663).
29 P. Jaccottet, La Semaison. Carnets 1968-1979, Œ, p. 673.
30 « Ainsi, lorsque j’écrivais, et simplement dans l’effort de chercher cette justesse de voix qu’on ne peut sans doute espérer trouver que très tard […]. » (P. Jaccottet, Observations. 1951-1956, Œ, p. 35).
31 P. Jaccottet, La Semaison. Carnets 1968-1979, Œ, p. 675.
32 Id., Beauregard, Œ, p. 707.
33 Id., Haïku, Fontfroide-Le-Haut, Fata Morgana, 1996.
34 Voir supra, note 14.
35 P. Jaccottet, La Semaison. 1980-1994, Œ, p. 909.
36 Id., Pensées sous les nuages, Œ, p. 739.
37 Id., La Semaison. 1980-1994, Œ, p. 909.
38 « Notes du ravin », publié en 2001, a été rédigé en 1999 (Voir la Note sur le texte par Doris Jakubec, Œ, p. 1583-1592).
39 P. Jaccottet, « Notes du ravin », Ce peu de bruits, Œ, p. 1228.
40 (« Voce : […] Canto potente e melodico, ben riconoscibile per la sequenza di fischi staccati in crescendo ‘lu lu liu liu li li’. » L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterström, trad. it. Andrea Corso, Marco Gustin e Alberto Sorace, Guida degli uccelli d’Europa, op. cit., p. 276).
41 L’application d’une lecture bachelardienne demeure une perspective possible. Toutefois, une telle approche nous éloignerait excessivement de l’objet principal de cette étude, principalement parce que son approche repose essentiellement sur l’imagination du mouvement relative à l’élévation et au vol. Bachelard se demandait : « Pourquoi une verticale du chant a-t-elle une si grande puissance sur l’âme humaine ? » Néanmoins, nous envisageons d’explorer cette question dans de futurs travaux. (Gaston Bachelard, L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris, Libraire José Corti, 1943, p. 101).
42 P. Jaccottet, « Ce peu de bruits », Ce peu de bruits, Œ, p. 1245.
43 Voir supra, note 39.
44 John Keats, Poesie, éd. et trad. Silvano Sabbadini, Milan, Mondadori, 2016, p. 330.
45 Voir supra, note 19.
46 P. Jaccottet, « Rossignol », Et, néanmoins, Œ, p. 1120.
47 Voir supra note 40.
48 Qui est d’ailleurs également présent dans le passage relatif à la relecture de Keats, avec d’autres figures ascensionnelles relatives à l’eau : « Une voix qui ne s’adresse pas à nous, qui nous ignore, et c’est pourquoi elle paraît si pure, montant comme une flamme liquide, une fusée liquide – un jet d’eau. » (P. Jaccottet, « Ce peu de bruits », Ce peu de bruits, Œ, p. 1246).
49 « Voix qui d’abord hésite / Et plusieurs fois s’essaie / Avant de monter en spirales / En espèce de vrilles d’eau / Dans le velours de la nuit. » (Jean-Marc Sourdillon, Note sur le texte relative à Et, néanmoins, Œ, p. 1550).
50 Voir la Note sur le texte par Doris Jakubec, Œ, p. 1591-1592.
51 Voir supra note 48.
52 « S’élevant en spirales comme certaines merveilleuses phrases musicales, en vrille ; dans le velours de la nuit d’été. Cela ruisselle vers le haut. » (P. Jaccottet, « Ce peu de bruits », Ce peu de bruits, Œ, p. 1246.)
53 « Pas de mélancolie, pas de plainte dans ce chant-là : comme il nous semble y en avoir dans le cri du chat-huant ou le gémissement des ramiers. » (Ibid.).
54 « Pas de nervosité non plus comme, toujours en apparence bien sûr, dans les cris des hirondelles, ou même le pépiement de certains passereaux. » (Ibid.).
55 « C’est lié à la nuit, bien qu’ils chantent beaucoup le jour ; au son même du mot « nuit » ; et cela monte de l’abri des arbres, des fourrés, comme la voix même des arbres. » (Ibid.).
56 « Comme de l’eau : cela rafraîchit donc, cela désaltère l’ouïe. » (Ibid.).
57 « Cela éclaire la nuit comme une tendre fusée ; et s’allie tout naturellement à la lune : monte tout naturellement vers elle. » (Ibid.).
58 « On oublie, à force de ne jamais le voir, que c’est un oiseau qui parle ainsi. » (Ibid.).
59 « Cela pourrait être encore comme un collier de perles pour l’ouïe. » (Ibid.).
60 Voir supra, note 14.
61 « L’ensemble se conclut sur une sorte de flèche ou d’envoi, le poème « Rossignol », où se résume dans un mouvement à la fois ascensionnel et mélodique ce qui a été dit, fragmentairement, sur cette poursuite du poétique à travers le prosaïque et de l’invisible à travers le visible. » (Jean-Marc Sourdillon, Note sur le texte d’Et, néanmoins, Œ, p. 1544).
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2074.html.
Quelques mots à propos de : Fabio Berlanda
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Université Lumière Lyon 2
Laboratoire Passages Arts & Littératures (XX-XXI)
Fabio Berlanda est doctorant à l’Université Roma Tre, où il travaille sur le projet « Éther sans oiseaux. Letteratura e ornitologia in testi recenti di lingua francese » sous la direction de Luca Pietromarchi et Simona Pollicino. Avec des professeurs de l’Université de Padoue, il a idée et organise depuis cinq ans le Progetto Archetypon, un séminaire-atelier sur les archétypes littéraires.
Publications : « Appunti sulla complessità relazionale dell’ecologia letteraria », publiée dans NuBE, Nuova Biblioteca Europea, 4, 2023, p. 25-47 ; « Écologestes. Vers une écologie gestuelle : geste, poésie, monde, lecture », Loxias, 86, « Doctoriales XXI », 2024. Depuis 2024, il fait partie de l’équipe de rédaction du carnet Animots.
