Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
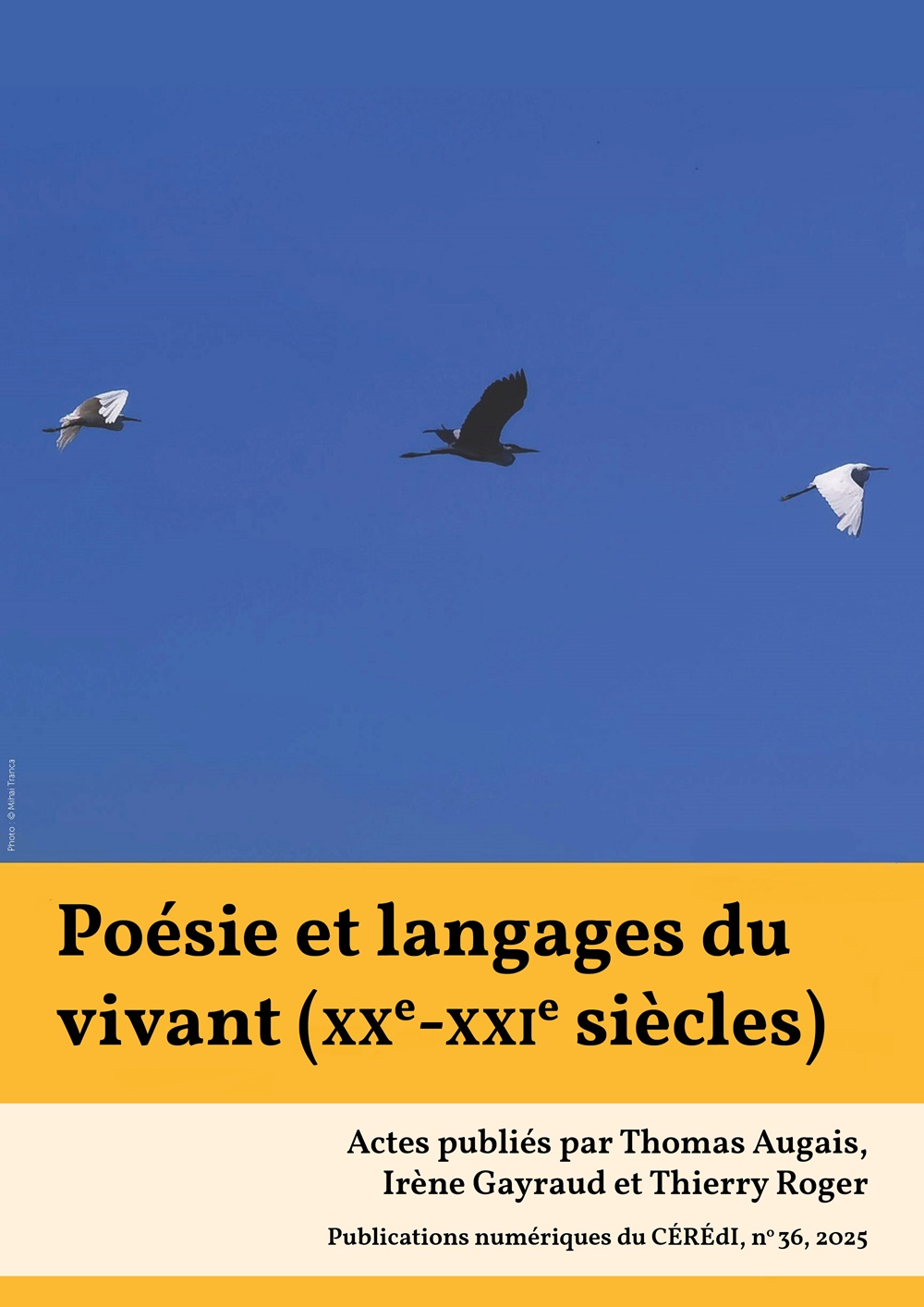
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
« L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
Bronwyn Louw
1La sympoïèse – une notion forgée par Donna Haraway – veut dire « faire avec ». Elle écrit que son néologisme « est un mot simple » qui « signifie “construire-avec”, “fabriquer-avec”, “réaliser-avec”1 ». S’érigeant en solidarité avec les pensées biologiques de la symbiose et de la symbiogénèse dues à Lynn Margulis2, la sympoïèse témoigne de la manière dont Haraway pose l’écologie comme problème poïétique engageant des pratiques langagières intimement intriquées avec les milieux de vie. C’est donc un mot-outil qui émane de son approche matérielle-sémiotique, laquelle consiste à prendre ensemble réalités de terrain et réalités figurales, qu’elles soient plastiques, rhétoriques, mythiques ou encore oniriques. Pour esquisser une image d’une pratique sympoïétique de l’écriture – d’une sympoétique3 –, je me propose de partir de la rencontre entre Camillo Sbarbaro, un poète et lichénologue italien du xxe siècle4, et ces symbiotes emblématiques que sont les lichens5. Par la symbiose lichénique, plus de 20 000 espèces connues de lichens émergent de relations durables et réciproques entre champignons et algues, et d’autres restent encore à connaître. Camillo Sbarbaro était particulièrement fasciné par la taxinomie inaboutie des lichens, et les diverses perspectives de nouveauté biologique recelées par ces « phénomènes6 » qui sont davantage une relation, une friction, qu’un organisme. Il a même contribué à identifier plusieurs espèces de lichen jusqu’alors inconnues qui figurent à ce jour dans des indexes botaniques7. Sbarbaro note dans un livre de 1967 : « Aujourd’hui aussi, un nouveau lichen : le monde n’a pas fini de se faire8. » La connaissance des lichens et de leurs vies obscures9, lentes, longues, pionnières et extrémophiles (certains peuvent survivre dans l’espace, d’autres des centaines d’années) n’a de cesse de se compliquer depuis l’époque de Sbarbaro. Selon des découvertes récentes, la symbiose des lichens ne serait pas seulement le fait de deux partenaires fongiques et photosynthétiques, mais aussi de nombreuses bactéries et levures10.
2C’est grâce à la journaliste, critique et poète Florence Trocmé que j’ai connu le recueil Copeaux11 (1920) de Sbarbaro, qui apparaît au détour d’un passage du Présage de Pierre Gascar qu’elle cite dans son Flotoir12 – un blog nourri d’entrées régulières où sa critique créative se constitue de citations en gloses. La citation en question était la suivante :
Les lichens ont eu leur poète en la personne de Camillo Sbarbaro qui occupe une place très honorable dans l’histoire de la littérature italienne de la première moitié de ce siècle. Montrant cette heureuse dualité de l’esprit dont Goethe nous a donné l’exemple, Sbarbaro alliait le sentiment poétique à la connaissance scientifique et faisait des lichens le thème de ses rêveries les plus libres comme de ses traités de botanique les plus rigoureux13.
3Trocmé a obtenu de l’éditeur la permission de partager certains extraits d’une édition épuisée de Copeaux sur son site dédié à l’actualité éditoriale de la poésie contemporaine, Poesibao. À leur découverte, j’ai été interpellée par ce que Sbarbaro y appelle l’« [é]piphanie des rencontres14 » qui le prenaient d’assaut alors qu’il collectait des lichens. Par cette cueillette, il faisait, selon ses propres mots, « l’amoureux inventaire d’une infime partie du monde », pour fabriquer un « Carnet d’Échantillons du Monde ». Ce carnet semble être un catalogue de lichens récoltés et ordonnés selon des considérations qui dépassent l’héritage des classifications binominales linnéennes tout en les englobant. Il y décrit la constitution – de reconnaissance végétale en cueillette, de collage en composition –, d’un herbier de lichens où gestes poétiques et botaniques se rencontrent et se confondent. Cet herbier, dont je n’ai pas trouvé de trace matérielle, est décrit comme un « Carnet » dans Copeaux, par une mise en abîme où le livre dans le livre permet de réfléchir à l’écriture et à la lecture par leur mise en scène15. Quelles façons d’écrire et de lire Sbarbaro nous livre-t-il dans Copeaux grâce au livre-objet du « Carnet d’Échantillons du Monde » ? J’aimerais suggérer qu’il s’agit d’une sympoétique, c’est-à-dire de façons d’inventer, de composer et d’écrire, littéralement, avec des lichens. En quels sens le geste de cueillir des lichens peut-il fonctionner comme une pratique de la citation ? Et en quoi les logiques figurales matérielles et métonymiques à l’œuvre dans l’écriture de Sbarbaro permettent-elles de parler d’une « écriture » ou encore d’une « lecture » des lichens16 ?
Cueillir des lichens pour écrire avec eux : une façon de citer les lieux du monde
Cueillir morcelle
4Emmanuel Hocquard cite Nietzsche dans « Les Coquelicots », une portion de sa Grammaire de Tanger17 : « Il faut émietter l’univers, aurait écrit le philosophe-philologue, perdre le respect du tout. » Dans son essai Tuer les fleurs, Pascal Quignard voit dans le geste de cueillir une leçon de fragmentation à l’attention des strictors (les cueilleurs d’olives en latin) et des litterators, cette figure de l’écrivain qui compose des anthologies en y rassemblant les plus belles citations. Cueillir est un geste aux sens et visées sociaux, ornementaux, poétiques et botaniques, en même temps agricole et pré-agricole, une tâche agraire tout comme une affaire vivrière et vernaculaire. L’affinité entre pratiques agricoles et littéraires de la cueillette mise en exergue par Quignard trouve sa justification non seulement dans le geste de choisir et de sectionner avant de rassembler, recueillir, mais aussi dans l’étymologie même du verbe « cueillir ». Celui-ci a comme racine grecque le verbe legein, qui veut dire en même temps « ramasser », « cueillir », « collecter », « dire », et « lire ». Après avoir rappelé qu’anthos veut dire fleur, qu’« anthologie » désigne en conséquence une cueillette de fleurs, Quignard écrit qu’une citation
à proprement parler, est une fleur qu’on a arrachée à un livre plus ancien et qu’on a introduit dans un livre plus récent. Les anciens « Grecs » nommèrent « anthologie » cette « recueillette » – ce recueil – des plus belles choses préalablement distraites de leur milieu et soustraites à l’époque de leur création18.
5Des fleurs cueillies aux lichens collectés, il n’y a qu’un pas, celui d’une révolution esthétique qui a fait des lichens un objet de fascination plutôt que de répulsion à partir de l’époque romantique19.
6Avec ses Copeaux, Sbarbaro répond à l’injonction de Nietzsche, écrivant à partir de sa pratique de faire des herbiers, un jeu d’enfance qu’il a transformé en passion empirique dans son activité de lichénologue20. Il morcelle le monde en cueillant des lichens, en les arrachant à leurs substrats de pierre, de bois, de terre, de sable, de mousse… Si ce geste comporte une certaine violence, il n’est pas pour autant mortifère. Les lichens sont capables de reviviscence : arrosé de quelques gouttes d’eau, un lichen desséché peut revivre. Sbarbaro ne s’attarde pas sur les ambivalences de sectionner une vie et de la transposer dans la vie paradoxale d’une « collection vivante21 ». Il semble comprendre le geste de tendre la main, de toucher, de dé-ranger, comme un acte d’amour, évoquant « l’Épiphanie des rencontres » avec les lichens et écrivant : « Dans l’amoureux inventaire d’une infime partie du monde, celle avec qui je suis le plus en affinité́, j’assouvissais sans le savoir mon “servile amour des choses”. » L’affinité éprouvée par le poète à l’endroit des lichens – un sentiment diffus d’avoir partie liée avec eux, mais aussi de vivre, de penser et d’habiter le temps et l’espace mieux à leur contact – semble motiver le fait d’en cueillir certains. Ce qui morcelle, ce qui met en exergue un lichen particulier, délimitant ainsi le morceau de monde retenu, la citation prélevée, n’est pas ici un esprit de dissection. Il s’agit davantage d’une rencontre à l’intérieur de laquelle le poète est percé par « l’aspect de toute plante » qui s’imprime en lui. Il se compare alors à « la strate – qui […] conserve à jamais […] l’empreinte d’une feuille, d’un élytre », sa sensibilité se muant en une sorte d’herbier virtuel avant même d’avoir cueilli le moindre lichen. Ainsi, rappelant Goethe, à qui Pierre Gascar a comparé la gémellité du regard scientifique et poétique que Sbarbaro porte sur les lichens, ce dernier semble placer les « affinités électives22 » au cœur de sa poétique mais aussi de son épistémologie. La notion d’« affinité élective » est triplement parlante ici. Elle motive la sélection des lichens cueillis en citation matérielle ; elle éclaire aussi le type de connaissance relationnelle que le lichénologue-poète entretient avec eux ; et, enfin, elle décrit leur façon d’être symbiotique.
7C’est d’une forme de préférence, d’affinité, qu’émergent les rencontres fortuites et durables entre poète et lichens, qui se jouent aussi entre ces derniers et les surfaces où ils habitent. Sbarbaro écrit à ce propos :
Il s’installe n’importe où ; toutefois, dans le choix d’un domicile, chaque espèce a ses préférences. La plupart des lichens habitent le bois ou la pierre. Mais, parmi les premiers, certains colonisent l’olivier, d’autres le cyprès, d’autres encore le pin. De goût plus difficile, d’aucuns ne s’établissent que sur un arbre bien à eux : le sureau, le jujubier.
8Il est donc question d’une rencontre particulière pour le poète-lichénologue qui se promène et pour les lichens qui s’installent sur le bois, la pierre, le sable, les os, le cuir, le porcelaine… Il s’agit d’une affinité élective dans les deux cas, d’une préférence qui dicte une attirance ayant l’effet de différencier entre eux les lichens pour le cueilleur, les substrats d’habitation pour les lichens. Dans le cas du compositeur de l’herbier, la rencontre est « exclamative », à croire que la rencontre aurait dans le vécu du poète une voix, une expression, non-seulement quelque chose à dire, mais un message épiphanique à livrer avec emphase et emportement. C’est d’une « épiphanie » sensorielle qu’il s’agit. Alors que le terme a des connotations religieuses, évoquant la révélation d’une vérité d’ordre sublime, Sbarbaro est « convaincu que la vérité du monde se révèle aux sens par des illuminations soudaines23 ». Il s’attache ainsi à montrer comment, lorsque la rencontre sensorielle s’illumine, un lichen luit, ressort du reste, et provoque ainsi le geste de le cueillir puis de le recueillir. L’affinité a lieu non-seulement entre Sbarbaro et les lichens, mais aussi au sein même du lichen qui est une affinité faite corps, et entre lichens et substrats. Cette affinité élective-là est décrite par Sbarbaro en termes d’habitation, d’appartenance, de liaison durable. Les lichens « s’installent », choisissent un « domicile » selon leurs « préférences » : certains « habitent » le bois et la pierre, d’autres « colonisent l’olivier ». Ils font corps avec un lieu dont ils gardent et transposent la mémoire, comme une bonne citation, quand ils sont cueillis ici pour être redéployés ailleurs.
L’herbier comme recueil de citations cueillies à même le monde
9Après ce geste de cueillir qui morcelle, à Sbarbaro de réunir ses récoltes dans un herbier, un objet-livre qu’il présente comme étant « à peu de choses près un Carnet d’Échantillons du Monde ». La formulation « à peu de choses près » est ambiguë, et, de ce fait, interpelle. Il pourrait reconnaître par-là qu’échantillonner un monde inachevé, avec sa marge obstinée de (ré)invention, est un projet forcément incomplet. Mais « à peu de choses près » pourrait aussi qualifier le nom de « carnet » qu’il donne à son herbier de lichens. Le carnet étant le lieu des brouillons, des croquis, des essais d’écriture, un herbier qui n’est pas bien loin d’être un carnet pourrait vraisemblablement contenir les esquisses d’une presqu’écriture, quelque chose à deux doigts de pouvoir se lire. Des lichens qui écrivent « à peu de choses près », qui frôlent le lisible, drôle de caractères qui ne sont pas sans évoquer le motif du monde comme livre (« liber naturae ») présent dans les logiques symboliques du monde médiéval et de la Renaissance24. On pourrait y voir une métaphorisation de l’écriture et de la lecture. Pourtant, dans le double mouvement de fragmentation / recomposition par lequel Sbarbaro compose son quasi-carnet transparaît une façon d’écrire littéralement avec des lichens. Ma suggestion est que cette écriture relève d’une sympoétique, laquelle déploie une poétique de la citation proche du collage, où citer peut aussi consister en la transposition sur la page d’une bribe brute extraite du paysage. Il s’agit d’une pratique qui inclut les choses du monde – en l’occurrence des lichens – dans la théorie intertextuelle de l’écriture. Tiphaine Samoyault écrit à propos d’une pratique intertextuelle et relationnelle de la littérature : « Le composite, le collectif, ne peuvent provenir que de l’inclusion de la réalité la plus ordinaire, la plus brute, la moins “artistique” possible25. » L’écriture du lichen chez Sbarbaro pourrait ainsi se comprendre à l’aune d’une esthétique de la récupération26, de l’hétérogène et du discontinu proche de poésie visuelle des collages de Guillaume Apollinaire27. Pour Michel Butor, les tableaux formés par des lichens sont de « la peinture qui se fait toute seule28 ». Considérer que les lichens corticoles constituent, dans leur façon de se coller aux surfaces, une forme « d’art involontaire29 », rappelle les conseils de Léonardo di Vinci aux peintres de se former auprès des murs en pierre et des figures hasardeuses qui s’y déploiement. Sbarbaro ne prend pas seulement les lichens comme modèle, mais acte une forme de cosignature30 en prélevant des bribes à même le paysage pour les recomposer ailleurs.
10On peut lire les passages des Copeaux qui se rapportent au « Carnet d’Échantillons du Monde » comme des commentaires de la presqu’écriture que Sbarbaro a composée avec les lichens, mais aussi comme glose de l’écriture des lichens telle qu’elle s’inscrit et fait figure sur une surface d’inscription. Si les lichens ont quelque chose d’un texte de la terre, d’un graphisme spontané propres à des auteurs nombreux et anonymes, alors les cueillir et les inscrire par effet de montage dans une autre composition est, assez littéralement, les déployer en tant que citation au sens de « morceau de discours transposé dans un autre discours31 ». C’est peut-être une exagération d’attribuer à des lichens cueillis, séchés et herborisés un statut de citation en dépit de leur caractère non-verbal. Et pourtant, Sbarbaro insiste sur les façons qu’auraient les lichens de faire sens en faisant appel aux sens, qu’il s’agisse de la vue, de l’ouïe ou de l’odorat :
La pièce est encombrée, imprégnée d’une odeur de sous-bois par un herbier de lichens. Sous des espèces de copeaux de bois, d’éclats de pierre, il constitue à peu de chose près un Carnet d’Échantillons du Monde. Parce que récolter des plantes, c’est récolter des lieux. Rien ne garde mieux la mémoire d’un site que la plante qui d’elle-même y est née : lui appartenant, tout comme celle qui y puise sa nature et que détermine la moindre de ses caractéristiques, elle le représente de la manière la plus concrète. Avec la voix du torrent ou le souffle de la mer, avec l’air de la ville ou celui des hauteurs, elle réveille chez qui la cueillit l’heure et la saison. Desséchée, elle suggère encore la manière dont le soleil la touchait.
11Le parfum qui embaume la pièce et qui introduit ainsi les sous-bois dans la maison n’est qu’une des manières par lesquelles ce presque-carnet se livre à un travail de représentation. Il ne s’agit pas de « représenter » au sens de reproduire en image une chose, une idée ou un son. Plutôt, et Sbarbaro met en exergue cette particularité de la presqu’écriture qu’il compose avec les lichens, ces derniers rendent présents les lieux de façon matérielle, gardent « la mémoire des sites », « réveille[nt] l’heure et la saison » de leur cueillette et « suggère[nt] encore la manière dont le soleil [les] touchait ». C’est donc comme réceptacles de mémoire et condensés d’atmosphère que les lichens représentent « de la manière la plus concrète » les lieux où ils ont été cueillis. En tant qu’images indicielles, ils les rendent aussi présents32. Pour Sbarbaro, les lichens tiennent ces capacités à recéler du sens – le fait de garder mémoire, de représenter, d’avoir une force de suggestion – de leur nature. Il s’agit d’une compréhension de la nature proche de son étymologie. Sa racine latine nascor veut dire « naître », « provenir33 ». C’est parce qu’un lichen est né d’un lieu, parce qu’il lui « appartient », parce qu’il y « puise sa nature » et que « la moindre de ses caractéristiques » en provient, qu’il le représente matériellement. C’est cette logique métonymique, celle qui veut que « récolter des plantes, c’est récolter des lieux », qui ouvre sur une lecture des lichens.
Les lichens comme figures métonymiques et matérielles
Logique métonymique
12Appeler les lichens cueillis « échantillons », en plus d’introduire une dimension expérimentale dans l’écriture poétique de Sbarbaro, témoigne de la présence d’une logique répandue en sciences empiriques selon laquelle la partie peut être l’unité de mesure et l’expression du tout34. Face aux lichens, Sbarbaro emprunte un chemin synecdochique pour prendre le large en passant par la porte d’un échantillon particulier :
L’herbier est un carnet d’échantillons du monde. Ressource des heures d’ennui, j’ouvre un paquet au hasard. Dans chacun il y a le monde.
Lorsqu’un lieu me plaît au point que le contempler des yeux ne suffit plus à m’assouvir, pour tromper mon impossible souhait d’une communion intime avec lui, un songe presque scientifique me visite : un aérostat en guise d’ailes, capable de compenser le poids de mon corps ; et devenir léger, léger, comme on peut l’être dans l’atmosphère de la lune. Au-delà de l’envie et du caprice, survoler ce lieu ; caresser l’oliveraie de la main comme si c’était le dos d’un troupeau de brebis […] faire des tours et des détours, être ici et être là : grappiller ce lieu comme un pampre, rival du papillon qui déguste son pré couvert de fleurs.
Avec l’herbier, le rêve s’accomplit ; et pas seulement en un lieu, mais à travers le monde !
13« Dans chacun il y a le monde ». Comme le fait valoir Matteo Meschiari, ce regard suit une « chaîne métonymique » : « lichen > support > lieu > paysage > monde35 ». Force est de constater que Sbarbaro ne renvoie pas dos-à-dos le fragment moderne (la bribe brute du lichen prélevée) et le monde cosmique des grecs, mais semble voir, à l’instar des romantiques allemands du cercle de l’Athénaeum, le premier comme point de passage vers le second36. Le sens de la synecdoque – la partie pour le tout – est décroissant, et va du particulier au général. Plutôt qu’un mouvement d’abstraction, l’effet stylistique est donc celui d’une esthétique paysagère, celle qui fait primer l’apparence exceptionnelle, piquante, insolite d’un paysage et cherche à la traduire. Pourtant, ce n’est pas le sens de la vision qui règne ici en maître, ni une écriture du paysage axée sur la belle apparence et baignée dans l’imaginaire des tableaux du xviiie siècle37. Il n’est pas question de contemplation. Le poète décrit au contraire une mise en sourdine du sens de la vue, ou du moins une expérience de ses limites. Il « lit » son carnet de lichens lorsque contempler un lieu aimé ne satisfait plus suffisamment son désir de paysage. La scène de lecture décrite est celle d’un envol lyrique. Mais Sbarbaro qualifie la rêverie qui survient de « songe presque scientifique ». En lisant son « Carnet d’Échantillons du Monde », il se sent survoler des paysages qu’il appréhende par le toucher (« caresser l’oliveraie »), par une cueillette qui savoure au hasard de son appétit, de son goût (« grapiller comme un pampre »). Paradoxalement, l’acte de lecture de l’herbier qui rend possible un regard surplombant sur le montage de lichens (tout comme son rêve d’aérostat permet de survoler des paysages) produit un sentiment d’immersion réciproque : celui de pouvoir plonger dans le paysage tout en l’embrassant. Faisant écho à des pensées paysagères contemporaines, comme celles de Jean-Marc Besse, le paysage surgit comme expérience d’immersion, comme milieu nourricier où l’on baigne, et les sens qui priment sont ceux du toucher et du goût38. Le poète ainsi plongé dans une synesthésie surnage sans contrainte spatio-temporelle, comme dans « l’atmosphère de la lune », et ce parce que dans chaque lichen « il y a le monde ». Exalté, il écrit : « Il y a un instant, j’étais sur l’Olympe de Grèce, entouré de traces des Dieux ; me voici au sommet de l’Amiata : c’est un jour d’automne nuageux, tu es là, parmi de grands châtaigniers… »
14Lire les lichens récoltés et recomposés les uns aux côtés des autres, c’est pour lui faire l’expérience d’un brassage sensible, imagé et mémoriel des lieux. Les figures métonymiques, comme le fait valoir le médiéviste Gerhart B. Ladner, ouvrent, par leur mouvement d’inclusion, sur un régime de participation au monde39. « L’impossible souhait d’une communion intime » avec un lieu formulé par Sbarbaro devient alors possible grâce à sa lecture métonymique du « Carnet d’Échantillons du Monde ». D’après le poète, la juxtaposition des lichens cueillis concentre en un carnet ses lieux aimés, et produit une expérience de lecture que le contact séquentiel, lichen après lichen, lieu après lieu, ne permettrait pas. Sbarbaro parvient ainsi, de survol en cueillette, de lieu cité par lichen prélevé, à vivre un degré de participation au monde a priori impossible. Un siècle plus tard, cet horizon de la participation, cette pratique de l’inclusion, font à la métonymie une place particulière dans les lectures écopoétiques et écocritiques contemporaines40. La sympoétique qui consiste à écrire, littéralement, avec les lichens, passerait donc par le fait de les cueillir, puis de les recueillir en carnet, de façon à composer avec ces citations matérielles un drôle de texte. Sa lecture se fait par une certaine logique figurale – la synecdoque – permettant paradoxalement de se saisir d’un tout – le monde – en le morcelant. Miniatures, ou du moins parts expressives, d’un univers qu’on a accepté de morceler, les lichens cueillis qui composent le carnet participent à une sympoétique où Sbarbaro écrit avec eux, et plus particulièrement avec leurs potentiels figuratifs, en même temps métonymique, comme l’on vient de le voir, mais aussi, comme je tenterai de montrer par la suite, matériel, graphique.
Les lichens comme images à même la matière
15Sbarbaro fait aussi valoir que ses observations minutieuses de lichénologue permettent de constater chez certains lichens un air d’écriture, des comportements scripturaux, et un potentiel graphique et figural quasi infini. La ressemblance d’une « entière tribu » de lichens avec l’écriture leur a valu le nom de Graphidées. Ils tapissent, selon le mot du poète « d’écritures indéchiffrables les supports » de leur choix. Il poursuit en énumérant les différentes manières qu’a cette tribu des Graphidées d’afficher une parenté avec l’écriture dans toute la grande diversité de son histoire mondiale. Ainsi, l’écriture de ces lichens se dessinerait en « caractères minuscules ou majuscules, incrustés ou en relief : linéaires, fourchus, chinois, cunéiformes ». En relevant ces contrastes, Sbarbaro rappelle les différences au sein des lettres de l’alphabet, mais aussi des principes de variation des techniques d’impression : creuser dans un substrat, s’y superposer… Il donne le détail biologique des impressions par incrustation de certains lichens, écrivant : « […] le lichen attaque les pierres les plus dures ; avec des acides de sa fabrication, il les désagrège, les perce pour mettre sa semence à l’abri du vent. » Il évoque à ce propos « des parois criblées de trous comme des tamis par le passage d’une Verrucaire » qu’il a rencontré dans les Alpes. Enfin, il renvoie, à des alphabets éloignés de lui par l’espace ou le temps : « chinois, cunéiformes41 ». Ce faisant, il évoque des systèmes où pictogrammes, sonogrammes et idéogrammes se côtoient, et rappelle la révolution que toutes ces techniques graphiques ont en commun, qui se produit à ce point de bascule où une figure se mue, de façon à capter en tant que miniature un aspect du monde. Voir, à l’instar d’Anne-Marie Christin, l’origine de l’écriture dans la figure plutôt que du côté du verbe ou de la parole, c’est imaginer son émergence de la matière rocheuse des caves préhistoriques42. Alors que le philosophe David Abram considère que l’avènement de l’écriture opère une césure avec le monde de la vie dans les civilisations de l’alphabet, où les lettres renvoient à des sons43, une approche figurale de l’écriture renvoyant davantage aux pictogrammes ou aux idéogrammes suggère plutôt une forme de continuité entre formes écrites, formes vivantes, et formes de vie.
16Sbarbaro fait état justement des comportements figuraux des lichens, de leurs façons d’évoquer par un jeu de ressemblances iconiques44, de simuler, et de contribuer plastiquement à une forme plus large en tant que figure ou qu’image abstraite, en interaction avec leur surface d’inscription45, telles des étoiles sous fond de ciel.
Quantité d’entre eux forment des toits de tuiles imbriquées ; voire des pavements : dalles triangulaires, pentagonales, polygonales. D’autres simulent des Voies lactées, des systèmes stellaires. D’autres encore, suspendus aux branches, évoquent des barbes, des crinières d’équidés ou des chevelures absaloniennes.
17Dans des passages où il rappelle explicitement sa dette vis-à-vis de Sbarbaro, Pierre Gascar compare lui aussi l’écriture collective des lichens aux comportements stellaires, décrivant certains lichens crustacés comme des « constellations éparses46 » et transformant le nom « étoile » en verbe pour dire que les lichens « étoilent, estampillent47 ». Impressions lumineuses d’une écriture s’imprimant en images, en miniatures, en estampes qui font figure au seuil du lisible, les lichens se prêteraient à des formes de lecture divinatoires, tout comme les constellations ou les écailles de tortue. Leur intérêt particulier, par rapport aux étoiles, serait de changer bien plus rapidement, de varier dans leurs façons de faire forme, parce qu’ils s’inscrivent aléatoirement sur leurs substrats, mais aussi en raison de leur grand polymorphisme. Ainsi, le caractère multiforme et imprévisible de ces entités aux statuts flous que sont les lichens, se déployant dans une morphogénèse perpétuelle au contact de surfaces minérales et végétales, serait à l’origine d’une écriture cryptique mouvante. En étudier l’opacité, l’étrange multiplicité, et la citer toute brute en s’appuyant sur sa capacité en tant que figure indicielle ou iconique à rendre présent, visible… Voilà quelques-unes des pistes qu’écrire avec les lichens comme caractères non-systémiques et innombrables aurait à offrir à une sympoétique qui cherche à relever le défi de devenir une poétique de la pluralité.
18Roland Barthes écrivait que « tout texte est un tissu nouveau de citations révolues48 ». En dépit de l’ambivalence d’un cueillir qui morcelle, la collection vivante rassemblée dans le « Carnet d’Échantillons du Monde » illustre ce que peut être une forme d’écriture se faisant littéralement avec des lichens. J’aimerais suggérer, en guise de conclusion, que le texte nouveau qui en résulte – ce presque « Carnet » – est sympoétique, cosigné par le poète-lichénologue et les lichens. Il est tissé de citations matérielles : des lichens cueillis et recueillis par l’auteur selon des considérations avant tout amoureuses. L’écriture, du « Carnet » comme des Copeaux, est sympoïétique, parce qu’elle se fait avec et à partir d’une cueillette de morceaux de monde dont les sens opaques, fuyants, hasardeux, polymorphes se sont révélés dans l’épiphanie de la rencontre. Cette rencontre amoureuse au potentiel créateur et heuristique se joue avec le lichen, entre les lichens, entre lichens et substrats, mais aussi au sein même des minuscules « écosystèmes complexes49 » que constituent leurs symbioses, le lichen étant en lui-même une « multiple rencontre50 » entre champignons, algues, bactéries et levures. Dans la sympoétique de Sbarbaro, ces lichens-citations introduisent à l’intérieur du poème, grâce à leur immense inventivité figurale, une langue foncièrement étrangère qui se compose plastiquement à même le monde.
1 Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble (2016), trad. Vivien Garcia, Vaulx-en-Velin, Les Éditions des mondes à faire, 2020, p. 115.
2 Lynn Margulis et Dorion Sagan, L’Univers bactériel : les nouveaux rapports de l’homme et de la nature, trad. Gérard Blanc et Anne de Beer, Paris, Seuil, 2002. Haraway commente en détail l’apport de Lynn Margulis à sa notion de sympoïèse dans Vivre avec le trouble, ibid. p. 116-117.
3 Bronwyn Louw, « Entre lichens et poètes : l’émergence d’une sympoétique », Mosaïque [En ligne], no 20, février 2024.
4 La portée contemporaine de l’approche scientifique et poétique des lichens pratiquée par Camillo Sbarbaro a notamment été commentée par Clémence Jeannin, « L’“amoureux inventaire” des paysages ligures dans l’œuvre de Camillo Sbarbaro », Cahiers d’études romanes [En ligne], no 46, 2023 ; Vincent Zonca, Lichens. Pour une résistance minimale, Paris, Le Pommier, 2022 ; Lavinia Spalanca, « Camillo Sbarbaro poeta e scienziato », Bollettino’900, 1, 2010 ; Matteo Meschiari, « Un mondo di licheni. Immagini vegetali e metonimia in Camillo Sbarbaro », Filologia e critica, no 3, 2003 ; Roberta Colombo, « La collezione si fa pagina. Le farfalle di Gozzano ei licheni di Sbarbaro », Inestesieonline, XIII (41), 2024, p. 1-18.
5 Pour une synthèse récente d’une connaissance pluridisciplinaire des lichens, voir Vincent Zonca, Lichens, op. cit., ou encore Marc-André Selosse, Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux, et les civilisations, Arles, Actes Sud, 2017.
6 Matteo Meschiari, « Un mondo di licheni. Immagini vegetali e metonimia in Camillo Sbarbaro », art. cité, p. 459.
7 Voir notamment les collections de la « Herbaria » de l’université de Harvard où Sbarbaro est référencé comme botaniste, ainsi qu’un article qui relate la réinscription d’une espèce de lichen dont la découverte est attribuée à Sbarbaro dans la flore lichénique italienne : K. Knudsen, J. Kocourková J. et P. L., « Nimis Acarospora crozalsii (Lichenized Ascomycetes, Acarosporaceae), to be re-instated in the Italian lichen flora », Borziana, no 5, 2024, p. 41-45.
8 Camillo Sbarbaro, Licheni, Un campionario del mondo, Vallecchi, Florence, 1967, p. 29, cité par Matteo Meschiari, op. cit. p. 458.
9 Brenda Hillman, Extra Hidden Life, Among the Days, Middletown, Wesleyan University Press, 2018, p. 22.
10 Juliette Asta, « Les lichens, de surprenants organismes pionniers », Encyclopédie de l’Environnement [En ligne], 2025.
11 Camillo Sbarbaro, Copeaux, suivi de Feux follets, trad. Jean-Baptiste Para, Sauve, Éditions Clémence Hiver, 1992, p. 57 à 66. Toutes les citations de Sbarbaro proviennent de cet extrait.
12 Le Flotoir est une parution régulière entretenue par Florence Trocmé sur Poesibao, site qu’elle a fondé en 2004.
13 Pierre Gascar, Le Présage, Paris, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1972, p. 161.
14 Toutes les citations de Copeaux sont tirées des extraits rendus accessibles par Florence Trocmé sur Poesibao.
15 Anthony Glinoer et Caroline Paquette, « Le livre dans le livre : représentations, figurations, significations », Mémoires du livre / Studies in Book Culture, volume 2, no 2, printemps 2011.
16 Je me limite ici à une analyse de Copeaux. Il serait intéressant, par la suite, et moyennant sa traduction, de poser ces mêmes questions au dernier livre publié par Sbarbaro avant sa mort, Licheni, Un campionario del mondo, qui porte le nom du « Carnet d’Échantillons du Monde » et poursuit donc ostensiblement le double geste qui m’interpelle dans Copeaux. Roberta Colombo nous apprend que cet ouvrage, paru en 1967, est « un volume dans lequel se mêlent prose écrite antérieurement, photographies et listes d’espèces nouvellement découvertes ». Roberta Colombo, « La collezione si fa pagina. Le farfalle di Gozzano ei licheni di Sbarbaro », art. cité, p. 14.
17 Emanuel Hocquard, « Les Coquelicots », Une grammaire de Tanger, Paris, P.O.L, 2022, p. 91.
18 Pascal Quignard, « Tuer les fleurs », Une journée de bonheur, Paris, Arléa, coll. « Arléa-Poche », p. 16.
19 Giliane Osborne, « Plant Poetics and Beyond: Lichen Writing », EntropyMag, 2019. C’est un point que je développe davantage dans mon article « Entre Lichens et Poètes. L’Émergence d’une sympoétique », art. cité.
20 Robert E. Kohler, All Creatures: Naturalists, Collectors, and Biodiversity, 1850-1950, Princeton, Princeton University Press, 2006.
21 Mathilde Gallay-Keller, Serge Reubi et Mélanie Roustan (dir.), « Collectionner le vivant », Gradhiva [En ligne], no 36, 2023.
22 Johann Wolfgang von Goethe, Les Affinités électives (1844), trad. Pierre du Colombier, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 1954, p. 59-62.
23 Roberta Colombo, « La collezione si fa pagina. Le farfalle di Gozzano ei licheni di Sbarbaro », art. cité, p. 16.
24 Gerhart B. Ladner, « Medieval and Modern Understanding of symbolism: a comparison », dans Images and Ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Art, Rome, Edizioni de Storia e Letteratura, 1983 ; Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 32-45.
25 Tiphaine Samoyault, L’Intertextualité. Mémoire de la littérature, Paris, Armand Colin, 2010, p. 25-26.
26 « Récupération » au sens de Tiphaine Samoyault, qui explore les « figures de la récup’ » dans son séminaire La Récup’ à l’EHESS (2021-2023).
27 Moucherif Abdelhakim, « L’esthétique du collage et du recyclage dans l’œuvre poétique de Guillaume Apollinaire », eLyra: Revista da Rede Internacional Lyracompoeticsi [En ligne], no 7, 2016.
28 Cité dans Vincent Zonca, Lichens. Pour une résistance minimale, Paris, Le Pommier/Humensis, 2021, p. 92.
29 Gilles Clément, Traité succinct de l’art involontaire, Paris, Sens & Tonka, 2014.
30 Gilles Clément parle d’un « partage de la signature » dans « La Préséance du vivant. Un dialogue entre Gilles Clément et Coloco / Nicolas Bonnenfant, Miguel et Pablo Georgieff », Les Carnets du Paysage, no 36, Arles, ENSPV/Actes Sud, 2022, p. 24.
31 Antoine Compagnon, La Seconde Main ou le travail de la citation, Paris, Points, coll. « Points Essais », 2016, p. 56.
32 Voir le recours d’Eduardo Kohn au « Pierce “bizarre” » pour penser des modes de représentation au-delà de l’humain dans Comment pensent les forêts (2013), trad. Grégory Delaplace, Bruxelles, Zones sensibles, 2017, p. 28-29. Le sémiologue Charles Pierce distingue entre différentes modalités de représentation : icones quand il est question de ressemblance ; indicielles quand il s’agit de signes marqués, affectés, impactés par la chose qu’elles représentent ; symboliques en ce qui concerne les signes conventionnels.
33 Emanuele Coccia, « Migrer, c’est commencer à vivre », dans Les Migrations des plantes, dir. Marion Grange, Bronwyn Louw, Paris, Manuella, 2024, p. 247. En se référant à cette étymologie, Coccia définit la nature comme la « collection de tout ce qui naît ».
34 Christian Godin, « Le tout dans la partie », Les Cahiers de médiologie, no 9, 2000/1, p. 179-188.
35 Matteo Meschiari, « Un mondo di licheni. Immagini vegetali e metonimia in Camillo Sbarbaro », art. cité, p. 465.
36 François Danzé, « Aux sources du premier romantisme », La Vie des idées, 12 juin 2024.
37 Jacques Rancière, Le Temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique, Paris, La Fabrique, 2020.
38 Jean-Marc Besse, La Nécessité du paysage, Marseille, Éditions Parenthèses, coll. « La Nécessité du paysage », 2018.
39 Gerhart B. Ladner, « Medieval and Modern Understanding of symbolism: a comparison », art. cité.
40 Voir notamment Ann-Sofie Lönngren, « Metaphor, Metonymy, More-Than- Anthropocentric. The Animal That Therefore I Read (and Follow) » dans The Palgrave Handbook of Animals and Literature, dir. Susan McHugh, Robert McKay et John Miller, Cham, Palgrave Macmillan, « Palgrave Studies in Animals and Literature », 2021 ; Rosi Braidotti, Metamorphoses: towards a materialist theory of becoming, Cambridge, Polity, 2001 ; Helen Cousins, « Morphing Forms: Metamorphosis in Twenty-First-Century British Women’s Experimental Short Fiction » dans Rethinking Identities Across Boundaries, dir. C. Capancioni, M. Costantini, M. Mattoscio, Cham, Palgrave Macmillan, 2024.
41 Les sinogrammes datent d’environ 1500 ans avant l’ère commune. L’écriture cunéiforme, qui a émergé au Moyen Orient, date d’environ 13 siècles avant l’ère commune.
42 Anne-Marie Christin, L’Image écrite ou la déraison graphique (1995), Paris, Flammarion, 2009.
43 David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens (1996), trad. D. Demorcy et I. Stengers, Paris, La Découverte, 2013.
44 Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, op. cit., p. 29.
45 L’historienne de l’écriture Anne-Marie Christin insiste sur l’importance de la surface d’inscription et de son interaction avec la figure pour l’émergence de l’écriture, notamment dans Poétique du blanc : vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, Paris, Vrin, 2000.
46 Pierre Gascar, Le Présage, op. cit., p. 71.
47 Ibid., p. 149.
48 Cité par Tiphaine Samoyault, L’Intertextualité, op. cit., p. 13.
49 Juliette Asta, « Les lichens, de surprenants organismes pionniers », art. cité.
50 Rainer Maria Rilke, Vergers (1926), Gouville-sur-Mer, Le Bruit du temps, 2019, p. 55.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2009.html.
Quelques mots à propos de : Bronwyn Louw
EHESS / CRAL
Lauréate du prix « Jeune chercheur » 2024 de la fondation des Treilles, Bronwyn Louw prépare une thèse à l’EHESS et enseigne à l’ENS. La proposition de penser une « écriture lichen » en termes de « sympoétique » s’est esquissée dans son article « Entre Lichens et poètes. L’émergence d’une sympoétique » (Mosaïque, no 20, février 2024), et fera l’objet du chapitre « The Sympoetics of Writing with Lichens » dans le livre Recent Approaches to Environmental Humanities (Bristol University Press, 2025).
