Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
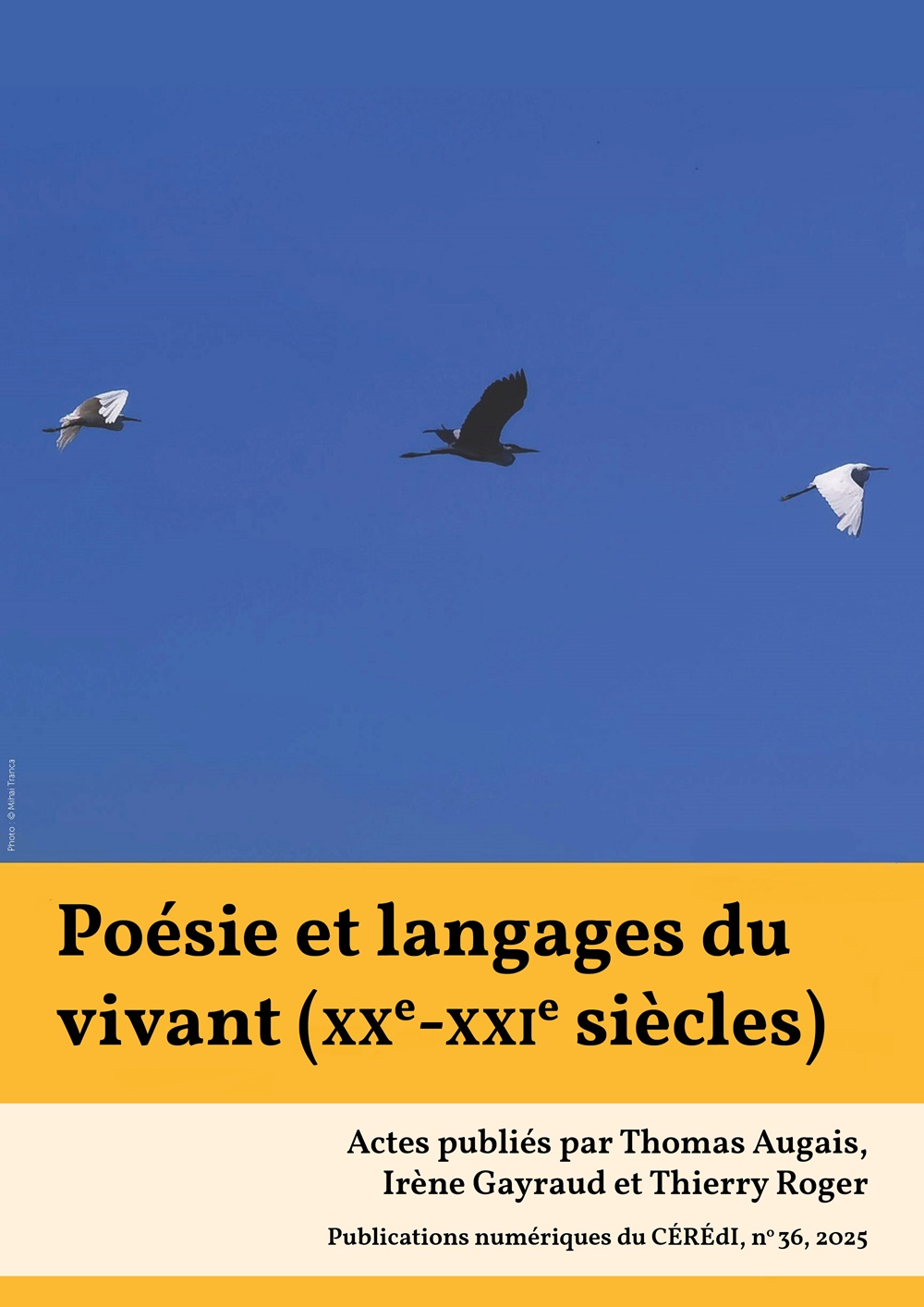
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
Patrick Suter
I
1La poésie et les vivants, il nous faut le reconnaître avec clairvoyance autant qu’avec crainte, suivent des voies contradictoires. Affirmation étrange peut-être, tant la poésie, par ses élans ou ses arabesques, par son mariage avec la voix, la danse et le chant, épouse les mouvements mêmes de la vie. Du joi que chantaient les troubadours à cet émerveillement qui caractérise tant de poèmes jusqu’à nos jours – fût-ce dans la conscience intime de la précarité de l’existence et de la parole poétique –, la poésie s’élève comme parole de vivants. Rappelons-nous la troisième note des Feuillets d’Hypnos :
Conduire le réel jusqu’à l’action comme une fleur glissée à la bouche acide des petits enfants. Connaissance ineffable du diamant désespéré (la vie)1.
2Que les poètes soient du côté de la vie, en témoigne leur extrême attention aux arbres, aux fleurs ou aux oiseaux. Au seuil de son premier recueil, Os de seiche (Ossi di seppia), dans un poème célèbre, Eugenio Montale se rit des « poètes couverts de lauriers » qui « se meuvent seulement parmi les plantes / aux noms peu usités : buis, troènes ou acanthes » – et il leur préfère les citrons2. Mais si les noms de buis, de troènes ou d’acanthes (« bossi ligustri o acanti ») sont ici récusés pour leur rareté, ce sont pourtant ceux de plantes communes – celles que nous rencontrons lors de nos promenades, dans les haies, le long des fossés herbeux (« erbosi / fossi »), et parfois non loin des roseaux (« canne ») que Montale dit aimer dans le même poème. Et si les poètes nomment les plantes qu’ignorent de si nombreux passants inattentifs, ce n’est pas, le plus souvent, par amour du haut langage, mais par une admiration face aux diverses espèces du vivant qui les incite à découvrir leurs noms. Ainsi chez Pierre Voélin :
Et sachons-le : aucun défilé de mode ne vaudra le défilé des petites fleurs des bois et des champs que voici […] : les pervenches, les violettes, les lupins, le mélilot […], la sublime ancolie dont les cinq pétales sont des oiseaux qui boivent à la fontaine […], et même la potagère campanule raiponce3 […].
3L’ancolie n’est pas nommée pour son nom qui rime avec mélancolie, mais pour la disposition très particulière de ses chétifs pétales. Quant aux « oiseaux qui boivent à la fontaine », ils n’apparaissent à la conscience soudain ravie que lorsque la fleur est suffisamment recourbée sous son poids – et qu’un vivant perçoit la rime inattendue qui la relie aux colombes, aux canards blancs, aux grues ou aux aigrettes.

Pierre Voélin : « la sublime ancolie dont les cinq pétales sont des oiseaux qui boivent à la fontaine ».
© zoom-nature.fr
4Toute la diversité du vivant peut mener à une telle admiration. Dès lors, le sentiment du sublime ne se confond pas avec celui d’une élévation éthérée, mais coïncide avec la reconnaissance du rayonnement des éléments les plus simples. Et ce transport ouvre la porte à un agrandissement de la vie, puisque, comme l’écrit Marie-Hélène Boblet, « quand elle s’actualise », l’« aptitude à s’émerveiller […] manifeste un élargissement de l’être, l’accès à plus de plénitude, un accroissement de la puissance par la probation de la confiance4 ». Alors, ajoute-t-elle, commence « une ère nouvelle, inédite, ouverte par l’expérience de l’inconnu, de l’inexplicable, de l’imprévisible5 ».
5Vue par les poètes, toute fleur – au nom rare ou commun, c’est selon – peut ainsi entraîner une extension de la sensation ou de la compréhension de la vie. À l’inverse, toutes les plantes peuvent aussi apparaître reléguées dans les limbes d’une poésie vaporeuse, jusqu’à ces citrons dont Montale aimait l’odeur, mais qui, dans la célèbre Chanson de Mignon de Goethe, ont souvent été perçus comme les symboles mêmes du rêve exotique et poétique – peut-être parce qu’ils mûrissent dans un pays lointain et accompagnent d’irréelles « oranges d’or » :
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn […]
Sais-tu le pays où fleurissent les citrons,
Où dans le sombre feuillage rougeoient les oranges d’or6 ? […]
II
6Si les poètes célèbrent la vie et s’engagent du côté du vivant – la parole poétique apparaissant elle-même comme le frémissement sensible de la vie dans le langage –, les poèmes n’en sont pas moins intégrés dans une écologie qui n’est pas celle de la vie. Nul autre peut-être ne l’a affirmé avec autant de lucidité que Mallarmé, dans sa fameuse formule de Crise de vers :
Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets7.
7Même s’il se lève et semble vivant, même s’il est musical et suave, même s’il est énoncé par une voix qui jubile, le mot « fleur » n’est pas la fleur. Pas plus – ou moins encore – que le reflet d’un objet dans le miroir, dont Emanuele Coccia indique dans La Vie sensible qu’il est le « mode d’existence d’une forme dans une matière qui lui est étrangère8 ». Loin de la tige qui la porte ou de la main qui la cueille, la [flœR], comme suite de phonèmes, n’est que vibration de l’air entraînée par la voix ; et lorsqu’il est écrit, le mot fleur n’est qu’une trace d’encre sur le papier.
8Les fleurs des arbres ou des champs participent aux cycles bio-géo-chimiques du système-Terre. Respirant elles-mêmes nuit et jour, elles sont associées, comme les plantes qui les portent, à la respiration générale de la vie sur terre, les parties vertes libérant de l’oxygène lors de la photosynthèse et relâchant un peu de dioxyde de carbone durant la nuit et leur décomposition. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans la perpétuation de la biosphère – soit de cette mince couche haute d’à peine quelques dizaines de mètres qui entoure l’écorce terrestre, dont Vladimir Vernadsky a été le premier à décrire le fonctionnement –, et elles se joignent à l’ensemble de la « matière vivante », qui exerce une « influence énorme […] sur l’histoire de l’atmosphère9 ».
9De son côté, le mot « fleur », dit par le poète ou n’importe quel énonciateur, n’est qu’une vibration passagère de l’air, dont on peut rappeler – non sans cruauté – qu’elle est produite lors d’une expiration animale, c’est-à-dire lors d’une émission d’air chargé en dioxyde de carbone. Et l’on rajoutera que les poètes ne se satisfont pas de ce destin éphémère, seuls les recueils publiés les légitimant comme poètes – ou une trace numérique pour les poètes performeurs contemporains.
10Or, qu’il soit calligraphié avec des substances naturelles (comme l’encre traditionnelle chinoise élaborée à partir de suie et de gélatine animale), ou qu’il soit imprimé avec des encres industrielles (contenant des pigments, des solvants et d’autres substances chimiques inconnues dans la nature), le poème écrit et imprimé échappe aux cycles de la vie. Son destin est de rejoindre les bibliothèques, dont sont exclus les vivants non-humains. L’une des recettes de l’encre traditionnelle chinoise inclut le camphre de Bornéo, dont les propriétés insectifuges protègent les manuscrits ; et les bibliothèques ayant mission de conservation sont tempérées dans une atmosphère dans laquelle les moisissures et les nuisibles ne peuvent prospérer. Les seuls rats de bibliothèques tolérés sont humains, alors que les vers et les papivores sont fermement combattus – la moindre découverte de l’un d’entre eux déclenchant d’immédiates mesures d’éradication.
11Les fleurs vivent au milieu des insectes et des grillons, et les criquets bondissent de l’une à l’autre ; mais les poèmes qui les évoquent se retrouvent dans des atmosphères aseptisées qui n’accueillent ni cigales ni fourmis.
III
12Ainsi la poésie évoque-t-elle le vivant, mais à partir d’une écologie de signes dont la vie est absente10. Blanchot a jadis commenté dans des termes proches cette mutation, en magnifiant le pouvoir de la littérature et en lui reconnaissance le droit à la mort – c’est-à-dire le droit à cette transformation des mots qui anéantissent les choses en les nommant :
Le sens de la parole exige donc, comme préface à toute parole, une sorte d’immense hécatombe, un déluge préalable, plongeant dans une mer complète toute la création. Dieu avait créé les êtres, mais l’homme dut les anéantir. C’est alors qu’ils prirent un sens pour lui, et il les créa à son tour à partir de cette mort11 […].
13Mais ce droit à la mort qui justifie la littérature, n’est-ce pas aujourd’hui une imposture, une de plus dans l’attirail des juridictions qui, depuis plusieurs siècles, ont permis – ou n’ont pas empêché – les écocides et l’extinction du vivant à l’échelle planétaire ? Et si Blanchot a raison, si la littérature procède effectivement d’une mise à mort, ne faut-il pas alors questionner ce « droit » qui serait le sien, et le mettre en doute ?
14En tout état de cause, lorsqu’un poète, interrogé sur l’attention qu’il porte à la nature et aux crises environnementales, répond en disant que ses poèmes sont emplis de fleurs et d’oiseaux, nous nous devons de ne pas le croire. Car si les poètes peuvent savoir, comme Deguy, que la poésie n’est pas seule12, ce n’est pas en le disant qu’ils brisent cette solitude. Durant le moment romantique, qui coïncide avec le premier essor de la révolution industrielle, la poésie s’est tournée vers la nature ; mais, alors que le locuteur du Prélude de Wordsworth s’échappe de la « grande cité » où il a longtemps été un « séjourneur mécontent » (« a discontended sojourner »), et qu’il goûte à la joie de respirer en marchant à l’air libre13, ni sa promenade, ni de surcroît la transformation de cette promenade en livre, n’empêchent les cheminées des usines de répandre leurs fumées. Retourner à la nature ne va pas de soi.
15La poésie n’est du reste pas la seule à être confrontée à cette contradiction, et, parmi d’autres disciplines, l’écocritique se trouve évidemment dans le même dilemme. Car si, comme le rappelle Gabriel Vignola, elle a dès ses débuts regretté la séparation de la littérature et du monde telle que la posaient le structuralisme et le postmodernisme à partir de la sémiotique saussurienne, et si elle a proposé un retour d’une pensée de la mimesis, on ne saurait dire qu’elle a été en mesure de réconcilier la vie de l’esprit et celle du monde14. Pas plus que nous ne le pouvons avec les communications que nous proposons durant nos journées d’étude, qui nécessitent la consommation d’infrastructures numériques et de transport dont le bilan écologique n’est évidemment ni positif ni neutre.
16Un tel constat est désagréable, je le confesse, mais nous conviendrons que l’écocritique ou l’écopoétique ne trouveront leur légitimité que si, à partir des événements organisés autour de ces thématiques, des solutions sont à l’avenir trouvées pour remédier réellement aux crises écologiques.
IV
17Pour l’instant, nous sommes loin d’être sortis de la situation qui nous préoccupe, qui touche l’ensemble de la culture contemporaine issue de l’époque moderne. Descartes, on le sait, avait distingué dans les Méditations métaphysiques entre chose étendue (res extensa) et chose pensante (res cogitans), soulignant par là même le pouvoir de l’homme, seul capable de penser la chose étendue en tant que chose pensante – ce système impliquant une distinction comme absolue entre corps et âme et entre nature et culture.
18Mais si l’on mesure aujourd’hui les dangers qu’a entraînés ce système de pensée dualiste, et l’extraordinaire orgueil sur lequel il repose en distinguant les humains des autres vivants, il ne suffit pas, pour réduire cette fracture, de proclamer la « fin de l’exception humaine » (Schaeffer15), ou de montrer que, comme les êtres humains, les forêts pensent (Kohn16), ou de reconnaître avec les éthologues que l’espèce humaine n’est pas la seule à connaître des formes de culture (dans la mesure où nous savons désormais que des groupes séparés de certaines espèces animales élèvent leur progéniture de façon différente et leur enseignent d’autres coutumes, ou que les individus de certaines espèces animales savent s’appeler par des noms qu’ils se donnent). De nombreux ouvrages de première importance témoignent de la nécessité de penser par-delà nature et culture (Descola17) et de mettre fin au grand partage qu’a engendré leur opposition (Charbonnier18), mais une frontière si massive n’est pas simple à démanteler. Que le partage de la nature et de la culture apparaisse désormais honteux aux naturalistes repentis – le naturalisme étant ici compris dans le sens de Descola –, il n’en est pas moins effectif, séparant d’un côté l’écologie de la vie, de l’autre, celle des signes.
19Et l’on saisit toute la perspicacité des situationnistes lorsqu’ils réclamaient, très en avance sur leur temps, que la poésie ne soit plus réalisée dans des livres, mais dans des situations. Car, pressentant déjà toute l’ampleur des crises écologiques, ils comprenaient pleinement qu’elles découlaient de cette séparation – l’un des mots-clés du situationnisme –, et revendiquaient par conséquent que « l’art » ne soit plus « séparé de la vie19 ».
V
20En attendant cette intégration de l’art dans la vie – que réclamait déjà le mouvement Dada20, mais dont la mise en œuvre n’a de toute évidence rien d’évident –, sans doute faut-il reconnaître que, même séparée, même publiée dans des livres et non agissante directement dans la vie, la poésie est, parmi les domaines de la culture, l’un de ceux qui manifestent le plus son indissociabilité par rapport au vivant. Au cours de son histoire, elle a maintes fois témoigné de sa connaissance du cycle de la vie, marqué par la finitude ou l’impermanence – comme l’attestent les méditations des poètes baroques sur la mort, ou, dans la deuxième partie du xxe siècle, le titre d’une célèbre revue autour de laquelle se sont regroupés plusieurs des poètes les plus importants de l’époque : L’Éphémère (1967-1972)21. Et peut-être est-ce en étant justement attentifs à la poésie dans sa dimension la plus large (puisque, selon Mallarmé, « vers il y a sitôt que s’accentue la diction, rythme dès que style22 »), que nous pourrons découvrir des modèles inédits, aptes à nous suggérer comment transformer la culture – de manière à ce que la culture tisse avec la nature des liens de réciprocité et de complémentarité, loin de cette attitude de possession et d’exploitation qui la caractérise depuis l’émergence de la modernité.
21Tout à la fin de L’Acacia de Claude Simon (un roman que la qualité d’écriture et la fréquence des figures d’analogie rapprochent justement du vers selon Mallarmé), le livre suggère la naissance d’un écrivain – par-delà sa quasi-mort dans le désastre de la guerre à laquelle il vient de réchapper :
Un soir il s’assit à sa table devant une feuille de papier blanc. C’était le printemps maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. L’une des branches du grand acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur, et il pouvait voir les plus proches rameaux éclairés par la lampe, avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres, les folioles ovales teintées d’un vert cru par la lumière électrique remuant par moments comme des aigrettes, comme animées soudain d’un mouvement propre, comme si l’arbre tout entier se réveillait, s’ébrouait, se secouait, après quoi tout s’apaisait et elles reprenaient leur immobilité23.
22Cet excipit suggère une continuité entre l’acacia et l’écrivain en train de naître, les feuilles en forme de plume soulevées par le vent, comme « animées soudain d’un mouvement propres », communiquant cette vie à l’écriture, dont la longue phrase aux parenthèses successives se déploie en arborescence avant de retomber dans l’immobilité. Par rapport à la morphologie de l’arbre, les folioles, traversées par une nervure centrale et disposées de part et d’autre du pétiole des feuilles pennées de l’acacia, manifestent l’importance de la symétrie et des réitérations structurelles entre les éléments de dimensions égales ou dissemblables. Décrites dans L’Acacia, de telles formes attirent à leur tour l’attention sur les symétries et les reprises dans l’œuvre, depuis le niveau du mot (acacia réitérant trois fois la même voyelle), jusqu’à ceux du livre et de l’œuvre (qui correspondraient à l’arbre ou à une forêt), en passant par la phrase (qui équivaudrait à une feuille). En même temps, le vent, qui agite les branches et les feuilles, laisse deviner de constants déplacements, de constants surgissements de dissymétries en agitant les feuilles et les branches dans tous les sens. Ainsi l’écriture serait-elle faite d’échos et de reprises (du côté des homologies et des symétries), en même temps que de constantes modifications ou variations (du côté des dissemblances et des dissymétries). Et l’excipit de L’Acacia en apporte la démonstration, dans la mesure où il constitue la réécriture symétrique – bien qu’avec des variantes – de l’incipit d’Histoire, l’autre roman de Claude Simon composé en douze chapitres, qui, publié vingt-deux ans plus tôt, s’ouvrait sur l’image de l’acacia :
l’une d’elles touchait presque la maison et l’été quand je travaillais tard dans la nuit assis devant la fenêtre ouverte je pouvais la voir ou du moins ses derniers rameaux éclairés par la lampe avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres, les folioles ovales teintées d’un vert cru irréel par la lumière électrique remuant par moments comme des aigrettes animées soudain d’un mouvement propre […], comme si l’arbre tout entier se réveillait, s’ébrouait et se secouait, puis tout s’apaisait et elles reprenaient leur immobilité24 […].
VI
23La résonance qui s’instaure entre ces deux phrases, avec leurs répétitions et leurs différences, instaure un jeu de rimes très lointaines dans l’œuvre simonienne. Et elle n’est pas sans évoquer Flaubert, pour qui il fallait que « les phrases s’agitent dans un livre comme les feuilles dans une forêt, toutes dissemblables en leur ressemblance25 ».
24Ce précepte se comprend si l’on se souvient du désir de Flaubert d’égaler la prose à la poésie, de « donner à la prose le rythme du vers », mais « en la laissant prose et très prose26 ». Car, comme il l’écrivait déjà à Louise Colet une année plus tôt, si le « vers est la forme par excellence des littératures anciennes », et si « toutes les combinaisons prosodiques ont été faites », il s’en fallait de beaucoup pour « celles de la prose27 ».
25La prose peut ainsi être animée comme un arbre ou comme une forêt, et suggérer, sans les montrer en clair, les principes qui relient l’œuvre littéraire au monde du vivant, et à la végétation en particulier. Chaque phrase est comme une feuille, mais l’ensemble des phrases forme le livre. Le livre se développe à partir d’un mot ou de la phrase, par expansion successive, comme toutes les plantes dont la croissance est fractale ou s’effectue en spirale28 – et cette organisation fractale est mise en évidence par les mises en abyme, qui soulignent les homologies entre les détails et la totalité de l’œuvre. Au niveau de la phrase comme du livre dans son ensemble, des échos constants entre les éléments se font entendre, tels que la reprise des participes présents dans la phrase de Claude Simon, ou que l’organisation inversée des chapitres d’un livre à l’autre de son œuvre (comme nous venons de le voir dans Histoire et L’Acacia). Entre ces niveaux, toute l’arborescence de la phrase se déploie. Et il est frappant que les plus grands prosateurs français, de Chateaubriand à Simon, en passant par Flaubert et Proust, aient tous reconnu comme modèles ou comme emblèmes l’arbre ou la forêt29.
26Pour ces prosateurs, c’est par cette homologie qui les lie au vivant que leurs œuvres égalent celles des poètes. La poésie traditionnelle suggérait par les rimes l’unité dans la diversité, et elle les mettait en évidence en fin de vers. Dans les œuvres en prose que nous venons de rencontrer, dont la présentation typographique est continue et ne varie qu’avec la longueur des paragraphes, l’élaboration de chaque phrase la rend singulière ; mais, réunies, elles n’en forment pas moins une forêt, qui est l’œuvre.
VII
27De la prose simonienne ou flaubertienne, dont nous venons de voir comment elles atteignaient à la poésie en s’approchant de l’écologie des forêts (ou du moins d’un modèle arborescent), nous pouvons retenir une leçon.
28Ce que mettent en évidence ces œuvres, c’est que des fragments de culture – des œuvres littéraires – peuvent se développer sur le modèle du vivant. Et ce qu’elles montrent par la même occasion, c’est que la culture peut ne pas être élaborée dans l’ignorance des échos et des symétries à l’œuvre dans l’écologie générale, mais au contraire dans la conscience qu’elle est au fond membre de la nature, dont elle a quelque chose à apprendre.
29Souvenons-nous maintenant de la haine de Flaubert contre la bourgeoisie, dont le langage ne cesse de véhiculer des idées reçues, et songeons que les idées reçues sont, dans l’environnement du langage, les équivalents des produits préfabriqués, dont la société bourgeoise qui domine l’appareil capitaliste favorise alors l’essor. Or, par rapport à ce langage automatique qui se diffuse partout dans l’environnement, on peut dire que la syntaxe de Flaubert est par excellence éco-critique, puisqu’elle entend explorer les combinaisons infinies de la prose et ne pas s’en tenir à une syntaxe en quelque sorte préfabriquée. Il s’agit ici de développer une attitude critique par rapport au langage environnant.
30Dans ce sens, Flaubert nous donne à comprendre que c’est le sens des relations qui doit présider à l’élaboration de la culture, et non celui de la production manufacturée ; et sa remise en cause de l’environnement langagier s’effectue autant par la syntaxe que par son travail sur les idées reçues. Lorsque nous baignons dans les idées reçues, nous sommes spirituellement du côté de la mort. Par opposition, le travail de la syntaxe engendre des phrases toujours nouvelles et ne cesse de ranimer le langage, comme les diverses feuilles des forêts ou les diverses folioles de l’acacia.
VIII
31Nous pouvons par ailleurs retenir une autre leçon, celle de Jaccottet quand lui aussi se confronte aux arbres – de La Promenade sous les arbres au cerisier du Cahier de verdure, en passant par les amandiers d’À travers un verger.
32Ce qui est frappant, en lisant Jaccottet, c’est à la fois son extraordinaire attention aux floraisons, qui repose à n’en pas douter sur un émerveillement ; mais un émerveillement tout de retenue, à la recherche toujours d’une relation avec le monde du vivant impliquant que ce dernier ne soit pas subsumé par la parole humaine.
33Ainsi, des amandiers, dont il reconnaît que la « floraison semblait plus confuse, plus insaisissable », et que le langage bute sans cesse devant leur altérité :
Essaim, écume, neige : les vieilles images reviennent, elles sont pour le moment les moins disparates. Rien de mieux.
[…] il me fallait, comme toujours, écarter ces rapprochements avec le monde humain qui faussent la vue […]
Peut-être était-ce tout de même assez pareil à de la neige, à un nuage de neige en suspens, arrêté un instant dans sa chute, au-dessus du sol — à cause de ce blanc pas éclatant et encore un peu froid, frileux, et de la multiplicité des fleurs. Un murmure de neige ? […]
(Il fut un temps où quelques mots simples auraient suffi à dire cela. Ces mots, nous en disposons encore, mais ils n’ont plus ce pouvoir. Les arbres gardent le leur30).
34Ce qui m’arrête dans ces fragments, c’est la prudence de la parole – une parole de prose – chez un poète qui, dans les principaux textes qu’il a consacrés aux arbres, a renoncé au vers, à l’éclat du vers, pour mieux nouer une relation avec le vivant. Les repentirs de Jaccottet, qui peuvent parfois sembler excessifs, indiquent une crainte presque sacrée, une attention extrême pour ne pas briser la fragilité ou la précarité de la vie que nous rencontrons parfois, et dont nous pressentons la fécondité. Il s’agit de ne rien briser par la parole, de ne pas posséder la nature ni de la maîtriser, mais au contraire de choisir la sobriété, en acceptant des pertes, pour que rien ne soit perdu du fragile vivant :
Même sédentaires, même casaniers, nous ne sommes jamais que des nomades. Le monde ne nous est que prêté. Il faudrait apprendre à perdre ; et l’image du verger, à peine la retenir31.
IX
35Bien sûr, malgré son attention au vivant, la poésie n’en appartient pas moins à l’écologie des signes, comme les arts et les sciences en général, comme l’économie et le droit – et comme l’écologie scientifique32, malgré ses précieuses publications. En tant que telle, elle est, comme l’écrivait Mallarmé, une action restreinte33. Et cependant, la poésie peut être décrite comme un système d’échos, et, dans le monde des signes, elle nous aide à percevoir, en les imitant ou en les modélisant, les interconnexions à l’œuvre dans le monde du vivant comme dans l’écriture. Il arrive par ailleurs qu’elle devienne un lieu où se développe une attitude humble face à lui, dans le respect de l’humus né de la biosphère, pour qu’il puisse à son tour perpétuer la vie34. Et, en ce sens, la poésie peut enseigner une certaine « esthétique » de l’écologie, si bien que, par contraste, nous pouvons peut-être mieux comprendre tout ce qui manque à la culture contemporaine pour être durable.
36Ce qui est frappant, dans la poésie, c’est qu’elle ne considère pas le langage comme une suite d’éléments concaténés, ajoutés les uns aux autres, mais que, dans le poème, tous les éléments résonnent les uns avec les autres. Un jeu de mots le donne à percevoir, puisque, sur le plan sonore, le poème peut être décrit comme un écho-système (un système d’échos), qui fait lui-même écho aux écosystèmes. À partir de là, nous percevons combien le sens de la poésie est celui des relations.
37Dans ce sens, la poésie joue un rôle important pour résoudre le problème des ontologies analogistes (au sens de Descola), pour lesquelles tous les éléments du monde sont épars et doivent être réunis. Pour réduire le désordre du monde, elle multiplie les analogies, qui, dans le poème, portent aussi bien sur les ressemblances phoniques (que mettent en évidence les rimes et les paronomases), sur les parallélismes syntaxiques, et sur les rapprochements sémantiques par le biais de comparaisons ou d’images.
X
38Il n’en demeure pas moins que, dans le poème, nous restons ici dans l’écologie des signes ; et nous nous devons de nous rappeler la clairvoyance de Mallarmé, qui rappelait que l’acte de la poésie « toujours s’applique à du papier » – dont la fabrication, le plus souvent à partir de bois, implique malheureusement la chute de beaucoup de feuilles d’arbres35.
39Or, dans le prolongement des mises en garde des situationnistes, nous comprenons que c’est dans l’écologie générale qu’il s’agit d’établir l’œuvre à venir. Œuvre qui, comme le poème, ne pourra advenir que par la qualité des relations entre ses composantes, qui doivent développer entre elles des relations vertueuses – en rappelant ainsi le rôle des rimes, qui est, entre autres fonctions, de relier la diversité des mots.
40Pour ce faire, il s’agit d’accomplir une conversion, qui implique la modification de nombreux principes de l’économie, du droit et des techniques – soit des institutions de la culture moderne et contemporaine imprégnées de l’ontologie naturaliste qui ont mené à la catastrophe que connaît aujourd’hui le vivant. L’œuvre d’art à venir laissera place au vivant et permettra de sortir d’une civilisation de la mort – non qu’elle doive empêcher la mort des individus, inéluctable, mais celle des espèces.
41Cette œuvre d’art est par essence pluridisciplinaire, et, dans ce sens, elle est moins à venir qu’à parachever, puisque, dans différents domaines de la culture, des propositions de modifications sont déjà élaborées. Nous en voyons dans le domaine agricole, avec le développement des cultures biologiques et de la permaculture ; dans le domaine juridique, où sont envisagées des législations permettant la représentation d’écosystèmes36 ; dans le domaine économique, où sont élaborés des modèles de sociétés décroissantes à partir de certains seuils37 ; dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, avec de nouvelles expériences proposant des formes d’habitat communautaires ou des quartiers urbains qui accueillent des animaux de traite ou des ovins pour la tonte des pelouses38. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi beaucoup d’autres qui montrent que, dans l’ensemble des institutions qui forment la culture, quelques-unes avancent en direction du vivant.
42La culture peut être décrite comme un ensemble de règles partagées par une société. L’ensemble des règles à venir doit au fond constituer une poétique du vivant, en en permettant la formation infinie – comme les poétiques permettent l’écriture d’une infinité de poèmes, ou comme les règles de grammaires permettent la formation d’une infinité d’énoncés. Cette poétique du vivant implique un ensemble de règles à respecter et à mettre en œuvre, et qui sont sans doute des contraintes. Mais nous savons par l’expérience des poètes que les contraintes n’empêchent nullement une liberté beaucoup fondamentale, et qu’elles stimulent l’imagination autant que les autres facultés intellectuelles. Et nous savons aussi combien nous aurons besoin de ces facultés pour parachever, dans l’écologie générale et non dans celle des signes, cette nouvelle œuvre d’art, qui a nom société durable – la société n’étant pas limitée aux humains mais incluant désormais l’ensemble du vivant.
XI
43Cependant, si des éléments de l’œuvre écologique à venir émergent, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’en va pas de même dans tous les secteurs, dont beaucoup vont à l’encontre de cette tendance. Nous en sommes tous les jours témoins avec la progression des guerres qui entraînent des morts sans relâche, celle d’enfants, de femmes et d’hommes, et celle de la biodiversité – si bien qu’il a été proposé de renommer polémocène le nouvel âge géologique dans lequel nous sommes entrés avec l’âge industriel, que l’on appelle généralement anthropocène39.
44Tout à la fois – et ces phénomènes sont liés –, cet âge est également désigné comme le capitalocène40, ce qui n’est guère étonnant dans la mesure où le fonctionnement de son institution principale, le marché, repose sur la traduction de la totalité de la diversité du monde (tous les éléments matériels et immatériels, vivants et non vivants, qu’il est possible d’échanger) en une seule valeur, la monnaie (qu’il s’agit pour le capitaliste d’amasser sans limite). Or, le proverbe le dit, l’argent n’a pas d’odeur, ce qui signifie qu’il a perdu tout lien avec le vivant.
45La monnaie est ainsi l’institution par excellence qui indiffère le vivant et le non vivant, et qui en même temps les domine, puisque c’est de sa seule accumulation ou de sa dépense que dépendent la confiance des investisseurs ou au contraire les dépôts de bilan, les budgets soutenus ou les banqueroutes. C’est une institution qui crée la seule vraie valeur reconnue, mais les opérations qui la produisent ont lieu dans une écologie de signes qui n’est nullement tenue de nouer un lien avec le système-Terre et les opérations de la biosphère. Ainsi, le commerce des armes est une activité lucrative, et pour l’économie privée et pour les États, alors qu’elles ont un énorme impact négatif sur les sociétés humaines et sur la biosphère.
XII
46À la différence des œuvres poétiques dont il a ici été question, les institutions de la société contemporaine – dont l’économie est sans doute la plus importante –, créent une écologie de signes qui ne rime plus avec le vivant (par exemple parce qu’un indicateur comme le PIB compte pour des valeurs positives la consommation d’énergies fossiles qui a un impact négatif sur la biosphère), par opposition, même si les écocides ont une longue histoire41, certaines sociétés plus anciennes ou non-naturalistes avaient trouvé des formes d’organisation qui ne mettaient pas en danger leur environnement.
47Mais peut-être un espoir demeure-t-il. L’institution de la monnaie, avec sa force magique qui réduit l’ensemble de la diversité du monde au même, est peut-être, dans le cadre des institutions de la culture contemporaine, le talon d’Achille sur lequel il est possible d’agir. Car au fond, si tel géant de l’économie fanfaronne, en prétendant par exemple que le monde de 2050 consommera 100 millions de baril de pétrole par jour – et ceci contre les déclarations de la très conservatrice Agence internationale de l’énergie42 –, peut-être n’est-ce pas tant qu’il a envie de produire du pétrole dans trente ans, mais pour acquérir de la monnaie et pour garantir la place de son entreprise en bourse43. En définitive, l’industriel pétrolier n’a pas pour fin ultime de vendre du pétrole, mais d’accumuler de l’argent.
48Dans ces conditions, il doit être possible de créer un système économique nouveau qui a) privilégie la sobriété ; et qui b) oblige les acteurs économiques à acquérir aussi autre chose que la monnaie – c’est-à-dire un bilan écologique positif, en arrimant son évaluation aux objectifs de l’ONU en matière de durabilité. Ainsi, sous peine de faillite déclarée, la sphère majeure qu’est l’économie serait contrainte de nouer avec la biosphère des relations vertueuses, pour que l’écologie des signes rime avec l’écologie générale.
49Tel est le domaine sur lequel il me semble urgent de travailler désormais, la poésie étant appelée à sortir des tombeaux – des livres – pour retisser les liens du vivant, avec le même sens des relations qui a été le sien, mais au-delà de ce qu’elle a été, c’est-à-dire hors des livres et dans l’écologie générale44 et 45.
1 René Char, « Feuillets d’Hypnos. 1943-1944 », Fureur et mystère, dans Œuvres complètes, intr. de Jean Roudaut, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1983, p. 175.
2 Eugenio Montale, « I limoni », Ossi di seppia, dans Tutte le poesie, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1977, p. 17-18.
3 Pierre Voélin, « De l’émerveillement », Trans, transRedaktion, ETH Zürich, no 22, mars 2013, p. 75. Une partie des ouvrages de Pierre Voélin est disponible chez Fata Morgana.
4 Marie-Hélène Boblet, Terres promises. Émerveillement et récit au xxe siècle. Alain-Fournier, Breton, Dhôtel, Gracq, Germain, Paris, José Corti, « Les Essais », 2011, p. 242.
5 Ibid.
6 Johann Wolfgang Goethe, « Mignons Lied », dans Anthologie bilingue de la poésie allemande, éd. établie par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1993 & 1995, p. 402. Je traduis.
7 Stéphane Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, dans Œuvres complètes, éd. présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 2003, p. 204-213, p. 213.
8 Emmanuele Coccia, La Vie sensible, trad. de l’italien par Martin Rueff, Paris, Payot, « Bibliothèque Rivages », 2010, p. 35.
9 Vladimir Vernadsky, La Biosphère, préf. de Jean-Paul Deléage, Paris, Seuil, « Points », 2002, p. 201.
10 J’utilise cette notion dans un sens restreint qui n’inclut pas les relations sémiotiques à l’œuvre dans l’ensemble du monde vivant. La notion d’écologie des signes désigne ici les relations que les signes ont entre eux, mais aussi avec leur environnement (support, matériaux, etc.). Les signes considérés sont produits par des humains – ou des avatars comme les intelligences artificielles. Cette écologie des signes humains diffère ainsi d’une écosémiotique « au-delà de l’humain » telle qu’a pu la théoriser Eduardo Kohn dans How Forests think. Toward an Anthropology beyond the Human, University of California Press, 2013. Ainsi l’écologie des signes apparaît-elle fondamentalement différente de celle de l’ensemble du monde vivant. C’est déjà ainsi que j’employais ce terme dans Le Journal et les Lettres 2. La presse dans l’œuvre (Vers une écologie littéraire), Genève, MētisPresses, 2010. Je remercie Claude Raffestin, géographe et ancien directeur du Centre universitaire d’écologie humaine de l’Université de Genève, pour les éclairages qu’il m’a accordés à ce propos.
11 Maurice Blanchot, « La littérature et le droit à la mort », dans La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 312-313.
12 Michel Deguy, La Poésie n’est pas seule. Court traité de poétique, Paris, Seuil, « Fiction & cie », 1988.
13 William Wordsworth, The Prelude, London, Edward Moxon, 1850, p. 2.
14 Gabriel Vignola, « Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en littérature », Cygne noir, no 5, 2017, p. 11-36, https://doi.org/10.7202/1089937ar.
15 Jean-Marie Schaeffer, La Fin de l’exception humaine, Paris, Gallimard, « NRF essais », 2007.
16 Eduardo Kohn, op. cit.
17 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 2005.
18 Pierre Charbonnier, La Fin d’un grand partage, Paris, CNRS Éditions, 2022 (2015).
19 « Le sens du dépérissement de l’art », Internationale situationniste, no 3, 1959, p. 3. Dans la même perspective, Guy Debord oppose dans La Société du spectacle le spectacle qui est séparé de la vie (« La critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie »), insistant sur le fait que la « séparation » est l’« alpha et l’oméga du spectacle » (voir Œuvres, Paris, Gallimard, « Quarto », p. 768 et 772). On peut certes se demander si la vie telle qu’elle est ici évoquée par Debord est comprise comme celle du vivant en général, ou plutôt comme celle des sociétés humaines. En fait, à une époque où la pensée écologique est en formation, il apparaît que les situationnistes sont passés d’une pensée relevant de l’écologie urbaine à celle d’une écologie générale. Ainsi, alors que les considérations sur l’urbanisme sont très importantes dans les premiers numéros de L’Internationale situationniste, c’est dans La Planète malade que Debord abordera une réflexion sur l’écologie générale – un texte rédigé en 1972 pour le treizième numéro de L’Internationale situationniste (qui n’a pas paru), et qui n’a été publié en volume que de façon posthume (Gallimard, 2004).
20 Auquel se réfèrent les situationnistes : « Dada […] a définitivement posé le problème de la réalisation de l’art. […] la réalisation de l’art, la poésie (au sens situationniste) signifie qu’on ne peut se réaliser dans une “œuvre”, mais au contraire se réaliser tout court » (Internationale situationniste, no 10, mars 1966, p. 51).
21 Dont le comité de rédaction a compté entre autres Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Paul Celan, Jacques Dupin et Louis-René des Forêts
22 Stéphane Mallarmé, art. cité, p. 205.
23 Claude Simon, L’Acacia, ch. XII, dans Œuvres, éd. établie par Alastair B. Duncan, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 2013, p. 1249.
24 Claude Simon, Histoire, dans Œuvres, éd. citée, p. 147. Les éléments semblables entre l’excipit de L’Acacia et l’incipit d’Histoire sont notés en italiques, les variations apparaissant en gras.
25 Gustave Flaubert, lettre à Louise Colet, 7 avril 1854, Correspondance, éd. établie par Jean Bruneau, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, t. II, p. 545.
26 Lettre à Louise Colet, 27 mars 1853, ibid., p. 287.
27 Lettre à Louise Colet, 24 avril 1852, ibid., p. 79.
28 Comme le romanesco ou la feuille de fougère, qui réitèrent les mêmes motifs à différentes échelles, disposés en spirale dans le premier cas, formant une spirale avant de se déployer dans le deuxième cas.
29 Voir chez Chateaubriand l’importance des bois de Combourg ou des forêts américaines dans René ou les Mémoires d’Outre-Tombe, certains passages qui leur sont consacrés pouvant être lus comme des poèmes en prose et entraînant par conséquent la prose au niveau de la poésie, avec les particularités du style de Chateaubriand telles qu’a pu les décrire Jean Mourot (Châteaubriand. Rythme et sonorité dans « Les Mémoires d’Outre-Tombe », Paris, Armand Colin, 1969). Chez Proust, l’énigme insoluble que posent au narrateur les arbres d’Hudimesnil dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs trouve en quelque sorte sa réponse dans les ramifications de la longue phrase proustienne (qui permettent de l’explorer), et dans le fait que, lors du fameux épisode des pavés dans Le Temps retrouvé, ils réapparaissent à côté d’autres grands lieux de la mémoire proustienne, dans une phrase synthétique : « […] au moment où, me remettant d’aplomb, je posai mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement s’évanouit devant la même félicité qu’à diverses époques de ma vie m’avaient donnée la vue d’arbres que j’avais cru reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec, la vue des clochers de Martinville, la saveur d’une madeleine trempée dans une infusion, tant d’autres sensations dont j’ai parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m’avaient paru synthétiser. » Tout se passe comme si l’arbre de la mémoire reliait les différents côtés qui, tout au long de la Recherche, apparaissaient au narrateur d’abord de façon discontinue et fragmentée. Voir Marcel Proust, « Noms de pays : le pays », À l’ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième partie, Paris, GF, éd. du texte, intr., notes, bibliogr par Daniuèle Gasiglia-Laster, 1987, p. 91-94 ; « Matinée chez la princesse de Guermantes », Le Temps retrouvé, Paris, éd. du texte, intr., bibliogr. par Bernard Brun, Paris, GF, 1986, p. 256.
30 Philippe Jaccottet, À travers un verger, dans Œuvres, préface de Fabio Pusterla, éd. établie par José-Flore Tappy, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2014, p. 554-555.
31 Ibid., p. 566.
32 Dans La Planète malade, Guy Debord considère que les moyens qui permettent de calculer où mène la croissance (ceux donc de l’écologie scientifique ou des sciences du Système-Terre) relèvent du même « développement technique et scientifique séparé » que les « moyens techniques » qui ont la possibilité « d’altérer absolument les conditions de vie sur toute la Terre ». Voir. Œuvres, éd. citée, p. 1063.
33 Stéphane Mallarmé, « L’action restreinte », op. cit., p. 214-218.
34 On sait qu’« humus » et « humble » sont liés étymologiquement, comme le rappelle le Dictionnaire étymologique de Bloch-Wartburg.
35 Karl Kraus a plusieurs fois évoqué l’hécatombe d’arbres que nécessite chaque édition d’un grand journal. Voir Karl Kraus, Untergang der Welt durch schwarze Magie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988, p. 11 et 342. La première version de ce texte a paru dans Die Fackel, nos 363-365, 12 décembre 1912.
36 Voir Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, Ethnographies des mondes à venir, Paris, Seuil, « Anthropocène », 2022, p. 89 passim.
37 Voir Kate Raworth, La Théorie du donut : l’économie de demain en 7 principes, Paris, Plon, 2018.
38 Voir « Aux Vergers, les circuits courts artisanaux ont besoin du soutien des mangeurs », article consacré aux Vergers de Meyrin, nouvel écoquartier dans l’agglomération genevoise (La Revue durable, no 66, été-automne 2021, p. 47-53).
39 Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, nouv. éd., Paris, Seuil, « Points/Histoire », 2016, p. 281-315.
40 Ibid., p. 247-279.
41 Voir Fournier-Kiss, Corinne (dir.), Littérature et écologie, ou comment écrire l’écocide de biotopes réels, Fribourg, Academic Press, « Cultures & écologies – Kulturen & Ökologien – Cultures & Ecologies », 2024.
42 « ExxonMobil prévoit une demande de pétrole quasiment inchangée en 2050 », Le Figaro, 27 août 2024.
43 Voir Laurent Horvath, « Le blues des compagnies pétrolières face au dilemme de Donald Trump », Le Temps, 29 janvier 2025.
44 Cette transformation de l’étendue de la poésie est évidemment pensée ici de manière radicale et programmatique, comme un horizon. Mais comme rien n’indique dans le climat géopolitique actuel que cet horizon puisse advenir, sans doute la poésie au sens habituel (réalisée dans des mots et publiée dans des livres) est-elle encore l’un des lieux qui peut rappeler sa nécessité.
45 J’ai esquissé ailleurs de façon plus précise ces propositions, l’idée étant de flanquer la monnaie d’un contre-pouvoir selon un système de double prix, l’un déterminé par le marché et relatif au travail nécessaire pour la production et la diffusion des produits, l’autre correspondant à l’impact (positif ou négatif) du produit échangé sur la biosphère, et qui serait donc un prix écologique, appelé « rime ». Voir Patrick Suter, « Antipoétique de l’écocide », dans Fournier Kiss (dir.), Littérature et écologie, ou comment écrire l’écocide de biotopes réels, op. cit., p. 111-127.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2008.html.
Quelques mots à propos de : Patrick Suter
Patrick Suter est Professeur de littératures de langue française contemporaines à l’Université de Berne et écrivain. Ses champs de recherche comprennent les relations entre presse et littérature, les avant-gardes, l’interculturalité et les frontières, ainsi que celle entre art, culture et écologie. Dans ce domaine, il a publié Le Journal et les Lettres. 2. La presse dans l’œuvre : vers une écologie littéraire ainsi que des articles portant sur Baudelaire, Mallarmé, Duchamp, les situationnistes ou Baudouin de Bodinat.
