Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
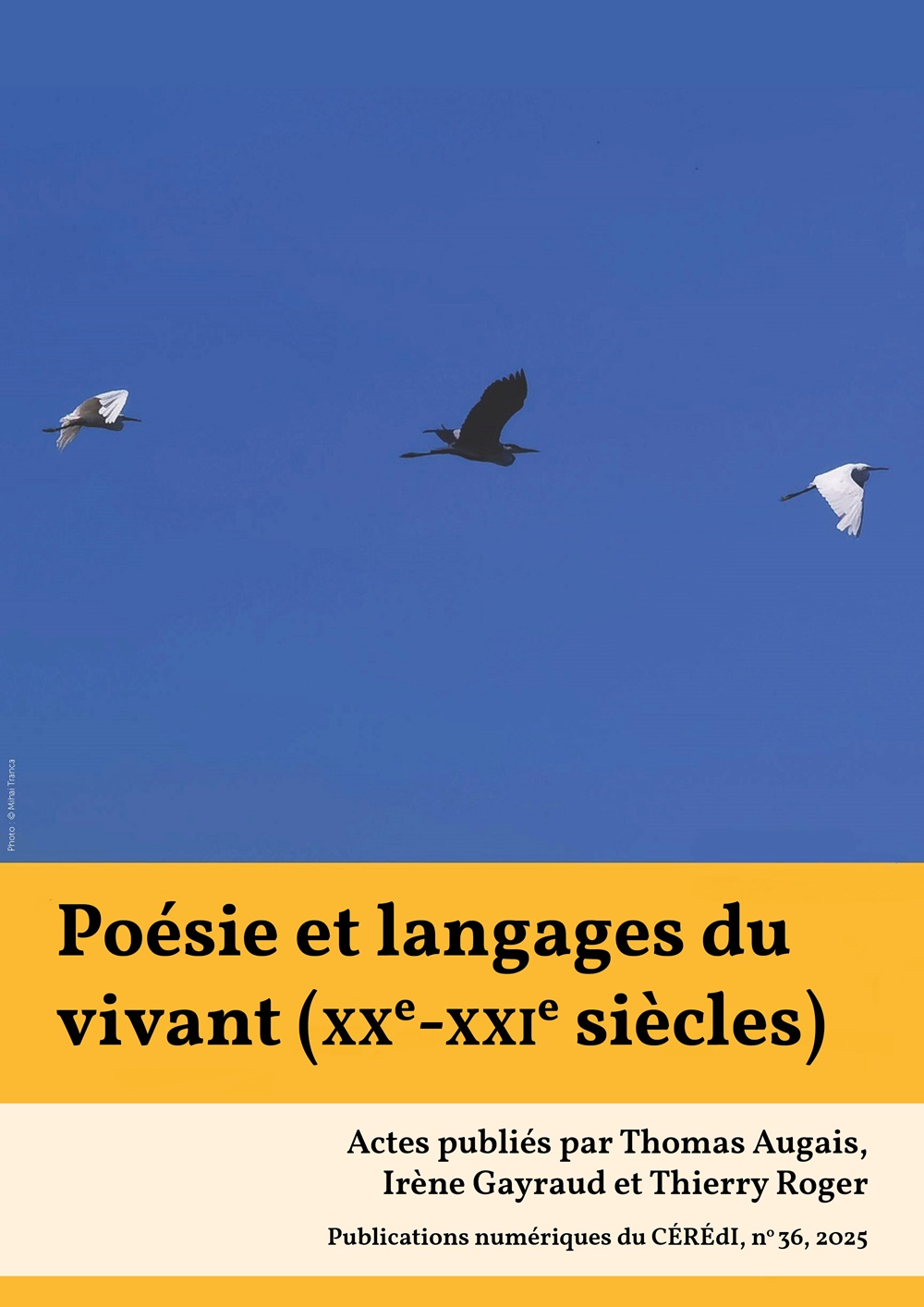
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
« Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy
Barbara Bourchenin
Introduction
1Jean Dupuy (1925-2021) n’est pas poète. Ou du moins, ne le classe-t-on pas initialement dans cette catégorie. Les historiens de l’art ont fait de lui un peintre, un performeur, un sculpteur. Pourtant, à la lumière de ses derniers travaux – les anagrammes qui l’occupent depuis 19731, et ce jusqu’à sa mort en 2021 –, il ne nous semble pas aberrant de faire de lui un poète, au regard de l’ampleur que cette pratique des anagrammes acquiert dans son parcours. L’édition de l’anthologie Where en 2013 par la galerie Lœvenbruck marque un moment important dans le paysage critique de l’œuvre de l’artiste en donnant accès à une part encore confidentielle de son œuvre.
2« Pierre angulaire de (son) œuvre2 », la pratique anagrammatique de Jean Dupuy consiste en des « textes qui accompagnent pour la plupart des photos, des objets. Écrits, i.e., en 2 parties, ils composent des anagrammes → l’exigence linguistique / que je pratique depuis 30 ans est une contrainte comme l’est, en poésie, la rime (voire l’alexandrin) […]3 ». Si Jean Dupuy n’est pas poète, l’exigeante gymnastique lettriste à laquelle il s’adonne quotidiennement fait de l’anagramme une poétique à part entière. Tant et si bien que si les anagrammes, dans un premier temps, accompagnent de manière descriptive des pièces, elles finissent par s’autonomiser et exister indépendamment de toute pièce annexe ; l’anecdote et la vie sont les seuls moteurs de leur création.
3Dans l’ouvrage Le Champ des signes, Roger Caillois dit qu’il lui est arrivé « de regarder les pierres comme des sortes de poèmes4 ». Il semble que c’est également ce qui motive l’intérêt de Jean Dupuy pour les galets niçois. Ces pierres, banales et faciles d’accès lors de promenades, touchent l’artiste dans leur simplicité. Aussi pourrait-on dire qu’elles ne laissent pas l’artiste de marbre, et qu’il n’a pas un cœur de pierre. Car les expressions sont nombreuses qui disent l’inexpressivité des pierres et leur insensibilité notoire.
4Avec Jean Dupuy et les galets niçois, il s’agit de penser avec, de rêver et poétiser avec ces cailloux, de prime abord insignifiants et froids. On pourrait dire qu’il s’agit d’être en empathie avec, de parler le langage des pierres, d’empathiser avec les cailloux comme on sympathise avec quelqu’un. Empathiser (selon le dictionnaire de la langue française en ligne), c’est « faire preuve d’empathie avec autrui », « être en capacité de comprendre (le vécu d’autrui) », synonymes : comprendre, saisir, ne pas être de bois. Cette analyse des poèmes de galets et des anagrammes d’Ypudu est l’occasion de se demander non seulement comment « penser Dupuy » (quelle(s) méthode(s) est(sont) à l’œuvre dans sa pratique), mais aussi comment pense la lettre, comment pense l’anagramme ou le poème, ou encore, comment pensent les pierres.
5Tant écologie de lecture qu’écologie de la langue, la pensée à l’œuvre dans les choses se trouve soumise à un processus d’anagrammatisation continu – ou continuum anagrammatique. Jean Dupuy est un traducteur et l’anagramme lui permet de penser sa pratique comme traduction perpétuelle de langage en langage, sans distinction des sémiotiques : le langage de pierre répond au langage de mot, tout comme celui-ci répondait au langage-sculpture, etc. Nous faisons l’hypothèse que ce processus d’anagrammatisation et de traduction est un processus d’individuation discursive.
Une métaphysique du galet ordinaire
6Les galets sont des pierres plutôt insignifiantes. A contrario de la métaphysique de Roger Caillois – qu’il imagine depuis l’observation de pierres exceptionnelles, ou qui ont une valeur esthétique particulière, la métaphysique des galets de Jean Dupuy est toute autre. Trouver sur la plage ou au gré d’une promenade un galet qui sédimente une lettre est une activité fortuite, enfantine. Elle nécessite pourtant une posture particulière : celle de l’arpentage, d’une attention portée au sol et non plus à l’horizon. La figure du flâneur nez en l’air n’est donc pas celle de ces trouvailles. Pour dénicher un X, un Y ou un O, il faut fouiller la terre des yeux, nez pointé vers ses pieds. Il faut donc une certaine disponibilité, une certaine attention portée à son environnement quotidien pour repérer la lisibilité du monde, là où l’on trouve d’ordinaire une nature muette.
7Dans l’anagramme no 70, l’artiste réalise un « inventaire de tiroir » dans lequel le galet trouvé sur la plage intègre une collection discrète (de celles que les enfants font des objets insignifiants).
V/V 1996
INVENTAIRE INA.NA.NA.INACHEVÉ DU TIROIR B.
DE LA TABLE OÙ LÉON, BÈGUE, ÉCRIT.
IL ÉCRIT QUELQUEFOIS COMME IL PA.PARLE
DE.DE.DE CETTE FAÇON IL PEUT FAIRE
DES. DES TEXTES ANAG.ANAGRAMMATIQUES
SANS TROP DE DIFFICULTÉS.
COMME PRÉCISÉMENT CELUI-CI QU’IL COLORE
EN.EN POUR. EN POURPRE. VERT PRÉ.
VIOLETS & JAUNE.
AINSI, IL PEINTURLIRE AH ! ET DE PLUS., IL ACCOM.
PAGNE SES TEXTES DE NO.DE NOTES MUSICALES →
« YOU SEE ? » DIT-IL À BOB.
CE.CE TIROIR CONTIENT 2 CRAYONS, DE LA FICELLE,
UNE. UNE. UNE ASPIRINE. 1 TUBE DE COLLE, 1 CLÉ,
2 GALETS. TROUVÉS SUR LA PLAGE, LES PHOTOS DE SA
SŒUR À.À 1 AN & D’UN CHIEN NOMMÉ GASTON,
1. PASSEPORT AMÉ.AMÉRICAIN VALABLE JUSQU’EN 1973,
1 LENTILLE, 1 PRÉSERVATIF, 1 PETIT FLACON DE LAVANDE
VIDE, 2 PASTILLES DE VIOLETTE ET SUR 2 MORCEAUX
DE. DE PAPIER DES INSCRIPTIONS SIGNÉES
COMPOSÉES DE 8 MOTS, I.E → UN ET MÊME
DEUX I.I.I.ILLISIBLES : TRAFIC. FACILE TIROIR B.B
QUOI ? QUOI ? QUOI ?
(246x2)5
8L’énumération presque pérecquienne de ces éléments en font des insignifiants non identifiés, des « inconnus » x ou y – n’ayant pas encore trouvé leur place dans une quelconque taxinomie.
[…]
J’AI
TRÈS
SOUVENT
TROUVÉ
DES
X
INSCRITS
SUR
LES
GALETS.
X,
EN ALGÈBRE,
C’EST
UN,
OU
UNE
INCONNU(E).
[…]6
Galets et art lazy
9L’utilisation des galets chez Jean Dupuy est également motivée par ce que l’artiste nomme l’art lazy, une méthode « paresseuse » de création, où le travail est délégué tant que possible ; en somme, une économie de l’effort comme principe de création.
10Ainsi dans Quoi (1984, galet et gouache sur bois, 35 × 12 cm), « le i n’est pas matérialisé par un trait de gouache blanche. C’est un trait naturel sédimentaire > art paresseux, je laisse au ready made faire tout le job – – as you know7 ». Les caractères naturellement inscrits dans les galets en font des signes prêts à l’emploi, un alphabet ready-made naturel, que l’artiste glane et agence. Plusieurs anagrammes font état de cette idée de ready-made sous l’appellation de « chef d’œuvre naturel » (anagramme no 75) ou de « sculpture naturelle » (anagramme no 58). L’anagramme no 87 accompagne un ready-made aidé, dans la stricte lignée duchampienne. Le « petit chef d’œuvre naturel » signé de la main de Léo (anagramme no 75) incarne la dynamique de l’art lazy, où le geste et l’effort sont délégués au maximum – aux galets et au bois. Cette stratégie espiègle est une stratégie productrice paradoxale, qui joue avec l’idée de co-signature ou d’œuvre co-signée.
LE 24/6/2012
OS
COQ
TRÈS FLUET
HERBEUX
EN
IMPOSANT
SON
POINT
DE VUE
AU
REGARDEUR,
LEO
S’EST
PERMIS
DE
SIGNER
CETTE SCULPTURE
TOUT
EN
PENSANT
QUE
C’EST
UN
PETIT
CHEF
D’ŒUVRE
NATUREL.
GRÈS
GUI
DES POMMES
L’OR
POIS
TERRES
OCRES
SUIE
BLÉ
ALE
®
(92x2)
Dupuy8
11Cette réflexion continue, de l’anagramme au galet (et inversement), interroge le rapport entre physis et logos. La lisibilité du monde9 est à comprendre depuis l’écriture hasardeuse présente dans les galets glanés par l’artiste. Depuis le néologisme de « thérolinguistique », nous pouvons penser une « litholinguistique » ou « géolinguistique » : une langue des pierres, ou langue de la terre, manière de réancrer notre expérience langagière du monde dans un sol plus concret (au sens étymologique du terme).
Langage des pierres, langage de formes : stratégie paréidolique et confusion des règnes
® D. LE 31.8
UN SOL COCO HACHISCH
HERBES BLETTES UNE LUNE
DORÉE NOIX UN BOIS POMME
ET LIS.
GALET RAMASSÉ SUR
LA PLAGE, À NICE.
UN PRIMATE EST
UN MAMMIFÈRE
TEL QUE
LE SINGE ET L’HOMME.
ET L’HOMME NÉANDERTALIEN,
LULU,
EST UN PRIMATE FOSSILE
PROCHE DE L’HOMME.
SIC.
UNE BRUNE UN OS PRÉ ACACIA
QUATRE GROS BABAS SIX CULS
ÉTÉ 2009 (123x2)10
12Les cailloux de Jean Dupuy sont glanés pour plusieurs raisons : tantôt pour leur forme, tantôt pour le signe linguistique ou linéaire qu’ils dessinent. Dans le cas de l’anagramme no 17, c’est le principe de paréidolie11 qui guide la découverte : l’artiste y voit des visages, des formes familières, qui participent souvent à humaniser les cailloux :
SCULPTURE NATURELLE
TROUVÉE À PUERTO RICO MÊME,
DÉTACHÉE D’UN
RÉCIF CONSTITUÉ DE
SQUELETTES DE POLYPES -
ET DÉPOSÉE
SUR UNE
PLACE
PAR LA MER.
L’EXAMEN À LA
LOUPE FAIT VOIR
3 FIGURES QUI SE CHEVAUCHENT
DE HAUT EN BAS.
C’EST ÉTONNANT.
[…]12
13Cet anthropomorphisme projectif s’incarne chez Dupuy dans une volonté de « montrer des sculptures naturelles anthropomorphes » (anagramme no 156). Aussi, les pierres ont-elles des yeux – et activent-elles un certain animisme esthétique, des « formes étranges, sculpturales, voire humaines » (anagramme no 155).
14À la manière de Luigi Lineri13, Jean Dupuy collectionne les galets les plus modestes et les agence en poèmes. Par là, il contribue à classer ces éléments. En particulier, plusieurs anagrammes sont consacrées à des classifications animalières, dont les chiens – forme très importante dans la collection de Luigi Lineri également. Aussi peut-on lire dans l’anagramme no 54 : « Ce caillou d’aspect marbrier me rappelle un certain médor. » Mais contrairement à Luigi Lineri, sa typologie ne relève en rien d’une démarche scientifique : c’est une classification fantasque et poétique qui contribue à la confusion des genres et des règnes. Jean Dupuy ne cherche pas un ordre dans le chaos ; il révèle la profusion du vivant. Les polypes, utilisés pour l’occasion, incarnent cette confusion : ces animaux marins, une fois morts, se pétrifient pour s’apparenter à un minéral. Devenus « masque grotesque » ou « gueule cassée » (dans l’anagramme no 74), la pierre-polype autant que le caillou-visage sont des stratégies de désignation qui visent à ré-insuffler de l’expressivité dans les pierres, à ré-emprunter la piste d’une expressivité propre à l’inanimé. Cet animisme esthétique ou forme d’incorporation imaginaire permet d’animer de manière symbolique l’inanimé. Si Luigi Lineri veut apprendre la langue des pierres et mettre en page leur alphabet, Jean Dupuy va plus loin en pensant avec la pierre et en leur donnant leur autonomie expressive.
15Ainsi, cette dimension expressive est également au centre de la réflexion de l’artiste lorsqu’il réalise des sculptures et des anagrammes où l’expressivité minérale s’incarne dans des collages qui mettent en jeu des interjections ou des onomatopées.
[…]
« OH » (O)
EXPRIME
DES SENSATIONS, LULU,
INVERSES,
SELON
L’INTONATION
ET PEUT S’ÉCRIRE,
I.E.
OH OU HO.
[…]14
16L’anagramme no 120 répond aux collages de galets sur bois où les « O » présents sur les galets inscrivent des HO ! / OH ! sur le bois. L’interjection – mot invariable, autonome, inséré dans le discours pour exprimer, d’une manière vive, une émotion, un sentiment, une sensation, un ordre, un appel, pour décrire un bruit, un cri – exprime bien une émotion, un affect spontané. La dimension sonore de l’interjection renforce l’idée que la pierre est douée d’expressivité, et qu’elle est loin d’être muette.
Langage des pierres : la signature dans les choses
17Cette autonomie expressive des pierres s’incarne peut-être dans ce que Giorgio Agamben évoque sous le nom de « signature ». La signature des choses (signatura rerum) ou signature dans les choses, va plus loin que la simple idée d’une lettre inscrite dans la pierre. Elle attribue aux choses, et aux éléments naturels en particulier, une signification cachée. Jean Dupuy, dans l’anagramme no 96, va parler de « stony meaning », d’un « sens pierreux » à l’œuvre dans la matière.
18La signature est aussi l’objet d’une investigation identitaire chez Jean Dupuy. Il n’est donc pas rare de trouver des signatures – au sens littéral – dans son travail. « Dupuy », le nom de l’artiste, fait ainsi rapidement l’objet d’une anagrammatisation : Dupuy devient YPUDU (très tôt, puisqu’on apprend qu’il signe de la sorte l’un de ses devoirs à l’âge de 15 ans15). C’est aussi de cette manière qu’il signe son premier ouvrage anagrammatique « Ypudu, Anagrammiste » en 1987. Les galets sont une nouvelle manière d’envisager la signature : souvent, le « d » ou le « o » de son nom sont inscrits dans la pierre.
19La signature peut être aussi davantage symbolique : Jean Dupuy agence des pierres pour créer des dates (xxe siècle, Mai 68 [anagramme no 139]), de sorte que ses sculptures renvoient à l’époque et à une temporalité précise : une temporalité contemporaine à la création, que l’inscription situe. Ces sculptures sont les marqueurs d’une époque, d’un rapport au présent et à une histoire émancipatrice (celle des avant-gardes historiques et de la liberté – qu’elle soit sexuelle ou d’expression).
20Par ailleurs, la signature dépasse la simple idée de sémiologie. En tant que « science par laquelle on trouve tout ce qui est caché16 », la signature insiste sur la puissance agissante du syntagme et l’agentivité du signe. Aussi, les anagrammes de Jean Dupuy relèvent-elles quelque part d’un véritable « Art signata17 », un art de la signature. Entre le caillou et la lettre de l’alphabet, la relation qui se tisse n’est pas simplement analogique : dans cette relation, le caillou devient tout entier lettre, et la poésie devient toute entière caillou. De fait, la signature tend vers l’agir. Plus que des signes, les cailloux sont des signatures : ils recèlent une marque qui développe un agir lecteur. Si pour Giorgio Agamben, la signature rend le signe intelligible, nous dirons que les poèmes de cailloux de Jean Dupuy rendent sensible et intelligible la poésie-même de la nature. Les anagrammes sont efficaces au sens performatif de la langue et leur efficacité l’emporte sur leur signification18. Historiquement, chez Michel Foucault en particulier, la signature relève d’un régime analogique de ressemblance19. Pour Giorgio Agamben, la ressemblance agissante qui lie les éléments entre eux ne relève pas nécessairement de l’analogie. Aussi, entre les anagrammes et les poèmes de galet se joue-il plutôt une « ressemblance efficace20 », qui permet de créer du lien entre les choses.
21Cette idée de reliance des choses, entre deux langages particulièrement, est démontrée dans les sculptures de galets avec lignes continues. Dans les anagrammes no 89, no 131 ou no 150, pas de lettres, mais des traits sédimentaires présents dans les galets et que l’artiste prolonge graphiquement sur le support qui les maintient. À la ligne naturelle s’adjoint la ligne artificielle du dessin. Deux régimes de réalité cohabitent : la réalité matérielle de la pierre et la réalité médiatisée de la représentation. Jean Dupuy, dans l’anagramme no 150, nomme explicitement le « trompe-l’œil » qui préside à la coïncidence des deux langages – naturel et artificiel :
[…]
POUR DONNER
À CES LIGNES
L’APPARENCE
D’UN TROMPE
L’ŒIL,
PRENEZ LE CADRE
À 2 MAINS.
YES !
LULU,
ET FAITES
COÏNCIDER
PAR
DE LÉGERS
MOUVEMENTS
LES
LIGNES
BLANCHES
DU GALET
AVEC CELLES
QUI
SONT TRACÉES
AU CRAYON
SUR LE PAPIER.
[…]21
22L’une des caractéristiques principales de la signature pour Giorgio Agamben tient également dans sa capacité à se situer entre-deux, et plus particulièrement entre le geste de lire et le geste d’écrire :
Non seulement il ne s’agit pas de signes, mais pas même de quelque chose qui ait jamais été écrit. […] Mais cela signifie que la signature est le lieu où le geste de lire et celui d’écrire inversent leur relation et entrent dans une zone d’indécidabilité. La lecture devient ici écriture et l’écriture se résout intégralement en lecture22 […]
23C’est dans cet entre-deux de la lecture et de l’écriture que se situent les productions de Jean Dupuy : elles relèvent d’une intermédialité, qui est surtout affaire de transmission23. Cette transmission, entre écriture et lecture, via le support qui recueille la trace du signe – quel qu’il soit – relève d’un apprentissage, de la lecture et de l’écriture. L’anagramme no 146 revient d’ailleurs sur cette pratique de l’« écriture bâton », où le trait n’est pas encore lettre, mais déjà signe.
J.D. ÉTÉ 2012 (112x2)
DES IFS.
JUS BIS LYS
DES SEINS
VEINE.
EN 1930
À L’ÉCOLE
(EN
ONZIÈME)
POUR APPRENDRE
À ÉCRIRE,
ON
COMMENÇAIT
PAR TRACER
DES TRAITS →
ÇA
S’APPELAIT
ALORS
« FAIRE
DES
BÂTONS ».
80 ANS
PLUS TARD
JE ME
DEMANDE
SI, TODAY,
JE NE REVIENS
PAS
EN ARRIÈRE.
N’EST-CE
PAS ?
COCO MIEL
ZINC CETTE PIE
PIERRE
PIS
CUL24.
24Revenir à une « enfance de l’écriture » permet à l’artiste de retrouver une lecture in media res, dans les signes-mêmes. Les anagrammes, en tant qu’agencements et images précaires dont la signature est éphémère, n’existent que dans le maintenant de la lecture. Pour parler avec Walter Benjamin, anagrammes et poèmes de galets existent comme des images dialectiques : on ne peut les lire que si l’on se tient dans leurs constellations, entre l’agencement passé et l’agencement présent de leurs lettres et de leurs pierres. L’anagramme no 90 évoque explicitement cet entre-deux dialectique, depuis la conjonction « ou » :
[…]
À NICE
CES GALETS TROUVÉS
SUR LA PLAGE SONT
MARQUÉ DE TRAITS
DUS À UNE SÉDIMENTATION.
« OU »
EST UNE
CONJONCTION
QUI INDIQUE
UNE ALTERNATIVE
OU
UNE ÉQUIVALENCE.
P.S → PEUT ÊTRE RENFORCÉE
I.E → PAR → BIEN
OU → ALORS
(LAROUSSE)
[…]25
Anagrammatisation continue : temporalité et sédimentation des langages
25Notre hypothèse principale est donc de dire qu’il existe dans la création de Jean Dupuy un processus d’anagrammatisation continue. Cette idée se démontre de plusieurs manières.
26Tout d’abord, elle est rendue possible par un rapport à la temporalité, spécifique à l’art lazy (défendu par l’artiste). L’art paresseux est non seulement un art qui prend son temps (qui le perd aussi parfois), mais surtout un art qui a conscience du continuum temporel dans lequel il s’inscrit ; un art de la durée et de la répétition (paradoxalement productive chez Jean Dupuy). La mention répétée d’un temps sédimentaire (en écho avec la constitution lente et immémoriale des pierres – l’anagramme no 72 mentionne une pierre au visage « sans âge ») encourage l’idée d’une sédimentation des formes, d’une écriture et du langage. L’anagramme no 147 rend compte du vertige temporel dans lequel le côtoiement des pierres nous plonge :
CE 24.6 (71x2)
OCRÉE OR
COCO VERT
ROND
EN FER
THÉ.
ESSAYER
D’IMAGINER
LE TEMPS
QU’
IL
A
FALLU
À
LA
NATURE
POUR
ÉCRIRE
CES
2 CHIFFRES
ME
DONNE
LE
VERTIGE.
LYS
COQS
ET
LA
MER
Dupuy
200926
27La dynamique d’anagrammatisation implique un continuum d’un langage à l’autre (nous l’avons déjà en partie évoqué plus haut, quand nous parlions d’intermédialité). C’est le cas dans certaines propositions où trois langages cohabitent : langage de pierre, langage de gouache, et langage de bois. L’anagramme no 99 fait ainsi dialoguer les veines du bois (qui forment un point), un « x » et un « y » sur des galets, un « z » à la gouache noire. Cette anagrammatisation est également un processus sémiophage et endophage :
® UN TON LILAS
UNE NUIT IF
DU SON
ZINC
LYS DATTE.
J’AI FAIT DE
CE MORCEAU
DE BOIS
UN ÉCRIN
POUR
PRÉSENTER
CES 2 GALETS.
JE VOIS UN X
COMME DANS
XYLOPHAGE
UN Y
COMME DANS
YOUPI.
LE Z
EST DESSINÉ À LA GOUACHE
ET
LE POINT FINAL
EST PARFAITEMENT NATUREL.
SIC.
UN JONC JUS
COCOS BIS UN GROS
DERRIÈRE
DU VIN
D.upuy
(117x2)27
28Le galet, en « dévorant » le bois, s’y inclut. Cette inclusion, décrite comme processus d’ingestion par l’auteur, rend compte d’une matière-langage qui se nourrit d’une autre que la sienne. Le galet phagocyte le bois, comme l’anagramme phagocyte le langage, le modifiant « de l’intérieur ».
29Enfin, les pierres et le rapport qu’elles entretiennent aux anagrammes, permettent de penser une méthode propre à Jean Dupuy ; une méthode où dans le jeu de l’anagrammatisation, il est question d’accueillir l’occasion et de se laisser surprendre par les re-créations langagières. Penser Dupuy, c’est donc, avec la lettre et la pierre, savoir « faire d’une pierre deux coups ». Dans l’anagramme no 127, la portée musicale qui traverse le galet (ou bien est-ce l’inverse) « permet […] de faire d’une pierre même, 9 notes à la fois28 » – le galet tenant lieu de note(s) placée(s) sur la portée. Même principe dans l’anagramme no 128 :
ÉTÉ (31.8)
DU FOIN
OR UN JUS
DIX LYS
BOISÉ
CE SEIN.
EN APPLIQUANT
CE
GALET
MARQUÉ
ICI
DE
4 TRACES
SÉDIMENTAIRES,
SUR
UNE
PORTÉE
FANTAISISTE,
JE
FAIS,
YES !
LULU,
D’UNE
PIERRE
7 NOTES.
ACACIA
DU GUI
MERS
CINQ
COQS
BIS
ET
MIEL
D.
EN 2011
85X2
®29
30« Faire d’une pierre deux coups » ou « faire d’une pierre 7 ou 9 notes » sont des stratégies opératoires, qui permettent des réussites multiples. L’anagramme et les poèmes de galets permettent de penser l’anagramme avec la pierre, la pièce avec le poème, la poésie ricochant avec légèreté de l’un à l’autre – dynamique paradoxale lorsque l’on sait à quel point des galets glanés peuvent peser dans les poches.
Conclusion
31Anagrammes et sculptures-poèmes de galets rendent compte de la logique d’intensification des formes brèves à l’œuvre dans la production de Jean Dupuy. Leur brièveté n’empêche pas leur répétition : ainsi s’intensifie l’œuvre de l’artiste et son approche poétique de la vie, par itération de phénomènes spontanés et vitaux. Figure majeure du mouvement Fluxus, Jean Dupuy a marqué la création contemporaine par une approche joyeuse et permanente de l’art. L’anagramme s’inscrit alors dans la lignée de l’art lazy (que l’on pourrait traduire par « art paresseux » ou « art nonchalant ») mis en œuvre dans les propositions sculpturales de l’artiste (nous pensons ici à la pièce Lazy Suzan réalisée en 1979). Cette pratique poétique, à mi-chemin entre peinture et écriture, participe d’un ralentissement général, d’une décroissance productrice salvatrice, qui traduit une volonté affirmée de s’extraire du marché de l’art (new yorkais en particulier) et de se réinscrire dans le langage de la nature et de la vie. Cette posture singulière questionne non seulement l’intérêt à agir qui motive la création, autant qu’un mode mineur de création, en déprise avec les attentes capitalistes et spéculatives du marché de l’art. L’anagramme devient alors l’incarnation d’une grève poétique de l’art contemporain, pendant laquelle l’artiste s’adonne sans discontinuer aux trouvailles heureuses. La dimension écologique des anagrammes exhibe l’expressivité des inanimés et la discursivité qui traverse les phénomènes. L’analyse des poèmes-galets de Jean Dupuy permet de mieux comprendre l’individuation discursive à l’œuvre dans la nature et dans la création artistique. Les méthodes poétiques de l’artiste – à la fois intuitives et millimétrées – explorent un continuum de la création, un processus d’anagrammatisation continue – manière de jouer avec la vie comme on fait des ricochets.
1 « C’est avec ces quatre mots “American venus unique red” inscrits sur un crayon de marque “venus”, que j’ai fait une anagramme pour la première fois, à New York, un jour de désœuvrement de 1973. », Jean Dupuy, Semiose galerie (dir.), Jean Dupuy, À la bonne heure !, Paris, Semiose éditions, 2008, p. 82.
2 Christian Xatrec, « À propos du système anagrammatique de Jean Dupuy », https://www.switchonpaper.com/portrait/artiste/a-propos-du-systeme-anagrammatique-de-jean-dupuy/, page consultée le 29 janvier 2024.
3 Anagramme no 3 « Malherbe ». Les numéros des anagrammes renvoient à la numérotation de l’anthologie Where (Jean Dupuy, Where, Paris, Loevenbruck, 2013).
4 Roger Caillois, Œuvres, Paris, Gallimard, 2008, p. 1129.
5 Anagramme no 70, dans Jean Dupuy, Where, éd. citée.
6 Anagramme no 158, ibid.
7 Jean Dupuy, correspondance privée avec l’artiste.
8 Anagramme no 75, dans Jean Dupuy, Where, éd. citée.
9 Hans Blumenberg, La Lisibilité du monde, Paris, Le Cerf, 2007. Voir particulièrement la question du « vulcanisme » et du mutisme de l’inorganique chez Goethe : chapitre XV – « Comme le livre de la nature devient lisible à mes yeux… », p. 235-238.
10 Anagramme no 57, dans Jean Dupuy, Where, éd. citée.
11 La paréidolie est, d’après le dictionnaire de la langue française en ligne, un phénomène psychologique par lequel un stimulus vague ou ambigu est interprété de manière claire et distincte comme une forme familière, souvent dans des contextes désordonnés (nuages, constellations, etc.).
12 Anagramme no 17, dans Jean Dupuy, Where, éd. citée.
13 Le travail de Luigi Lineri a été présenté par Claire Margat lors d’une conférence intitulée « Des gogottes et autres formes symboliques », lors de la journée d’étude « Esthétique minérale. Généalogie et enjeux contemporains », organisée par Bertrand Prévost et Marina Seretti, Université Bordeaux Montaigne, 6-7 juin 2024.
14 Anagramme no 120, dans Jean Dupuy, Where, éd. citée.
15 Gilles Coudert, Jean Dupuy Ypudu, film documentaire, a.p.r.e.s production/Vosges TV, 2021, DVD, 52 min.
16 Giorgio Agamben, Signatura Rerum. Sur la méthode, traduit de l’italien par Joël Gayraud, Paris, Vrin, p. 40.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 57.
19 Voir Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1966.
20 Giorgio Agamben, Signatura Rerum, op. cit., p. 59.
21 Anagramme no 150, dans Jean Dupuy, Where, éd. citée.
22 Giorgio Agamben, Signatura Rerum, op. cit., p. 63.
23 Voir Eric Mechoulan, « Intermédialité, ou comment penser les transmissions », Fabula / Les colloques, Création, intermédialité, dispositif, dir. Philippe Ortel, 2017, URL : http://www.fabula.org/colloques/document4278.php, page consultée le 24 mars 2025.
24 Anagramme no 146, dans Jean Dupuy, Where, éd. citée.
25 Anagramme no 90, ibid.
26 Anagramme no 147, ibid.
27 Anagramme no 90, ibid.
28 Anagramme no 127, ibid.
29 Anagramme no 128, ibid.
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy » dans Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles),
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2097.html.
Quelques mots à propos de : Barbara Bourchenin
Université Bordeaux Montaigne
ARTES – UR 24141
Barbara Bourchenin est Maîtresse de conférences en arts plastiques à l’Université Bordeaux Montaigne. Ses réflexions théoriques sur la discursivité et les poétiques à l’œuvre dans le « faire-bibliothèque » et le « faire-lecture » questionnent la « poétique » à l’œuvre dans tout travail de recherche : comment dire une œuvre ? Comment l’œuvre travaille-t-elle notre langage ? Et en retour, comment la discursivité façonne-t-elle notre expérience des œuvres et notre regard ?
Publications : « Jean Dupuy et le je(u) du traduire anagrammatique » (Intermédialités, no 27, printemps 2016), « Jean Dupuy : personnage conceptuel bègue » (Angers, 2022, communication en ligne).
