Sommaire
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
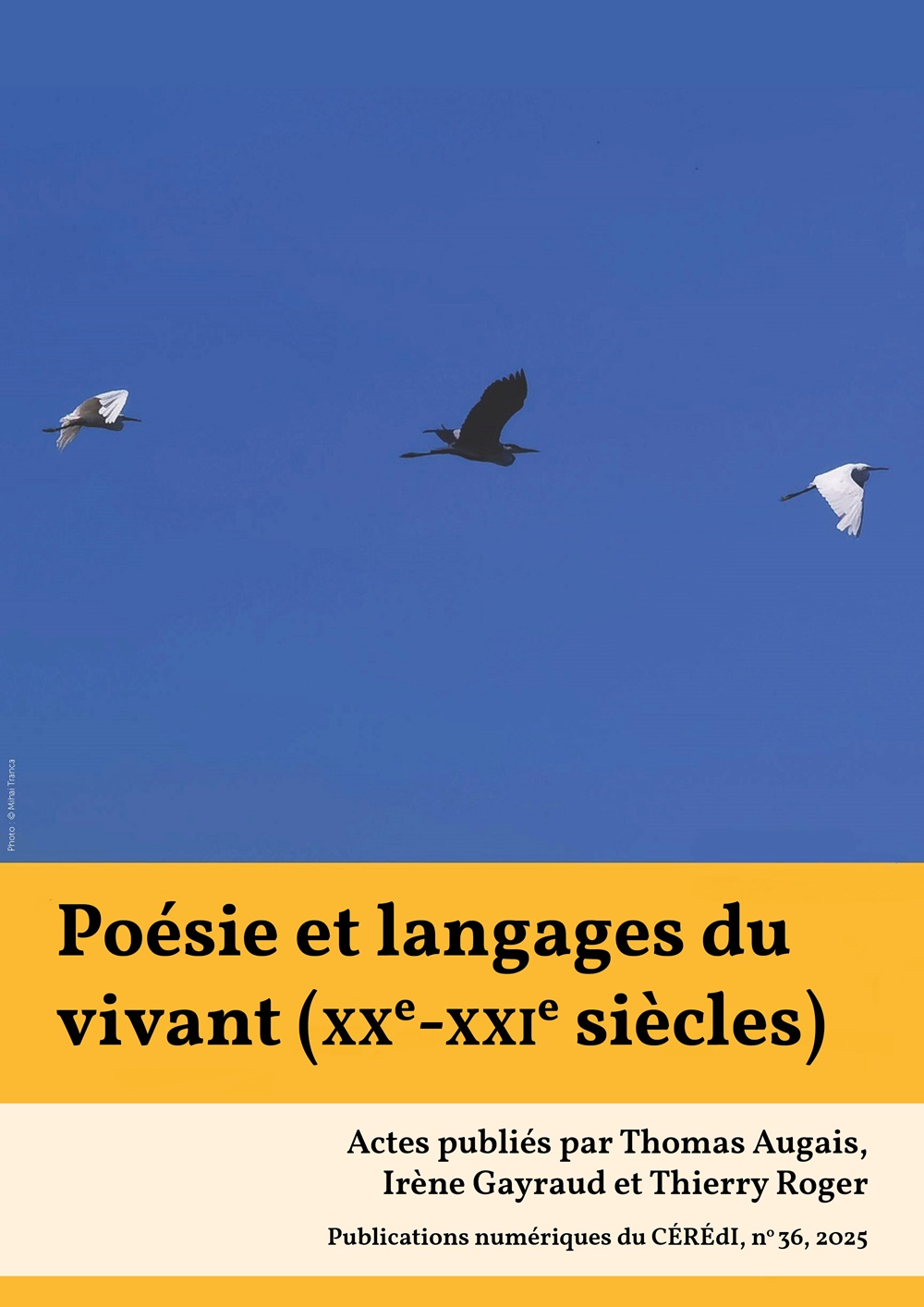
- Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction
- Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes
- Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
- Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar
- Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »
Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy - Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant
- Michel Collot La Terre parle ?
- François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles
- Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro
- Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème
- Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace
- Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet
- Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières
- Marik Froidefond Poésie prédatrice ?
- Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant
Poésie et langages du vivant (xxe-xxie siècles)
S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue
Alexis Messmer
1Cet article vise à explorer la « lisibilité vivante1 » (Del Fiol), c’est-à-dire « un état du langage » maintenant une continuité avec « le mouvement même du vivant2 ». En nous appuyant sur l’œuvre de Gherasim Luca, laquelle, même si elle n’aborde pas explicitement la question du vivant, expose sous maints aspects un rapport charnel, voire physiologique, au langage humain, nous souhaitons envisager l’inscription de ce dernier dans l’ordre du vivant en étudiant la notion d’Umwelt discursif selon une approche sémiotique.
2Après avoir présenté le caractère métabolitique de l’expression chez Luca ainsi que sa conception de la langue comme système autopoïétique, il s’agira, en s’appuyant sur la métaphore élaborée par Luca de la langue en tant que femme (avec un détour par la figure de Méduse) et de l’idée en tant qu’œil, de montrer, par le recours d’une part à la notion de vie telle que la définit le biologiste André Pichot3, et d’autre part au concept de médiance proposé par Augustin Berque4, en quoi l’œuvre de Luca permet de penser l’expression comme une relation entre le locuteur et son milieu linguistique (que nous nommons Umwelt discursif). À partir du poème « Prendre corps5 » en particulier, nous proposerons une analogie entre l’être vivant et l’être parlant. Le premier évolue au sein d’un milieu naturel structuré par des relations physico-chimiques et le second au sein d’un espace discursif, structuré linguistiquement par la grammaire et le dictionnaire, structuré moralement par le droit. Dans ce poème, Luca renouvelle la signification en s’écartant de la norme linguistique. Ce faisant, il emporte le lecteur dans une sorte d’errance sémantico-syntaxique, laquelle permet de s’intéresser au « possible de langue6 ».
Gherasim Luca, une posture et un style
3Pour commencer, quelques mots sur Luca7 (1913-1994) : poète d’origine roumaine proche du surréalisme sans jamais y avoir véritablement adhéré, il quitte la Roumanie en 1952 et s’installe à Paris où il écrira en français. Cette langue lui est donc étrangère, langue d’adoption avec laquelle il entretiendra un rapport à la fois fusionnel et distancié. Sa poésie peut être vue comme une exploration des limites et des potentialités de la langue dans une visée régénérative. Il utilise de ce fait la langue comme matière qu’il s’agit de modeler par des expérimentations formelles, en explorant la subjectivité et l’inconscient comme moyens de contestation sociale et politique, avec humour et ironie. Toutes ces caractéristiques rendent la lecture de ses textes assez déconcertante : lire un poète dont le vœu est de poursuivre « la constellation spectrale du dépassement humain8 » n’est pas de tout repos ! Sa « cabale phonétique » et son « dynamitage de la parole sacrée9 » rendent son œuvre difficile d’accès. Se qualifiant d’« amoureux monstrueux amoureux d’une amoureuse monstrueuse10 », celle-ci étant la langue, il n’a de cesse de s’ébattre avec elle dans un rapport nourri à la fois de révolte et de séduction, d’angoisse et d’érotisme, mais aussi à l’intérieur d’elle, pris dans les mots avec lesquels il expérimente en faisant preuve d’une grande créativité linguistique. Rappelons que les récitals, très incarnés, qu’il donnait de ses poèmes, font partie intégrante de sa production poétique et exposent son rapport corporel avec la langue où les sons produisent du sens11.
4Pour cet article, nous nous appuyons sur deux ouvrages : le dernier recueil auquel Luca travailla, composé de deux textes publiés originellement en roumain en 1945 puis en français en 1994, L’Inventeur de l’Amour suivi de La Mort morte12, et Héros-Limite13, recueil publié en 2001 et reprenant Héros-Limite de 1953, Le Chant de la carpe de 1973 et Paralipomènes de 1976. L’Inventeur de l’Amour est un long monologue en prose poétique qui entend proposer une libération de la condition œdipienne par des voies sacrilèges dans un monde où « tout doit être réinventé14 ». Héros-Limite est composé quant à lui de textes expérimentaux, sorte de mise en pratique des voies sacrilèges annoncées dans L’Inventeur de l’Amour.
La vie de la langue
5Ce qui nous intéresse chez Luca, c’est la manière dont il considère la langue comme un organisme15, puisque, pour reprendre les mots de Gaspar, « son organisation arborescente, son développement à ramures, les relations dynamiques de ses éléments, sa matrice germinative, sa stratégie s’inspirent de l’ordre du vivant16 ». Nous souhaitons ainsi montrer que la poésie de Luca relève d’un processus (bio)sémiotique, c’est-à-dire créateur de sens, au prisme de la notion d’Umwelt17. Voyons tout d’abord en quoi son expression se rattache à des notions de biologie telles que le métabolisme et l’autopoïèse.
Métabolisme linguistique
6En biologie, le métabolisme – ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d’une cellule et donc d’un être vivant – se décompose en deux parties : le catabolisme, qui est l’ensemble des réactions de dégradation permettant la production de métabolites, et l’anabolisme, qui est l’ensemble des réactions de synthèse permettant la production de métabolites18. En alchimiste du verbe, synthétisant ou dégradant des mots pour produire du sens, Luca manie l’idiome selon un processus de métabolisation que de nombreux poèmes, dont voici quelques extraits, mettent en scène :
Le viol viole violemment le on du violon19
« La mort, la mort folle, la morphologie de la méta, de la métamort, de la métamorphose ou la vie, la vie vit, la vie-vice, la vivisection de la vie » étonne, étonne et et et est un nom, un nombre de chaises, un nombre de 16 aubes et jets, de 16 objets contre, contre la, contre la mort ou, pour mieux dire, pour la mort de la mort ou pour contre, contre, contrôlez-là, oui c’est mon avis, contre la, oui contre la vie sept, c’est à, c’est à dire pour, pour une vie dans vidant, vidant, dans le vidant vide et vidé, la vie dans, dans, pour une vie dans la vie20
entre le temps de tes tempes et l’espace de ton esprit
entre la fronde de ton front et les pierres de tes paupières
entre le bas de tes bras et le haut de tes os
entre le do de ton dos et le la de ta langue21
7Dans nombre de ses textes, Luca manipule donc la langue comme si elle était vivante, et que ses transformations – procédés de morphologie lexicale – relevaient d’une dynamique vivante, ainsi que l’énonce Meschonnic : « La poésie fait vie de tout. Elle est cette forme de vie qui fait langage de tout. Elle ne nous arrive que si le langage même est devenu une forme de vie22. » Il est possible d’analyser la poésie de Luca au prisme du concept de métabolisme : il s’agit de composer-décomposer les mots en jouant avec les phonèmes et les morphèmes (unités minimales de signification), afin de régénérer la signification selon une logique combinatoire. Cette analogie rejoint l’hypothèse défendue par Amr Helmy Ibrahim selon laquelle « penser le fonctionnement de la langue est la manière la plus achevée qui nous soit donnée pour penser le vivant23. » Pour ce faire, il inventorie l’ensemble des propriétés du vivant et tente de les appréhender à travers sept types de traces24 dont la structure renvoie à une « propriété spécifique, définitoire et distinctive des langues naturelles25 ». Parmi ces traces, il relève la combinatoire, que le poème « son corps léger26 », par exemple, illustre. Dernier texte du recueil, il se compose d’une série de 5 séquences, toutes constituées des mêmes syntagmes organisés selon un ordre différent, dont voici la première et la dernière :
Son corps léger / est-il la fin du monde ? / c’est une erreur / c’est un délice glissant / entre mes lèvres / près de la glace / mais l’autre pensait : / ce n’est qu’une colombe qui respire / quoi qu’il en soit / là où je suis / il se passe quelque chose / dans une position délimitée par l’orage (300)
Ce n’est qu’une colombe / dans une position délimitée / là où je suis par l’orage / mais l’autre pensait : / qui respire près de la glace / est-ce la fin du monde ? / quoi qu’il en soit c’est un délice / il se passe quelque chose / c’est une erreur / glissant entre mes lèvres / son corps léger (304)
8Ce texte fait évidemment référence aux cubomanies de Luca que Luc Mercier définit ainsi :
Inventée par Luca et qualifiée par lui de « non œdipienne », la cubomanie est une nouvelle forme de collage réalisé au moyen d’images découpées en petits carrés. Elle représente la destruction de la réalité par les ciseaux et par l’humour, et la construction d’une réalité nouvelle selon les lois du hasard ou le caprice. Elle est le « complément oculaire », la traduction visuelle du rejet de la réalité extérieure hostile et de la réalité œdipienne castrante27.
9Dans ce texte – comme pour ses cubomanies, qui sont des collages picturaux où Luca découpe un tableau et mélange les pièces obtenues pour reconstituer un nouveau tableau, mettant ainsi en avant certains éléments du tableau original qui seraient passés inaperçus – il redistribue les syntagmes pour offrir au lecteur différentes variations, ou combinaisons, d’un même texte, chacune d’elles mettant en valeur l’une ou l’autre des propositions et des idées contenues dans le texte initial. Son corps léger, titre et derniers mots du poème, met en lumière l’importance de la syntaxe (en grec syntaxis : mise en ordre, disposition). Le français est une langue où l’ordre des mots est fondamental pour la compréhension, à la différence par exemple des langues à désinences où les mots portent la marque de leur fonction. Ce poème de Luca montre également la liquidité de la langue et son caractère malléable28.
10Rappelons que Luca a étudié la chimie à l’Institut Polytechnique de l’Université de Bucarest de 1930 à 193229 et que cette formation a pu influencer sa manière d’appréhender la langue30. Luigi Rizzi a analysé cette chimie de la morphologie lexicale : « nous pouvons penser la phrase comme une molécule […] dont les atomes seraient les morphèmes, les entités les plus petites ayant un sens31. » Si la phrase est molécule, le texte ne serait-il pas tissu ou organe, et la langue corps ?
Système ouvert et autopoïèse
11Considérer la langue comme un organisme amène à la définir, à partir de plusieurs poèmes, comme un système ouvert et autopoïétique. Le concept d’autopoïèse, développé par les biologistes Maturana et Varela32, désigne la capacité d’un système à se maintenir et à se reproduire lui-même en se régénérant continuellement à partir de ses propres composants et de son environnement. Plusieurs poèmes et quelques titres explicites tel que « Hermétiquement Ouverte » abondent en ce sens :
la métafemme ouvre la femme
elle ouvre et découvre sa chair translucide
ses entrailles transcendantes sa chevelure
transmissible
éruptive dévorante et dormante
son cœur transpercé par les balles transparentes
de mes caresses en transe33
C o m m e n t
s ’ e n s o r t i r
s a n s s o r t i r
(…)
On s’en sort par lapsus linguae
par lapsus vitae
par lapsus linguae
par lapsus vitae, on s’en sort
[…]
Poisson sans poids ni son
dans l’eau sans voyelles34
Mais le mort le mot d’or d’ordre
le mot le mot d’or d’ordre
de la mort de la mort
c’est mordre mordre les bornes de la forme
et fondre son beau four dans le corps de la femme35
12Comme le rappelle David Abram : « Pour Saussure, la langue […] n’avait rien d’une structure mécanique, facilement décomposable en ses différents constituants. Il s’agissait plutôt d’un système organique, vivant, dont chacune des parties est liée de manière interne à toutes les autres36. » La langue peut donc être envisagée comme un système autopoïétique capable d’évoluer, par l’entremise de ses locuteurs, en se régénérant continuellement à partir de ses propres composants, les morphèmes, et de son environnement, le monde social où communiquent les membres d’une communauté linguistique. Pour exprimer cet aspect vivant de la langue, Luca développe la personnification de celle-ci en femme, avec le corps de laquelle le poète va interagir.
La sensualité de l’expression : métaphorisation de la langue et de l’idée
La langue-femme
13Dès L’Inventeur de l’Amour, Luca élabore une personnification de la langue en femme. Par cette figure de style relevant à la fois de l’anthropomorphisme et d’une sorte de biomorphisme, Luca peut affirmer son amour envers celle-ci et également lui conférer un caractère vivant. Comme le souligne Rotirati : « La Femme et son corps sont pour Luca le lieu du langage et du silence où la parole a vraiment lieu37. » Sans approfondir cette interprétation lacanienne ou barthésienne38, nous nous contenterons de considérer la femme aimée comme la langue, à la fois mère qui donne la vie et langue qui donne du sens, femme à aimer pour engendrer la vie, langue à chérir pour engendrer le sens. Le rapport de Luca à la langue peut donc être qualifié d’organique et associé à la « chair du monde ». En effet pour Merleau-Ponty, « l’épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui ; ce n’est pas un obstacle entre lui et elle, c’est leur moyen de communication39 ». De même pour Luca, l’épaisseur de chair entre le locuteur et l’idée (le signifié) est constitutive de sa dicibilité à elle comme de sa corporéité à lui, où le premier est capable de donner forme à la seconde, laquelle forme est rendue possible par la faculté articulatoire, donc physique, du locuteur à émettre des sons porteurs de sens.
14De surcroît, les sensations et les cinq sens sont primordiaux dans le rapport à la femme-langue :
Les cinq femmes qui visitent
dans les circonstances
les plus inattendues
les plus singulières et absurdes
mon désespoir voluptueusement amoureux
rendent manœuvrable cette aimée
tentaculaire et radiante
qui baigne de son parfum mon existence40
15Dans « Prendre corps41 », poème sur la relation amoureuse, Luca insiste particulièrement sur la sensualité par la perception : la vue (tu me miroir, tu me mirage, tu me cataracte, je te transparente, tu me pénombre, tu me visible, je te rétine…), le toucher (je te peau, je te cuisse, tu me chair cuir peau et morsure…), l’ouïe (je te clavecin, tu me silencieusement, je te phonétiquement…), l’odorat (je te narine, tu m’odeur…) et le goût (je te bouche, je te palais…). C’est donc en particulier par les sens que s’établit la relation entre le locuteur et la langue.
La langue créatrice et la figure de Méduse
16Cette femme qui personnifie la langue n’est pas seulement un artefact dont les réalisations seraient à percevoir selon une optique sémiotique. En effet, elle est aussi créature mythique : dans L’Inventeur de l’Amour, l’insistance sur la chevelure42 de l’aimée, sur le regard et la stupéfaction43, ainsi que sur le sang, font d’emblée penser à la figure de Méduse.
cette tête de ténèbres
la tête de l’aimée drapée d’une nébuleuse
la tête de ma bien-aimée adorée
tentaculaire, radiante, jamais née
et dont l’affirmation suprême
est l’immense cordon ombilical
par lequel je lui suce le cœur44
17Mentionnée dans le poème « L’écho du corps45 », Méduse y est mise en rapport avec les muses : « entre la muse de tes muscles et la méduse de ton médius ». Si les deux figures mythologiques évoquées se rapprochent dans leur relation au corps et à sa réalité physique, elles s’éloignent néanmoins et a priori par ce qu’elles représentent : la voix inspiratrice des Muses et le regard immobilisant de Méduse46, laquelle pétrifie et interdit le geste. Au-delà d’une simple référence à Méduse, « la femme sans tête47 », Luca semble s’emparer de cette figure mythologique afin de remotiver le mythe même. Méduse est autant « monstrueuse » que salvatrice : le sang qui coule de son cou donne en effet la vie et annonce le renouveau.
je me donne la liberté de ne pas aimer
une image toute faite par le Créateur
et de poursuivre l’apparition au monde
de cette aimée
[…] ma bien-aimée
en perpétuel devenir
en sublime négation
de son être toujours inventé48
18La mort de Méduse a été interprétée de diverses manières dans la mythologie et la philosophie. Isabelle Turcan interprète la victoire de Persée sur Méduse comme un mythe cosmologique, celui d’un pouvoir solaire vainqueur du règne de l’hiver. Le pouvoir pétrifiant du regard de Méduse représente alors celui du gel49. Il s’agit selon cette perspective de refuser l’immobilisme et de susciter l’émergence et le mouvement, tel un éternel retour recréateur, en mettant en évidence le cycle naturel des saisons et la régénération du vivant en constante évolution. La langue ne se fige jamais dans un état donné, elle mue sans cesse, insaisissable, il est vain de chercher à la connaître totalement :
on cherche en vain cette femme absolue
dont la raison d’être
est de n’être jamais rencontrée50
19Par ailleurs, le sang, autre figure récurrente, peut s’interpréter comme l’encre, l’écriture qui véhicule la signification, sorte de flux vital qui permet de faire couler le sens. L’Inventeur de l’Amour commence d’ailleurs ainsi : « D’une tempe à l’autre / le sang de mon suicide virtuel / s’écoule51 ». S’agit-il de lire : d’une marge à l’autre, le sens se dessine dans les mots et exprime un dérèglement radical de la signification ? André Velter nous rappelle que Luca « conjugue le sens et le sang, mêle son rapport physique avec le langage au rapport physique avec l’être aimée52 ». Mais le sang représente également la violence de l’acte de penser et d’écrire :
Je vois d’ici
le cerveau satisfait de l’homme
qui me dénonce à la psychologie
comme vampire53
20Pour lui apporter du sang neuf, le poète, tout comme Persée, doit faire acte de violence envers la langue. En ce sens, Octavio Paz écrit :
La création poétique est d’abord une violence faite au langage. Son premier acte est de déraciner les mots. Le poète les soustrait à leurs connexions et à leurs emplois habituels : séparés du monde informe du langage parlé, les vocables à nouveau sont uniques, comme s’ils venaient de naître. Le second acte est le retour du mot : le poème se convertit en objet de participation54.
21C’est ainsi que ces corps de femmes, ces parties de langue, pourront venir intégrer le corps total de la femme, de la langue, après avoir trouvé un nouveau signifié.
Ce n’est qu’après leur avoir pris
les quelques gouttes de sang
par lesquelles elles se donnent à moi
comme à un démon ce n’est qu’au moment
où elles ne s’appartiennent plus
que ces femmes commencent à se retrouver
et à se laisser enchanter et ensorceler
par leur murmure intérieur55
22La décollation de Méduse entraîne la naissance de deux figures mythologiques importantes : de sa tête tranchée jaillissent deux fils, Pégase, le cheval ailé souvent associé à l’inspiration littéraire et à la créativité poétique56, et Chrysaor, le géant à l’épée d’or, emblème de l’autorité et du pouvoir divins. Cette transformation symbolise la possibilité de renaissance et de création à partir de la destruction, vue comme une expérience sublime. Figure ambivalente, à la fois terrifiante et protectrice, Méduse est également une métaphore de l’art57 : puisque, dans la tradition classique, l’art est le reflet de la vie, la figure de Méduse devient une métaphore de l’art et de l’effet de l’art. L’effet de saisissement et de stupéfaction du spectateur devant l’œuvre d’art renvoie à la pétrification. En ce sens, Méduse devient chez Luca la métaphore de la création poétique même. En effet, sa décapitation entraîne la naissance de Chrysaor et de Pégase qui symbolisent, d’après Diel, la spiritualisation et la sublimation58. Le crime n’a donc pas pour but premier de supprimer Méduse mais de lui permettre d’engendrer sa descendance. Luca, endossant ici le rôle de Persée, procède selon une démarche maïeutique, visant à faire réfléchir sur le renouvellement du sens et des valeurs, ainsi qu’à dépasser l’incapacité à regarder la figure pétrifiante :
Si l’indice semble être l’indicible
La cible
Perçons ensemble l’imperceptible
Personne59
Représentation et espace des idées
23Ainsi, la pétrification menace le locuteur en l’empêchant de s’exprimer et le place, médusé, face à l’indicible. La figure d’une langue figeant l’expression du locuteur, qui en reste interdit, doit être apprivoisée ; il s’agit alors pour lui de surmonter cet obstacle en montrant la langue, en exposant le corps de la femme afin d’aller conquérir l’indicible. Pour engendrer le sens, il faut selon Luca changer le regard et apprendre à regarder ailleurs, autrement. Le locuteur de la langue, cette « amoureuse monstrueuse » qu’il faut séduire pour lui permettre de s’épanouir, au-delà de toute maîtrise ou possession, doit être capable de se laisser surprendre par ce que la langue peut montrer, si monstrueux cela soit-il, et quand bien même il lui faudrait la violenter. La langue doit être inventée et régénérée, sous le regard, en se montrant sous une apparence nouvelle :
Si la femme que nous aimons
ne s’invente pas sous nos yeux
si nos yeux
n’abandonnent pas
les vieux clichés
de l’image sur la rétine
s’ils ne se laissent pas exorbiter se
surprendre et attirer vers une région
jamais vue
la vie me semble une fixation arbitraire
à un moment de notre enfance
ou de l’enfance de l’humanité60
24Concernant la métaphore de l’œil, le poème Droit de regard sur les idées pose la question de la représentation et de la primauté de la vue dans notre appréhension du monde. Luca mène une réflexion sur le signe et pense la représentation comme un espace et l’idée comme une créature fabuleuse qui vit dans cet espace et prend l’apparence d’un œil. En pensant à nouveaux frais la représentation par la métaphore de l’œil, Luca considère dans ce poème l’expression langagière comme une interaction au sein d’un environnement où se trouvent des idées auxquelles il faut donner une image. À la fois platoniste et nominaliste, le locuteur doit réussir à pénétrer dans l’œil-idée et pour s’en libérer, il doit lui donner une image, lui offrir un signifiant.
DROIT DE REGARD SUR LES IDÉES61
Dans une des régions
les plus raréfiées de l’esprit
où je campais au pied de la lettre
à une altitude de nul pied
plane un petit nombre
d’idées très particulières
qu’il eût été dommage de ne pas saisir
au vol de mes distractions
[…]
À peine aspiré au fond de l’œil
mon regard entreprit de se frayer
un chemin vers le haut
[…]
Il se peut cependant
que nos regards trouvent
au double fond de l’œil
quelque peu
d’une sécrétion visionnaire
25Selon Carlat, il s’agit dans ce poème de « restituer à la pensée une dimension érotique ; l’effort de représentation intellectuelle est associé à un rituel de séduction, l’approche d’une idée à une forme de parade nuptiale62 ». À la lumière des réflexions sur les yeux comme représentation symbolique des organes génitaux, il est avéré que les yeux sont l’objet d’un fort investissement libidinal : « Cette appréhension du sexe féminin que sous-tend la logique phallique/castré de la théorie sexuelle infantile et où se formalise et s’inscrit en corps le fantasme “du pénis en creux” mis en lien direct ici, dans le déplacement bas/haut, avec l’identification sexe/œil – regard63. » C’est par ce moyen – redonner à la pensée et à l’acte expressif une dimension érotique – qu’il sera possible, pour le poète, de se soustraire à la condition œdipienne et de sortir du rapport problématique à la mère :
dans les terres aériennes de mes cuisses
la transmigration de la bouche de son âme
vers les cuisses de mon haleine
[…]
la transmutation gigantesque perpétuelle et triomphante
du lait maternel64
26La langue, personnifiée en femme, est à la fois mère qui donne la vie et femme à aimer pour engendrer la vie : s’agirait-il alors de faire l’amour, métaphoriquement, à la langue ? En donnant une forme aux idées, le poète apporte à la langue de la matière à signifier, et le poème devient le fruit de cette rencontre entre une intuition et sa possibilité de formulation, l’hybridation entre une idée neuve et une langue régénérative. Selon Gaston Bachelard, « [l]e poème est essentiellement une aspiration à des images nouvelles. Il correspond au besoin essentiel de nouveauté qui caractérise le psychisme humain65. »
27Par ailleurs, quelle est cette « sécrétion visionnaire » ? Une sécrétion étant une substance pouvant s’introduire dans le sang par osmose ou être évacuée66, n’est-elle pas alors ce mot formulé qui pourra intégrer la langue, tel un signe nouveau à percevoir ?
28À la lumière de ces considérations sur la femme aimée en tant que langue et sur la représentation en tant qu’espace où s’opère l’offrande d’images à l’œil-idée, nous pouvons interpréter le poème « Prendre corps » comme une illustration des relations entre un locuteur et son milieu (l’espace discursif dans lequel il évolue) en proposant une analogie avec le vivant tel que le définit le biologiste et épistémologue André Pichot.
Interactions linguistiques et Umwelt discursif
« Prendre corps » : la conversion pour élargir le domaine du signifiable
29Le poème « Prendre corps67 » peut être qualifié de déclaration d’amour : ce texte propose une série de relations entre le poète aimant et la femme aimée, interactions singulières puisque tous les verbes utilisés y sont inventés. Le poète semble ici céder « l’initiative aux mots », selon l’expression de Mallarmé68. Ainsi Prendre corps est un poème générateur de verbes, dont voici le début et la fin :
Je te flore
tu me faune
Je te peau
je te porte et te fenêtre
tu m’os
tu m’océan
tu m’audace
tu me météorite
[…]
je te langue
je te nuque
je te navigue
je t’ombre je te corps et te fantôme
je te rétine dans mon souffle
tu t’iris
je t’écris
tu me penses
30Cette créativité linguistique permet de redéfinir les relations entre les êtres aimés et de proposer de nouveaux rapports au corps en créant des néologismes verbaux : la signification des noms, adverbes et adjectifs convertis en verbes se voit comme rafraîchie et vivifiée. Luca procède par conversion (dérivation impropre, implicite ou zéro) de nom (ou adjectif ou adverbe) à verbe, ce qui est un procédé morphologique courant de formation d’unités lexicales69. Ce procédé est d’ailleurs annoncé dans le poème « APOSTROPH’APOCALYPSE » :
Et l’on passe
de « passe » chose
en « passe » verbe
de la chose à la ch’ose
au silence qui
ose crier taire70
31Par ce procédé, le mot change de catégorie grammaticale sans aucune modification formelle mais il change de fonction syntaxique : ce changement de fonction ne pourrait-il pas être rapproché de la notion d’exaptation en biologie ? Le processus d’exaptation permet de penser les caractéristiques émergentes au sein d’un organe préexistant qui développe un usage pour lequel il n’a pas été spécifiquement créé71. D’ailleurs, Luca ne met pas de « s » à la deuxième personne du singulier au présent simple des verbes qui se rattacheraient au premier groupe – tu me faune(s), tu m’audace(s) –, affichant de la sorte l’origine nominale des verbes créés, étant donné qu’il ne les conjugue pas, n’allant pas au bout de la conversion.
32Comment analyser ce poème ? Que peuvent signifier les syntagmes « Je te transparente », « Tu me marée haute », etc. ? Dans ce poème synesthésique, le rôle des sens est, nous l’avons vu, primordial (tu me mirage, je te peau, je te clavecin, etc.), ainsi que la place de la nature (tu m’insecte, je te lune, tu me volcanique, etc.), celle de la sensation (tu m’extase, je t’ardente, etc.), du mouvement (tu m’oblique, je te navigue, etc.). Comme l’indiqua Mallarmé, « il faut penser de tout son corps, ce qui donne une pensée pleine et à l’unisson72. » Dans le poème, noms, adjectifs et adverbes deviennent des verbes transitifs directs qui relatent des actions exercées sur l’autre, selon un rapport direct, où ces néologismes se chargent d’un sens renforcé. Il s’agit par cet effet de retrouver l’immédiateté de la sensation vécue évoquée par ces verbes inventés. Luca apporte de la tension dans la compréhension et joue sur l’équilibre tensionnel garanti par la grammaire dans la linguistique de la parole73. Par ailleurs, la répétition des pronoms je te et tu me donne une impression d’intimité entre le locuteur et la langue qui prennent corps ensemble, libérés de toutes les entraves. Luca invente ici sa propre langue – « je te délivre, je te délire » – à la limite de la folie. Pour reprendre les mots de Michel Collot :
La relation arbitraire que la langue établit entre le phonème et le sens tend à brouiller cette correspondance entre propriétés articulatoires, qualités sensibles et motions pulsionnelles. Mais la poésie, dans sa tendance à remotiver le signe linguistique, retrouve cette possibilité de symbolisation réciproque du sens, de la sensation et du fantasme74.
33La singularité de l’expression permet de sublimer la relation amoureuse ; la subversion envers la langue (par la conversion) permet d’atteindre une subjugation de l’autre, de l’aimée, par la conjugaison. En apportant de l’étrangeté et de la nouveauté dans la manière de dire la relation, Luca ne se perd pas dans un amour fusionnel mais enrichit au contraire le principe d’altérité dans la langue75.
34Ainsi, par le changement délibéré de classe grammaticale, le poète place le lecteur dans une position déconcertante d’incertitude sémantique où le sens du verbe lui est méconnu (tout comme sa valence d’ailleurs), posant de ce fait la question de la compétence du destinataire à comprendre l’énoncé (en tant que locuteur doté d’un lexique et ayant intégré les règles syntaxiques). Si le poème est toujours porteur de sens, celui-ci est donné dans une sorte d’instabilité sémantique due au non-respect de la grammaire, le contexte discursif étant altéré ou corrompu. Le poète écrit en langue « étrangère », tel un « barbare » au sens étymologique, exposant volontairement une langue « monstrueuse » de façon contraire aux conventions. Le lecteur se retrouve alors dans un état d’errance sémantico-syntaxique – qui serait l’équivalent en linguistique de l’« errance physicochimique » en biologie76 – au sein d’un espace sémantique qui n’est plus partagé car indéterminé, c’est-à-dire virtuel et non pas actualisé. Luca est bien conscient que sa démarche rend son expression méconnaissable :
Mes mouvements
n’ont pas la grâce axiomatique
du poisson dans l’eau
du vautour et du tigre
ils paraissent désordonnés
comme tout ce qu’on voit
pour la première fois
Je suis obligé d’inventer
une façon de me déplacer
de respirer
d’exister
dans un monde qui n’est ni eau
ni air, ni terre, ni feu
comment savoir d’avance
si l’on doit nager
voler, marcher ou brûler77
35Il invente une façon de s’exprimer, ni poisson dans l’eau, ni humain dans l’idiome consensuel auquel tout locuteur est habitué – comme on dirait « dans son élément ».
Du milieu à l’Umwelt discursif
36Dans sa quête de redéfinition de l’amour en générant de nouveaux verbes à partir de mots existants appartenant à une autre classe grammaticale, Luca se place au cœur du débat entre nominalisme et réalisme (platonisme) et pose la question de la relation entre le monde des idées et l’expérience sensible qu’il tente d’exprimer par la langue. Pour envisager cette relation, nous aimerions recourir à la double analogie entre être parlant et être vivant, et entre espace sémantique et milieu, en partant d’une citation de Pichot78 visant à circonscrire la notion de vie79 :
Du fait qu’il est le produit d’une évolution disjointe de celle de l’environnement, l’être vivant se trouve dans un état d’« errance physico-chimique » au sein de celui-ci (il ne lui est pas relié directement selon les lois physico-chimiques). Il doit alors organiser ses relations (physico-chimiques) avec cet environnement : sélectionner certains de ses éléments avec lesquels il interagira, et coordonner ses actions et réactions avec ces éléments sélectionnés (bien souvent, les relations que l’être a avec chacun d’entre eux n’est possible que grâce à celles qu’il a avec les autres au même moment ; ce qui donne au comportement un aspect de totalité). De la sorte l’être vivant se constitue, au sein de l’environnement, un milieu extérieur structuré auquel il se relie par un comportement structuré. À une errance physico-chimique dans l’environnement (laquelle conduit tôt ou tard à la disparition de l’entité errante) est substituée une action comportementale déterminée au sein d’un milieu extérieur (constitué et structuré de la sorte). Et ce comportement fait partie intégrante de la disjonction d’évolution.
37Il est possible d’envisager l’analogie suivante : le milieu extérieur est à l’environnement, pour l’être vivant, ce que l’épistémè (non pas au sens de Foucault80, mais plus simplement en tant qu’ensemble des connaissances et discours – scientifiques, religieux, juridiques, littéraires, etc. – propres à une communauté linguistique), est à la sphère du pensable, du dicible, pour l’être parlant. Ce dernier se constitue, au sein de cette sphère du dicible, un espace sémantique structuré (une conception du monde véhiculée par des discours) auquel il se relie par un comportement structuré, c’est-à-dire des actes langagiers. À une errance sémantique et syntaxique dans l’immensité de la sphère du dicible (laquelle conduirait à l’incommunicabilité) est substituée une action comportementale déterminée d’une part par la grammaire – entendue dans son sens global et prescriptif d’ensemble de règles syntaxiques, phonétiques et morphologiques permettant la communication – et le dictionnaire – ensemble du lexique admis – et, d’autre part, par des valeurs morales au sein d’un espace signifiant (constitué et structuré par des règles linguistiques et des conventions sociales). Cet espace pourrait être qualifié d’Umwelt discursif, en reprenant le terme d’Umwelt tel que l’a défini Uexküll81 – « concept clé de la biosémiotique qui réfère au fait que chaque espèce, que chaque individu au sein de chaque espèce, perçoit son environnement en fonction de ce qui lui est significatif aux fins de sa survie et d’après les sens que lui confère son anatomie82 ». Cet Umwelt serait donc le monde subjectif médié par la langue d’un être parlant et de sa communauté linguistique, c’est-à-dire la manière de percevoir et d’interpréter des énoncés. Il serait alors déterminé par les capacités linguistiques de l’être parlant. Selon nous, cet Umwelt discursif a rapport à l’espace cognitif selon Dubreuil83, là où le domaine du dicible (pas encore signifié ou dit mais potentiellement signifiable donc dicible) ressort à l’espace intellectif. D’une certaine façon, à la manière dont Merleau-Ponty s’intéressait au « visible » et à l’« invisible », nous nous intéressons ici au dicible et à l’indicible. En outre, l’errance fait référence à la notion de possibilisme : en géographie, pour Vidal de la Blache84, un même milieu naturel est susceptible d’exploitations et d’appropriations diverses selon les techniques, les valeurs et donc les choix des humains qui y habitent.
38Selon la perspective de cette analogie, ajoutons quelques commentaires sur le poème « Prendre corps ». Ainsi commence le poème : « Je te flore / tu me faune ». Et ainsi se conclut-il : « Je t’écris / tu me penses ». Quelle importance et quel sens donner à ces syntagmes ? « Je te flore / tu me faune » : s’agit-il de comprendre que l’humain végétalise la langue, la faisant apparaître, éclore et s’épanouir telle une plante, ou comme la nature, sous des formes variées, et que la langue, en retour, animalise l’humain, le rappelle sans cesse à son corps physique et sensible, le ramène à sa condition d’être vivant, animal qui se meut dans le milieu, en quête de signe à percevoir ? Ces vers font écho à un passage de L’Inventeur de l’amour : « Si j’avance ma main / vers le sein de l’aimée / je ne suis pas étonné / de le voir soudain / couvert de fleurs85. » Quant aux deux derniers vers, « Je t’écris / tu me penses » : il ne s’agit pas ici pour le poète d’écrire à la femme-langue mais bien de l’écrire, le pronom « te » non pas COI mais COD comme dans la formule « tu me penses ». Le poète lui donne une forme sensible et tangible, la rendant manifeste, et en retour, la langue pense le poète, et non pas au poète, elle le fait tout simplement exister. Elle le conçoit, dans un équilibre dynamique entre la parole et la créativité expressive, entre la capacité des sons à générer du sens pour le locuteur et l’effort créatif du poète à renouveler la langue elle-même. C’est la relation réciproque entre langue et locuteur qui est ici illustrée : ce que le poète fait à la langue et, réciproquement, ce que la langue fait au locuteur.
39La poésie peut donc influencer l’Umwelt discursif du simple fait d’inventer des néologismes, en y ajoutant des signes à percevoir. En participant d’une « extension modale86 », entendue – dans le cas de son application à l’Umwelt discursif – comme capacité à comprendre un répertoire de mots appartenant à un domaine signifiable particulier, ici celui de la langue française, le poète contribue, nous dit Gaspar, à « trouver les mots et les formes qui nous paraissent justes pour exprimer ce qui est en mouvement dans le corps et dans la pensée87 ». Il donne ainsi une forme à la langue, lui donnant métaphoriquement un corps.
Médiance linguistique
40Ce que nous venons de décrire peut être rapproché de la médiance, définie par le géographe et philosophe Augustin Berque comme « le moment structurel instauré par la bipartition, spécifique à l’être humain, entre un corps animal et un corps médial88 ». Le concept de médiance est étroitement lié à celui de « milieu » (la mésologie) qui désigne l’environnement dans lequel les êtres humains vivent et interagissent. Selon Berque, la médiance est une relation dialectique entre l’homme et son environnement, un processus dynamique et créatif, qui implique une interaction constante. Berque distingue deux formes de médiance : la médiance technique qui désigne la manière dont les êtres humains utilisent la technique pour façonner leur environnement (projection), et la médiance symbolique (introjection) qui désigne la manière dont ils donnent un sens à leur environnement à travers des symboles, des mythes et des représentations. Il nomme ce mouvement dialectique la « trajection » : projection technique (dans notre cas, une capacité linguistique à structurer l’Umwelt discursif en tant que milieu) et introjection symbolique89 (l’Umwelt discursif, en tant qu’espace sémantique extérieur, est intériorisé et fait ainsi sens pour le locuteur). Puisqu’il exprime la manière dont l’être parlant va déterminer et façonner son Umwelt, c’est-à-dire la langue telle qu’elle se manifeste par des discours, tout en intériorisant les significations venant de cet espace sensible, Gherasim Luca peut donc être qualifié de poète de la médiance linguistique, en ce sens qu’il illustre la logique trajective énoncée par Berque, dans un mouvement continu entre noèse – activité mentale, poïétique – et noème – ce qui procède de la noèse et en même temps la fonde, de manière poïématique90.
41Il reste à comprendre comment cet Umwelt discursif est structuré, et il l’est par la communauté linguistique, l’usage qui fait la règle et les instances normatives.
Droit, régulation et subversion : « le possible de langue »
« Je m’oralise91 »
42La communauté linguistique décide elle-même de ce qui appartient à sa langue (via l’Académie française notamment) et de ce qui ne lui appartient pas. Elle trace donc une limite arbitraire dans un flux de mots et d’idées et décide que ce qui se trouve à l’intérieur de cette limite est le système ouvert qu’est la langue (ce qui se trouve à l’extérieur est inacceptable, à cause d’une agrammaticalité ou d’une asémanticité). L’expression transgressive de Luca, par la conversion verbale, semble inacceptable mais cette transgression ne peut-elle pas devenir variation ?
En ce qui concerne la langue, une variante est, pourrait-on dire, une transgression qui a réussi. Si, à notre époque, cela s’avère être très fréquent dans le domaine lexical, il n’en est pas de même sur le plan syntaxique où les erreurs d’hier demeurent, le plus souvent, les fautes d’aujourd’hui92.
43La question est donc de savoir quelle variation peut être sélectionnée par la communauté ? Et pour comprendre la possibilité de cette sélection, une analogie avec la biologie de l’évolution est éclairante : comme dans le vivant, où les mutations génétiques qui introduisent des variations dans le patrimoine génétique peuvent être sélectionnées (la sélection naturelle favorise les traits génétiques qui augmentent la survie et la reproduction des organismes), les variations linguistiques (nouveaux mots, changements de prononciation, évolution de la grammaire) qui facilitent la communication ou répondent à de nouveaux besoins sociaux peuvent être adoptés ou rejetés par les locuteurs ; en biologie, il y a un équilibre entre la conservation des traits génétiques utiles et l’innovation par mutation, tandis qu’il existe en linguistique un équilibre entre la conservation des structures linguistiques traditionnelles et l’innovation par création de nouveaux mots et expressions.
44C’est donc le droit qui préside à la structuration de l’Umwelt discursif. Citons Viangalli :
Dans la mesure où toute norme juridique s’exprime en effet par la langue, et repose fondamentalement sur elle, cette dernière est intimement liée au pouvoir. Réciproquement, toute langue repose intrinsèquement sur un ensemble de normes et de conventions communes, sans quoi l’efficacité de la communication pour laquelle elle a été conçue est irrémédiablement compromise, et suppose par conséquent un système normatif qui en garantit et protège l’usage93. […] L’homme a naturellement peur du changement, lorsque ce dernier peut remettre en cause sa situation présente et constituer à ce titre un défi d’adaptation. La volonté de fixer la langue par des règles s’explique fondamentalement par cette angoisse de la perte de contrôle94.
45Comme l’énonce Jakobson :
La grammaire est un véritable ars obligatoria, comme disaient les scolastiques ; elle impose des décisions par oui ou non. […] les concepts grammaticaux d’une langue donnée orientent l’attention de la communauté linguistique dans une direction déterminée, et, par leur caractère contraignant, influencent la poésie, les croyances et même la pensée spéculative95.
46Dans ce sens, Dubreuil précise : « Nos routines cognitives sont garanties par des règles d’organisation morphosyntaxiques. Le langage verbal humain dissémine encore le savoir et l’interrogation, il renforce nos appétences logiques, il transmet et il configure les ordres sociaux96. » Gherasim Luca est bien conscient de cet état de fait : « je m’oralise », lance-t-il, en mettant en évidence l’inséparabilité fondamentale de l’expression linguistique et du caractère moral de toute prise de position par le langage, à la fois moyen d’une expression singulière mais surtout instrument nécessaire au maintien des rapports sociaux, à l’intégrité de la société et à la cohésion sociale. Ainsi, pour se comprendre en partageant la même langue et éviter toute confusion et toute incompréhension, la condition est le respect des règles qui régissent le fonctionnement du code linguistique. Le propos du poète peut être transgressif tout en respectant la grammaire (L’Inventeur de l’Amour) mais est-il acceptable quand il la transgresse (« Prendre corps ») ?
Ces femmes évadées
que les apparences
la rue et les coutumes
tentent de dénoncer
comme les folles du village97
47Revenons sur le poème « Prendre corps ». On pourrait qualifier la façon de s’exprimer de Luca de pathologique, manifestant un trouble du langage, une dysphasie. Notons d’ailleurs que Deleuze qualifia Gherasim Luca de « grand poète parmi les plus grands : il a inventé un prodigieux bégaiement, le sien98 », en faisant référence au poème passionnément99 et à la nécessité qu’il fallait « parler dans sa langue à soi comme un étranger ». L’expression de Luca est-elle finalement compréhensible et acceptable ? Le milieu qu’il nous propose est-il habitable ? D’après Vignola :
[…] la capacité de l’être humain à forger son Umwelt selon sa volonté propre peut-elle lui sembler infinie en raison des possibles que permet l’usage des formes symboliques, elle reste tout de même limitée par les réalités biologiques et physiques de notre espèce et de notre environnement terrestre100.
48Il nous faut compléter en ajoutant que cette volonté est limitée par les réalités langagières : ce que je peux comprendre et dire (en fonction, d’une part, de ma maitrise de la langue, mais aussi, d’autre part, d’un droit qui me serait accordé). Et Vignola de poursuivre : « À travers l’usage de mots propres à une langue donnée s’affirme le caractère arbitraire de la langue qui fonde sa conventionnalité101 ». Ce caractère arbitraire renvoie au fascisme de la langue tel que formulé par Barthes : « la langue, comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire ni progressive ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire102. » Le concept de fascisme de la langue met en lumière la manière dont le langage peut être utilisé pour exercer un contrôle et maintenir des structures de pouvoir :
[…] la sémiologie étant conçue par Barthes comme un moyen d’analyser et donc de résister à la production mythique de la langue, le fascisme de la langue devient non pas une conclusion mais la problématique même de cette sémiologie. En permettant de déjouer les obligations syntaxiques, de fuir les énoncés affirmatifs, d’ajouter les sous-entendus connotatifs et de mythifier le mythe, la littérature sera le lieu même de cette résistance discursive ; […] la littérature, pensée comme le lieu d’un déplacement discursif permanent, peut résister devant ce figement103.
49Le « fascisme de la langue » exercé sur le locuteur se mue chez Luca en fascination envers la langue et devient même l’objet de l’écriture poétique :
avec un dégoût que je finis par ignorer
je me meus parmi ces figures toutes faites
connues à l’infini104
50La célèbre phrase de Wittgenstein – « Que le monde soit mon propre monde, voilà qui se montre dans le fait que les limites de mon langage (du seul langage que je comprenne) signifient les limites de mon propre monde105 » – trouve ici son implication : ce que nous pouvons dire et penser est limité par les capacités de notre langage. Le langage détermine les frontières de notre compréhension et de notre expérience du monde, de notre Umwelt discursif. Par conséquent, les limites de ce que nous pouvons exprimer dans le langage sont également les limites de ce que nous pouvons comprendre du monde. Et Luca ne s’y résigne point : si Wittgenstein conclut le Tractatus en affirmant que ce qui ne peut être dit doit être passé sous silence – « ce dont on ne peut parler, il faut le taire106 » –, le poète quant à lui s’aventure dans la sphère du dicible pour y faire exister, au-delà des limites connues du langage, de nouveaux signifiés ; il « ose crier taire107 ». Concernant ces limites, mentionnons que le poème « Prendre corps » constitue les deux premières parties du texte intitulé « LA FIN DU MONDE », où il est évident qu’il faut entendre le substantif « fin » à la fois comme limite et finitude, mais aussi comme finalité.
on nous interdit
à l’aide du bon sens, de la modestie
et du rationalisme, toute tendance
à nous dépasser et à briser
nos propres limites108
Médiance et remédiation : combler les lacunes de la langue
51On se retrouve finalement sur la ligne de crête entre le désir de revitaliser la langue dominante et figée perçue comme une oppression (Viangalli) et la nécessité d’obéir à la grammaire et d’user d’un certain lexique. En outrepassant ces normes, Luca élargit-il le signifiable en créant des signifiants nouveaux et en exerçant la « puissance démiurgique de la dénomination » telle que Frath la conçoit109 ? Par ailleurs, respecte-t-il le génie de la langue ? « Une langue […] ne saurait changer sa syntaxe qu’en changeant son génie. Un barbarisme heureux reste dans une langue sans la défigurer ; des solécismes ne s’y établissent jamais sans la détruire110 », disait Chateaubriand. Ainsi, il ne s’agit pas pour Luca de désintégrer la langue, ni de la corrompre, mais au contraire de renforcer son intégrité en l’enrichissant, en remédiant à ses lacunes, au risque d’être incompris.
52Comme l’écrit l’écrivaine Madeleine Gagnon, « [l]a parole déstructurée agresse les structures » et « [l]’idéologie bourgeoise dominante passe d’abord par le langage. Seuls les fous qui le décodent et le discordent le savent. Et l’éprouvent. L’ordre grammatical, lexical, syntaxique, stylistique, protège autant que les asiles. Autant que les prisons. Les fous sont des prisonniers politiques111. » La folie apparaît alors comme une modalité de subversion. Luca s’exprime donc avec folie, hors de tout purisme de la langue, car il insuffle le changement et, ce faisant, engendre une conscience métalinguistique du fonctionnement de la langue112.
53Pour finir, citons Hérout :
[…] s’ils peuvent [les énoncés] actualiser une potentialité de la langue, c’est en allant chercher, au-delà de l’usage ordinaire de la langue, des lieux stratégiques où l’instabilité pourra être introduite de manière fructueuse. […] les anomalies ou monstruosités dans la langue provoquent un acte de lecture différent qui génère aussi de la signification. C’est bien l’imagination qui va établir la transition entre tout ce qui est possible et attesté en langue, et ce qui est potentiel, encore impossible mais en gestation113.
54Luca écrit :
Ces corps de femmes dynamités par moi
fragmentés et mutilés
par ma soif monstrueuse
d’un amour monstrueux
ont enfin la liberté de chercher
et de trouver hors d’eux-mêmes
le merveilleux du fond de leur être114
55Sans origine ni destination – « le mot / atome renversé / sans fin ni commencement115 » –, la langue évolue et cette évolution procède de l’énaction116 au sens de la cognition située (couplage entre le locuteur et l’Umwelt discursif). C’est ainsi que l’on comprend que l’intercompréhension entre locuteurs d’une même communauté linguistique permet à cette communauté non seulement de s’organiser dans l’espace mais aussi de se perpétuer dans le temps, de se reproduire. Du point de vue synchronique, l’intercompréhension intragénérationnelle est à l’humain ce que la communication (échanges d’informations, de signaux, par exemple sous forme de phéromones, de cris, de chants, de sécrétion, d’excrétion, etc.) est aux êtres vivants non humains : l’existence d’un code de communication spécifique. D’un point de vue diachronique, l’intercompréhension intergénérationnelle est à l’humain ce que l’interfécondité entre membres d’une même espèce est aux êtres vivants : le transfert d’un code génétique commun d’une génération à l’autre d’un côté, la transmission d’un patrimoine linguistique et d’une compétence discursive (à la fois référentielle et cognitive), voire d’un « milieu anthropologique117 », de l’autre. La possibilité de reproduction entre deux membres d’une espèce, tout comme celle d’hybridation des discours (s’inspirer d’auteurs différents en faisant dialoguer leurs pensées, si différentes soient-elles mais formulées selon la même syntaxe et avec le même lexique, à partir de la même grammaire et du même dictionnaire) est le critère de perpétuation, soit de l’espèce, avec des organismes et leurs comportements qui peuvent évoluer, soit de la langue, avec des discours et des opinions qui peuvent aussi évoluer.
si dans ce fragment de seconde
où l’on exécute n’importe quoi
sur le corps de l’aimée
ne se résolvent pas dans leur totalité
nos interrogations, nos inquiétudes
et nos aspirations les plus contradictoires
alors l’amour est en effet
ainsi que le disent les porcs
une opération digestive
de propagation de l’espèce118
Faire vivre la langue
56Dans l’œuvre de Luca, la cruauté revendiquée et la transgression linguistique assumée n’ont pas pour but d’embarrasser le lecteur mais bien de régénérer la langue et, par-là même, de renouveler le sens de l’existence en œuvrant à la signifiance. Résolument tourné du côté de la vie, l’auteur de L’Inventeur de l’Amour n’a d’autre ambition que de vivifier l’idiome et d’exprimer ce qui est tu par une langue figée. En mettant des mots sur l’immotivé, sa langue donne à voir de nouvelles formes, elle dit ce que l’ouïe n’a encore jamais entendu : l’inouï. Loin de profaner la langue, il la consacre en l’enrichissant afin d’assouvir l’insatiable besoin de sens dont l’accessibilité n’est possible qu’en élaborant des formes perceptibles par le recours à la langue.
57En se faisant intermédiaire entre le signifié en puissance et le signifiant en acte, selon une raison linguistique trajective, Luca engendre un élargissement de l’Umvelt discursif. Cette intermédiation, telle une maïeutique, entre « la femme non-née » – la langue en perpétuelle devenir – et ces « corps de femme » – représentations multiples et concrètes de la langue – permet à Luca de libérer la force brute de la langue par la création poétique. Il s’ébat dans et avec la langue, à la fois contre elle, dans un élan de révolte subversive, et tout contre elle, dans un attachement régénératif : il s’agit de lui faire « prendre corps », de donner une forme singulière à ces interactions linguistiques, selon un comportement déstructurant-restructurant, au sein d’un Umwelt discursif dès lors poétiquement constitué, en réinventant l’amour pour la signification dans une langue éperdue.
58La poésie de Luca permet donc de considérer la langue de chaque être parlant comme un corps auquel il faut donner forme au sein d’un Umwelt discursif, ce milieu propre aux êtres parlants, dans lequel ceux-ci perçoivent des signes en fonction de leurs capacités sensorielles (ouïe pour entendre et vue pour lire) et cognitives (maîtrise de la langue, capacité à interpréter) ainsi que de leurs besoins spécifiques (raconter, expliquer, etc. et, chez Luca, renouveler le rapport au monde).
59Cependant, pourrions-nous tous, locuteurs d’une langue commune, modeler notre Umwelt de manière personnelle, à la manière du poète, en lui permettant de s’épanouir au point de le voir nous échapper à cause d’un éventuel foisonnement pléthorique et sans risquer de sombrer dans l’incommunicabilité ? La perpétuation de l’Umwelt discursif commun, dont le caractère partagé est une modalité indispensable au mode d’existence d’une communauté linguistique, ne saurait en effet tolérer de trop grandes divergences dans l’expression des individus qui la composent.
1 Maxime Del Fiol, Lorand Gaspar Approches de l’immanence, Paris, Hermann, coll. « Vertige de la langue », 2013, p. 298.
2 Ibid.
3 André Pichot, Histoire de la notion de vie, Paris, Gallimard, 1993.
4 Augustin Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 1987.
5 Héros limite suivi de Le Chant de la carpe et de Paralipomènes, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », no 364, 2001, p. 288-298.
6 Raphaëlle Hérout, « Penser le possible de langue, en linguistique et en poésie », dans Franck Neveu, SHS Web of Conferences, dir. Peter Blumenthal, Linda Hriba, Annette Gerstenberg, Judith Meinschaefer et Sophie Prévost, Volume 8 (2014), 4e Congrès mondial de Linguistique française, Berlin, Allemagne, 19-23 juillet 2014, p. 2783-2793.
7 Charlène Clonts, Repères biographiques – Salman Locker / Gherasim Luca, ALTER (Arts / Langages : Transitions et Relations), Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2016.
8 L’Inventeur de l’Amour suivi de La Mort morte, Paris, José Corti, 1994, p. 111. Ci-après abrégé en IA.
9 Maurice Mourier, La Quinzaine littéraire, 1998, repris sur www.jose-corti.fr/titres/inventeur-de-l_amour.html, page consultée le 04 février 2025.
10 IA, p. 37.
11 André Velter, préface à Héros-Limite, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2001, p. I-XVI.
12 Voir la référence en note 8.
13 Héros limite suivi de Le Chant de la carpe et de Paralipomènes, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », no 364, 2001. Ci-après abrégé en HL.
14 IA, p. 21.
15 Concernant l’interrogation sur la nature de l’objet de la linguistique en général et sur la métaphore organiciste en particulier, se reporter à l’ouvrage de Carita Klippi, La vie du langage. La linguistique dynamique en France de 1864 à 1916, Lyon, ENS Éditions, 2010, coll. « Langages », 464 p.
16 Lorand Gaspar, Approche de la parole, Paris, Gallimard, NRF, 1978, p. 27.
17 Le concept d’Umwelt, introduit en éthologie par J. von Uexküll, a été ensuite utilisé par la philosophie et l’anthropologie. Voir Camille Chamois, « Les enjeux épistémologiques de la notion d’Umwelt chez Jakob von Uexküll », Tétralogiques, no 21, 2016, p. 171-194.
18 Xavier Coumoul, Le Métabolisme cellulaire, Paris, Dunod, 2023.
19 « Contre-créature, Le Triple », dans HL, p. 65.
20 « HÉros-limite », dans HL, p. 15.
21 « L’écho du corps », dans HL, p. 68.
22 Henri Meschonnic, La Rime et la Vie, Lagrasse, Verdier, 1989, p. 208.
23 Amr Helmy Ibrahim, « Le fonctionnement des langues : paradigme du vivant ? », Épistémocritique, vol. 13 : « Littérature et savoirs du vivant », 2014.
24 Ces sept types de traces sont : irrégularité aléatoire au sein d’une régularité systémique ; combinatoire au résultat complexe et imprédictible malgré des constituants simples et des règles de combinaison élémentaires et peu nombreuses ; imbrication des systèmes et vocation à intégrer l’hétérogénéité ; stratégies d’adaptation : transformations, translations, restructurations, reformulations, reconfigurations, métamorphoses et exaptation ; redondances généralisées ; émotion commandée par la forme ; pouvoir de transposition et de simulation.
25 Ibid.
26 HL, p. 299-304.
27 Gherasim Luca et Dolfi Trost, Dialectique de la dialectique, Postface de Luc Mercier, Montréal, La Sociale, 2011 [1945].
28 Comme dans un liquide où les molécules se meuvent par roulement, à la différence d’un gaz dont les molécules peuvent translater selon un mouvement aléatoire, ou d’un solide où elles ne peuvent que vibrer.
29 Charlène Clonts, Repères biographiques – Salman Locker / Gherasim Luca, ALTER (Arts / Langages : Transitions et Relations), Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2016.
30 Carlat rappelle que « Luca quitte cependant l’Université après deux ans. Cette formation n’est pas sans susciter toutes les rêveries possibles sur la relation “chimique” du poète à la substance matérielle du langage » (Gherasim Luca l’intempestif, Paris, José Corti, 1998, p. 22). Nous pensons toutefois que cette formation a pu influencer le poète.
31 Luigi Rizzi, « L’étude du langage est à la croisée de nombreuses discipline », entretien, 13/09/2023, sur le site du Collège de France, https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/etude-du-langage-est-la-croisee-de-nombreuses-disciplines, page consultée le 4 février 2025.
32 Francesco Varela, Le Cercle créateur. Écrits (1976-2001), Paris, Seuil, 2017.
33 « Hermétiquement Ouverte », dans HL, p. 51.
34 « Apostroph’apocalypse », dans HL, p. 262.
35 « Contre-créature, La Morphologie de la Métamorphose », dans HL, p. 62.
36 David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens, Paris, La Découverte, 2013 [1997], p. 112.
37 Giovanni Rotirati, « Perspectives psychanalytiques du regard : Gherasim Luca et l’éternel féminin. Corps de langage et corps de femmes dans l’évolution poétique roumaine de l’artiste », Alkemie, Revue semestrielle de littérature et philosophie, 2014-2, no 14, Classiques Garnier, p. 315-324.
38 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973.
39 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, 1979, p. 178.
40 IA, p. 45-46.
41 HL, p. 288-298.
42 IA, p. 12.
43 IA, p. 20.
44 IA, p. 52-53.
45 HL, p. 70.
46 Nicholas Edward Hauck, L’Inhumain poétique : Ghérasim Luca et Henri Michaux face à la « crise » de l’humain, thèse de philosophie, University of Toronto, 2018, p. 165.
47 « Apostroph’apocalypse », dans HL, p. 254.
48 IA, p. 40-41.
49 Isabelle Turcan, Persée, vainqueur de la « nuit hivernale » ou le meurtre de Méduse et la naissance des jumeaux solaires Chrysaor et Pégase, Études Indo-européennes, 1989, p. 5-17.
50 IA, p. 30.
51 IA, p. 7.
52 André Velter, Ghérasim Luca : passio passionnément, éd. Jean-Michel Place, 2001, p. 11.
53 IA, p. 23.
54 Octavio Paz, L’Arc et la Lyre, Paris, Gallimard, NRF essais, 1965 [1956], p. 41.
55 IA, p. 48-49.
56 « Pégase » dans Trésor de la Langue Française informatisé, Dictionnaire en ligne, https://www.cnrtl.fr/definition/pégase, page consultée le 29 novembre 2024,
57 Sous le regard de Méduse. De la Grèce antique aux arts numérique, éd. Emmanuelle Delapierre et Alexis Merle du Bourg, In Fine Editions d’Art, 2023.
58 Paul Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque. Étude psychanalytique, Paris, Payot, 1952, p. 109.
59 Gherasim Luca, Sept slogans ontophoniques, Paris, José Corti, 2008, p. 57.
60 IA, p. 17.
61 HL, p. 189-198.
62 Dominique Carlat, Ghérasim Luca l’intempestif, Paris, José Corti, 1998, p. 206.
63 Catherine Desprats-Péquignot, « Correspondances sexe/visage et sang génital », Champ psychosomatique, no 40, 2005, p. 115-133.
64 « Hermétiquement ouverte », dans HL, p. 54.
65 Gaston Bachelard, L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris, José Corti, 1990 [1943], p. 8.
66 « Sécrétion » dans Trésor de la Langue Française informatisé, Dictionnaire en ligne, www.cnrtl.fr/definition/sécrétion, page consultée le 1er septembre 2025.
67 Ce poème existe dans une version mise en musique et interprétée par Arthur H, disponible sur Internet.
68 Stéphane Mallarmé, « Divagation première Relativement au vers », dans Vers et Prose, Perrin et Cie, 1893, p. 192.
69 Delphine Tribout, Les Conversions de nom à verbe et de verbe à nom en français, thèse de linguistique, Université Paris Diderot (Paris 7), 2010, 347 pages, p. 3.
70 « Apostroph’apocalypse », dans HL, p. 251.
71 Stephen Jay-Gould, Elisabeth S. Vrba, « Exaptation – a missing term in the Science of Form », Paleobiology, vol. 8, no 1, 1982, p. 4-15.
72 Stéphane Mallarmé, Lettre à Eugène Lefébure, 23 mai 1867, dans Correspondance, Lettres sur la poésie, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, « Folio-Classique », 1995, p. 353.
73 Julio Murillo Puyal, «“ Il reste beaucoup à faire.” Hommage à Petar Guberina », dans Actes du colloque Francontraste 4, Conceptualisation, contextualisation, discours, Tome 1 : Sciences du langage, Mons, Cipa, 2025, p. 11-38.
74 Michel Collot, L’Horizon fabuleux, vol. 1, José Corti, 1988, p. 123.
75 Comme le rappelle Catherine Desprats-Péquignot : « une relation d’amour aboutie, vivable, suppose que soient maintenues de l’altérité, de la différence, un minimum de discorde, et que l’idéal du “faire un”, qui continue à être la visée de l’amour, reste une affaire de discours, de parole d’amour (« Du “faire un” de l’amour », Cahiers de psychologie clinique, no 19, 2002, p. 49-65).
76 André Pichot, Histoire de la notion de vie, op. cit., p. 950.
77 IA, p. 9-10.
78 Chargé de recherche en histoire et philosophie de la biologie au CNRS (Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie – UMR 7117 CNRS / Nancy-Université), André Pichot est notamment l’auteur de Petite Phénoménologie de la connaissance, Aubier, 1991 ; Histoire de la notion de gène, Flammarion, 1999 ; Aux origines des théories raciales, de la Bible à Darwin, Flammarion, 2008 ; Expliquer la vie, de l’âme à la molécule, Quae, 2011.
79 André Pichot, Histoire de la notion de vie, op. cit., p. 950.
80 Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966.
81 Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot & Rivages, 2010 [1934], p. 33-40.
82 Gabriel Vignola, « Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en littérature », Cygne noir, no 5, 2015, p. 11-36, https://doi.org/10.7202/1089937ar, page consultée le 1er septembre 2025.
83 Laurent Dubreuil, « Le poème, le penser », dans Langue et science, langage et pensée, dir. Jean-Noël Robert, Paris, Collège de France / Odile Jacob, 2020, p. 231.
84 Vincent Berdoulay, « Le possible chez Vidal de la Blache », Revisiter la pensée de Paul Vidal de la Blache, Cahiers de géographie du Québec, vol. 66, nos 184-185, avril-septembre 2021, p. 153-162.
85 IA, p. 20.
86 Camille Chamois, « Les enjeux épistémologiques de la notion d’Umwelt chez Jakob von Uexküll », op. cit., p. 184.
87 Lorand Gaspar, « Vivre et écrire », dans Apprentissage, Paris, Deyrolle, 1994, p. 49
88 Augustin Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 1987, p. 206.
89 Ibid., p. 208.
90 Ibid., p. 245.
91 Ghersasim Luca, Je m’oralise, Paris, José Corti, 2018, 72 p.
92 Berthille Pallaud, « De la transgression à la variation », Marges linguistiques, no 2, 2004, p. 76-87, p. 85.
93 François Viangalli, « La norme juridique et la langue : histoire d’une intimité renforcée », Sens Public, 2015, p. 2, https://doi.org/10.7202/1043632ar, page consultée le 1er septembre 2025.
94 Ibid., p. 18.
95 Roman Jakobson, « La notion de signification grammaticale selon Boas », dans Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de Minuit, 1959 [1963], p. 201-202.
96 Laurent Dubreuil, « Le poème, le penser », op. cit., p. 232.
97 IA, p. 49-50
98 Gilles Deleuze, « Un prodigieux bégaiement sur le style ! », extrait de Gille Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977.
99 HL, p. 168-176.
100 Gabriel Vignola, « Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en littérature », art. cité.
101 Ibid., p. 24.
102 Roland Barthes, Œuvres complètes, Tome I-V, textes établis par Éric Marty, Paris, Seuil, 2002, p. 432.
103 Hessam Noghrehchi, « Le fascisme de la langue », Littérature, no 186, Armand Colin, 2017/2, p. 42.
104 IA, p. 13.
105 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Paris, Gallimard, 1961, p. 142.
106 Ibid. p. 177.
107 « Apostroph’apocalypse », dans HL, p. 251.
108 IA, p. 35-36.
109 Pierre Frath, « La puissance démiurgique de la langue », Studii de Lingvisticà, vol. 13, no 1, 2023, Editura Universatàtii din Oradea, p. 207-221.
110 Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, t. 2, 1848, p. 702, cité à l’article « barbarisme » du TLFi, https://www.cnrtl.fr/definition/barbarisme, page consultée le 1er septembre 2025
111 Madeleine Gagnon, Autographie 1. Fictions, Montréal, VLB, 1982 [1962-1979], cité dans l’appel à contribution sur « La folie » de la revue Chameaux (page consultée le 4 février 2025), Université Laval.
112 Rhéa Delveroudi et Spiros Moschonas, « Le purisme de la langue et la langue du purisme », PhiN, Philologie im Netz, no 24, 2003, p. 1-26, p. 7.
113 Raphaëlle Hérout, « Penser le possible de langue, en linguistique et en poésie », op. cit., p. 2791-2792.
114 IA, p. 44.
115 HL, p. 267.
116 Francisco J. Varela, Evan Thompson et Eleanor Rosch, The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge Massachusetts, MIT press, 1992.
117 Pierre Frath, « La langue comme milieu anthropologique », La linguistique, vol. 59(2), 2023, p. 27-53, https://shs.cairn.info/revue-la-linguistique-2023-2-page-27?lang=fr, page consultée le 1er septembre 2025.
118 IA, p. 19.
Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024, publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 36, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2083.html.
Quelques mots à propos de : Alexis Messmer
Chaire de langue française
Université de Zagreb
Alexis Messmer est Lecteur de français à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Zagreb. Il a étudié la géographie physique et sociale à l’Université de Caen et les sciences du langage à l’Université de Rouen. Ses recherches portent sur la matérialité de la langue par le recours aux transferts conceptuels entre les sciences du vivant et de la matière et les sciences du langage.
Publications :
Normativnost oranja (La normativité du labour, 10 poèmes en croate), dans TEMA, 1-3/2023, Zagreb, p. 64-72.
« Concevoir une hydricité de la langue par le prisme d’analogies conceptuelles (physique, géographie et biologie) », Actes du colloque Francontraste 4, Conceptualisation, contextualisation, discours, Tome 1 : Sciences du langage, Mons, Cipa, 2025, p. 193-204.
