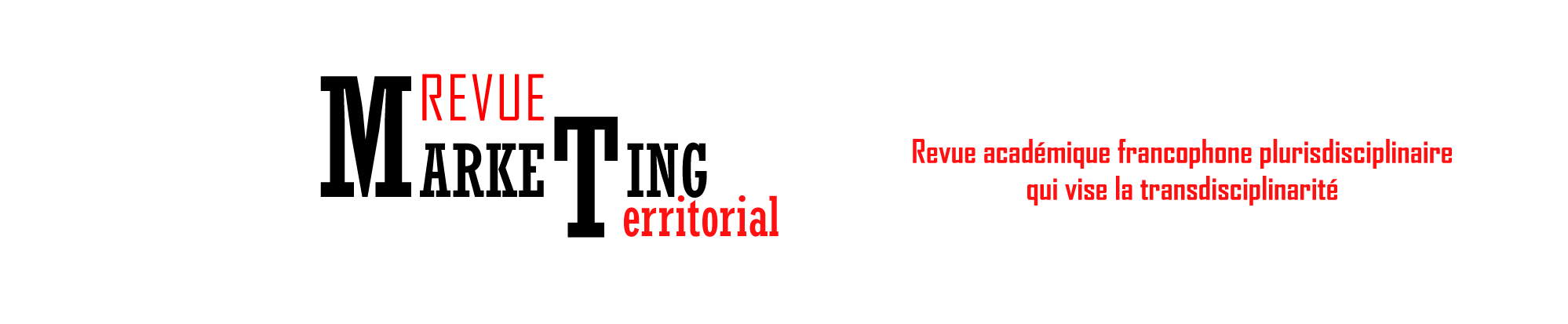Sommaire
7 / été 2021
Le Havre, vers la métropole portuaire ?
- Editorial
- Charles-Edouard Houllier-Guibert, Marie-Laure Baron et Olivier Desplebin Le Havre, vers la métropole portuaire ?
- Articles
- Nathalie Aubourg, Erwan Boutigny, Pascale Ezan et Corinne Renault Rôle de l’Université dans la constitution d’un écosystème d’innovation territoriale : le cas Le Havre Smart Port City
- Patricia Sajous et Sarah Dubeaux Petite histoire du terme de métropole à l’aune de la construction intercommunale : Le Havre face à son développement territorial
- Marie-Laure Baron Le développement d’un corridor logistique se traduit-il par le déploiement de stratégies collectives entre les entreprises ?
- Xiao Liu Des écosystèmes à la dynamique collective : une étude des zones touristiques du Havre et de Honfleur
- Synthèses
- Charles-Edouard Houllier-Guibert Les tournages audiovisuels dans le décor havrais
- Antoine Kauffmann Résumé de thèse. De la gouvernance portuaire havraise vers la gouvernance de corridor : conséquences organisationnelles
- Alexandre Faure Le Havre et le Grand Paris : une cohérence géographique certaine pour un engagement politique volatile
- Image et Territoire
- Bénedicte Martin et Muriel De Vrièse Le street art comme objet de marketing territorial : entre institutionnalisation et instrumentalisation
Le street art comme objet de marketing territorial : entre institutionnalisation et instrumentalisation
Bénedicte Martin et Muriel De Vrièse
À travers l’exemple havrais de la « chasse aux Gouzous », œuvre du graffeur Jace dans le cadre initial de la manifestation des « 500 ans du Havre », nous interrogeons les conséquences de l’institutionnalisation du street art via une collectivité territoriale. Opportunité de visibilité pour l’artiste, vecteur d’attractivité et outil de stratégie marketing pour la collectivité, le dispositif parait a priori gagnant-gagnant. L’hypothèse est celle d’une absence de convention constitutive, d’un accord préalable sur ce qu’est le street art, contre-culture plutôt que genre de l’art, et sur la manière de le valoriser. Les intérêts divergents des parties concernées (artiste d’un côté, collectivité de l’autre), en l’absence de cet accord initial, ne peuvent que glisser de l’institutionnalisation du travail de l’artiste vers l’instrumentalisation de ses œuvres au service du marketing territorial.
In this study, we are going to deal with the impact of institutionalisation of street art via a local authority through the production of Jace, a graffiti artist from Le Havre whose work “Catch me if you (spray) can” was released on the occasion of Le Havre 500th anniversary in 2017. Working hand in hand can be considered as a favorable deal for both the artist and the local authority since it offers an interesting opportunity of visibility to the first and an efficient marketing strategy tool to the latter that can be used as a way to add value the area. In this article, this hypothesis is that of a lack of preliminary agreement between the very purpose of street art i.e a form of anti-establisment art and its promotion which can be considered as a mere decoration by the public. Considering the absence of any prior agreement, the differing interests of both parts (on one side the artist and on the other the local authority) can only lead to the institutionalisation and exploitation of the artist and his work for territorial marketing purposes.
1Comme de nombreux anciens bassins industriels, Le Havre a engagé sa mutation. Pour cela, les décideurs politiques ont cherché, entre autres, à redorer l’image de la ville, très souvent décriée, parfois moquée1 (Gravari-Barbas et Renard, 2010). L’une de leurs stratégies a consisté à enclencher cette transformation par le levier de la culture et du tourisme. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco de 2005 pour son architecture et son urbanisme d’après-guerre, la ville, administrée à l’époque par Antoine Rufenacht (maire de 1995 à 2010), puis par Edouard Philippe (2010 à 2017), a engagé des investissements en faveur de la culture et du tourisme, parmi lesquels la célébration de l’anniversaire des 500 ans de la ville en 2017. À cette occasion, de nombreux projets artistiques et culturels sont lancés, dont l’appel à un graffeur, Jace pour intervenir dans le domaine public. La réalisation de la commande de 50 œuvres, mettant en scène les personnages emblématiques de l’artiste, les Gouzous, s’est vite transformée en un jeu de piste, « Catch me if you (spray) can » (plus communément appelée la « Chasse aux Gouzous ») invitant les habitants et les touristes à trouver les œuvres en parcourant la ville.
2Jace, artiste autodidacte né au Havre et vivant depuis son enfance à la Réunion, a depuis les années 1990 réalisé des graffitis dans plusieurs villes, en particulier au Havre, sans autorisation de la Mairie. La littérature sur le street art2 est largement documentée sur ce point : l’illégalité ainsi que la dimension contestataire de la démarche des artistes constituent des piliers du mouvement. Or, dans le cas de la « Chasse aux Gouzous », Jace répond à une commande publique, en proposant une production artistique s’inscrivant dans la légalité, perdant dès lors l’une des caractéristiques majeures de ce qui fait l’essence du street art. Dès lors, le travail de l’artiste, autorisé, et donc légitimé, par la Mairie, perd-il de sa légitimité pour les acteurs des mondes de l’art ? La commande de la Mairie, et donc l’institutionnalisation supposée du travail de l’artiste par la collectivité engendre-t-elle des conséquences sur la reconnaissance et la qualification de ses œuvres ? Pour répondre à ces questions, notre méthodologie s’appuie sur l’examen de l’exemple Havrais au regard de la littérature existante à la fois sur le street art, la géographie urbaine, le marketing territorial et l’économie des conventions. Nous nous appuyons également sur l’analyse du discours des acteurs (artiste/ collectivité) dans les documents officiels (site web municipal, dossier de presse) et médiatiques (articles de presse, réseaux sociaux...) pour mettre en exergue leurs objectifs, parfois divergents, dans ce projet. En outre, nous comparons l’exemple Havrais avec celui de Nantes/ Saint-Nazaire pour mettre en avant une certaine uniformisation des pratiques.
3Notre étude s’articule en trois temps. Nous présenterons d’abord les formes de requalification de la Ville du Havre par la culture, et plus spécifiquement dans l’appel à un graffeur. Nous verrons ensuite que le street art, dans ce cas précis, peut être envisagé comme un outil de marketing territorial. Enfin, nous terminerons en étudiant le glissement de l’institutionnalisation du travail de l’artiste par la Ville vers son instrumentalisation, conduisant à une disqualification possible de son travail par les acteurs du monde de l’art contemporain.
Ilustrations 1. Des graffitis plus ou moins célèbres

1. La requalification de la Ville par la culture
4Nombre de chercheurs en géographie et en urbanisme ont souligné la fonction de l’art dans les processus de construction ou de reconstruction des espaces urbains (Grésillon, 2002, 2004, 2008 ; Gravari Barbas, 2013 ; Guinard, 2014 ; Kullmann, 2015). La problématique havraise est en cela très typique de toutes les villes industrialo-portuaires en déclin (Nantes/ Saint-Nazaire, Dunkerque, Marseille) dont la stratégie de requalification a consisté en une spécialisation culturelle plus ou moins réussie : les villes recherchent leur « effet Bilbao » (Plaza, 1999, 2000, 2009 ; Panerai, 2014 ; Baudelle et al., 2015).
5Il n’est pas tant question pour les collectivités de la valeur économique générée par les manifestations et équipements culturels, l’impact économique de la culture étant sujet à de nombreuses polémiques quant à la robustesse de ses indicateurs, le fameux coefficient multiplicateur des dépenses culturelles variant de 3 à 10 selon les situations (Nicolas 2007 ; Negrier et Vidal 2009 ; Teillet, 2019). Il s’agit davantage d’une valorisation symbolique, de l’image renouvelée, d’une identité nouvelle dont se pare la ville et qu’elle met au service d’un nouvel imaginaire la réhabilitant aux yeux de ses habitants comme des non-résidents (Le Gallou, 2018). Ce nouveau récit reconstruit la mémoire de la ville et lui offre de nouvelles possibilités de développement touristique.
1.1. Stratégie de repositionnement de la Ville du Havre
6Le cas de la stratégie de patrimonialisation de l’architecture et de la reconstruction du Havre (Gravari-Barbas et Renard, 2010) débute au milieu des années 1990, lorsque l’équipe menée par A. Rufenacht saisit l’enjeu que représente un classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est alors que se dessine, a fortiori à partir de 2005, une nouvelle image de la ville, un nouveau récit dont les principaux conteurs, souvent des touristes, sont étrangers au territoire. Les projets urbains seront dès lors appuyés sur cette nouvelle dimension symbolique qui reformule une autre identité territoriale, moins vécue toutefois qu’énoncée. L’arrivée d’E. Philippe à la tête de la Mairie ne fera que renforcer cette dynamique. Dès 2010 se tiennent les Assises de la culture, opération renouvelée un an après, où la Ville invite des personnalités extérieures, acteurs de la culture dans des territoires industrialo-portuaires similaires au Havre, comme Fabrice Lextrait3, ancien administrateur de la friche La Belle de Mai à Marseille, ou Jean Blaise4, acteur important de la vie culturelle nantaise, directeur du « Voyage à Nantes ».
7Les assises de 2011, intitulée « Le Havre, ville créative », sont l’occasion de présenter les grands projets culturels prévus par la ville, c’est-à-dire 77 propositions pour l’horizon 2017, année de l’anniversaire de la création de la Ville du Havre, en plus de la création de cinq nouveaux lieux :
-
la restructuration du site Niemeyer, le Volcan, avec le réaménagement de la salle de la scène Nationale et l’intégration d’une médiathèque dans le forum Niemeyer
-
la création de deux lieux culturels dans l’ancien fort militaire de Tourneville en ville haute, soit le Tétris, scène de musiques actuelles et les nouveaux locaux CEM (le Sonic intégrant des studios de répétition, et le déménagement de l’école de musique dans les anciennes réserves du Museum d’histoire naturelle)
-
l’Electro nouveau lieu de culture et de création dans les quartiers Sud (projet abandonné depuis)
-
un cinéma « art et essai » sur le site du cinéma Le Sirius.
1.2. Le Havre, ville créative ?
8De nombreux décideurs politiques (élus municipaux) et économiques se sont appropriés rapidement la thèse de Florida (2005), fondée sur une approche du capital créatif d’une classe éduquée et favorisée socialement (la classe créative) comme levier de promotion du développement économique d’une ville (exemple de Baltimore, Toronto). Se mettent alors en place de nouvelles stratégies territoriales basées sur une différenciation, via la création, dans un contexte de concurrence des territoires. On retrouve, au Havre un certain nombre de politiques urbaines qui appartiennent au registre de la ville créative, entendue davantage comme stratégie que comme catégorie, identifiées par Vivant (2009) : d’abord la création de nouveaux équipements culturels, énoncés plus haut, ensuite la présence d’une architecture spectaculaire conçu par un architecte de renom (mise en valeur des bâtiments Perret, du site Niemeyer, et appel à J. Nouvel5) et enfin l’organisation d’évènement culturel et festif qui permette d’inscrire le territoire dans les destinations touristiques culturelles (500 ans du Havre qui deviendront l’évènement annuel « Un Eté au Havre »)6. Si Le Havre tente de s’emparer du concept de Ville créative, elle ne base pas son impulsion sur une classe créative locale, mais tient davantage à s’appuyer sur des compétences extérieures, en particulier en faisant appel à un directeur artistique nantais, Jean Blaise pour organiser les célébrations des 500 ans de la Ville et à une société parisienne, Artevia pour produire l’évènement. En outre, la programmation s’appuie très majoritairement sur le travail d’artistes non locaux, en particulier pour les installations d’œuvres sur le domaine public7 (« La ville révélée par les artistes »8). Les seuls artistes havrais, ou d’origine havraise, présents dans cette programmation d’art in situ sont la compagnie La Bazooka (Le Temple des 5000 vœux, au jardin japonais) et Jace (Catch me if you (spray) can) que la ville présentera comme un « graffeur havro-réunionnais » 9. L’histoire entre l’artiste et la municipalité avait pourtant mal commencé. Le 13 octobre 2015, « la brigade anti graffitis » de la Ville du Havre efface par erreur une fresque réalisée par plusieurs artistes revendiqués du street art parmi lesquels Jace. Ce dernier va s’en émouvoir sur les réseaux sociaux. La presse régionale et nationale va s’en faire l’écho, moquant la « méconnaissance », la « boulette », « la méprise » des agents de la ville mais par généralisation de la ville elle-même. Cette anecdote devient préjudiciable pour l’image du Havre, disqualifiée dans sa capacité à appréhender et valoriser le street art. Très rapidement, la Ville du Havre communique, s’excusant en offrant « sur un lieu à définir ensemble » une nouvelle opportunité d’expression aux artistes concernés. L’anniversaire des 500 ans de la Ville sera l’occasion de réparer le préjudice et d’en tirer parti.
2. Le street art, instrument de marketing territorial
9Pour saisir l’idée d’instrumentalisation du street art comme outil de marketing territorial par les collectivités territoriales en général, et par la Ville du Havre en particulier, il est indispensable de revenir sur la définition du street art. Ce terme, dont la paternité est attribuée au critique d’art A. Schwartzman (1985), est très discuté : est-ce exclusivement un ensemble de pratiques artistiques illégales ? Faut-il exclure toute œuvre qui ne soit pas « dans la rue » ? Faut-il ou non intégrer les graffitis ? Toutes ces questions révèlent en creux une difficile catégorisation de ce qu’est le street art, c’est à dire de ses conditions de production et de réception, et de la façon de le valoriser, autrement dit de son intégration sur le marché de l’art et/ou sa reconnaissance par les instances de légitimation, autrement dit celles qui sont en mesure de reconnaître et qui ont le pouvoir de dire « ce qui est art » et ce qui ne l’est pas.
10La définition du street art, dont la paternité est attribuée au critique d’art A. Schwartzman en 1985, est très discutée : est-ce exclusivement un ensemble de pratiques artistiques illégales ? Faut-il exclure toute œuvre qui ne soit pas « dans la rue » ? Faut-il ou non intégrer les graffitis ? Ces questions révèlent en creux une difficile catégorisation de ce qu’est le street art, c’est à dire de ses conditions de production et de réception, et de la façon de le valoriser, autrement dit de son intégration sur le marché de l’art ou sa reconnaissance par les instances légitimation (celles qui sont en mesure de reconnaître et qui ont le pouvoir de dire « ce qui est art » et ce qui ne l’est pas).
2.1. De l’illégalité à la légitimité : intégration et reconnaissance du street art
11Le street art recouvre des pratiques artistiques protéiformes réalisées dans la rue, dont les techniques sont variées (graff, pochoir, sticker, installation, collage, mosaïque). Il se développe dans les années 1970 aux Etats-Unis comme en France, et se présente souvent comme une culture underground (Génin, 2015) fondée initialement sur l’illégalité (œuvres produites dans le domaine public sans autorisation, le plus souvent la nuit) et une dimension contestataire forte. L’art urbain se distingue d’autres formes artistiques présentes dans l’espace public, comme le Land Art ou les œuvres acquises dans le cadre du 1% artistique. Il véhicule et transmet une identité, une représentation et participe à un autre discours. Génin (2015) considère le street art comme une culture et non comme un genre de l’art contemporain et c’est sans doute ce qui en fait un puissant levier de reconstruction de l’identité territoriale.
12Selon Lemoine (2012), le terme est utilisé par les acteurs du marché de l’art pour identifier positivement des œuvres qui, jusque-là, peinaient à être considérées comme de l’art. Il devient un mouvement artistique puisqu’il est reconnu par l’Histoire de l’art (Ardenne, 2011 ; Génin, 2013). Une fois intégré au marché et reconnu par les instances de légitimation (on en dénombre habituellement quatre sur les marchés de l’art : les musées, les galeries d’art contemporain spécialisées, les collectionneurs et les critiques ; Moulin, 1992 ; Moureau et Sagot-Duvauroux, 2006), il est nommé progressivement « art urbain ». Si la notion de street art est « protéiforme et évolutive » (Guinard et al., 2018), on trouve six critères communs pour désigner et regrouper les street artistes.
-
La gratuité des œuvre situées dans la rue, sur l’espace public. Tout le monde peut donc y avoir accès sans payer de droit d’entrée.
-
Les supports de l’œuvre qui peuvent être licites ou illicites. On observe à cet égard une hybridation des pratiques in/off pour une très grande majorité des artistes.
-
La présence d’un message contestataire, souvent vis-à-vis de la société de consommation, du système capitaliste...
-
La performance, en général dans la réalisation (hauteur des murs, emplacements des graffs…).
-
La qualification du modèle économique de base avec une diffusion de la performance ou de l’œuvre via les réseaux sociaux numériques. Landes (2015) parle de screen art.
-
La façon dont le street art s’intègre au marché de l’art, en modifiant ses supports. Le graff est retranscrit sur des toiles peintes, des installations, des photographies.
13Sur ces derniers points, Génin (2015) identifie deux grandes stratégies d’intégration pour les artistes du street art au marché de l’art. La première est l’art contemporain urbain qui transforme les inscriptions/ interventions sur des supports cessibles. Des lieux dédiés aux cultures urbaines ont été créés, des galeries d’art contemporain se sont spécialisées sur ce segment de marché depuis l’intégration par les musées de cette forme artistique (« Né dans la rue » Fondation Cartier 2009, « Tag », Grand Palais 2009, « The political Line » Musée d’Art Moderne 2013 par exemple). La seconde stratégie d’intégration repose sur l’interventionnisme in situ : conception d’œuvres en fonction d’un site dédié (le festival In situ d’Aubervilliers par exemple). Ce qui n’est pas explicitement souligné par Génin, c’est l’intervention indispensable d’une instance de légitimation, de reconnaissance appartenant au monde de l’Art (Moulin, 1992 ; Heinich, 1998, Moureau, 2000) et dont le statut d’expert confère à l’œuvre et à l’artiste une identité (« c’est de l’art ») et une qualité (ordonnée suivant le pouvoir de reconnaissance de chaque instance qui labellise). Ainsi, être légalisé, autrement dit avoir l’autorisation de graffer comme c’est le cas de Jace pour les 500 ans du Havre, ne délégitime pas en soi l’artiste, contrairement à ce que souligne Blanché (2015). En revanche passer de l’illégalité à la légalité (par l’autorisation communale) ne reconnait en rien le travail du graffeur comme artistique, et ne lui confère pas pour autant de légitimité dans le monde de l’art contemporain.
2.2. Le street art, vecteur d’attractivité des territoires
14Lorsqu’il est saisi par une collectivité territoriale, le street art peut être perçu comme un vecteur d’attractivité et de mise en tourisme des territoires (Mould, 2017). Pour se positionner dans une compétition globale, les villes mettent en œuvre des stratégies de différenciation, où la culture, par nature bien économique singulier, joue un rôle majeur à la fois en termes d’image et de représentation collective, mais aussi d’objet touristique singulier. Pour mener cette stratégie, le street art comporte un certain nombre d’atouts. D’abord, son caractère bi-face le destine simultanément à deux publics, deux cibles, les habitants et les touristes, n’ayant pas nécessairement le même type d’attentes. Ensuite, il permet une esthétisation du « délaissé urbain », les œuvres pouvant recouvrir des édifices abimés, améliorer l’existant à moindre coût. Le street art permet également d’organiser un parcours ludique orienté et mise en scène contrôlée. Il peut aussi être un vecteur d’image numérique grâce à la géolocalisation et participer ainsi à la mise en valeur de la ville par les réseaux sociaux, dans et en dehors du territoire.
15Le projet de réalisation des 50 Gouzous, présenté comme une commande municipale dans le cadre de la manifestation culturelle autour des 500 ans du Havre s’accompagne dès l’origine d’une chasse aux trésors dont l’objectif est de parvenir à identifier les lieux de réalisation, les photographier et les poster sur les réseaux sociaux. À la clé et en récompense, une œuvre signée de l’artiste. Ce jeu de piste n’est pas une particularité de la manifestation havraise, utilisée par les street artistes les plus célèbres depuis quelques années (Banksy via ses réseaux sociaux, Space Invader créant sa propre application...) comme par les collectivités dès lors qu’elles investissent dans cet art in situ (Paris, Montpellier). Ces chasses au trésor sont essentiellement des outils de promotion touristique qui permettent de développer un tourisme culturel ludique, familial qui n’est pas sans rappeler le géocaching, « jeu de piste numérique » déjà présent sur l’agglomération havraise (Vidal et al., 2017). Ce projet s’accompagne ainsi d’une forte dimension numérique qui inscrit la trace et l’empreinte géographique via la cartographie et qui a pour vocation, en utilisant les réseaux sociaux comme vecteur de communication, d’amplifier la visibilité des productions. Toutefois, contrairement à ce que les chercheurs observent souvent, à savoir que le street art institutionnalisé se déplace de la périphérie au centre, quittant la marge pour les espaces consacrés, il s’agit là dès l’origine de valoriser un parcours officiel, d’orienter les visites des habitants ou touristes selon un chemin qui sera celui de la manifestation officielle, que l’on retrouve dans les parcours choisis par la ville pour la manifestation10. Les œuvres de Jace se trouvent essentiellement sur ces parcours : « ils m’ont proposé de peindre 50 Gouzou un peu partout en ville pour rythmer les quatre parcours artistiques créés pour les festivités »11. La ville ne s’en cache pas : la visée stratégique de la commande est mise en avant dès la présentation de la programmation12.
16En résumé, et comme le soulignent Génin (2013, 2015), Blanchard et Talamoni (2018) ou Salomone (2018), l’artiste est ici contraint de s’adapter à la commande renonçant ainsi à l’un des principes fondateurs du street art : la liberté d’agir sur des supports et des objets urbains qu’il choisit (murs, panneaux…). Jace le reconnait d‘ailleurs : « Il a fallu trouver des spots dans le périmètre des quatre parcours d’Un Été au Havre puis leur faire correspondre des dessins que j’avais déjà plus ou moins esquissés »13. On peut donc supposer que ce n’est pas en vertu d’une forme de libéralisme politique que les communes autorisent des lieux, dédient des espaces, c’est aussi une forme de contrôle de la production artistique à des fins touristiques, ou d’animations culturelles. Au Havre, les œuvres de Jace ont majoritairement été placées sur des objets usuels et urbains, dans une visée d’amélioration de l’esthétique (l’escalier du MUMA excepté) : ils se retrouvent majoritairement au centre de la ville, sur des supports de second rang, délaissés, détériorés (figures 3 et 4). Par une opération de recouvrement, le street art participe donc à la requalification de ces objets, l’artiste devenant parfois, de plein gré ou non, un décorateur urbain. L’esthétisation de supports urbains dégradés est un vecteur promotionnel pour les pouvoirs publics sur un marché concurrentiel (des territoires/ des lieux de tourisme). « Les centres urbains sont toilettés, scénographes, disneyifiés en vue de la consommation touristique » (Lipovetsky et Serroy, 2013, p.49).
Illustration 2. Œuvres apposées sur du mobilier urbain

17Longtemps la ville du Havre a souffert d’une image décriée (Gravari-Barbas et Renard, 2010). A mesure que la patrimonialisation se construit, l’identité de la ville se modifie et le regard des visiteurs et touristes s’impose progressivement à tous. A ce point qu’aujourd’hui nombre de Havrais arborent des vêtements et accessoires de marque « LH » (à prononcer // L.A !), comme l’affirmation d’une fierté territoriale. Cette entreprise s’appuie d’ailleurs sur des artistes graffeurs, streeters, skatteurs, rappeurs… en résumé sur une culture urbaine revendiquée. Le facebook institutionnel de la municipalité reprend cet acronyme. Les interventions de Jace accompagnent un évènement culturel construit comme un moment privilégié de mise en récit d’un projet culturel dont l’objectif est plus de renouveler l’image de la ville que d’espérer des retombées économiques (Teillet, 2019). La manifestation autour des 500 ans du Havre est résolument tournée vers l’avenir de la Ville et la mise en tourisme à travers des œuvres plastiques et d’art vivant spectaculaire14. L’objectif pour les pouvoirs publics est de susciter un autre imaginaire15, de créer une mémoire collective façonnée par des interventions artistiques et plastiques d’envergure internationale. La stratégie marketing havraise n’est pas en ce sens très originale.
3. Institutionnalisation, instrumentalisation, disqualification
18L’institutionnalisation des œuvres de Jace, autrement dit la reconnaissance via une institution, est bien l’objet de la ville du Havre. C’est ainsi que Jace exprime l’origine du projet dans la presse quotidienne régionale. Dans son édition datée du 7 juillet 2017, Le Monde précise que la programmation des 500 ans du Havre s’est faite en collaboration avec l’ancien maire, Edouard Philippe. Il y a dans cette commande une ambiguïté persistante : d’un côté, Jace est intégrée à la programmation artistique de l’évènement confiée à un opérateur externe, de l’autre la Ville du Havre communique (sur son site dédié, sur le site institutionnel de la Ville) et revendique la paternité du projet. Cette ambiguïté révèle plus une instrumentalisation qu’une institutionnalisation. L’instrumentalisation du street art par les collectivités territoriales a été largement dépeinte (Sallenave 2017 ; Blanchard et Talamoni 2018 ; Salomone 2018), elle ne signifie pas forcément que les artistes sont manipulés à des fins politiques ou électoralistes mais plutôt que les pouvoirs publics utilisent le street art comme un instrument, le réduisant par la même à un outil au service d’un intérêt qui dépasse celui de la médiation et de la médiatisation culturelles ou artistiques. Pour certains, la pratique est si commune que le street art est devenu rapidement un instrument de la fabrique de la ville. Il n’est pas nécessaire de partager les mêmes objectifs pour qu’un accord stable, durable et profitable aux deux parties puisse être trouvé. Pour autant, cela nécessite au préalable un accord sur ce qui fait la valeur de l’échange, du bien considéré, ce que l’Economie des Conventions (Dupuy et al., 1989) nomme une convention constitutive. Pour le dire autrement, l’on peut avoir des intérêts différents, opposés, mais si chacun partage une même représentation de ce qui fait la valeur de l’art, de la manière de l’évaluer et de le valoriser. Il apparait évident qu’en l’espèce, l’artiste et la ville ont continué de fonctionner avec leurs codes propres à leurs espaces de valeurs, la difficulté étant que ces deux espaces ne se recouvraient pas, que la convention touristique qui outillait le comportement des acteurs publics n’était pas compatible avec la convention de qualité du street art. En conséquence de quoi, la requalification de la ville visée par la commande de la collectivité risque in fine de disqualifier l’artiste dans son monde, celui du street art.
3.1. La Ville du Havre, décor de création
19Lorsque les villes revendiquent une identité créative (Vivant, 2009) elles s’appuient sur des caractéristiques sociales et géographiques qu’elles organisent, valorisent pour dessiner une nouvelle représentation urbaine. Dans l’exemple du Havre, nous avons déjà souligné que la patrimonialisation avait été effectuée par les visiteurs extérieurs, les touristes (Gravari-Barbas, 2013) et la stratégie s’est renouvelée lors de l’organisation des 500 ans du Havre. Cette manifestation a été confiée à Jean Blaise, dont la personnalité connue des mondes de l’art et notamment des arts du spectacle, a été qualifiée « d’opérateur-entrepreneur » par Sagot-Duvauroux (2010). Ce dernier étudiant la réussite de la reconversion nantaise et tentant d’identifier les raisons du succès de ce renouvellement d’identité urbaine, Nantes étant aujourd’hui considérée comme la ville créative par excellence, souligne l’importance cruciale d’une proximité géographique d’entreprises créatives sur le territoire (un cluster) animé par des opérateurs-entrepreneurs chargés d’organiser des évènements et de tisser des liens internationaux. Le Havre toutefois ne dispose pas d’un écosystème similaire (Chantelot, 2009), si bien que la Ville n’a pas, ou peu, cherché en interne de collectifs d’artistes ou d’associations susceptibles de porter cet évènement. La commande a été passée à un opérateur extérieur chargé in fine de dupliquer les raisons du succès de Nantes « la belle éveillée ». Dès lors Le Havre parait proposer un décor dans lequel un opérateur met en scène des artistes internationaux, nationaux et pour une part minime locaux, selon des parcours ludiques et touristiques. Le street art vient en surplus, parachever la mise en tourisme culturel du territoire. La mise en récit de ce projet achoppe donc sur l’origine de la production, comment se revendiquer créative alors même que les ressources propres font défaut ? Pour reprendre l’analyse de Florida, cet évènement, porté par un opérateur extérieur, révèle d’une classe créative trop minoritaire sur le territoire (Chantelot, 2009). Ainsi, cet évènement reste un levier d’attractivité touristique indéniable, contribue à modeler la représentation de la Ville, son bâti mis en lumière, pour autant, les habitants sont les grands absents du récit.
3.2. De la différenciation à la l’uniformisation
20La stratégie de différenciation qui vise à investir la culture en général, le street art en particulier, ne peut engendrer une rente de monopole qu’à condition de créer un produit innovant, spécifique au territoire. Or, Le Havre n’a pas valorisé son capital créatif et la chasse aux Gouzous rappelle d’autres chasses aux œuvres, notamment celles des « Oides » de Saint-Nazaire, débutée en 2015, à l’initiative de Charles Cantin, artiste originaire de la ville. L’idée d’un circuit de visite touristique autour du street art est déjà ancienne. Elle s’est institutionnalisée à Grenoble, développée à Paris dans le cadre d’expositions dédiées au street art, et ne constitue plus aujourd’hui un produit innovant. Ce tourisme urbain, alternatif, est soit pris en charge par l’institution, au travers notamment de visites organisées par les offices de tourisme, soit par le marché avec le développement d’agences touristiques événementielles qui proposent des « street art tours ». Cette politique d’institutionnalisation par une collectivité et d’intégration par le marché correspond à un mouvement plus large, déjà identifié par Boltanski et Chiapello (1999), dénoncé par Lipovetsky et Serroy (2013) ou Mould (2017), d’une récupération capitaliste de la critique artiste. Le capitalisme comme l’institution ont cette capacité de se nourrir des critiques qui leur sont faites, de les intégrer dans un nouveau mode de production et de consommation les vidant simultanément de leurs contenus. Génin (2015) souligne que l’institutionnalisation du street art donne à voir une version « allégée, qui consiste (…) en un décor urbain pour donner une image à des façades mortes ». Ainsi les figures sympathiques Oides ou Gouzous véhiculent des messages bon enfant qui n’ont plus grand chose de politique. Cette institutionnalisation a donc pour conséquence une uniformisation des pratiques, de l’offre touristique, des évènements liés au street art, et aboutit à une uniformisation de l’offre culturelle urbaine.
Illustration 3. Des messages qui n’ont pas grand-chose de politique

3.3. L’artiste « papier peint », disqualifié par le monde de l’art contemporain
21Génin (2015) soulève les conflits qu’engendre l’instrumentalisation du street art au sein même de la communauté des street artistes. Considérés comme des « vendus » (passage du vandale au vendu), par des « puristes », la réponse à la commande publique n’est pas sans créer de discussion sur les effets d’une récupération politique d’un genre contestataire. Néanmoins, cette critique, émanant de la communauté artistique n’est pas propre au street art, elle traverse le monde de l’art contemporain, elle en est même constitutive. Heinich (1998) identifie les trois étapes de l’intégration de l’art contemporain : transgression des frontières de l’art par les artistes, rejet du public, intégration par les institutions, instances de l’art contemporain. Les limites se trouvent dès lors toujours plus repoussées à mesure que les premières sont intégrées à l’histoire de l’art consacrée. Ce n’est donc pas tant l’institutionnalisation qui soulève ici des débats et des critiques à l’endroit des artistes mais plutôt les conditions de réalisation des commandes et de l’identité même du commanditaire. Lorsque Ernest Pignon-Ernest colle ses fresques éphémères à Naples ou quand J.R installe le poing levé sur les containers du port du Havre, aucune autorisation n’est demandée à la ville ou aux autorités compétentes, l’installation a lieu la nuit et est dévoilée au public en même temps qu’aux collectivités. Pour autant, leurs œuvres sont immédiatement intégrées au marché de l’art : s’il n’est pas possible de les voir in situ dans le temps, des photographies sont produites et deviennent des œuvres. Cette intégration au marché est simultanée d’une institutionnalisation par les instances de reconnaissance du marché de l’art (Moulin, 1992 ; Moureau et al., 2006). Un artiste n’est reconnu qu’au terme d’un parcours d’épreuves artistiques organisées par des instances de l’art contemporain spécifiques (Martin, 2005) : critiques d’art, galeries d’art contemporain, conservateurs de musées ou centres d’art, collectionneurs. Une ville ou une métropole ne jouissent pas d’un pouvoir de reconnaissance équivalent à ce monde de l’art constitué qui partage une même représentation de la valeur de l’art, la même convention de l’art contemporain outillée par des codes de production, de représentation et de diffusion des œuvres. Les finalités du marketing territorial ne sont pas compatibles avec le paradigme de l’art contemporain, elles impliquent un registre de valorisation très éloigné de la grammaire de jugement mobilisée par ce monde de l’art.
22Dans une interview, Jace dit avoir aimé l’idée de décorer la ville. Ce motif décoratif est à l’opposé du registre mobilisé par l’art contemporain, il est même exclusif de ce monde de l’art dont le paradigme se construit en opposition aux précédents, et notamment à l’art classique voué à représenter le réel sur des supports permettant de décorer les intérieurs (Heinich, 2014). Bien avant la première édition d’Un Eté au Havre, des œuvres de Jace sont disponibles à la Galerie Hamon du Havre. Mais là encore, il s’agit d’une galerie ne disposant d’aucun pouvoir de reconnaissance dans le monde de l’art contemporain. Elle appartient au modèle des galeries commerciales16 ; en opposition aux modèles de galeries de promotion et de galeries tremplin (De Vrièse et al., 2011) et, en ce sens propose des objets artistiques davantage considérés comme des produits dérivés que comme des œuvres, à l’image des albums de coloriage de Gouzous qui y sont en vente.
« Le livre de coloriages vendu à la galerie Hamon marche très bien, mais j’essaie d’être modéré pour éviter que le Gouzou devienne un produit commercial. Ce n’est pas comme ça que je conçois mon art » (Jace dans une interview de 2018)17.
Conclusion
23Fondée initialement sur l’illégalité et sur une dimension contestataire dominante, le street art se présente davantage comme une contre-culture que comme un genre de l’art. Il se construit et se développe avec un certain nombre de codes et de normes qui sont incompatibles avec l’institutionnalisation qui peut être faite par les collectivités territoriales. Le cas précis de « Catch me if you (Spray) can » de Jace, œuvre réalisée dans le cadre des 500 ans de la ville du Havre, illustre parfaitement cette thèse. La démarche artistique est davantage un outil de marketing territorial et d’esthétisation du délaissé urbain pour la Ville qu’un outil de reconnaissance et de légitimation du travail de l’artiste dans et par le monde de l’art contemporain. Autrement dit, légalisation par les pouvoirs publics ne signifie pas pour autant légitimation par les mondes de l’art. En outre, la stratégie de différenciation des territoires par la mise en tourisme culturel des villes achoppe sur une conformité des propositions culturelles, comme nous avons pu le constater dans notre exemple entre Le Havre et Nantes. On assiste à une uniformisation des évènements, à une reproductibilité des propositions. La logique de contrôle des élus sur la production des artistes contrevient à celle de « ville artiste » et disqualifie de ce fait autant les œuvres que l’identité territoriale qu’ils essayent de modeler via cette instrumentalisation.
ARDENNE P. (2002). Un art contextuel : création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation, Paris, Flammarion, 254 p.
ARDENNE P. (2011). La rue est à moi ! in 100 artistes du street art. Paris, Ed. la Martinière, 240 p.
BAUDELLE G., KRAUSS G., POLO J-F. (2015), Musées d’art et développement territorial, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 228 p.
BECKER H. (1982), Les Mondes de l’Art, Paris, Flammarion, 384 p.
BLANCHARD S. (2017), « Street art, rénovation urbaine et gentrification dans le Nord-Est parisien : entre marketing urbain et gender mainstreaming », Urbanités [En ligne], n°9.
BLANCHARD S., TALAMONI R. (2018), « Street art et mise en tourisme de la métropole parisienne, des festivals aux street art tours », EchoGéo, 44, en ligne.
BLANCHE U. (2015), « Qu’est-ce que le Street art ? Essai et discussion des définitions », Cahiers de Narratologie, 29, en ligne.
BOLTANSKI L, CHIAPELLO E. (1999), Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Paris, Gallimard, 980 p.
CHANTELOT S. (2009), « La géographie de la classe créative : une application aux aires urbaines françaises », annales du XLVIe Colloque ASRDLF, Clermont-Ferrand, 6-8 juillet, p.89-108.
DE VRIESE M, MARTIN B., MELIN C., MOUREAU N. SAGOT-DUVAUROUX D. (2011), « Diffusion et valorisation de l'art actuel en région. Une étude des agglomérations du Havre, de Lyon, de Montpellier, Nantes et Rouen », Culture études, 2011/1 (n°1), p.1-16.
DUPUY J-P., EYMARD-DUVERNAY F., FAVEREAU O., SALAIS R., THEVENOT L. (sous la dir. de) (1989), Economie des conventions, Revue Economique, vol.40, n°2.
FLORIDA R. (2005) The Flight of the Creative Class: The New Global Competition For Talent, New York, Harper Business, 352 p.
GENIN C. (2013). Le street art au tournant. Reconnaissance d’un genre. Bruxelles, Ed. Les impressions nouvelles, 251 p.
GENIN C. (2015), « Le street art : de nouveaux principes ? », Cahiers de Narratologie, 29.
GRESILLON B. (2002), Berlin, métropole culturelle, Paris, Belin, coll. Mappemonde, 352 p.
GRESILLON B. (2004), « Le Tacheles, histoire d’un « squat » berlinois », Multitudes, n°17, p.147-155.
GRESILLON B. (2008), « Ville et création artistique. Pour une autre approche de la géographie culturelle », Annales de géographie, 2, n°660-661, p.179-198.
GRAVARI-BARBAS M., RENARD C. (2010), « Une patrimonialisation sans appropriation ? Le cas de l’architecture de la reconstruction au Havre », Norois, 217, p.57-73.
GRAVARI-BARBAS M. (2013), Aménager la ville par la culture et le tourisme, coll. “Ville-aménagement”, éditions Le Moniteur, Paris, Guinard, 158 p.
GUINARD P. (2014), Johannesurg : l’art d’inventer une ville. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 326 p.
GUINARD P., JACQUOT S., KULLMAN C. (2018), « Les valorisations territoriales et touristiques du street art », Echo-Géo, 44, en ligne.
HEINICH N (1998), Le triple jeu de l’art contemporain, collection Paradoxe, Paris, Editions de Minuit, 384 p.
HEINICH N. (2014), Le paradigme de l'art contemporain. Structures d'une révolution artistique. Paris, Gallimard, 373 p.
LANDES O. (2015), Street art et projet urbain, une mise en valeur croisée dans la ville en transition. Cahiers de narratologie, 29, en ligne.
LE GALLOU A. (2018), « Le street art entre valorisation informelle du territoire et logiques d’institutionnalisation », EchoGéo, 44, en ligne.
LEMOINE S. (2012), L’Art Urbain, Du Graffiti au Street art, Gallimard, Paris, 128 p.
LEXTRAIT F. (2000), Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets interdisciplinaires : une nouvelle étape de l’action culturelle, rapport remis à Michel Duffour, Secrétaire d’État au patrimoine et à la décentralisation culturelle.
LEXTRAIT F., KAHN F. (dir.) (2006), Nouveaux territoires de l’art, Paris, Éditions Sujet-Objet, 296 p.
LIPOVETSKY G., SERROY J. (2013), L’esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, 496 p.
MARTIN B. (2005), L’évaluation de la qualité sur le marché de l’art contemporain : le cas des jeunes artistes en voie d’insertion, Thèse de Doctorat, Paris 10.
MILON A. (1999). L’Étranger dans la ville, du rap au graff mural, Paris, PUF, 160 p.
MOULD O. (2017), Urban Subversion and the Creative City, London & N-Y, Routledge, 1ère ed. 2015, 206 p.
MOULIN R. (1992), L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion, 423 p.
MOUREAU N., SAGOT-DUVAUROUX D. (2006), Le marché de l’art contemporain, Paris, La Découverte, coll., « Repères culture communicatin », 125 p.
NEGRIER E., VIDAL M. (2009), « L’impact économique de la culture : réels défis et fausses pistes », Economia della cultura : rivista trimestrale dell’ Associazione per l’economia della cultura, SocietàEditrice il Mulino, 2009, p.487-498.
NICOLAS Y. (2007), « Les premiers principes de l'analyse d'impact économique local d'une activité culturelle », Culture méthodes, 1 (n°1), p.1-8.
PANARAI P. (2014), « L’effet Bilbao », Tous urbain, 4 (n°8), p.20-21
PLAZA B. (1999), “The Guggenheim-Bilbao Museum effect: a reply to Marıa V. Gomez ‘Reflective images: the case of urban regeneration in Glasgow and Bilbao’”, International Journal of Urban and Regional Research, 23, 3, p.589-592.
PLAZA B. (2000), “Evaluating the influence of a large cultural artifact in the attraction of tourism: the Guggenheim Museum Bilbao case”, Urban Affairs Review, 36, 2, p.264-274.
PLAZA B. (2008), “On some challenges and conditions for the Guggenheim to be an effective economic re-activator”, International Journal of Urban and Regional Research, 32, 2, p.506-517.
PLAZA B. (2010), “Valuing museums as economic engines: willingness to pay or discounting of cash flows?”, Journal of Cultural Heritage, 11, 2, p.155-162.
SAGOT-DUVAUROUX D. (2010), « La scène artistique nantaise, levier de son développement économique », Nantes, la Belle Eveillée, le pari de la culture, Les éditions de l’attribut, p.95-107.
SALLENAVE L. (2017), « Le Grenoble Street Art Fest, catalyseur d’images institutionnalisées et détournées. Enjeux discursifs et territoriaux », Urbanités, n°9, en ligne.
SALOMONE C. (2018), « Le street art à Naples. Entre pratiques informelles et instrumentalisation de l’art urbain : discours et stratégies d’acteurs », EchoGéo 44, en ligne.
SCHWARTZMAN A. (1985), Street art, Garden City : Dial Press, 110 p.
TEILLET P. (2019), « Les politiques culturelles deviennent-elles des politiques événementielles pour peaufiner leur image ? », Nectart, 2019/2 (N° 9), p.62-68.
VASLIN J. (2018), « Les espaces du graffiti dans les capitales touristiques : l’exemple de Paris et Berlin », EchoGéo, 44, en ligne.
VIDAL P., JOLIVEAU T., SANSY D., COUILLET A., JEANNE P. (2017), « Approche géographique du géocaching comme opérateur de lien territorial : une illustration havraise », cybergeo, 829, en ligne.
VIVANT E. (2009), Qu'est-ce que la ville créative ? Paris, Presses universitaires de France, 89 p.
1 « À peine cinq ans auparavant [le classement du patrimoine du Havre à l’Unesco en 2005], les journaux s’étonnaient de la décision de l’Unesco de classer « cette sinistre caricature de la reconstruction d’après-guerre, ce béton âpre, cette ville au carré » (Télérama, 12 octobre 2005). « L’Unesco est-elle tombée sur la tête ? » (Martin-Chauffier, 2005) s’interrogeait Paris-Match magazine. (..) Surnommée « Stalingrad-sur-Mer », traversée par la « Staline-allée » » (Gravari-Barbas et Renard, 2010, p.57)
2 Il n’existe pas de définition unique ou uniforme du street art. Cependant, nous entendons par « street art » un mode d’expression artistique qui s’exprime dans la rue ; il est devenu mouvement artistique à la fin du XXème siècle dès lors qu’il a été reconnu par les acteurs du monde de l’art. Il peut s’agir d’un graffiti, d’un pochoir, d’une peinture, d’une mosaïque, d’un collage, d’une affiche.
3 Fabrice Lextrait est à l’origine d’un rapport sur la requalification des friches industrielles en lieux culturels (2000, 2006).
4 Parmi ses activités à Nantes, les plus connus sont les suivantes : Jean Blaise y dirige d’abord le Centre de recherche pour le développement culturel (1987-1999), puis crée le Festival des Allumées (1990) avec l’aide de J-M Ayrault ; il participe ensuite à la requalification du lieu Unique qu’il dirigera à partir de 2000 ; il sera à l’origine de l’organisation de l’évènement culturel « Estuaire » en 2007, puis dirigera « le Voyage à Nantes » à partir de 2012 ; Edouard Philippe viendra le chercher pour intervenir aux Assises de la Culture en 2011 et lui proposera de diriger l’évènement « Un Eté au Havre » à partir de 2017.
5 Jean Nouvel a conçu la piscine « Le Bain des Docks » dans le quartier Saint-Nicolas, inaugurée en 208, et était en charge d’un projet de construction de tour signal, « La Tour Nouvel », dans le cadre d’un projet plus large de cité de la mer Odyssée 21, abandonné en 2013 en raison du coût proche de 100 millions d’euros.
6 A cette occasion, la Ville crée le Groupement d’Intérêt Public « Le Havre 2017 », qui regroupe la Ville du Havre et la Communauté d’Agglomération Havraise (dont E. Philippe est Maire et Président de ces dernières instances), Haropa (alliance entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris), la Chambre du Commerce et d’industrie Seine-Estuaire. Viendront s’ajouter par la suite la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime et l’Université du Havre. Edouard Philippe présidera le GIP, dirigé par Thomas Malgras, et la direction artistique sera confiée à Jean Blaise. Le GIP dispose d’un budget global de 20 millions d’euros pour l’ensemble de l’évènement, financements privés compris. La ventilation du budget administrée à chaque œuvre n’a pas été communiquée.
7 Les artistes dont les œuvres sont parsemés dans la ville sont Julien Berthier (Altoviseur à la gare SNCF et Love, love dans le bassin Vauban), Baptiste Debombourg (Jardins fantômes au Bassin du Roy), Félicie d’Estienne d’Orves (Vénus et Mars sur les cheminées EDF), Vincent Ganivet (Catène de containers sur le Quai Southampton), Franck Gérard (De rade en rade, 8 bars dans la ville), Surasi Kusolwong (Gold in the Cube, magasins rue de Paris), Lang/Bauman (Up#3 sur la plage), Karel Martens (Couleurs sur la plage, cabanes de plage), Chiharu Shiota (Accumulation of power dans l’église Saint-Joseph), Stéphane Thidet (Impactsur le bassin du commerce).
8 Dossier de presse de la présentation de « Un Eté au Havre, février 2017.
9 Dossier de presse de la présentation d’ « Un Eté au Havre », op. cit.. Jace est né au Havre et y a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans. Depuis, il vit et travaille à la Réunion. On trouve ses œuvres dans le domaine public depuis le début des années 1990.
10 Parcours 1 « La ville Perret », parcours 2 « Vers le Port », parcours 3 « Les escaliers », parcours 4 « Les Bassins ». Ces 4 parcours se trouvent en quasi-totalité dans le centre-ville élargi. Les œuvres de Jace se trouvent essentiellement sur ces parcours : « ils m’ont proposé de peindre 50 Gouzou un peu partout en ville pour rythmer les quatre parcours artistiques créés pour les festivités » (site de la ville du Havre, entretien avec Jace).
11 Site de la ville du havre, « entretien avec Jace ».
12 « Au fin fond d’une ruelle secrète. Dans un recoin perdu du port. Aux abords d’un terrain vague. Jace, Fameux graffeur havro-réunionais, va semer ses Gouzous (…) dans les coins les plus improbables, les plus surprenants, les plus stratégiques, de la ville. A la clef, des trophées et cadeaux pour ceux qui les débusquent en premier. Une chasse au trésor, orchestrée sur les réseaux sociaux, qui tiendra en haleine l’immense fan club des Gouzous, non sans ravir et surprendre les passants » (dossier de presse, « Un été au havre », février 2017).
13 Site internet de la ville u Havre, « Il est où le Gouzou ? ».
14 Pour Jean Blaise : « Le Havre, reconstruite dans les années cinquante par l’atelier de l’architecte Auguste Perret, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité en 2005, mérite à l’évidence de devenir une des destinations françaises les plus désirées du tourisme urbain. » (Communiqué de presse, op.cit., en avant-propos)
15 Pour Edouard Philippe : « Pouvoir fêter les 500 ans de sa fondation est une chance rare. En 2017, Le Havre a cette chance ! Une chance de poser un regard neuf, et peut-être un regard étonné, sur notre ville. Une chance de dire au monde ce que nous sommes et ce que nous savons faire. 2017 sera aussi la fête de notre identité. Une identité heureuse, qui ne se complait pas dans les regrets du passé (…) une identité optimiste porteuse de projets et d’avenir. » (Communiqué de presse, op. cit., en avant-propos).
16 « Les œuvres vendues ont une qualité objective qui ne nécessite pas de travail de certification particulier, soit parce que la qualité dépend de la facture de l'œuvre, soit que l'artiste dispose déjà d'une renommée établie. Cette réputation peut être régionale, nationale voire internationale et garantit un potentiel de marché plus qu'une légitimité artistique. Il n'est pas rare que ces galeries développent un art lié à leur région. » (De Vrièse et al., 2011, p.9)
17 Paris-Normandie, « Le Havre, un an après, que reste-t-il des Gouzous de Jace ? », 7 juillet 2018.
Bénedicte Martin et Muriel De Vrièse, « Le street art comme objet de marketing territorial : entre institutionnalisation et instrumentalisation » dans © Revue Marketing Territorial, 7 / été 2021
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/index.php?id=697.
Quelques mots à propos de : Bénedicte Martin
Maître de conférences en économie à l’Université Le Havre Normandie, membre du laboratoire EDEHN, ses travaux portent sur la construction collective de la qualité des œuvres et sur la reconnaissance des artistes sur le marché de l’art contemporain via une grille d’analyse conventionnaliste et à travers des enquêtes auprès des principaux acteurs du marché de l’art.
Quelques mots à propos de : Muriel De Vrièse
Maître de conférences en économie à l’Université Le Havre Normandie, membre de l’UMR IDEES, ses travaux portent sur l’économie de la culture, en étudiant à la fois les processus de reconnaissance des artistes qui participent à la formation des prix sur le marché de l’art, les mécanismes de reconversion des territoires industriels par la culture et la perception des publics de l’offre culturelle des territoires.