Sommaire
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
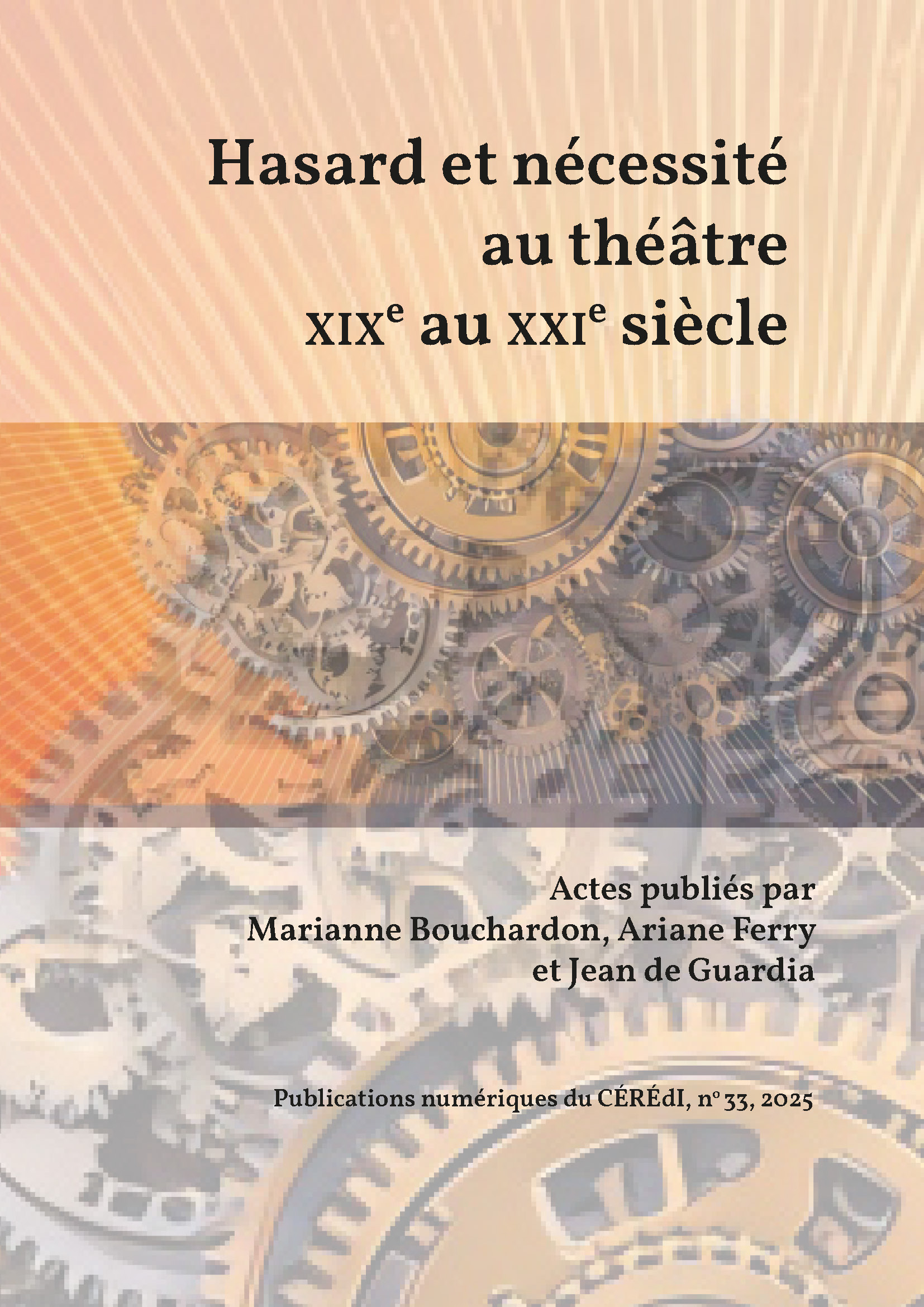
- Marianne Bouchardon, Jean de Guardia et Ariane Ferry Introduction
- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?
Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)
- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste
- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène
- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss
- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade
- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal
- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue
- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité
- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin
- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle
- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle
Delphine Edy
1Depuis quelques années, il existe sur les scènes européennes un véritable engouement autour de l’Œdipe Roi de Sophocle. Le metteur en scène anglais Robert Icke a proposé à l’été 2019 pour le Festival international d’Édinbourg un Œdipus très politique (en néerlandais) avec la International Theater Amsterdam Company1, une création qui a rencontré un vif écho médiatique et critique2. À Paris, Wajdi Mouawad a réalisé sa première mise en scène d’opéra avec Œdipe de Georges Enesco pour l’Opéra Bastille dont la première a eu lieu le 23 septembre 20213. Souvenons-nous par ailleurs que, déjà en 2003, Wajdi Mouawad proposait avec Incendies une « écriture-réécriture4 » d’Œdipe-Roi qu’il mettait en scène dans la version de Sophocle en 2014 au moment où il décidait de monter les sept tragédies parvenues jusqu’à nous. Enfin, Éric Lacascade a présenté avec sa compagnie un Œdipe Roi très remarqué au Printemps des Comédiens à Montpellier en mai 20225.
2Mais cet intérêt manifeste pour la tragédie de Sophocle ne s’arrête pas là et se retrouve également dans une double actualité : la parution en octobre 2021 de l’essai de Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable6, et la pluri-relecture de la pièce qui s’actualise dans des réécritures contemporaines, comme celles de Maja Zade ou de Tiago Rodrigues7, qui revendiquent un dialogue libre et ouvert avec l’hypotexte de la pièce antique.
3Michel Deutsch et Philippe Lacoue-Labarthe voyaient dans la traduction d’Hölderlin une « expérience unique » :
Hölderlin – Hölderlin traduisant Sophocle –, c’est une expérience unique (il n’y a jamais rien eu de comparable), et unique en ceci qu’au lieu de viser à imiter ou reconstituer la tragédie grecque, elle cherche au contraire à construire, en faisant fond précisément (et paradoxalement) sur l’étrangeté radicale et l’éloignement des Grecs, une tragédie moderne8.
4Les mises en scène récentes et les réécritures citées ont montré que la « tragédie moderne » continue à s’écrire dans les traces spectrales de l’Antiquité et questionne toujours et encore, comme Sophocle en son temps, la véritable nature de notre identité.
5D’ailleurs, lorsque William Marx affirme qu’« Œdipe est sans tombeau » et que la tragédie est aujourd’hui « au mieux un mirage », il défend bien une « idée de littérature […] en mutation perpétuelle » tout en affirmant que « la tragédie grecque sert de point de repère admirable pour rendre sensible cette évolution9 ». Bien sûr « Sophocle n’a pas écrit pour nous » et la recherche systématique d’un « message intemporel10 » dans les textes qu’il nous a laissés pose question. Mais ses textes ont une histoire : l’histoire d’Œdipe que Sophocle nous a laissée dans Œdipe Roi a parcouru les siècles jusqu’à nous et le fait que des auteurs contemporains choisissent toujours de s’inscrire dans ses traces mérite d’être interrogé et analysé car cela dit quelque chose de très profond de ce que nous sommes, de ce que nous voulons continuer à être, de ce dont nous ne pouvons visiblement pas nous détacher.
6C’est à deux de ces relectures et à leurs intersections et jeux d’échos, découverts ces dernières années et qui ne cessent d’étonner, qu’il s’agit ici de s’intéresser : celle de Pierre Bayard avec son essai et celle de Maja Zade avec sa pièce Ödipus, écrite à la demande de Thomas Ostermeier, le directeur artistique de la Schaubühne de Berlin, qui avait reçu pour commande de mettre en scène une tragédie grecque pour le Festival d’Épidaure. Tous deux choisissent en effet de tirer Sophocle et son texte Œdipe Roi dans le même sens, vers une nouvelle interprétation, en interrogeant les notions de destin et de nécessité au cœur de la tragédie et en suggérant que nous, lecteurs et spectateurs, nous sommes peut-être aveuglés depuis plus de deux-mille-cinq-cents ans. On mesure déjà ici les enjeux décisifs que cette piste suggère, à la fois pour l’histoire du théâtre et la réalité de la scène contemporaine mais plus encore pour notre compréhension du monde, d’autant qu’il y a quelque chose de profondément paradoxal à penser que, peut-être, Œdipe Roi pourrait être le lieu originel d’où l’on vient, une véritable matrice pour tout le théâtre occidental.
Opérations de cadrage
7Pierre Bayard a donc publié le 7 octobre 2021 un nouvel essai, Œdipe n’est pas coupable. Une provocation de plus, pourra-t-on se dire, après d’autres du genre. Pensons notamment à Comment parler des livres qu’on n’a pas lus (2007) qui a connu deux déclinaisons par la suite : Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? (2012) et Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ? (2020) ou Le Plagiat par anticipation (2009)11 dans lequel il pose comme une possibilité le fait de s’inspirer de créateurs qui ne sont pas encore nés, de sorte qu’il conviendrait de réécrire entièrement l’histoire de la littérature et de l’art, afin de mettre en évidence les véritables filiations et de rendre à chacun son dû. Se profilent donc d’autres questions dont une qui pourrait être formulée ainsi : qui donc Sophocle a-t-il plagié par anticipation ?
8Une fois déjà, Pierre Bayard s’était intéressé au monde spécifique du théâtre, avec Shakespeare dans Enquête sur Hamlet. Le Dialogue de sourds (2002). Dans les deux cas, Shakespeare et Sophocle, il a montré à l’aide de la méthode critique qu’il a élaborée tout au long de ces années, et qu’on appelle critique policière – l’une des sept branches de la critique interventionniste – que les coupables ne sont pas ceux que l’on croit. Évidemment, c’est pour certains tout à fait inacceptable, tant cela remet en question la réception de textes appartenant au patrimoine mondial de la littérature. Mais dans le cas d’Œdipe, il est quand même fortement troublant que la relecture de Pierre Bayard se soit doublée d’une relecture dramaturgique par l’autrice et dramaturge Maja Zade, qui convoque les mêmes hypothèses, sans qu’ils n’en aient jamais discuté.
9En effet, l’actualité de la nouvelle thèse de Pierre Bayard se trouve concomitante d’une autre actualité théâtrale. Le 3 septembre 2021, soit à peine un mois avant la parution de l’essai de Pierre Bayard, Thomas Ostermeier présentait au Festival d’Épidaure, l’un des plus anciens festivals de théâtre, qui se veut le relais de la tragédie grecque depuis 1955, une pièce de Maja Zade12, Ödipus, écrite pour l’occasion et qui se trouve être, son nom l’indique déjà, une réécriture de Sophocle. Et étonnamment, et sans qu’elle ait lu Pierre Bayard puisque l’essai n’était pas sorti et qu’ils ne se connaissent pas, elle propose une relecture dramaturgique de Sophocle dans ses traces. Puisque les coïncidences n’existent pas, il y a tout lieu de croire que quelque chose est « bien pourri au Royaume de Thèbes ».
10Le cadre étant posé, il s’agit à présent d’avancer en deux temps : d’une part, revenir sur les raisons qui montrent qu’Œdipe n’a pas pu tuer son père, en menant l’enquête dans le texte de Sophocle, et montrer comment cela réinterroge rétrospectivement les questions de hasard et de nécessité ; d’autre part, analyser la réécriture de Maya Zade – qui fonctionne comme un miroir de la lecture de Pierre Bayard – et la manière dont elle démonte et remonte la fable œdipienne.
Double enquête chez Sophocle
11Il n’est pas question ici de faire un compte rendu de lecture de l’essai de Pierre Bayard13, mais bien d’expliquer le contexte de cette enquête littéraire. Si j’ai été très sensible à son questionnement, c’est parce que, de mon côté, je nourrissais depuis longtemps de plus en plus de doutes au fil de mes relectures de l’œuvre, et l’analyse comparée de diverses traductions14 n’a fait que renforcer ces interrogations.
12Un constat initial s’impose : il y a bien trop d’incohérences dans le texte de Sophocle et ces incohérences engagent pleinement la réception de ce texte, car il apparaît très difficile de percevoir la logique de Sophocle comme nécessaire. Si j’ai longtemps pensé que c’était lié aux traductions du grec, j’ai bien été obligée de me ranger à l’évidence : quelque chose ne fonctionne pas dans le système de la pièce, de sorte que le texte de Sophocle résiste à sa réception classique qui fait du mystère des origines, du parricide et de l’inceste les fils dramaturgiques essentiels.
13Dès le début de la pièce, Créon affirme que, des assassins de Laïos,
tous sont morts, tous sauf un, qui a fui, effrayé, et qui n’a pu conter de ce qu’il avait vu qu’une chose, une seule… […] Il prétendait que Laïos avait rencontré des brigands et qu’il était tombé sous l’assaut d’une troupe, non sous le bras d’un homme15.
14Et la réaction d’Œdipe qui suit, bien trop souvent passée sous silence par la critique, est pourtant essentielle : « Des brigands auraient-ils montré pareille audace, si le coup n’avait pas été monté ici et payé à prix d’or16 ? » Deux éléments sont à souligner : d’une part, il y a urgence à s’interroger sur les raisons qui motivent ceux qui sont qualifiés de brigands, il faut un mobile, on ne tue pas un roi comme ça, et l’adverbe « ici » – présent dans les trois traductions17 – renvoie clairement au fait que le meurtre aurait été commandité de l’intérieur, dirait-on aujourd’hui.
15Par ailleurs, à l’époque de l’assassinat de Laïos, aucune enquête n’est menée : ce qui veut dire concrètement que le roi de Thèbes se trouve assassiné et que personne n’ordonne d’enquête. Il y a quand même de quoi s’étonner, et l’argument avancé, de la présence du Sphinx – qui aurait été un plus grand péril encore –, a du mal à convaincre Œdipe : « Et quelle détresse pouvait donc bien vous empêcher, quand un trône venait de crouler, d’éclaircir un mystère pareil18 ? » D’autant que l’on apprend un peu plus loin qu’il s’est écoulé très peu de temps entre l’assassinat de Laïos et l’arrivée d’Œdipe triomphant du Sphinx à Thèbes. La traduction de Daniel Loayza nous instruit d’ailleurs sur la nature de la chose : les Thébains choisissent alors de regarder du côté du Sphinx « sans prendre garde à l’invisible19 », ce terme invisible méritant toute notre attention.
16Et que penser du fait qu’on laisse le seul témoin de l’assassinat du roi quitter le royaume de Thèbes ? Œdipe s’en étonne d’ailleurs auprès du Coryphée : « Mais le témoin qui aurait vu le fait, personne ici ne le voit plus lui-même20 ».
17Plus tard, lorsque Tirésias refuse de poursuivre son récit, Œdipe se met en colère et l’accuse d’avoir fomenté le crime, ce qui déclenche une contre-accusation qui se transforme en condamnation : « Je dis que c’est toi l’assassin cherché21 ». Or, la parole est ici éminemment performative : Tirésias parle et l’énonciation de sa parole devient action et vérité. Puisque Tirésias le dit, alors c’est vrai, cela s’est forcément passé ainsi. Bien sûr, le devin Tirésias est aux ordres d’Apollon et cela pourrait nous suffire, mais ce serait sans compter les autres étrangetés dans le discours de Tirésias qui suit, au moment où il annonce à Œdipe ce qui va lui arriver : « Bientôt, comme un double fouet, la malédiction d’un père et d’une mère, qui approche terrible, va te chasser d’ici22 ». Si on comprend assez facilement le sens de « la malédiction d’un père » – le viol de Chrysippe par Laïos a conduit Pélops à demander à Apollon de maudire Laïos et sa descendance23 –, celle « d’une mère » est beaucoup plus obscure. On pourrait d’abord penser que Jocaste maudira Œdipe lorsqu’elle va comprendre qui il est, mais elle n’en fait rien, il n’y en a aucune trace dans le texte de Sophocle. De quelle malédiction est-il donc question ? À la fin du premier chapitre de son enquête, Pierre Bayard esquisse une piste mythologique très stimulante, laissant à son lectorat l’opportunité de l’exploiter :
Cette faute initiale [comprendre ici le crime de Laïos] dissimule elle-même des événements plus anciens dont ceux liés à la fondation de Thèbes, en particulier le combat de Cadmos avec le dragon, puis l’épisode des Spartoi. Si ces derniers ont engendré des lignées de descendants, comment ne pas se demander si, trois générations plus tard, l’un deux n’aurait pas conçu l’idée, sous le couvert de la malédiction d’Apollon, de se venger des Labdacides24 ?
18Une chose intrigue immédiatement : qui peuvent donc être ces « lignées de descendants » ? C’est en cherchant du côté de la filiation maternelle d’Œdipe que l’on finit par dénouer – peut-être – les fils de l’intrigue. Créon est le « fils de Ménécée25 » et Jocaste « [s]a sœur26 », ce que confirme Euripide dans Les Phéniciennes27. Or, dans Les Phéniciennes, nous apprenons au cœur du troisième épisode que Créon a un fils, également nommé Ménécée, « un pur descendant des Spartes » qu’il doit sacrifier pour « apaiser l’antique colère d’Arès liée au meurtre du serpent par Cadmos28 », le fondateur de Thèbes. La malédiction de la mère aurait donc à voir avec l’histoire de la naissance de Thèbes29, ce qui signifie que les deux parents d’Œdipe sont des ennemis jurés, puisque Laïos est le fils de Labdacos, lui-même fils de Polydore, l’un des cinq enfants de Cadmos et Harmonie. On comprend donc que « l’un d’eux » veuille « se venger des Labdacides ». Mais lequel ? Une possible réponse se trouve chez Carl Robert, éminent philologue et archéologue allemand, dans son ouvrage Oidipus: Geschichte eines poetischen Stoffs im griechischen Altertum30. Il suggère que le Ménécée des vers 1010-1011 des Phéniciennes (« Et de là, je m’immolerai en me précipitant dans le noir et profond repaire du serpent, là où l’a prescrit le devin ») n’est pas le fils de Créon, mais le père de Jocaste, dont on connaît le terrible destin comme le mentionne Hygin dans ses Fabulae :
Une disette étant survenue à la suite d’une pénurie de récoltes à cause des crimes d’Œdipe (ob Oedipodis scelera), Tirésias fait savoir que, « si quelqu’un de la race du serpent survivait (encore) et se tuait pour la patrie, il la libèrerait de ce fléau » (si quis ex draconteo genere superesset et pro patria interiisset, pestilentia liberaturum). Ménécée, père de Jocaste, se jette alors du haut des remparts (se praecipitauit)31.
19Si tel est le cas, quel mal Ménécée, père de Jocaste, chercherait-il à expier ? Toujours ce meurtre du serpent par Cadmos ? Pour Carl Robert, cela serait lié au fait que « Laïos a pris sa fille de force32 » (la connotation sexuelle est à peine voilée) et cela justifierait la malédiction qui pèse sur les Labdacides. Nous voilà donc face à un Œdipe maudit deux fois, les deux malédictions étant liées à son père, Laïos, dont on comprend finalement mieux pourquoi les Thébains, la reine Jocaste la première, semblent avoir très vite fait le deuil.
20Après ce rappel de la double malédiction, Tirésias confirme son accusation contre Œdipe à la fin du premier épisode en traçant avec des mots la courbe que va prendre sa vie : il deviendra aveugle, mendiant, étranger et se révèlera frère et père à la fois, rival et assassin de son propre père. La tragédie Œdipe à Colone semble donner raison à Tirésias. Pourtant le chœur insiste dans le premier stasimon sur l’identité incertaine du coupable, alors même qu’Œdipe vient d’être formellement accusé – « le coupable incertain33 », « l’obscur criminel34 », « l’homme obscur35 » –, et se refuse à condamner Œdipe : « Tant que je n’aurai pas vu se vérifier les dires de ses accusateurs, je me refuse à les admettre36. »
21Lorsqu’Œdipe accuse par la suite Créon d’être à l’origine de ce qu’il imagine être un complot, c’est-à-dire à l’initiative des accusations de Tirésias, on apprend que le devin était déjà présent à Thèbes, lors de l’assassinat de Laïos, il y a « beaucoup de longues et de vieilles années37 » mais qu’à cette époque, il n’a rien dit, alors même qu’une enquête aurait déjà été menée, ce que confirme Créon lorsqu’Œdipe l’interroge.
Si ! Cela va de soi – sans aboutir à rien38.
Comment ne l’aurions-nous pas fait ? Mais sans succès39.
Nous avons fait notre devoir
Si bien sûr
Mais nous n’avons pas entendu40.
22Pourtant, au début de la pièce, le même Créon avait expliqué à Œdipe que la présence du Sphinx les avait « empêch[és] […] d’éclaircir un pareil mystère41 », nous ne sommes pas à une contradiction près.
Décentrement, recentrement : la nécessité comme responsabilité
23Mais le plus troublant reste encore à venir, lorsque l’on passe au peigne fin les paroles de Jocaste. Elles sont nombreuses à nous faire dresser l’oreille, même si Jocaste n’apparaît que trois fois au cours de la tragédie. Lorsqu’elle entre pour la première fois sur scène et qu’elle choisit de mettre un terme à la querelle entre Créon et Œdipe, elle affirme : « Ne faites pas d’un rien une immense douleur42 ». « Rien » donc, mais dès que Créon a quitté la scène, Jocaste cherche à connaître la nature de sa colère. Sa réaction aux révélations de Tirésias est sans appel : Œdipe ne peut qu’être innocent et les dieux se sont nécessairement trompés, une sentence qui bien sûr nous interroge, car elle contredit absolument tous les principes du monde dans lequel vit Jocaste, ce que le chœur ne manque pas de commenter plus loin : « Apollon se voit privé ouvertement de tout honneur. Le respect des dieux s’en va43. » Et cela est d’autant plus paradoxal, qu’à peine a-t-elle expliqué à Œdipe à la fin du deuxième épisode qu’il ne faut pas tenir compte des prophéties, que, dès le début du troisième, elle cherche le soutien d’Apollon pour soulager les maux intérieurs d’Œdipe44.
24Lorsque Jocaste apprend les raisons de la colère d’Œdipe vis-à-vis de Créon, elle ne manifeste aucun étonnement, aucune colère, et pose juste cette question qui sonne éminemment pragmatique, telle qu’on la trouverait dans n’importe quel roman policier : « Le sait-il par lui-même ? ou le tient-il d’un autre45 ? » Elle ne montre ni stupeur ni colère face à cette révélation, formule simplement une question terre-à-terre, comme si elle cherchait à vérifier que l’alibi tient bien et qu’il n’y a pas de témoin. Lorsqu’elle comprend que Tirésias est l’intermédiaire, elle manifeste un véritable soulagement, comme si sa parole ne comptait pas. Pour Jocaste, les jeux sont faits : Œdipe ne peut qu’être innocent puisque
Laïos, dit la rumeur publique, ce sont des brigands qui l’ont abattu, au croisement de deux chemins, et d’autre part, l’enfant une fois né, trois jours ne s’étaient pas écoulés, que déjà Laïos, lui liant les talons, l’avait fait jeter sur un mont désert46.
25Dans ce récit, Jocaste donne une indication jusqu’ici non verbalisée, il s’agit du « croisement de deux chemins » qui fonctionne chez Œdipe comme un élément déclencheur de souvenirs ; il cherche à faire parler Jocaste et apprend alors quatre indices capitaux : il s’agit d’un carrefour en Phocide « où se joignent les deux chemins qui viennent de Delphes et de Daulia47 » ; cet assassinat aurait eu lieu « un peu avant le jour où fut reconnu [s]on pouvoir sur Thèbes48 » ; Laïos « était grand. Les cheveux sur son front commençaient à blanchir49 » ; et il était accompagné de quatre gardes et voyageait sur un chariot50. Comme le montre Pierre Bayard au chapitre III de sa contre-enquête51, c’est à partir de ces indications de lieu et de temps et ce portrait sommaire qu’Œdipe s’accuse alors du crime et raconte son histoire à Jocaste. Sauf que, là encore, quelque chose ne fonctionne pas du tout. Si Jocaste peut lui faire ce récit, c’est parce qu’il lui a été rapporté, et ce, par le seul témoin de l’altercation qui a conduit à la mort de presque tout l’équipage « sauf un » comme le souligne le texte : « un serviteur, le seul survivant du voyage52 », alors qu’Œdipe nous raconte qu’il « les tue tous53 ». On serait donc fondé à penser qu’Œdipe veuille voir ce témoin, ancien esclave devenu berger, car sa seule existence prouve qu’il n’y a pas eu un événement mais bien deux, puisqu’Œdipe est certain de les avoir tous tués ; mais il ne s’arrête pas à la stricte matérialité des faits et ne fait qu’espérer : s’ils étaient plusieurs, alors peut-être y a-t-il bien eu deux événements distincts…
26Plus incohérent encore : pourquoi Jocaste, la reine de Thèbes, accepte-t-elle de « laisser partir » le seul témoin de l’assassinat de son mari ? D’autant que les raisons qu’il aurait invoquées sont bien troubles :
Il voulait être désormais le plus loin possible de Thèbes54.
Pour se soustraire de son mieux aux regards de notre cité55.
Le plus loin possible de la ville
Hors de portée des regards56.
27Et pourtant, elles ne sont pas aussi troubles que celles qui ont motivé Jocaste à accepter ce départ :
Ce n’était qu’un esclave, mais qui méritait bien cela, et mieux encore57.
Cet esclave pouvait prétendre
À une bien plus belle récompense58.
Pour un homme de sa valeur
Autant qu’un esclave vaille quelque chose
Ce n’était pas grande faveur59.
28Pourquoi pouvait-il donc prétendre à une « récompense » ? Pour avoir fui alors que son maître était assassiné ? Qu’est ce qui fait donc « la valeur » de cet homme ? Pourquoi « mérite »-t-il quoi que ce soit ? Dans le texte de Sophocle, aucune réponse à ces questions.
29En attendant le retour du berger à Thèbes, qui permettra de confirmer ou d’infirmer sa thèse, Œdipe apprend la mort de Polybe, un soulagement puisqu’il pense encore être son fils mais il s’interroge toujours sur la deuxième partie de l’oracle et là, les mots de Jocaste apparaissent comme une déroute supplémentaire qui ajoute encore une bonne dose de confusion :
Ne redoute pas l’hymen d’une mère : bien des mortels ont déjà dans leurs rêves partagé le lit maternel. Celui qui attache le moins d’importance à pareilles choses est aussi celui qui supporte le plus aisément la vie60.
30On peut quand même s’étonner que la critique n’ait pas davantage creusé cette image utilisée par Jocaste. Quand on relit les excellents chapitres de Jean-Pierre Vernant consacrés à Œdipe dans Mythe et tragédie en Grèce ancienne61, pas un mot sur ces propos de Jocaste, toute l’analyse se concentre sur la seule figure d’Œdipe. Cette manière que Jocaste a de légitimer l’inceste – même en rêves – a évidemment alimenté la critique freudienne des siècles plus tard, mais il me semble qu’elle est à prendre en compte pour ce qu’elle dit, à la lettre du texte. Car, à ce stade de la pièce, alors que les éléments s’accumulent pour prouver qu’Œdipe n’est pas celui qu’il croit être, on peut être en droit de penser que Jocaste en sait bien plus que ce qu’elle laisse entendre et qu’elle est « au moins » sur la voie de la compréhension et cherche peut-être déjà une porte de sortie.
31D’autant qu’ensuite les choses s’enchaînent très vite : le messager de Corinthe apprend à Œdipe qu’il n’était pas l’enfant naturel de Polybe et Mérope, qu’il l’a lui-même recueilli sur le Mont Cithéron alors qu’il était berger et il lui rappelle le sort de ses pieds : « Tes pieds pourraient sans doute en témoigner encore. […] C’est moi qui dégageai tes deux pieds transpercés62. » Et ici aussi, que penser du fait que le nom même d’Œdipe ne semble jamais avoir été interrogé par celles et ceux qui l’entourent – sauf par le berger de Corinthe qui lui rappelle le sens de son nom : « Tu lui as dû un nom tiré de l’aventure63 ». Et pourtant, ce nom est lourd de sens comme le rappelle Jean-Pierre Vernant :
Ambigu, il porte en lui le même caractère énigmatique qui marque toute la tragédie. Œdipe, c’est l’homme au pied enflé, infirmité qui rappelle l’enfant maudit, rejeté par ses parents, exposé pour y périr dans la nature sauvage. Mais Œdipe, c’est aussi l’homme qui sait l’énigme du pied, qui réussit à déchiffrer, sans le prendre à rebours, l’oracle de la sinistre prophétesse, de la Sphinx au chant obscur. […] Le double sens de Oidipous se retrouve à l’intérieur du nom lui-même dans l’opposition entre les deux premières syllabes et la troisième64.
32Dès lors, on est quand même en droit de s’interroger : comment Jocaste peut-elle partager depuis de si nombreuses années son lit sans s’être rendu compte de cette infirmité ? Car c’est bien d’une réelle infirmité qu’il s’agit, comme le signale Pierre Bayard en rappelant que c’est à la toute fin de la tragédie que l’infirmité d’Œdipe va jusqu’à être qualifiée de « cruelle entrave65 » liée à des « fers sauvages66 ». Dans les pas de Voltaire et de Franco Maiullari67, Pierre Bayard souligne qu’une telle blessure ne peut mener qu’à des déformations lourdes et à une démarche très affectée qui ne peut pas passer inaperçue. Ce qui fait qu’il « est totalement invraisemblable » que Jocaste puisse ne pas « remarquer sa blessure hautement caractéristique qu’il porte aux pieds, une blessure d’autant plus identifiable qu’elle présente un aspect symétrique68 ». Et Pierre Bayard d’ajouter : « Personne ne peut sérieusement croire que plusieurs guerriers grecs portaient à l’époque aux chevilles les traces d’une double perforation par une agrafe69 ».
33Lorsqu’Œdipe apprend les raisons des marques qu’il a aux pieds, il cherche à savoir lequel de ses deux parents l’avait voulu : « mon père ? ma mère ? par les dieux, dis-le70 ! », jamais il ne pense que cela puisse être une décision commune. Puis, il apprend que le berger de Corinthe ne l’a pas trouvé mais qu’un autre berger le lui a remis, un « des gens de Laïos71 ». À ce moment-là, Jocaste ne peut plus ne pas avoir compris, mais elle ne dit toujours rien. C’est seulement une fois qu’est établi le fait que le berger de Laïos et le survivant de l’assassinat du même Laïos sont une seule et même personne (ce qui ne prend que quelques vers) que Jocaste s’exprime : « Et n’importe de qui il parle ! N’en aie nul souci. De tout ce qu’on t’a dit, va, ne conserve même aucun souvenir. À quoi bon72 ! » Puis, juste après : « Non, par les dieux ! Si tu tiens à la vie, non, n’y songe plus. C’est assez que je souffre, moi73. » À partir de là, elle essaie encore de le dissuader dans les quatre répliques suivantes, et voyant qu’elle n’y parvient pas, elle rentre au palais, fermement décidée à mettre fin à ses jours, ce que confirment ses tout derniers mots « Tu n’en auras jamais un autre de ma bouche74 » : jamais plus elle ne lui parlera.
34Lorsque le berger de Laïos arrive, c’est celui de Corinthe qui lui rafraîchit la mémoire au sujet de l’enfant qu’il lui a confié. La première réaction du berger de Laïos est immédiate : il se fait menaçant. Il est totalement effrayé :
Levant son bâton : Malheur à toi ! veux-tu te taire75 !
Malheur à toi ! Vas-tu te taire76 !
Mais tu vas donc pas crever
Pas fermer ta gueule77.
35Là aussi, on pourrait penser qu’il soit d’abord seulement étonné ou dans l’incompréhension. En fait, c’est précisément cette attitude qui prouve qu’il sait, et depuis longtemps, qu’Œdipe est l’enfant de Laïos et Jocaste. L’indication la plus importante, et avec laquelle cette enquête se termine, est celle qu’il donne juste après, lorsqu’il avoue à Œdipe que c’est sa mère qui lui a confié le bébé avec ordre de le tuer :
C’est elle, seigneur. […] Pour que je le tue78.
Oui, seigneur. […]
Pour que je le fasse périr79 !
C’est ça seigneur […]
Que je m’en débarrasse80.
36Résumons donc la situation : c’est Jocaste qui a confié le bébé de trois jours au berger qui sera, plus tard, le seul survivant et témoin de l’assassinat de Laïos, celui qui quittera la ville juste après la mort de son maître. Ce bébé avait subi des violences extrêmes dont on peut interroger la finalité puisqu’il était voué à être dévoré par les bêtes sauvages : un enfant de trois jours n’allait pas se mettre à marcher pour s’échapper... Et Jocaste ne peut pas avoir ignoré les traces de ces graves blessures tout au long de leur vie commune. Une seule conclusion s’impose : elle savait81, et dès qu’Œdipe commence son enquête, elle n’a de cesse de vouloir le détourner de la vérité en faisant feu de tout bois. Mais pourquoi ? Pour Pierre Bayard, le mobile est « triple » :
Elle veut se protéger d’elle-même, protéger les siens et protéger son peuple. On ne peut rien comprendre à la pièce de Sophocle si on n’a pas présente à l’esprit cette obsession sécuritaire de Jocaste, qui détermine tous ses comportements82.
37Mais alors qui a tué Laïos ? Et pourquoi ? Ce n’est pas Jocaste elle-même bien entendu, mais son commanditaire, le berger, comme l’explique très précisément Pierre Bayard83. En tout cas, il a pleinement raison quand il souligne que « le cœur d’Œdipe Roi n’est pas le parricide mais l’infanticide84 ». Un infanticide avorté en quelque sorte. Et cela soulève toute une série de questions, sur l’hostilité des mères envers leurs enfants qui peut aller jusqu’à l’infanticide, « qui domine, comme un fil rouge sanglant, l’ensemble de la mythologie grecque85 », quelque chose d’à peine soutenable, pensons à Médée et à ce que le mythe est devenu tout au long des siècles. Mais surtout cette relecture éclaire différemment la question de la nécessité chez Sophocle. Certes, l’oracle ne s’est donc pas réalisé : Œdipe n’a pas tué Laïos. Mais, en commanditant le meurtre de Laïos et en se « substituant à [son fils] en croyant sauver son peuple, Jocaste déclenche à nouveau la foudre divine86 » et ne réussit pas à se jouer des dieux.
Maja Zade, une enquêtrice qui actualise au plateau la nouvelle lecture d’Œdipe Roi
38Que fait Maja Zade de la tragédie de Sophocle ? Le titre est en effet sans ambiguïté : Ödipus. Et l’on est fondé à attendre de voir se matérialiser sur la scène la pièce de Sophocle ou, en tout cas, les personnages mythologiques. Pourtant, Thomas Ostermeier s’est toujours refusé à monter des tragédies antiques car il ne voit pas ce que les questions de nécessité divine peuvent dire de notre monde. Mais comme il sent, en 2020, qu’il ne peut pas encore refuser la demande de la directrice du festival d’Épidaure, Katerina Evangelatou, il demande à Maja Zade d’écrire une tragédie d’aujourd’hui pour aujourd’hui qui s’inscrirait dans les traces des Grecs anciens. Que raconte donc Ödipus87 ?
39Christina est propriétaire d’une entreprise chimique qu’elle dirige avec son frère Robert. Elle est en vacances en Grèce dans sa villa avec son jeune compagnon Michael qui est aussi son employé ; tous deux se reposent avant la naissance de leur premier enfant, une fille. Mais Robert, le frère de Christina, surgit sans prévenir pour confondre Michael, qui a secrètement ordonné une enquête sur un accident dans lequel un camion de l’entreprise s’est renversé et a déversé des pesticides dans un lac. Une violente dispute éclate et s’amplifie lorsque Theresa, la meilleure amie de Christina, arrive avec d’autres mauvaises nouvelles. Plus la journée avance, plus l’avenir de l’entreprise devient sombre, tandis que des secrets de famille sont révélés. On découvre que l’accident de camion met en cause Wolfgang, le défunt mari de Christina, ancien patron de l’entreprise, car il a pris le volant à la place du chauffeur et provoqué d’autres conducteurs de véhicule en adoptant une conduite très dangereuse. L’un d’eux a choisi à son tour de répondre à ses provocations et, sans le vouloir, l’a poussé à une mauvaise manœuvre qui l’a fait sortir de sa route, le camion a pris feu et il est mort. Seul le chauffeur en réchappe. Michael découvre alors qu’il est à l’origine de la mort de Wolfgang.
40Parallèlement, Michael apprend le décès de son père en Allemagne, un père malade depuis de longues années, dont il sait qu’il n’est pas le sien puisqu’il a été adopté. Il s’est toujours senti différent de ses parents, et le décès de son père lui donne le sentiment d’être enfin légitime pour chercher du côté de ses origines. Il se met à raconter des souvenirs et finit par aller chercher le seul souvenir que sa mère lui a laissé lorsqu’elle l’a déposé dans une « boîte à bébé » à l’hôpital88 : une chaîne avec une petite coccinelle à la patte cassée. Voilà le signe de reconnaissance tant valorisé par Aristote dans le chapitre 11 de la Poétique. Christina reconnaît alors immédiatement le pendentif de Theresa et comprend qu’elle l’a glissé à l’époque dans le couffin. Mais que s’est-il passé ?
41L’histoire de couple de Christina et Wolfgang est sordide. Lui est un chef d’entreprise autoritaire, carriériste et misogyne qui se croit tout permis. Christina est jeune et ne sait ni se positionner, ni se défendre. Un soir, les choses dérapent lors d’un cocktail où elle jette un verre de crémant à la figure d’un collaborateur de Wolfgang qui cherche à lui donner des conseils conjugaux. Wolfgang est furieux, ils rentrent chez eux et il la viole. Elle doit comprendre qui a le pouvoir89. Christina ne peut faire face, elle choisit le déni, le silence. Mais elle tombe enceinte et se refuse à garder le bébé. Elle s’arrange donc pour masquer cette grossesse en prétextant un voyage pour une longue cure, et se débarrasser de l’enfant. Ce bébé, c’est Michael.
42On reconnaît par transparence la structure de Sophocle : quatre personnages-clés – qu’on peut assez facilement identifier à Créon (Robert), Jocaste (Christina), Œdipe (Michael) Tirésias/berger (Theresa) – avec une trame commune : sans le savoir le héros commet un parricide (qu’il ne commet pas vraiment ici non plus) puis l’inceste. Les enjeux de pouvoir sont aussi présents : le royaume de Thèbes est devenu une entreprise familiale et la peste a pris la couleur d’une catastrophe écologique.
43Mais surtout, le personnage de Christina est au cœur de la pièce. C’est elle le personnage principal, et les effets d’écho avec Sophocle relu par Pierre Bayard sont très forts :
Et au cœur de la pièce se trouve cet ordre infâme donné par Jocaste […] d’exécuter l’enfant qu’elle avait conçu. Dire que l’infanticide est central dans Œdipe Roi ne signifie pas que la question du meurtre du père soit pour autant absente de la pièce de Sophocle, mais elle est secondaire par rapport à celle du meurtre d’enfant, laquelle est à la fois antérieure chronologiquement et plus insistante sur le plan fantasmatique90.
Les conflits socio-politiques, moteurs inattendus du tragique
44Dans des termes bayardiens, on pourrait donc formuler les choses ainsi chez Maja Zade : au cœur de la pièce se trouve la volonté de Christina de se débarrasser à tout prix de l’enfant, une volonté mise à mal par Theresa (comme le berger chez Sophocle) – humaine trop humaine –, et la mort de Wolfgang et ses conséquences écologiques restent secondaires. En voici quelques exemples.
45Comme dans la relecture bayardienne, Christina (alias Jocaste) a sa part de responsabilité dans la mort de Wolfgang (alias Laïos) : c’est elle qui l’a poussé à accompagner ce chauffeur dans l’espoir que son mari finisse par se rendre compte de la réalité matérielle et sociale de l’entreprise qu’il dirige, qu’il comprenne ce que vivent ses employés. Mais, dans le même temps, elle avoue qu’elle se doutait qu’il pourrait ne pas rester à sa place, qu’il chercherait à faire pression sur son employé pour continuer à exister, et le fait qu’il ait pris le volant alors qu’il n’en avait pas le droit, ne l’étonne pas91. Elle le clame haut et fort : « je suis co-responsable92. »
46Par ailleurs, cela semble tous les arranger que Wolfgang soit mort, c’est la part d’« invisible93 » de l’affaire. Ils n’ont pas trop voulu regarder de ce côté-là, ne se sont pas trop interrogés sur les questions de responsabilité dans l’accident. Christina particulièrement n’a pas cherché à en savoir plus, bien trop soulagée que Wolfgang soit mort :
le pire c’est que, d’abord, quand j’ai appris la nouvelle, j’ai presque été soulagée94
juste l’espace d’un moment, un tout petit moment, je me suis dit95
à présent j’aurai pas besoin de divorcer96.
47Ce soulagement est bien sûr lié à leur histoire conjugale, au viol, à toutes ces années de domination, mais, à ce moment de la pièce, personne ne peut le comprendre encore, comme chez Sophocle. Jocaste, déjà, n’avait pas cherché à traquer les meurtriers de son époux et avait bien volontiers accepté d’épouser le jeune vainqueur du Sphinx. Il est intéressant tout de même de noter que Laïos / Wolfgang, dans les deux cas, s’est rendu coupable de viol : sur Chrysippe pour le premier, sur Christina pour le second.
48Plus étonnant peut-être, à l’issue de la violente dispute entre Robert et Michael en début de matinée – à cause de l’enquête que Michael a ordonnée sans avertir ses employeurs –, Robert lance une véritable malédiction (empiétant ainsi sur le rôle de Tirésias) en promettant à Christina et Michael qu’ils vont très vite se retrouver face aux débris de leur bonheur, et la journée se termine effectivement en tragédie :
vous n’avez aucune idée de ce à quoi ressemble le monde vraiment, de ce qu’il faut faire pour gravir les échelons, des humiliations qu’il faut avaler, des compromis qu’il faut accepter, des courbettes qu’il faut faire jusqu’à plus pouvoir se redresser ; vous allez tout perdre, vous retrouver dans le pétrin, et moi je serai là à vous regarder lorsque tout ça va vous exploser à la figure, la boîte, votre vie ; pendant ce temps je boirai un bon whisky et, le sourire aux lèvres, je vous regarderai chialer devant les morceaux brisés de votre vie, l’amas de gravats de vos espoirs, le petit tas fumant de votre bonheur passé qui pue la merde97.
49Et ce que Robert avait prédit se produit en effet, de la même manière que Tirésias avait prédit à Œdipe : « Tu n’entrevois pas davantage le flot de désastres nouveaux qui va te ravaler au rang de tes enfants98. »
50Surtout, lorsque Michael comprend que Christina est sa mère, la haine monte et se développe comme une traînée de poudre car elle lui explique tout : le viol, le dégoût qui s’ensuit, de Wolfgang, d’elle, du bébé, mais surtout du bébé qu’elle refuse de voir, de toucher même – elle ira jusqu’à le faire maladroitement tomber par terre en refusant de le prendre dans ses bras quelques instants après l’accouchement ; Michael en a gardé une cicatrice sur le front (deuxième signe de reconnaissance). Les marques de la violence ont changé de place : des pieds, elles se trouvent à présent sur le haut de la tête. Les mots chez Christina sortent comme des coups de couteau retenus si longtemps, elle dit tout, son langage n’a plus de limite et elle ne semble plus se rendre compte qu’elle les adresse à Michael, qui est ce bébé et qui est présent, devant elle. De sorte que c’est comme si elle l’abandonnait (le tuait ?) une nouvelle fois :
je vomissais plusieurs fois par jour, comme si j’avais pu vomir cet enfant, c’était comme si j’avais eu de la haine tangible au fond de moi, des grumeaux, un paquet de haine pour wolfgang99
elle t’a posé dans mes bras alors que je voulais pas100
je pouvais pas le toucher101
je voulais qu’il disparaisse, pour toujours102
je me dégoûtais moi-même103
51Enfin, et c’est probablement là le plus troublant, à la différence de Jocaste, elle ne se contente pas de « rêver l’inceste », elle le pose comme une possibilité : alors qu’elle a tout révélé, que Michael sait tout, elle donne le sentiment de penser qu’ils peuvent continuer leur vie ainsi et accueillir malgré tout leur bébé qui va bientôt naître. Tout cela se lit en creux de l’écriture de Maja Zade, dans les silences (stille) et la langue quasi dactylographique. Alors que Michael continue à l’injurier, elle tente de trouver des mots, elle le supplie :
Michael dégage
Christina je suis désolée […]
Michael dégage
Christina s’il te plaît
je t’aime
Michael dégage
Christina michael104
52Pour Michael en revanche, toute cette situation est absolument insupportable et il disparaît, en proie à une profonde colère conjuguée à un terrible désarroi. Il rentre dans la maison dont il ne ressortira pas, comme Jocaste chez Sophocle, et lorsque Robert forcera la porte de sa chambre, il trouvera la pièce vide, fenêtre grande ouverte, une fenêtre qui « donne sur les falaises », « il fait trop sombre […] pour voir en bas105 », ils appellent la police. Michael s’est donc suicidé, non pas pendu, mais défenestré.
53En un jour – l’unité de temps chère aux tragédiens grecs et aux classiques français étant ici parfaitement respectée –, Maja Zade déroule le fil implacable d’une nécessité qui n’est plus celle du fatum antique mais de la relation causale entre deux actions : ce ne sont plus les dieux qui décident de nos vies mais bien les hommes ou plus exactement la manière dont les hommes organisent leurs (non)-rapports entre eux. En effet, on peut passer en revue ce qui se serait passé si Christina avait refusé les rapports de pouvoir instaurés par Wolfgang, si Theresa n’avait pas déposé la coccinelle dans le couffin, si Christina n’avait pas continué à vouloir faire de Wolfgang quelqu’un de meilleur, si Michael n’avait pas réagi à la provocation d’un chauffard sur la route… C’est bien chaque relation causale entre ces différentes actions / décisions humaines (et non la malédiction lancée par Robert en fin de matinée) qui est à l’origine de la catastrophe, qui surgit au petit matin et emporte tout sur son passage, tel un tsunami, pour ne laisser qu’un champ de ruines le soir.
54Cette évolution de la nécessité est ancienne et ne date pas du xxie siècle. Comme l’a rappelé Jean de Guardia au cours de ce colloque, déjà chez Corneille, la meilleure nécessité, c’est celle qui fournit un but au personnage, mais ce but doit se situer très haut dans la liste des buts possibles, de sorte que Corneille a recours à des pulsions très fondamentales de l’être humain. Chez Maya Zade, les buts des personnages ne sont plus les mêmes, ils sont très directement liés au contexte social et politique de notre époque et engagent à la fois la question des rapports de domination homme-femme, la masculinité exacerbée, les enjeux écologiques, le désir de sauver le monde, l’incapacité à ne pas vouloir exister à tout prix… De sorte que – pour les spectateurs – la reconnaissance fonctionne parfaitement, puisque les personnages qui se débattent sur le plateau dans cette tragédie moderne pourraient bien être eux-mêmes…
Conclusion
55En réécrivant la tragédie de Sophocle, qui n’a pourtant pas changé de nom, Maja Zade suit – sans le savoir – les sillons creusés par la relecture de Pierre Bayard en mettant la mère, Christina / Jocaste, au centre de tout. C’est elle qui est au cœur de la tragédie. Bien sûr, elle est victime tout autant que coupable, et il y aurait beaucoup à dire encore sur Jocaste106. En choisissant de mettre l’infanticide au cœur de la pièce et donc de donner à Jocaste une place dramaturgique qui diminue la force de l’oracle antique et oblige par conséquent à repenser la question de la nécessité, Maja Zade touche à l’un des mythes les plus forts de notre civilisation, celui de la mère protectrice et aimante. En proposant une notion complémentaire au complexe d’Œdipe théorisé par Freud, « le complexe de Jocaste » qui « met l’accent sur la dimension meurtrière de la relation107 » parents-enfants, Pierre Bayard a pleinement conscience des dangers d’une telle proposition :
Une pensée d’autant plus insupportable qu’elle ne concerne pas les individus seuls, mais doit sans doute être étendue aux groupes et aux sociétés. N’arrive-t-il pas à celles-ci de privilégier leur confort à la vie future de leurs enfants et se désintéresser du destin de ces derniers, voire de souhaiter inconsciemment qu’ils ne leur survivent pas108 ?
56Et il est quand même étrange de voir que Maja Zade et Thomas Ostermeier lui emboitent le pas sans le savoir. Bien sûr, chez eux, les dieux, le fatum antique prennent les couleurs du désastre écologique de notre monde dont les origines sont incontestablement humaines, mais est-ce pleinement exclusif ? À la presque fin de son essai – et rappelons qu’il le termine à l’été 2021 –, Pierre Bayard écrit :
Je parlais plus haut des messages envoyés par les dieux quand ils ont décidé d’intervenir dans nos vies. Est-ce de la paranoïa que de voir, dans les incendies qui ravagent en ce moment Athènes et sa région, un lien avec le secret que je partage avec Jocaste109 ?
57Faut-il voir là une coïncidence avec les choix scénographiques de Thomas Ostermeier ? Au début du spectacle, nous découvrons le cœur de la villa, la cuisine avec son îlot central, et – à cour – des images projetées, organiques mais par moment tout à fait reconnaissables comme celle du Sphinx qui se trouve posé sur le plan de travail. La musique commence, rythmique inquiétante et sonorités dissonantes, quelque chose va se passer, c’est assez évident. Puis, défilent des images prises depuis une voiture sur une route en Grèce, dans une région qui a tout de celle du Péloponnèse, où l’on découvre des images désolantes de sécheresse, des arbres calcinés, une nature dévastée. Robert est au volant, il roule vers la villa. C’est le prologue d’Ödipus de Thomas Ostermeier et l’épilogue de Pierre Bayard. On n’en a donc peut-être pas encore fini avec les dieux ou du moins avec une forme de nécessité…
1 La compagnie d’Ivo van Hove.
2 https://web.archive.org/web/20220810211349/https://ita.nl/en/shows/oedipus/2555860/, page consultée le 10 avril 2025.
3 Georges Enesco, en sortant d’une représentation d’Œdipe Roi à la Comédie-Française en 1909, s’est empressé de transcrire les premières mesures de son futur et unique opéra qu’il n’achève qu’en 1931 et qui sera créé en 1936 à l’Opéra de Paris.
4 Sandrine Montin, « Incendies de Wajdi Mouawad : une réécriture d’Œdipe Roi », dans La Réécriture au xxie siècle, revue T(r)OPICS, no 3, Université de la Réunion, décembre 2016, p. 172.
5 La pièce a été reprise pour la saison 2023-2024 au Théâtre du Nord de Lille et cette saison à la Scala Paris.
6 Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, Paris, Les Éditions de Minuit, 2021.
7 La courte pièce, Entre les lignes [Entrelinhas], écrite et jouée en 2013 au São Luiz Teatro Municipal de Lisbonne, et traduite en français en 2015, s’était présentée comme un dialogue avec Œdipe Roi, et elle trouve fin 2022 une nouvelle actualité dans sa reprise parisienne au Théâtre de l’Athénée, six ans après sa création le 29 mars 2016 pour le Festival « Terres de Paroles » au Théâtre du Château de la ville d’Eu. Dans ce spectacle, Tiago Rodrigues entremêle le texte de Sophocle à des lettres qu’un prisonnier écrit à sa mère, « entre les lignes » d’une vieille édition de la tragédie grecque trouvée dans la bibliothèque d’une prison. Cette fable labyrinthique et fantastique autour de réappropriations du personnage d’Œdipe apparaît comme une métaphore de l’auteur et de l’acteur qui retournent aujourd’hui à Œdipe pour écrire leurs propres histoires.
8 Michel Deutsch et Philippe Lacoue-Labarthe, Avant-Guerre, no 2, 1981, p. 76.
9 William Marx, Le Tombeau d’Œdipe. Pour une tragédie sans tragique, Paris, Les éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2012, p. 159.
10 Ibid., p. 163.
11 Une précision s’impose : cette notion n’est pas née avec l’essai de Pierre Bayard. C’est François Le Lionnais, membre de l’Oulipo qui utilise le concept pour la première fois : Oulipo, La littérature potentielle, Paris, Gallimard, 1973, p. 21. Et Marcel Bénabou rattache même l’origine de la notion à un vers d’Alexis Piron dans La Métromanie – « Leurs écrits sont des vols qu’ils nous ont faits d’avance. » III, 7 – : Marcel Bénabou, « Les ruses du plagiaire » dans Le Plagiat, dir. Christian Vandendorpe, Ottawa, Presses Universitaires, 1992, p. 17-30.
12 Dramaturge depuis vingt ans à la Schaubühne, Maja Zade écrit depuis quelques années pour le théâtre de véritables tragédies contemporaines. Sa pièce abgrund [abyme] a été jouée en France, au théâtre des Gémeaux de Sceaux en 2019.
13 Recension que j’ai faite par ailleurs pour Fabula : https://www.fabula.org/revue/document14695.php, page consultée le 10 avril 2025.
14 Celle de Pierre Mazon (que Pierre Bayard utilise lui-même dans son essai) dans Sophocle, Tragédies complètes, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2018 [1962], celle de Daniel Loayza dans Sophocle, Œdipe Roi, Paris, Flammarion, 2015, et celle d’Irène Bonnaud, dans Sophocle, Tragédies complètes, 1, Besançon, Les Solitaires intempestifs, coll. « Traductions du xxie siècle », 2022. À présent, les références à ces traductions ne mentionneront que le nom du traducteur et la page.
15 Mazon, p. 189. Je citerai le texte dans la traduction de Paul Mazon, mais renverrai systématiquement aux analogies ou aux divergences dans les traductions de Daniel Loayza et Irène Bonnaud.
16 Ibid. Je souligne en italique.
17 Loayza, p. 52 et Bonnaud, p. 365.
18 Mazon, p. 189.
19 Loayza, p. 52.
20 Mazon, p. 194.
21 Mazon, p. 197.
22 Ibid., p. 199. Les deux autres traductions sont peut-être encore plus explicites : « Et sous ses doubles coups, surgie de ta mère et de ton père / Pour te chasser de ce pays, l’Imprécation te traquera d’un pied terrible », Loayza, p. 68. « La malédiction d’une mère et de ton père / Fouet à double lanière / Monstre au pied terrible / Te chassera un jour de ce pays », Bonnaud, p. 387.
23 Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, op. cit., p. 28.
24 Ibid., p. 28-29.
25 Mazon, p. 187.
26 Ibid., p. 206.
27 Euripide, Les Phéniciennes, trad. Christine Amiech, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 165 : « Allons, toi, va chercher le fils de Ménécée, Créon, le frère de ma mère Jocaste » (v. 690-691).
28 Ibid., p. 23.
29 Ce que Pierre Bayard confirme au moment où il dénoue les fils pour rétablir la vérité : « Il semble qu’on ne se soit pas suffisamment avisé du fait que Jocaste est une descendante des Spartoi [Par son père, Ménécée, Jocaste descend d’Echion, l’un des cinq Spartoi survivants (note 6)] et qu’elle porte en elle, dès sa naissance, à son insu même, la haine des occupants du trône de Thèbes », dans Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, op. cit., p. 165.
30 Carl Robert, Oidipus: Geschichte eines poetischen Stoffs im griechischen Altertum, I, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1915.
31 Le texte et la traduction d’Hygin sont cités ici via Jacqueline Fabre-Serris dans son article « Le mythe thébain à Rome : les fables 66-75 d’Hygin. L’interprétation d’un mythographe », Polymnia, 4, 2019, p. 97-124.
32 Carl Robert, Oidipus: Geschichte eines poetischen Stoffs im griechischen Altertum, op. cit., p. 493 : « wenn der Sparte dem Labdakiden die Hand seiner Tochter verweigerte und dieser sie sich mit Gewalt nahm ».
33 Mazon, p. 201.
34 Loayza, p. 71.
35 Bonnaud, p. 392.
36 Mazon, p. 201-202.
37 Ibid., p. 203.
38 Ibid., p. 204.
39 Loayza, p. 76.
40 Bonnaud, p. 398.
41 Mazon, p. 189.
42 Ibid., p. 206.
43 Ibid., p. 214.
44 Ibid., p. 215 : « C’est vers toi que je me tourne, ô dieu lycien, Apollon, notre voisin. Fournis-nous un remède contre toute souillure. »
45 Ibid., p. 208.
46 Ibid., p. 209.
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Mazon, p. 210.
50 Ibid. « Ils étaient cinq en tout, dont un héraut. Un chariot portait Laïos ».
51 Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, op. cit., p. 81-90.
52 Mazon, p. 210.
53 Ibid., p. 212.
54 Ibid., p. 210.
55 Loayza, p. 88.
56 Bonnaud, p. 414.
57 Mazon, p. 210.
58 Loayza, p. 88.
59 Bonnaud, p. 415.
60 Mazon, p. 217.
61 Jean-Pierre Vernant, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, tome 1, Paris, La Découverte, 2001 [1972].
62 Mazon, p. 219.
63 Ibid.
64 Jean-Pierre Vernant, « Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d’Œdipe-Roi », dans Mythe et tragédie en Grèce ancienne, op. cit., p. 113.
65 Mazon, p. 230 et Loayza, p. 122.
66 Bonnaud, p. 463.
67 Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, op. cit., p. 95, note 5.
68 Ibid., p. 98.
69 Ibid.
70 Mazon, p. 220.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid., p. 221.
75 Ibid., p. 223.
76 Loayza, p. 110.
77 Bonnaud, p. 446.
78 Mazon, p. 225.
79 Loayza, p. 113.
80 Bonnaud, p. 224.
81 Comme le démontre Pierre Bayard dans son essai, « Jocaste savait pertinemment, dès leur première rencontre ou dès les jours qui ont suivi, qu’elle avait retrouvé son fils ». Et il rappelle qu’Albert Machin [dans son article « Jocaste dans le temps tragique », Pallas, Revue d’études antiques, no 36, 1990] avait relevé en son temps les mêmes indices sans toutefois « tirer les conséquences logiques de ses découvertes » dans Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, op. cit., p. 163.
82 Ibid., p. 165. Et ce sont d’ailleurs ces mêmes raisons « sécuritaires » qui poussent certaines reines shakespeariennes, Lady Anne au premier chef dans Richard III, à accepter l’inacceptable, un baiser et le mariage avec celui qui a assassiné son mari.
83 Ibid., p. 166-167.
84 Ibid., p. 171.
85 Ibid., p. 172.
86 Ibid., p. 167.
87 Maja Zade, Ödipus, Berlin, Henschel Verlag, 2021. Par ailleurs, la traduction française de la pièce existe : Maja Zade, Œdipe, trad. Delphine Edy, Paris, Arche Agence théâtrale, 2022.
88 Le dispositif de « boîte à bébé » permet de déposer son enfant, de manière anonyme, dans un tiroir sécurisé et chauffé, avant qu’il ne soit pris en charge quelques minutes plus tard.
89 Maja Zade, Œdipe, trad. Delphine Edy, éd. citée, p. 54 : « je me suis même dit pendant l’acte, ok, je comprends ce que tu veux me dire, il s’agit pas de sexe ici, il s’agit de pouvoir. »
90 Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, op. cit., p. 172.
91 Maja Zade, Œdipe, op. cit., « mais il s’est jamais tenu à aucune règle que ce soit, peut-être que j’aurais dû penser que ça pouvait arriver », p. 44.
92 Ibid., p. 37.
93 Voir note 19.
94 Ibid.
95 Ibid., p. 38.
96 Ibid.
97 Ibid., p. 20.
98 Mazon, p. 199.
99 Maja Zade, Œdipe, op. cit., p. 56.
100 Ibid., p. 59.
101 Ibid., p. 59 et 60.
102 Ibid., p. 60.
103 Ibid.
104 Ibid., p. 66.
105 Ibid., p. 71.
106 Depuis ce colloque, Cassandre Martigny a soutenu sa thèse Devenir Jocaste. Naissances et renaissances du personnage de l’Antiquité à nos jours, sous la direction de Véronique Gély et Marie-Pierre Noël à Sorbonne Université en 2023.
107 Pierre Bayard, Œdipe n’est pas coupable, op. cit., p. 176.
108 Ibid., p. 177.
109 Ibid., p. 169.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1964.html.
Quelques mots à propos de : Delphine Edy
CRLC Sorbonne Université – ACCRA Université de Strasbourg
