Sommaire
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
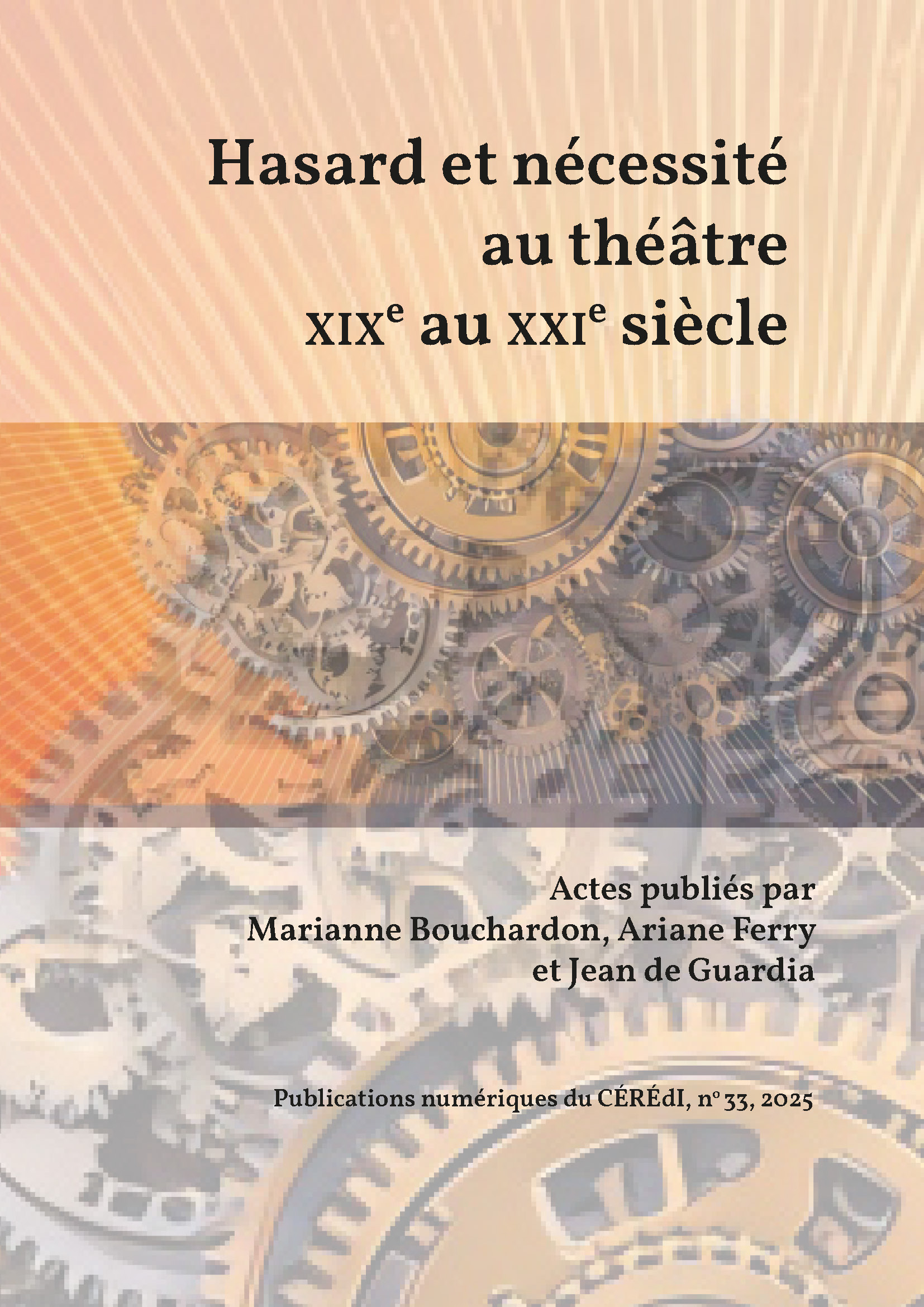
- Marianne Bouchardon, Jean de Guardia et Ariane Ferry Introduction
- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?
Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)
- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste
- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène
- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss
- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade
- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal
- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue
- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité
- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin
- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle
- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Introduction
Marianne Bouchardon, Jean de Guardia et Ariane Ferry
1Dans le chapitre X de la Poétique, Aristote établit une nette distinction entre deux manières de lier les événements dramatiques : il est très différent, explique-t-il, de dire que ceci a lieu à la suite de cela ou que ceci a lieu à cause de cela. L’anecdote de la statue de Mitys, qui écrase en tombant l’assassin de celui qu’elle représente, lui offre un exemple parfait de l’effet que la tragédie doit chercher à produire : l’émotion est ici d’autant plus vive que l’accident ne paraît pas être arrivé par hasard, mais semble bel et bien répondre à une forme de nécessité. Il en conclut que la réussite d’une pièce de théâtre dépend de l’impression donnée au spectateur que les épisodes qui se succèdent selon un rapport de consécution s’enchaînent selon un rapport de conséquence. Au fondement de la poétique aristotélicienne se trouve ainsi posée une exigence de cohérence logique que la construction des pièces classiques françaises pousse à son paroxysme. Les soubassements en ont été mis au jour par Gérard Genette en 1968 dans son fameux article « Vraisemblance et motivation » : l’enchaînement des causes et des effets, dans une œuvre narrative ou dramatique, doit dissimuler que celle-ci est, en réalité, organisée de manière rétrograde, en fonction de son excipit ou de son dénouement, qui est sa raison ultime. Le déroulé chronologique des faits représentés et leur découverte progressive par le spectateur dans l’expérience du spectacle ne font dès lors qu’occulter le caractère inéluctable, prédictible car déjà conçu par l’auteur, de l’action générale et de sa conclusion. Les études génétiques de Georges Forestier (Essai de génétique théâtrale : Corneille à l’œuvre, Droz, 1996), qui montrent que Corneille composait ses tragédies à rebours, accréditent cette thèse. Plus récemment, Jean de Guardia (Logique du genre dramatique, Droz, 2017) s’est efforcé de reconstituer le système des motivations qui guident la construction des tragédies de Corneille et de Racine, en croisant deux régimes d’explication (la cause et la raison) et deux modèles d’organisation (la chaîne et la roue). Interroger le devenir du système de causalité au théâtre, en France et à l’étranger, à partir du moment où toute une partie de l’écriture dramatique s’émancipe des principes de composition hérités de la poétique aristotélicienne et s’engage dans la voie de ce que Jean-Pierre Sarrazac a appelé un « changement de paradigme du drame1 », tel était l’enjeu du colloque organisé par le CÉRÉdI et l’IRET qui s’est tenu à l’Université de Rouen-Normandie les 1er et 2 décembre 2022, dont les actes sont ici publiés.
2Sur la notion de nécessité classique, qu’en réalité ni Aristote ni le xviiᵉ siècle n’ont jamais précisément définie, l’analyse liminaire de Jean de Guardia tente d’apporter un éclairage. Dans son Discours de la Tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire (1660), rappelle-t-il, Corneille est le seul à en proposer une définition : le nécessaire est le moyen adéquat par lequel le personnage arrive à son but. Entendue dans cette acception, la nécessité se fonde désormais sur la mise en relation d’un but, d’une condition sine qua non et d’une décision à prendre. Le « syllogisme pratique » qui en résulte, formulé dans le monologue délibératif, est souvent répété de manière redondante au cours de la tragédie, tant il est essentiel à sa structure. Jean de Guardia insiste ainsi sur le changement de paradigme opéré par Corneille : chez lui, la causalité fictionnelle n’est plus fondée sur les lois de l’enchaînement des événements mais sur la logique des buts de l’individu.
3À partir du moment où la pièce de théâtre se libère de l’esthétique de l’unité qui fondait la valeur artistique des œuvres dramatiques à l’époque classique, ni la poétique de l’auteur, ni la logique de ses personnages ne s’embarrassent plus de la catégorie du nécessaire. La fable, entendue comme histoire représentée, bien souvent se délie, se délite ou se disperse, semblant avancer hors de tout dessein humain ou divin. Le principe de nécessité aurait-il disparu au profit de l’imprévisible, de l’inexplicable, autrement dit d’un inintelligible hasard ? Ou le hasard n’est-il que le masque des nécessités – politiques, sociales, biologiques, etc. – identifiées et mises en scène par les théâtres moderne et contemporain ? Un premier ensemble de questions soulevées par le colloque portait donc sur les facteurs qui contrarient la concaténation de la fable : lorsque les événements représentés suivent un ordre incohérent ou illogique, dans quelle mesure peut-on y voir des effets de l’instabilité du personnage, de ses hésitations ou de ses revirements, de l’inconstance de ses désirs ou des fluctuations de sa volonté ? Et d’autre part, quelle place est ménagée par l’intrigue à la coïncidence, à l’accident, à l’inattendu, à la disproportion entre la cause et l’effet ? Trois articles choisissent ici de mettre le personnage au centre de leur réflexion, afin de montrer comment peuvent s’articuler, au sein d’une même figure, un facteur d’aléa et un facteur de contrainte. Ainsi fait Tatiana Victoroff lorsqu’elle étudie Le Revizor (1836) de Gogol, au prisme de ses réécritures par Boulgakov (1934), Ghelderode (1934) et Nabokov (1938). Toutes ces versions de la comédie, montre-t-elle, font découler d’une cause fortuite (le quiproquo qui fait prendre un simple voyageur pour un redoutable inspecteur) une cascade de conséquences inévitables : les efforts déployés par les bourgeois de la ville pour dissimuler leur turpitude et leurs malversations. Ainsi fait Ariane Murphy lorsqu’elle s’intéresse à la figure de l’enfant à naître chez trois auteurs peu ou prou apparentés au symbolisme : Maeterlinck (L’Oiseau bleu, 1908, et Les Fiançailles, 1918), Hofmannsthal (La Femme sans ombre, 1919) et Yeats (Le Purgatoire, 1938). Les récents progrès de la science de l’hérédité, explique-t-elle, la font concevoir comme une forme de déterminisme à la fois plus arbitraire et plus implacable que la fatalité antique. D’autant que, pour les symbolistes, ce ne sont pas seulement les ancêtres qui influencent leur postérité, mais aussi, réciproquement, les descendants qui agissent sur leur ascendance. Silvia de Min, quant à elle, met l’écriture dramatique de Pirandello à l’épreuve des principes théoriques qu’il expose dans son Introduction au théâtre italien (1935). L’évolution qui se fait jour au fil des quatre grands moments évoqués, le théâtre sacré du Moyen Âge, la commedia dell’arte, la comédie de Goldoni, le drame moderne, correspond à un renversement des rapports de subordination entre la catégorie du personnage et la catégorie de l’action, de telle sorte que, chez Pirandello, le caractère détermine l’intrigue et non plus l’inverse. Il est vrai que ses personnages ne poursuivent aucun but dont le spectateur aurait été préalablement informé. Pourtant, sous l’apparente l’improvisation à laquelle se livrent les six personnages en quête d’auteur (1921) perce une réelle contrainte, le drame qu’ils rejouent ayant déjà eu lieu, la répétition apparaissant peu à peu comme une nécessité.
4Lorsque la déliaison caractérise non plus les événements représentés (la fable) mais la représentation des événements, la question qui se pose est celle des gestes d’écriture qui président à la composition ou à la décomposition de l’œuvre dramatique : la déliaison se fonde-t-elle sur un principe rhapsodique de découpage et de montage favorable à la discontinuité ? sur un principe de fragmentation qui ne laisse subsister que des éclats et des bris ? sur une poétique sérielle favorisant la répétition-variation ? Tout en analysant cette poétique de l’éclatement, plusieurs articles la mettent ici en relation avec une volonté de représenter le Mal. C’est ainsi que L’Instruction de Peter Weiss (1965), étudiée par Pauline Philipps, adopte la forme du théâtre documentaire pour représenter le Procès de Francfort, au cours duquel comparurent plusieurs responsables du camp d’Auschwitz. Le geste rhapsodique de l’écrivain allemand, aussi significatif de la contingence de l’Histoire que de la banalité du Mal, laisse alors en suspens la question du pourquoi. C’est ainsi que Mauvaise (2003) de debbie tucker green, Poings (2018) et À la carabine (2020) de Pauline Peyrade, évoquées par Nina Roussel, adoptent une construction elliptique et fragmentaire pour revenir sur le viol d’une jeune fille par l’un de ses proches. Le dialogue, dépourvu d’articulations logiques, calque sa forme éclatée et répétitive sur celle des symptômes traumatiques. En revanche, Émilie Combes montre que les pièces courtes de Fernando Arrabal, comme Guernica (1961), Le Jardin des délices (1968) ou Le Ciel et la Merde II (1980), bien qu’elles illustrent sa théorie Panique fondée sur la mémoire, le hasard et la confusion, en juxtaposant une série de tableaux fragmentaires et oniriques régis par des principes de disproportion et de désorientation, n’en sont pas moins structurées en profondeur par des jeux de miroir et de symétrie qui témoignent d’un souci de maîtrise du chaos.
5De fait, une autre question soulevée par le colloque était celle des différentes logiques à l’œuvre dans la composition d’une pièce. Entre les épisodes ou les morceaux dont la succession n’est pas régie par un rapport de cause à conséquence, n’est-il pas possible de déceler d’autres formes de liaison, comme des phénomènes d’échos ou de correspondances, de collision ou de déflagration ? Quand le système de causalité est affaibli à l’échelle macro-structurelle, au plan de l’agencement des épisodes, ne se réfugie-t-il pas à l’échelle micro-structurelle, au plan de la liaison entre les répliques ? Quels phénomènes stylistiques justifient alors la progression du texte au niveau moléculaire ou capillaire ? Les deux communications consacrées aux questions climatiques répondaient en partie à ces interrogations, en montrant tantôt comment les aléas du temps qu’il fait sont résorbés par les contraintes d’un genre dramatique, tantôt comment la fatalité de l’air du temps devient l’effet produit par le système des figures de style. Le Tremblement de terre (1840) d’Adolphe Dennery, dont l’intrigue s’inspire du séisme qui bouleversa la Martinique en 1839, représente une catastrophe survenue par hasard, mais les codes du mélodrame, observe Barbara T. Cooper, rendent l’enchaînement des événements inévitables et prévisibles. Les drames de Tchekhov, Maeterlinck et Henri-René Lenormand, évoqués par Pierre Causse dans une communication qui n’a malheureusement pas pu être publiée, sont représentatifs du tournant des années 1880, à partir duquel le météorologique le cède à l’atmosphérique comme moteur de l’action dramatique. Plus continue et plus discrète que les anciennes tempêtes du théâtre lyrique, cette nouvelle forme de nécessité, qui donne aux drames leur unité, est portée par le réseau des métaphores suggérant l’emprise du macrocosme sur le microcosme.
6Il convenait encore de s’attarder sur les effets produits sur le lecteur ou le spectateur : que devient la fiction quand s’effrite le principe de causalité au fondement de la croyance et de l’immersion ? D’où procède le plaisir procuré par une pièce dont les parties ne sont pas enchaînées les unes aux autres ? L’intérêt est-il alors moins tendu vers le futur, plus concentré sur le présent ? Ou l’attention est-elle toujours sous-tendue par une attente, ne fût-ce que par une succession de « micro-attentes » (Michel Vinaver) à l’intérieur de chaque partie ? Cette question des effets est ici surtout soulevée par les articles attentifs au dialogue du théâtre contemporain avec le théâtre antique, ainsi qu’au problème du sens à donner à la violence qui se débonde sur scène. Zoé Schweitzer se penche ainsi sur trois tragédies d’Hanokh Levin, Les Femmes de Troie (2004), Tout le monde veut vivre (2008) et L’Empereur (2018) qui sont des réécritures d’Euripide (Les Troyennes, Alceste et Ion). Alors que chez l’auteur grec, les dénouements étaient heureux grâce à l’intervention des Dieux, explique-t-elle, chez l’auteur israélien, les dénouements sont funestes puisque nulle transcendance n’intervient : le monde, livré à la toute-puissance des passions humaines, est entré dans une ère de dérégulation, et c’est au théâtre qu’il appartient désormais de rendre à l’Histoire son intelligibilité. De même, Ödipus (2019) de Maya Zade est une réécriture d’Œdipe Roi de Sophocle qui, selon Delphine Edy, plagie par anticipation les conclusions de l’enquête menée par Pierre Bayard dans son essai Œdipe n’était pas coupable (2021). Dans cette version suédoise et contemporaine du mythe antique, où le royaume de Thèbes est devenu une entreprise familiale et où la peste a pris la forme d’une catastrophe environnementale, le crime est un infanticide et le véritable coupable une femme : Jocaste / Christina. C’est de cette mise à mal de la figure de la mère protectrice et bienveillante, montre la chercheuse, que la pièce tire son efficacité paradoxale sur le public.
7Se posait, enfin, la question de la réinterprétation rétrospective : à la fin d’une pièce organisée de manière décousue, erratique ou chaotique, n’est-il pas possible de reconsidérer, après-coup, l’ensemble de cette pièce, de se livrer à un travail de démontage et de remontage afin de tenter de rétablir les liens manquants, de découvrir une chronologie et/ou une logique qui fassent sens, d’inventer une fable dotée de cohérence ? Quelle part faut-il accorder à l’illusion rétrospective dans l’impression donnée au lecteur ou au spectateur que les événements se suivent selon un rapport de contiguïté ou s’enchaînent selon un rapport de continuité ? Par quels procédés le hasard peut-il être converti, à ses yeux, en nécessité ? Comment une série de faits, arbitraire et contingente, peut-elle faire croire à la réalisation d’un mécanisme inévitable et implacable ? Réciproquement, par quels procédés la nécessité peut-elle passer pour hasard ? Comment la rectitude d’une ligne droite peut-elle se dissimuler derrière les arabesques d’une ligne courbe ? Ce mouvement de rétrospection est au cœur de l’article que Pierre Piret consacre aux Nègres (1959) de Jean Genet. Cette représentation d’une cérémonie macabre orchestrée par des comédiens Noirs à destination de faux Blancs invite, selon lui, à une remontée de la chaîne signifiante de l’effet vers sa cause première et originelle : le discours colonialiste, afin d’en saper les fondements.
8Finalement, chacun à leur manière, les articles ici réunis viennent sans doute nuancer l’idée d’une liquidation complète de la nécessité dramatique par la modernité théâtrale. Peut-être la nécessité dramatique n’avait-elle pas été assez clairement définie par la tradition théorique pour être efficacement chassée. Plus qu’à une disparition du nécessaire, c’est sans doute à une série de mutations qu’assiste la modernité théâtrale, à l’apparition de nouvelles manières de lier entre elles les parties de la pièce de théâtre. À la conception rigoureuse d’un plan fondé sur l’enchaînement des faits selon un rapport de consécution interprété comme un rapport de conséquence, ont succédé des formes dramatiques brouillant intentionnellement la chronologie des événements et privilégiant l’expression subjective, fragmentée et en apparence confuse des personnages, les conflits de mémoire, la perturbation des frontières entre univers fictionnel et monde du spectateur ; ont succédé aussi des écritures dramatiques et poétiques où le retour de quelques mots et images, saisis et mémorisés par le spectateur, suffisent à lui donner le sentiment d’une nécessité qui ne dit plus son nom, mais n’en est pas moins puissante.
1 Jean-Pierre Sarrazac, « La reprise (réponse au postdramatique) », Études théâtrales, nos 38-39, « La Réinvention du drame (sous l’influence de la scène) », 2007, p. 11.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1944.html.
Quelques mots à propos de : Ariane Ferry
Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI
Quelques mots à propos de : Marianne Bouchardon
Sorbonne Université, CELLF 16-21
Quelques mots à propos de : Jean de Guardia
Sorbonne nouvelle, IRET
