Sommaire
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
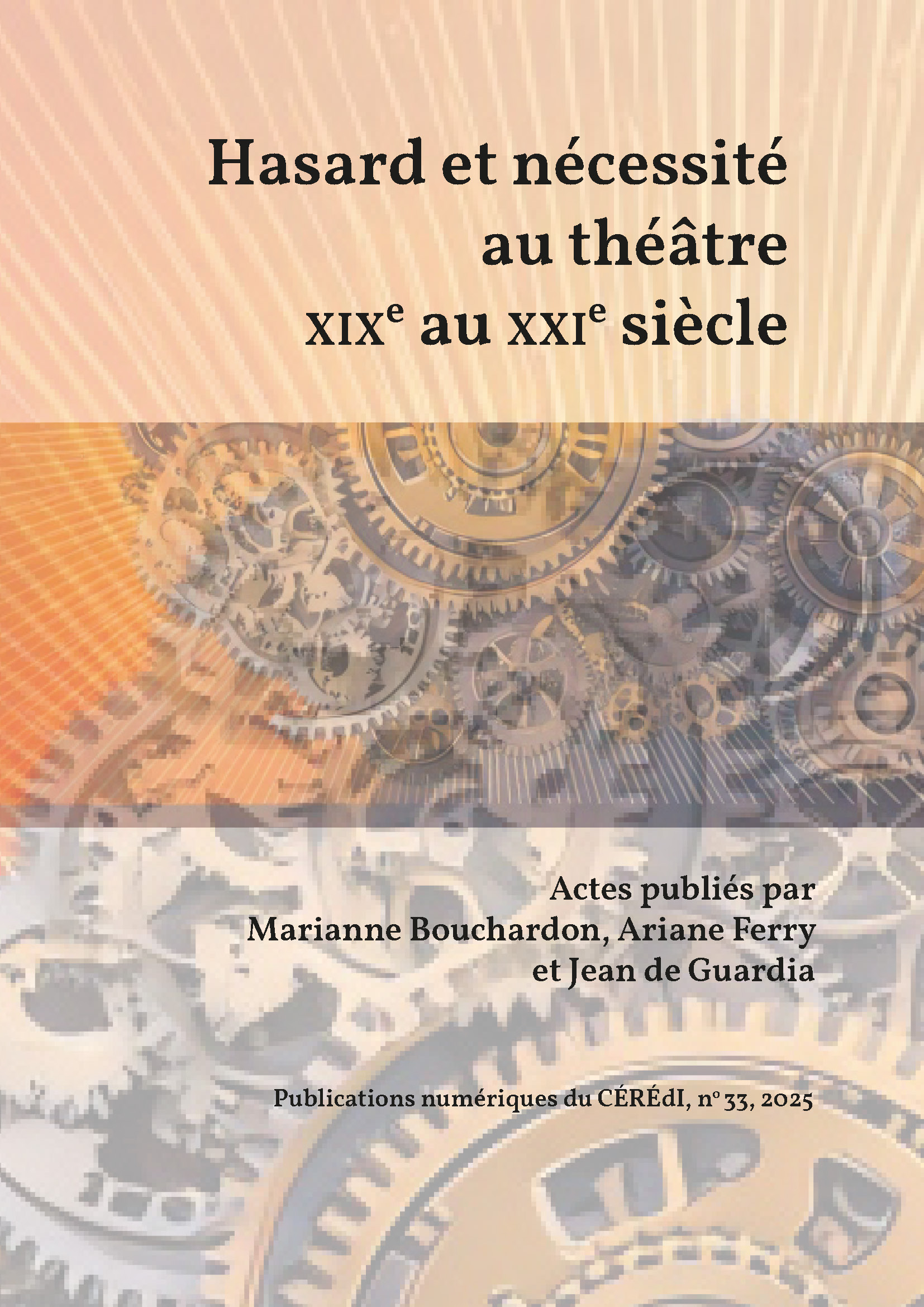
- Ariane Ferry, Marianne Bouchardon et Jean de Guardia Introduction
- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?
Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)
- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste
- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène
- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss
- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade
- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal
- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue
- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité
- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin
- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle
- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité
Barbara T. Cooper
À côté de ces variations sur le mal dont le traître est le sujet, il y a des variations sur un autre thème obligé : la catastrophe naturelle, orage, incendie, tremblement de terre, tempête, raz-de-marée ; le mal dû aux égarements de la nature se combine avec le mal dû à la perversité des hommes1.
Montrez-nous aussi un souterrain […]. [… Mais] rassurez-vous, âme sensible, il n’y aura pas de sang répandu : autant le tyran de la pièce en est altéré, autant la sage administration du théâtre en est avare2.
1Comment distinguer, dans Le Tremblement de terre de la Martinique d’Adolphe Dennery, mélodrame en quatre actes précédés d’un prologue, créé à la Gaîté en 1840, ce qui résulte du hasard de ce qui correspond à une nécessité3 ? La réponse est moins facile à formuler qu’on ne le croit et demande qu’on jette un coup d’œil rapide sur les conventions génériques et les considérations commerciales qui ont présidé à la composition de la pièce en même temps qu’on étudie sa trame idéologique et dramaturgique. On sait, par exemple, que les administrateurs des théâtres du Boulevard rivalisaient pour attirer les spectateurs dans leurs salles non-subventionnées et n’hésitaient pas à profiter de l’intérêt d’un sujet d’actualité ou d’un succès chez leurs voisins pour renflouer leurs caisses. Mettre en scène l’important séisme tellurique qui a secoué la Martinique en janvier 1839 serait ainsi le fruit d’un hasard, dans le sens que cet événement n’était pas prévu d’avance4. Mais, une fois arrivé, ce cataclysme se transformera en sujet incontournable, indispensable à l’administration et aux auteurs dramatiques qui souhaitent renouveler l’affiche de leur théâtre et faire de l’argent5. Prévoir le succès de la transformation de l’actualité géologique en drame était d’autant plus évident que d’autres tremblements de terre avaient déjà figuré dans des (mélo)drames joués sur les théâtres du Boulevard6. Deux groupes d’auteurs se sont donc mis à la dramatisation des événements qui ont bouleversé la Martinique en 1839 et fait de nombreux sinistrés. Le mélange du hasard et de la nécessité qui a présidé à la composition et la création de la pièce de Dennery ainsi élucidé, on peut désormais tourner notre attention vers la manière dont le dramaturge a façonné son intrigue et dégager la part qui revient au hasard de celle qui correspond à une nécessité.
Le prologue : le passé et ses secrets resurgissent et font trembler
2Si le titre de la pièce de Dennery annonce d’emblée la catastrophe naturelle qui va marquer sa fin7, le prologue, lui, revient sur des événements passés et désigne des personnages qui participeront aux péripéties qui vont se dérouler sous les yeux des spectateurs. Cet exposé des antécédents de l’action et la présentation des personnages est nécessaire à la bonne intelligence de l’intrigue par les lecteurs et spectateurs. Aussi le début du drame de Dennery laisse-t-il comprendre que la mort plane sur la vie de M. de Pontalban, planteur à la Martinique, et que son décès pourrait tout changer pour les esclaves noirs dont il est le maître et pour Marie, une mulâtresse qu’il a affranchie et dont il a récemment fait son épouse. Le prologue rappelle aussi l’existence d’un espace souterrain, depuis longtemps abandonné et muré, qui cachait les punitions infligées aux esclaves par l’ancien propriétaire de la plantation. Un vieil esclave craint que ces châtiments puissent recommencer si Robert, le neveu cruel et égoïste de Pontalban, hérite de ses biens, car tout enfant Robert avait observé et s’était délecté des tortures pratiquées dans cet endroit au passé sinistre8. Pontalban aussi a lieu de craindre le retour de Robert. Il a une fille, née de sa liaison avec Marie. Vivant en France et ignorée de tous à l’exception de ses parents, Jenny risque de devenir la victime de Robert si, avant de mourir, Pontalban ne refait pas son testament reconnaissant la légitimité de sa fille et son droit à sa succession. Si Marie tremble alors pour Pontalban et pour l’avenir de leur enfant, les Noirs tremblent devant Robert qui jaillit comme un diable de sa boîte, la cravache à la main, pour réclamer l’héritage de son oncle. Présenté dans la pièce comme s’il s’agissait d’un hasard, le retour de Robert est en fait une nécessité dramaturgique, la péripétie qui va déclencher l’action qui se développera dans les actes qui suivent. La confrontation entre Robert, son oncle et Marie est aussi une nécessité idéologique qui souligne le conflit entre bons et méchants typique du genre mélodramatique. Pontalban, outré par le mauvais comportement et l’avidité de son neveu ainsi que par son mépris pour Marie, mourra avant la fin du prologue, mais non sans avoir désigné Jenny sa fille légitime et son légataire universel9. Il a juste le temps de cacher les documents précisant ses nouvelles dispositions testamentaires et une importante somme d’argent avant son décès. Marie seule sait où retrouver ces preuves de la légitimité de Jenny et son droit à l’héritage de Pontalban que Robert voudrait détruire. Pressée par Robert, elle refuse de révéler ce secret. Aidé de Daniel, un esclave à qui il promet de l’argent et son affranchissement en échange de sa collaboration, Robert fera administrer un narcotique à Marie et fera croire qu’elle est morte plutôt qu’endormie. Puis il enfermera Marie dans le caveau souterrain de la plantation en attendant qu’elle consente à parler. Dix longues années vont se passer entre le prologue et le premier acte sans qu’elle fasse la moindre déclaration. Dans l’intervalle, Robert aura assassiné Daniel (du moins le croit-il). C’est un geste qu’il considère nécessaire à sa sécurité et au succès de son usurpation de la succession de son oncle.
3Mais avant de passer au premier acte de la pièce, revenons encore une fois sur le rôle du hasard et de la nécessité dans le prologue. Cette fois-ci, partons d’une citation de Michel Vinaver, dramaturge du xxe siècle qui ne connaissait sûrement pas la pièce de Dennery, mais qui parle d’expérience de l’enchaînement logique des différentes parties d’une œuvre dramatique. Selon Vinaver :
Au départ d’une pièce il n’y a aucun sens. Mais aussitôt l’écriture de la pièce commencée, il y a une poussée vers le sens, une poussée vers la constitution de situations, de thèmes, de personnages. À partir d’un noyau indéterminé issu de l’explosion initiale, la pièce n’arrête pas de se construire. À la fin, si elle est réussie, elle se présente comme un objet aussi rigoureusement construit que s’il y avait eu un plan préalable10.
4Or, si l’on accepte l’idée de Vinaver qu’une pièce se construit à partir d’un « noyau indéterminé issu de l’explosion initiale » et si l’on admet que « l’explosion initiale » dans ce cas, c’est le tremblement de terre de la Martinique qui eut lieu en 1839, on ne peut plus accorder de place au « hasard » dans la composition du Tremblement de Dennery, et encore moins considérer le cachot d’esclaves sous la maison de M. Pontalban comme un simple élément de « couleur locale11 » dans le décor. Bien au contraire, la présence de ce caveau souterrain dans la pièce serait non seulement un lieu commun du genre mélodramatique12, mais aussi une « nécessité » qui « parle » de tortures cachées et suggère que des secrets vont finir par surgir de dessous la terre pour bouleverser le monde colonial et faire trembler les méchants avant la fin de la pièce. Des observations faites par Hippolyte Lemaire en 1899 font croire que Dennery lui-même aurait volontiers souscrit à l’idée de Vinaver. Selon ce chroniqueur, « la situation était tout pour lui [Dennery] et, pour que la situation fût bien claire, il lui fallait des caractères et des sentiments nettement dessinés, intelligibles du premier coup, et en quelque sorte connus d’avance du public13. » Les conventions du genre mélodramatique lui fournissent de quoi satisfaire ces envies.
Nouvelle exposition des faits et évolution de l’intrigue au premier acte
5Le premier acte du Tremblement de terre de Dennery aura lieu donc, comme nous l’avons dit, dix ans après le prologue. Cet acte révèlera d’autres éléments liés à l’évolution de l’histoire et fera avancer l’intrigue. Avec la mort de Pontalban, l’emprisonnement de Marie dans le cachot souterrain et la prise de possession de la plantation par Robert, il s’agira dorénavant de découvrir ce que va devenir Jenny. Le père Gervaut, qui avait été chargé par Pontalban et Marie d’élever leur fille dans sa cure villageoise en Normandie, n’a pas de nouvelles du couple depuis longtemps et n’a plus les moyens de subvenir à ses besoins et ceux de la jeune femme. Leur silence et sa pauvreté motivent le voyage qu’il décide d’entreprendre avec Jenny en Martinique où il espère obtenir des renseignements sur le sort des parents de la jeune femme et des fonds qui leur permettront de vivre, lui et sa « fille ». Ce voyage aux Antilles est ainsi représenté comme une nécessité – nécessité occasionnée par le dénuement économique où se trouvent Jenny et le père Gervaut et le mystère qui entoure le destin de Pontalban et Marie.
6Une fois arrivés à la Martinique, Gervaut et Jenny apprendront la mort des parents de la jeune femme et la bonne fortune de Robert, devenu seul héritier des biens de son oncle et membre du conseil colonial de la Martinique. Comme Jenny n’a aucun document qui atteste sa naissance légitime et son droit à l’héritage de Pontalban, elle et Gervaut sont réduits à la pauvreté extrême et elle est obligée d’envisager la proposition de Robert qui la demande en mariage après avoir refusé de reconnaître ses droits à la succession de son père. Elle n’y consent qu’avec regret, ayant rencontré à bord du vaisseau qui les a amenés en Martinique un jeune marin sans fortune, mais bon et dévoué, dont elle est tombée amoureuse. Mais, voilà des mois que Jenny n’a plus de nouvelles d’Arthur qui fut obligé de repartir aussitôt arrivé à la Martinique. Or, le même « hasard » qui a présidé à leur rencontre lors du voyage transatlantique va dicter le retour d’Arthur à la Martinique. Enrichi de deux cent mille francs par un coup de chance14 et devenu maître d’un domestique noir nommé Daniel, Arthur arrivera le jour même où Jenny décide d’accepter d’épouser Robert pour éviter que Gervaut ne souffre de la misère et la faim.
7On ne sera peut-être pas surpris d’apprendre que le mot qui revient le plus souvent dans le dialogue de cet acte est « fortune ». Or, si ce mot prend fréquemment le sens de richesses (argent, terres et autres biens dont on dispose), il signifie aussi « tour favorable ou défavorable que prend une situation, un événement, sans que l’on puisse l’expliquer autrement que par la chance, le hasard15 ». C’est cette dernière définition qui explique la rencontre et le retour d’Arthur à point nommé pour empêcher le mariage de Jenny avec Robert – mariage déloyal et intéressé puisque Robert entend profiter du Code civil qui accorde à l’époux tout contrôle sur les biens de son épouse et empêche celle-ci d’initier une action en justice contre son mari16. C’est aussi le mot « fortune » pris au sens de « hasard » qui explique comment Arthur, jeune homme intègre mais pauvre, se trouve à la tête d’une belle somme d’argent et maître de Daniel – Noir qui aura miraculeusement survécu à la tentative de meurtre de la part de Robert et qui se souvient d’avoir aidé Robert à enfermer une femme au souterrain de la plantation dix ans plus tôt. (Ce genre de « hasard » est bien évidemment une péripétie nécessaire à l’évolution de l’intrigue.) À la fin de l’acte, alors qu’Arthur et Robert s’apprêtent à se battre en duel, c’est apparemment encore le « hasard » qui interviendra pour rappeler Arthur à son bord. En réalité, c’est un acte déloyal que Robert a arrangé d’avance et qui souligne sa scélératesse. Ce retard est aussi une nécessité dramaturgique pour reporter la résolution du conflit entre les deux hommes à un autre moment17. L’acte se terminera sur la demande que Jenny fait à Daniel de l’amener au cachot voir si la femme qui y fut enfermée est toujours vivante et s’il s’agit bien de sa mère.
Au cœur de la pièce, des crises souterraines et les premiers remous du tremblement de terre
8Le deuxième acte – acte qui se situe au cœur de la pièce – se passe au fond du cachot et amène des confrontations entre Robert, Marie et Jenny. Cet espace, typiquement associé au traître du mélodrame et à ses abus de pouvoir18, est le site de multiples crises souterraines. Crise de morale pour Marie qui, après dix années de souffrances et de privations, songe à renoncer à la vie, puis se ravise en pensant à Dieu, à son mari défunt et son devoir de mère. Crise d’angoisse pour Robert qui descend au caveau dans un état de perturbation psychologique tout aussi intense que celle de Marie. Il lui faut recouvrer sans plus attendre le testament et l’argent de Pontalban pour empêcher son déshonneur et sa dépossession de l’usufruit de la plantation. Pour cela, il doit persuader Marie de lui dire où sont cachées les preuves de la légitimité de sa fille et des intentions testamentaires de Pontalban pour qu’il puisse les détruire. Crise d’appréhension mêlée d’espoir, enfin, de la part de Jenny qui suit Daniel sous la terre à la recherche des nouvelles de sa mère. Elle va l’y retrouver et se fera reconnaître à l’aide d’une croix d’or – convention identitaire archiconnue et souvent utilisée dans les mélodrames du xixe siècle. Peu après, Jenny expliquera à Robert, qui lui pose la question, qu’elle a découvert l’entrée du caveau « par hasard » et que personne d’autre n’est au courant du passage qu’elle a emprunté pour arriver auprès de Marie. Robert ne sait pas s’il doit la croire et s’inquiète. Le spectateur / lecteur comprend que son incrédulité, dictée par la conscience de ses crimes, est tout à fait justifiée et nécessaire à la suite de la pièce.
9Tous ces personnages tourmentés se confrontent dans l’univers obscur et trouble du cachot et remueront des souvenirs du passé que Robert voudrait enterrer à tout jamais alors que Marie et Jenny voudraient les faire remonter à la surface et à la lumière du jour. Robert décide alors d’enfermer la mère et la fille au caveau pendant trois jours, le temps de réfléchir à sa demande. Après son départ, Daniel, qui s’était caché dans un autre coin du souterrain pendant ces entretiens, revient auprès de Marie et Jenny. Il va tenter de s’échapper par le soupirail qui donne sur un torrent coulant à côté du cachot. Portant autour du cou un sachet qui renferme le récit des souffrances de Marie – récit écrit dans le sang de cette innocente victime –, il espère surgir de dessous la terre et porter des nouvelles des deux femmes et des nouveaux forfaits de Robert à Arthur. Au moment où Daniel se met à grimper vers le soupirail, on entend les premiers bruits qui annoncent un tremblement de terre. La coïncidence entre le début de la crise tellurique et la concrétisation de la crise dramaturgique n’est pas le fruit du hasard. Dennery est un excellent « charpentier » dramatique et le titre de la pièce et le prologue avaient déjà laissé deviner le lien entre ces deux éléments19.
Des hommes et la nature fort agités et la trame de l’action bouleversée par le hasard
10L’acte trois verra de nombreux revirements provoqués par le hasard et montrera la nature et les hommes – Robert, Gervaut, Daniel, Arthur et le gouverneur de la Martinique – fort agités. Robert, craignant que quelqu’un d’autre que Jenny n’ait découvert le cachot où sont enfermées ses deux prisonnières, veille depuis deux nuits, des pistolets à la main, auprès de l’entrée du souterrain. Le père Gervaut, qui s’inquiète de l’absence de Jenny, semble surveiller les mouvements de Robert qui, en s’en rendant compte, se demande si le vieillard, venu se présenter chez lui, est plus retors qu’il ne le croit. Accusé par le prêtre de rapt, le traître détourne le blâme contre Arthur, retenu à bord son bateau depuis deux jours par son capitaine qui avait reçu un avis mensonger. Persuadé par l’explication de Robert, Gervaut voudrait dénoncer Arthur au gouverneur qui, comme par hasard, arrive aussi chez Robert pour se renseigner sur la disparition de Jenny. Alors que Robert quitte Gervaut pour aller à la rencontre du gouverneur, des Noirs transportant le corps de Daniel, qu’ils croient mort, passent à côté de la plantation en route vers le cimetière. La mer est fort agitée, le ciel se couvre et le vent semble venir du fond. Gervaut les fait entrer chez Robert pour dire des prières sur le corps du « défunt », mais découvre que Daniel n’est qu’évanoui. Il lui donne des soins et le fait placer dans la pièce à côté dont il ferme la porte. Gervaut reçoit des Noirs le sachet qui pendait au cou de Daniel quand ils l’ont retrouvé. Lisant l’écrit, il découvre l’histoire de Marie et des indications sur l’endroit où se trouve l’attestation de la naissance de Jenny et le testament et l’argent de Pontalban. Pendant qu’il part à la recherche de ces objets précieux, Robert et le gouverneur arrivent dans la pièce que Gervaut vient de quitter. Des bruits courent dans la ville de Saint-Pierre sur l’absence de Jenny et la disparition d’une autre femme de la plantation de Robert dix ans plus tôt. La rumeur accuse Robert de ces deux crimes, mais puisqu’il manque des preuves, Robert, s’appuyant sur le témoignage qu’il a dicté à Gervaut, échappe à l’arrestation. Le gouverneur n’est pourtant pas convaincu de l’innocence de cet homme. À son départ, l’orage se renforce et on entend des bruits souterrains. Gervaut a trouvé les documents et l’argent qu’il cherchait et revient les montrer à Robert qu’il ne soupçonne plus de l’enlèvement de Jenny. Face à ces preuves, Robert voudrait s’emparer de la fortune de Pontalban afin de quitter la Martinique. Pressé par Gervaut, Robert avoue ses crimes mais refuse de rendre l’or et les documents qu’il a pris de force au prêtre. Arthur arrive alors, accuse Robert de mensonges et de lâcheté et déclare la maison cernée par les forces de l’ordre. Pendant ce temps le ciel devient encore plus sombre, au point où l’action se passe dans une demi-obscurité. Alors que Robert cherche à fuir, Daniel, revenu à lui et armé de pistolets, lui fait face. Étonné de voir son ancien esclave vivant et dénonçant ses crimes, Robert fuit, menaçant la vie de Marie et Jenny si on le poursuit jusqu’au caveau. Alors qu’il descend au cachot, le tremblement de terre secoue l’habitation, démolissant les murs du bâtiment et barrant le passage qu’il vient d’emprunter.
11À lire cet acte, on se croirait presque dans une pièce de Labiche ou de Feydeau, tant la situation s’y complique et change de direction. Cependant, dans le drame de Dennery, les déplacements physiques des personnages n’ont rien de comique et s’accompagnent de l’ébranlement de la terre. Or, si c’est le « hasard » qui amène tous les personnages masculins à la plantation de Robert au moment où le tremblement de terre se produit et la vérité se fait sur le sort de Jenny et Marie, c’est aussi la conséquence d’une nécessité dramaturgique, une étape qui prépare la punition obligatoire du traître et la reconnaissance des droits des innocents. Ce sont les conventions du mélodrame « classique » qui imposent cette finalité morale20.
Mettre fin au pouvoir du traître et à la claustration des innocentes : conclusion « nécessaire »
12Comme nous venons de le constater, l’acte trois se termine sans qu’il y ait une résolution définitive à l’action. À l’acte quatre du Tremblement de terre, on découvre Robert, comme ses deux victimes, emprisonné sous la terre. Mais alors qu’elles sont impuissantes à sortir du caveau où elles risquent de mourir de faim et de soif, Robert est armé d’un poignard, signe de sa dangerosité persistante et son agentivité. Qui plus est, l’éboulement a séparé la mère et la fille tout juste réunies. Voilà ce qui fait monter d’un cran la température émotionnelle et la tension dramaturgique de la situation. En attendant, Robert s’est creusé un chemin vers ce qu’il croit être une sortie du caveau, mais qui ne l’amène que vers la partie du cachot où est bloquée Marie. Il est bientôt nécessaire de décider de quel côté les sauveteurs doivent faire tomber des poutres pour délivrer ceux qui sont enfermés sous les décombres du souterrain. Marie veut sauver sa fille, serait-ce au prix de sa vie et celle de Robert. Robert, toujours en possession de l’argent et des documents de son oncle, prétend être sauvé et laisser mourir Jenny et sa mère. Le contraste entre l’égocentrisme du traître et l’altruisme de Marie rappelle que ces personnages sont l’incarnation de la perfidie et de la bonté, cas de figure qui va dicter la résolution « nécessaire », incontournable, du dilemme. Aussi une poutre tombera-t-elle sur Robert, le tuant sur le coup. Marie et Jenny seront sauvées et, aidées de Daniel, remonteront à la surface où elles seront réunies à Gervaut et Arthur et verront leurs droits restaurés alors qu’on voit au fond du tableau la ville de Saint-Pierre détruite par le tremblement de terre. Cette scène sidérante de la destruction de la ville par le tremblement de terre et de la résurrection / restauration des bons dans leurs droits légitimes, attendue dès le début de la pièce par le public, est d’une nécessité dramaturgique et conforte le message idéologique du drame. Il est tout aussi vrai, selon André de Lorde, que « [Dennery] comprit tout de suite que le cœur du peuple, qu’il excellait à faire vibrer, ne devait manquer de tressaillir aux affres des Martiniquais21 ».
Conclusion : hasard ou nécessité ?
13Notre examen du Tremblement de terre de la Martinique avait pour but de montrer que le choix du sujet, le portrait de personnages et les développements de l’intrigue qui semblent le fait du « hasard » dans la pièce résultent, en réalité, des conventions dramaturgiques du genre mélodramatique et des nécessités commerciales liées à l’administration des théâtres non-subventionnés du « Boulevard du crime » à Paris. Le choix du cadre de l’action – la Martinique convulsée par un tremblement de terre – est le résultat d’un hasard fourni par l’actualité, mais le lien entre le séisme tellurique, les retournements fréquents de la situation et la commotion sentimentale que vivent les personnages dont la vie est bouleversée est tout à fait nécessaire à l’effet esthétique et moral que le mélodrame « classique » veut produire sur le public. Faire de la catastrophe naturelle et du désordre politique et social une source d’ordre relève d’un code esthétique qui met le tourment en scène pour l’évacuer. La « nécessité », qui convoque le « hasard » afin de créer le mal ou le crime, sert aussi en fin de compte à les éradiquer.
1 Anne Ubersfeld, Le Roi et le Bouffon : étude sur le théâtre de Hugo de 1830 à 1839, Paris, José Corti, 1974, p. 547. Cette leçon est déjà présente dans le Traité du mélodrame, par MM. A ! A ! A ! [Abel Hugo, Armand Malitourne, Jean-Joseph Ader], Paris, Delaunay, 1817, p. 68, « Le Mélodramaturge doit mettre à profite toutes les catastrophes contemporaines […] ». Ce Traité annonce, pour s’en moquer, les clichés du genre mélodramatique.
2 Traité du mélodrame, op. cit., p. 37, 39-40.
3 La pièce fut créée au Théâtre de la Gaîté le 23 janvier 1840 et l’édition originale date de cette année. Nous avons réédité cette œuvre en 2014 (Paris, L’Harmattan, coll. « Autrement Mêmes »).
4 Voir à ce sujet mon article « Évolution d’une pièce composée à deux : Le Tremblement de terre de la Martinique de Lafont et Desnoyer (1840) » dans Parcours de génétique théâtrale : de l’atelier d’écriture à la scène, dir. Ana Clara Santos, Sophie Proust, Ana Isabel Vasconcelos, Paris, Le Manuscrit, coll. « Entracte », 2018, p. 197-211.
5 Voir F. Bonnaire, « Bulletin », Revue de Paris, t. 14 (1840), p. 73, qui écrit au sujet du Tremblement de terre de la Martinique de Lafont et Desnoyer, pièce rivale jouée au Théâtre de la Porte-Saint-Martin : « M. Harel [administrateur de la salle] se serait accusé d’ingratitude envers la Providence, qui protège bien évidemment le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, s’il eût vu dans ce grand désastre autre chose qu’un nouveau miracle accompli en faveur de son établissement » et Maxime Gaucher, « Causerie littéraire », Revue politique et littéraire, 7 octobre 1876, p. 353-356. Voir aussi Pierre Causse, « La Catastrophe dans Macbeth et son devenir dans les adaptations scéniques de la pièce en France (1784-1942) », dans Écrire la catastrophe : L’Angleterre à l’épreuve des éléments (xvie-xviiie siècle), dir. Sophie Chiari, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, p. 238 : « Fin 1840, deux mélodrames joués à Paris se font concurrence pour mettre en scène la crue de la Saône qui eût lieu au début du mois de novembre […], et constituent un bon exemple de l’exploitation immédiate des catastrophes naturelles par la scène du temps. »
6 Voir par exemple Jean-Nicolas Bouilly, Le Désastre de Lisbonne, drame héroïque en trois actes, en prose, mêlé de danse et pantomime, Paris, chez Barba, an XIII (1804), Théâtre de la Porte-Saint-Martin ; Jean-Baptiste-Augustin Hapdé, Le Colosse de Rhodes ou le Tremblement de terre d’Asie, mélodrame en trois actes, Paris, Barba, 1809, Théâtre de la Gaîté.
7 Voir cette description de la fin de la pièce par un critique contemporain : « des événements bien conduits et qui se succèdent avec vraisemblance, amènent pour dénouement le tremblement de terre, qui termine la captivité de la mère et de la fille ; délivrance suivie du mariage des deux amants et de la mort du coupable Robert » (« Théâtre de la Gaîté. Le Tremblement de terre de la Martinique […] de M. d’Ennery », Journal des artistes, 2 février 1840, p. 78.)
8 Séquestrer la vertu, martyriser l’innocence sont des composants typiques du mélodrame quelles que soient les origines (raciales, nationales, socioéconomiques, politiques ou religieuses) des victimes. Voir par exemple mon étude, « Dans les marges du théâtre romantique : concurrence et industrialisation théâtrale sous la Monarchie de Juillet, l’exemple de Gaspard Hauser et du Pauvre Idiot (1838) », Revue d’histoire du théâtre, no 257, 2013, p. 41-52. Dennery est un des auteurs de Gaspard Hauser.
9 Une certaine somme d’argent sera pourtant réservée à Marie.
10 Michel Vinaver, Écrits sur le théâtre, Paris, L’Arche, 1998, t. 1, p. 130.
11 Voir, par exemple, Benjamin Antier et Alexis de Comberousse, Le Marché de Saint-Pierre, acte IV, rééd. Barbara T. Cooper, Paris, L’Harmattan, coll. « Autrement Mêmes », 2016 [éd. orig., 1839] (M. de la Rebelière : « Qu’on le [Donatien] mette dans le cachot au-dessous de ma chambre qui donne sur le petit parterre, où j’avais fait enfermer Vulcain, le borgne… Le diable en personne n’ébranlerait pas la forte grille qui le clôt d’un côté et la lourde porte qui le ferme de l’autre… » [IV, v]) et Almire Gandonnière, « La Créole », Nouvelles antillaises du xixe siècle, [1843], éd. Barbara T. Cooper, Paris, L’Harmattan, coll. « Autrement Mêmes », 2021, t. 3, p. 135-162, où des esclaves sont torturés dans un caveau souterrain. Voir aussi Caroline Oudin-Bastide, « Sévices contre les esclaves et impunité des maîtres (Guadeloupe et Martinique, xviiie et xixe siècles) », dans Caleidoscopios coloniales, dir. Ottmar Ette, Gesine Müller, Madrid, Iberoamericana et Frankfurt-am-Main, Vervuert, 2010, p. 193-212.
12 Voir, par exemple, Joseph Servière, Alphonsine ou la Tendresse maternelle, Paris, Fages, 1806 et Alexandre de Ferrière et Aimé Desprez, Marguerite de Strafford, ou le Retour à la royauté, Paris, Barba, 1816 ainsi que le Gaspard Hauser (1838) de Dennery, op. cit.
13 Hippolyte Lemaire, « Théâtres », Le Monde illustré, 5 février 1899, p. 94.
14 Voir acte I, scène 4.
15 Voir https://www.cnrtl.fr/definition/fortune, page consultée le 10 avril 2025.
16 Code civil, 1804, ch. v, art. 209-215 ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5857715b/f100.image, page consultée le 10 avril 2025.
17 Voir Michel Vinaver, Écritures dramatiques, Arles, Actes Sud, 1993, p. 594 : « Comprendre un texte de théâtre, c’est, principalement, voir comment il fonctionne dramaturgiquement. »
18 Dans La Petite Bohémienne, mélodrame comique de Louis Caigniez, Paris, Barba, 1816, un personnage décrit le souterrain comme le « séjour affreux du crime et de la plus noire perfidie » (II, 3). Voir aussi Les Frères féroces ou M. Bonardin à la répétition, mélodrame en un acte d’Armand-François Jouslin de La Salle, Paris, Fages, 1819, où le personnage de l’auteur dit à M. Bonardin : « Le deuxième acte se passe dans un des souterrains du château d’Altamor, à cent cinquante pieds sous terre » (scène 10). Cette pièce se moque des conventions du mélodrame.
19 « Charpentier » signifie ici auteur qui établit le plan d’une pièce de théâtre.
20 Voir Jean-Marie Thomasseau, Le Mélodrame, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1984, p. 44, sur la définition du mélodrame « classique ».
21 André de Lorde, « Le Tremblement de terre et le théâtre », Minerva, 15 septembre 1902, p. 305.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1960.html.
Quelques mots à propos de : Barbara T. Cooper
Université du New Hampshire (USA)
