Sommaire
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
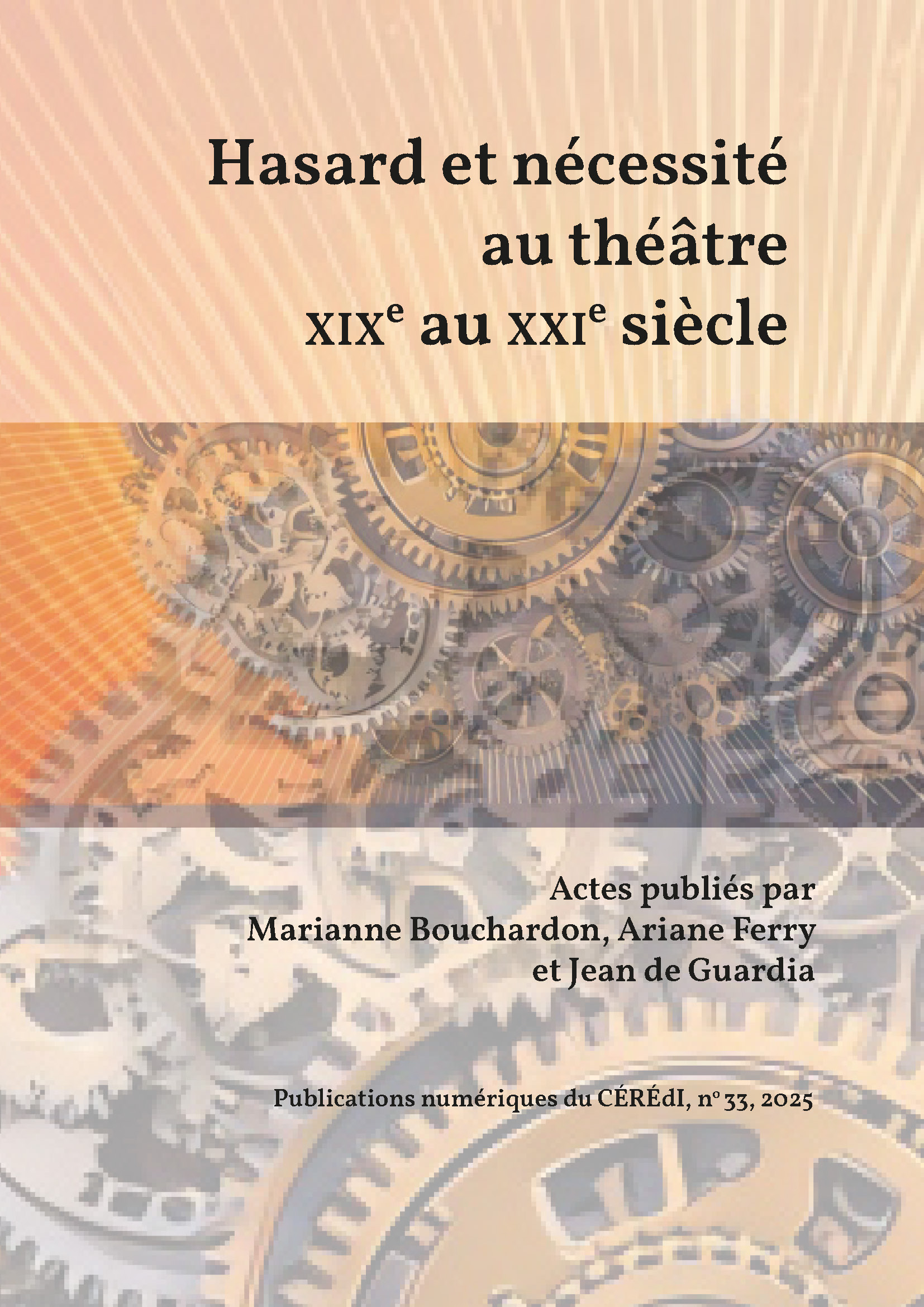
- Marianne Bouchardon, Jean de Guardia et Ariane Ferry Introduction
- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?
Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)
- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste
- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène
- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss
- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade
- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal
- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue
- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité
- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin
- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle
- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss
Pauline Philipps
1Quand Pierre Corneille évoque l’importance de la nécessité dans l’écriture théâtrale, c’est pour provoquer chez le lecteur-spectateur du plaisir. En remettant en question sa place dans leurs œuvres, certains dramaturges du xxe siècle comme Peter Weiss entendent faire de la scène un lieu d’expression de la souffrance, et créer des spectacles qui mettront mal à l’aise le public. En effet, interroger la question de la nécessité au théâtre n’est pas seulement un moyen de réinventer le genre, cela devient indispensable pour répondre au défi imposé par les tragédies qui ont lieu dans le monde réel : après la révélation des principaux crimes nazis et la découverte des camps, Theodor Adorno notamment s’interroge sur le rôle de l’art, et demande quel sens il peut bien avoir désormais à écrire un poème. Précisant sa pensée, il détaille au début des années 1960 dans ses Modèles critiques quelle est désormais la responsabilité de l’art : pour être authentique, un artiste doit proposer des œuvres qui fassent écho à l’horreur totale. En proposant une œuvre qui traite directement d’Auschwitz, Peter Weiss répond à ce défi, tout en réinterrogeant le principe de nécessité au théâtre. Sa pièce, intitulée L’Instruction, oratorio en onze chants (Die Ermittlung, Oratorium in elf Gesängen), a été composée à la suite des seconds procès d’Auschwitz au milieu des années 1960. S’inscrivant dans le genre du théâtre documentaire, elle prétend ne porter sur scène que des faits, sans autres remaniements de la part de l’auteur que les coupes qui ont pu être faites dans les témoignages ou l’agencement des différentes parties. Les exigences du sujet pèsent ainsi fortement sur cette déconstruction du rapport au hasard et à la nécessité au théâtre dans l’écriture de Peter Weiss, pour qui les règles cornéliennes ont vécu, en tout cas dès lors qu’il s’agit d’évoquer un tel sujet. Si le genre même du théâtre documentaire s’est rapidement essoufflé, et si peu d’auteurs se sont risqués à traiter aussi directement du sujet des camps de concentration, L’Instruction a provoqué dès ses premières représentations de vifs débats sur les schémas de la dramaturgie classique. Y est affirmée sur scène la toute-puissance de la contingence, au détriment de la nécessité narrative traditionnelle, perçue comme simpliste. Après avoir étudié la déconstruction partielle de l’idée de récit dans cette œuvre, nous montrerons comment Peter Weiss redonne toute sa place à l’angoissante contingence de l’Histoire. Alors qu’Adorno s’interrogeait sur la possibilité pour de l’art de survivre après Auschwitz, L’Instruction place au cœur de sa réflexion la question du rôle joué par le théâtre dans l’appréhension de tels événements : le re-jeu des événements historiques devient un temps nécessaire dans leur pleine compréhension par un public qui éprouve des difficultés à se mesurer à l’horreur de son passé.
Quel récit après Brecht ?
2Quand L’Instruction est jouée pour la première fois, le théâtre a déjà connu de nombreux bouleversements dans son rapport au récit et à la narration. La place du hasard et de la nécessité a été interrogée en profondeur, avant même la découverte des camps nazis.
3Les théories de Bertolt Brecht ont marqué un tournant dans le théâtre européen du xxe siècle, et si l’auteur du Petit Organon pour le théâtre est décédé en 1956, son œuvre prolifique influence encore les dramaturges des années 1960. Peter Weiss hérite ainsi du principe des effets de distanciation (« Verfremdungseffekte »), qui ont pour vocation de rappeler au spectateur que ce qu’il voit n’est jamais que théâtre, afin de l’empêcher de se laisser bercer par le récit. Ce faisant, il est censé être plus réceptif au message politique et social contenu dans l’œuvre. Le récit fictionnel continue d’être attaqué dans le cadre du théâtre documentaire par l’usage fréquent de ces effets. Dans L’Instruction, on retrouve ceux-ci tout d’abord pour les lieux et les décors, selon un procédé courant du théâtre brechtien. Ainsi Weiss précise-t-il dans les indications qu’il donne sur la manière de monter sa pièce qu’il ne faut surtout pas rechercher l’illusion, et reconstituer sur scène une vraie cour de justice1. La scène doit être la plus dépouillée possible, afin de répondre aux exigences du théâtre documentaire, qui veulent que l’on ne présente au public que des faits réels : la reconstitution des faits passés, quand bien même elle serait très fidèle, reviendrait toujours à montrer aux spectateurs une illusion. La scène est donc dépouillée, et seuls sont autorisés pour rappeler la salle du procès des images d’archives, projetées en fond. De même, reprenant à nouveau Brecht, Weiss indique qu’il faut qu’un même acteur joue plusieurs personnages, ces derniers étant dépourvus de noms, à l’exception de Lili Tofler, la seule à avoir lutté activement contre l’horreur de la mécanique des camps. Si des noms peuvent apparaître à certains moments dans les dialogues, ils ne sont pas repris devant les répliques, et les personnages sont simplement affublés de numéros. Un même numéro peut être associé à deux personnes différentes, le « troisième témoin » du deuxième chant ne reprenant pas les propos de la même personne historique que dans le septième chant, par exemple. Enfin, en qualifiant sa pièce d’« oratorium », Weiss s’inscrit explicitement dans le sillage de son prédécesseur, pour lequel la musique (et notamment l’« organon ») joue une place centrale dans le nouveau théâtre. L’Instruction est ainsi divisée en onze chants : tout comme la musique est un langage sans connecteur logique mais fluide, on retrouve à l’intérieur de chaque chant un enchaînement logique des répliques, sans pour autant qu’il y ait de liens explicites entre chaque morceau. Il s’agit, par la reprise des effets brechtiens, et en renonçant à l’ordre chronologique, d’effacer l’impression de nécessité dans l’arrangement des documents historiques, de proposer une œuvre fluide sans être absurde. Le récit fictionnel et sa nécessité classique ne sont par conséquent pas attaqués sous l’angle de l’absurde dans L’Instruction. Le recours aux effets de distanciation a, comme chez Brecht, pour but « d’amener le spectateur à considérer ce qui se déroule sur la scène d’un œil investigateur et critique2 ».
4Cependant, Peter Weiss ne prétend pas reprendre tout à fait l’esthétique brechtienne. En effet, il ne s’agit pas de réemployer une forme d’écriture qui a échoué à empêcher l’organisation des camps de la mort. Alors que très tôt l’auteur de Grand-peur et Misère du IIIe Reich mettait en garde ses contemporains, son œuvre n’a pas eu l’effet escompté. Dès lors, il devient compliqué d’utiliser les mêmes ressources, et de remettre en cause de la même manière les notions de hasard et de nécessité dans une pièce qui traite d’événements historiques tragiques comme ceux d’Auschwitz. Quand Brecht proposait ses effets de distanciation, il s’agissait pour lui de mettre à distance le récit fictionnel et sa nécessité afin de provoquer une réaction militante du public, le théâtre devant aider à « transformer » le monde, au-delà d’en proposer une simple interprétation3. Le théâtre se donnait un but politique actif, et prétendait pouvoir agir positivement en corrigeant les errances de la société. En parlant d’événements non pas contemporains, mais passés, Peter Weiss change déjà de perspective par rapport à Brecht. Il ne s’agit plus de montrer grâce à la redéfinition du rapport au hasard et à la nécessité comment se comporter aujourd’hui et dans l’avenir, mais de réfléchir sur ce qui a eu lieu. Le théâtre de Weiss est moins agissant que réflexif. La différence essentielle qu’il y a entre lui et son prédécesseur tient donc au fait que Brecht compose un théâtre explicitement idéologique, qui relit l’Histoire à l’aune de la vision communiste et engage à l’action, quand Weiss ne fait reposer son œuvre sur aucun de ces repères, et cherche davantage à faire voir le passé qu’à montrer comme agir dans le présent. La lecture idéologique du théâtre brechtien impose que les événements qui y sont traités sont présentés selon une certaine nécessité, celle imposée par la compréhension communiste du monde. Si Brecht déconstruit la conception classique de nécessité théâtrale via l’utilisation des effets de distanciation, c’est donc dans le but de proposer à la place une autre nécessité, celle de la lecture idéologique. L’absence de tels repères conduit Weiss à proposer avec L’Instruction une pièce sans reconstruction d’un récit nécessaire. Le théâtre documentaire marque ainsi un tournant dans la conception du hasard et de la nécessité dans l’art dramatique : Weiss lui-même le qualifie de « théâtre du compte-rendu », qui « se refuse à toute invention4 ». Le théâtre documentaire dans L’Instruction a pour ambition de se situer avant la mise en récit historique, et donc la relecture des événements selon un point de vue idéologique. Les faits sont présentés les plus nus possible, tous les éléments du texte devant préexister au travail de l’écrivain, dont la voix, créatrice de sens et reconstructrice de nécessité, doit être étouffée. En renonçant à la lecture idéologique, Peter Weiss s’éloigne de l’héritage de Piscator, qui avait avant-guerre posé les prémisses du théâtre documentaire, mais qui maintenait une vision marxiste des événements présentés. Weiss, en s’écartant comme il le fait de l’héritage de ses prédécesseurs, va donc plus loin que ne se proposait de le faire Brecht dans la remise en cause de la nécessité et dans le travail de son rapport au hasard au théâtre : en traitant d’un événement historique majeur passé, il rejette toute mise en récit qui lui donnerait du sens, d’autant plus qu’il ne prétend pas présenter sur scène une image des camps possibles d’« Auschwitz comme menace de demain » (« Auschwitz als Drohung von morgen »).
5Il ne s’agit pas de considérer les faits du passé pour apprendre à agir dans le présent, mais bien à conduire le spectateur à regarder ces crimes en face et ce qui les rend les plus atroces : le fait qu’ils semblent n’avoir été en rien nécessaires. L’idée de récit une fois mise à mal, ne restent plus que l’omnipotence du hasard, et l’horreur de l’angoissante contingence de l’Histoire.
L’angoissante contingence de l’Histoire
6Dans L’Instruction, Peter Weiss « revendique l’héritage de Piscator et Brecht, mais travaille aussi à s’en distinguer5 », proposant un renouveau radical de l’écriture dramatique. Le travail de l’écrivain doit s’effacer le plus possible derrière l’Histoire, qui n’est pas créatrice de sens. S’il s’agit d’ajouter le moins possible aux faits historiques, les choix qui sont faits dans la sélection des différents événements portés sur la scène participent tous à renforcer l’impression d’une contingence absolue de l’Histoire, effaçant autant que possible ceux qui auraient pu rappeler une idée de nécessité dans la manière dont tout s’est déroulé.
7Le théâtre de Weiss a pour prétention de se « resserre[r] autour du document qu’il diffuse sur scène, sans jamais en modifier le contenu, et l’organise selon le principe du montage afin de mettre à jour le schéma-type qui sous-tend le modèle réel observé6 ». Autrement dit, L’Instruction n’est pas une redite du réel, et l’agencement des éléments présentés doit aider à mettre en évidence ce qui est sinon difficilement perceptible. Weiss procède ainsi à de nombreuses coupes, souvent brutales, dans les documents qu’il a choisi de présenter, afin de dénoncer toute tentative de reconstruction d’un récit nécessaire à partir des faits des camps de concentration. Le choix même du titre est significatif : alors qu’il reprend des extraits des seconds procès d’Auschwitz, il intitule sa pièce « L’Instruction », ou « Ermittlung » en allemand, ce qui renvoie principalement au processus d’enquête, plutôt qu’au procès. Le titre suggère ainsi une recherche non encore aboutie : le sens de tous ces faits n’a toujours pas été trouvé. Alors même qu’un procès se donne pour objectif de mettre en récit un incident, et de répondre aux différents « pourquoi ? » soulevés au cours de l’enquête, en délivrant avec la décision finale du jugement une interprétation nécessaire des événements et de leur enchaînement, une instruction ne prétend pas avoir déjà atteint ces conclusions.
8Si Weiss reprend ainsi des documents des procès des années 1960, il procède à des coupes volontairement perturbatrices et réfléchies afin d’éliminer toutes les parties de ces procès qui explicitent les liens logiques entre les événements jugés. On observe notamment qu’il n’y a dans L’Instruction aucun débat, mais aussi aucun jugement. Aucune plaidoirie préliminaire n’est retranscrite, et les avocats, lorsqu’ils interviennent, ne le font généralement que pour poser des questions, pour lesquelles ils ne reçoivent que peu de réponses satisfaisantes. Ne sont ainsi proposés principalement que des bouts de témoignages, rarement entiers : ce qui perturbe le critique Walter Jens lorsqu’il découvre la pièce en 1965 constitue en fait une stratégie d’écriture novatrice à l’époque dans la représentation des camps, et une réponse de Weiss aux échecs relatifs de ses contemporains écrivains7. C’est en détruisant tout repère et tout discours visant à expliquer ces événements qu’il entend rendre le plus fidèlement possible ce qui s’est passé dans ce qu’on l’on qualifie souvent à l’époque d’« enfer8 ».
Une absence d’explication des événements
9De fait, les personnages de la pièce n’ont de cesse de rappeler qu’eux-mêmes ne comprennent pas ce qui s’est passé, ni même ce que l’on peut bien leur demander. Le terme de « Zufall » (« hasard ») revient ainsi dans toutes les bouches, et l’accusé no 8 explique même qu’il ne « sait absolument pas ce que l’on veut de lui » (« Ich weiss überhaupt nicht / was man von mir will9 »). Les victimes semblent ainsi avoir été tuées sans raison particulière (« Es kam eben vor / dass einer überleben sollte / und zu diesen wenigen / gehörte ich » : « Il arriva alors / que l’un de nous devait survivre / c’est de ce petit nombre / que je faisais partie10 »). Il y a ainsi une conscience profonde de ce hasard qui régit l’Histoire chez certains. Weiss ne nous donne accès à aucun point de vue surplombant, qui nous permettrait d’englober la totalité des événements, et donc de créer du lien entre les faits apportés à notre connaissance. Nous restons obstinément au niveau du point de vue des simples individus perdus dans une vaste réalité qui les dépasse. Personne ne vient apporter de réponses aux différents « pourquoi ? » posés, et le juge, le procureur et l’avocat n’apparaissent dans la pièce que comme des embrayeurs de discours. Plutôt que d’interpréter les faits présentés, ils posent des questions aux témoins et aux accusés, si bien que la pièce se compose surtout de tranches de vie : nous ne connaissons ni le début, ni la fin des existences des personnages qui prennent la parole. Weiss ne nous donne accès pour la plupart qu’au récit qu’ils font de ce qu’ils ont vécu dans les camps. Ce faisant, il ne se place pas du côté du « témoin oculaire » comme peut le faire Brecht, mais plutôt du côté de « l’archive » comme l’écrit Jean-Pierre Sarrazac11, une archive très parcellaire.
10Seule l’histoire de Lili Toffler, présentée dans le chant 5, contredit à cette logique, ce que l’on peut expliquer comme la volonté pour Weiss de mettre en lumière l’exemple d’une jeune femme – l’une des rares nommées – à avoir tenté de résister ouvertement au rouleau compresseur de la contingence historique.
11Le théâtre documentaire, tel qu’il est présenté dans L’Instruction, refuse par conséquent la nécessité du récit historique après avoir écarté celle du récit fictionnel. C’est ainsi qu’il force son spectateur à percevoir pleinement la contingence derrière tous les événements historiques, de la même manière que les individus contemporains de ces événements, et qui par définition ne pouvaient compter que sur les quelques éléments qu’ils connaissaient pour comprendre ce qu’ils traversaient, ont pu la connaître. Ceci n’est pourtant pas un renoncement ni un aveu d’échec de la part de Peter Weiss : c’est en effet ce refus même qui permet d’abolir la « distance sublime au nom de laquelle l’univers des camps nous est incompréhensible » selon Philippe Ivernel, reprenant les mots de Peter Weiss lui-même. Le théâtre, en renonçant ainsi à la nécessité, fait du hasard dramaturgique l’outil d’accès privilégié à une vision individuelle de l’Histoire : en s’attaquant aux codes classiques qui prétendaient régir la construction de toute pièce, L’Instruction fait de l’art dramatique un élément essentiel de ce que l’on appelle depuis les années 1990 le « devoir de mémoire ». Le théâtre devient une porte d’accès au vécu individuel des camps.
Le re-jeu des événements historiques
12La déconstruction de la nécessité dramatique du récit et de celle qui préside à toute lecture historique n’a ainsi pas pour but de nous faire renoncer à toute réflexion. Il y a bel et bien un sens à trouver dans une pièce comme L’Instruction, au-delà même du constat d’un non-sens absolu de l’Histoire. La prise de conscience de la contingence de celle-ci sert à affronter plus directement et avec le regard le plus honnête possible les événements évoqués. Si la société a mis du temps à accepter l’ampleur des crimes commis dans les camps de concentration ainsi que la logique meurtrière et industrielle qui y régnait, on ne peut pas dire que, vingt ans après, dans le courant des années 1960, et alors qu’une nouvelle génération d’êtres humains a remplacé la précédente, elle est prête à accepter la réalité de tout ce qui s’y est passé. Le théâtre a alors un rôle à jouer, répondant d’une certaine manière à la question posée par Adorno sur la possibilité même de la poésie après 1945 : en utilisant des procédés qui lui sont propres, loin donc du regard scientifique des disciplines historiques qui analysent, expliquent et mettent en récit les faits, la scène dramatique conduit les individus à se confronter à nouveau à des événements qu’ils souhaiteraient bien considérer comme passés.
13Peter Weiss écrit sa pièce à la suite des seconds procès d’Auschwitz, c’est-à-dire alors que les crimes commis dans les camps font à nouveau l’actualité dans les médias. Bien qu’elle paraisse vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, L’Instruction traite d’un sujet d’actualité pour ses contemporains. L’auteur y réagit face à des individus qui se refusent à se souvenir, et au premier chef les accusés eux-mêmes, qui n’avaient pas été inquiétés par la justice lors de la première instruction. De fait, si le théâtre documentaire tel que le pratique Weiss se veut davantage un théâtre « d’archive », on remarque qu’il insiste particulièrement sur la légèreté avec laquelle ces individus semblent prendre ce qui leur est reproché. Dans une pièce où les didascalies sont très rares, on relève à plusieurs reprises des indications de jeu comme « les accusés rient » (« die Angeglakten lachen »). Quand on leur reproche des faits graves, ils font le plus souvent mine de ne pas s’en souvenir et d’ignorer ce que leur apprend l’accusation. L’avocat de la défense joue sur cette question de la mémoire quand il essaie de jeter le discrédit sur les témoignages les plus accablants : « Mme la témoin / votre mémoire ne vous joue-t-elle pas des tours » (« Frau Zeugin / täuscht Sie nicht Ihr Gedächtnis12 »). En sélectionnant les moments où il est le plus question de ce problème du souvenir, Weiss insiste sur l’un des principaux rôles de tout procès : forcer l’individu à regarder en face ses crimes, et lui interdire de réécrire ses souvenirs et son histoire personnelle. Cette question se retrouve en effet régulièrement dans la pièce, et dès qu’un accusé parle, c’est bien souvent pour tenter d’imposer une autre version de ses actes. L’accusé 7 prétend ainsi qu’il était « aimé » (« ich war beliebt »), et affirme sa volonté de laisser derrière lui ces années des camps : « je ne veux rien de plus que vivre en paix » (« ich will nichts anderes als in Frieden leben13 »).
14Si les procès qu’a suivis Peter Weiss sont censés avoir rempli ce rôle, et conduit de nombreux accusés à faire face à la criminalité de leurs actes, c’est au théâtre qu’il appartient pleinement de forcer la société dans son ensemble à se souvenir, même si elle était absente à l’instant des procès et n’a pas suivi l’affaire. Weiss a en effet choisi de relever les passages où au-delà des accusés, des personnes qui n’ont apparemment pas commis de crimes essaient à leur tour de tordre la vérité et de la cacher. Le procureur affirme ainsi qu’il est évident « que la défense essaie avec cette tactique / d’empêcher la révélation de la vérité » (« dass die Verteidigung durch diese Taktik versucht / die Aufklärung der Wahrheit zu verhindern14 »). Les passages choisis lors desquels s’exprime l’avocat de la défense montrent en effet tous que des contemporains de la première mise en scène de L’Instruction cherchent à minimiser les faits.
15Peter Weiss touche ici à un point sensible pour la société des années 1960, et les critiques contemporains témoignent de la nécessité de ce travail mémoriel, même si tous ne sont pas d’accord sur la manière de procéder. Walter Jens a ainsi pu lui reprocher de ne pas être allé assez loin dans son texte, notamment en enlevant la conclusion des procès15. Selon lui, Weiss ne cherche pas à réfléchir au futur en évoquant la possibilité d’un « Auschwitz de demain16 », ne traitant que du passé : c’est parce qu’il s’agit de s’en tenir aux faits, et de ne surtout pas les dépasser pour faire de ce texte une fable, servant à autre chose qu’au rappel de ce qui s’est produit. En cela, son texte correspond à ce qu’écrit Tania Moguilevskaïa sur le théâtre documentaire, décrit comme « une forme génétiquement dépendante de son contexte socio-politique et idéologique17 ». L’Instruction est un texte qui a été écrit pour ses contemporains prioritairement, à une époque où l’on ne parle pas encore de « devoir de mémoire », et qui se donne pour seule mission de forcer le souvenir de ses premiers spectateurs.
16La pièce a été jouée pour la première fois en 1965, dans l’urgence, afin d’être vue juste après la conclusion des procès qui se sont tenus entre 1963 et 1965. Philippe Neveux explique que cette proximité entre les deux événements a contribué à faire de cette pièce un événement national. Weiss rappelle en effet le rôle joué par de nombreuses instances dans ces meurtres de masse qui dans les années 1960 ne sont pourtant pas vraiment inquiétées par la justice, et en particulier les industries chimiques. Le théâtre, en re-jouant ces procès et au-delà du choix particulier qui a été fait dans les coupes, entend ainsi faire ce qui a échappé aux tribunaux : si les coupables étaient trop nombreux pour être tous jugés, et si par conséquent les procès ne peuvent être qu’insatisfaisants au regard des atrocités commises, c’est à l’art en général et au théâtre en particulier qu’il revient de dénoncer ces coupables oubliés ou volontairement laissés de côté, afin de les empêcher de vivre normalement après ce qu’ils ont fait. L’Instruction met à nu la contingence judiciaire, rendue dans toute sa force sur la scène théâtrale par l’anonymat de témoins qui parfois ne sont pas des victimes, mais bien des complices, qui ne se trouvent pas sur le banc que les accusés, alors même qu’ils y avaient leur place. C’est ce que dénoncent à plusieurs reprises certains accusés eux-mêmes, critiquant ce qu’ils perçoivent comme une injustice des tribunaux : l’accusé no 8 par exemple explique qu’il ne comprend pas pourquoi lui plutôt que les autres a été choisi pour comparaître face à la cour, alors même qu’il a depuis 1945 « vécu en paix / comme tous les autres » (« ich habe ruhig gelebt / wie alle anderen auch18 »). Dans la société de 1965, des coupables vivent impunis, à qui le théâtre rappelle que ce n’est presque que grâce au hasard s’ils n’ont pas encore eu à répondre de leurs actes, et que, comme leurs camarades, la justice peut venir les chercher même après plusieurs décennies.
Aider à la prise de conscience de la « banalité du mal »
17Si les cibles les plus évidentes de la pièce sont donc tous ceux qui, qu’ils le reconnaissent ou non, ont quelque chose à se reprocher, le malaise qu’il fait naître tient à ce que Weiss accuse également ceux qui sont effectivement innocents de ce qui s’est passé. Il ne s’agit pas pour lui de diviser la société en deux catégories manichéennes : il n’y a pas d’un côté les coupables, de l’autre les innocents. Tout le travail qu’il mène sur la déconstruction de la nécessité a pour but d’attaquer cette tranquillité d’esprit illusoire que peuvent avoir ceux qui ne se sentent pas du côté des accusés. Weiss rend perceptible à travers sa pièce ce que Hannah Arendt dans les mêmes années décrit comme la « banalité du mal » : confronté au même contexte historique, n’importe qui peut devenir victime ou bourreau, et personne ne saurait dans les années 1960 ou même aujourd’hui répondre avec certitude de ce qu’il aurait fait dans les années 1940. Weiss décrit ainsi ce phénomène de déconstruction de l’humain, et la transformation contingente de l’individu, qui a fait que certains sont devenus « un morceau d’ordure19 ». L’un des témoins victimes de L’Instruction rappelle ainsi que le monde barbare des camps était devenu pour eux tous « le monde normal » (« zur normalen Welt wurde20 »). La répétition de la pièce, jouée et rejouée, invite, par sa mise en scène évidente de la contingence, à mettre en garde le spectateur : lui aussi pourrait, par « hasard », se faire monstre.
18Si la nécessité se trouve ainsi attaquée dans L’Instruction, c’est parce qu’elle nuit au projet même de la pièce. Afin de produire un texte qui parle correctement d’Auschwitz, et qui éveille les consciences des contemporains de Weiss sur la question en interrogeant leur responsabilité, celui-ci propose un nouveau rapport au récit et au théâtre. Faire revivre des événements passe par le rejet du récit dont la logique rassure mais aussi nous met à distance des faits contés, nous donnant un point de vue englobant sur les choses narrées. La nécessité a tendance à rassurer dans la mesure où elle donne en apparence du sens à ce qui s’est produit. Afin de présenter Auschwitz dans toute son horreur, le choix de la contingence s’est donc imposé : celle-ci, en frisant l’absurde tout en ne s’y soumettant jamais tout à fait, nous paraît, telle qu’elle est mise en évidence dans le théâtre documentaire, plus terrifiante encore. L’Instruction apporte sa propre réponse au rapport à la nécessité redéfini tout au long du xxe siècle par l’art théâtral : ce n’est pas seulement que la nécessité est trop facile, c’est bien plutôt qu’elle est trop factice, à une époque où les lectures idéologiques et religieuses, encore fortes, commencent à s’essouffler. La nécessité, qui passait pour l’un des signes de l’art au théâtre à l’âge classique, devient moins un signe de virtuosité que d’artificialité dès lors que l’on traite d’un sujet aussi problématique qu’Auschwitz. Si Peter Weiss, en composant sa pièce, souhaitait s’adresser prioritairement à ses contemporains (il fallait urgemment réagir pour que cette volonté de mettre derrière soi le passé – voire de minimiser les crimes commis –, qui s’était manifestée à l’occasion des seconds procès d’Auschwitz, n’en vienne pas à étouffer la vérité et à excuser les coupables), celle-ci, par ses réflexions dramaturgiques sur la composition d’une œuvre théâtrale, mais aussi par ses réflexions plus générales sur la question de la culpabilité et de l’individu devenu bourreau, parle encore aujourd’hui.
1 Peter Weiss, Die Ermittlung, Frankfurt am Main, Suhrkamp,1991, p. 9.
2 Bertolt Brecht, Écrits sur le théâtre I, Paris, L’Arche, 1972, p. 330.
3 Ibid., p. 242.
4 Peter Weiss, « Notizen zum dokumentarischen Theater », dans Rapporte 2, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1971, p. 91.
5 Sylvain Diaz, Philippe Ivernel, Hélène Kuntz, David Lescot, Tania Moguilevskaïa, « Mettre en scène l’événement : Tretiakov, Weiss, Brecht, Gatti, Vinaver, Paravidino, Jelinek… », Études théâtrales, nos 38-39, 2007, p. 87.
6 Ibid.
7 Ernst Shumacher, « Die Ermittlung von Peter Weiss: über die szenische Darstellbarkeit der Hölle auf Erden », dans Peter Weiss, Die Ermittlung, éd. citée, p. 211-233.
8 Ibid.
9 Peter Weiss, Die Ermittlung, éd. citée, p. 21.
10 Ibid., p. 72.
11 Jean-Pierre Sarrazac, « Le témoin et le rhapsode ou le retour du conteur », Études théâtrales, nos 51-52, 2011, p. 16.
12 Ibid., p. 60.
13 Ibid., p. 49.
14 Ibid., p. 81.
15 Walter Jens, « Die Ermittlung in Westberlin » [1965], dans Peter Weiss, Die Ermittlung, éd. citée, p. 209.
16 Ibid., p. 209.
17 Tania Moguilevskaïa, « Les variables idéologiques du théâtre, de Peter Weiss aux dramaturgies russes actuelles », Études théâtrale, nos 50, 2011, p. 36.
18 Peter Weiss, Die Ermittlung, éd. citée, p. 22.
19 Peter Weiss, « Laocoon ou les limites de la langue », trad. Françoise Delignon et Hédi Kaddour, Po&sie no 141, 2012, p. 117.
20 Ibid., p. 38.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1954.html.
Quelques mots à propos de : Pauline Philipps
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3329
