Sommaire
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
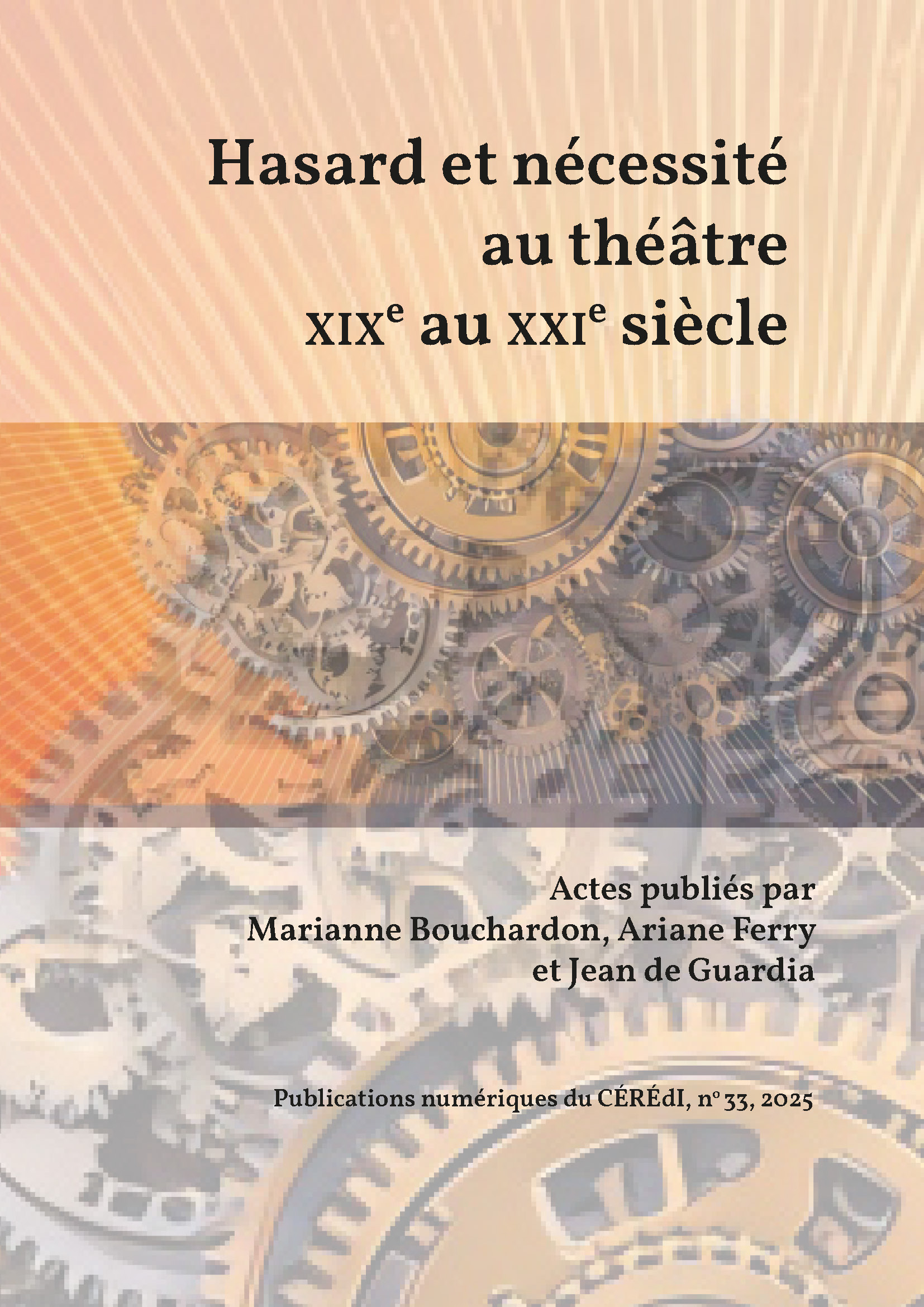
- Marianne Bouchardon, Jean de Guardia et Ariane Ferry Introduction
- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?
Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)
- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste
- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène
- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss
- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade
- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal
- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue
- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité
- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin
- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle
- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
« Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade
Nina Roussel
1
Random (adj.): Having no definite aim or purpose; not sent or guided in a particular direction; made, done, occurring, etc., without method or conscious choice; haphazard1.
2random, c’est le titre retenu par la dramaturge anglaise d’origine jamaïcaine debbie tucker green2 pour sa pièce créée à Londres en 2008 qui prend pour sujet le meurtre au couteau d’un adolescent noir en Angleterre3. La pièce met en scène une famille ordinaire saisie à travers de menus actes du quotidien, au cours d’une journée dont le cours est bouleversé par la disparition brutale du plus jeune membre du foyer : un garçon sans histoire4 abattu hors-scène, sur le chemin de l’école. Et la famille de devoir vivre avec cette mort absurde, ce tragique coup du sort. Point de hasard pourtant (« not no random5 ») dans les blessures mortelles infligées à l’adolescent, constate sa sœur à la découverte de son corps mutilé, tandis que la forme même de la pièce (création d’un certain nombre d’effets de prévisibilité, réinvestissement d’une fatalité tragique) interroge discrètement la contingence de ce crime qui, dans le contexte anglais qui inspire la pièce, arrache la vie à un nombre démesuré d’adolescents noirs. « Random don’t happen to everybody. » constate amèrement la sœur du défunt, « So. / How come / “random” haveta happen to him? / This shit ent fair6. » « Pourquoi / le “hasard” devait lui arriver à lui7 ? » : c’est une question analogue qui tourmente la protagoniste de mauvaise [born bad], agressée sexuellement dans son enfance. Comme random, mauvaise thématise et met en débat la question du hasard en son sein. Une pulsion exercée aléatoirement dans un parking souterrain, une femme violée en rentrant chez elle la nuit, par un inconnu : les représentations communes du viol déclinent à l’envi ce scénario articulé autour d’une femme au mauvais endroit au mauvais moment, et qui fait les frais d’une violence terrible mais exceptionnelle. La réalité évidemment est tout autre, et la vague #MeToo nous a rappelé – si besoin en était – la dimension ordinaire du viol, qui est rarement le fruit d’une rencontre fortuite, puisque dans l’écrasante majorité des cas, l’agresseur appartient à l’entourage proche de la victime. C’est de cette réalité tristement banale que se saisit debbie tucker green dans mauvaise (20038), que nous souhaitons mettre en regard de deux pièces de la Française Pauline Peyrade : Poings (2018) et À la carabine (2020).
3Avec son esthétique fragmentaire, la brutalité et la crudité extrême de sa langue comme des expériences traumatiques endurées par ses personnages, le théâtre de Pauline Peyrade s’impose – depuis la première pièce de l’autrice Ctrl-X (2016) – comme un théâtre « coup de poing9 ». Cette formule reste étroitement associée au théâtre anglais dit In-Yer-Face des années 1990, dont debbie tucker green a pu être désignée comme une représentante tardive à la création de sa première pièce dirty butterfly qui, présentée au public deux mois avant mauvaise, évoque déjà la question des violences sexuelles. Pourtant, à rebours d’un théâtre In-Yer-Face qui misait sur une actualisation scénique, explicite et spectaculaire de la violence, les pièces de debbie tucker green et de Pauline Peyrade ne montrent pas l’action violente qui – comme l’écrit Élisabeth Angel-Perez à propos entre autres du théâtre de tucker green – se trouve « relog[ée] […] au cœur d’une parole réhabilitée qui la remplace et la reconfigure », geste fondateur à ses yeux d’un théâtre « In-Yer-Ear10 », plus agressif pour l’oreille que pour l’œil. Les trois pièces qui nous intéressent, qui ont largement contribué à la reconnaissance de leurs autrices11, sont particulièrement représentatives du paradoxe illustré par ces théâtres « coup de poing ». Dans mauvaise, Poings et À la carabine de fait, la « catastrophe » – qui survient en l’occurrence dans l’espace de l’intime – a déjà eu lieu au lever du rideau, et ressurgit par bribes, au prisme de la mémoire et de la parole des victimes ainsi que de celle de leur entourage. Poings de Pauline Peyrade s’articule autour d’un viol conjugal, point de bascule dans l’histoire d’un couple et dans la prise de conscience d’une femme sous l’emprise de son compagnon. À ce viol répond celui d’À la carabine : la pièce met en scène une jeune femme qui, abusée dans son enfance par un ami de son frère, et reconnue consentante par la justice, décide de se faire justice elle-même en retournant contre son agresseur la violence subie. Enfin, mauvaise nous installe, le temps d’une journée, au cœur du foyer d’une famille afro-descendante dont l’une des filles décide de briser le silence sur l’inceste qu’elle a subi enfant. Elle, Fille, prend successivement à partie chacun des membres de la famille (Père, Mère, Sœur 1, Sœur 2 et Frère) auprès desquels elle tente de glaner des bribes de ce souvenir hautement conflictuel.
4En somme, ces trois pièces ancrées dans le temps de l’après-coup et du trauma, donnent à voir des personnages féminins qui s’efforcent de redonner un sens à cet événement ou période traumatique de leur vie ; et qui tentent d’apercevoir la logique d’une histoire qui en semble dépourvue. Et si cette logique se dérobe, c’est sans doute en partie parce qu’elles doivent composer avec le viol perpétré par un proche, conduite qui entre en contradiction absolue avec les représentations du viol communément admises autant qu’avec quelques-unes des croyances partagées les plus fondamentales, qui excluent par exemple la possibilité d’une telle violence d’un père envers sa fille. Nous verrons également que l’entourage des victimes à son tour, en juge intransigeant de la vraisemblance de leurs histoires, s’efforce de motiver a posteriori cet événement inacceptable. À partir de ce qui peut être lu comme une mise en abyme du geste auctorial de motivation des faits, nous aimerions étudier le traitement et pour ainsi dire l’impact de cet événement paradoxal (puisque contraire à la doxa) sur le système de causalité dramatique dans ces trois pièces.
« somewhere somethin ent runnin true this piece just don’t add up » : un événement paradoxal, le drame en morceaux
5Poings, À la carabine et mauvaise sont construites autour de la contradiction ou disjonction radicale entre un fait (le viol perpétré par un ami, un conjoint, un père) et la croyance partagée ou si l’on veut, la maxime communément admise que serait l’amour ou la bienveillance prêtée à un proche ; contradiction qui rend l’événement proprement incompréhensible aux yeux des victimes. Cette croyance ou maxime se trouve en quelque sorte résumée à travers le refrain chanté par le personnage féminin de Poings au moment de sa rencontre avec celui qui deviendra son compagnon, au cours d’une rave party : « You can’t hurt me cause I know you love me12. » Tout au long de cette scène de « première vue », la jeune femme répète inlassablement cette scie, ce poncif qui se transformera en piège. La scène se clôt sur les mots de la jeune femme qui, comme pour mieux le faire sien, traduit désormais le refrain en français : « Je n’ai pas mal puisque je sais que tu m’aimes13. » Pendant toute la durée de la scène de viol qui succède à ces mots, le cruel petit refrain résonne encore aux oreilles du lecteur-spectateur, comme l’expression du déni mortifère du personnage.
6De cette contradiction et de l’incompréhension qu’elle engendre témoigne aussi la litanie des « pourquoi ? » que Fille adresse à sa mère dans mauvaise (scène 7) ; une mère qui, selon les dires de Sœur 1, l’aurait choisie parmi ses frères et sœurs pour ce qui est présenté comme un sacrifice au père :
Pourquoi t’as pas choisi de m’laisser en dehors de ça comme t’as fait pour eux ? Pourquoi j’ai pas pu pas savoir comme elle là et avoir la fabuleuse enfance de celle-là ?
Pourquoi t’as pas choisi ça pour moi.
Hein, pourquoi ?
Pourquoi tu m’l’as fait à l’envers comme ça ?
Pourquoi tu m’as fait jouer l’épouse quand j’aurais dû rester la fille ? Pasque la fille c’est ça qu’j’étais.
Ça que chuis. J’étais pas toi. J’aurais pas dû m’trouver à faire c’que toi t’aurais dû faire – c’que tu voulais pas faire, hein ? Et t’aurais pas dû m’choisir pour ça14.
7À travers cette cascade de questions introduites par « pourquoi » (« how come? » dans le texte anglais, c’est-à-dire littéralement « comment ça se fait ? »), associées à la présentation systématique d’un scénario alternatif, jaillit toute la force du scandale engendré par cette situation aberrante et contre-nature. S’y exprime en effet la conscience confuse de ce que l’une des lois humaines les plus fondamentales a été bafouée, l’interdit de l’inceste en l’occurrence. Dans le même temps, l’inceste demeure significativement passé sous silence, indicible : Fille s’y réfère au moyen de pronoms anaphoriques (« m’laisser en dehors de ça », « leave me outta it ») dont les référents ne sont jamais élucidés, de périphrases (« c’que toi t’aurais dû faire », « what you shoulda done »), voire de structures verbales privées de leur complément, comme dans cette phrase où l’emploi intransitif du verbe « savoir » associé à la double négation offre une traduction formelle – et pour ainsi dire grammaticale – à l’anomalie dénoncée par Fille : « Pourquoi j’ai pas pu pas savoir ».
8Ce conflit généré par les viols au cœur de nos pièces est parfois résolu par une négation des faits ou par leur requalification – ce qui revient de fait à nier le viol en tant que tel. Ainsi de la décision de justice dans À la carabine qui fait suite à l’agression d’une jeune fille par un ami de son frère. Cet après-midi-là, le jeune homme avait été envoyé auprès d’elle par la mère de la jeune fille elle-même, inquiète de la savoir seule à la fête foraine. « Elle a raison […] de bien te surveiller », commente l’adolescent à son arrivée, avant d’ajouter – ô terrible ironie : « Y a plein de mecs pas nets ici15. » La pièce convoque d’entrée de jeu un horizon d’attente lié aux représentations communes du viol : les agresseurs potentiels sont les hommes « pas nets », délinquants et/ou psychopathes, toujours des inconnus en tout cas, toujours « autres ». Pas une seconde la mère de la jeune fille ne semble avoir envisagé que ce garçon connu de la famille puisse représenter un danger pour sa fille. C’est en effet un adolescent plutôt tranquille, un peu loser, du genre « sans histoire », que les lecteurs-spectateurs ont découvert, dialoguant avec la jeune fille, ce jour de fête foraine. Elle jouait à un stand de tir à la carabine. Lui, l’ami de la famille, s’est approché, a insisté pour l’aider à atteindre la cible, elle a refusé. Ils se sont taquinés. Il lui a proposé d’aller manger une barbe à papa. L’instant d’après, c’est le viol, qui surgit au beau milieu de la pièce. Cruel reflet des premières impressions des lecteurs-spectateurs face à ce jeune homme, les bribes du procès qui nous parviennent à la fin de la pièce dessinent le portrait d’un adolescent banal, trop banal aux yeux de tous pour s’être rendu coupable du crime qui lui est reproché : « on le connaît, tout le monde le connaît, jamais d’histoires, normal, c’est un garçon normal16. » Forcément inoffensif donc.
9Dans mauvaise, l’accusation portée par la protagoniste fait l’objet d’un discrédit analogue. L’une de ses sœurs cadettes, en particulier, oppose à sa sœur abusée dans son enfance une négation pure et simple des faits ; sœur qu’elle traite tour à tour de malade et de menteuse. L’inceste n’a pas sa place dans le récit familial, voilà ce que Sœur 2 signifie à Fille lorsqu’elle déclare : « somewhere somethin ent runnin true this piece just don’t add up17. » Le terme « piece », qui renvoie ici implicitement à l’inceste, évoque l’image du morceau ou de la pièce résiduelle qui peine à s’assembler à l’ensemble. Les traductrices françaises insistent significativement sur le défaut de logique et de vraisemblance pointé par Sœur 2 : « tu vois y a un truc qui cloche là – kekpart y a kekchose qui marche pas – et là c’est juste pas logique18 » (nous soulignons).
10Cette absence de cohérence pointée par les personnages eux-mêmes trouve en quelque sorte une traduction formelle à travers des dramaturgies caractérisées par la discontinuité et la déliaison, qui semblent marquer l’impossibilité de lier les faits à travers des rapports de cause à effet. De ces histoires ne demeurent en effet que des éclats brisés, des « bouts », pour reprendre le terme employé par les membres de la famille de mauvaise, des bribes de souvenirs qui sont autant de versions irréconciliables d’un même passé. Aussi Sœur 2 a-t-elle beau jeu d’affirmer à Fille – telle une spectatrice sceptique :
des bouts, ça compte pas. Des bouts, c’est pas assez. […] des bouts, ça fait pas l’plus gros et l’plus gros ça fait pas l’tout et tous tes bouts ensemble ça fait pas qu’ta version elle est vraie ni mainnant ni après19.
11Dans Poings et À la carabine, qui se présentent précisément comme des pièces en morceaux, Pauline Peyrade opte pour une composition elliptique et désordonnée. À la carabine s’offre ainsi comme un puzzle à reconstituer, composé d’une trentaine de séquences numérotées qui relèvent de différentes temporalités. Le lecteur a ainsi tôt fait de comprendre qu’en dépit des numéros des saynètes qui peuvent laisser attendre un déroulement linéaire, il lui faut distinguer entre plusieurs ensembles ou « séries » au sein de la pièce : les scènes de vengeance que l’on suppose ancrées dans le présent, l’épisode de la fête foraine qui conduit au viol et qui constitue une sorte de flash-back, et entre ces deux temporalités, d’autres séquences plus difficiles à situer temporellement, dont certaines intitulées « entraînement », qui donnent à voir la préparation au combat de la jeune fille devenue femme. Or, la logique ou le principe ordonnateur qui sous-tend cet entremêlement se dérobe aux yeux du lecteur-spectateur qui peut – du moins au premier abord – avoir la sensation d’une juxtaposition de scènes assez arbitraire.
12Poings repose sur un principe de composition analogue, avec cette fois uniquement cinq parties, dotées d’un titre ; cinq parties qui correspondent à cinq moments clés de l’histoire du couple, unies donc par un référent commun mais formellement hétérogènes, puisque chaque « partie » possède une dramaturgie – et une « scénographie » du texte sur la page – qui lui est propre. Pour apprécier la force de l’ellipse entre ces différentes sections, revenons à la première d’entre elles, « OUEST », qui met en scène la rencontre entre les deux personnages de la pièce. À ce moment marqué par l’évidence du coup de foudre amoureux et l’ivresse d’une danse partagée succède la scène de viol, dont le lecteur-spectateur comprendra a posteriori qu’elle intervient pour le couple après un certain temps de vie commune :
J’ouvre les yeux. Son sexe est dans ma bouche. Sa main sur ma nuque. Il pousse. J’essaie de me dégager. Je ne sens plus mes bras. Son poing dans mes cheveux. Il s’agrippe. Ça tire. Il pousse encore. Une mèche de cheveux dans ma bouche. Je secoue un peu la tête. Il pousse plus fort. Je secoue la tête. Il serre plus fort mon cou. Ça fait mal. Il s’énerve. Il appuie très fort. Ma mâchoire cède. Il s’enfonce. La salive coule sur mon menton. Des bruits terribles s’échappent de mes lèvres. Je crie20.
13Cet extrait permet aussi d’observer, à une autre échelle, l’effacement des liens logiques : la dislocation du langage, son atomisation et l’adoption d’une syntaxe paratactique – qui traduit ici la terreur, l’impossibilité d’une pensée articulée face à la douleur et la nécessité pour le personnage d’organiser sa survie – viennent redoubler, au niveau de l’enchaînement des phrases, l’esthétique de la juxtaposition qui prévaut au niveau de la structure d’ensemble de la pièce.
14Cet effacement ou affaiblissement des articulations logiques se retrouve chez debbie tucker green, dont la langue est marquée en outre par des interruptions constantes, des phrases voire des mots avortés et laissés en suspens. Émaillées de répétitions, ces prises de paroles tronquées évoquent le bégaiement. De nombreux termes circulent entre les différents membres de la famille : c’est le cas de « chienne » (« bitch ») – insulte de Fille à sa mère scène 2, retournée contre Fille par la suite, à de multiples reprises –, du verbe « se souvenir » et du substantif associé, ou encore, du terme « rien », comme ici à l’échelle d’une réplique adressée par Fille à sa mère (scène 2) : « Et j’vais l’dire comme si c’est rien, et j’vais l’dire comme ça, comme le rien qu’c’est, comme le rien qu’t’es, comme le rien qu’t’as essayé d’faire de moi21. » Comme le souligne Hélène Lecossois dans « L’écriture du traumatisme de debbie tucker green ou la mise en jeu de la répétition », la récurrence du « nuthin » au sein de cette réplique, soit le paradoxe de ce « trop de “rien”22 » met en évidence la présence-absence du trauma – à la fois omniprésent, obsédant, et passé sous silence – et l’impossibilité d’inscrire le traumatisme dans le registre symbolique.
15Ces multiples répétitions à l’échelle de la réplique comme de la pièce tout entière créent des effets de leitmotiv et d’échos entre les différentes occurrences des termes réitérés, qui défient la logique linéaire de la lecture, autant qu’elles désignent discrètement la « logique » toute émotionnelle qui structure le déploiement du texte dramatique : celle du traumatisme.
Réassigner une nécessité à l’événement : du procès de la victime à la mise en évidence des mécanismes de l’emprise
16À une logique immédiatement accessible, Poings, À la carabine et mauvaise substituent donc une expérience du choc et de la désorientation, et une « logique » qui ne se dévoile qu’après coup, pour peu que le lecteur-spectateur s’efforce de rassembler les morceaux de ces histoires brisées. Les dispositifs dramatiques qui les accueillent désignent un jeu de déterminations complexes, incluant notamment des mécanismes d’emprise, qui s’inscrivent à rebours des « explications » produites par certains personnages des pièces. On remarquera en effet que lorsqu’ils ne sont pas purement et simplement niés, les faits sont admis par l’entourage de la victime, au prix de la production d’une explication qui leur permet d’évacuer ou dépasser la contradiction évoquée plus tôt. Dans mauvaise, l’une des sœurs de la protagoniste, Sœur 1, se réfère ainsi à une providence divine. Pour elle, aucun doute, le fardeau qui est échu à sa sœur aînée s’est accompagné d’un don de Dieu : celui de la force, d’un caractère exceptionnel, qui la rendrait apte à endurer cette épreuve :
Tu sais, t’es forte.
T’as reçu l’don de la force, ouais. Rends grâce pour ça. Dieu t’a fait comme ça – t’a fait forte comme ça. M’man a vu cette force, elle a vu ça elle a choisi – elle a choisi facile23.
17Et Sœur 1 de conclure : « C’était pas par hasard. / Ça s’est pas fait au ptit bonheur la chance – ou au petit malheur malchance. Selon que. / C’était pas par malchance. Nan24. » À travers une variation autour du champ lexical du hasard (enrichie en français par la trouvaille des traductrices qui détournent l’expression « au petit bonheur la chance »), nié avec vigueur par Sœur 1, l’inceste subi par Fille est transformé en élection, dont le père est significativement tenu à l’écart : seul demeure le Père et ses projets, ainsi que son exécutrice : la mère. De fait, si la pièce s’apparente à un long procès, au cours duquel comparaissent tour à tour tous les membres de la famille, le père quant à lui, c’est-à-dire l’agresseur, n’est jamais inquiété. Dans la mise en scène de Sébastien Derrey, il demeure assis sur sa chaise, quasi silencieux pendant toute la durée du spectacle, et regarde le reste de la famille se déchirer sous ses yeux. Au fur et à mesure de la pièce, le « procès » se retourne progressivement contre la plaignante, à travers les prises de parole de Sœur 2 d’abord, qui l’accuse confusément d’être responsable du malheur de la famille ; à travers la prise de parole de la mère ensuite, et surtout. Sommée par sa fille de répondre de son silence durant toutes ces années et de justifier son « choix », Mère met l’abus dont sa fille a été victime sur le compte de sa nature perverse : « J’ai su du départ. J’ai su dans mon ventre que tu étais mauvaise25 ». Mère poursuit alors, en accusant sa fille d’avoir elle-même cherché une intimité sexuelle avec son père dès son plus jeune âge, et d’être responsable, en un mot, de son propre viol. Cette sentence terrible qui tombe sur la née « mauvaise » (« born bad ») donnera son titre à la pièce.
18Ce schéma, qui consiste à incriminer les victimes, est également à l’œuvre dans À la carabine, comme en témoignent les échos du procès (qui n’a cette fois plus rien de symbolique) rapporté par le personnage féminin à la fin de la pièce. En dépit de son très jeune âge au moment des faits, la jeune fille est reconnue consentante par la justice, qui estime qu’elle « avait[t] le droit de dire non ». « Il aurait fallu ne pas, il aurait fallu enlever la main26 » commente le personnage féminin : l’idée de manquement suggérée par l’emploi du verbe « falloir » au conditionnel passé, suivi d’une négation seule sans complément, prépare le glissement insidieux de la jeune fille sur le banc des accusés : « Pourquoi toutes ces histoires, elle ne ferait pas d’histoires si elle ne l’avait pas un peu cherché, elle est bizarre cette gosse27. »
19Bien loin des récits explicatifs produits par l’entourage des victimes et de leurs commentaires aberrants, le lecteur-spectateur se voit en réalité offrir la possibilité d’accéder à un autre niveau de compréhension des faits. La scène de viol de Poings permet par exemple d’appréhender les phénomènes de sidération et de dissociation qui peuvent survenir pendant une agression : « NORD » s’apparente à un long monologue intérieur qui nous installe au plus près des perceptions du personnage féminin que l’on découvre dans un premier temps absent à lui-même. Dans Poings comme dans À la carabine en outre, le surgissement de la scène de viol incite le lecteur-spectateur à reconsidérer les séquences antérieures sous de nouvelles perspectives. Dans Poings, il pourra par exemple repérer dès la première partie des signaux de ce qui deviendra une relation d’emprise. Il pourra observer dans À la carabine que l’humiliation et la dévalorisation systématique que l’adolescent inflige à la jeune fille dans leurs conversations a priori anodines du stand de tir, amorcent et préfigurent les dernières phrases de la scène de viol, pure expression d’une jouissance de domination et d’annulation de l’autre : « Je la broie, sa nuque, à moi, je l’écrase, je suis fort, j’écrase, encore, c’est bien, je décide, c’est ma force que je sens et c’est fou et c’est terrible28 » ; ou remarquer, encore, que dès son arrivée au stand de tir de la fête foraine et bien avant le viol, le jeune homme ne respecte pas la volonté de la jeune fille, la touche et touche son arme factice sans son accord, comme plus tard pendant le viol. Ce continuum est d’ailleurs mis en évidence au cours de l’une des séquences de vengeance, à travers cette réplique de la jeune fille devenue adulte qui se réfère au viol à l’aide de la métaphore du jouet dérobé :
Pauvre merde, […] pas capable de prendre quelqu’un de ton âge et de lui demander la permission. […] elle t’a pas expliqué ta mère, connard, quand t’étais un petit connard, elle t’a pas dit que t’as pas le droit de jouer avec les jouets des autres sans leur permission29 ?
20Ce paramètre du jeune âge de la victime – qui rend toute résistance impossible –, doublé chez tucker green d’une relation filiale, est aussi souligné dans mauvaise, par exemple lorsque la protagoniste évoque à demi-mot les pratiques sexuelles qui lui étaient imposées par son père : « Y a rien que je voulais pas faire frangin / Y avait pas l’choix30. » On n’est pas loin, ici, de la réactivation d’une forme de fatum incestueux, qui surgit également à travers une interrogation du poids de l’héritage familial dans la perpétuation des violences. D’entrée de jeu en effet (scène 2), Fille maudit sa mère et la lignée de femmes qui l’ont précédée. Derrière l’insulte conventionnelle, ces imprécations peuvent suggérer un phénomène transgénérationnel :
et j’vais l’dire deux fois.
[…] pour toi – ta mère, et la mère de ta mère – toutes ces chiennes de ta race qu’étaient là avant et encore avant – et encore avant avant.
Depuis la première chienne de ta race de chiennes.
Depuis la chiennerie première d’où t’es descendue.
Chienne31.
21Ce soupçon semble confirmé par le puissant effet de symétrie entre l’ouverture et la clôture de la pièce, au cours desquelles Mère et Fille « échangent » leurs rôles. Plus largement, la prégnance des répétitions suggère une fixation dans le temps du trauma. Celle qui a osé briser le silence est finalement « happée » par lui à nouveau à la fin de la pièce, sous la pression familiale : la dernière apparition de Fille, au cours d’une scène sans dialogue (scène 12), montre une jeune femme rentrée dans le rang. À la suite d’un cruel jeu de chaises musicales au cours duquel sa famille l’a privée de chaise, Fille est désormais assise par terre, entre les jambes de son père. Cette effroyable photo de famille vient confirmer la persistance du trauma, symboliquement perpétré à nouveau.
22Les trois pièces de Pauline Peyrade et debbie tucker green parcourues sondent donc, chacune à leur manière, la déstabilisation d’une histoire familiale, conjugale et d’un imaginaire collectif provoquée par une agression sexuelle d’autant plus inattendue, inacceptable et inassimilable qu’elle est perpétrée par un proche : l’événement figure comme une béance ou une pièce surnuméraire au sein de ces récits collectifs et individuels, portés par des dramaturgies et une langue qui font la part belle au discontinu et à la déliaison, et donnent forme à la désorientation générée par l’événement traumatique chez la victime. Poings, mauvaise et À la carabine mettent en évidence les efforts déployés par certains protagonistes pour résorber cette « anomalie » en niant l’agression ou en la justifiant, mais révèlent aussi et surtout le jeu de déterminations complexe des violences ordinaires et les mécanismes par lesquels elles se perpétuent. Partant, c’est bien l’accomplissement d’une nécessité qui se dévoile : implacable chez debbie tucker green, qui met en scène la progressive réduction au silence de Fille, soumise à la pression familiale, elle demeure plus « résistible » chez Pauline Peyrade, qui ménage dans ses pièces la possibilité d’une émancipation – toujours fragile – des personnages féminins : ainsi la jeune femme de Poings parvient-elle finalement à s’extraire de sa relation toxique en prenant la fuite, quand la protagoniste d’À la carabine devenue adulte organise sa vengeance – réelle ou fantasmée, la pièce ne permet pas de trancher. À travers l’alternance entre les flash-back du jour de l’agression et les séquences de vengeance, la pièce superpose à une mécanique implacable – celle de la soumission d’une jeune fille qui commence par le jeu, se poursuit par son viol et se termine par une décision de justice qui finit de l’anéantir – une autre nécessité, tout aussi impérieuse : celle de se faire justice soi-même, et de se libérer d’une violence dont le corps conserve la mémoire. Si, comme le souligne son autrice, le propos de la pièce n’est assurément pas, de « di[re] qu’il faut prendre des armes à feu et dézinguer tout le monde », « ce que dit fort le personnage, c’est que la violence ne disparaît pas ». À défaut d’être prise en charge, cette violence débouche sur une destruction. Et Pauline Peyrade d’ajouter : « ici en l’occurrence la victime de cette histoire choisit de ne pas se laisser détruire32. » À travers cette prise d’armes fictive, À la carabine interroge, dans la lignée entre autres de la philosophe Elsa Dorlin33, la construction sociale d’une féminité « sans défense » qui prive les femmes du droit et de la capacité de riposter et défendre leur corps menacé. Après l’expérience paralysante du viol (« Mes muscles étaient en pierre, ma tête en pierre, ma main, mon ventre, je suis devenue une statue34 »), les scènes de vengeance, au cours desquelles le personnage féminin contraint physiquement son « adversaire » à l’aide d’une arme, tout en l’insultant copieusement, mais aussi les scènes d’entraînement, sortes de pastiches de sessions d’auto-défense féministe, montrent, en actes, une réappropriation par le personnage féminin de son corps et de sa voix. À la statue de pierre que la jeune femme a été, à la poupée malléable assise entre les jambes de son père à la fin de mauvaise, muette elle aussi, ces séquences opposent un corps souple et puissant, qui boxe et donne de la voix : « C’est ta violence. Tu vas te la prendre, bien profond. Ouvre grand. Ta violence, je te la rends. Bon appétit, connard35 », déclare le personnage à son agresseur à la fin de la pièce.
1 « Random, n., adv., and adj. », dans Oxford English Dictionary (Online), Oxford University Press, 2023 (en ligne : https://www-oed-com.ezproxy.normandie-univ.fr/view/Entry/157984, page consultée le 14 mai 2023).
2 À la suite de l’intellectuelle et militante afroféministe bell hooks, debbie tucker green écrit son nom et celui de ses pièces en minuscules.
3 Comme le signale Élisabeth Angel-Perez dans un article qu’elle a consacré à la pièce, random « met en scène comme une synthèse des nombreux faits divers tragiques qui émaillèrent l’actualité anglaise en 2007. » É. Angel-Perez, « Du In-Yer-Face au In-Yer-Ear : les “solo-symphonies” de debbie tucker green », Coup de théâtre, Le théâtre In-Yer-Face aujourd’hui : bilans et perspectives, no 29, 2015, p. 177 (en ligne : https://radac.fr/index.php/revue/#toggle-id-7, page consultée le 21 octobre 2021).
4 La pièce a pu être lue comme une réponse aux propos du Premier ministre de l’époque Tony Blair qui, dans un discours prononcé à Cardiff en avril 2007, et face à la flambée des meurtres au couteau commis sur des adolescents, avait mis ce phénomène sur le compte de la « culture de gang noire ». Voir notamment sur ce point L. Goddard, « debbie tucker green », dans D. Rebellato (éd.), Modern British Playwriting (2000-2009), Londres, Bloomsbury, 2013, p. 210 et M. Fragkou, « Intercultural encounters in debbie tucker green’s random », dans Staging Interculturality, dir. W. Huber, M. Rubik et J. Novak Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2010, p. 81: « tucker green’s sketch of a normal family evokes the victim’s innocence, as it is made clear that he does not form part of gang culture, contrary to Blair’s allegations ».
5 Debbie tucker green, random, Londres, Nick Hern Books, 2010, p. 37.
6 Ibid., p. 49.
7 Nous traduisons.
8 En France, la pièce est créée en mars 2022 à la MC93 de Bobigny (mise en scène de Sébastien Derrey).
9 Voir à ce titre les nombreuses variations sur les titres des pièces de l’autrice proposées dans la presse, qui empruntent significativement au champ lexical du combat, et plus spécifiquement de la boxe.
10 É Angel-Perez, « “In-Yer-Ear Theatre” : la voix photogénique sur la scène anglaise contemporaine », dans L’Orecchio e l’occhio, Lo spettacolo teatrale, arte dell’ascolto e arte dello sguardo, Rome, Artemide, 2019 (en ligne : https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-03377770, page consultée le 19 avril 2022), p. 1.
11 Poings est lauréat du Prix Bernard-Marie Koltès 2018 et finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique ARTCENA, décroché par À la carabine en 2021. born bad vaut à son autrice le prix Laurence Olivier 2004 du meilleur jeune talent.
12 P. Peyrade, Poings, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2017, p. 17 ; 18 ; 20, etc.
13 Ibid., p. 33.
14 « How come you never chose to leave me outta it like you did them? How come I couldn’ta not known about it like she did and had the glorious growin-up years like this one? / How come you never chose for me to do that. / How come that then? / How come you played me like wifey when I shoulda stayed playin dawta? Cos dawta was what I was. / What I am and I weren’t you. I shouldn’ta been doin what you shoulda done – what you wouldn’ta done was it? And you souldn’ta chose me to. » debbie tucker green, born bad, dans Plays: one, Londres, Nick Hern Books, 2018, p. 36 ; traduit en français par G. Joly, S. Magnaud et S. Vermande, mauvaise, Maison Antoine Vitez, Montreuil, Éditions théâtrales, 2020, p. 38.
15 P. Peyrade, À la carabine, suivi de Cheveux d’été, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2020, p. 18.
16 Ibid., p. 64.
17 debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 52.
18 debbie tucker green, mauvaise, trad. G. Joly, S. Magnaud et S. Vermande, op. cit., p. 53.
19 « bits don’t count. Bits ents good enough. […] the bits don’t make the bulk and the bulk don’t mek the whole and the all a your bits together don’t make your versions true and never will » debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 44-45 ; mauvaise, op. cit., p. 46.
20 P. Peyrade, Poings, op. cit., p. 40.
21 « And I’ll call it like iss nuthin, and I’ll say it like iss nuthin like the nuthin it is like the nuthin you are like the nuthin you took a try at to mek me. » debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 6 ; mauvaise, op. cit., p. 10.
22 H. Lecossois, « L’écriture du traumatisme de debbie tucker green ou la mise en jeu de la répétition », dans Écritures théâtrales du traumatisme ; Écritures de la résistance, dir. C. Page, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 7.
23 « You’re strong you are. / You got given the gift, given the gift of strength, you did. Give thanks for that. Got made you like that – made you strong like that. Mum saw that strength, seeing that made her choice – made her choice easy. » debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 14 ; mauvaise, op. cit., p. 17.
24 » It wasn’t by luck. Il wasn’t by – or lack a it. Depending. / It wasn’t by misfortune. It weren’t. » debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 11 ; mauvaise, op. cit., p. 14.
25 « From the out I knew. I knew you was born bad right from the beginning – » debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 37; mauvaise, op. cit., p. 39.
26 P. Peyrade, À la carabine, suivi de Cheveux d’été, op. cit., p. 63.
27 Ibid., p. 64.
28 Ibid., p. 49.
29 Ibid., p. 39.
30 « there was nothing I wouldn’t do. / Brother. / There was no choice. / So. » debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 25 ; mauvaise, op. cit., p. 27.
31 « and I’ll say it two times. / […] for yu – yu mudda, and yu mudda’s mudda – those bitches that bred yu off before and before that – and from before that again. / From whenever your bitch bloodline started. / From whatever bitch beginnings y’had. / Bitch. » debbie tucker green, born bad, op. cit., p. 6 ; mauvaise, op. cit., p. 10.
32 P. Peyrade, « L’écriture à la carabine avec Koffi Kwahulé et Pauline Peyrade » [entretien oral, en ligne], A. Charon, Tous en scène, France Culture, 20 novembre 2021. Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/l-ecriture-a-la-carabine-avec-koffi-kwahule-et-pauline-peyrade, page consultée le 21 février 2023.
33 Voir E. Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Paris, La Découverte, coll. « La Découverte Poche », 2019 ; ouvrage dont la lecture a constitué l’un des points de départ d’À la carabine. Dans cet essai, la philosophe s’interroge sur le « droit à la violence » et identifie une ligne de partage entre « les sujets dignes de se défendre et d’être défendus » (p. 16) et ceux qui, à l’instar des populations colonisées ou des femmes, sont dissuadés – à travers un long travail de socialisation et d’incorporation de cet interdit – de recourir à la violence pour se défendre. Partant de ce constat, la philosophe définit la domination comme un « gouvernement des corps [qui] intervient à l’échelle du muscle » (p. 17), et s’intéresse à la manière dont, d’hier à aujourd’hui, les populations opprimées le déjouent à travers des pratiques de défense subalternes, auto-défensives.
34 P. Peyrade, À la carabine, suivi de Cheveux d’été, op. cit., p. 63.
35 Ibid., p. 64.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1955.html.
Quelques mots à propos de : Nina Roussel
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
