Sommaire
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
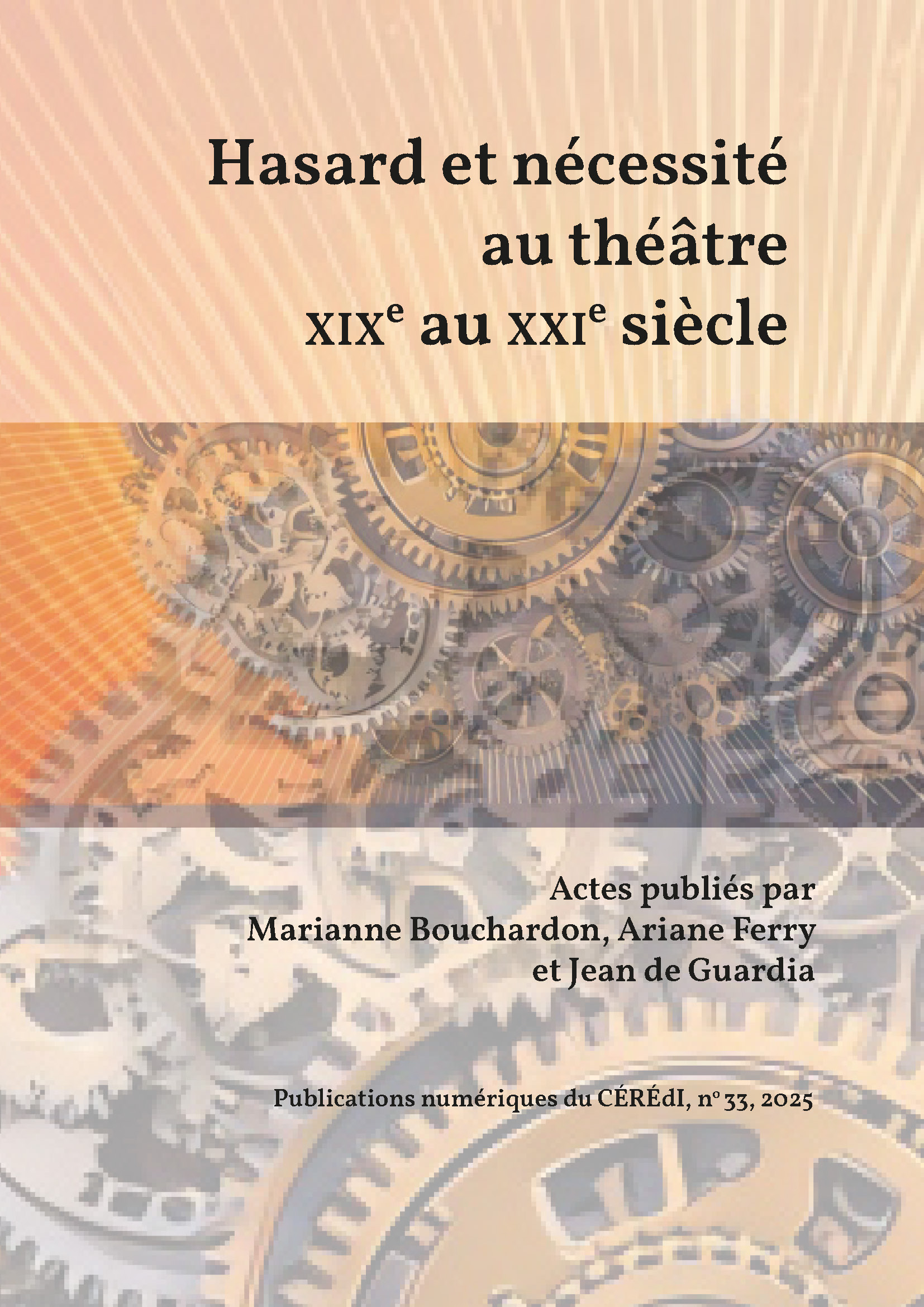
- Marianne Bouchardon, Jean de Guardia et Ariane Ferry Introduction
- Jean de Guardia Qu’est-ce que la nécessité classique ?
Corneille et les conditions sine qua non - Tatiana Victoroff « Il nous arrive un Revizor ! » : coup de théâtre ou hasard providentiel ? (Gogol, Boulgakov, Nabokov, Ghelderode)
- Ariane Murphy L’hérédité et son contraire : images de la fatalité moderne dans le théâtre symboliste
- Silvia De Min Pirandello et la création d’un « acte de vie » sur la scène
- Pauline Philipps L’insupportable concaténation des faits dans le théâtre documentaire de Peter Weiss
- Nina Roussel « Au ptit malheur malchance » : le système de causalité dramatique à l’épreuve de l’agression sexuelle chez debbie tucker green et Pauline Peyrade
- Émilie Combes La maîtrise du chaos dans le théâtre panique de Fernando Arrabal
- Carole Guidicelli L’écriture avec marionnettes, entre la chaîne et la roue
- Barbara T. Cooper Le Tremblement de terre de la Martinique de Dennery : entre hasard et nécessité
- Zoé Schweitzer Succession, hasard et causalité dans les réécritures d’Euripide par Hanokh Levin
- Delphine Edy Pierre Bayard et Maya Zade, relecteurs de Sophocle
- Pierre Piret Causalité et incomplétude. En relisant Les Nègres, de Jean Genet
Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle
Qu’est-ce que la nécessité classique ?
Corneille et les conditions sine qua non
Jean de Guardia
1On s’attendrait à trouver dans les poétiques du xviie siècle – siècle de la théorie et siècle de la tragédie – une élaboration théorique majeure de la notion de nécessaire. Or, les principaux théoriciens en parlent très peu : ni d’Aubignac, ni Chapelain, ni La Mesnardière n’y consacrent de chapitre, et aucun d’entre eux ne propose de définition explicite de la nécessité fictionnelle. De ce point de vue, le xviie siècle français, grand lecteur d’Aristote, ne fait que prolonger le flou définitionnel qui existe dans la poétique du philosophe, comme le remarque Corneille :
Aristote […] nous apprend que le poète n’est pas obligé de traiter les choses comme elles se sont passées, mais comme elles ont pu ou dû se passer, selon le vraisemblable ou le nécessaire. Il répète souvent ces derniers mots, et ne les explique jamais1.
2Le constat est un peu vertigineux, parce qu’en l’absence de définition d’une notion si fondamentale, les grands montages théoriques du xviie siècle semblent bel et bien bâtis sur du sable. La seule définition explicite de la nécessité que l’on trouve au xviie siècle est celle de Corneille lui-même, et elle semble particulièrement floue :
Après avoir tâché d’éclaircir ce que c’est que le vraisemblable, il est temps que je hasarde une définition du nécessaire dont Aristote parle tant […]. Je dis donc que le nécessaire, en ce qui regarde la poésie, n’est autre chose que le besoin du poète pour arriver à son but ou pour y faire arriver ses acteurs2.
3Notre propos sera donc d’essayer de clarifier, autant que faire se peut, cette définition difficile et bizarre, non par fétichisme de Corneille, mais parce que, faute de combattants, cette définition revêt de facto une très grande importance.
4Pour Corneille, le noyau du concept de nécessité est ainsi l’idée de besoin pour arriver à un but. Ce qui est nécessaire est ce dont on a besoin pour. En langue, cette définition a évidemment du sens, mais la position de Corneille est a priori paradoxale parce que ce sens n’est pas dans une relation d’opposition structurale avec le concept de hasard, qui est son pendant dans notre esprit : apparemment, le nécessaire, pour Corneille, n’est nullement ce qui n’arrive pas par hasard. Le concept auquel le nécessaire cornélien semble s’opposer est plutôt celui de superflu : ce dont je n’ai pas besoin pour mener mon action. On voit là que le problème du concept de nécessité fictionnelle est qu’il peut se mouvoir dans deux jeux d’oppositions, et donc admettre deux définitions distinctes :
– il peut s’opposer au hasard et signifier ce qui n’arrive pas par hasard.
– il peut s’opposer au superflu et signifier ce qui n’est pas superflu.
5C’est apparemment dans ce deuxième jeu conceptuel que Corneille place globalement sa réflexion. Il en a tout à fait conscience et est si ennuyé qu’il a recours à cet argument philologique douteux pour le justifier :
Cette définition a son fondement sur les diverses acceptions du mot grec anangkaion, qui ne signifie pas toujours ce qui est absolument nécessaire, mais aussi quelquefois ce qui est seulement utile à parvenir à quelque chose3.
6Mais même en forçant le terme pour se concentrer uniquement sur l’idée de besoin, Corneille n’a pas réussi à homogénéiser conceptuellement le nécessaire : sa définition n’est pas totalement unifiée. En effet, si le noyau est bien l’idée de « besoin », ce besoin se joue sur deux plans différents, qui conduisent à deux définitions distinctes. Ce besoin peut être d’une part celui du dramaturge au travail, du « poète », d’autre part celui des personnages, « les acteurs4 ». Le nécessaire est donc pour moitié un concept qui porte sur l’élaboration du monde fictionnel (la poétique), et pour moitié sur le fonctionnement du monde fictionnel (la logique de la fiction). Or, les définitions, on va le voir, sont contre-intuitives sur les deux plans.
« Le besoin du poète pour arriver à son but »
7Plaçons-nous d’abord sur le plan du travail du dramaturge, sur lequel le nécessaire est « le besoin du poète pour arriver à son but ». Cette définition est développée un peu plus loin par Corneille :
Le but du poète est de plaire selon les règles de son art. Pour plaire, il a besoin quelquefois de rehausser l’éclat des belles actions et d’exténuer l’horreur des funestes. […] Pour plaire selon les règles de son art, il a besoin de renfermer son action dans l’unité de jour et de lieu ; et comme cela est d’une nécessité absolue et indispensable, il lui est beaucoup plus permis sur ces deux articles que sur celui des embellissements5.
8Voici donc formulé le centre conceptuel du nécessaire : le « but » du poète est de plaire, ce dont il a « besoin » pour cela est le nécessaire. Un esprit contredisant pourrait aisément répondre à Corneille qu’à ce compte, absolument tout, au théâtre, est « nécessaire », car tout vise à plaire au spectateur. Mais Corneille précise et resserre assez vite l’analyse : pour plaire, dit-il, il est parfois indispensable de « rehausser » ou « d’exténuer » les événements historiques, c’est-à-dire de les trahir. Autrement dit, cette trahison de l’Histoire est une faute nécessaire pour plaire. De la même manière, écrit-il, pour plaire, il faut « renfermer » l’action dans l’unité de jour et de lieu, et pour cela forcer la vraisemblance. En effet, il est invraisemblable que tant d’événements importants se déroulent en une seule journée, mais cela est inévitable étant donnée la structure du genre théâtral. Ainsi, pour Corneille, le « nécessaire » recouvre les « fautes » que l’on ne peut éviter, celles qu’il est indispensable de faire pour plaire. Elles tiennent principalement à deux enjeux poïétiques : le rapport aux événements historiques et le respect des unités. Apparaît ici le noyau dur de la définition cornélienne du nécessaire : il n’est rien d’autre qu’une faute dramaturgique inévitable. Le concept a donc dans l’esthétique cornélienne une fonction d’excuse dramaturgique : je n’ai pas pu faire autrement, donc cela est excusable et doit être oublié dans le processus de jugement esthétique.
9On pourrait être tenté de voir dans cette définition une curiosité théorique marginale, mais ce serait une erreur : les bribes de définition que l’on trouve chez les autres théoriciens vont tout à fait dans le même sens. D’Aubignac, notamment, appelle nécessaire « ce qu’on ne peut éviter », par exemple dans ce passage :
On peut encore, à mon avis, considérer les narrations, ou comme de simples récits, ou comme des explications pathétiques de quelque aventure. Les premières sont toujours mauvaises, pour peu qu’elles soient étendues, parce qu’étant sans mouvement et sans ornement, elles sont froides et languissantes : elles sont pourtant nécessaires en beaucoup de rencontres, comme quand il faut donner un avis important et en diligence, pour remédier à quelque mal pressant, pour sauver un homme que l’on poursuit, et pour quelqu’autre effet semblable ; mais il faut qu’elles soient fort courtes, autrement elles ne conviennent pas à la nécessité de l’action présente6.
10Ainsi, ce premier sens du nécessaire ne s’oppose pas conceptuellement au hasard – sauf à soutenir un peu sophistiquement que le nécessaire est en ce sens « ce que le dramaturge ne fait pas par hasard ».
Le besoin du personnage pour arriver à son but
11En revanche, le second sens cornélien – le « besoin du poète pour faire arriver ses acteurs à son but » entre bien en relation structurale avec le concept de hasard. Corneille le développe et l’exemplifie en ces termes :
Le but des acteurs est divers, selon les divers desseins que la variété des sujets leur donne. Un amant a celui de posséder sa maîtresse ; un ambitieux, de s’emparer d’une couronne ; un homme offensé, de se venger ; et ainsi des autres. Les choses qu’ils ont besoin de faire pour y arriver constituent ce nécessaire, qu’il faut préférer au vraisemblable ou, pour parler plus juste, qu’il faut ajouter au vraisemblable dans la liaison des actions, et leur dépendance l’une de l’autre. Je pense m’être déjà assez expliqué là-dessus ; je n’en dirai pas davantage7.
12Voilà le passage le plus clair et le plus explicite que l’on puisse lire à l’âge classique sur l’idée de nécessité : le nécessaire est constitué des choses que le personnage a « besoin de faire » pour « arriver » à son « dessein ». Dans cette seconde définition, la nécessité est bel et bien une modalité de l’enchaînement des événements, de la causalité : elle constitue ce que l’âge classique appelle la « liaison des actions ». Ce qui est nécessaire, ce n’est pas l’action elle-même (l’événement), mais bien la « liaison », pensée selon cette définition :
Cinna peut nous fournir des exemples de ces deux sortes de liaisons [vraisemblable et nécessaire] : j’appelle ainsi la manière dont une action est produite par l’autre8.
13Contrairement à la première définition, on se retrouve ici en terrain connu, c’est-dire en terrain aristotélicien. En ce second sens, la nécessité est bien une modalité de la relation causale et s’oppose bien au hasard : Corneille pense que les événements s’enchaînent « nécessairement » quand ils ne sont pas dans un rapport de pure succession chronologique hasardeuse.
14En matière de nécessité, il faut ainsi distinguer scrupuleusement la question de l’action et celle de la liaison, car ce qui est nécessaire ou non, c’est uniquement la liaison :
[La] conspiration [de Cinna] contre Auguste est causée nécessairement par l’amour qu’il a pour Émilie, parce qu’il la veut épouser, et qu’elle ne veut se donner à lui qu’à cette condition. De ces deux actions, l’une est vraie, l’autre est vraisemblable, et leur liaison est nécessaire9.
15Les événements en eux-mêmes ne sont pas « nécessaires » : la conspiration est « vraie » (au sens où elle est historique), et l’amour pour Émilie est vraisemblable (au sens où il est inventé mais possible). Seule la liaison est nécessaire : Cinna ne peut pas arriver à son but sans en passer par le meurtre. De la même manière, lorsque Cinna a des doutes et se trouve tenté de renoncer à l’assassinat :
Il consulte [Émilie] dans cette irrésolution : cette consultation n’est que vraisemblable, mais elle est un effet nécessaire de son amour, parce que s’il eût rompu la conjuration sans son aveu, il ne fût jamais arrivé à ce but qu’il s’était proposé, et par conséquent voilà une liaison nécessaire entre deux actions vraisemblables, ou si vous l’aimez mieux, une production nécessaire d’une action vraisemblable par une autre pareillement vraisemblable10.
16Malgré son caractère assez intuitif cette conception constitue un complet changement de paradigme. D’abord, elle crée un écart brutal vis-à-vis de la nécessité antique, comme volonté divine. Chez Corneille, la nécessité n’est pas la volonté du dieu poussant l’homme à sa perte : elle est totalement immanente. Ensuite, elle s’éloigne par certains aspects de l’idée qu’Aristote se fait de la liaison. En effet, chez le philosophe, la liaison dramatique est pour ainsi dire de nature statistique. Il y a liaison lorsque la fiction reproduit une régularité statistique du monde réel, selon une formule de ce type : Le plus souvent, dans la vie, quand il arrive A, il arrive ensuite B. C’est bien là le sens du mot eikos, que l’on traduit par vraisemblable. La liaison vraisemblable, pour Aristote, est bien « ce qui arrive le plus souvent ». Comme Aristote n’explicite jamais le sens du nécessaire, les poéticiens en déduisent en général que la liaison nécessaire est constituée par « ce qui arrive toujours » dans la vie : Quand A arrive, alors B arrive toujours. Mais Corneille a dû sentir que cette conception de la nécessité est en réalité inapplicable en fiction, car la fiction met en scène le monde des hommes : dans le monde humain, contrairement au monde des phénomènes physiques, les corrélations systématiques de ce type n’existent tout simplement pas. À partir du moment où les décisions humaines sont en jeu, il y a une part d’arbitraire ou de hasard et donc de variation. C’est bien ce constat qui a mené la philosophie à élaborer la distinction entre l’explication scientifique et la compréhension des phénomènes humains, entre les sciences de la nature et les sciences humaines, entre les causes et les raisons. Et c’est probablement ce même constat qui a mené Corneille à changer de paradigme quand il s’est agi de penser la nécessité théâtrale. La nécessité, selon lui, n’est pas une corrélation systématique, simplement parce qu’il n’y a pas de corrélation systématique dans le monde humain, mais un type de raisonnement sur les moyens et les fins, qui a la capacité d’unir un événement à celui qui le précède, en ce que l’élément qui précède est un des paramètres de la décision individuelle à prendre.
Nécessité théâtrale et « syllogisme pratique »
17La liaison nécessaire est fondée sur un système à trois éléments. Une décision à prendre (tuer ou non), un but (« il la veut épouser ») et une condition sine qua non (« elle ne veut se donner à lui qu’à cette condition »). La théorie aristotélicienne de la délibération a créé un outil pour penser ce type de dispositif : le « syllogisme pratique11 ». C’est celui que mène l’être humain lorsqu’il veut fixer une conduite à tenir : il part du but, calcule le meilleur moyen et conclut. Soit un raisonnement sous cette forme :
Je veux Émilie
Or, elle sera à moi uniquement si je tue Auguste
Donc je tue Auguste
18Cette liaison nécessaire est potentiellement d’une très grande solidité et pour cela elle est appelée à former la matrice fondamentale de la pièce, son squelette, sa structure :
Le nécessaire [dans les liaisons] est à préférer au vraisemblable, non que cette liaison ne doive toujours être vraisemblable, mais parce qu’elle est beaucoup meilleure quand elle est vraisemblable et nécessaire tout ensemble. La raison en est aisée à concevoir. Lorsqu’elle n’est que vraisemblable sans être nécessaire, le poème s’en peut passer, et elle n’y est pas de grande importance ; mais quand elle est vraisemblable et nécessaire, elle devient une partie essentielle du poème, qui ne peut subsister sans elle12.
19La liaison nécessaire rend l’élément strictement inamovible : il ne peut être ôté, il est partie intégrante du tout de l’œuvre théâtrale. C’est la raison pour laquelle, quand une pièce de l’époque possède bien une liaison nécessaire, elle y insiste fortement pour afficher la puissance de sa structure. C’est le cas de Cinna :
Émilie
S’il me veut posséder, Auguste doit périr :
Sa tête est le seul prix dont il peut m’acquérir.
Je lui prescris la loi que mon devoir m’impose. (I, 1, v. 55-57)
Émilie
Et faisons publier par toute l’Italie,
« La liberté de Rome est l’œuvre d’Émilie,
On a touché son âme, et son cœur s’est épris,
Mais elle n’a donné son amour qu’à ce prix. » (I, 1, v. 109-112)
Émilie
Souviens-toi du beau feu dont nous sommes épris,
Qu’aussi bien que la gloire Émilie est ton prix. (I, 3, v. 275-276)
Maxime
Il adore Émilie, il est adoré d’elle ;
Mais sans venger son père il n’y peut aspirer,
Et c’est pour l’acquérir qu’il nous fait conspirer. (III, 1, v. 709-711)
20La liaison nécessaire est si précieuse d’un point de vue esthétique que Corneille n’hésite pas à être très redondant pour que le spectateur la remarque bien : l’enjeu est vital pour l’œuvre. Le problème est que la solidité de cette architecture générale dépend précisément du caractère persuasif de l’argumentation : si le spectateur n’est pas pleinement convaincu du caractère unique de la solution choisie par le personnage, toute la structure s’effondre. À quelles conditions le spectateur percevra-t-il cette liaison comme pleinement satisfaisante ?
21D’abord, la nécessité cornélienne ne se pensant qu’à la première personne, (jamais à la troisième), le spectateur percevra l’action du personnage comme nécessaire s’il lui est possible (à lui, spectateur) de reconstruire le calcul fait subjectivement par le personnage, en fonction du but subjectif que s’est posé le personnage, et à la lumière des circonstances dans lesquelles le personnage s’est trouvé. Si le texte lui fournit ces éléments (par la bouche du personnage concerné ou celle d’un autre, comme Maxime dans ce cas), alors le spectateur sera satisfait, quand bien même tout cela serait faux. Imaginons par exemple qu’Émilie ait prononcé dans la scène d’exposition un monologue expliquant au spectateur qu’en réalité elle n’aime pas vraiment Cinna et ne compte pas tenir sa promesse. Dans ce cas, le raisonnement mené par Cinna, qui fonde le nécessaire, serait objectivement faux (et le spectateur le sait) mais cela n’aurait aucune importance. Le spectateur considérerait quand même que la liaison est nécessaire puisque, subjectivement, le raisonnement est vrai aux yeux du personnage – c’est cela qui importe pour persuader le spectateur. Le nécessaire est ainsi fondé sur une simulation de raisonnement à la première personne.
22Une fois cela acquis, pour qu’un effet de nécessité s’installe, il faut encore que le spectateur donne son assentiment aux deux éléments : d’une part le but à atteindre, d’autre part le raisonnement sur les moyens et les fins. Les types de buts que le spectateur percevra comme valides et aptes à fonder la nécessité sans analysés dans ces termes par Corneille :
Le but des acteurs est divers, selon les divers desseins que la variété des sujets leur donne. Un amant a celui de posséder sa maîtresse ; un ambitieux, de s’emparer d’une couronne ; un homme offensé, de se venger ; et ainsi des autres13.
23Cette liste de trois exemples mêle en réalité deux cas de figure différents. L’intrigue peut donner un but vraisemblable au personnage : si elle amène une offense faite à un personnage (on pense bien sûr à Don Diègue dans Le Cid), il aura pour but de se venger, et l’on accepte volontiers son « syllogisme pratique ». Mais dans les deux autres cas, ce ne sont pas les événements de l’intrigue qui posent le but du personnage, mais le système classique des caractères. Le « caractère de l’ambitieux » lui impose son but « s’emparer d’une couronne », celui de l’amant lui pose le sien, « posséder sa maîtresse » (ce dernier cas est évidemment celui de Cinna). La nécessité classique a ainsi une part variable dans le temps, car le système des caractères acceptables, alors-même qu’il est largement perçu comme intemporel – est en réalité posé par chaque époque. Intuitivement, le spectateur ne validera pas des buts qui n’appartiennent pas à la caractérologie de son époque. Par exemple, le spectateur du xviie siècle n’admettra sans doute pas le caractère du philatéliste comme pouvant fonder une nécessité :
Je veux ce timbre de collection par-dessus tout
Or, pour avoir ce timbre il faut que je tue son propriétaire
Donc je tue son propriétaire.
24En revanche, dans un film policier hollywoodien14 d’aujourd’hui, il est absolument loisible au scénariste de motiver un meurtre nécessaire par une folie de collection. Sur ce point, le nécessaire est éminemment fragile dans le temps long : certains buts risquent de ne plus être « compris », c’est-à-dire acceptés, par les époques ultérieures.
25On voit là que la meilleure nécessité est sans doute celle dans laquelle l’intrigue elle-même fournit un but au personnage (comme dans Le Cid), et non un caractère : la nécessité sera alors moins variable dans le temps. Mais dans tous les cas, il sera indispensable que ce but se situe très haut dans la hiérarchie virtuelle des buts possibles de l’être humain, parce qu’il va logiquement entrer en concurrence avec d’autres buts naturels. Il faut par exemple que le but que Corneille veut donner à Don Diègue (se venger) se situe au-dessus du but naturel qui serait de protéger la vie de mon fils. C’est pourquoi la tragédie a mécaniquement recours à des pulsions très fondamentales de l’être humain pour motiver les actions de ses personnages : l’effet de nécessité en dépend, et à terme la structure même de la pièce.
26Enfin, pour que le spectateur considère l’enchaînement comme nécessaire, il faut qu’il soit persuadé par le raisonnement sur les moyens et les fins, c’est-à-dire par la délibération elle-même. Si ce raisonnement lui semble forcé, alors il y aura dysfonctionnement et la nécessité ne s’établira pas. Pour cela, le texte doit se justifier très scrupuleusement. Ainsi, dans le théâtre classique, le monologue de délibération a bien souvent un double enjeu : non seulement montrer l’hésitation du personnage, mais aussi convaincre le spectateur que la solution choisie face à la situation est bel et bien le seul moyen d’arriver au but, à l’exclusion de tous les autres. Le caractère parfois fastidieux de ce genre de scène, qui pèse et écarte successivement les solutions possibles, lasse le spectateur moderne, mais il est en réalité indispensable. L’enjeu de la délibération classique est, de ce point de vue, considérable : si le spectateur peut se dire que le personnage ferait mieux de choisir une autre option, la liaison nécessaire est rompue et la structure dramatique s’effondre.
27Corneille opère ainsi un véritable changement de paradigme. L’enjeu de son raisonnement est en fait de créer une toute une nouvelle vision de la causalité fictionnelle, fondée sur la logique des buts de l’action individuelle, et non plus sur les lois de l’enchaînement des événements. Par exemple, pour motiver l’action de Cinna, Corneille aurait pu avoir recours à une loi de corrélation « aristotélicienne » du type : Quand ils n’ont pas été tués, les vaincus d’une guerre civile finissent toujours par se venger. Cette maxime aurait fort bien rendu compte de l’action de Cinna, qui appartient à une famille vaincue par Auguste dans la guerre civile. Mais on voit bien que ce « toujours » n’en est pas un : si générale que soit cette loi, c’est en réalité un « la plupart du temps ». Dans les affaires humaines, une fois de plus, contrairement aux phénomènes naturels, il y a toujours des exceptions. Ce que fonderait cette maxime, ce serait en profondeur une simple liaison vraisemblable et non une liaison nécessaire. La manière cornélienne de penser le nécessaire permet d’échapper à cet inconvénient et de créer en quelque sorte un véritable nécessaire, par les buts.
|
Nécessité par les lois |
Nécessité par les buts |
|
Les vaincus d’une guerre civile finissent toujours par se venger. |
Je veux Émilie |
|
Or, Cinna est le vaincu d’une guerre civile |
Or, le seul moyen pour avoir Émilie est de tuer Auguste |
|
Donc Cinna tue Auguste |
Donc je tue Auguste |
28
Le constat le plus important est au fond qu’il n’existe pas de nécessité stricte dans les affaires humaines réelles, et qu’il n’existe donc pas de nécessité fictionnelle qui serait la mimésis d’une nécessité réelle. Pourquoi Corneille, face à ce constat, invente-t-il un artefact fictionnel qu’il appelle nécessité au lieu d’y renoncer ? Simplement parce que la pensée classique ne peut pas penser l’unité de l’œuvre d’art fictionnelle sans l’idée de nécessité : sans nécessité pas d’unité, sans unité pas d’art. Mais il est certain que dès que l’esthétique de l’unité disparaîtra, avec la Querelle des Anciens et des Modernes, le problème changera de nature : la nécessité ne sera plus elle-même nécessaire.
1 Pierre Corneille, Discours de la Tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire [1660], dans Trois discours sur le poème dramatique, éd. M. Escola et B. Louvat, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1999, p. 117-119.
2 Ibid., p. 129.
3 Ibid., p. 129-130.
4 En poétique classique, le mot acteur signifie exclusivement personnage.
5 Pierre Corneille, Discours de la Tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire [1660], dans Trois discours sur le poème dramatique, éd. citée, p. 130.
6 Abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. H. Baby, Paris, Champion, 2001, p. 421-422.
7 Pierre Corneille, Discours de la Tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire [1660], dans Trois discours sur le poème dramatique, éd. citée, p. 130. Nous soulignons.
8 Ibid., p. 123.
9 Ibid., p. 123-124.
10 Ibid., p. 124.
11 Voir Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. M. Thurot, Paris, Didot, 1824, VI, 12, 1144 a 30 et suiv. V. Descombes écrit à propos du syllogisme pratique aristotélicien : « Ce genre de proposition fournit à la fois le point de départ de la délibération et le terme de l’action (dont elle spécifie l’objectif). D’où la célèbre formule de l’action : l’objet désiré est le point de départ (ou le “principe”) de l’intellect pratique, tandis que le terme final de cet intellect pratique (à savoir l’action qu’il est possible de faire ici et immédiatement sur le champ) est le point de départ de l’action. (De l’âme, III, 10, 433 a 15 et suiv.) » (« Note sur le syllogisme pratique » dans Le Raisonnement de l’ours, et autres essais de philosophie pratique, Paris, Seuil, 2007, p. 122).
12 Pierre Corneille, Discours de la Tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire [1660], dans Trois discours sur le poème dramatique, éd. citée, p. 123.
13 Ibid., p. 130.
14 La dramaturgie hollywoodienne – contrairement au théâtre d’Art postérieur à l’âge classique – a largement repris le principe d’une motivation nécessaire des événements par les conditions sine qua non.
Corneille et les conditions sine qua non » dans Hasard et nécessité au théâtre - xixe au xxie siècle,
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en décembre 2022, publiés par Marianne Bouchardon, Ariane Ferry et Jean de Guardia
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 33, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1947.html.
Quelques mots à propos de : Jean de Guardia
Sorbonne Nouvelle
IRET
