Sommaire
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
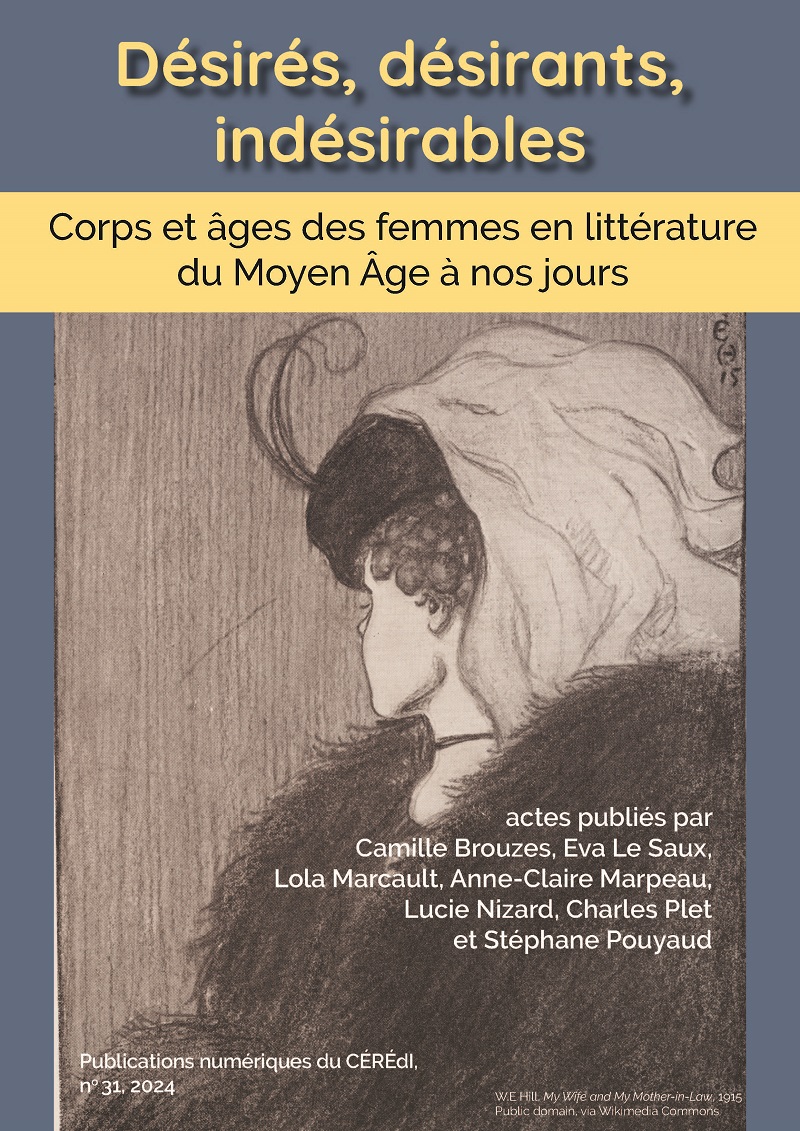
- Stéphane Pouyaud, Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard et Charles Plet Préambule
- Martine Boyer-Weinmann « Le coffre du corps, il faudrait l’ouvrir »
- Marielle Lavenus Sorcière, entremetteuse, maquerelle et concubine : représentations de la figure de la vieille servante dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Bruxelles, KBR, ms. 9631 et Paris, BnF, ms. fr. 24378)
- Clémence Aznavour Écrire à 84 ans : Madame de Rosemonde ou la parole restreinte
- Cassandre Martigny Dire l’indicible. Reconfigurations du scandaleux désir de Jocaste pour la jeunesse, dans Le Chevalier errant de Legrand (1726), Œdipe de Voltaire (1718) et Jocaste Reine de Nancy Huston (2009)
- Céline Duverne Devenir épouse et mère : corps de jeunes filles dans le roman balzacien
- Camille Stidler Les jeunes filles dans l’œuvre d’Émile Zola : des cas et des normes
- Véronique Samson La femme de trente ans : un personnage de la première moitié du xixe siècle
- Éléonore Reverzy Retour d’âge, retour de flamme. Lecture de La Conquête de Plassans
- Savannah Kocevar Du corps au corpus : un fil initiatique d’encre et de sang dans le cycle indochinois de Marguerite Duras
- Pascale Millot Entre identification et dégoût : l’accueil du corps vieux de la mère chez Beauvoir, Calle et Cixous
- Ariane Ferry De l’indésirable à la désirante ou comment sortir de la malédiction du « naître fille » (Fille de Camille Laurens, 2020)
- Nina Roussel « L’âge de détruire » : violence féminine et subversion des représentations de la jeune fille et de la femme vieillissante dans L’Amante anglaise de Marguerite Duras et Rouge dents de Pauline Peyrade
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
De l’indésirable à la désirante ou comment sortir de la malédiction du « naître fille » (Fille de Camille Laurens, 2020)
Ariane Ferry
1« C’est une fille » : cet énoncé revient presque une trentaine de fois dans Fille, le roman d’inspiration autobiographique de Camille Laurens paru chez Gallimard en 20201. Il est tantôt assumé par la narratrice, Laurence Barraqué, qui le répète, le détache parfois, avant de se lancer dans un nouveau paragraphe, qui médite sur ses multiples significations, connotations et implications en termes d’assignation de genre ou de dévalorisation d’un genre par rapport à un autre ; il est d’autres fois rapporté à différents personnages qui le complètent, exprimant malgré eux une déception, une légère réserve, comme c’est le cas du père lorsqu’il annonce à sa famille la naissance de sa deuxième fille : « C’est une fille… Oui oui, c’est bien aussi2. » Prononcé en salle de naissance, puis répété, relayé par les parents vers leurs proches et connaissances, l’énoncé ne relève pas de la simple information : surgissant dans l’espace social, il y résonne, y rebondit, ses « ricochets se propageant de voix en voix (“C’est bien aussi”, “Ce sera pour la prochaine fois”, “Les filles sont plus faciles”, “Reste plus qu’à transformer l’essai3”) », ricochets dont les projections atteindront le bébé fille, puis la petite fille, la jeune fille, la femme et la mère, lui signifiant implicitement qu’elle n’est qu’une fille, c’est-à-dire qu’elle n’existe que comme la version défaillante et indésirable de l’être achevé, attendu, désiré que serait le garçon dans l’imaginaire collectif. Parce que cet énoncé véhicule toutes sortes de non-dits, de préjugés, de jugements négatifs, il fonctionnerait comme une « malédiction4 », fixant le sort de la nouvelle-née, ce que résume la narratrice en s’adressant, par-delà les années, au nourrisson qu’elle fut lors de son entrée dans le monde, en 1959, pour lui en expliciter la signification la plus lourde de conséquences pour elle :
Tu vas percevoir peu à peu, au gré d’autres mots, son importance inaugurale. Tu vas comprendre qu’il ne s’agit pas seulement, comme pourrait le laisser croire le présentatif « c’est », d’une observation neutre, d’un constat, mais aussi et plutôt d’un rapport au monde, d’un destin en creux, si l’on peut dire. « C’est une fille » signifie d’abord « Ce n’est pas un garçon5 ».
2Cet énoncé, dont le retour scande le texte, invitant le lecteur à accompagner le travail d’élucidation mené par la narratrice à propos de ce qui se joue, se trahit dans la langue – le vocabulaire, la syntaxe, les expressions toutes faites qu’on dit sans y penser mais qui en disent long –, dès lors qu’il s’agit de définir une fille, puis une femme, ce qui revient à l’enfermer dans un réseau de normes, de contraintes, d’interdits qui limitent sa liberté d’action et de parole mais aussi ses désirs, cet énoncé, dont l’aura négative domine dans la première partie du roman, fait pourtant l’objet d’une réévaluation positive.
3Cette dernière est portée d’abord par le discours et les réflexions de la narratrice qui, la cinquantaine dépassée6, revient avec ironie sur le poids, dans sa propre vie, des règles de conduite qui lui ont été fixées, déconstruisant les propos et les comportements des hommes ayant affecté son existence, mais aussi des femmes de sa famille (arrière-grand-mère, grand-mère, mère, tantes) montrées comme relayant les normes de la société patriarcale. Mais le retournement axiologique, qui transforme et ouvre enfin favorablement le sens du « c’est une fille », est surtout porté par sa fille adolescente, Alice, qui reprend ce même énoncé, posé en excipit de la IIIe partie, pour lui signifier qu’elle est amoureuse d’une autre fille – et non d’un garçon, comme la mère le présuppose – et part la rejoindre pour la nuit. Dans l’Épilogue, Alice apparaît comme libérant sa mère, telle la bonne fée conjurant le mauvais sort qui lui avait si cruellement fait défaut au-dessus du berceau de sa naissance, de la malédiction du naître fille et de son sentiment de culpabilité d’avoir engendré / éduqué une fille lesbienne, lorsqu’elle prononce l’une de ces phrases capables de « faire tomber des monuments », de faire s’écrouler la tour « dont [elle] était à la fois la prisonnière et la geôlière7 » :
« Tu sais, maman… », reprend-elle – elle articule, et il y a dans sa voix, c’est drôle, un soupçon de pédagogie –, « tu sais, une fille, c’est bien aussi. Et même… » – elle sourit comme à un souvenir –, « c’est merveilleux, une fille8. »
4Annonçant la trajectoire heureuse du roman – le mot figure sur la page de garde –, mais aussi brouillant les frontières entre non-fiction et fiction, il y a cette dédicace qu’on peut lire au seuil du texte : À ma merveilleuse fille.
5Camille Laurens, l’autrice de Fille, de son vrai nom Laurence Ruel (née à Dijon en 1957), occupe une position de premier plan dans le champ littéraire, institutionnel et médiatique français – elle a été un temps chroniqueuse au Monde où elle signait « le feuilleton littéraire », et depuis 2020, elle est membre de l’Académie Goncourt. Si ses premiers romans relèvent de la fiction, à partir de 1995 son œuvre affirme une dimension autobiographique assumée pour aller vers une écriture mêlant histoire personnelle et fiction, désignée aussi sous le terme d’autofiction9. C’est cette année-là qu’elle fait paraître Philippe, récit rédigé à partir de notes à la première personne – en assumant le « pronom de l’intimité10 » –, et suscité par la mort, deux heures après l’accouchement, de son premier enfant, un garçon. Cette expérience douloureuse, ce malheur, a fait l’objet d’un travail de deuil et de réécriture au long cours et sous-tend encore toute la deuxième partie de Fille, pour revenir dans la troisième de manière plus apaisée11. Suivront d’autres textes écrits à la première personne, ou « depuis soi12 », s’entremêleront le biographique et le fictionnel, ce qui a valu à Camille Laurens un procès, intenté par son ex-mari dont elle avait conservé le prénom, au moment de la parution de L’Amour, roman13 (POL, 2003) – procès qu’il a perdu. Au-delà de l’approche référentielle et des problèmes juridiques que l’autofiction soulève, d’autres approches mettent l’accent sur certains traits stylistiques, repérés par Philippe Gasparini à propos de l’auto-narration, et qui peuvent être partiellement pertinents pour Fille – « traits d’oralité, d’innovation formelle, de complexité narrative, de fragmentation d’altérité, de disparate et d’autocommentaire qui tendent à problématiser le rapport entre l’écriture et l’expérience14 ». Camille Laurens, quant à elle, a également mis l’accent sur la dimension genrée, dans le discours médiatique, du recours à cette catégorie générique qui continue à poser des problèmes de définition et à faire débat15. Dans un entretien relativement récent avec Céline du Chéné – le cadre en était une Masterclasse enregistrée à la BnF en juin 202016 –, tout en se disant convaincue que l’autofiction, c’est l’« autobiographie moderne », elle souligne les enjeux genrés et négatifs de l’emploi médiatique d’un terme désormais « associé au féminin », au motif implicite que les femmes ne sauraient que « déballer » « leurs petits secrets ». L’autofiction, jugée « nombriliste, narcissique », rejetée par beaucoup d’hommes écrivains, aurait mauvaise presse et son emploi critique pour cataloguer une œuvre de femme serait le signe d’un processus de « minoration de l’écriture des femmes ». Laurens, tout en jugeant la notion d’autofiction « intéressante », ne l’emploie pas systématiquement pour évoquer ses propres textes, refusant une catégorisation générique réductrice : si cela peut être compris comme le signe d’une certaine prudence acquise au fil de ses démêlés judiciaires, on peut aussi y voir la conséquence de sa bonne connaissance du champ littéraire et des enjeux poétiques et théoriques qui sous-tendent « le procès de l’autofiction ». Tel était le titre d’un article de Jean-Louis Jeannelle publié en 201317, très éclairant sur le contexte compliqué (affaires portées devant la justice) dans lequel l’écrivaine a eu à s’engager dans la défense de l’autofiction ; il observait que Laurens préférait auparavant la catégorie de « roman vécu18 » à celle d’autofiction. Mais le propos n’est pas ici d’entrer plus avant dans les débats et querelles sur l’autofiction. Il s’agit plutôt de formuler l’hypothèse que certaines modalités du déploiement de la fictionnalisation de l’expérience vécue (amplification, accumulation, répétition, mythification, typification, condensation, intertextualité, commentaires inspirés par la psychanalyse) peuvent être pertinentes pour appréhender, dans le cadre de la représentation d’une existence particulière auto-fictionnalisée, la question des âges de la vie d’une femme et des modes de relations entre différentes générations de femmes.
6L’expérience vécue ne se limite pas en effet à ce qui arriverait « vraiment », « factuellement » et peut être transposé, masqué, modifié dans un roman par son auteur, et qui peut faire l’objet, au fil des textes, de déclinaisons narratives multiples où se réinvente et se réinterprète le vécu : le nom ou la profession d’un père, la ville où l’on a grandi, le cours de danse qu’on a suivi, des attouchements sexuels intrafamiliaux subis, un avortement, la liaison adultère d’une mère, la mort du fils à la naissance, les divorces, le sien et celui du père. La possible véracité biographique des événements relatés importe moins, par rapport au projet du roman, que sa composition et ses effets de lecture, c’est-à-dire l’agencement et le réagencement de ces « fragments biographiques », de ces « biographèmes19 » dans une réécriture rétrospective qui leur découvre des significations nouvelles pour les partager avec des lecteurs d’aujourd’hui. La matière biographique est retravaillée et sa mise en récit réorientée et reconfigurée, ce que ferait apparaître par exemple la comparaison des deux portraits de femme que sont Fille et Dans ces bras-là, roman publié vingt ans plus tôt. Le chapitre « Ce serait un livre sur », qui met en scène et en mots le passage du Je au Elle, affiche un positionnement diamétralement opposé à celui du roman qui nous occupe, très troublant pour le lecteur qui ne cesse de « reconnaître », d’un texte à l’autre, des séquences narratives dont il supposera, à tort ou à raison, qu’elles renvoient à un même réel.
Je ne serais pas la femme du livre. Ce serait un roman, ce serait un personnage, personnage, qui ne se dessinerait justement qu’à la lumière des hommes rencontrés ; ses contours se préciseraient peu à peu de la même façon que sur une diapositive, dont l’image n’apparaît que levée vers le jour. Les hommes seraient ce jour autour d’elle, ce qui la rend visible, ce qui la crée, peut-être. Je sais ce que vous allez dire : et les femmes ? Les autres femmes ? La mère, la sœur, l’amie… N’ont-elles pas autant de poids dans une vie, sinon davantage ? Ne comptent-elles pas ? Elles ne compteraient pas. Pas dans cette histoire. Ou très peu20.
7Dans Fille, les femmes comptent… La narratrice de ce roman retrace, sur plusieurs décennies, un parcours de vie qui lui-même croise les parcours d’autres filles et femmes, saisies à différents âges, égrenés notamment pour elle et, dans la IIIe partie, pour sa fille, l’ensemble constituant un portrait contrasté de la condition féminine dans ses évolutions et ses permanences. À certains égards, Fille fonctionne pour le lecteur à la manière d’un roman d’apprentissage des lois du genre (gender), en ce sens que le double retour effectué par la narratrice sur son enfance et son adolescence, puis sur celles de sa fille Alice, pose clairement la question de l’éducation des filles et du formatage de genre mis en œuvre par la famille et l’école, évoque les expériences et épreuves que traverse toute jeune fille confrontée aux normes qui lui sont prescrites ; mais ce roman est aussi le lieu de la remémoration et de l’expression de refus, de non21 formulés par les filles et les femmes, de colères, de critiques pensées et/ou émises à différents âges, et, au cours de leur existence, de choix émancipateurs. La condition féminine, envisagée notamment à travers les « vies-modèles » de la grand-mère et de la mère et toutes les prescriptions adressées à l’enfant, à l’adolescente puis à l’adulte, fait en partie figure de repoussoir en ce qu’elle semble arrêter une destinée faite de contraintes, de répétitions et d’interdits. Dans Encore et jamais. Variations (2013), et plus précisément dans le premier chapitre intitulé « Tu repasseras », la narratrice déclare avoir vu petite fille en sa grand-mère, et en toute « femme au foyer », « une Danaïde condamnée à remplir sans fin le tonneau du quotidien22 » (repassage, ménage, reprisage) et se souvient de sa décision : échapper à son genre :
[…] si routine et ressassement formaient l’essence du féminin, pas d’hésitation : je serais un homme ! Je ne mourrais pas effacée par mes propres gestes, par mes gestes propres, je ne me laisserais pas repasser par le rouleau compresseur du destin anatomique23 […].
8Le retour sur soi effectué par Laurence Barraqué, qui se représente et se décline grammaticalement à travers les trois pronoms – tu, je et elle –, peut se lire comme une enquête sur ce que signifie être fille, ou comme un « parcours de genre24 », pour reprendre la formule employée par l’historien Ivan Jablonka, auteur de Un garçon comme vous, « autobiographie de genre25 » contemporaine de Fille, où il invente la notion de « genration », définie comme « le processus par lequel le genre détermine une génération, la manière dont l’identité sexuée s’inscrit dans le temps des individus26 ». Là où Jablonka utilise les méthodes des sciences sociales (archives familiales, entretiens) tout en faisant œuvre littéraire, Laurens a recours à la fiction et à sa propre mémoire pour décrire et questionner comment la féminité, comme façon d’être, de bouger, de se penser, de parler, de vivre en fille, a été « prescrite aux jeunes [filles] de [s]a cohorte et, réciproquement, comment [elles] l’ont comprise, interprétée, adoptée, parfois contredite ou rejetée27 ». L’enquête de Laurens porte par ailleurs sur la langue, l’inscription dans la langue d’une infériorisation, d’une minoration et d’une dévaluation de tout ce qui touche au féminin : cette sensibilité à la langue et à ce que charrient les mots comme représentations trouve son origine dans la formation académique de Camille Laurens (agrégée de Lettres – son double fictionnel est traductrice), dans sa pratique de la littérature comme écrivaine, lectrice et critique ; elle s’est aussi exprimée dans ses essais sur le langage28 où elle tente de faire apparaître, armée de ses dictionnaires, de ses lectures et de choses entendues, ce que trament les mots, tissant nos vies et complotant parfois contre nous.
9Ses compétences linguistiques et sa curiosité ironique sont reversées au crédit de la narratrice autodiégétique de Fille, qui partage avec l’écrivaine une certaine façon de voir le monde et d’analyser, en termes transgénérationnels, les évolutions de la condition féminine en France. La mise en œuvre de ses réflexions sur la polysémie du mot « fille », sur l’écart sémantique observable entre les sens des mots « garce », « garçon29 » ou sur le choix du terme « règles » pour désigner les menstruations, est aussi importante que le déroulé narratif des événements marquants dont se souvient la narratrice, et ce sont ces réflexions et commentaires qui ont une vertu pédagogique et émancipatrice, qui aident le lecteur à transformer les émotions qui peuvent, en fonction de son propre vécu, le traverser à la lecture de certains épisodes violents – abus sexuel, crainte d’un viol, avortement, mort d’un bébé, coups portés par le mari – en une matière à penser et à mettre en perspective collectivement.
10Le roman, composé en trois parties d’inégale longueur et un épilogue, met en place une structure permettant de confronter un certain nombre d’expériences vécues par la narratrice, successivement petite fille, adolescente découvrant la sexualité, épouse, parturiente et mère, toujours fille de son père et de sa mère, mais aussi femme exerçant une activité professionnelle, et les expériences proches ou différentes, inscrites dans différents âges de la vie, et observées de l’extérieur, celles traversées par son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère puis sa fille, comme par d’autres filles-femmes, plus ou moins éloignées d’elle, réelles ou fictionnelles, qui sont les miroirs où elle cherche à se voir en fille, elle qui se sentait « garçon, des fois. Pas exactement pareille, mais pas différente, à part le rose et les robes30 » : sa sœur et rivale Claude, également affublée d’un prénom épicène qui exprime le désir profond du père – avoir un fils –, ses camarades de classe, dont Jeanine, « morte au printemps », à l’âge de treize ans, d’anorexie : « elle pesait vingt-huit kilos, à force de vouloir perdre, elle a perdu la vie31 » ; les femmes indiennes, évoquées dans les premières pages (« Si tu étais née en Inde ou en Chine, tu serais peut-être morte. À Rouen, tout va bien. On t’aime quand même32 »), puis vers la fin, à propos de ses discussions avec Alice qui a choisi de faire un TPE sur le féminisme :
Ce qui est terrible, tu sais, maman, c’est que les femmes ont peur tout le temps, partout, à toutes les époques. Évidemment, elles ont moins peur chez nous qu’en Inde ou je ne sais où, mais enfin, que ce soit conscient ou non, elles vivent dans la peur, la peur des hommes33. [Propos d’Alice].
11Mais s’appréhender comme fille, pour Laurence B., c’est aussi se confronter à des représentations, à des récits, à des situations mis en œuvre par la littérature, c’est affronter en soi les contradictions entre son aspiration à la liberté, à l’égalité, et la puissance de ses fantasmes de domination, générateurs de plaisir, et qui sont alimentés par des mots lus (ceux de Sade, de Montaigne). Cette remémoration-analyse par la narratrice du double effet du mot « garce », sur l’adolescente qu’elle fut, témoigne d’un rapport ambivalent à la domination, contestée mais aussi désirée, son évocation et sa mise en scène fantasmatique lui offrant des plaisirs aussi violents que secrets et solitaires. Un passage articule de manière saisissante la façon dont le mot « garce » est compris intellectuellement comme la marque d’une stigmatisation du féminin, mais reconnu comme doté de « pouvoirs » sur son imagination et sur son corps :
Garce. Le mot revient et la hante. C’est une injure. […] Mais il a des pouvoirs. Elle va bientôt le retrouver à la bibliothèque municipale où elle passe des heures dès qu’elle le peut. « Héliogabale attelait parfois deux cerfs à son coche, et une autre fois quatre chiens, et encore quatre garces nues, se faisant traîner par elles », lit-elle par hasard dans un livre de Montaigne. Cette phrase entre dans le recueil privé de ses caresses les plus violentes. Elle a une espèce de hit-parade comme pour les chansons. Ça, c’est une bonne phrase, c’est plus fort que la comtesse de Ségur, elle voit l’image avec le mot qui crache, elle voit la fille en laisse qui avance à quatre pattes, elle voit l’animal qu’on fouette et qui va, elle s’y voit. Être une garce, on en jouit34.
12Par ailleurs, le roman procède par accumulation, concentration et répétition d’expériences – souvent déjà écrites, on l’a dit – qui sont reconsidérées, voire requalifiées à partir d’un point de vue contemporain éclairant autrement ce qui a été vécu dans le silence, la solitude, la peur parfois et la soumission. Il en va ainsi lors de l’évocation de ce qui serait aujourd’hui catégorisé comme agression sexuelle sur mineure par un adulte exerçant une autorité : pour évoquer ce traumatisme de l’inceste – l’agresseur est le frère aîné de son grand-père –, la narratrice renonce au Je – adopté à partir du moment où elle décrit ce dont elle se souvient consciemment – pour passer au elle, pendant plusieurs pages, seul moyen de tenir à distance la petite fille de neuf ans atteinte dans son intimité :
À travers le temps, je me reconnais en cette enfant comme dans un miroir, mais c’est à une autre que les choses arrivent, sinon je ne peux pas. Elle sort de la baraque aux lapins […]. Lui, c’est le frère aîné de son grand-père, il s’appelle Félix […]. Il touche ses fesses, elle veut se retourner […]. Mais elle ne peut pas, il la tient d’une main serrée sur la nuque comme Thérèse quand elle dépouille un lapin35.
13Un peu plus tard, le grand-oncle recommence ses attouchements dans la cuisine, au vu et au su des adultes qui ne disent rien et pire, la condamnent, elle : « Les grands ne font pas attention à lui, ils la dévisagent, elle. Petite vicieuse, disent leurs yeux36. » L’enfant finit par parler à sa grand-mère, qui lui ordonne de ne jamais répéter ce qu’elle vient de lui dire37, mais réunit un « conseil de filles » qui tente de trouver une solution pour protéger l’enfant sans ébruiter l’affaire. Le grand-oncle est quelque temps exclu des parties de cartes du soir, seule distraction nocturne à la campagne ; mais la mise à l’écart ne durera pas… il faut bien un quatrième partenaire pour jouer à la belote.
14Une telle séquence suggère en quoi les femmes, quelle que soit leur génération, de la grande sœur à la grand-mère, ont eu leur part de responsabilité dans le maintien de la domination masculine et l’acceptation d’abus aujourd’hui considérés comme de graves délits. Toutes générations confondues, ces femmes ont intériorisé l’idée que femmes et hommes étaient différents par nature, mais aussi que, d’une certaine façon, l’origine du problème se trouvait du côté des femmes. De quoi est-il question en effet ? L’épouse de Félix a eu droit à « la totale » et elle ne peut plus satisfaire ses besoins sexuels : une remarque, saisie au vol, voit là l’origine et l’explication indiscutable du comportement du grand-oncle :
Depuis son opération, elle ne veut plus entendre parler de rien, avec son mari c’est l’auberge du cul tourné tous les soirs, alors forcément, il est frustré. Les hommes, c’est des pulsions, on n’y peut rien. Il leur faut la bagatelle38.
15La résistance des femmes à cette situation de menace, qui leur apparaît comme marquée par la fatalité, ne saurait être frontale : évitement, surveillance commune, c’est tout ce qui sera proposé par ce « conseil de filles » à l’enfant agressée. On ne parlera pas non plus de cette histoire au père, pourtant médecin, resté à Rouen pour travailler : « on n’y pensera même pas39. » Mais l’enfant-fille, laissée à elle-même alors qu’elle a « parlé », fait des cauchemars où son corps est assailli par des insectes qui veulent la pénétrer. Et son corps se referme, se refuse, se barricade comme il le peut :
elle se voit trous béants, sa peur est à hurler, mais bouche cousue. Bientôt, il faut la traiter pour une constipation rebelle, c’est le mot écrit sur la notice, rebelle. […] Elle rêve de bouchons qui bloquent toutes les entrées, toutes les issues : son corps n’est pas un lieu de passage. On ne passe pas40.
16Laurence Barraqué ne posera des mots sur ce vécu que bien plus tard, quand un ami de jeunesse, à qui elle se sera confiée, l’invitera à parler dans le cadre d’une journée d’étude internationale sur l’inceste : la réaction de sa mère, à qui elle demande de garder sa fille, manifeste son incapacité à prendre acte de l’abus sexuel dont a été victime son enfant des années plus tôt :
« Sur l’inceste ? Tu vas traduire ? – Non, maman. J’y vais comme participante. » Le vide se meuble d’une imperceptible friture. « Mais quel rapport avec toi ? » finit-elle par dire41.
17La représentation de plusieurs générations de femmes dans le roman se révèle donc efficace pour montrer comment ces dernières collaborent à leur propre domination, épousant le point de vue et les intérêts des hommes, parfois contre l’intérêt de leurs propres filles, on l’a vu dans cet épisode. On pourrait également évoquer le récit de l’accouchement tragique de la narratrice et ses suites, la compréhension tardive de la responsabilité de ses deux parents, père et mère, dans la mort de son enfant : disqualification de la gynécologue qui la suivait, accusée par eux d’alcoolisme, pour lui imposer, par complaisance, un jeune gynécologue sans expérience, mais fils d’un confrère du père, et qui se révèlera incompétent, indifférent et arrogant42.
18Cette représentation diffractée de la condition féminine met en tension ce qui pourrait apparaître comme la reconduction d’un certain nombre de stéréotypes – la mère de la narratrice a épousé un médecin, ne travaille pas pendant longtemps, s’ennuie, aime les robes (le mot revient une quarantaine de fois dans le roman) et le maquillage, écoute dans sa cuisine des chansons sentimentales et prend un amant qui la délaisse lorsque son épouse a un nouvel enfant. Le discours de la narratrice sur sa mère est pourtant nuancé : elle lui a donné présence et amour pendant ses premiers mois, avant de la délaisser parce qu’elle était enceinte à nouveau – la petite fille meurt dès sa naissance –, nouvelle qui est commentée avec ironie pour évoquer la responsabilité du père dans l’affaire, comme médecin et comme père frustré de n’avoir encore que deux filles :
Quoi ? Encore ! Oui. Ta mère a cru tout rond ce que lui assurait ton père (c’est lui le savant, il connaît tout du fonctionnement, le corps féminin n’a pas de secrets pour lui) : tant qu’elle allaite, elle ne peut pas tomber enceinte. C’est mathématique. La lactation empêche le retour de l’ovulation. Tu parles, Charles ! C’est l’as de la contraception, ton père ! À moins qu’il ne se soit remis en douce illico à son ambition mâle : avoir un garçon. Ta mère n’a pas le temps de dire ouf. Ni toi de dire encore43.
19La mère est donc montrée comme subissant la déception d’un époux, qui finira sur le tard par la quitter pour épouser une femme plus jeune, laquelle, suivie par la gynécologue jadis diffamée, c’est à noter, accouchera d’un fils. Comme les mots, les stéréotypes disent un état de la société et entrent dans le processus de genration, sans dire toute la complexité des parcours individuels. On a déjà mentionné le fait que la mère ne travaillait pas au début de son mariage (elle prendra plus tard un emploi dans un bureau d’import-export pour ne plus avoir à quémander de l’argent). Mais mémé, son arrière-grand-mère, patronne d’une parfumerie, continue de travailler : « Personne ne trouve bizarre que de toutes les filles de la maison, sur quatre générations, ce soit la plus vieille qui travaille, la seule qui gagne de l’argent44 », observe la narratrice, depuis le présent d’où elle accomplit ce retour vers un passé familial où cohabitaient plusieurs générations de femmes. En formulant son étonnement, elle invite le lecteur à sortir de la double illusion d’un progrès continu ou d’un déterminisme générationnel. Mémé, que le père n’aime pas, est pourtant montrée en exemple à ses filles, Claude et Laurence : elles devront « absolument avoir un métier45 », moins pour s’émanciper par le travail que pour ne pas se tourner les pouces. Laurence, dont on a repéré le QI élevé – il dépasse celui des garçons du groupe scolaire testé, à la grande surprise du père –, fera donc des études et ne deviendra pas hôtesse, mais traductrice. Si le père projette ses filles vers le monde du travail, son échange avec les psychologues venues lui parler des dons de sa cadette montre ce que demeurent les assignations de genre et préjugés en termes de capacités et d’orientation professionnelle des filles au début des années 70 – et au-delà :
– Les filles sont plutôt littéraires, en effet. Cela dit, il y a de plus en plus de femmes médecins, comme vous le savez. – Oui. Mais hôtesse dans un aéroport, par exemple, ce serait bien pour Laurence. Les langues, pour une fille, ça fait de bonnes études, russe, chinois, il y a des débouchés de nos jours46.
20Un tel discours témoigne de la façon dont les inégalités de genre continuent à agir alors même que les conditions de vie des femmes se sont globalement améliorées d’une génération à l’autre : elles pèsent sur les ambitions que des parents peuvent nourrir pour leur fille, sur la façon dont sa vie et son comportement restent sous contrôle. Le père de la narratrice fait un cours à ses filles sur l’importance de conserver leur virginité jusqu’au mariage (rien de tel pour les garçons bien sûr) ; le père d’Alice, des années plus tard, s’inquiètera de ce que sa fille ne soit pas « féminine » et tiendra pour responsable de cet échec de formatage… sa mère : normes de conduite, normes de genre demeurent édictées par les hommes et en partie intériorisées voire relayées par les femmes. Mais là encore rien de continu, de linéaire, de systématique : le personnage de mémé annonce par ses choix, non conformes aux attentes de son époque, le personnage d’Alice par sa confiance dans la valeur des filles :
Ta grand-mère a toujours été fille unique, sa mère aussi, et fille-mère en prime, qui l’a élevée seule. Alors les filles, elles trouvent ça bien, en un sens. Même s’il en naissait une flopée, chacune serait unique. Enfin, unique… À la fois unique et comme elles, extraordinaire et identique, vouée au même destin que le leur et riche d’autres possibles, qui sait ? La fille est l’avenir de la femme, chez elles. La fille est l’avenir d’elles, mais aussi leur reflet. Ça les tient, mamy et mémé. Elles ne votent que depuis dix ans, guère plus, et encore, elles n’osent pas toujours. Mais elles ont des espérances. Elles te donnent leur procuration. Tu seras unique, ma petite-fille. Mais reste dans les clous, quand même47.
21Cette confiance dans le génie féminin – confiance prudente toutefois –, qui anime mémé et sa fille, mamy, et qu’elles ont transmise à leurs descendantes, ne les empêche en rien de reformuler des prescriptions (être sage, ne pas coiffer Sainte-Catherine) ou des interdits. Mémé se montre horrifiée lorsqu’elle découvre les deux sœurs, Claude et Laurence, s’embrassant sur la bouche pour s’entraîner à des amours hétérosexuelles :
Nous voir la défigure. « Pas deux filles, crie-t-elle, pas deux filles ensemble, c’est mal ! » – et elle me tire par le bras pour me séparer de ma sœur. Claude rit aux éclats et la poursuit dans le couloir, « mais une fille et un garçon, là c’est bon, mémé ? Dis, ça va, si c’est un garçon48 ? »
22Camille Laurens ne cesse ainsi de montrer la complexité du rapport que ses personnages féminins ont aux normes de genre et souligne leur difficulté à avancer dans l’existence sans se heurter à ce qui, en elles, fait résistance, au plus profond : les préjugés de genre qui leur ont été inculqués dès l’enfance, qu’elles ont intériorisés, même en les contestant49 et qu’elles tendent à faire passer à la génération suivante, étant ainsi prisonnières et geôlières selon les mots de la narratrice dans l’épilogue que nous avions cités en introduction. Mais rien n’est figé non plus, ni univoque dans ces portraits de femmes qui trouvent les moyens de suivre leurs désirs : mémé a une fille hors mariage, la mère de la narratrice a pris un amant, approuvée en cela par les anciennes (après tout, Matthieu, son époux n’est pas une affaire au lit), Laurence se marie certes avant vingt-cinq ans, mais en ayant acquis une expérience sexuelle, comme un garçon, puis assumé un avortement, Alice vivra sa sexualité plus librement encore, sans éprouver de honte parce qu’elle aime une autre fille.
23Fille peut donc aussi se lire comme une fiction engagée, féministe, dont la séduction ne tient pas seulement à sa capacité à prêter vie à des personnages féminins saisis à différents âges de leur vie. C’est aussi un essai, entendu comme tentative pour traiter de manière argumentée et libre l’inépuisable sujet que serait « la fille », à partir de personnages singuliers, mais en universalisant le propos, notamment par la convocation ironique de figures mythiques masculines renvoyant au vieux monde. Les choix onomastiques effectués par l’autrice transfigurent et excèdent le vécu de la narratrice : le père qui évangélise ses filles s’appelle Matthieu ; l’amant de la mère, André, c’est-à-dire l’homme50 ; le fils perdu à la naissance, Tristan ; le garçon, si longtemps attendu par le père, obtenu si tard dans sa vie, sera nommé Adam. Pour les femmes, la liberté et l’émancipation se gagnent du côté de la littérature et de fictions nouvelles : en nommant sa fille Alice, la narratrice ne savait pas qu’elle lui ferait un jour quitter le vieux monde, où naître fille était malédiction, pour lui ouvrir le pays des merveilles51 en prononçant les mots réparateurs effaçant le sortilège inaugural et dotés d’une force politique, au sens large du terme : « c’est merveilleux, une fille52 », des mots repris comme une vérité universelle soudain révélée et pleinement assumés par la narratrice en conclusion du roman : « Tu as raison, ma chérie, ai-je dit, c’est merveilleux une fille53. » Laurens formule là, au terme d’une trajectoire narrative et critique portée par l’ironie, l’amour maternel et la force de son âge, ce qu’Alice Zeniter, suivant le philosophe Frédéric Lordon54, appelle une « idée affectante, c’est-à-dire [arrivant] chargée de mises en récit ou d’images qui nous rendront présentes, urgentes, brûlantes des choses ou des causes qui étaient jusque-là lointaines voire invisibles55 ». Elle produit un récit encore « minoritaire », en ce sens qu’il évoque, sur plusieurs générations et à plusieurs âges, des femmes dont la vie ordinaire – par opposition aux vies extraordinaires – s’est construite dans des champs sociaux et culturels, mais aussi au sein d’une langue dévalorisant les filles ; mais ce récit, par l’écho qu’il a rencontré chez ses nombreux lecteurs, par le retournement joyeux et contestataire qu’il opère en déclarant c’est merveilleux, une fille, fait partie de ceux capables de contrer « le récit dominant (lequel est une forme dominante du récit en même temps qu’un récit des dominants)56 ».
1 Camille Laurens, Fille, Paris, Gallimard, 2020 ; coll. « Folio », 2022 (édition de référence pour toutes les citations du texte). La formule se trouve déjà quatre fois dans Dans ces bras-là (2000), les premières pages de Fille pouvant se lire comme une amplification de l’incipit du premier des chapitres intitulés « Père ».
2 Ibid., p. 21.
3 Ibid., p. 22.
4 « Il y a des mots qui portent en eux la malédiction », observe la narratrice dans un autre contexte, à propos d’un terme figurant « dans le dossier médical de Tristan, mort par sidération » (ibid., Épilogue, p. 243).
5 Ibid., p. 29.
6 L’Épilogue fournit un repère chronologique relevant du temps calendaire : une manifestation en faveur du mariage pour tous (la loi fut promulguée début 2013) au cours de laquelle sa fille a été insultée et maculée d’un crachat haineux par un vieil homme. Le temps de l’écriture n’est pas précisément situé, mais il s’inscrit donc après le moment où la narratrice découvre l’orientation sexuelle de sa fille Alice et surmonte, grâce au discours très ferme de cette dernière, sa propre culpabilité de n’avoir pas su jouer le « rôle d’une mère envers sa fille » : lui transmettre le « goût » de la « féminité » (voir ibid., p. 247).
7 Ibid., p. 250.
8 Ibid.
9 Voir l’article « Autofiction », utile synthèse accompagnée de propositions bibliographiques, rédigée par Sylvie Jouanny dans Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi en langue française, dir. Françoise Simonet-Tenant, Paris, Honoré Champion, 2017, p. 94-97.
10 Camille Laurens, Philippe, Paris, POL, 1995 ; Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2008 (édition de référence). Au terme de ce court récit, l’autrice prend acte du fait que le Je, pronom qui avait longtemps été, pour l’écrivaine qu’elle était, le commencement d’une « phrase impossible », s’est ouvert un chemin dans son écriture : « Quand je relis les pages écrites dans ce livre, c’est l’impression d’un immense effort qui domine. Jusqu’ici, j’ai toujours trouvé impensable, ou, pour mieux dire, impraticable, d’écrire Je dans un texte destiné à être publié, rendu public. Je est pour moi le pronom de l’intimité, il n’a sa place que dans les lettres d’amour. » (p. 81).
11 Voir notamment Cet absent-là. Figures de Rémi Venet, Paris, Éditions Léo Sheer, 2004 ; Gallimard, coll. « Folio », 2006, p. 39, p. 43-47. Dans Fille, l’enfant disparu devient le mythique Tristan. Dans un entretien accordé à Adina Stroia, Camille Laurens a évoqué la nécessité et le sens pour elle de ce travail d’écriture et de ré-évocation : « Travail de deuil, ça a l’air de dire que c’est une étape, on fait son deuil et puis on passe à autre chose. Disons plutôt que c’est un travail qui n’en finit pas, qui se rejoue sans arrêt d’un livre à l’autre. […] Ce n’est pas une guérison, pas quelque chose dont on guérit, plutôt quelque chose qu’on répète de livre en livre, mais pas comme une répétition stérile, comme quelque chose qui fait avancer aussi, mais qui ne finit pas. » Adina Stroia et Camille Laurens, « Camille Laurens, l’écriture depuis soi », Dalhousie French Studies, vol. 112, 2018, p. 141-149 ; cit. p. 143.
12 J’emprunte l’expression à Adina Stroia (voir note précédente).
13 Cet exemple devenu emblématique des problèmes posés par les limites – juridiques notamment – du « dévoilement de la vie d’autrui » (p. 582) est convoqué par le Dictionnaire de l’autobiographie, op. cit., p. 172-173 (article « Censure » signé Catherine Viollet et Véronique Montémont) et p. 582 (article « Nom propre » signé Véronique Montémont qui se réfère au Petit traité de la liberté de création d’Agnès Tricoire, Paris, La Découverte, 2011). Voir aussi : Jean-Louis Jeannelle, « Le procès de l’autofiction », Études, 2013/9 (Tome 419), p. 221-230. DOI : 10.3917/etu.4193.0221. URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-9-page-221.htm, page consultée le 22 mai 2024, lire notamment § 10-12.
14 Philippe Gasparini, Autofiction. Une aventure du langage, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2008, p. 311.
15 Voir Philippe Vilain, « Démon de la définition », dans Autofiction(s), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2010. En ligne : http://books.openedition.org/pul/3753, page consultée le 22 mai 2024 ; Jean-Louis Jeannelle, « Le procès de l’autofiction », art. cité.
16 Lien vers le podcast dont sont citées quelques formules : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-masterclasses/camille-laurens-l-autofiction-c-est-insister-sur-ce-melange-de-fiction-a-l-oeuvre-y-compris-quand-on-pretend-parler-de-soi-c-est-l-autobiographie-moderne-6157030, page consultée le 22 mai 2024.
17 Jean-Louis Jeannelle, « Le procès de l’autofiction », art. cité.
18 Ibid., § 11.
19 Dans son entretien avec Céline du Chéné, Camille Laurens compare la fabrique de ses autofictions à la création de formes que produit le kaléidoscope lorsqu’il fait bouger les petits fragments de verre se reflétant dans un miroir : elle crée de nouvelles figures en réagençant des « fragments biographiques » ou « biographèmes », explique-t-elle en convoquant Roland Barthes. Voir note 16 pour le lien vers le podcast (37’).
20 Camille Laurens, Dans ces bras-là, Paris, POL, 2000, chap. « Ce serait un livre sur ».
21 Voir le très bel essai de Jennifer Tamas, Au NON des femmes. Libérer nos classiques du regard masculin, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2023.
22 Camille Laurens, Encore et jamais. Variations, Paris, Gallimard, coll. « nrf », 2013, p. 17.
23 Ibid.
24 Ivan Jablonka, Un garçon comme vous et moi, Paris, Seuil, coll. « Points », 2021, chap. 1 « Je ne suis pas un mâle ! », p. 10.
25 Ibid.
26 Ibid., chap. 36 « Être avec elle », p. 299.
27 Nous détournons ici une phrase de Jablonka, en modifiant tout ce qui y avait trait au genre masculin : « Dans ce livre, j’ai étudié ma genration pour savoir quelle garçonnité a été prescrite aux jeunes mâles de ma cohorte et, réciproquement, comment ils l’ont comprise, interprétée, adoptée, parfois contredite ou rejetée. Ainsi ai-je mené mon enquête sur nous garçons, sur le nous-garçon. », ibid., p. 299.
28 Voir les trois essais réunis dans La Trilogie des mots. Quelques-uns. Le Grain des mots. Tissé par mille, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2022. Ces essais se présentent sous forme d’articles ouverts par une entrée nominale. Plusieurs d’entre eux font écho à ce qu’on peut lire dans Fille, notamment « Homme / Femme » (Le Grain des mots), où on peut lire ceci : « Belle occasion de méditer sur le machisme et la misogynie servis par une langue dans laquelle le même mot désigne l’espèce humaine et l’individu mâle, comme si le second était le meilleur représentant de la première […]. » L’article « Vieillir » (dans Tissé par mille) rejoint également notre texte de bien des façons, notamment lorsque Camille Laurens commente ainsi le « J’ai vieilli. », réponse de la délicieuse Zazie à la question « Alors, qu’est-ce que t’as fait ? » (dialogue conclusif de Zazie dans le Métro de Queneau) : « J’adore cette réponse, et pas seulement parce qu’elle émane d’une petite fille. Elle évoque le temps qui passe, irrémédiablement perdu, mais aussi une expérience, une maturité gagnée. » Une maturité qui peut offrir une liberté nouvelle.
29 Voir Camille Laurens, Fille, op. cit., p. 100 : « Tout ce qui est féminin déçoit, déchoit, elle le sait désormais. Garçon, c’est un constat. Garce, c’est un jugement. Le mot, en changeant de genre, devient mauvais. »
30 Ibid., p. 59.
31 Ibid., p. 122 pour cette citation et la précédente.
32 Ibid., p. 27.
33 Ibid., p. 236.
34 Ibid., p. 100-101.
35 Ibid., p. 77-79.
36 Ibid., p. 81.
37 Cet épisode est présent, associé à l’enterrement de son grand-père, et restitué selon un schéma narratif initialement proche – attouchements dans le potager, réitérés devant des adultes qui n’interviennent pas et la condamnent, elle, récit fait à la grand-mère qui lui donne l’ordre de se taire – dans Dans ces bras-là (2000), chap. « Le grand-oncle ». Le long développement concernant la réaction des femmes à cette agression offre au lecteur de quoi méditer sur la complicité active des femmes dans les abus dont sont victimes les enfants.
38 Ibid., p. 83.
39 Ibid., p. 84.
40 Ibid., p. 87.
41 Ibid., p. 233. Camille Laurens est revenue ailleurs sur le déni de l’entourage à propos de cet événement immédiatement voué au silence et à la non-existence par sa grand-mère, la nécessité de parler rencontrant le refus d’écouter et l’injonction au secret. Voir Encore et jamais. Variations, publié en 2013 et le texte intitulé « Écrire : secréter le secret » qui a été publié, suite à un colloque où elle avait été invitée, dans un collectif dirigé par Pierre Benghozi et Pierre Etchart, L’Inceste, scènes de famille, Paris, Éditions In press, 2020, p. 159-168. L’article éclaire de bien des manières cette séquence de Fille en inscrivant le traitement de cet « épisode incestueux » (p. 160) traumatique dans le temps long de l’œuvre : Camille Laurens fait l’hypothèse que ce déni pourrait s’expliquer par le fait que la « représentation de l’inceste » se fait toujours « de biais » dans ses « romans de genre autofictionnel », l’inceste n’en constituant jamais le « sujet principal » (ibid.). La rédaction de ce texte a été pour l’écrivaine l’occasion de revenir sur les façons dont l’acte incestueux s’est écrit successivement pour elle « dans le corps, dans la psychanalyse, puis dans la littérature » (p. 164) ; de relire les textes qui ont fait affleurer peu à peu l’épisode incestueux dans différents livres : Dans ces bras-là, Romance nerveuse, Encore et jamais. La conclusion met en avant l’énergie libératrice de l’écriture autofictionnelle : « […] la répétition inlassable du trauma dans l’autofiction a sans doute pour visée ultime de parvenir à dire quelque chose de cet indicible, à montrer quelque chose de cet invisible. Et au-delà, en ce qui me concerne, par l’humour et l’ironie, par la jouissance d’écrire, de réaffirmer le principe de plaisir contre l’horreur du réel. En ce sens, la vertu eudémonique de l’écriture autofictionnelle est évidente. Il s’agit, encore et toujours, contre le réel, de devenir heureux. » (p. 168).
42 Dans Philippe, le médecin accoucheur est conseillé au couple qui, vivant et travaillant au Maroc, a fait le choix de revenir en France pour la naissance, par des amis. Ici, c’est au père, soutenu par son épouse, que revient cette responsabilité de l’éviction, par disqualification mensongère, d’une collègue femme au profit d’un jeune médecin sans expérience, par corporatisme et entre-soi masculin. Ce déplacement est significatif de la réorientation du matériau biographique vers une analyse critique des modes de fonctionnement de la domination masculine.
43 Camille Laurens, Fille, op. cit., p. 33-34.
44 Ibid., p. 60.
45 Ibid., p. 61.
46 Ibid., p. 99.
47 Ibid., p. 37.
48 Ibid., p. 127.
49 La narratrice se représente comme observant dès l’enfance que les garçons ne lui sont pas supérieurs : voir notamment p. 46-53 et ses observations de petite fille sur le sexe opposé que se remémore la narratrice.
50 Sur ce prénom, voir Dans ces bras-là, Paris, Gallimard, 2000, chap. « André » : « Dans tous les romans qu’elle écrira plus tard, André sera le nom de l’amant. Elle ne pourra pas changer ce nom, en inventer un. L’amant n’est pas une fiction, mais une réalité nommable ; l’amant n’est pas un personnage, mais un homme, un vrai : c'est lui, et pas un autre : André. »
51 La référence à Lewis Carroll est consciente chez les parents, mais elle s’assortit d’un commentaire montrant l’écart d’intention très net observable entre le père et la mère : « […] on avait décidé de l’appeler Alice pour qu’elle nous emmène au pays des merveilles, avait dit Christian, moi je préférais que des lapins se penchent sur son berceau plutôt que des hommes », Camille Laurens, Fille, op. cit., p. 189. On trouve plus tôt dans le roman une autre référence intéressante liée au prénom Alice : la littérature jeunesse, que Laurence a dévorée – à côté d’autres titres pas du tout écrits pour les enfants – à l’âge de onze ans, et où elle découvre que « des jeunes filles du nom d’Alice ou de Fantômette résolvent des énigmes » (p. 101), ce qui les situe du côté de l’intelligence et de l’agency.
52 Camille Laurens, Fille, op. cit., Épilogue, p. 249.
53 Nous soulignons le « tu as raison » qui semble exprimer l’adhésion volontaire et réfléchie de la narratrice aux convictions profondes de sa fille.
54 Frédéric Lordon, Les Affects de la politique, Paris, Seuil, 2016.
55 Alice Zeniter, Je suis une fille sans histoire, Paris, L’Arche, coll. « Des écrits pour la parole », 2021, p. 74.
56 Ibid., p. 76.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 31, 2024
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1761.
Quelques mots à propos de : Ariane Ferry
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
