Sommaire
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
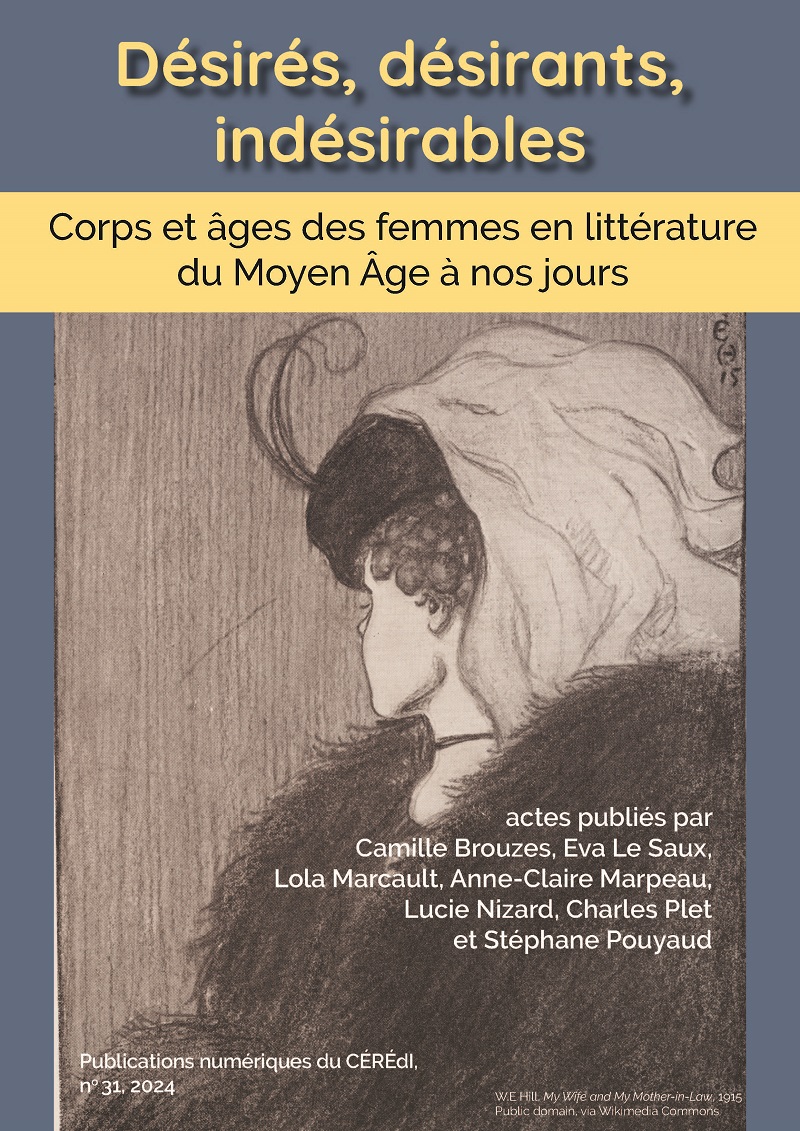
- Stéphane Pouyaud, Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard et Charles Plet Préambule
- Martine Boyer-Weinmann « Le coffre du corps, il faudrait l’ouvrir »
- Marielle Lavenus Sorcière, entremetteuse, maquerelle et concubine : représentations de la figure de la vieille servante dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Bruxelles, KBR, ms. 9631 et Paris, BnF, ms. fr. 24378)
- Clémence Aznavour Écrire à 84 ans : Madame de Rosemonde ou la parole restreinte
- Cassandre Martigny Dire l’indicible. Reconfigurations du scandaleux désir de Jocaste pour la jeunesse, dans Le Chevalier errant de Legrand (1726), Œdipe de Voltaire (1718) et Jocaste Reine de Nancy Huston (2009)
- Céline Duverne Devenir épouse et mère : corps de jeunes filles dans le roman balzacien
- Camille Stidler Les jeunes filles dans l’œuvre d’Émile Zola : des cas et des normes
- Véronique Samson La femme de trente ans : un personnage de la première moitié du xixe siècle
- Éléonore Reverzy Retour d’âge, retour de flamme. Lecture de La Conquête de Plassans
- Savannah Kocevar Du corps au corpus : un fil initiatique d’encre et de sang dans le cycle indochinois de Marguerite Duras
- Pascale Millot Entre identification et dégoût : l’accueil du corps vieux de la mère chez Beauvoir, Calle et Cixous
- Ariane Ferry De l’indésirable à la désirante ou comment sortir de la malédiction du « naître fille » (Fille de Camille Laurens, 2020)
- Nina Roussel « L’âge de détruire » : violence féminine et subversion des représentations de la jeune fille et de la femme vieillissante dans L’Amante anglaise de Marguerite Duras et Rouge dents de Pauline Peyrade
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
Entre identification et dégoût : l’accueil du corps vieux de la mère chez Beauvoir, Calle et Cixous
Pascale Millot
1Dans son essai La Vieillesse, Simone de Beauvoir qualifie la vieillesse « d’irréalisable » en ce sens qu’un individu ne peut en prendre conscience par lui-même : « Ce que nous sommes pour autrui, il nous est impossible de le vivre sur le mode du pour-soi1. » En d’autres termes, l’être vieux, incapable de réconcilier l’image, changée, qui lui est renvoyée, avec son intériorité qui, elle, lui semble intacte, ne réalise pas son état, ce qui provoque chez lui une forme de désorientation. La vieillesse surgit ainsi de l’extérieur, comme une surprise aperçue dans le regard des autres ou dans le reflet furtif du miroir. « Nous sommes l’Autre pour les autres, pour la société, qui nous renvoient cette image à laquelle nous n’adhérons pas, et autres que ce que nous pensons être nous-mêmes2 », écrit Beauvoir avant d’ajouter, en se référant à sa propre expérience : « La vieillesse est particulièrement difficile à assumer parce que nous l’avions toujours considérée comme une espèce étrangère : suis-je donc devenue une autre alors que je demeure moi-même3 ? » Cette inquiétante étrangeté qui transforme les vieilles et les vieux en Uncanny Subjects4 circulant dans le monde étrangers à eux-mêmes est d’autant plus déroutante pour les femmes que, comme l’a montré Susan Sontag dans « The Double Standard of Aging5 », elles se voient qualifiées de « vieilles » – c’est-à-dire, dans le cas du sexe féminin, évacuées du champ de la séduction – plus précocement que les hommes, à un âge, précisément, où l’image perçue n’est pas suffisamment altérée pour qu’elles en accusent sereinement le verdict. Si cet état de fait en dit long sur la reproduction des stéréotypes de genre et l’iniquité des rapports de pouvoir qu’elle sous-tend, ainsi que sur nos sociétés consuméristes où la jeunesse et l’apparence sont valorisées au détriment de l’expérience et de l’intériorité, ce n’est pas le propos de cet article. Il sera plutôt question d’examiner comment un certain type de textes littéraires produits par des femmes, les récits de deuil de la mère écrits par leur fille écrivaine, permet, dans une certaine mesure, de dépasser l’irréalisable beauvoirien. Ces textes sont Homère est morte d’Hélène Cixous et Elle s’est appelée successivement Rachel, Monique, Szyndler, Calle, Pagliero, Gonthier, Sindler. Ma mère aimait qu’on parle d’elle de Sophie Calle. De brèves incursions seront également faites du côté d’Une mort très douce de Simone de Beauvoir.
2À partir de ces textes sera émise l’hypothèse selon laquelle, pour une écrivaine, écrire la grande vieillesse et la fin de vie de sa mère lui permet de faire l’expérience anticipée de sa propre vieillesse, de se devancer en quelque sorte. Si cette projection est rendue possible par la fréquentation rapprochée de la mère vieillissante, puis mourante, par les soins et l’attention qu’on lui prodigue, par le simple fait d’être dans la promiscuité de son corps détérioré, c’est ensuite, et plus encore peut-être, le travail de l’écriture qui, par l’expansion qu’elle donne à l’expérience vécue, autorise ce devancement, ou le réalise, pour reprendre l’expression de Beauvoir.
3Cette « réalisation » en deux temps (par le corps et par le texte) sera examinée à partir de concepts de l’éthique du care : l’accueil de la vulnérabilité maternelle dans sa grande vieillesse, les soins à son corps et à ses mots (disponibilité, écoute tendue, attention soutenue, dialogues serrés). C’est aussi, surtout, leur élaboration dans une forme de cocréation au-delà même de la mort de la mère qui permet de dépasser « l’irréalisable » beauvoirien.
Par la littérature, se devancer
4Dans Homère est morte, Hélène Cixous raconte la dernière année de vie de sa mère, Ève Cixous, morte en 2013. Dans Elle s’est appelée successivement Rachel, Monique, Szyndler, etc., Sophie Calle élabore un projet qui rend hommage à sa mère décédée en 2006. Quant à Simone de Beauvoir, dans Une mort très douce, elle s’attelle au récit de la fin de vie de sa mère, événement marquant s’il en est qui, alors qu’elle est âgée de 56 ans, la projette précisément dans sa propre vieillesse à venir.
5Le choix des deux textes principaux n’est pas anodin, car ils présentent à la fois des similarités s’expliquant par le projet commun de placer la mère morte au centre de l’œuvre, mais aussi de grandes différences, notamment dans le rapport que les deux écrivaines ont entretenu avec leur mère de son vivant. Proche, constant, fusionnel, marqué par une continuité bienveillante chez Cixous ; conflictuel, fragmenté, souvent distant chez Calle. Or, malgré les différences, dans les deux cas, le texte littéraire, sans se substituer à la relation réelle, s’impose comme un espace qui tout à la fois la prolonge et la réinvente. Cet espace qui est simultanément autre et non autre, fictionnel et agissant, performe et transforme la relation mère-fille au cœur du texte et s’impose dès lors comme une trace pérenne de la vie de la mère et, pour la fille, confrontée au miroir maternel, comme un exercice de préparation à son avenir de vieille femme orpheline de mère. La fille-écrivaine y aménage, de manière très concrète, un espace commun où est réélaboré le hors-temps de la maladie et du deuil, et qui agit comme un sas de décompression où quelque chose se dépose : dans cet espace de papier, intermédiaire entre la fille et la mère, les identités générationnelles s’abolissent, les rôles et les rangs permutent, les frontières entre la vie et la mort se brouillent, la mère y circulant à la fois morte et vivante, présente et absente.
6Pour créer cet espace, les deux autrices ont recours à la fois à des ressources narratives afin de « raconter » la vie de leur mère en faisant appel à leur mémoire, mais aussi à des ressources graphiques et matérielles, comme s’il fallait, en plus de la narration, incruster dans les pages des traces de la vie matérielle de la mère disparue. Il s’agit ici, peut-être, de la rendre réelle, voire surréelle, de lui donner, pour reprendre la belle formule de Vinciane Desprest, « plus d’existence6 ». « Ce plus s’entend certes au sens d’un supplément biographique, d’un prolongement de présence, mais surtout dans le sens d’une autre existence7. » Cet espace autre qui rend possible une coprésence est ainsi taillé littéralement dans le corps et la matière du texte grâce à des constantes thématiques, des stratégies narratives et des procédés formels qui se révèlent communs à nombre de récits de deuil : écriture à deux, reproduction d’artefacts, de photos de la défunte ou prises par elle, jeux sur la typographie et la mise en page, récit de visites réelles ou fantasmées au cimetière, ou de dernier voyage avec la mère, lui aussi réel ou fantasmé, sans oublier, pour la fille, le topos de la confrontation au corps nu, abîmé, littéralement en lambeaux de sa mère qui agit comme un coup de semonce la rappelant à sa propre mortalité.
Une cocréation fille-mère
7Les deux ouvrages revendiquent un projet une en forme de cocréation. Cette écriture à quatre mains (qui n’en est évidemment pas une) est annoncée par Cixous dès le prologue : « Ce livre a déjà été écrit par ma mère jusqu’à la dernière ligne8 », puis confirmée à la fin d’Homère est morte qui se clôt sur une signature commune : « Ève Cixous et Hélène Cixous. Le 26 août 2013 à 5 heures du matin dans la maison d’Arcachon9. » Sophie Calle, elle, l’exprime sous la forme d’une inscription au tampon-encreur, en épilogue : « Ce livre a été volé à Monique Szyndler10. » On notera l’écart lexical entre les deux verbes : écrire / voler, la connotation négative du verbe voler s’expliquant notamment par la nature plus diffuse de la relation entre la mère et sa fille chez Sophie Calle, mais aussi par l’inévitable sentiment de trahison qu’engendre un tel exercice. Cixous en convient elle aussi : « Tandis que je le recopie voilà qu’il s’écrit autrement, s’éloigne malgré moi de la nudité maternelle, perd de sa sainteté et nous n’y pouvons rien11. » Elle assume ainsi dès le début à la fois le caractère performatif de l’écriture qui, à peine initiée, s’emballe, acquiert une vie autonome, et la trahison de la mère, posant d’emblée, et y répondant de fait, la question éthique de la voix narrative. Peut-on écrire sur sa mère morte ou pour sa mère morte sans la trahir ? Non, répondent implicitement les deux autrices qui d’emblée plaident coupables. C’est dans cette trahison indissociable de la création à partir du réel que se performent en texte et en acte la permutation des rangs familiaux et l’inversion des générations. Se produit dès lors le « vieillissement » de la fille qui revendique et prend de fait en charge le rôle maternel (dans les soins et la sécurité prodigués à la mère malade) tandis que la mère « rajeunit », devient l’enfant nourri, lavé, soigné, tout entière offerte à la sollicitude de sa fille. « Ma mère, qui jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans m’avait aidée, était devenue mon enfant, d’un jour à l’autre elle m’avait remis la maternité entre mes mains, et j’avais dit oui12 », écrit Cixous, puis : « Elle me fait mère, pour l’enfant mourant qu’elle est13 » et encore : « je murmure : maman. Que dis-je ? Maman c’est moi !, si ma mère vit encore14 », tandis qu’Ève appelle parfois sa fille Mutter.
8Bien souvent, la prise de conscience de l’extrême vulnérabilité maternelle passe par la confrontation à son corps sexué. Chez Beauvoir, c’est en voyant le sexe de sa mère que Simone réalise que sa mère a un corps, mais aussi qu’elle est frappée par l’inéluctabilité de la situation : sa mère va mourir.
Celle-ci exhibait avec indifférence son ventre froissé, plissé de rides minuscules, et son pubis chauve. […] Voir le sexe de ma mère, ça m’avait fait un choc. Aucun corps n’existait moins pour moi – n’existait davantage. Enfant, je l’avais chéri ; adolescente, il m’avait inspiré une répulsion inquiète ; c’est classique ; et je trouvai normal qu’il eût conservé ce double caractère : répugnant et sacré : un tabou15.
9Tabou et caractère sacré s’effondrent cependant à mesure que la maladie progresse et que Simone, « pour la première fois, [aperçoit] en elle un cadavre en sursis16 ». Par le fait même, la fille se retrouve en haut de la liste des morts en sursis.
10Chez Sophie Calle, en raison, sans doute, de la nature moins fusionnelle de la relation entre les deux femmes du vivant de la mère, l’inversion générationnelle est moins claire mais se produit cependant alors que Sophie accepte finalement d’entrer dans la danse du « care » avec sa mère, de la soigner, mais surtout d’être attentive à son souci et à son désir, même exprimé à moitié, et que la mère l’accepte elle aussi avec une bienveillance tardive mais réelle. Ainsi en est-il de la réalisation même de l’ouvrage qui permet une fusion des deux femmes post mortem. Monique avait en effet écrit dans ses carnets : « Curieusement mon seul regret si je devais être malade, c’est de ne rien laisser derrière moi, de n’avoir accompli aucune œuvre17. » Cela n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde. Sophie, prenant acte plus tard du fait que sa mère n’a pas détruit ses carnets (« Ma mère n’était pas dupe de ce qui pourrait arriver si elle me les abandonnait18 »), se glisse littéralement dans la peau de Monique pour lui prodiguer un dernier soin, actualiser le « care » ultime en produisant l’œuvre que sa mère regrette de ne pas avoir elle-même réalisée. Le retournement générationnel se produit ainsi dans une forme d’incorporation de la mère par la fille au cœur de l’objet-livre et du texte littéraire. En témoigne justement le « vol » implicitement autorisé des carnets de la mère perpétré par les deux filles. « Je décide d’incruster dans cette construction qui désobéit à maman des feuillets tirés de sa sainte simplicité19 », écrit Cixous tandis que toute la première partie de Elle s’est appelée successivement Rachel, Monique, etc. est exclusivement constituée des carnets manuscrits (reproduits comme tels ou dans une typographie d’imprimerie) de la mère et de photos légendées par celle-ci. C’est seulement dans la deuxième partie, une fois que la présence de la mère s’est imposée, que la fille s’autorise à parler par sa voix propre, mais elle le fait en sourdine, en inscrivant en relief des phrases blanches sur du papier blanc : elle se montre en s’effaçant comme un fantôme. C’est alors la fille qui est le spectre et la mère morte la monumentale présence.
11Chez Cixous, la reproduction des carnets agit également comme préparation à la fin de vie, répétition générale de ce qui viendra pour la fille aussi. « Ces cahiers ont l’utilité qui est la vertu de ma mère. Ils n’ont pas d’autres soucis que d’accompagner les voyageurs et d’aider à mieux trépasser20. » Or, ces cahiers sont ceux sur lesquels Ève a noté tous les détails des accouchements qu’elle a effectués au cours de sa vie, elle qui a exercé le métier de sage-femme jusqu’à plus de 80 ans. Étrange retournement qui marque l’équivalence entre mort et naissance, entre fille et mère, entre nouvelle-née et vieillarde. « On est un corps qui en a vu d’autres. Deux cent quarante accouchements par mois21. » Quel est ce On qui en a vu d’autres ? Mère-fille, indéniablement, mais ce On peut aussi se lire dans un mouvement de sororité et de solidarité féministe, comme regroupant toutes les femmes qui ont accouché.
Incorporation et hommage à la mère morte
12Chez Cixous, la mère est incorporée dans la langue même, qui foisonne d’idiomes et d’expressions d’Ève la polyglotte, et de dialogues proches de la stichomythie qui rendent difficile l’attribution des répliques à l’une ou à l’autre, provoquant un floutage des identités et des générations. Il n’y a là rien d’étonnant puisque toute la vie de l’écrivaine s’est bâtie autour de la présence de la mère et que toute son œuvre, et plus particulièrement les livres produits au cours des vingt dernières années (parfois regroupés sous la dénomination « Le cycle d’Ève ») évoquent l’histoire maternelle. Calle, elle, comme elle en convient dans la seule phrase (typographie blanche sur fond blanc) qu’elle écrit à la première personne du singulier avant l’insertion des carnets de sa mère, a marché à côté d’elle, les deux femmes ne se rejoignant finalement que dans l’espace de ce livre-hommage : « Sa vie n’apparaît pas dans mon travail. Ça l’agaçait. Quand j’ai posé ma caméra au pied du lit dans lequel elle agonisait parce que je craignais qu’elle expire en mon absence, alors que je voulais être là, entendre son dernier mot, elle s’est écriée : “Enfin22”. »
13Dans les deux cas, les narratrices ont recours à la technologie pour dessiner l’espace conjoint et fixer l’hommage. Sophie s’équipe d’une caméra et d’un appareil photo pour filmer les derniers instants de Monique-Suzanne, etc., la photographier sur son lit de mort et jusque dans son cercueil. Hélène, munie d’un magnétophone, procède à « l’enregistrement de maman » pour reprendre le titre du chapitre de Benjamin à Montaigne, le terme étant ici à prendre, comme c’est souvent le cas chez Cixous, dans toute sa polysémie : elle a véritablement enregistré la voix de sa mère à l’aide d’un magnétophone, mais elle « enregistre » aussi ses moindres mouvements, ses moindres sons, mots, clignements d’yeux dans cette attitude d’attention tendue chère aux éthiciennes du care. En proie à une « attention inqualifiable23 », elle « écoute », est « [elle-]même le ruban magnétique24 ». Cette attention inqualifiable s’actualise aussi dans la peur de manquer les dernières fois. Chez Calle : « Souci », le dernier mot prononcé par la mère, est écrit, à peine visible, en noir sur papier glacé noir, dans les deux pages qui ouvrent et ferment le livre comme une pierre tombale, tandis que l’écrivaine guette les dernières fois : « Ses dernières larmes ont coulé. Le 15 mars 2006, à 15 heures, dernier sourire. Dernier souffle, quelque part entre 15 h 02 et 15 h 13. Insaisissable25 », tandis que Cixous écrit : « Je ne te quitte pas du regard, mon adorée. […] J’ai ramassé chaque dernier instant, la dernière gorgée d’eau, le dernier mot et le dernier baiser26. » Ramasser chaque dernier instant pour le garder en mémoire certes, mais aussi (surtout peut-être) pour le déposer dans l’espace du livre.
14C’est ce dédoublement de l’attention de la narratrice propre à l’anticipation du deuil, dans un travail de présence totale de la fille à la mère et de réélaboration dans le texte sinon simultané du moins prévu et assumé qui permet, en redoublant l’expérience précisément, le processus de « réalisation » de la fille. Ainsi, l’exercice qui consiste à guetter jusqu’au bout (et on croirait lire Barthes dans La Chambre claire) « le processus de l’altération infinie, de la mutation, donc, en vérité, du travail virulent de la mort27 », puis à l’élaborer dans le texte agit comme une forme de pharmakon (à la fois poison et remède), ou de vaccin, qui inocule à la fille la vieillesse de sa mère, sa mort imminente, l’empoisonnant et l’immunisant en même temps, la mithridatisant, comme dit Cixous. « Une fois je lui demandai si l’époque couin-couin [référence à un bruit désagréable que la mère grabataire fait avec sa bouche] finirait un jour, mais elle n’en savait rien. Elle devait couin-couiner et à la longue, je finis par me mithridatiser28. »
Une voix différente
15En conclusion, c’est donc par un travail simultané de soin à la mère (soins du corps, attention tendue, accueil de sa vulnérabilité et de la matérialité organique du corps malade puis de la mort) et de construction littéraire, de mise en mots et en pages que la fille élabore son « livre-mère », son « livre-care » qui performe, transforme et prolonge la relation. Dans cet espace intermédiaire se façonne alors cette voix différente définie par Carol Gilligan dans son livre fondateur29 : une voix relationnelle, éthique, féminine et féministe dans le projet même de rendre visible la mère invisible et non entendue. Cette voix à la tessiture unique qui mêle celle de la fille et celle de la mère (« J’écris par toi, j’écris ce que tu m’écris, ma bien-aimée30 ») et singulière n’est ni celle de la mère ni celle de la fille, mais une troisième voix, celle de la fille-écrivaine advenue à l’écriture par la mort de sa mère. En tricotant cette voix double ou duelle dans laquelle la fille incorpore sa mère et est incorporée par elle, la narratrice-autrice s’approche au plus près de sa mère en fin de vie et, ainsi, de sa propre vieillesse saisie dans le miroir du corps de la mère exposé dans toute sa nudité. Il serait présomptueux d’affirmer que ce travail littéraire adoucit la vieillesse de la fille, cela lui permet en tout cas certainement de la vivre en toute lucidité.
1 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1970, p. 410.
2 Ibid., p. 400.
3 Ibid.
4 « Étranges sujets » : ma traduction. Amelia DeFalco, Uncanny Subjects: Aging in Contemporary Narrative, Columbus, Ohio State University Press, 2010.
5 Susan Sontag, « The Double Standard of Aging », The Saturday Review, 23 septembre 1972, p. 29-38.
6 Vinciane Despret, Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Paris, La Découverte, « La Découverte Poche », 2017, p. 14.
7 Ibid.
8 Hélène Cixous, Homère est morte, Paris, Galilée, 2014, p. 9.
9 Ibid., p. 224.
10 Sophie Calle, Elle s’est appelée successivement Rachel, Monique, Szyndler, Calle, Pagliero, Gonthier, Sindler. Ma mère aimait qu’on parle d’elle, Paris, XAVIERBARR, 2012 [Ouvrage non paginé].
11 Hélène Cixous, op. cit., p. 9.
12 Ibid., p. 211.
13 Ibid., p. 24.
14 Ibid., p. 26.
15 Simone de Beauvoir, Une mort très douce, Paris, Gallimard, « Folio », 1964, p. 25.
16 Ibid., p. 26.
17 Sophie Calle, op. cit.
18 Ibid.
19 Hélène Cixous, op. cit., p. 9.
20 Ibid., p. 12.
21 Ibid., p. 36.
22 Sophie Calle, op. cit.
23 Hélène Cixous, Benjamin à Montaigne : il ne faut pas le dire, Paris, Galilée, 2001, p. 73.
24 Ibid.
25 Hélène Cixous, Homère est morte, op. cit., p. 11.
26 Ibid., p. 15.
27 Ibid.
28 Ibid., p. 17.
29 Carol Gilligan, Une voix différente : pour une éthique du care, Paris, Flammarion, 2008.
30 Ibid., p. 15.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 31, 2024
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1759.
Quelques mots à propos de : Pascale Millot
Université de Montréal
Département des Littératures de langue française
Chaire McConnell-Université de Montréal en recherche-création sur les récits du don et de la vie en contexte de soins
Pascale Millot est candidate au doctorat en recherche-création au Département des Littératures de langue française, à l’Université de Montréal. Sa thèse porte sur l’accompagnement par la littérature dans le deuil et l’écriture. Elle a récemment publié « Comme une odeur de javel » dans le collectif de création Récits infectés (XYZ, 2022) et a codirigé l’ouvrage La Réinvention des corps, une incursion organique dans les domaines de la médecine et de la culture (PUL, 2024). Elle enseigne la littérature au Cégep Édouard-Montpetit, dans la banlieue de Montréal.
