Sommaire
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
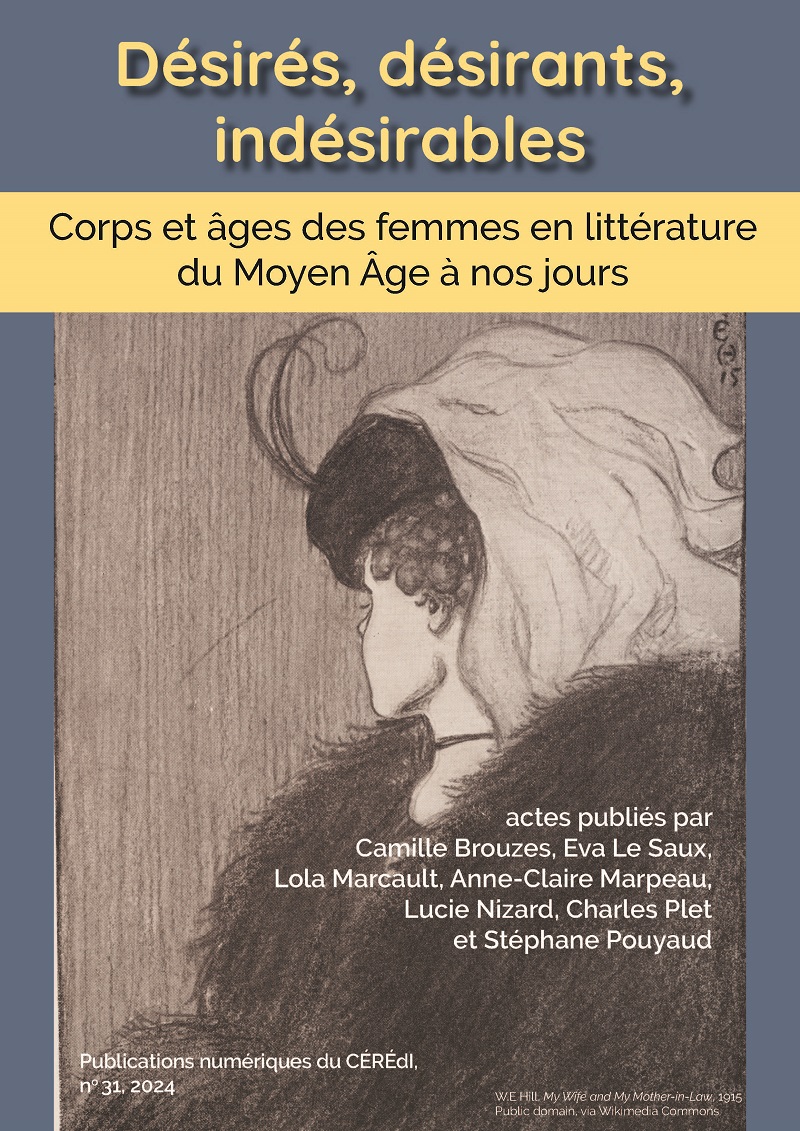
- Stéphane Pouyaud, Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard et Charles Plet Préambule
- Martine Boyer-Weinmann « Le coffre du corps, il faudrait l’ouvrir »
- Marielle Lavenus Sorcière, entremetteuse, maquerelle et concubine : représentations de la figure de la vieille servante dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Bruxelles, KBR, ms. 9631 et Paris, BnF, ms. fr. 24378)
- Clémence Aznavour Écrire à 84 ans : Madame de Rosemonde ou la parole restreinte
- Cassandre Martigny Dire l’indicible. Reconfigurations du scandaleux désir de Jocaste pour la jeunesse, dans Le Chevalier errant de Legrand (1726), Œdipe de Voltaire (1718) et Jocaste Reine de Nancy Huston (2009)
- Céline Duverne Devenir épouse et mère : corps de jeunes filles dans le roman balzacien
- Camille Stidler Les jeunes filles dans l’œuvre d’Émile Zola : des cas et des normes
- Véronique Samson La femme de trente ans : un personnage de la première moitié du xixe siècle
- Éléonore Reverzy Retour d’âge, retour de flamme. Lecture de La Conquête de Plassans
- Savannah Kocevar Du corps au corpus : un fil initiatique d’encre et de sang dans le cycle indochinois de Marguerite Duras
- Pascale Millot Entre identification et dégoût : l’accueil du corps vieux de la mère chez Beauvoir, Calle et Cixous
- Ariane Ferry De l’indésirable à la désirante ou comment sortir de la malédiction du « naître fille » (Fille de Camille Laurens, 2020)
- Nina Roussel « L’âge de détruire » : violence féminine et subversion des représentations de la jeune fille et de la femme vieillissante dans L’Amante anglaise de Marguerite Duras et Rouge dents de Pauline Peyrade
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
Du corps au corpus : un fil initiatique d’encre et de sang dans le cycle indochinois de Marguerite Duras
Savannah Kocevar
1Composés de cinq ouvrages retraçant l’enfance coloniale fantasmée (Un barrage contre le Pacifique [1950], L’Eden Cinéma [1977], L’Amant [1984], L’Amant de la Chine du Nord [1991]) et « Histoire de Léo » dans Cahiers de la guerre et autres textes [2008]) les récits du cycle indochinois de Marguerite Duras reprennent un fil narratif presque identique et constamment réécrit : une famille de colons blancs, ruinée depuis la mort du père et menée par une mère au bord de la folie, tente tant bien que mal de s’en sortir dans une Indochine coloniale marquée à la fois par la misère des populations locales et des colons les plus pauvres, et par la corruption de l’administration coloniale. Le seul espoir de la famille tient dans l’amour d’un riche Chinois pour la jeune fille : elle vivra avec lui, selon les textes, une initiation sensuelle, parfois sexuelle, rarement amoureuse. La découverte du corps et de la jouissance, contemporaines à la naissance de la vocation d’écrivaine dans les récits les plus tardifs, inscrivent une initiation également littératienne.
2À notre sens, l’architecture du cycle indochinois (caractérisée par l’idée de traversée) est organisée et structurée par des logiques culturelles de type initiatique. Dès lors, dans la lignée des travaux ethnocritiques de Marie Scarpa sur l’hypothèse d’une homologie fonctionnelle et structurelle entre logiques ritiques et logiques narratives1, nous posons pour postulat que le récit aurait à voir avec le rite. Dans cette perspective, la trajectoire narrative des personnages deviendrait une forme de mise en marge symbolique, un espace-temps nécessaire avant l’acquisition d’un nouveau statut au sein de la communauté. Dès lors, l’enjeu pour les personnages, souvent marginaux, car vivants dans les limites entre la société coloniale européenne et la société autochtone colonisée, va être de s’initier pour s’intégrer (ou se réintégrer) à la communauté, dans une perspective indissociable de la notion de rite de passage telle que la théorise le folkloriste Arnold Van Gennep2.
3En reconfigurant en termes de poétique littéraire certaines de ces notions et propositions anthropologiques, Marie Scarpa propose la notion de « personnage liminaire3 ». Si le rite permet de mesurer « le type de “socialisation” du personnage4 », alors son organisation formelle au sein du récit aussi peut servir à « penser la narrativité5 ». Le processus initiatique se matérialiserait par conséquent dans les épreuves (les rites de passage) que certains personnages traversent. Cependant, il apparaît que des personnages n’arrivent pas à quitter ce temps d’entre-deux et restent arrêtés sur les seuils (le limen). « Inachevés » du point de vue anthropologique de la socialisation des sexes et des âges, ils se caractérisent par leurs contradictions. Souvent forgés à partir d’oppositions, les personnages liminaires sont de véritables figures d’entre-deux6.
4Les textes de ce corpus prennent justement ancrage durant une période de changement cristallisée par un même scénario : une mère vieille et affaiblie se meurt, une fille veut quitter les chemins de l’enfance et accéder à l’indépendance. Problématique universelle, cette « crise de la relève » nourrit une multitude de cultures. Le langage symbolique des mythes insiste en effet sur le remplacement de la mère par la fille et souligne la dimension critique des rapports mère-fille dans la transmission des rôles et la construction des identités. Les questions de socialisation et d’apprentissage posées par ces récits trouvent par conséquent un écho dans les principes de transmission et de renouvellement qui veut que, selon Anne Monjaret, « à la naissance d’un enfant, l’un des grands-parents disparaisse7 ». De là l’idée d’un progrès, d’une avancée : lorsqu’il y a mort, il y a également naissance, alternance, rénovation. Dans cette perspective, une pensée symbolique associe le cycle du sang à un certain nombre de métaphores construites sur un vocabulaire agraire et sur l’organisation cyclique des saisons. Cycle calendaire et cycle générationnel s’entrecroisent ici : la fertilité des sols et la fécondité des femmes se rejoignent. L’hiver part, le printemps le remplace ; les vieilles meurent, les jeunes s’agrègent à la communauté.
5En réactualisant cette pensée mythique, les récits du cycle indochinois montrent combien la fabrique d’identités à la fois féminines (c’est-à-dire, les états dits « physiologiques » et le statut culturel donné au corps) et scripturales (soit, les apprentissages littératiens) entrent en corrélation avec le meurtre sacrificiel de la mère. Cette étude ethnocritique vise donc à interroger la représentation de deux âges fondamentaux dans le cycle indochinois de Marguerite Duras, celui de la jeune fille et celui de la femme ménopausée, en soulignant notamment la dimension critique des rapports mère-fille dans la transmission des rôles et la construction des identités.
Le corps inachevé de la jeune fille passante
6Dans l’ensemble du cycle indochinois, le corps adolescent et le statut de la jeune fille sont perçus comme étant en transition ; ils s’écrivent dans l’incomplétude et l’ambivalence de la liminarité. Dès l’ouverture d’Un barrage contre le Pacifique, Suzanne est définie par un manque : l’alliance à laquelle son statut de jeune fille la voue et qu’elle n’a pas encore conclue. En effet, le mariage apparaît comme un événement attendu par l’adolescente dans la mesure où il l’arrachera à la plaine stérile et mortifère dans laquelle elle vit. Par conséquent, c’est bien la perspective d’une possible union qui motive l’attente quotidienne des voitures sur le bord du pont (à la croisée des chemins). Suzanne se rêve en princesse de contes : « [u]n jour un homme s’arrêtera8 […] ». Et pour cause, dans les années 1930, période dans laquelle se déroulent les romans, c’est principalement par rapport au mariage à conclure que la fille nubile se définit. Le mariage, en tant que rite et en tant qu’institution, marque bien « la “fin” (au sens de finalité) de la jeune fille9 » ; il est à comprendre comme un aboutissement conclu par l’agrégation au statut d’épouse, puis de mère. Suzanne ne cesse dès lors de s’écrire par l’inachèvement : le corps est mal achevé, l’identité incomplète. Les différentes étapes initiatiques semblent avoir été ralenties. Elle se sent enfermée dans un monde étriqué où l’ouverture sur l’extérieur est presque inexistante. Par conséquent, si comme l’énonce Nathalie Heinich, la « jeune vierge pubère est par excellence une passante10 », Suzanne semble pour sa part bloquée sur le seuil de la plaine, endiguée dans l’ensauvagement mortifère de la plaine de Kam.
7La poétique de l’inachèvement propre au personnage de la jeune fille se poursuit dans la suite du cycle. Une nouvelle fois, les textes insistent sur la dimension symbolique de la jeune fille passante ; mais, cette dernière n’est plus bloquée sur les seuils spatiaux comme l’était Suzanne : dans l’Amant de la Chine du Nord, elle « marche11 », « traverse » (ACDN, p. 19), « oblique » (ACDN, p. 19). Le corps est dans l’ivresse du mouvement, il cherche désormais une place, un statut autre. Dans L’Amant, la jeune fille possède à l’ouverture du roman un corps décrit comme « maigre et vierge12 », « presque chétif » (A, p. 28), avec des « seins d’enfants » (A, p. 28), mais se farde « en rose pâle et en rouge » (A, p. 28). La tenue du bac mêle les ambivalences et inscrit déjà cette dualité liminaire qui se prolonge tout au long des récits : la jeune fille se réapproprie la vieille robe de la mère pour en faire un vêtement érotique, « sans manches, très décolleté », « presque transparen[t] » (A, p. 17) ; les chaussures du soir « ornées de petits motifs en strass » (A, p. 18) et le « chapeau d’homme » que porte le personnage (A, p. 18) deviennent également les marques d’une individualité qui marginalisent la jeune fille : « [a]ucune femme, aucune jeune fille ne porte de feutre d’homme dans cette colonie à cette époque-là. Aucune femme indigène non plus. » (A, p. 19) Un désordre règne, où « [l]’ambiguïté déterminante » (A, p. 18) réside dans l’entremêlement des différents statuts (enfant et femme ; masculin et féminin ; vierge et prostituée ; pauvreté et richesse). L’adolescente de L’Amant de la Chine du Nord est de surcroît continuellement qualifiée d’« enfant », appuyant davantage encore l’inachèvement des corps et des identités. Corps et identités sont en désordre, l’inachèvement persiste, comme un continuel passage en train de se faire : la voix narrative de L’Amant désigne la jeune fille comme « cette chose-là, pas tellement définie encore, regardez, encore une enfant. » (A, p. 109, nous soulignons).
8Or, la conquête de liberté du personnage adolescent intervient dans un contexte de dysfonctionnement familial, où la transmission semble en crise, où les autres corps qu’elle fréquente, au contraire de s’ouvrir, se referment jusqu’à disparaître. Dans cette perspective, le corps de l’enfant va trouver sa place en remplaçant un autre corps, celui de la mère. Si l’on admet que dans le cycle indochinois le récit fonctionne comme un rite, « l’achèvement » textuel prend dès lors forme par le biais du sacrifice maternel et l’accès à l’écriture. Les récits du corpus s’inscrivent à mon sens dans une logique rituelle de transmission intergénérationnelle. Par conséquent, le corpus traduirait dans sa langue et dans son système propres par quels mécanismes poétiques et symboliques la quête identito-littéraire de l’adolescente prend forme par la conquête du corps.
Un corps maternel au seuil de la vie et de la mort
9Par son étude ethnologique approfondie de plusieurs mythes, contes, rites et représentations religieuses, l’ethnologue Lucie Desideri a interrogé l’idée « partagée par les traditions les plus diverses13 », qui voudrait que « l’œil des femmes, en raison de leur physiologie, [serait] investi de redoutables pouvoirs ou puissances14 ». Elle remarque que la manière de nommer la jeune fille par la pupille (« “pupilla” en latin, “niña”, “menina” en espagnol et portugais ; “Koré” en grec15 ») renvoie à cette filiation linguistique entre l’œil et la jeune fille :
Dans toutes les langues dérivées et conservées cette antique et saisissante trouvaille langagière n’a cessé d’irriguer le discours des mythes, tournant autour de ce qui, littéralement, enchante l’œil. […] [Au printemps,] tout comme une jeune fille, la « nature » (terme désignant aussi le sexe de la femme) ouvre la paupière et « voit » (« voir » servant à désigner les règles féminines)16.
10L’ethnologue poursuit : « L’œil est donc le lieu de la manifestation du sang (et des pouvoirs qui lui sont associés17). »
11Or, la naissance de la vocation littéraire chez le personnage de la jeune fille s’inscrit bien dans la poétique du regard : ce dernier est qualifié au fil du corpus de « farouche » (ACDN, p. 30), « venimeux18 » (CG, p. 53), d’« intelligent » (CG, p. 53), d’« insatiable » (ACDN, p. 37) mais aussi, dans la force génésique du sang (on pensera aux scènes de défloration, au sang qui coule, dans l’ensemble des textes). L’initiation littératienne, indissociable de l’apprentissage de la corporalité, ne peut dès lors s’appréhender en dehors de la problématique, plus large, de la transmission. La révolte du corps jeune et sexué paraît indissociable du corps malade de la mère, corps qu’il tend par ailleurs à remplacer. Tout au long des récits, le portrait de la mère est construit comme une déchéance à la fois physique, morale, sociale et identitaire. Marquée par toutes ses contradictions, la direction de son corps est illisible. À l’opposé du corps inachevé de l’enfant qui se construit et grandit au fil de l’écriture, le corps de la mère rétrécit à mesure que son identité s’efface.
12La description physique de la mère présente dans L’Amant appuie la marginalité de ce personnage des seuils, liminaire :
Ma mère mon amour son incroyable dégaine avec ses bas de coton reprisés par Dô, sous les Tropiques elle croit encore qu’il faut mettre des bas pour être la dame directrice de l’école, ses robes lamentables, difformes, reprisées par Dô […] elle use tout jusqu’au bout, croit qu’il faut, qu’il faut mériter, ses souliers, ses souliers sont éculés, elle marche de travers, avec un mal de chien, ses cheveux sont tirés et serrés dans un chignon de Chinoise, elle nous fait honte, elle me fait honte dans la rue devant le lycée, quand elle arrive dans sa B. 12 devant le lycée tout le monde regarde, elle, elle s’aperçoit de rien, jamais, elle est à enfermer, à battre, à tuer. » (A, p. 31)
13Le texte joue sur les ambivalences du personnage vu comme excentrique et défini par ses démesures et ses lacunes. Caractérisée par son « incroyable dégaine » (le terme est d’emblée péjoratif), elle porte des bas de coton dans une région chaude et humide, ce qui la différencie de la population locale et marque sa situation de colon, de même, que la présence de la bonne, Dô. Pourtant ces bas sont reprisés (marque de pauvreté) tout comme la robe « lamentable », elle aussi « reprisée » et « difforme » (donc sans forme, sans sens). Ces signes distinctifs la séparent finalement des colons les plus riches et la marginalisent. De même, elle « croit qu’il faut mettre des bas pour être la dame directrice de l’école » : la mère a de fausses croyances, car elle enseigne aux enfants indigènes pauvres et non aux enfants de colons, ce qui la place dans une classe hiérarchique bien plus modeste. Elle ne tient donc pas sa place et tente de s’élever bien au-delà de sa condition sociale. Son comportement ne s’avère par conséquent jamais adéquat, comme une vie vécue de travers. Elle a par exemple des difficultés à définir sa place à l’intérieur même du système social : c’est une colon pauvre, ruinée, loin de tout rêve de réussite coloniale, à la marge à la fois des colons plus riches et de la population colonisée. Si elle met des bas en coton comme une Européenne, ils sont reprisés. Personnage ambivalent, elle trouble les frontières et s’érige comme une figure de désordre. Elle fait d’ailleurs honte à ses enfants devant le lycée (symbole de l’institution coloniale). La description de la mère rejoint une poétique carnavalesque à l’œuvre dans les récits ; figure grotesque, oscillant entre l’excès et l’ascèse, la mère regroupe les caractéristiques du monde à l’envers. Cet entre-deux constitutif de la mère se retrouve également dans la démarche claudicante de celle-ci : ses souliers étant éculés, elle marche littéralement « de travers ». Elle est déséquilibrée et sa mobilité en est donc entravée ; elle est d’ailleurs celle qui marche « avec un mal de chien », l’expression amenant une animalisation du personnage et un ensauvagement de ce dernier. La comparaison figure également un lien avec la mort, le chien étant un animal psychopompe. Ce n’est pas le seul lien avec la mort que l’on peut faire dans cet extrait : dans son article proposant une lecture ethnocritique d’« À une passante » de Charles Baudelaire, Sophie Ménard rappelle que le boiteux est un être du passage19. D’ailleurs, pour Carlos Grinzburg « [d]es malformations ou des déséquilibres de la marche caractérisent, ici aussi, des êtres en équilibre instable entre le monde des morts et celui des vivants20. » La boiterie a ainsi des accointances avec le tré-pas, et présage déjà la mort à venir de la mère. Veuve et boiteuse, elle est une caractérisée, physiquement ici, par l’entre-deux qui semble constitutif de son identité.
De mère en fille : voir et savoir
14Symboliquement aveugle, la mère du cycle indochinois est par ailleurs celle qui ne voit plus (à l’inverse de la jeune fille donc), soit, pour reprendre la « façon de dire » qu’Yvonne Verdier a longuement analysée dans son ethnographie21, elle est celle qui est ménopausée. Dès « L’histoire de Léo », la jeune narratrice ne manque pas de clairement rappeler que la destruction des barrages (qui fait le malheur de la famille) coïncide avec le « retour d’âge » de la mère. Cette précision était également présente dans les premières esquisses d’Un barrage contre le Pacifique. Ménopausée, la mère rejoint celles qui ne voient plus ; elle se trouve ainsi affilée aux croyances du malvoir, soit du « mauvais œil ». Or, les personnages d’Un barrage contre le Pacifique évoquent leur constante malchance… par le terme non anodin de « déveine » : « Ce n’était pas la peine. C’était la déveine, ce M. Jo, la déveine comme les barrages, le cheval qui crevait, ce n’était personne, seulement la déveine. » (BCP, p. 78) Littéralement, la veine manque (vena, dérivé du radical indo-européen commun veis (« couler ») se comprend au sens de « suc vital »). Nous sommes ici face à un phénomène de logogénèse22 où la langue « imagée » construit tout à la fois des réseaux sémantiques latents et des univers symboliques culturellement réglés. En d’autres termes, « la culture est dans la langue ». Par conséquent, les coups de sort que subit la famille sont symboliquement associés au malvoir de la mère, à ce sang qui ne coule plus, à cet ensauvagement synonyme d’une absence de renouveau dans lequel la figure maternelle enferme les adolescents. Progressivement privée de la seule identité qui lui a été laissée, celle de mère (notons que dans l’ensemble du cycle indochinois, elle n’est jamais qualifiée autrement que comme « la mère » soit une identité sociale, marquée par une fonction biologique), elle perd ses facultés cognitives à mesure que ses enfants s’éloignent d’elle pour vivre leur propre vie et notamment faire leurs propres choix.
15Le corps maternel martyr s’inscrit alors dans une imagerie presque christique ; il est contraint de s’effacer pour que grandisse et s’épanouisse celui de ses enfants. Ainsi, la mère écrit-elle au cadastre dans l’Eden Cinéma : « Je vous ai donné tout ce que j’avais ce matin-là, tout, comme si je vous apportais mon propre corps en sacrifice, comme si de mon corps sacrifié allait fleurir tout un avenir de bonheur pour mes enfants23. » (EC, p. 132) À plusieurs reprises, il apparaît au sein de l’imaginaire textuel d’Un barrage contre le Pacifique et de L’Eden Cinéma que ce n’est pas la maladie ou l’âge avancé de la mère qui sont à l’origine de sa mort, mais bien un assassinat symboliquement orchestré : à mesure que la jeune fille s’initie, qu’elle découvre les pouvoirs de son corps et la sexualité, la mère s’affaiblit et s’efface. Seulement huit jours après que Suzanne découvre la jouissance dans les bras de Jean Agosti, la mère a sa dernière crise, celle qui lui est fatale.
Ce fut pendant ces huit jours-là, entre la promenade au champ d’ananas et la mort de la mère que Suzanne désapprit enfin l’attente imbécile des autos des chasseurs, les rêves vides. La mère lui avait dit qu’elle pouvait se passer d’elle, qu’elle prendrait ses pilules toute seule, qu’il n’y avait qu’à les laisser sur une chaise près de son lit. Peut-être ne les prit-elle pas régulièrement. Peut-être que la négligence de Suzanne fut cause que sa mort survint un peu plus tôt qu’elle n’aurait dû. C’est possible. (BCP, p. 286)
16Ce constat est plus net encore dans L’Eden Cinéma où la mise en scène s’attache à montrer cette progressive transition entre corps mort et corps vivant. La stérilité de la mère et de la plaine, est combattue par le processus créatif qui s’échappe du corps de l’adolescent. À cette mise en mots du corps succède ainsi une émergence du corps au-delà des mots. La musique et la danse, très présentes dans la pièce, deviennent les symboles de la jeunesse, du corps jeune et sexué qui souhaite prendre sa liberté. Suzanne devenant femme, et Joseph ayant quitté le foyer maternel pour rejoindre une compagne, ce personnage sans nom, désigné uniquement par sa fonction maternelle, n’a plus d’existence biologique à mesure qu’elle ne peut plus exercer sa fonction sociale de mère.
17Ce manque à voir de la mère, ce vieillissement, est poétiquement et symboliquement présent dans le reste du cycle par le biais d’une poétique du regard : dans Un Barrage contre le Pacifique, lorsque Lina vient chercher Joseph, la mère garde les yeux fermés. La mention est faite à trois reprises : « Les yeux à demi fermés » (BCP, p. 241), « elle avait de nouveau fermé les yeux » (BCP, p. 243), « la mère les yeux fermés était toujours dans la même position » (BCP, p. 244). Après le départ de son fils, elle « ne voi[t] rien » (BCP, p. 244) et paraît « très vieillie et exténuée » (BCP, p. 276). La dégradation du corps maternel n’en est que plus importante dans L’Eden Cinéma : « La mère ne bouge pas […] La mère ne répond pas […] La mère ne parle plus. Elle ferme les yeux. » (EC, p. 144) Et cela, jusqu’à sa mort, jusqu’à devenir une statue immobile. Via les didascalies, lors des scènes jouées, la mise en scène appuie la représentation d’un corps malade et vieillissant, d’un corps mourant. Celui-ci tend à réduire jusqu’à un effacement mis en scène par les quelques indications scéniques : « Le caporal baisse un store vers le corps endormi de la mère. Ce corps cesse d’être visible, il devient une ombre noire dans la lumière blanche. Silence. » (EC, p. 133)
18L’Amant de la Chine du Nord trace pour sa part le portrait d’une mère marquée par son aveuglement. Aveuglement symbolique certes, mais qui ne cesse de s’inscrire dans le récit : « La mère ne le voit pas » (ACDN, p. 14), « […] aveugle. Isolée. Perdue. » (ACDN, p. 26), « C’est la mère qui baisse les yeux. Tuée, on dirait » (ACDN, p. 30). La mère perd également toute fonction orale et créatrice ; elle est privée de parole, son enfant lui « ferm[ant] sa bouche de sa main pour qu’elle ne parle plus » (ACDN, p. 26). L’ouverture de sa bouche est niée, fermée, de même que toute sexualité lui est refusée. Symboliquement stérile, elle n’est jamais femme, seulement mère et veuve. La mère, aliénée, devient la victime consentante de ses enfants ; le meurtre, s’il est imagé, se trouve néanmoins textualisé dans l’ensemble du récit : « Elle, elle pleure sans bruit, tout bas, elle n’a plus de force. [La mère] est déjà morte. » (ACDN, p. 197)
19Nous sommes dans la même logique de transmission intergénérationnelle des « pouvoirs féminins » déjà narrée par les contes. Prenons l’analyse proposée par Yvonne Verdier du « Petit Chaperon Rouge » :
La petite fille élimine déjà un peu sa mère le jour de sa puberté, encore un peu plus le jour où elle connaît l’acte sexuel, et définitivement plus si celui-ci est procréatif, en d’autres mots, au fur et à mesure que ses fonctions génésiques s’affirment. Mais c’est aussi une image vampirique qui nous est proposée quand le sang afflue chez la fille […] il doit quitter la mère qui va se trouver dépossédée de son pouvoir comme dans un jeu de vases communicants24.
20Dès les prémices de l’Amant de la Chine du Nord, la jeune fille le sait, elle « fera des livres » (ACDN, p. 25), comme d’autres « font » des enfants, et l’utilisation du verbe « faire » marque bien cette prédominance du corporel.
21Les récits textualisent donc comment le personnage de la jeune fille, qui dévore par son regard aussi bien les corps que les livres, entre en pleine possession de son pouvoir créateur féminin. L’initiation à la littératie n’est autre que le fruit du corps, le fruit d’un regard décrit comme étant constamment « d’une curiosité déplacée, toujours surprenante, insatiable » (ACDN, p. 37). Marquée par le besoin obsédant de voir, de dire, d’écrire, la jeune fille tend à remplacer la mère, mourante, représentante de l’anti-sexualité, de l’anti-jouissance et donc de l’anti-création. Au sein de la structure familiale mortifère marquée par la tare et la stérilité, le sacrifice du corps maternel opère ainsi un déplacement vers la ville, vers la vie, puis vers l’écriture.
1 Marie Scarpa, « Le personnage liminaire », Romantisme, no 145, 2009, p. 25-35.
2 Pour Arnold Van Gennep, la séquentialisation du rite de passage s’effectue en trois parties : la phase de séparation d’avec le groupe social (phase pré-liminaire, qui se caractérise par des rites de rupture d’avec un état antérieur), la phase de marge (phase liminaire par laquelle le sujet proprement liminaire change d’état et fait l’expérience de l’altérité ; durant cette phase l’individu se trouve entre deux statuts), et la phase d’agrégation (phase post-liminaire, elle souligne un passage réussi, où le changement de statut est confirmé par la communauté). Voir Les Rites de passage. Étude systématique des rites, de la porte et du seuil, de l’hospitalité, de l’adoption, de la grossesse et de l’accouchement, de la naissance, de l’enfance, de la puberté, de l’initiation, de l’ordination, du couronnement, des fiançailles et du mariage, des funérailles, des saisons, etc., Paris, Éditions A. et J. Picard, « Picard Histoire », 1981 [1909].
3 La réflexion sur la liminarité est initiée par la notion de rite de passage théorisée par Arnold Van Gennep et notamment par le concept de « phase de marge » (intrinsèque au processus initiatique). Les travaux un peu plus tardifs de l’ethnologue américain Victor Turner (Le Phénomène rituel : structure et contre-structure, Paris, Presses Universitaires de France, 1990) conceptualisent cette phase intermédiaire de marge. La « phase liminale », selon l’expression de Turner, est une phase de seuil, de marge où le sujet serait caractérisé par ses oppositions et ses contradictions. La reconfiguration en termes de poétique littéraire de certaines de ces notions et propositions anthropologiques permet à Marie Scarpa de proposer la notion ethnocritique de « personnage liminaire » (« Le personnage liminaire », art. cité).
4 Ibid., p. 27.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Anne Monjaret, « “De l’épingle à l’aiguille”. L’éducation des jeunes filles au fil des contes », L’Homme, no 173, 2005, p. 145.
8 Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, Paris, Gallimard, « Folio », 2011 [1950], p. 16. Désormais abrégé BCP, suivi du numéro de page.
9 Marcel Bernos, Yvonne Knibiehler, Élisabeth Ravoux-Rallo et Éliane Richard, De la pucelle à la minette les jeunes filles de l’âge classique à nos jours, Paris, Temps actuels, « La Passion de l’histoire », 1983, p. 15.
10 Nathalie Heinich, États de femme. L’identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, Gallimard, « NRF essais », 1996, p. 53.
11 Marguerite Duras, L’Amant de la Chine du Nord, Paris, Gallimard, « Folio », 1993 [1991], p. 18. Désormais abrégé ACDN, suivi du numéro de page.
12 Marguerite Duras, L’Amant, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 79. Désormais abrégé A suivi du numéro de page.
13 Lucie Desideri, « Jeu de l’œil », Ethnologie française, no 4, 1991, p. 421.
14 Ibid.
15 Ibid., p. 417.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, Paris, P.O.L., 2009. Désormais abrégé CG suivi du numéro de page. « L’histoire de Léo » ouvre Les Cahiers de la guerre, recueil non publié du vivant de l’autrice qui rassemble ses premiers textes, écrits entre 1943 et 1949. On y trouve en effet des récits où Marguerite Duras évoque les périodes les plus cruciales de sa vie, particulièrement sa jeunesse en Indochine, des ébauches de romans en cours, comme Un barrage contre le Pacifique.
19 Sophie Ménard, « Avec sa jambe de boiteuse. Lecture ethnocritique d’“À une passante” de Baudelaire », Ethnologie française, no 4, 2014, p. 646.
20 Carlo Ginzburg, Le Sabbat des sorcières, Paris, Gallimard, 2011, p. 231.
21 Yvonne Verdier, Façons de dire, façons de faire, Paris, Gallimard, 1979.
22 Jean-Marie Privat, « Parler d’abondance. Logogenèses de la littérature », Romantisme, no 145, 2009, p. 79.
23 Marguerite Duras, L’Eden Cinéma, Paris, Gallimard, « Folio », 1989. Désormais abrégé EC suivi du numéro de page.
24 Yvonne Verdier, « Grands-mères, si vous saviez… », Cahiers de littérature orale, no 4, 1977, p. 35.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 31, 2024
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1757.
Quelques mots à propos de : Savannah Kocevar
Université de Lorraine
CREM
Savannah Kocevar est titulaire d’un doctorat en langue et littérature française (Université de Lorraine / Université du Québec à Montréal). Sa thèse propose une lecture ethnocritique du cycle indochinois de Marguerite Duras. Actuellement ATER à l’Université de Lorraine, ses recherches portent principalement sur l’imaginaire culturel des textes, l’homologie rite-récit et l’écriture féminine.
