Sommaire
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
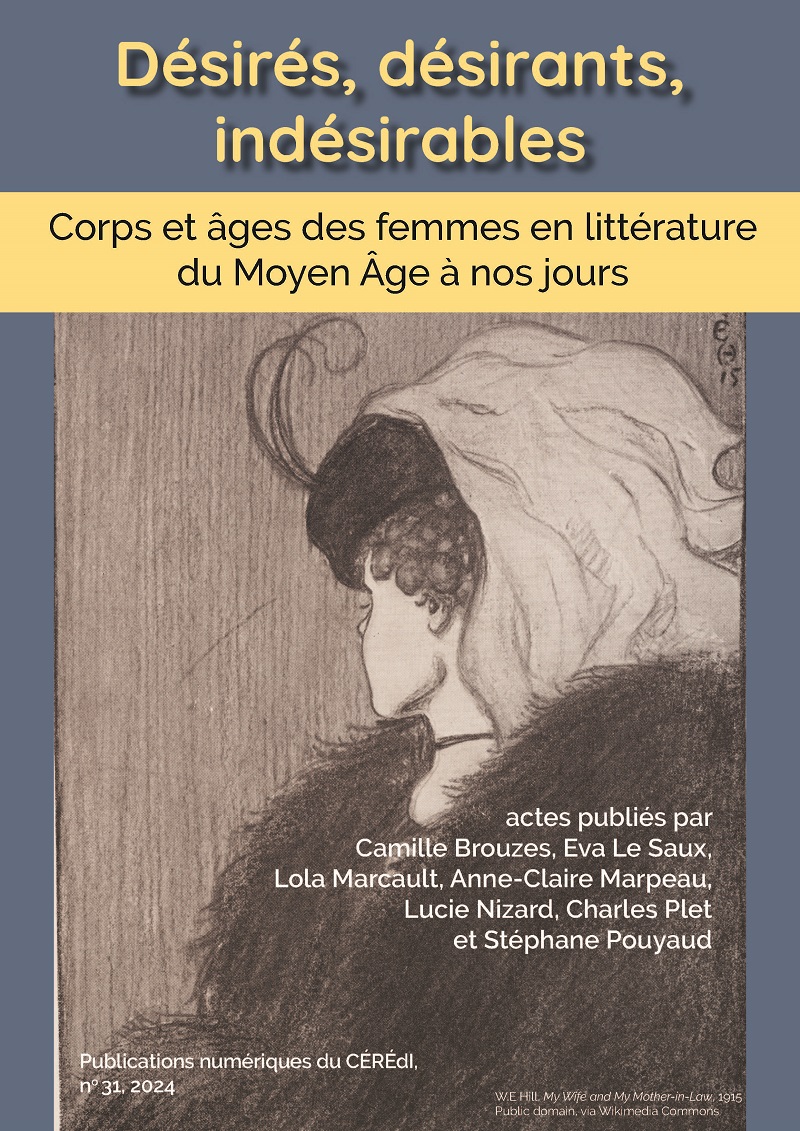
- Stéphane Pouyaud, Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard et Charles Plet Préambule
- Martine Boyer-Weinmann « Le coffre du corps, il faudrait l’ouvrir »
- Marielle Lavenus Sorcière, entremetteuse, maquerelle et concubine : représentations de la figure de la vieille servante dans l’Histoire de Gérard de Nevers (Bruxelles, KBR, ms. 9631 et Paris, BnF, ms. fr. 24378)
- Clémence Aznavour Écrire à 84 ans : Madame de Rosemonde ou la parole restreinte
- Cassandre Martigny Dire l’indicible. Reconfigurations du scandaleux désir de Jocaste pour la jeunesse, dans Le Chevalier errant de Legrand (1726), Œdipe de Voltaire (1718) et Jocaste Reine de Nancy Huston (2009)
- Céline Duverne Devenir épouse et mère : corps de jeunes filles dans le roman balzacien
- Camille Stidler Les jeunes filles dans l’œuvre d’Émile Zola : des cas et des normes
- Véronique Samson La femme de trente ans : un personnage de la première moitié du xixe siècle
- Éléonore Reverzy Retour d’âge, retour de flamme. Lecture de La Conquête de Plassans
- Savannah Kocevar Du corps au corpus : un fil initiatique d’encre et de sang dans le cycle indochinois de Marguerite Duras
- Pascale Millot Entre identification et dégoût : l’accueil du corps vieux de la mère chez Beauvoir, Calle et Cixous
- Ariane Ferry De l’indésirable à la désirante ou comment sortir de la malédiction du « naître fille » (Fille de Camille Laurens, 2020)
- Nina Roussel « L’âge de détruire » : violence féminine et subversion des représentations de la jeune fille et de la femme vieillissante dans L’Amante anglaise de Marguerite Duras et Rouge dents de Pauline Peyrade
Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours
Devenir épouse et mère : corps de jeunes filles dans le roman balzacien
Céline Duverne
1Sous l’impulsion du roman d’apprentissage, né en Allemagne à la fin du xviiie siècle, le temps de la jeunesse s’impose « pour la culture européenne moderne, comme l’âge qui renferme en soi le “sens de la vie1” », rappelle Franco Moretti. Or c’est, pour l’essentiel, l’itinéraire du jeune homme qui nourrit l’inspiration des romanciers. La raison semble évidente : à l’ère postrévolutionnaire, le personnage masculin projette plus librement ses ambitions dans l’arène sociale, quelle que soit sa classe d’origine ; tandis que l’horizon du personnage féminin semble, au contraire, se rétrécir dans la sphère domestique sous l’effet du code Napoléon. Dès lors, comme le souligne Boris Lyon-Caen, « comment imaginer le roman de formation d’un individu qui ne s’appartient pas2 ? »
2Par-delà cette évidence, La Comédie humaine construit en creux un discours sur le développement affectif, intellectuel, mais également physique de la fille nubile. Aussi laisserons-nous de côté les questions séminales de l’éducation et d’une possible émancipation3, pour envisager l’inscription de ces jeunes corps dans le roman balzacien. Questionner leur représentation suppose, au préalable, de se demander quelle est la place dévolue à ces êtres de l’entre-deux dans la taxinomie des « Espèces sociales » qu’esquisse l’historien des mœurs, sur le modèle des « Espèces zoologiques4 » de Buffon. L’indétermination de ces êtres hybrides laisse déjà percer le déterminisme du destin conjugal qui leur est imposé, dont le romancier a su faire un puissant vecteur d’intensification de l’intrigue. Ce parcours initiatique empêché de la jeune fille devient le catalyseur d’un romanesque intériorisé qui, c’est là sa nouveauté, dramatise narrativement le devenir-adulte.
3Chemin faisant, Balzac confère à ses héroïnes une force d’incarnation inédite, en traduisant la succession d’étapes qui transforment une adolescente candide en mater dolorosa. L’instrumentalisation sociale et économique est d’ailleurs souvent redoublée par la démarche essentialisante de l’auteur, expert autoproclamé dans l’analyse du beau sexe. À travers ces avatars d’une féminité sondée, disséquée sous le scalpel du taxinomiste, le texte balzacien apparaît travaillé par l’inconscient de son époque et n’échappe pas tout à fait à la réification qu’il dénonce. L’ambition de donner voix à ces sujets empêchés entre alors en conflit avec un imaginaire plus fantasmagorique de l’altérité. Les frictions sensibles dans ces portraits révèlent ainsi l’aporie que constitue, pour un écrivain homme, la tradition de fétichisation du corps féminin, et annoncent le changement de régime esthétique marquant la représentation du sexe faible dans le second xixe siècle.
Écrire le passage : des âges de la vie des femmes
4Dans son Avant-propos à La Comédie humaine, Balzac prend ses distances avec Walter Scott en prônant une représentation moins édulcorée des protagonistes féminins, guidant le lecteur jusqu’aux régions les plus sombres de la psyché humaine :
Dans le protestantisme, il n’y a plus rien de possible pour la femme après la faute ; tandis que dans l’Église catholique, l’espoir du pardon la rend sublime. Aussi n’existe-t-il qu’une seule femme pour l’écrivain protestant, tandis que l’écrivain catholique trouve une femme nouvelle, dans chaque nouvelle situation5.
5À la lumière de cette déclaration, on comprend que le modèle héroïque privilégié par Balzac n’est pas celui de la jeune première, objet traditionnel de la quête héroïque, mais les splendeurs et misères de l’épouse, mûrie précocement par les désillusions. Après La Femme de trente ans en 1830, la nouvelle Honorine réaffirme plus tardivement, en 1842, cette préférence pour « la femme en faute », éprouvée par la vie, aux dépens de « la jeune fille pure » encore vierge de toute souillure, dont roman ne saurait être écrit :
Quelque belle que fût mademoiselle de Courteville, je sentis, en la revoyant, que l’amour a trois faces, et que les femmes qui nous inspirent un amour complet sont bien rares. En comparant involontairement Amélie à Honorine, je trouvais plus de charme à la femme en faute qu’à la jeune fille pure. Pour Honorine, la fidélité n’était pas un devoir, mais la fatalité du cœur ; tandis qu’Amélie allait prononcer d’un air serein des promesses solennelles, sans en connaître la portée ni les obligations. […] Entre les plaines de la Champagne et les Alpes neigeuses, orageuses, mais sublimes, quel est le jeune homme qui peut choisir la crayeuse et paisible étendue6 ?
6Dans la métaphore finale, l’alternative érotique se double d’une confrontation esthétique. À rebours d’une conjugalité placide et sans éclat, les tempêtes de la vie intime participent d’un romantisme du sublime, où l’ambivalence ontologique de l’altérité féminine ouvre au créateur une fenêtre vers la transcendance.
7Dès lors, quelle place peut revenir à des corps encore exempts de tout stigmate ? Celle, précisément, d’être un livre ouvert sur un avenir tout tracé : la jeune fille en fleur intéresse le romancier en tant qu’elle éclaire la femme en devenir et ses souffrances. Sociologue avant l’heure7, Balzac ne désolidarise jamais l’individu de l’histoire collective dont il est le produit. Or la trajectoire du sexe faible, socialement annulé par le Code Napoléon, est marquée par une succession d’étapes fixes : « Il y a quatre âges dans la vie des femmes. Chaque âge crée une nouvelle femme », affirme le narrateur d’Une fille d’Ève (1839), non sans préciser que « [l]e cœur d’une femme de vingt-cinq ans n’est pas plus celui de la jeune fille de dix-huit, que celui de la femme de quarante n’est celui de la femme de trente ans8 ». Cette essentialisation réductrice d’un destin unique est compensée par la prise en compte, relativement nouvelle, du passage et des effets de seuil qui scandent chacune de ces phases. La condition de jeune fille est elle-même encadrée par deux moments-clés. Un premier palier, séparant l’enfant de l’adolescente, est signifié par l’abandon de toute spontanéité au profit d’une pudique réserve ; ainsi de Madeleine de Mortsauf dans Le Lys dans la vallée (1836) :
[…] à quinze ans, Madeleine était femme ; elle avait grandi, ses couleurs de rose du Bengale renaissaient sur ses joues bistrées ; elle avait perdu l’insouciance de l’enfant qui regarde tout en face, et commençait à baisser les yeux ; ses mouvements devenaient rares et graves comme ceux de sa mère ; sa taille était svelte, et les grâces de son corsage fleurissaient déjà ; déjà la coquetterie lissait ses magnifiques cheveux noirs9 […]
8La sortie d’une enfance asexuée impose à la jeune fille, désormais consciente de sa beauté, les sentiments d’humilité, de continence et de gravité qui, dans l’inconscient collectif, marquent le corps féminin du sceau de la honte. La plume balzacienne entérine ce passage en intégrant à la palette du portraitiste les métaphores florales topiques (« rose du Bengale », « fleurissaient ») héritées de la tradition courtoise de la descriptio puellae. D’une œuvre à l’autre, ces analogies relient d’une chaîne invisible toutes les esquisses de belles femmes et développent, dans La Comédie humaine, une herméneutique de la condition féminine10 : « Une jeune fille est comme une fleur qu’on a cueillie ; mais la femme coupable est une fleur sur laquelle on a marché11 », résume Honorine, plaçant dans les deux cas le protagoniste féminin (ici, la fleur) en position de complément, qui subit l’action dont le sujet est un pronom personnel à valeur générique.
9À l’image de la fleur se mêle naturellement celle du fruit promis à la maturation. Dans Mémoires de deux jeunes mariées (1841), la forme épistolaire du roman donne l’illusion d’exprimer sans médiation, à travers les lettres qu’elles échangent, les affects de deux jeunes filles fraîchement sorties du couvent pour y naître à leur rôle d’épouses. Face à son miroir, Louise de Chaulieu capte dans son reflet les prémices de la femme qu’elle voit naître. Son charme de « très joli fruit vert », comme elle se nomme, réside non dans l’apparence actuelle de ses lignes inabouties, mais dans les « espérances [qu’elle] donne » :
Quand on a, quinze jours durant, admiré l’exquise rondeur des bras de sa mère, […] on se trouve malheureuse en se voyant des bras maigres ; mais on s’est consolée en trouvant le poignet fin, une certaine suavité de linéaments dans ces creux qu’un jour une chair satinée viendra poteler, arrondir et modeler. Le dessin un peu sec du bras se retrouve dans les épaules. À la vérité, je n’ai pas d’épaules, mais de dures omoplates qui forment deux plans heurtés. Ma taille est également sans souplesse, les flancs sont raides12.
10L’écriture à la première personne génère une certaine confusion des points de vue : la réification de ce jeune corps est-il le seul fait du regard candide prêté à cette coquette en devenir, intériorisant pour son malheur les canons contemporains ; ou est-il celui de l’auteur lui-même, celui d’un homme conservateur de son temps ? Ce portrait téléologique résume l’opposition entre la ligne et la courbe qui structure la silhouette féminine dans l’imaginaire balzacien : roideur et sécheresse agissent comme des marqueurs d’exclusion d’une économie érotique – soit que l’extrême jeunesse du personnage le soustraie encore au désir masculin, soit que ses choix de vie le condamnent à la frustration13. Au même titre que le mariage seul confère aux femmes une certaine valeur sociale, la beauté des filles nubiles est conditionnée par la promesse d’une fertile rondeur, qui atteste leur adhésion à la logique productiviste de la fécondité, et partant, leur aptitude à embrasser un destin d’épouse et mère.
11De fait, si la nubilité résonne comme une éclosion à la beauté, on sera surtout sensible aux inflexions qu’imprime, dans la trame de ce roman épistolaire, un deuxième jalon constitué par « le terrible passage de l’état de jeune fille à l’état de femme », comme le désigne Louise à la veille de ses noces. L’inquiétude qui saisit la jeune rouée à l’approche de ce moment-charnière donne prétexte au romancier pour rappeler la soumission attendue d’une jeune mariée, dont la noce tient davantage de l’épreuve sacrificielle que de la fête : l’« air de victime » et la « fausse pudeur » nés de ses « craintes » ont « le mérite de [la] rendre la fiancée vulgaire des gravures » aux yeux du « monde », qui la juge « charmante et très convenable14 ». Aussi, à défaut de leur octroyer la liberté que la société leur refuse, Balzac imprime-t-il à leurs portraits sa conscience tragique d’un déterminisme : là où le jeune homme poursuit sa destinée, la jeune fille est prisonnière de sa condition.
« [L]ivrées par nos familles comme des marchandises15 » : une conscience tragique de la condition féminine
12La logique capitaliste qui préside à l’avenir de ces jeunes héroïnes est illustrée, dans Mémoires de deux jeunes mariées, par l’obligation imposée à Louise de sacrifier la fortune qui lui est normalement due à l’établissement de son frère aîné : reste l’alternative du couvent, ou d’un mariage sans dot. Dans les heures qui précèdent sa présentation officielle, la jeune fille, qui croit avoir fait preuve d’indépendance en refusant de prendre le voile, a la prescience que c’est, en réalité, son entrée dans le monde qui sonne le glas de sa liberté : « Je n’existe pas encore pour le monde, je lui suis inconnue. Quel délicieux moment ! Je m’appartiens encore, comme une fleur qui n’a pas été vue et qui vient d’éclore16. » Le retour de la métaphore florale, qui dévoile le regard de l’écrivain homme – pour ainsi dire, le male gaze17 – derrière la plume fictive d’une jeune fille, associe la féminité non plus à la grâce mais à la fragilité d’un bonheur périssable : les « adieux à nos pâles marguerites innocemment cueillies, effeuillées insouciamment » font de l’avènement au monde un renoncement à soi.
13Si cette vérité transite fréquemment par le portrait, l’un des ressorts de dramatisation du récit réside dans la valeur proleptique conférée à des micro-événements affectant ces jeunes corps. Dans La Femme de trente ans (1830), la répétition d’un geste en apparence anodin mime le passage de relais symbolique de l’autorité du père à celle du mari. Le portrait inaugural de l’héroïne éponyme, Julie d’Aiglemont, est fortement marqué par l’hybridité : le lexique de l’enfance est encore sensible dans la « beauté mignonne » de cette jeune fille choyée, dont le « visage mutin » et le regard brillant d’une « douce malice », baigné d’un « fluide pur », attestent la candeur d’une jeunesse édénique. Mais bientôt, la destinée féminine vient s’inscrire dans les embardées imposées au corps de Julie, soulevé, transporté et déposé comme un bien meuble. C’est d’abord son père qui l’extrait du cocon douillet du cabriolet familial pour la mener près de l’homme qu’elle croit aimer :
La petite personne se laissa complaisamment saisir par la taille quand elle fut debout sur le bord de la voiture, et passa ses bras autour du cou de son guide, qui la posa sur le trottoir, sans avoir chiffonné la garniture de sa robe en reps vert. Un amant n’aurait pas eu tant de soin18.
14La phrase finale résonne comme un avertissement liant cet épisode à son jumeau symbolique. En effet, quelques pages plus loin, la prévenance paternelle est éclipsée par le « brusque enlèvement » du futur époux : « – Prenez donc garde, s’écria l’officier qui saisit Julie par la taille et la souleva avec autant de vigueur que de rapidité pour la transporter près d’une colonne19. » À travers le lexique percent les indices d’une virilité dominatrice : ce geste protecteur mais brutal, exercé sans le consentement de l’intéressée, anticipe déjà celui du viol conjugal décrit à mots couverts au début de la partie suivante. C’est alors à la dissolution de cette félicité originelle que procède le deuxième portrait :
Un bonnet de martre lui servait de coiffure, et les plis du manteau fourré dans lequel elle était enveloppée déguisaient si bien ses formes qu’on ne pouvait plus voir que sa figure. Julie d’Aiglemont ne ressemblait déjà plus à la jeune fille qui courait naguère avec joie et bonheur à la revue des Tuileries. Son visage, toujours délicat, était privé des couleurs roses qui jadis lui donnaient un si riche éclat. […] Cependant ses yeux brillaient d’un feu surnaturel ; mais au-dessous de leurs paupières, quelques teintes violettes se dessinaient sur les joues fatiguées20.
15Tout autant que la valeur symbolique conférée à des gestes anodins, l’effet contrastif de ce nouveau portrait de l’héroïne, après une ellipse temporelle d’un an, participe d’une dramatisation de la condition féminine dont Julie devient l’emblème – comme le veut la valeur générique du titre La Femme de trente ans. La vision édénique d’une silhouette s’ébaudissant, encore libre de toute entrave, laisse ainsi place, quelques lignes plus loin, à celle d’un corps précocement enseveli sous le lourd linceul de l’épouse, engourdi par la maladie intime qui ravage Julie depuis son initiation douloureuse à la sexualité. L’image de la défloration s’impose même subrepticement dans l’apparition de la couleur violette, marquant toujours la flétrissure, en lieu et place du rose des jeunes filles en fleurs. La critique a parfois souligné la dimension artificielle de cette trajectoire de femme, fruit de l’assemblage de plusieurs nouvelles initialement publiées dans la presse21. La construction morcelée de l’héroïne éponyme, saisie de sa jeunesse flamboyante au crépuscule de sa vie, accuse néanmoins de manière tangible les étapes par lesquelles l’épouse naît puis meurt à elle-même, dans une expérience d’altération progressive. Dans la suite du roman, une absence de plusieurs mois de Victor opère comme une embardée qu’atteste le retour du type de la jeune fille, délivrée du poids du devoir conjugal et rendue à sa candeur virginale : « Un jour, enfin, Julie fit briller aux yeux de sa tante étonnée un oubli complet du mariage, une folie de jeune fille étourdie, une candeur d’esprit, un enfantillage digne du premier âge22. »
16La sexualité comme marchandisation de la jeune fille s’offre ainsi pudiquement comme l’angle mort de ce roman de l’adultère23. Dans la première citation susmentionnée, la superposition inattendue des figures du père et de l’amant témoignait déjà d’une sexualisation précoce jusque dans l’intimité familiale. Malgré l’isotopie de l’enfance revenant avec insistance dans le premier portrait de Julie, l’orgueil de son père est flatté de ce que « l’on [la] croit [s]a femme » : « Quoiqu’il fût arrivé depuis longtemps à l’âge où les hommes doivent se contenter des trompeuses jouissances que donne la vanité, il se mit à sourire. » Si le lien de paternité s’efface devant la mise en scène d’une universelle fatuité masculine, c’est que les promesses érotiques de la jeune fille s’offrent comme le prolongement de la puissance paternelle :
Il semblait avoir de la coquetterie pour sa fille, et jouissait peut-être plus qu’elle des œillades que les curieux lançaient sur ses petits pieds chaussés de brodequins en prunelle puce, sur une taille délicieuse dessinée par une robe à guimpe, et sur le cou frais qu’une collerette brodée ne cachait pas entièrement24.
17Ce comportement mêlant la relation incestuelle25 à l’instrumentalisation de la beauté nubile se retrouve, dans Mémoires de deux jeunes mariées, lors de la première visite que fait Louise à son père, après son refus de prendre le voile qui dérange les projets familiaux :
« Vous voilà donc, fille rebelle ! » m’a-t-il dit en me prenant les deux mains dans les siennes et me les baisant avec plus de galanterie que de paternité. Et il m’a attirée sur lui, m’a prise par la taille, m’a serrée pour m’embrasser sur les joues et au front. « Vous réparerez le chagrin que nous cause votre changement de vocation par les plaisirs que nous donneront vos succès dans le monde. [S’adressant à sa femme] Savez-vous, madame, qu’elle sera fort jolie et que vous pourrez être fière d’elle un jour26 ? »
18La rhétorique de la séduction entre en conflit avec le sentiment paternel, suggérant que c’est bien la jolie femme, et non sa fille, qu’embrasse le duc. Fin politique jusque dans la sphère privée, il indexe la valeur de Louise sur la vanité qu’il pourra tirer de sa beauté, compensation du préjudice économique que fait peser sur sa famille son sexe féminin, l’héritier mâle étant seul dépositaire du nom et du titre.
19Cette valeur marchande conférée à la beauté des jeunes filles n’est pas l’apanage des classes aisées, où elle devient une vitrine mondaine. Outre les actrices et lorettes, signalons l’ouvrière Madame Crochard, qui place sa fille brodeuse tout près de la fenêtre, dans l’espoir qu’un « homme veuf ou un Adonis de quarante ans » veuille « posséder à bon marché son « cou frais et [s]a peau blanche » : à chaque passant, « elle semblait leur marchander sa fille, tant ses yeux babillards essayaient d’établir entre eux de sympathiques affections, par un manège digne des coulisses27 ». À travers cette manœuvre, la réduction du corps d’une jeune fille à sa valeur sensuelle devient un piège auquel un homme faible se laisse prendre – et c’est à quoi Louise de Chaulieu, consciente de sa valeur, saura s’employer pour se faire épouser sans dot, à l’instar de Caroline Crochard trompant l’homme qui l’a pourtant soustraite à la misère. Du corps-marchandise au corps conquérant, Balzac, malgré son empathie sincère, ne se déprend jamais tout à fait d’un regard réifiant sur l’autre sexe, attaché à déjouer les pièges tendus par les filles d’Ève en déployant ses talents d’herméneute.
Balzac, herméneute ambivalent des corps en rébellion
20Si la représentation du beau sexe chez Balzac se heurte aux contradictions entre son conservatisme politique et son relatif progressisme en matière d’éducation, la réflexion de l’historien des mœurs ne fait pas l’économie des mythes pluriséculaires qui, dans l’imaginaire collectif, sédimentent la représentation de l’altérité féminine. Dès lors, son ambivalence idéologique est nourrie par l’évolution de ces fantasmagories, de l’idéalisation romantique d’un Éternel féminin en réponse à la crise de la transcendance, vers le désaveu radical de cette harmonie rêvée dans le second xixe siècle28. Ainsi La Comédie humaine laisse-t-elle entrevoir de précoces avatars de Cette femme qu’ils disent fatale, pour citer l’étude-phare de Mireille Dottin-Orsini29.
21Le romancier confère à cette menace une signification politique. La rébellion du sexe faible, revers de l’emprise exercée sur lui, cristallise le sentiment d’une impuissance masculine analysée par le duc de Chaulieu : « En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n’y a plus de famille aujourd’hui, il n’y a plus que des individus30. » Qui mieux que sa propre fille, dame courtoise castratrice, et son amie Renée de l’Estorade, prônant la soumission pour mieux asseoir son ascendant conjugal, en apportent la preuve ? Dans le roman Le Contrat de mariage (1835), la future comtesse de Manerville reçoit de sa mère, à la veille de ses noces, une leçon de vie qui prend à rebours la prophétie du duc :
[…] eh ! bien, la cause principale des désunions conjugales se trouve dans une cohésion constante qui n’existait pas autrefois, et qui s’est introduite dans ce pays-ci avec la manie de la famille. Depuis la révolution qui s’est faite en France, les mœurs bourgeoises ont envahi les maisons aristocratiques. […] Et, depuis, les femmes comme il faut ont nourri leurs enfants, ont élevé leurs filles et sont restées à la maison. […] sache-le bien, ma Natalie, nous avons toutes une destinée en tant que femmes comme les hommes ont leur vocation. Ainsi, une femme est née pour être une femme à la mode, une charmante maîtresse de maison, comme un homme est né général ou poète. […] Tu n’es faite ni pour être mère de famille, ni pour devenir un intendant. […] Toi, sois la grande dame qui représente le luxe et le plaisir de la maison ; mais sois une supériorité visible seulement dans les choses qui flattent l’amour-propre des hommes, et cache la supériorité que tu pourras acquérir dans les grandes31.
22Foncièrement anti-balzacienne, cette morale individualiste tenant lieu d’éducation conjugale s’appuie sur un désaveu de la famille comme idéal bourgeois. La revendication d’une destinée, en lieu et place d’une condition féminine, repose sur une inversion des rapports de force : la jeune fille devenue femme pourra se libérer de l’asservissement de son corps-objet désirable, en devenant le sujet du processus de séduction pour faire de ce corps un instrument d’émancipation, dirigé contre l’homme mué en proie. Chemin faisant, elle échappera au rétrécissement induit par la maternité et plus encore, s’octroiera un rôle social véritable ; la dernière phrase suggère que le charme exercé sur l’amour-propre des hommes est destiné à endormir leur méfiance, pour ouvrir aux maîtresses de salon d’autres terrains d’expansion.
23Il importe donc, pour Balzac, de contrer ce prétendu péril féminin, en signifiant son expertise de romancier surplombant face au mari dupé – ici Paul de Manerville, un dandy faible et sans étoffe. Dès le premier portrait, le narrateur se targue de sa maîtrise des lois de la physiognomonie pour déceler les « indices » qui annoncent chez la jeune fille le futur tyran femelle. Fidèle à la logique inductive qui veut que chaque cas singulier soit l’illustration d’un paradigme générique, Natalie possède, « comme toutes les jeunes personnes », une « figure impénétrable » puisque « rien encore ne l’a émue ». L’isotopie du déchiffrement confère à cette esquisse son intensité maximale en l’abordant comme creuset d’une révélation, dans cet âge de l’entre-deux où tout est déjà prévisible alors même que rien n’est encore joué. L’effet de suspense est sacrifié à une leçon de lecture en acte : en s’attelant méthodiquement à décrire la coupe régulière de son visage, les aspérités de sa silhouette et jusqu’au son métallique de sa voix, l’entomologiste Balzac s’attache à lever le « voile dans lequel la femme était enveloppée, comme le papillon l’est dans sa larve » :
Néanmoins un homme habile à manier le scalpel de l’analyse eût surpris chez Natalie quelque révélation des difficultés que son caractère devait offrir quand elle serait aux prises avec la vie conjugale ou sociale. […] En ce moment la grâce et la fraîcheur de la jeunesse, la distinction de ses manières, sa sainte ignorance, la gentillesse de la jeune fille coloraient ses traits d’un vernis délicat qui trompait nécessairement les gens superficiels32.
24En déconstruisant le topos d’une virginité morale de la jeunesse, dans cette analyse implacable d’une altérité féminine foncièrement fallacieuse, le romancier exalte sa supériorité d’auteur et d’homme. La pseudo-scientificité se mêle à l’irrationnel du mythe : le calme empreint sur le visage de cette séductrice l’assimile aux « divinités qui ne savent rien des agitations terrestres », à l’instar de ses « mains de statue grecque » ; même l’écran en plumes indiennes reçu de son fiancé résonne comme un sinistre présage, qui rappelle « les Parques de la Mythologie33 ». Ces rares émanations oniriques ne suffisent pas à tempérer la désacralisation qu’opère cette analyse aride, où le prétendu mystère féminin se trouve réduit à un ensemble de rouages.
25Sept ans après Le Contrat de mariage, l’auteur d’Albert Savarus se livre à une nouvelle entreprise heuristique dans le portrait de la terrible Rosalie de Watteville qui, par jalousie, réduit à néant les ambitions du héros éponyme. C’est d’abord dans la Renaissance allemande et italienne que Balzac puise le modèle de cette « jeune fille frêle, mince, plate, blonde, blanche, et de la dernière insignifiance », mais dont le « visage ressemblait parfaitement à ceux des saintes d’Albert [Albrecht] Dürer et des peintres antérieurs au Pérugin ». Le narrateur légitime l’incongruité de cette transfiguration d’une provinciale insipide en figure iconique en invoquant, derechef, l’expertise de l’observateur qui excède la pauvreté du regard ordinaire pour saisir la quintessence d’un être : « Tout en elle, jusqu’à sa pose rappelait ces vierges dont la beauté ne reparaît dans son lustre mystique qu’aux yeux d’un connaisseur attentif34. » Soucieux d’arrimer sa fantasmagorie picturale à des ressorts scientifiques, le narrateur n’hésite pas à faire mentir les lois de la physiognomonie, anticipant de quelques décennies le prisme généalogiste de Zola. Car si le corps de Rosalie, mêlant aux traits de la noblesse ceux de la banalité plébéienne35, masque son machiavélisme sous une frêle enveloppe trompeuse, une attention à son hérédité peut démentir l’apparente placidité de sa physionomie lisse :
Cette éducation et l’attitude modeste de Rosalie cachaient un caractère de fer. Les physiologistes et les profonds observateurs de la nature humaine vous diront, à votre grand étonnement peut-être, que, dans les familles, les humeurs, les caractères, l’esprit, le génie reparaissent à de grands intervalles absolument comme ce qu’on appelle les maladies héréditaires. Ainsi le talent, de même que la goutte, saute quelquefois de deux générations. […] Le caractère décisif, la romanesque audace du fameux Watteville étaient revenus dans l’âme de sa petite-nièce, encore aggravés par la ténacité, par la fierté du sang des de Rupt. Mais ces qualités ou ces défauts, si vous voulez, étaient aussi profondément cachés dans cette âme de jeune fille, en apparence molle et débile, que les laves bouillantes le sont sous une colline avant qu’elle ne devienne un volcan.
26Encadré en amont par l’horizon des Beaux-Arts et, en aval, par les métaphores naturelles qui closent cet extrait, les observations généalogiques apportent un démenti physiologique à l’innocuité dans laquelle sa condition de jeune fille brimée cantonne Rosalie, soumise au rigorisme d’une éducation prude. Plus encore, la dissimulation semble résulter directement de la continence imposée à ce corps nubile, qui « n’avait jamais porté de bas de soie, ni de brodequins » et, à dix-sept ans, « n’avait lu que les Lettres Édifiantes, et des ouvrages sur la science héraldique36 ». Une digression sur les « problèmes si graves » posés par l’éducation des jeunes filles établit une alternative ainsi résumée : « il va sans dire que le système religieux est compresseur : si vous les éclairez, vous en faites des démons avant l’âge ; si vous les empêchez de penser, vous arrivez à la subite explosion si bien peinte dans le personnage d’Agnès par Molière37 », dont Rosalie offre un nouvel avatar.
27Les deux branches de cette alternative aporétique trouvent une illustration dans le diptyque offert par Albert Savarus et Le Contrat de mariage, auquel il faut à présent revenir. Les deux romans présentent bien des similitudes. Modelées sur un patron comparable, les premières pages dramatisent le portrait d’une « forte tête de frêle jeune fille38 » pour signifier l’habileté du romancier-démiurge à résoudre l’énigme du sphinx, à déjouer les pièges de deux visages mutiques. La proximité onomastique39 conforte encore cette convergence : malgré leurs éducations résolument opposées, Natalie de Manerville choyée par une croqueuse de fortune et Rosalie de Watteville comprimée par une dévote se trouvent tout à fait libres après s’être jouées de l’homme qu’elles avaient choisi – l’une délivrée d’un mari parti reconquérir sa fortune, l’autre vivant émancipée après avoir brisé les espoirs de celui qui ne pouvait l’aimer. Désirable ou insignifiant, le corps de ces filles d’Ève, toujours trompeusement placide, est modelé par la société bourgeoise pour le mensonge, duquel l’excès de rigueur ne préserve pas davantage que l’excès de liberté.
28Penseur rétrograde et bonaldien, mais aussi romancier empathique du sexe faible, Balzac nous étonne par sa saisie paradoxale d’une destinée féminine socialement rétrécie, qui fait de la jeune fille le sujet empêché d’un impossible roman de formation. À notre regard contemporain, la force de frappe de ces portraits va bien au-delà de l’intrigue qui les cadenasse. Ils signifient combien, au-delà des batailles concrètes pour les droits civiques et sociaux, la lutte des sexes se cristallise autour de la représentation, de l’esthétisation d’une altérité féminine figée par le regard démiurgique de l’artiste homme. Analyste minutieux des réalités quotidiennes vécues par les femmes, Balzac n’échappe pas au piège de la fétichisation en enfermant ses jeunes héroïnes dans l’alternative entre le corps-martyre et le corps révolté, d’une hypostase à une autre de l’Éternel féminin. À travers ces tensions se joue, enfin, le destin de ce genre bâtard qu’est le roman, dont le lectorat essentiellement féminin doit se masculiniser pour œuvrer à sa respectabilité. Cela explique le reflux d’un certain imaginaire érotique idéalisant le beau sexe, au profit d’une vision moins édulcorée des relations sexuées, appréhendées comme un objet d’étude. Endosser la charge de l’historien des mœurs, c’est pour Balzac assigner à la prose l’ambition de comprendre les femmes et, plus encore, de disséquer « la » femme pour s’octroyer sur ce corps un pouvoir de contrôle et conjurer l’impuissance masculine. Cela suppose, en somme, de délaisser ce que Stendhal qualifie de « romanesque pour femme de chambre40 » pour faire du novel, tel que le définira Lukacs, « la forme de la maturité virile41 ».
1 Franco Moretti, Le Roman de formation [1986], Paris, CNRS éditions, 2019, p. 20.
2 Boris Lyon-Caen, « Balzac et le “sujet” des jeunes filles », Revue italienne d’études françaises [En ligne], no 13 : « Le Roman de formation au féminin », dir. Francesco Fiorentino, 2023, URL : http://journals.openedition.org/rief/10915, page consultée le 4 juin 2024.
3 Sur ce thème, voir par exemple Richard Bolster, Stendhal, Balzac et le féminisme romantique, Paris, Lettres modernes Minard, 1970 et Catherine Nesci, La Femme, mode d’emploi. Balzac, de la Physiologie du mariage à La Comédie humaine, French Forum, Publishers, Lexington, Kentucky, 1992.
4 Tels sont les termes employés par l’écrivain dans son Avant-propos à La Comédie humaine (1842), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, t. I, p. 8. Toutes les références à l’œuvre de Balzac sont empruntées à cette édition en douze volumes de Pierre-Georges Castex, 1976-1981. Dorénavant, nous indiquerons directement le nom de l’œuvre et le tome.
5 Avant-propos de La Comédie humaine, t. I, p. 16.
6 Honorine, t. II, p. 584.
7 Sur ce thème, voir Andrea Del Lungo et Pierre Glaude (dir.), Balzac, l’invention de la sociologie, Paris, Classiques Garnier, 2019.
8 Une fille d’Ève, t. II, p. 293.
9 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1154.
10 Voir notamment Nicole Mozet, « Réception et génétique littéraire : quand une lecture devient censure » dans H. de Balzac, Œuvres et critiques, textes réunis par Richard Beilharz, XI, 3, Tübingen / Paris, G. Narr / J.-M. Place, 1986, p. 241-251 et Pierre Laforgue, « Honorine ou le sexe des fleurs », dans L’Érotique balzacienne, dir. L. Frappier-Mazur et J.-M. Roulin, Paris, SEDES, 2001, p. 35-40.
11 Honorine, t. II, p. 582.
12 Ibid., p. 211.
13 À titre d’exemple parmi bien d’autres, Le Cousin Pons exacerbe l’opposition entre l’ex-« belle écaillère » madame Cibot, « modèle de Rubens » aux courbes opulentes, et Madeleine Vivet, « vieille fille sèche et mince » ou encore la présidente de Marville, « devenue sèche » sous l’effet de l’ambition (Le Cousin Pons, t. VII, p. 521, 506 et 509).
14 Mémoires de deux jeunes mariées, t. I, p. 303.
15 Ce constat amer est formulé par l’héroïne éponyme de Modeste Mignon, t. I, p. 604.
16 Mémoires de deux jeunes mariées, t. I, p. 213.
17 Sur ce concept des études cinématographiques récemment adapté à l’analyse littéraire, nous renvoyons aux travaux de Laura Mulvey, Au-delà du Plaisir visuel. Féminisme, énigmes, cinéphilie, traduit de l’anglais par Florent Lahache et Marlène Monteiro, Paris, Éditions Mimésis, 2017 [1975], et d’Anne-Claire Marpeau, « Le regard masculin, ou male gaze : le roman réaliste français du xixe siècle à l’épreuve d’un outil d’analyse féministe », Romantisme, 2023/3 (no 201), p. 139-154.
18 La Femme de trente ans, t. II, p. 1039 et 1040.
19 Ibid., p. 1043.
20 Ibid., p. 1054.
21 Voir notamment Stéphane Vachon, « La même histoire d’une femme de trente ans : “J’ai corrigé l’édition qui sert de manuscrit” », dans Balzac, La Femme de trente ans. « Une vivante énigme », dir. José-Luis Diaz, Paris, SEDES, 1993, p. 5-16 et Takayuki Kamada, Balzac. Multiples genèses, Presses universitaires de Vincennes, « Manuscrits modernes », 2021, « Chapitre 10 : Modes de publication et poétiques du chapitre », p. 165-185.
22 Le retour, à deux reprises, du motif de la jeune fille ressuscitée par la quiétude conforte notre intuition : « Semblable à une jeune fille vertueuse qui accable un amant de dédains, mais qui, le soir, se trouve si triste, si abandonnée, qu’elle le désire, et veut un cœur où déposer ses souffrances, Julie laissa violer sans mot dire le cachet que la délicatesse imprime à une lettre ouverte, et resta pensive pendant que la marquise lisait. » ; « Maintenant que Victor vous a laissée seule, n’êtes-vous pas redevenue jeune fille, tranquille ; sans plaisirs, mais sans souffrances ? » (Ibid., p. 1063 et 1066.)
23 Si les diatribes formulées par Julie ne portent pas spécifiquement sur la sexualité, la « prostitution légale » qu’elle dénonce fait signe vers les rapports intimes : « Le mariage, institution sur laquelle s’appuie aujourd’hui la société, nous en fait sentir à nous seules tout le poids : pour l’homme la liberté, pour la femme des devoirs. Nous vous devons toute notre vie, vous ne nous devez de la vôtre que de rares instants. Enfin l’homme fait un choix là où nous nous soumettons aveuglément. Oh ! monsieur, à vous je puis tout dire. Hé bien, le mariage, tel qu’il se pratique aujourd’hui, me semble être une prostitution légale. De là sont nées mes souffrances. » (Ibid., p. 1114.)
24 Ibid., p. 1040.
25 Sur cette notion psychanalytique, distincte de l’inceste consommé, nous renvoyons à l’article de Paul-Claude Racamier, « L’Incestuel », Empan, 2006/2, no 62, p. 39-46.
26 Mémoires de deux jeunes mariées, t. I, p. 205.
27 Une double famille, t. II, p. 21.
28 Sur ce thème, voir Éléonore Reverzy, La Mort d’Éros. La mésalliance dans le roman du second xixe siècle, Paris, SEDES, 1997.
29 Mireille Dottin-Orsini, Cette femme qu’ils disent fatale. Textes et images de la misogynie fin-de-siècle, Paris, Grasset, 1993.
30 Mémoires de deux jeunes mariées, t. I, p. 242.
31 Le Contrat de mariage, t. III, p. 609.
32 Ibid., p. 548.
33 Ibid., p. 548 et 595.
34 Albert Savarus, t. I, p. 923.
35 À titre d’exemple, « Elle avait de belles mains, mais rouges, et le plus joli pied, un pied de châtelaine » (ibid).
36 Ibid., p. 923-924.
37 Ibid., p. 931.
38 Ibid., p. 985.
39 Il faut rappeler que Rosalie devait initialement s’appeler Philomène. On peut, dès lors, émettre l’hypothèse d’un rapprochement volontaire de ces deux jeunes filles à travers leurs prénoms, qui redoublent la consonance de leurs patronymes.
40 Stendhal, « Projet d’article sur Le Rouge et le Noir », Œuvres romanesques complètes, t. I, dir. Yves Ansel et Philippe Berthier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », 2005, p. 824-825
41 « The novel is the art-form of virile maturity » (Georg Lukács, The Theory of the Novel. A historico-philosophical essay on the forms of great epic literature, trans. Anna Bostock, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1971, p. 71).
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en janvier 2023, publiés par Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet et Stéphane Pouyaud
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 31, 2024
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1749.
Quelques mots à propos de : Céline Duverne
Université de Reims-Champagne Ardenne
Crimel – Ihrim
ATER à l’Université Reims-Champagne Ardenne, Céline Duverne est l’autrice de la thèse Poètes, poésie et poéticité dans l’œuvre d’Honoré de Balzac, à paraître chez Droz. Elle a co-dirigé avec Jacques-David Ebguy et Lucie Nizard le volume Des Filles d’Ève. Balzac et la question-femme à paraître chez Classiques Garnier. Ses autres travaux portent sur la poétique des genres littéraires au dix-neuvième siècle, en particulier le roman et la poésie, ainsi que sur l’iconographie des écrivains.
