Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
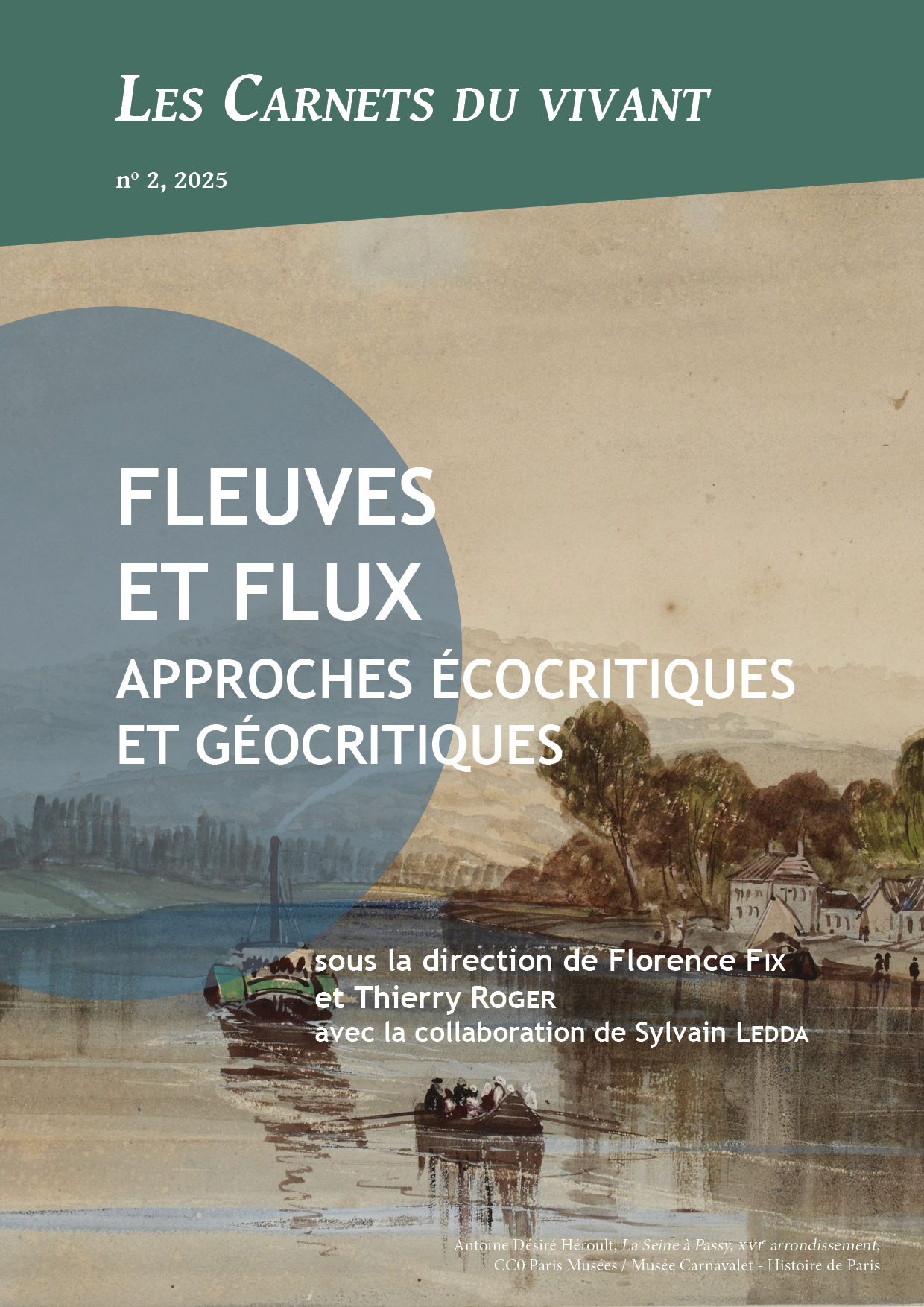
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
Camille Thermes
1Paru en 2019, Amazonia fait partie des « romans sans fiction » de Patrick Deville. C’est le septième volume du projet « Abracadabra », avec lequel l’auteur s’est donné pour ambition de « suivre autour du monde les soubresauts historiques et politiques depuis cette fatidique année 1860 de la deuxième révolution industrielle1 ». Il s’agit, sur trente ans, de parcourir le monde dans un sens puis dans l’autre – sur un axe ouest-est, puis sur un axe est-ouest –, en résidant dans des lieux sélectionnés au début du projet. Chacun de ces lieux fait l’objet d’un récit mêlant enquête, reportage, carnet de voyage, discussions érudites et autobiographie.
2Cette approche de la géographie et de l’écriture a amené la critique à parler de Patrick Deville comme d’un « écrivain de terrain2 », expression qui souligne l’attention que l’auteur porte aux lieux rencontrés, à leur histoire et à leur réalité matérielle contemporaine. Son entreprise en effet est indissociable d’une pensée singulière de l’environnement ; chaque lieu écrit est d’abord documenté, arpenté et habité par l’auteur. Dans Amazonia, c’est depuis le plus grand fleuve du monde que Patrick Deville poursuit son projet. En compagnie de son fils Pierre, il remonte l’Amazone depuis l’Atlantique vers le Pacifique, sur des embarcations commerciales dont les cabines « permet[tent] de concilier la chambre pascalienne et le spectacle du paysage3 ».
3La traversée fluviale est en fait l’occasion d’une quadruple expédition : historique, géographique, esthétique et affective. Historique, parce que Deville ne cesse d’évoquer les grands explorateurs et des événements passés, géographique parce qu’il se déplace et décrit le territoire, esthétique parce qu’il évoque à l’envi des écrivains et artistes, affective, enfin, parce qu’il espère aussi explorer pendant ce voyage la relation père-fils4. Surtout, ce séjour amazonien amène l’auteur à se rendre à l’évidence : « par-delà les conflits, les péripéties, les avancées technologiques », dit-il, « l’événement le plus considérable de ces vingt-deux dernières années [est] le bouleversement climatique en cours, auprès de quoi le reste para[ît] anecdotique5 ». Si la préoccupation écologique est présente dès le début de l’entreprise devilienne, elle est en effet de plus en plus forte et prend une ampleur particulière dans Amazonia, comme le constate l’auteur lui-même : « autant dans les premiers livres, mes interrogations étaient plus politiques, elles sont aujourd’hui davantage environnementales. Parce que c’est ce qui est devenu l’urgence6. » Si Amazonia marque un tournant, c’est d’ailleurs peut-être parce que cette expédition fluviale en particulier témoigne d’une triple réalité. En effet, si l’Amazone est le lieu mythique de grandes explorations fascinantes, les terres qu’il traverse sont également connues pour leurs ressources, initialement abondantes et fructueuses. De ce fait, destructions et massacres et se sont succédés dans ce lieu dont la fertilité et la biodiversité étaient encore récemment réputées inépuisables. L’émerveillement et le dépaysement que suscite ce territoire sont ainsi associés dès le début à des phénomènes d’exploitation et de destruction. Pour cette raison, l’exergue provocatrice du roman n’apparaît finalement que comme faussement paradoxale. La référence à Tristes tropiques – « Je hais les voyages et les explorateurs » – invite les lecteurs et lectrices à déceler le pas de côté que tente de faire Patrick Deville en distinguant sa démarche d’un « voyage » et d’une « exploration ». S’il ne « voyage », ni n’« explore » les lieux, que fait-il donc en remontant ce fleuve avec son fils ?
4Le fleuve ici est perçu comme ce qui organise un territoire, au-delà des nombreuses frontières nationales qu’il franchit. Il est un acteur essentiel de l’écosystème, autant qu’une voie permettant de se déplacer. Cet article a pour but d’analyser la manière dont la centralité du fleuve dans ce texte interroge l’ambivalence du geste d’exploration, entre source d’émerveillement et processus destructeur. Dans quelle mesure la démarche littéraire de Patrick Deville parvient-elle à remplacer l’exploration par d’autres pratiques du territoire inconnu ? Quelles sont ces pratiques, et en quoi amènent-t-elles l’auteur à faire évoluer sa perception des frontières entre communautés humaines et non-humaines ?
5L’article montrera d’abord comment le fleuve Amazone sert ici une sorte de « stratigraphie7 » devilienne qui permet d’échapper au motif de la « découverte » et de prendre du recul sur l’acte d’exploration. Il s’agira ensuite d’interroger la manière dont pratique du fleuve et pratique de l’écriture interagissent. Enfin, l’on montrera que les rencontres humaines et non-humaines suscitées par le fleuve permettent à l’écrivain d’amorcer une « entrée en minorité8 », c’est-à-dire de se replacer au sein du vivant.
6L’hypothèse de départ est que l’écriture devilienne « éprouve le fleuve » pour tenter d’inverser un processus : puisque le fleuve Amazone et son territoire sont « éprouvés » au sens où ils sont endommagés, tourmentés par les exploitations humaines, il s’agit cette fois-ci de « faire soi-même l’épreuve » du fleuve : au lieu de mettre le fleuve à l’épreuve, en faire l’épreuve.
Voguer, contempler et évoquer : une « stratigraphie » devilienne ?
7Dans un entretien paru en 2015, Deville affirme qu’il « n’imagine pas écrire sur un lieu qu’[il] ne connaîtrai[t] pas réellement9 ». « Connaître » un lieu signifie pour lui au moins deux choses : l’habiter sur une durée assez longue, et l’explorer en pensée par des lectures hétéroclites – littérature, histoire, géographie, biologie10… Cette connaissance physique et érudite est essentielle à la méthode de Patrick Deville, qui ne cesse de faire des allers-retours entre son expérience immédiate du paysage et sa « bibliothèque de bord11 ». Dominique Viart rappelle que « l’immersion de l’écrivain sur le terrain est un marqueur essentiel des littératures de terrain12 », littératures auxquelles il associe Patrick Deville :
Le « projet » est alors à entendre au sens étymologique : l’écrivain se projette dans un lieu, une situation, une histoire, ou, dans le cas de Deville, dans un embrouillamini d’histoires stratifiées dont le narrateur entreprend de démêler les liens et les analogies, fussent-elles hasardeuses13.
8En effet le fleuve Amazone est dans ce texte un carrefour temporel et spatial ; les explorateurs, les écrivains, les événements historiques cités sont innombrables. Le fleuve se trouve alors doté d’une grande puissance d’évocation et de mise en relation : le début du texte multiplie les passages qui disent la sensation d’envoûtement suscitée par la navigation fluviale, permettant au corps et à l’esprit de voguer lentement tout en contemplant le paysage. On lit par exemple :
Nous profitions des heures de navigation monotone dans le ronronnement des machines.
Assis à l’abri du rouf, nous laissions défiler la lente muraille verte hypnotique, laquelle avait mené vers la folie ou la poésie les premiers navigateurs effarés14.
9Ou encore, quelques pages plus loin :
Mains derrière la nuque, on peut imaginer ces milliers de rivières qui, depuis les deux hémisphères, se rejoignent dans le lit du fleuve quelques degrés sous l’équateur comme des milliers d’histoires15.
10Le fleuve et ses abords sont ainsi des prétextes à l’évocation du passé à travers les « premiers navigateurs », et font signe vers une certaine mythologie de l’exploration fluviale, puisque la référence à Au cœur des ténèbres apparaît en second plan avec la « lente muraille verte hypnotique16 ». La navigation fluviale permet aussi de mettre en avant la corrélation entre données géographiques et données historiques. Isabelle Bernard Labadi affirme d’ailleurs que la géographie chez Patrick Deville « rel[ève] bien plus d’une herméneutique spirituelle que d’une observation immédiate17 ». L’écriture éminemment intertextuelle de l’auteur lui permet de tisser des liens entre le temps et l’espace, et ainsi de mettre en place une « stratigraphie ». Par ce terme, Bertrand Westphal entend le fait de saisir un lieu à partir de quelque chose qui lui préexiste – d’ordre esthétique, par exemple18. Dans le cas de Deville, l’auteur a conscience qu’il écrit l’Amazone après Cendrars et Jules Verne, le Brésil après Zweig et Bernanos, l’Équateur après Henri Michaux, et que les récits de ces derniers orientent sa propre perception des lieux. Il a aussi conscience qu’il arrive après les conquêtes, les explorations et les destructions, qui ont fait de l’Amazone une référence collective qui se mêle à son expérience subjective.
11Le fleuve Amazone est donc l’occasion de faire des liens avec d’autres écrivains, avec d’autres lieux de la planète comme le Congo ou les bords de la Loire – où Deville a grandi –, ou encore avec sa propre autobiographie. Par exemple, le chapitre intitulé « l’eau qui coule depuis les ruines » remonte trois ans en arrière ; Deville se souvient d’un voyage en train qui l’emmenait à Aguas Calientes, au Pérou :
Devant la fenêtre du compartiment coulait la rivière étroite et bouillonnante comme une gave à truites, pas si éloignée à vol de condor du Pacifique, mais l’orographie19 est onirique : elle invite à s’élever haut dans le ciel à la verticale de ces rails, à lire le futur de ces eaux, à imaginer la main d’un enfant confiant ici au courant un frêle esquif […]. Même si je nourrissais déjà, à bord du train, ce projet amazonien […] je n’imaginais pas alors ou n’osais pas espérer que, trois ans plus tard, je retrouverais en compagnie de Pierre ces eaux loin en aval20.
12Le contact avec le fleuve est vécu individuellement et directement, mais aussi médiatisé par des référents antérieurs. Le lieu est alors doté d’une mémoire personnelle et culturelle, et il est saisi à travers plusieurs couches temporelles. Cette « stratigraphie » est ce qui permet à Deville de donner un sens spécifique à sa démarche ; il examine ce que le territoire représente ou a pu représenter pour lui, ou pour d’autres. C’est ainsi qu’il prend ses distances avec un processus de découverte, qui sous-entendrait la possibilité d’une rencontre avec une nouveauté absolue. Et c’est cette approche qui lui permet d’adopter un point de vue critique sur le territoire, ainsi que sur l’expérience qu’il en a21.
13Cette stratigraphie en effet n’est pas uniquement un prétexte à l’émergence de récits multiples. Le contraste entre les différentes strates temporelles révélées par le fleuve met en évidence le processus de destruction massif en cours. À propos d’une réserve naturelle péruvienne située le long du fleuve, Deville affirme que, si son fils et lui étaient arrivés les yeux bandés, « ils aur[aient] pu croire le monde préservé, tout empli d’oiseaux et de poissons, de dauphins et de caïmans, […] et que cette planète était le paradis qu’elle fut ». Cependant, poursuit-il,
il faudrait le nouer à nouveau, ce bandeau, pour traverser les villes amazoniennes, agglomérations incontrôlées que ne limite aucun obstacle naturel, chancres au milieu de la forêt qu’elles salissent […]. La forêt était en voie de destruction. […] Cette phrase de Lévi-Strauss, écrite au milieu du siècle dernier, était revenue un soir dans nos propos : « ce que d’abord vous nous montrez, voyages, c’est notre ordure lancée au visage de l’humanité. » Ces mots avaient cinquante ans. Ils disaient la deuxième révolution industrielle vieille alors d’un siècle déjà, l’avènement du plus grand bouleversement de l’écosystème depuis la collision, soixante-cinq millions d’années plus tôt, avec l’astéroïde22.
14La force de la critique vient ici de l’alliage entre la description du lieu et la phrase de Levi-Strauss, puisque cette juxtaposition montre que le constat de l’anthropologue était déjà le même cinquante ans auparavant. Ces mises en perspective sont fréquentes ; dans le chapitre « Alexandre & Aimé », Deville indique comme en passant qu’Alexander von Humboldt (1769-1859) est l’« inventeur de la définition scientifique d’un écosystème et de son équilibre entre l’eau et les arbres, les bêtes et les plantes [et] décrit le risque de perturbation amené par l’intervention humaine23 ». En mettant en avant cette référence, il souligne l’aberration d’une histoire humaine qui semble avoir ignoré ces mises en garde déjà prononcées il y a pourtant plusieurs siècles. La stratigraphie sert donc dans ce texte à mettre – partiellement – en perspective une expérience subjective, mais aussi à dénoncer un aveuglement humain destructeur, élaboré sur le long terme.
Pratiquer le fleuve
15Or cette dimension critique nourrit à son tour une pratique du territoire, puisqu’il s’agit de se démarquer de ce qui est dénoncé. La présence physique de l’auteur dans les lieux permet de mettre en place une « implication sensuelle24 » multiple, qui cherche à s’inscrire en opposition avec les phénomènes d’exploration/destruction décriés. Au point de vue de la méthode, la démarche devilienne n’est ni vraiment une enquête de terrain, ni un récit de voyage, ni une expédition scientifique, ni un reportage journalistique ; l’auteur cherche à dire le lieu par le biais de l’interaction qu’il a avec lui, interaction tout autant médiatisée parce qu’érudite, qu’immédiate, parce qu’immersive. Une telle démarche pourrait constituer une version littéraire du dispositif de l’« observation participante ». Cette méthode de recherche utilisée en anthropologie, en psychologie et aujourd’hui aussi en biologie / écologie de la conservation, « cherch[e] à faire fonctionner ensemble, sur le terrain, l’observation, qui implique une certaine distance, et la participation, qui suppose au contraire une immersion du chercheur dans la population qu’il étudie25 ». On constate en effet que l’auteur ne prend pas le fleuve comme un simple décor ; il s’agit pour lui de vivre dans, et parfois avec l’écosystème complexe qu’il arpente. Par exemple, lorsqu’il relate l’une des expéditions qu’il fait avec son fils dans la forêt primaire :
Nous étions attentifs à ne pas transformer cette marche épuisante en l’un de ces défis corporels si communs chez les grands mammifères rouleurs de mécaniques, combat de cerfs mêlant leurs bois, un vieux mâle déjà sexagénaire et l’autre presque trentenaire et dans la force de l’âge. Nous avancions silencieux, suant et ahanant côte à côte ou à la file sur cette planète en train de mourir et nous aussi, économisions le souffle, un peu les dents serrées, les muscles fondant sous la chaleur humide26.
16Ce passage révèle une tentative de déplacement du regard, sur les lieux et sur le monde non-humain en général. Deville utilise d’abord l’hyperonyme « grands mammifères » pour mettre sur le même plan l’humain et une partie des non-humains, puis une métaphore pour les associer son fils et lui à des cerfs27. L’humain se fond dans le vivant par l’intermédiaire de verbes comme « suer » et « ahaner », qui pourraient s’appliquer à d’autres mammifères. Plus encore, l’emploi du terme « aussi » intervient juste après la mention de « cette planète en train de mourir », ce qui a pour effet de comparer leur souffle à celui de la planète. On relève également l’expression « en train de » qui, associé au déictique « cette », crée soudainement un effet de simultanéité ; l’auteur se situe dans un contemporain qui diffère du passé en ce qu’il commande une prise de conscience écologique.
17De plus, l’arpentage du territoire alterne avec les heures d’ennui – le mot revient souvent, et il est même mis en avant, voire chéri – vécues dans la « chambre pascalienne » que représente la cabine du bateau. La référence à Pascal est signifiante ; confronté à l’enfermement et à l’inactivité, l’individu est également confronté à la « misère de l’homme28 », et à sa condition de mortel. Parce que cette chambre pascalienne flotte sur l’Amazone, elle met en évidence l’imbrication entre la mortalité de l’homme et celle du monde vivant au sein duquel il s’inscrit ; la dialectique entre les périodes d’inaction dans la cabine et les moments d’excursion engendre donc une prise de conscience relative au vivant. La réflexion pascalienne se trouve ainsi quelque peu décentrée ; elle entre en dialogue avec une pensée qui est moins anthropocentrée puisque la finitude mise en exergue par l’ennui est celle de l’écosystème et non plus seulement de l’homme.
18Il y a là peut-être un changement de point de vue, qui consiste à allier, dans une certaine mesure, condition humaine et condition non-humaine. En phénoménologie, et en particulier chez Merleau-Ponty, « la perception […] est […] réciprocité, […] échange permanent entre mon corps et les entités qui l’entourent29 ». Comme le dit David Abram :
Notre expérience la plus immédiate des choses, selon Merleau-Ponty, est nécessairement une expérience de rencontre réciproque […]. Depuis les profondeurs de cette rencontre, nous ne connaissons la chose ou le phénomène que comme notre interlocuteur […]. Nous ne figeons conceptuellement ce phénomène […] que lorsque, mentalement, nous nous absentons nous-mêmes de cette relation, lorsque nous oublions ou réprimons notre implication sensuelle30.
19En se rendant physiquement sur les lieux, Patrick Deville en appelle à cette « implication sensuelle » qui lui permet de ne pas « figer » le territoire d’après des représentations qu’il mobilise pourtant massivement. S’il se projette dans le paysage, il est aussi influencé par lui et c’est bien de cette rencontre entre son corps et le territoire vivant que naît le texte.
20Si le fleuve a dans ce texte une puissance d’évocation, il prolonge et fait évoluer le geste romantique consistant à projeter sa singularité dans le paysage décrit31. Le fleuve n’est plus l’occasion de l’expression du « moi », mais celle d’une multitude d’interactions, humaines et non-humaines, dans le temps et dans l’espace. On comprend alors la raison pour laquelle Patrick Deville insiste sur le fait qu’il s’agit d’un « roman » : le but n’est pas de décrire l’Amazone, mais de relater une expérience singulière de ce fleuve, par ailleurs elle-même nourrie d’une multitude d’autres expériences antérieures médiatisées par des textes. Le processus d’écriture fondé sur une double pratique du fleuve – médiatisée et immédiate –, permettrait donc d’approcher le territoire en mettant l’accent sur l’« implication sensuelle » et sur la perception comme « rencontre réciproque ».
« Entrer en minorité » ?
21Il faut dire immédiatement cependant que ce changement de perception se fait sentir à des degrés divers dans le roman. Deville dit par exemple son souhait de contempler de la « beauté32 », ainsi que sa « fringale de voir des animaux sauvages » ; ces désirs associent sa démarche à un voyage touristique malgré tout très classique. Mais père et fils vivent des rencontres qui ouvrent ponctuellement à d’autres perspectives. Le chapitre de « la nuit chez Takashi » s’avère particulièrement décisif. Poète et traducteur que Deville compare à Thoreau, Takashi vit avec ses chiens et son chat dans la forêt amazonienne. Il accueille le père et le fils pour une nuit, et en cette occasion Deville se fait l’« observateur participant33 » d’un mode de vie dans lequel la relation entre l’homme et son environnement a été transformée. D’ailleurs, l’écriture du chapitre est influencée par ce changement puisque Patrick Deville s’attarde régulièrement à décrire l’attitude que les chiens adoptent envers son fils et lui. Il raconte également comment Takashi rappelle à ses chiens « son indispensable présence à leur côté », signifiant par-là que la relation maître/animal a été redéfinie. C’est à l’occasion de cette excursion que l’écriture témoigne d’une inversion complète – quoi qu’éphémère – du point de vue ; c’est en effet au cours de celle-ci que l’écrivain semble se soucier vraiment de la manière dont il est lui-même perçu par les êtres non-humains qui peuplent le territoire. On lit par exemple :
La fumée jointe à nos odeurs de transpiration, plus tard à nos ronflements, donnait sans doute à réfléchir aux singes et peut-être aussi au puma terrorisé34.
22Cet élargissement de la perception acquiert une résonance particulière dès lors que les descriptions amazoniennes de Cendrars, dont il était largement question depuis le début du livre, sont critiquées par l’interlocuteur de Deville :
[Takashi] critiquait Cendrars pour avoir vanté le silence de la forêt amazonienne quand il suffisait ici d’entendre l’incessant boucan, les cris des oiseaux, les appels, bientôt les singes hurleurs qui s’approcheraient pour voler ses fruits auxquels répondraient ses chiens, eux-mêmes nourris à la noix de coco, qu’il fend pour eux à la machette […]35.
23Cette critique rend explicite le phénomène qui a cours dans ce chapitre : l’écriture témoigne d’un changement dans l’importance que l’auteur accorde à ce qui l’entoure. Le séjour chez Takashi l’a rendu attentif à la manière dont l’environnement communique sans cesse, sans lui mais aussi avec lui. Il l’a amené à observer la manière dont lui-même s’inscrit au sein d’un environnement vivant. On peut percevoir ici l’amorce d’un phénomène décrit par Baptiste Morizot :
[…] les chants d’oiseaux, de grillons, de criquets, dans lesquels on est immergés en été dès qu’on s’éloigne des centres-villes, sont vécus dans la mythologie des modernes comme un silence reposant. Alors qu’ils constituent […] des myriades de messages géopolitiques, de négociations territoriales, de sérénades, d’intimidations, de jeux, de plaisirs collectifs, de défis lancés, de tractations sans paroles. […] Ce qu’on appelle la « campagne » un soir d’été, c’est […] un Times Square autre qu’humain un lundi matin – et les modernes sont assez fous […] pour y voir un silence qui ressource, une solitude cosmique, un espace apaisé. Un lieu vide de présence réelle, et muet36.
24Parler du « silence » de la forêt amazonienne, c’est donc s’aveugler non seulement sur ce qui se passe autour de soi, mais également sur sa propre place dans le vivant. Dans l’énumération que Deville prête à Takashi – « incessant boucan, cri des oiseaux […] » –, la barrière entre mondes « sauvage » et non sauvage disparaît au profit d’une pluralité d’interactions et de relations qui peuvent être d’ordres variés : l’entraide, l’information, la menace. Si l’on poursuit le rapprochement, on pourrait dire que Takashi est allé « vivre en minorité » :
Dès que la nature est dénaturalisée – non plus […] un fond sur lequel se jouent des tribulations humaines –, dès qu’on retraduit les vivants en êtres et non plus en choses, alors le cosmopolitisme multispécifique devient submergeant, presque irrespirable, écrasant pour l’esprit – on est entré en minorité37.
25Cette « entrée en minorité », Patrick Deville l’amorce dans Amazonia mais ne la mène pas jusqu’au bout. Il perçoit que le processus est long et déroutant, avouant :
lorsque nous avions quitté Takashi, nous n’imaginions pas à quel point ce lieu et ce séjour si bref allaient nous épuiser et nous bouleverser. […] Nous nous demandions avec Pierre au bout de combien de temps d’acclimatation nous pourrions parvenir à vivre ici comme lui38.
26Il ne s’agit donc pas pour l’auteur de s’associer pleinement et durablement à ce mode de vie, pourtant ce passage semble ouvrir à la possibilité d’émergence de « capacités ignorées39 », qui n’est pas sans rappeler l’« éthique du paysage » d’Aldo Lepold40, permettant d’ouvrir à une « communauté des vivants ». Cette éthique n’est pas pleinement adoptée par Deville mais elle est entr’aperçue par lui et surtout rendue visible grâce à une écriture de terrain qui crée l’occasion de rencontres humaines et non-humaines.
27On perçoit ici les prémices d’une « entrée en minorité » dans la manière dont Deville se laisse transformer par son expérience du fleuve amazonien. La nuit chez Takashi joue en cela un rôle charnière, et elle a des répercussions sur des réflexions ultérieures41.
Conclusion : entre dépaysement et familiarisation
28L’analyse de la démarche de Patrick Deville dans Amazonia a montré que l’auteur tente de repenser nos rapports à l’exploration, et à la pratique de territoires qui nous dépaysent parce qu’ils nous sont inconnus. Le roman porte une critique envers la manière dont le fleuve Amazone est, de longue date, mis à l’épreuve par l’activité humaine. À ce geste, Deville répond en faisant lui-même l’épreuve du fleuve à travers le récit d’un arpentage, qui est associé non pas à l’action mais à la contemplation et à l’ennui. En pratiquant ainsi le fleuve, Patrick Deville initie une mise à distance critique de la notion d’« exploration », dont découle un changement de point de vue sur la relation entre humains et non-humains. Ces deux éléments mettent en œuvre littérairement une pensée phénoménologique de la perception, qui correspond à une « participation » ; la rencontre à la fois médiate et immédiate entre Deville et le fleuve rapproche cette participation de la méthode de l’« observation participante ».
29Chemin faisant, le roman initie alors une réflexion autour des notions de « dépaysement » et de « familiarité ». Dans Manières d’être vivant, Baptiste Morizot montre comment passer du « dépaysement » à la « familiarité », c’est cesser de prêter attention à ce qui nous entoure. Bien sûr, cette démarche est nécessaire dans la mesure où elle nous permet d’accorder de l’attention à d’autres choses qu’à notre rapport immédiat à l’environnement. Cependant, dans le cas de l’exploration de territoires, elle peut contribuer à passer de l’émerveillement à l’exploitation destructrice. Baptiste Morizot rappelle que, chez les peuples autochtones, « le chez soi implique […] [une] attention au tissage des autres formes de vie, qui enrichissent l’existence42 ». Dans Amazonia, cette « attention au tissage des autres formes de vie » est, il faut le dire, encore embryonnaire. Mais le récit montre comment elle se construit peu à peu, grâce à la double rencontre médiate et immédiate d’un territoire. Dès lors le séjour long et parfois ennuyeux, ainsi que la stratigraphie, deviennent les moyens d’une sorte d’appropriation littéraire du territoire, débarrassée de sa dimension conquérante. L’écriture contribuerait à élaborer une certaine familiarité avec le fleuve, mais une familiarité qui augmenterait l’attention du sujet à ce qui l’entoure, au lieu de la diminuer. Le roman de Deville rejoint ici de façon particulièrement évidente la réflexion de Baptiste Morizot :
Le paradoxe […], c’est qu’à un certain degré, il y a un confort appréciable dans l’art des modernes de se libérer de l’attention exigée par le milieu et ceux qui le peuplent, mais que, dès qu’il dépasse un certain seuil ou prend une certaine forme, il devient pire qu’inconfortable : il rend le monde invivable. Le problème devient : quel est ce seuil et quelles sont ses formes […] ? Comment hériter intelligemment de la modernité, faire la part des choses dans nos legs historiques entre les émancipations à chérir et protéger, et les errances toxiques43 ?
30En voguant sur l’Amazone mais aussi entre passé, présent et futur, le roman de Deville pose ce que Baptiste Morizot désigne comme l’une des « grandes questions de ce siècle » : celle de l’héritage moderne, de la possibilité de forger à partir de lui des relations désirables au territoire, et plus largement au monde vivant.
1 Patrick Deville, Amazonia, Paris, Éditions du Seuil, « Points », 2019, p. 263.
2 Voir par exemple l’introduction par les directrices de l’ouvrage, dans Création(s) et réception(s) de Patrick Deville, dir. Isabelle Bernard-Rabadi et Marina Ortrud M. Hertrampf, Munich, AVM éditions, 2019, p. 8 pour la première occurrence.
3 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 160. On peut souligner d’emblée grâce à cette expression une approche du terrain caractérisée malgré tout par une posture d’observation et de retrait, qui nuance peut-être l’ancrage local que nous venons de décrire. L’usage de l’expression « chambre pascalienne » annonce également un voyage intérieur et solitaire, qui se concentre en grande partie sur l’expérience subjective et intime d’un lieu.
4 Celle qu’il vit avec Pierre, et celle que d’autres ont vécue avant eux. Divers chapitres, intitulés « père & fils », explorent cette thématique à travers diverses figures comme celles de Rudyard et John Kipling. Sur cette question, voir par exemple Isabelle Bernard Rabadi, « Patrick Deville et les villes-fleuves du monde. Une histoire d’art et d’eau », dans Pour une poétique des villes-fleuves du monde, entre géopoétique et écopoétique, dir. Patrick Voisin, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2023, p. 495-512.
5 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 260-261.
6 Patrick Deville cité par Christian Desmeules, dans « Un roman-fleuve de Patrick Deville », Le Devoir, 2 novembre 2019. Notons qu’il est étonnant de trouver une opposition ici entre « interrogations environnementales » et « interrogations politiques », puisque l’écriture relie très justement et très étroitement ces deux dimensions. Il me semble que cette contradiction témoigne du fait qu’il faut bien envisager Amazonia comme une étape dans le projet, mais aussi dans le parcours d’un auteur dont les textes montrent qu’il évolue au fur et à mesure du voyage dans le rapport qu’il entretient avec les territoires et leurs habitants.
7 Bertrand Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Minuit, 2007. Voir définition infra.
8 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes sud, « Babel », 2020, p. 23.
9 Patrick Deville, entretien dans « Le Pont de Mindin », dans Presse Océan, 16 septembre 2015, disponible en ligne sur https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/pont-de-st-nazaire-un-texte-inedit-de-l-ecrivain-patrick-deville-pour-presse-o-88a293dd-dbba-11e9-8deb-0cc47a644868, lien consulté le 18 janvier 2023.
10 Il dit d’ailleurs dans un entretien pour Le Devoir accordé à Christian Desmeules : « en même temps, j’ai lu avant sur ces lieux et donc je les vois différemment. Je les vois aussi depuis la bibliothèque ». Patrick Deville, dans « Un roman-fleuve de Patrick Deville », Le Devoir, 2019, n. p.
11 À la fin du livre les lecteurs et lectrices peuvent se reporter à la liste conséquente des ouvrages cités par Deville, intitulée « une petite bibliothèque de bord ».
12 Dominique Viart, « Les terrains de Patrick Deville », chap. cité, p. 155.
13 Ibid.
14 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 12. Je souligne.
15 Ibid., p. 15. Je souligne.
16 Cette expression rappelle le passage durant lequel Marlow navigue sur le fleuve Congo et observe la côte qui commence à faire vaciller ses repères entre réalité et imaginaire. Joseph Conrad, Au Cœur des ténèbres [1899], traduit de l’anglais par Jean Deurbergue, Paris, Gallimard, « Folio bilingue », 1996, p. 62-65.
17 Isabelle Bernard Rabadi, « Patrick Deville et les villes-fleuves du monde. Une histoire d’art et d’eau », chap. cité, p. 499-500.
18 Bertrand Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace, op. cit.
19 Étude, description, représentation des reliefs.
20 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 142. Je souligne.
21 Sur ce point, on peut cependant continuer à nuancer l’ancrage territorial de Deville. En effet, il ne s’agit pas pour lui de tenter une approche qui serait la plus critique possible, dans la mesure où, par exemple, son récit ne mentionne qu’à la marge des rencontres avec des habitants locaux. Il s’agit donc d’un regard qui reste résolument extérieur à toute une réalité du territoire.
22 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 164-165.
23 Ibid., p. 234.
24 Voir David Abram, Comment la terre s’est tue (1996), traduit de l’anglais (États-Unis) par Didier Demorcy et Isabelle Stengers, Paris, La Découverte, 2020, p. 74.
25 Georges Lapassade, dans Vocabulaire de psychologie, dir. Jacqueline Barus-Michel et al., Toulouse, Érès, 2016, p. 392-407, ici p. 394-395.
26 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 44. Je souligne. Notons que, sur la même page, Patrick Deville cite un personnage de Beckett, dans Mercier et Camier : « Nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager que je sache, dit Camier. Nous sommes cons, mais pas à ce point-là. »
27 On retrouve d’ailleurs cette importance accordée aux animaux dans d’autres romans du projet Abracadabra comme Kampuchéa (2011) et Peste&Choléra (2012).
28 Conscience de la disproportion entre le vouloir et le pouvoir de l’homme, qui mène ce dernier à prendre conscience de sa condition de mortel. Voir Blaise Pascal, Pensées (1670).
29 David Abram, op. cit., p. 74.
30 Ibid., p. 78.
31 C’est de la rencontre entre l’œil de l’auteur, sa subjectivité, et ce qui l’entoure, que naît le « paysage » qui fait l’objet d’Amazonia. Sur ce point, voir notamment les travaux de Pierre Wat qui portent sur les arts visuels mais qui peuvent éclairer la démarche devilienne. Voir par exemple Pierre Wat, Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire, Paris, Hazan, 2017.
32 « Entre îles et méandres, nous contemplions les faîtes mouchetés de jaune citron et de vermillon, les ciels comme haillons blancs ou violets accrochés aux cimes. Puisque c’est bien la beauté que nous étions venus chercher jusqu’ici, celle des paysages et des animaux, l’excitation de notre mémoire éidétique, laquelle est souvent aiguisée par la pratique du dessin qui nous apprend à voir ». Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 84.
33 Dans le sens de la méthode décrite plus haut.
34 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 89.
35 Ibid., p. 88.
36 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 23.
37 Ibid., p. 24.
38 Patrick Deville, Amazonia, éd. citée, p. 90-92.
39 Ibid., p. 93.
40 « l’éthique de la terre élargit simplement les frontières de la communauté de manière à y inclure le sol, l’eau, les plantes et les animaux, ou collectivement, la terre » ; Aldo Leopold, « Le concept de communauté », Almanach d’un comté des sables [1949], préface de Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Paris, Flammarion, « GF », 2000, p. 258.
41 Par exemple, lorsqu'il tombe sur un hôpital pour animaux blessés (p. 219), il souligne que l’un des intérêts majeurs de ce lieu est que, en accueillant un public scolaire, il éduque le regard que les enfants portent sur les non-humains.
42 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 34.
43 Ibid., p. 35-36.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2047.html.
Quelques mots à propos de : Camille Thermes
Université Grenoble-Alpes
Litt&Arts – UMR 5316
