Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
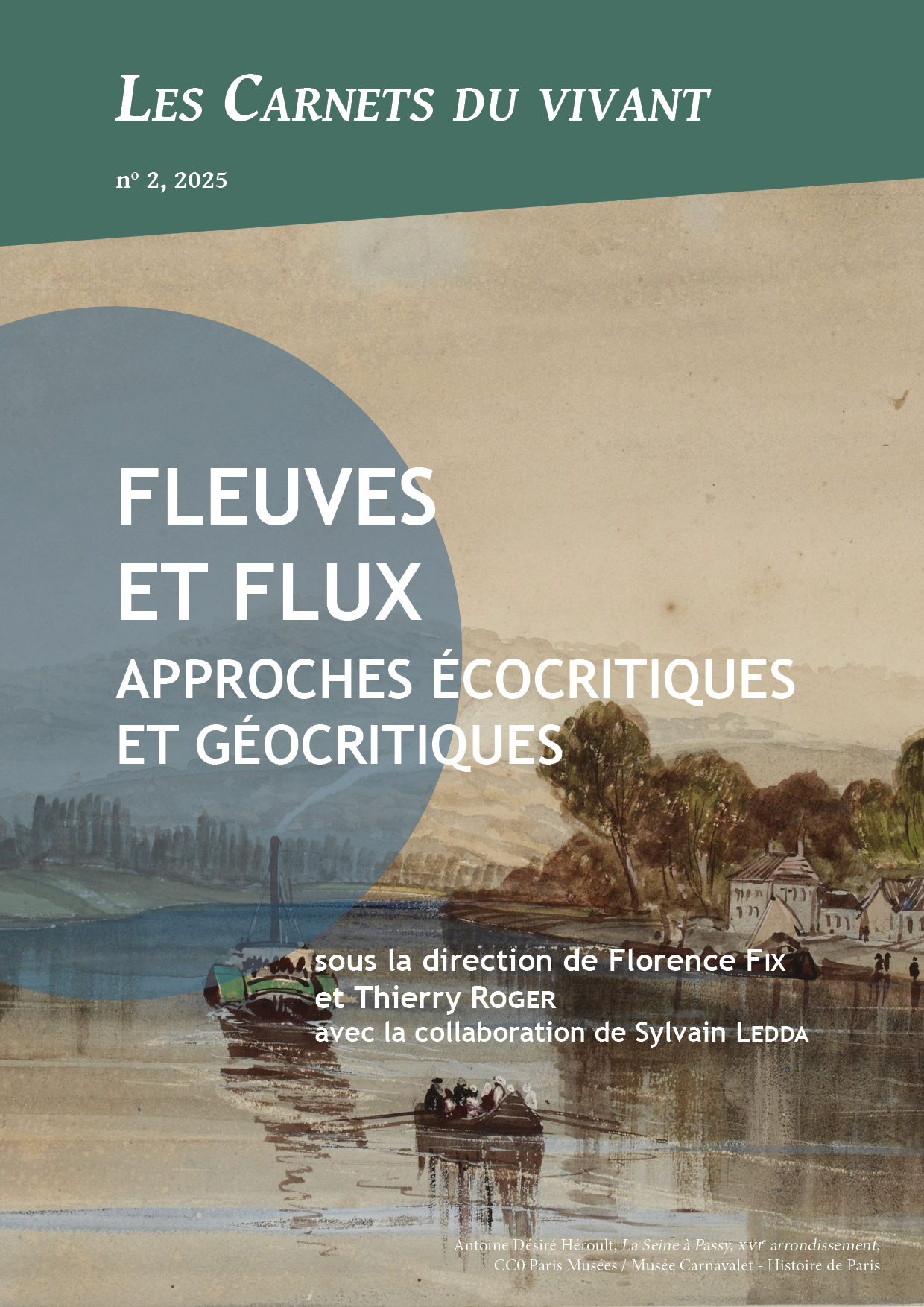
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
Adélaïde Guillou
Quid ? non et lympha figuras
Datque capitque nouas1 ?
1En 1557, Pontus de Tyard publie chez Jean de Tournes et Guillaume Gazeau L’Univers, ou Discours des parties et de la nature du monde : à partir de 1578, il prendra le titre, pour la partie qui nous intéresse ici, de Premier Curieux2. Dans cette « generale histoire du Monde et de ses parties » consacrée aux « choses materielles » de la nature et plus particulièrement dans la description qu’il propose des éléments aquatiques, l’auteur s’attache à définir la « cause des fleuves et fontaines ». Puisant largement dans la vaste bibliothèque des Anciens, il envisage le fleuve dans une perspective savante, à la fois physique, géographique mais aussi fabuleuse. L’élément fluvial, selon le docte Curieux, se caractérise comme une force muable et mouvante, d’origine profondément métamorphique, issue de la confrontation entre les éléments. En ce sens, il se fait le témoin de l’« esmerveillable diversité » de la nature, ce que le savant illustre dans son discours en soumettant à ses interlocuteurs une importante liste de fleuves aux propriétés diverses et merveilleuses, selon le « tesmoignage bien authorisé3 » des récits naturalistes de la littérature antique. Peindre le mouvement fluvial, représenter le lien entre fleuve et métamorphose, faire montre dans des récits fabuleux de la variété des eaux, tel semble constituer le programme d’une autre œuvre de Pontus de Tyard de nature a priori bien éloignée du propos scientifique du Premier Curieux, à savoir les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines, composées dans la même période que le Discours4.
2Affiché dans le titre de l’opuscule, le fleuve apparaît nettement comme le sujet principal de cet ensemble poétique. Comme dans le Premier Curieux, il se trouve dans une relation d’équivalence avec la fontaine (« Fleuves ou Fontaines »), qu’il convient d’entendre au sens classique d’« eau vive sortant d’une source5 » plutôt qu’au sens de l’aménagement architectural contenant une eau stagnante. L’élément fluvial se trouve au cœur de ce petit ouvrage destiné en première intention au peintre qui acceptera de réaliser une série de peintures destinées à décorer une salle du château d’Anet6. Le recueil, très structuré, est composé de douze triptyques qui suivent un schéma identique : la réécriture en prose d’une fable, une description du même sujet pour le peintre et un sonnet-épigramme7. De la même manière que dans le discours du Curieux, Pontus de Tyard emprunte au répertoire antique une série de fables variées faisant toutes mention d’un fleuve aux vertus miraculeuses et inattendues. Mais par-delà cet apparent regroupement thématique de fables fluviales, il semblerait que ce petit recueil cherche à rendre compte de la notion même de fleuve, telle qu’elle est conçue scientifiquement par l’auteur du Premier Curieux, non seulement à travers la sélection très signifiante des récits qu’il choisit mais également à travers la construction formelle de l’ensemble. Ce que nous voudrions montrer, c’est que cet opuscule traduit de manière poétique la conception savante du fleuve telle qu’elle apparaît dans les écrits philosophiques de Tyard. Les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines constitueraient alors une véritable forme-sens prenant le fleuve tant pour sujet que pour modèle, forme à travers laquelle il s’agirait de donner à lire poétiquement l’essence fluviale.
« La metamorphose leur sert de cause8 » : choisir et récrire la fable au regard du fleuve
3Parmi les « diverses facultez entremeslées en cest Element9 », la première particularité du fleuve mise en évidence dans le Premier Curieux réside dans son essence métamorphique : celui-ci naît et se compose selon l’action des quatre éléments, aussi bien de l’eau, de la terre, de l’air que du feu. En effet, d’après les différentes théories rapportées par Pontus de Tyard, le fleuve tire son origine ou bien d’une accumulation d’eaux pluvieuses, qui après avoir été retenues sur la Terre, se transforment en abondante rivière, ou bien d’un phénomène distillatoire de l’air :
Car l’un a dit que les fleuves et fontaines ne sont qu’un escoulement des Eaux pluvieuses, receues et conservées en telle abondance, au caverneux giron des montagnes, ou de la Terre. Les autres ont affermé que l’air enclos dans les cavernes froides et ombreuses, ou ombragées, puis reduit en une espesseur comme paresseuse, est transmué en vapeur distilable, et goute à goutte [sic] rechet en liqueur, d’où s’accroist telle abondance d’eaux10.
4En fonction des différentes qualités de l’air distillé et de l’influence de la terre sur laquelle il s’écoule mais aussi de la chaleur naturelle du feu, les eaux fluviales nouvellement formées se muent et s’imprègnent de ces éléments matriciels :
D’où s’accroist telle abondance d’eaux, savoureuses de divers goust, selon la qualité des vapeurs, desquelles la metamorphose leur sert de cause, et la corruption de generation : ou selon l’accident souffert en la transmutation : ou possible selon qu’elles retiennent des Terres, par lesquelles elles sont escoulées […] Toutesfois la cause plus soustenable est, pource que la matiere, par laquelle elles passent en coulant, est sulphurée, bitumeuse, ou de semblable qualité : joint un feu naturellement vivant avec telles matieres, qui laissent aux Eaux avec la chaleur, la saveur telle que l’on peut discerner facilement au goust11.
5Pur produit d’une conjoncture élémentaire, le fleuve se voit aussitôt gratifié d’un pouvoir métamorphique : à la suite de sa présentation des « causes des fleuves et fontaines12 », le savant Curieux soumet à son auditoire une liste abondante et variée de fleuves aux propriétés transfiguratrices, tel que le fleuve des Cicones qui transforme toute chose en « escorce pierreuse13 », le fleuve Astace qui donne le lait noir aux juments ou encore Cephisse et Melas, ces « fleuves de Beotie, desquels le premier blanchit les moutons noirs, et l’autre noircit les blancs14 ». Ainsi l’idée de fleuve apparaît-elle étroitement liée à la notion de métamorphose dans les écrits savants de Tyard, conformes en ce sens à la pensée pythagoricienne telle qu’elle est rapportée par Ovide dans les Métamorphoses15 et de manière plus générale à la philosophie aristotélicienne qui sous-tend toute l’architecture du Curieux16, mais elle se retrouve également au cœur de la composition et de la sélection des récits des Douze Fables de Fleuves ou Fontaines.
6En effet, parmi les innombrables possibilités offertes par l’arsenal de mythes antiques mettant en scène une personnification fluviale, seules les fables qui font apparaître la transformation effective et visible d’un personnage en fleuve retiennent l’attention du poète. Pourtant, si l’on s’en tient seulement au premier livre des Métamorphoses d’Ovide, bien connu en latin comme en français et maintes fois réédité au xvie siècle17, les légendes célèbres qui font valoir un fleuve personnifié ne manquent pas. On peut se souvenir par exemple de l’intervention du fleuve Pénée dans le fameux épisode d’Apollon et de Daphné18 ou de la peine du fleuve Inachus pleurant la perte de sa fille Io19. Toutefois, dans ces deux fables, les dieux fluviaux préexistent au récit et, bien qu’il y ait métamorphose – Daphné en éternel laurier et Io en éphémère génisse –, celle-ci n’est pas fluviale. Il semblerait que Pontus de Tyard ne choisisse pas ces fables, outre le fait qu’elles sont sans doute trop célèbres pour trouver leur place dans ce recueil d’histoires méconnues, parce que celles-ci ne sont pas liées directement à la métamorphose aquatique. Au contraire, dans tous les récits qu’il convoque et qu’il récrit, c’est toujours au contact de l’eau que les êtres se transforment et revêtent un don particulier. Immanquablement20, l’élément liquide préside à la mutation : que ce soit dans le cadre d’une métamorphose fluviale dans lequel un corps se dissout dans les eaux – c’est le cas pour la nymphe Clytorie (1), le pasteur Selemne (3), la vierge Callirhoë (4), le beau Narcisse (8) et le pauvre Chios (10) –, ou dans le cadre d’une métamorphose minérale ou végétale issue du contact entre les êtres et l’élément aquatique : après s’être précipités dans leurs fleuves respectifs, le jeune Phasis (5) et le roi Araxe (6) se changent en herbe, Inde (7), Strymon (11) et Nilus (12) en pierre. Cette attention singulière au principe de la métamorphose est mise en abyme, pourrait-on dire, dans la neuvième fable à travers les deux corps en cours de fusion et « desja joints ensemble » (D. 9) de la nymphe Salmace et du jeune Hermaphrodite, au patronyme déjà marqué significativement par la coalition onomastique du nom de ses parents, qui confèrent au fleuve ses nouvelles propriétés métamorphiques :
Que quiconque en ton fleuve, ô Salmace, entrera,
Aura, comme vous deux, les deux sexes ensemble. [E. 9]
7Cette volonté très nette de la part de Tyard d’associer fleuve et fable par le biais effectif du processus de transformation se perçoit plus encore dans la liberté qu’il prend à l’égard des « anciens Auteurs » dont il s’inspire. Aussi n’hésite-t-il pas à inventer le récit de métamorphose fluviale lorsqu’il n’apparaît pas comme tel ou à le rendre plus visible lorsque sa source n’est pas assez explicite sur ce point. C’est le cas de la métamorphose de la nymphe Clytorie que le poète associe à la naissance de Bacchus. Inspiré d’Ovide, le récit donne à voir le terrible accouchement de Sémélé avant de faire intervenir une nymphe salvatrice qui, en protégeant le nouveau-né, se transforme en fleuve :
Au piteux accident Clytorie arriva
Qui secourant le dieu, de larmes le lava
Estaignant à l’entour la vive flame emprainte.
Il est encor ardent à qui sans eau l’espreuve :
Elle, fondant en pleurs, de son nom fait un fleuve,
Qui rend l’ardeur du vin pour enyvrer, estainte. [E. 1, v. 9-14]
8Or, dans le texte ovidien, il n’est pas plus question de fleuve que de métamorphose :
Corpus mortale tumultus
Non tulit aetherios donisque iugalibus arsit.
Inperfectus adhuc infans genetricis ab aluo
Eripitur patrioque tener (si credere dignum est)
Insuitur femori maternaque tempora complet21.
[« Le corps d’une mortelle ne put supporter le fracas qui ébranlait les airs ; elle fut consumée par les présents de son époux. L’enfant imparfait est arraché du sein de sa mère et, tout frêle encore, cousu (s’il est permis de le croire) dans la cuisse de son père, où il achève le temps qu’il devait passer dans les flancs maternels. »]
9Même si le poète peut se souvenir ici de Pline ou d’Ovide, qui évoquent tous deux les propriétés désenivrantes d’un certain lac Clitor22, nulle part dans leurs textes il n’est fait mention d’une nymphe ou d’une transformation et nous nous trouvons ici face à ce que Gisèle Mathieu-Castellani appelle une véritable « “invention” de Tyard23 ». Afin d’unifier le cycle autour de la métamorphose, l’auteur choisit de transformer la fable matricielle de Sémélé en récit de transmutation fluviale.
10C’est pourquoi, dans certains épisodes, il insiste davantage que ses sources sur le lien entre le pouvoir métamorphique des eaux et la dissolution des corps qui le constituent. Dans la onzième fable, le poète signale que c’est au contact du fleuve Palestin que le corps de Strymon « s’endur[e] en pierre esmerveillable » alors que, comme le dit à nouveau Gisèle Mathieu-Castellani, dans le De Fluviis qui fournit l’argument de cette fable, le pseudo Plutarque constate seulement la présence de la pierre24. Il en va de même pour les sixième et septième fables : le poète met l’accent sur la métamorphose d’Araxe en herbe et d’Inde en pierre tandis que le De Fluviis rend seulement compte de leur existence :
Le fleuve donne naissance à une plante du nom d’araxa25. [Pseudo-Plutarque, « Araxe »]
Mais les Dieux le transformerent en une herbe, que ceux du pays nomment Araxe. [F. 6, nous soulignons]
Le fleuve donne naissance à une pierre du nom de ˂***˃26 [Pseudo-Plutarque, « Indos »]
et se noyant en ce fleuve (qui depuis eut le nom d’Inde) fut transformé en une pierre. [F. 7, nous soulignons]
11Enfin, fort de sa pensée savante qui fait du fleuve le produit d’une conjoncture élémentaire, Tyard insiste sur l’interaction entre les différentes forces naturelles à l’instant décisif de la mutation : par endroits, le fleuve de la fable naît de l’intrication réelle ou symbolique entre deux éléments, le plus souvent l’eau et le feu. C’est le cas du fleuve de la première pièce qui émerge de l’alliance entre les larmes de la nymphe et la chaleur ardente du dieu nouveau-né :
Clytorie, secourut du feu, et estaignant avec ses larmes la flamme qui environnoit le petit Bacchus, fut transformee et fondue en fleuve de son nom, qui depuis estaint la force du vin, comme le vin trouvé par Bacchus, participe encores de la naturelle ardeur du feu. [F. 1]
12En d’autres fables, l’interaction entre les différents éléments est rendue manifeste par un effet de concomitance dans l’économie du récit ou de la description. Ainsi, le sang de Callirhoë se mêle à l’eau de la fontaine « qui peut faire allumer une amour mutuelle » (F. 4) au moment même où Coresus périt dans le feu. De la même manière, apparaîtront simultanément sur le tableau l’immolation des filles du roi Araxe et le suicide de ce dernier dans le fleuve :
En un autre endroit se verroit Mnesalce, tuant l’une des filles du Roy, et l’autre qui seroit desja morte et brulante en un feu. Puis en prochaine veue se verroit Araxe dedans un fleuve. [D. 6, nous soulignons.]
13Au terme de chacun de ces douze récits, la fable se trouve systématiquement et symboliquement dissoute dans le fleuve, qui fait mémoire du récit originel en s’appropriant le nom de l’être transformé. Cette insistance sur la transmission onomastique illustre la relation de réciprocité que l’auteur instaure entre les êtres et les fleuves. À de nombreuses reprises, Pontus de Tyard souligne le changement du nom du fleuve (métonomasie) :
Phasis […] se noya dedans un fleuve prochain, appelé Arcture : tirant sa denomination de l’Estoile qui est entre les jambes de Bootes, constellation Septentrionale. Et depuis ce temps, ce fleuve retint le nom de Phasis. [F. 5]
Araxe […] s’alla noyer dedans un fleuve nommé Alme, qui depuis fut, pour ce fait, appelé Araxe. Mais les Dieux le transformèrent en une herbe, que ceux du pays nomment Araxe. [F. 6]
Lors le fleuve Mausol le nom d’Inde retint [E. 7, v. 9]
Du fleuve Palestin lors se changea le nom
En retenant celuy du désolé Strymon [E. 11, v. 9-10]
14Devenus éponymes27, les noms des héros mettent en évidence les liens profonds entre l’homme, le langage et le monde. Il y a dans cet opuscule une réelle volonté de rendre les noms signifiants à travers cette métamorphose du patronyme en toponyme, « ce qui ne saurait laisser indifférent l’humaniste soucieux d’expliquer le rapport du verbum à la res, et féru d’étymologies comme on le voit par exemple dans le Solitaire Premier28 ». À travers la sélection de ses récits, par ses choix de réécriture et par son désir d’afficher linguistiquement les liens dissolubles qui unissent les êtres aux fleuves, le poète fait de la métamorphose le principe unificateur et créateur de ces fables-fleuves. Ce processus, imposé par la connaissance philosophique du fleuve décrite dans le Premier Curieux, s’inscrit dans le même temps dans la perspective globale du recueil qui vise à rendre compte du dynamisme fluvial.
Figurer le mouvement fluvial
15Le savant Curieux rappelle en effet que l’eau est l’élément fluctuant par excellence : « Element d’Eau non engendré ny corruptible en son entier : muable toutesfois, c’est à dire changeant de place, selon que le tire la celeste naturelle vertu29. » Conformément à sa nature aquatique, le fleuve n’échappe pas à ce principe fondamental : « l’un a dit que les fleuves et fontaines ne sont qu’un escoulement des Eaux pluvieuses30. » Son passage dynamique sur la « matiere » – « Terres, par lesquelles elles sont escoulées », « à cause du mouvement qu’elles font », « par laquelle elles passent en coulant31 » – conditionne les nouvelles propriétés substantielles, qui le rendent chaud, savoureux ou encore merveilleux. Or, dans les Douze Fables, le désir de peindre le mouvement est pleinement inscrit dans le programme poétique et esthétique de l’auteur. Dans chaque triptyque, une attention toute particulière est portée sur l’énergie qui se dégage de ces saynètes où se dissolvent les corps et les éléments. Même si le produit fini de la métamorphose sous-tend la progression des récits, il semblerait que ce qui intéresse le plus Pontus de Tyard dans ces petits récits, pourtant étiologiques, ne soit pas tant le terme qui en résulte que le processus vivant et imagé à l’œuvre au moment où convergent les mouvements du héros et ceux du fleuve. En annonçant de manière programmatique, dans le titre de toutes les fables qui ouvrent le triptyque, le résultat de la métamorphose32, le poète invite le lecteur déjà informé du dénouement narratif à porter son attention sur le processus qui a conduit jusqu’à lui. De manière plus significative encore, les descriptions, que l’auteur imagine en vue d’une réalisation picturale, s’appliquent tout particulièrement à rendre visible la force cinétique de ces épisodes. « C’est le presque, le à demi, le déjà, que Tyard propose comme objet à l’art du peintre. Comme si la contiguïté spatiale parvenait à “rendre” la simultanéité de l’état et du mouvement, que ne peut restituer la linéarité du discours33. » C’est pourquoi le poète suggère de peindre ce moment où les êtres encore hybrides se trouvent à mi-chemin de l’humain et de l’élément naturel :
Seroit Clytorie à demy transformée en fleuve : et entre ses bras seroit le petit Bacchus, partie encores envelopé de feu, et en partie le feu estaint [D. 1]
Leurs deux corps seroient (comme un commencement de transformation) desja joints ensemble, comme s’ils n’estoient qu’un, combien que la teste, les bras, et les jambes fussent encores separez. [D. 9]
Ailleurs seroit peint un fleuve, dedans lequel se noyeroit Strymon, desja se transformant en pierre. [D. 11, nous soulignons]
16En découvrant la métamorphose in medias res, le lecteur-spectateur se doit non seulement de saisir le mouvement hic et nunc (« desja »), encore incomplet (« presque, en partie, à demy »), de la mutation du corps en eau, mais également de le poursuivre en pensée. C’est ce que souligne Eva Kushner,
le résultat est d’une vivacité d’autant plus extraordinaire que le lecteur est invité, par l’emploi de verbes au conditionnel, à participer à l’invention ; le tableau reste hypothétique, sujet à transformation, ce qui porte davantage encore le lecteur à mettre en œuvre sa propre imagination34.
17L’attention portée à la représentation cinétique du récit dépasse le seul moment de la métamorphose. Ainsi personnages de la fable et éléments aquatiques sont-ils toujours en action : « puis assez pres seroit Phasis se precipitant en un fleuve » (D. 5), « le fleuve, duquel le cours seroit représenté roide et violent » (D. 7), etc. De la même manière, l’arrière-plan du tableau est gagné par cette énergie qui tend à se généraliser. Le décor se charge de figurants affairés en tous sens : cortège de Bacchantes (2, 7), soldats au combat dans la geste troyenne (11), poursuivants acharnés de Chios (10)… Toutes ces images qui apparaissent simultanément dans les tableaux exacerbent la vigueur trépidante qui se dégage de ces récits palpitants ou dynamiques qui ne cessent de multiplier les effractions : scène de mort violente par meurtre (1, 4, 5, 6, 11) ou par suicide (3, 5, 6), agression sexuelle (7, 8) et tentative de fuite (7, 8, 10) et de noyade (7, 10, 11), tentative de vol (10), guerre troyenne macabre (11), catabase (12). En donnant à voir le mouvement sous toutes ses formes et en toutes parts du tableau, les descriptions suffisent alors, sans le secours du peintre, à transmuer le « récit en composition, processus dont la réussite ne dépend aucunement d’une éventuelle réalisation. L’enargeia verbale déployée par Tyard contient en elle-même sa propre finalité esthétique35. » Il apparaît alors que le principe du dynamisme fluvial influence et conditionne les choix poético-picturaux de l’auteur autour de cette traduction visuelle et verbale du mouvement. Tout comme dans la pensée pythagoricienne telle qu’elle est rapportée par Ovide dans les Métamorphoses, le fleuve chez Pontus de Tyard représente l’éternel processus cinétique et métamorphique qui caractérise la marche du monde :
Tout passe, toutes les formes ne sont faites que pour aller et venir. Le temps lui-même s’écoule d’un mouvement continu, ni plus ni moins qu’un fleuve ; car un fleuve ne peut s’arrêter36.
18En figurant le mouvement perpétuel, les fables-fleuves de Pontus de Tyard rendent compte de l’énergie protéiforme de la nature. S’y établit un lien indissoluble et mimétique entre la profonde instabilité des récits et le devenir de l’essence muable du fleuve. La fable se dissout dans le fleuve mouvant auquel elle transmet les traces de ses vicissitudes passées. Les diverses configurations qui sont mises en œuvre dans les douze récits vont alors faire état du principe de variété inhérent, dans la pensée savante de l’auteur, à la nature fluviale.
Poétiser la diversité « esmerveillable » des fleuves
19Dans le Premier Curieux, la partie consacrée aux fleuves fait valoir à quel point « Nature […] a fait aux Eaux plusieurs montres de son esmerveillable diversité37 ». Afin d’illustrer ce principe, le savant établit un abondant répertoire mytho-scientifique de fleuves aux propriétés les plus diverses. Bien qu’il s’en défende, il souscrit largement à la pratique de la liste en énumérant une multitude d’exemples38 qu’il trouve chez les Anciens39 :
Je ne veux, pour ne vous ennuyer, amonceler ce que j’ay leu de semblables merveilles en Aristote, Josephe, Pline, Seneque, Plutarque, Pausanias, et autres, tant Philosophes que Historiens, qui ont recueilly grand nombre de miracles à ce propos40.
20Ce sont en partie les mêmes sources41 qui font autorité dans les Douze Fables, « tirees d’Homere, d’Ovide, de Diodore, de Pausanias, de Plutarque, et autres anciens Auteurs ». Penser le fleuve pour Tyard ne semble pas se concevoir sans ce recours aux autorités savantes antiques. Dans ces deux œuvres, certains cours d’eau ont des propriétés identiques : à proximité du fleuve de Clytorie, présent dans les deux textes, les eaux dégrisantes du Lynceste42 dans le Premier Curieux rappellent celles de la Fontaine d’André (2), les eaux alchimiques des Indes qui changent l’eau en or évoquent celles du Chrysoroas (10) et certains fleuves présentent la même faculté de transformer des corps en pierre – le fleuve des Cicones, un Styx en Arcadie et le Surie aussi bien que les fleuves Inde (7) et Strymon (11). Toutefois, s’il existe des analogies entre les deux ouvrages, le recueil poétique structure la diversité fluviale en la resserrant autour de la thématique amoureuse, là où les abondantes propositions du discours savant cherchent à faire apparaître, outre le savoir du locuteur, la multiplicité infinie des propriétés aquatiques. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que l’œuvre fasse fi de cette variété propre à la pensée tyardienne du fleuve puisque, à travers le cadre de l’amour43, ce sont la multiplicité et la mouvance des configurations sentimentales qui intéressent le poète.
21De fait, la diversité propre à la nature des fleuves est particulièrement bien rendue par la construction de l’ensemble poétique qui met en évidence les vicissitudes du cœur humain et l’instabilité identitaire des êtres : « Tyard se sert de la mythologie aquatique pour ramener les désirs humains au domaine de la nature, qui d’emblée n’en exclut aucun44. » Dans ces configurations amoureuses, c’est à chaque fois un versant différent de l’amour qui est mis en avant : jalousie de Junon (1), inconstance d’Argire (3), martyre amoureux de Coresus et regrets de Callirhoë (4), adultère incestueux de Phasis (5), amour paternel d’Araxe (6), viol d’Inde (7), désir coupable de Narcisse (8), avances non consenties de Salmace pour Hermaphrodite (9), bonheur familial provisoire (10), amitié funeste de Strymon pour Rhésus (11) ou deuil inconsolable de Garmathone après la perte de son fils (12). Le thème de l’amour unifie le cycle mais il permet surtout de rendre compte de ses formes infinies. Cette volonté de montrer les potentialités illimitées de la nature se mesure également dans l’agencement des poèmes du recueil, à travers l’organisation spéculaire choisie par Tyard qui associe ses récits deux à deux45. Relié par l’antithèse ou par l’analogie, chaque épisode regarde l’autre « comme dans un miroir » (D. 8) qu’il soit inversé ou non. Afin de montrer la réversibilité et la variété de la nature, certaines fables-fleuves présentent des vertus radicalement opposées : la première fable « qui a force de desenyvrer » se heurte à la deuxième « qui a force d’enyvrer » ; la troisième fable « efface la passion d’Amour » tandis que la suivante « engendre le réciproque amour ». D’autres se présentent comme des variations autour d’un sujet similaire : la chasteté et la fidélité (5 et 6), l’androgynie (8 et 9), le crime (7 et 10) et le deuil impossible (11 et 12). Dans les deux cas, leur association en regard permet au poète de montrer la manière dont un même phénomène peut se démultiplier. En ce sens, la fable de Narcisse, qui constitue un pivot dans le recueil46, constitue également une mise en abyme de cette structure en miroir dans laquelle chaque fable est à la fois la même et une autre. De la même manière que le Narcisse de la huitième pièce, inspiré de Pausanias, admire dans l’eau autant sa propre image (le même) que celle de sa défunte sœur jumelle (et l’autre), les fables se réfractent deux à deux et se répondent tantôt par analogie, tantôt par altération. Quand dans le Premier Curieux l’expression de la variété fluviale s’écrit à travers l’abondance de l’énumération, elle se dit dans le recueil poétique par le biais d’une structure spéculaire très travaillée qui reflète l’image d’un monde où tout cohabite et où tout se mue, à commencer par le texte lui-même qui, à travers ses trois variations stylistiques, fait montre rhétoriquement de la constitution même du fleuve.
Décomposer et recomposer le fleuve
22Mouvement, métamorphose et diversité, les caractéristiques ontologiques fluviales semblent bien inspirer la composition originale de l’opuscule et l’exercice de style que constitue la réécriture de ses pièces en triptyque. Chaque épisode repose sur un dispositif poétique bâti sur trois unités textuelles différentes – une fable, une description et une épigramme en vers, qui se complètent et qui se glosent, dont nous reproduisons un exemple :
TROISIESME FABLE DU FLEUVE SELEMNE, QUI EFFACE LA PASSION D’AMOUR
Argire, Nymphe marine enamouree d’un jeune pasteur, nommé Selemne, sortit hors de la mer, et vint aveques luy cuillir les fruicts de l’Amour. Peu de temps apres, qu’il ne luy sembla plus beau, elle se desacoustuma de le favoriser, dont luy impatient d’Amour, se laissa mourir, et fut, mourant, transformé en un fleuve, auquel Venus donna vertu de faire oublier l’Amour à ceux qui, tourmentez de celle passion, se viendroient laver dedans.
DESCRIPTION DE LA PEINTURE
Argire, Nymphe marine seroit peinte assise sur un Dauphin assez pres du rivage de la mer : et accompagnee d’un Triton, duquel, au raport de Pausanias en sa Boetie, la figure est telle : Il a la teste chevelue, et de couleur telle que les Grenoilles palustres : le nés ainsi qu’un homme, mais la bouche plus grande, et les dents comme une beste brute : Il a sous les aureilles des branches ou petits ailerons, comme les poissons, et les yeux de couleur entre le bleu et le vert : Il a des mains, et les ongles des doigts sont faites en petites coquilles : le reste du corps finissant en forme menue et gresle, est revestu d’une escaille aspre, comme l’Angelot de mer : dessous le ventre il a en lieu de pieds, une queue comme un Dauphin. Argire donc riant comme par moquerie, monstreroit au Triton, Selemne mort, et presque transformé en fleuve, aupres duquel paistroit un troupeau de bœufs et d’autre betail.
EPIGRAMME DU FLEUVE SELEMNE
En celle fleur des ans qu’une toyson doree
Le menton et la joue à Selemne frisoit,
Quant aux pastis herbus ses beufs il conduisoit,
De mainte Nymphe fut sa beauté desiree.
La Nymphe Argire en fut plus qu’autre enamouree :
Et sortant de la mer, avec luy se plaisoit,
Où des faveurs d’Amour telle part luy faisoit :
Que la liberté fut au pauvret empiree.
Elle estaint (l’inconstante) en peu de temps sa flame
Quant plus plus le pauvret la sent croistre en son ame :
Elle ingratte se rit de ce dont il soupire.
Luy enfin soul d’aymer, de vivre aussi se soule :
Et pour l’oubly d’Amour Venus en eau l’escoule
Qui lave et qui estaint tout amoureux martire.
23Véritables transfigurations du dire poétique, elles vont tantôt déplacer tantôt accentuer tel ou tel aspect du récit matriciel fourni par la fable de telle sorte que le fleuve décrit par chacun des trois textes est à la fois, conformément au principe métamorphique, le même et un autre. Ce schéma poétique explicite ouvertement la re-formalisation métamorphique à laquelle se livre le poète et renvoie aux principes intrinsèquement liés à la pensée savante de l’auteur.
24Première métamorphose du texte matriciel, la description condense la fable et la réoriente tout entière pour offrir au lecteur-spectateur une expérience visuelle inédite du mouvement et de la simultanéité :
Tyard, dans son œuvre poétique passée, nous avait peu habitués au pittoresque visuel […]. Si le récit est, de toute évidence, syntagmatique, le tableau lui, combine avec la succession des épisodes une fonction paradigmatique : tous s’offrent à la vue simultanément, mais la description conduit le lecteur d’un segment à l’autre selon les phases du récit47.
25Il ne s’agit en effet pas, nous l’avons vu, de raconter le processus de la métamorphose, mais bel et bien de le faire apparaître sous nos yeux. La fable subit dès lors une forme de réagencement stylistique de manière à ce que l’œil englobe le récit comme il le ferait devant un tableau.
En un temple sur un autel, sur lequel seroit le simulachre d’Hercule, le Roy Araxe assisteroit au sacrifice qui se feroit de deux vierges. En un autre endroit se verroit Mnesalce, tuant l’une des filles du Roy, et l’autre qui seroit desja morte et brulante en un feu. Puis en prochaine veue se verroit Araxe dedans un fleuve, en partie transformé en herbe comme les pieds et l’un des bras, à la discretion du peintre48. [D. 6, nous soulignons]
26Aussi le texte de la description est-il saturé par des indications de plans et de perspectives, par les répétitions lexicales parfois tautologiques ou par la multiplication des présentatifs verbaux qui visent à niveler la progressivité narrative de la fable. Les descriptions tendent à convertir le texte en image, le lisible en visible, alors même qu’elles représentent des scènes de métamorphose. À travers les mutations qu’il fait subir à son propre texte, le poète semble bien construire une relation iconique entre ce qui est représenté et la manière dont il le représente dans le recueil.
27Deuxième variation stylistique, le sonnet-épigramme transpose non seulement la fable mais aussi la description qu’il soumet aux nombreuses contraintes du sonnet. De manière générale, les quatrains reprennent comme prémices les éléments narratifs du premier récit alors que les tercets, tendus vers la métamorphose des corps et des fleuves, se rapprochent davantage des descriptions. C’est le cas, par exemple, du troisième sonnet : les deux premières strophes empruntent à la fable le développement narratif (la rencontre entre Argire et Selemne) tandis que les tercets reproduisent la scène imaginée dans la description, à savoir le rire de la nymphe devant le corps mort de l’amant éconduit :
Argire donc riant comme par moquerie, monstreroit au Triton, Selemne mort, et presque transformé en fleuve, aupres duquel paistroit un troupeau de bœufs et d’autre betail. [D. 3]
Elle ingratte se rit de ce dont il soupire
Luy en fin soul d’aymer, de vivre aussi se soule [E. 3, v. 11-12]
28De la même manière, dans le deuxième épisode, c’est l’image d’un Silène assis dans l’eau, tiré par une bacchante et par un satyre, que le poète propose au peintre et c’est sur celle-ci également que se clôt le sonnet, alors que dans la fable matricielle ces deux personnages faisaient partie d’un groupe indéterminé : « Là accoururent quelques Satyres et Baches, qui en riant et moquant, tirerent le vieil yrongne dehors. » (F. 2, nous soulignons). Au contraire, dans la description et le sonnet-épigramme, Tyard choisit de resserrer la scène autour d’un nombre restreint de figurants :
Une femme ainsi barbouillee que Silene, et vestue d’une peau de chevreuil ou fan de biche, ayant son Thyrse aupres d’elle, et un Satyre luy aydant, tireroient hors du ruisseau d’une fontaine voisine, le vieil Silene. [D. 2]
Une Bacche riante aveques un Satyre
Le vieillard tout honteux hors du ruisseau retire [E. 2, v. 9-10, nous soulignons.]
29Le passage de la fable à la description conditionne les réécritures épigrammatiques qui font mémoire des images fortes pensées pour la peinture. Toutefois, à la différence des descriptions toutes entières portées sur le mouvement, les épigrammes font valoir quant à elles le produit fini de la métamorphose dans une pointe étiologique conclusive, conformément à la logique de montée de puissance qui les caractérise. Ce faisant, elles concentrent le suc de la fable :
[Clytorie] fut transformee et fondue en fleuve de son nom, qui depuis estaint la force du vin, comme le vin trouvé par Bacchus, participe encores de la naturelle ardeur du feu. [F. 1]
Elle, fondant en pleurs, de son nom fait un fleuve,
Qui rend l’ardeur du vin pour enyvrer, estainte. [E. 1, v. 13-14]
30Les deux vers du sonnet récrivent la proposition narrative de la fable dans un volume textuel réduit. Si nous retrouvons les mêmes termes (« ardeur », « vin », « fleuve », « nom », « fondue/fondant », « estaint/e »…), la contrainte du vers oblige le poète à recomposer le récit. Aux deux événements de la narration correspondent deux vers distincts : le vers 13 évoque la transformation de Clytorie et le vers 14 fait état de la propriété merveilleuse du fleuve nouveau-né. Toutefois, le poète ne retient pas la comparaison finale de la fable, qui permettait de relier la première et la deuxième pièce autour de la figure de Bacchus. Celle-ci apparaît sans doute ici comme une amplification superflue qui nuirait à la construction épigrammatique de la pointe. Au contraire, le poète choisit de clore la pièce sur le terme « estainte » (v. 14) alors qu’il apparaissait plus tôt dans la narration (« estaint »). La mise en valeur de cet attribut placé en fin de vers, retardé par sa postposition derrière le complément, permet au poète de clore la pièce par le rapprochement oxymorique « enyvrer, estainte » qui n’est autre que la propriété naturelle du fleuve décrite dans cette fable. De la même manière que le fleuve ne conserve que le suc de la légende passée, l’épigramme distille la prose du récit, au gré de ses nombreuses contraintes prosodiques, rimiques, phonologiques ou strophiques, pour n’en garder que l’essence poétique.
31En définitive, le dispositif rhétorique inventé par Pontus de Tyard met en place une combinaison subtile entre le voir, le dire et le dit à travers laquelle la métamorphose des héros en fleuves métaphorise le passage de la fable en description ou en sonnet. Tout comme le mouvement fluvial, le texte lui-même repose sur une forme d’instabilité et c’est par la transfiguration et la démultiplication de ses formes qu’il se constitue. Le mouvement symbolique induit par la métamorphose peut être considéré comme une image du processus sémantique et formel à l’œuvre dans ce texte qui touche aussi bien les héros que les petits poèmes. C’est pourquoi, contrairement à Françoise Charpentier pour qui « la double vocation poétique et scientifique de Tyard laisse une nette séparation entre ses œuvres poétiques et ses dialogues en prose49 », il nous a semblé que l’étude des Douze Fables de Fleuves ou Fontaines menée à la lumière du Premier Curieux pouvait se révéler fructueuse. Au regard de la conception tyardienne du fleuve dans ce discours, il apparaît que l’opuscule constitue une véritable forme-sens prenant le fleuve pour icône. Métamorphose, mouvement et diversité, les principes ontologiques du fleuve travaillent le recueil en profondeur et donnent leur forme poétique à l’ensemble de ses fables devenues fleuves. Gisèle Mathieu-Castellani disait à propos de cette œuvre : « un tel projet est le symptôme du rêve humaniste, s’efforçant de penser le monde comme un texte50 », ce à quoi nous pourrions ajouter, de penser le texte comme le monde.
1 Ovide, Les Métamorphoses, texte établi et traduit par Georges Lafaye, revu et corrigé par Henri Le Bonniec, Paris, Les Belles Lettres, 2002, t. 3, Livres XI-XV, v. 308-309, p. 131 : « Ne voyons-nous pas l’eau donner et recevoir des formes nouvelles ? ».
2 Pontus de Tyard, L’Univers, ou Discours des parties et de la nature du monde, Lyon, J. de Tournes et G. Gazeau, 1557, Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, R-2952. Le texte, révisé et enrichi par ses soins, est réédité à Paris en 1578 par Mamert Patisson sous le titre de Deux discours de la nature du monde et de ses parties. A sçavoir le Premier Curieux traittant des choses materielles et le Second Curieux des intellectuelles. Enfin, le premier des deux discours, auquel nous nous référons ici, prend le titre simplifié de Premier Curieux et trouve place en 1587 dans une réédition que Pontus de Tyard entreprend de six discours déjà publiés qu’il regroupe dans ses Discours philosophiques. L’édition de référence utilisée pour les emprunts à ce texte est celle de Jean Céard : Pontus de Tyard, Œuvres complètes, dir. Eva Kushner, Le Premier Curieux, t. IV, 1, éd. Jean Céard, Paris, Classiques Garnier, 2010.
3 Pontus de Tyard, Le Premier Curieux, op. cit., p. 151.
4 Les Douze fables de Fleuves ou Fontaines, Avec la Description pour la Peinture et les Epigrammes sont composées vers 1555. La publication quant à elle est plus tardive : elles paraissent chez Jean Richer en 1585 et 1586. Nous utiliserons pour ce travail l’édition de Gisèle Mathieu-Castellani, Douze fables de fleuves ou fontaines, dans Pontus de Tyard, Œuvres complètes, dir. Eva Kushner, Œuvres poétiques, t. I, Paris, Honoré Champion, 2004.
5 Dictionnaire historique de la langue française, dir. Alain Rey, Paris, Le Robert, t. 1, 2019, p. 1441.
6 Nous ignorons toujours si les tableaux furent réalisés : « il ne nous est malheureusement rien resté des peintures du château d’Anet. Il n’existe pas non plus à notre connaissance de documents les signalant ou les décrivant. », Heidi Marek, Le Mythe antique dans l’œuvre de Pontus de Tyard, Paris, Honoré Champion, « Bibliothèque littéraire de la Renaissance », LXV, 2006, p. 258.
7 Pour la désignation des pièces, nous adoptons le système suivant : les lettres F renvoient à la fable, D à la description et E à l’épigramme. Elles sont suivies du numéro du triptyque auquel elles appartiennent (de 1 à 12).
8 Pontus de Tyard, Le Premier Curieux, op. cit., p. 151.
9 Ibid., p. 153.
10 Ibid., p. 150-151.
11 Ibid., p. 151.
12 Ibid., p. 150.
13 Ibid., p. 151.
14 Ibid., p. 152.
15 Même s’il est établi que Pontus de Tyard ait connaissance des théories de Pythagore (Frédéric de Buzon a montré à quel point il dialoguait avec lui dans le Solitaire second, voir Frédéric de Buzon, « Pontus de Tyard et le calcul des modes », dans Pontus de Tyard, poète, philosophe, théologien, dir. Sylvianne Bokdam, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », no 206, Série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne », no 31, p. 185-186.), il semblerait qu’il emprunte plus précisément cette idée commune de métamorphose fluviale à Ovide, qui rapporte la pensée pythagoricienne à ce sujet dans le livre XV des Métamorphoses, ouvrage présent dans la bibliothèque de Tyard (François Roudaut, La Bibliothèque de Pontus de Tyard, Paris, Honoré Champion, « Études et essais sur la Renaissance », no LXXIX, 2008, p. 407). Ovide apparaît en effet comme une source pour la partie fluviale du Premier Curieux, car elle est fortement influencée par Sénèque qui cite lui-même le livre XV d’Ovide dans ses Questions naturelles, largement reprises par Tyard à cet endroit du dialogue (voir l’identification des sources par Jean Céard [éd.], Le Premier Curieux, op. cit., p. 254-256.).
16 On retrouve en effet cette notion classique chez Aristote dans le De Mundo, chap. IV, ouvrage « tout à fait familier aux lecteurs du xvie siècle » (Le Premier Curieux, éd. Jean Céard, op. cit., p. 10) mais surtout source première pour Tyard : « il n’est pas difficile de voir que le De mundo est une sorte de canevas du Premier Curieux » (Ibid., p. 12). Concernant la partie sur les eaux et les fleuves, Tyard reprend également les Meteorologica d’Aristote, traduites en latin par Lefèvre d’Étaples et commentées par Jean Cochlaeus (Meteorologica Aristotelis […], Norimbergae, F. Peypuss, 1512) : « Ce commentaire fournit une foule d’informations dont le Premier Curieux fait un abondant usage, en même temps qu’il mobilise une vaste bibliothèque, où, évidemment, les Questions naturelles de Sénèque ont une large place : Aristote et Sénèque, en matière de météorologie, restent les deux grandes autorités » (Le Premier Curieux, éd. Jean Céard, op. cit., p. 38). L’examen des sources utilisées dans la partie du Premier Curieux concernant les fleuves révèle bien la primauté de l’intertexte aristotélicien passé par le filtre de la paraphrase de Lefèvre d’Étaples puis de Jean Cochlaeus (voir ibid., p. 254-256).
17 Jean-Claude Moisan rappelle « la vogue incontestable dont cette œuvre a joui tout au long du xvie siècle et qui s’est traduite par une quantité impressionnante de rééditions latines des Métamorphoses, glosées ou non. Avant la traduction de Marot des deux premiers livres des Métamorphoses (1534 puis 1543), « avaient paru en français la Bible des poètes (1484) et le Grand Olympe (1532). Après lui paraîtront les traductions d’Aneau et de François Habert, sans compter une vogue semblable chez les Italiens. », dans Les Trois premiers livres de la Métamorphose d’Ovide, éd. Jean-Claude Moisan, Paris, Classiques Garnier, « Textes de la Renaissance », no 14, « Introduction », p. XCIX.
18 Ovide, Les Métamorphoses, texte établi et traduit par Georges Lafaye, revu et corrigé par Jacqueline Fabre-Serris, Paris, Les Belles Lettres, t. 1, Livres I-V, 2002 [8e édition revue et corrigée], Livre I, v. 454-567, p. 23-27.
19 Ibid., v. 567-746, p. 27-33.
20 Tous les récits mettent en avant une métamorphose corporelle à l’exception de la deuxième fable dans laquelle Silène, qui tombe à l’eau à cause de la précipitation de son âne, n’est pas véritablement transformé. Toutefois, c’est bien par contact avec l’eau et par le biais de Bacchus que le corps du satyre enivré transmet sa principale caractéristique au fleuve dont les eaux seront désormais « vineuse[s] » [E. 2, v. 13].
21 Ovide, Les Métamorphoses, op. cit., t. 1, Livre III, v. 308-312, p. 79.
22 Ibid., t. 3, Livre XV, v. 322-333 : « Clitorio quicumque sitim de fonte leuauit / Vina fugit gaudetque meris abstemius undis », « Quiconque a apaisé sa soif à la fontaine de Clitorium prend le vin en horreur ; il s’en abstient pour toujours », p. 131 et Pline, Histoire naturelle, Livre XXXI, 2 : « Vinum taedio venire his qui ex Clitorio lacu biberint », cité par Jean Céard, op. cit., note 479, p. 257.
23 Gisèle Mathieu-Castellani (éd.), Douze fables de fleuves ou fontaines, dans Pontus de Tyard, Œuvres complètes, dir. Eva Kushner, t. I, op. cit., p. 609, note 5.
24 Ibid., p. 627, note 95.
25 Pseudo-Plutarque, Nommer le monde. Origines des noms de fleuves, de montagnes et de ce qui s’y trouve, éd. Charles Delattre, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, « Mythographies », 2011, p. 213.
26 Ibid., p. 223.
27 Charles Delattre, « Introduction », Nommer le monde [Pseudo-Plutarque], op. cit., p. 44 : « L’éponymie […] vise à donner non seulement une origine aux choses, mais une explication aux noms propres, et plus particulièrement un sens : les noms propres sont le reflet direct d’une anecdote ou d’une caractéristique, ils sont à la fois la conséquence et un souvenir. »
28 Gisèle Mathieu-Castellani (éd.), Douze fables de fleuves ou fontaines, dans Pontus de Tyard, Œuvres complètes, dir. Eva Kushner, t. I, op. cit., Introduction, p. 590.
29 Pontus de Tyard, Le Premier Curieux, op. cit., p. 145.
30 Ibid., p. 150.
31 Ibid., p. 151.
32 Les titres des fables sont tous composés de la même manière : place de la fable dans le recueil (groupe nominal : « Cinquième fable »), nouveau nom du fleuve (première expansion nominale par le biais d’un complément du nom : « du Fleuve Phasis »), nouvelle propriété merveilleuse à l’issue de la métamorphose (seconde expansion nominale sous la forme d’une proposition subordonnée relative : « qui asseure les jaloux »).
33 Gisèle Mathieu-Castellani (éd.), Douze fables de fleuves ou fontaines, dans Pontus de Tyard, Œuvres complètes, dir. Eva Kushner, t. I, op. cit., Introduction, p. 600.
34 Eva Kushner, Pontus de Tyard et son œuvre poétique, Paris, Champion, « Bibliothèque littéraire de la Renaissance », Série 3, t. XLIX, 2001, p. 318.
35 Ibid., p. 320.
36 Ovide, Les Métamorphoses, op. cit., t. 3, XV, v. 178-180 : « Cuncta fluunt omnisque uagans formatur imago. / Ipsa quoque assiduo labuntur tempora motu, / Non secus ac flumen ; neque enim consistere flumen », p. 126-127.
37 Pontus de Tyard, Le Premier Curieux, op. cit., p. 151.
38 Il mentionne le fleuve des Cicones, un Styx en Arcadie, le Surie, un fleuve en Silare, le fleuve Astace, un fleuve à Dodone, un surgeon d’eau et une fontaine en Sicile, le fleuve Sabbatique de Syrie, Cephisse et Mélas en Béotie, un fleuve de Cappadoce, une fontaine d’or des Indes, un fleuve qui épaissit ce que l’on ingurgite, le Lynceste, le Lac Clitorie, une fontaine en l’Isle de Cee, le Léthé en Béotie, deux fontaines dans les îles Canaries.
39 Sur l’idée de nature et des savoirs à la Renaissance, on pourra consulter avec profit les travaux de Jean Céard : Jean Céard, La Nature et les Prodiges [1re édition, 1977], Genève, Droz, 2008 ; Jean Céard, « L’idée d’encyclopédie à la Renaissance », dans L’Encyclopédisme, Actes du colloque de Caen, 12-16 janvier 1987, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1990, p. 57-67.
40 Ibid., p. 152-153.
41 On remarquera tout de même que les sources évoquées dans le Premier Curieux réfèrent à certains ouvrages plus scientifiques (les Questions naturelles de Sénèque, le De Bello Judaïco de Flavius Josephe, l’Histoire naturelle de Pline) alors que les Douze Fables convoquent quant à elles Homère et Ovide.
42 Ibid., p. 153 : « D’autres qui enyvrent, comme celles de Lynceste : et d’autres qui desenyvrent, voire laissent un contrecoeur de vin à ceux qui s’en lavent ou abreuvent, comme l’on lit du Lac Clitorie ».
43 Seule la deuxième fable fait exception : il n’y est pas question d’amour, à l’exception peut-être de celui de Silène pour le vin.
44 Eva Kushner, Pontus de Tyard et son œuvre poétique, op. cit., p. 324.
45 La structure de l’opuscule a clairement été mise en évidence dans un tableau conçu par Heidi Marek, op. cit., p. 272-273.
46 Voir Heidi Marek, « Narcisse et Salmacis. Le thème de l’unité et de la diversité dans Les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard », dans Sources et fontaines du Moyen Âge à l’Âge baroque, Actes du Colloque tenu à l’Université Paul Valéry (Montpellier III) les 28, 29 et 30 novembre 1996, Paris, Champion, « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance », XII, 1998, p. 285-301.
47 Eva Kushner, Pontus de Tyard et son œuvre poétique, op. cit., p. 318.
48 Cette liberté donnée au peintre s’avère assez limitée, seul le choix de la partie du corps à transformer lui revient alors que toute la composition d’ensemble est dirigée par le poète, qui va jusqu’à mentionner le nom du dieu qu’il faudra représenter sur l’autel.
49 Françoise Charpentier, « L’espace épique du Microcosme de Scève », dans Plaisir de l’épopée, dir. Gisèle Mathieu-Castellani, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, « Créations européennes », 2000, p. 86.
50 Gisèle Mathieu-Castellani (dir.), Plaisir de l’épopée, op. cit., p. 600.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2025.html.
Quelques mots à propos de : Adélaïde Guillou
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
