Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
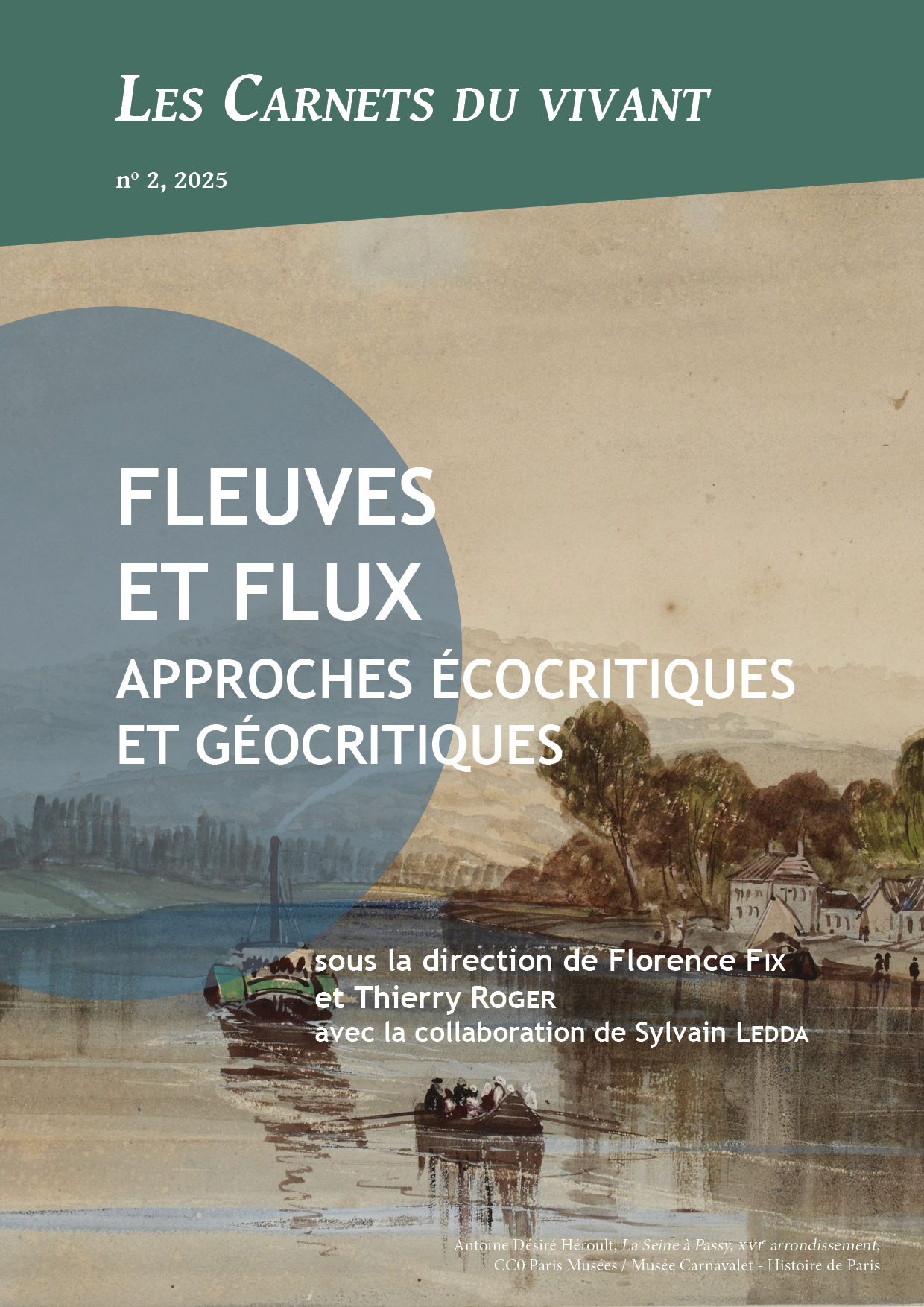
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Sylvain Ledda
1L’histoire des fleuves est celle des hommes. Le récit fluvial témoigne de choix cruciaux qui ont façonné notre histoire et notre imaginaire communs. Sa présence dans les paysages traversés nous rappelle que notre interdépendance avec l’élément fluvial est forte, que la vie et la mort des hommes entrent en résonance avec celui qui irrigue nos paysages, nos villes et nos campagnes. Se pencher sur les eaux des fleuves, c’est se tourner vers le miroir de nos pratiques, de notre vie collective ou individuelle. Comme en témoignent les articles de ce volume, le fleuve offre à notre réflexion une tentative spéculaire, en laquelle nous pouvons lire nos peurs, nos fascinations, voire notre rapport intime, politique, poétique à l’environnement.
2De nombreux travaux d’anthropologie ont démontré et démontrent avec vigueur que la domestication ou l’aménagement des fleuves correspondent à des moments charnières de notre civilisation – l’essai de Gérard Chabenat, L’aménagement fluvial et la mémoire1 décrit ainsi comment s’organise la vie des hommes à partir de l’appropriation technique du Rhône. Ces reconfigurations ne sont pas tout uniment pragmatiques. Façonner le fleuve, c’est penser son rapport à l’homme. Le beau livre d’Isabelle Backouche, La trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850)2 témoigne également de cet étroit dialogue entre l’univers fluvial, l’histoire et la littérature. L’enquête de l’historienne met en lumière la diversité des rôles du fleuve dans la ville du xviiie au xxie siècle. Elle explique que la Seine a été de longue date un creuset de vie, une zone d’échange économique aux évidents enjeux politiques. Les fleuves français navigables accompagnent l’évolution vers l’émancipation des populations. Cependant, comme le montre Isabelle Backouche, de la ville ancienne à la ville contemporaine, les fleuves avancent dans le temps de manière bien différente des rythmes de l’urbanisation. Tout à la fois espace partagé et espace mouvant en ses berges comme en son centre, le fleuve joue un rôle déterminant dans la vie urbaine et humaine, partant dans la création littéraire et artistique. Vivre avec le fleuve, c’est en tirer les ressources économiques et poétiques. Le fleuve suit son rythme, aussi bien dans la réalité que dans l’imagination.
3Proche des hommes, souvent nourricier, le fleuve entretient aussi des liens étroits avec la mort, et il convient peut-être de refermer le livre du fleuve sur quelques tombeaux. L’imaginaire du Styx, de l’Achéron ou du Léthé traverse les âges. Si certains parviennent à traverser « deux fois vainqueur l’Achéron » grâce à la force de la poésie, d’autres subissent plus concrètement les méandres des fleuves, qui bien souvent charrient des cadavres. Au xviiie siècle, par exemple, en Seine-Maritime, la noyade est la première cause de mort accidentelle – en témoigne l’étude conduite par Jean-Pierre Derouard3 sur vingt-sept communes autour de Rouen. Elle est liée le plus souvent aux activités fluviales, aux baigneurs imprudents ou aux enfants mal surveillés. En temps de crise, les eaux des fleuves rougissent. On se souviendra ici que les fleuves peuvent devenir de vastes cimetières : durant la Saint-Barthélemy, la Seine charrie le corps des protestants massacrés ; certains épisodes de la Terreur voient aussi la Seine se transformer en charnier. Deux images de fleuves ensanglantés ont fortement marqué Victor Hugo et Alexandre Dumas dans leurs romans respectifs, Quatrevingt-treize et Les Blancs et les Bleus. En pleine guerre de Vendée, à l’automne 1793, le terrible Jean-Baptiste Carrier, missionné par la Convention, réunit les prisonniers royalistes, opposés au nouveau régime et les fait jeter dans la Loire, où ils se noient par milliers. Forcés de se dévêtir et d’embarquer, ils sont contraints de se jeter à l’eau au milieu du fleuve. Rares sont ceux qui savent nager, et quand ils tentent de s’échapper, ils sont frappés à coups de rame ou de bâtons. Rares seront ceux qui réchapperont de ce massacre. Le nombre de victimes est estimé à 4 000 entre décembre 1793 et février 1794. Carrier sera guillotiné à Paris le 16 décembre 1794. Un autre épisode le plus connu est celui de La Roche-de-Mûrs, où, le 26 juillet 1793, des soldats furent acculés à la falaise et précipités dans la Loire. Le nombre des morts a été, par certains, évalué à 600.
4Mourir dans un fleuve constitue dans l’imaginaire occidental une horreur supplémentaire à la mort. Ce fait anthropologique alluvionne les imaginaires littéraires. Quand l’eau se transforme en cimetière se pose un problème qui a trait au devenir des corps. Eh quoi, pas même un tombeau, soupire Philippe Strozzi quand il apprend que le corps de Lorenzaccio a été jeté – non pas dans un fleuve, mais dans la lagune ; c’est encore la formule terrible de Maupassant, sans doute l’écrivain qui a le mieux décrit la dimension mortifère de la Seine, à propos de quoi il écrit : « c’est en effet le plus sinistre des cimetières celui où l’on n’a point de tombeau. » (Sur l’eau). Quant au narrateur du Horla, il « passe [s]es journées à regarder la Seine », en une fascination morbide et prémonitoire.
5L’imaginaire funèbre du fleuve a construit une fable poétique au début du xxe siècle, celle de l’Inconnue de la Seine. En 1902, une inconnue est repêchée dans la Seine. À la morgue, le légiste est frappé par la beauté de la jeune femme et ordonne qu’on fasse un moulage de son visage. Le masque impavide de cette jeune morte a fasciné des générations, qui ont associé un visage tout de tendresse à la mort fluviale. Cet épisode marque à ce point les contemporains qu’on le retrouve dans de nombreux textes littéraires, notamment dans les très mélancoliques Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rilke : « Le mouleur que je visite chaque jour a deux masques accrochés près de sa porte. Le visage de la jeune qui s’est noyée, que quelqu’un a copié à la morgue parce qu’il était beau, parce qu’il souriait toujours, parce que son sourire était si trompeur ; comme s’il savait4. » Dans Aurélien d’Aragon, l’inconnue joue encore un rôle déterminant et poétique. Aurélien possède chez lui le masque de l’inconnue, qu’il confond avec le visage de Bérénice, la femme dont il tombe amoureux ; la même femme lui fera don plus tard d’un autre masque, réalisé à partir de son propre visage. De nombreux exemples littéraires associent le fleuve à la beauté d’outre-tombe d’une jeune morte, comme si les eaux fluviales avaient recouvré la fonction sacrée d’immortalité que leur prêtaient les Anciens.
6En regardant les fleuves, on voit le temps humain qui défile. Nul mieux qu’Apollinaire a su dire le rythme des douleurs de la vie à l’aune du débit inlassable du fleuve, faisant de lui et à jamais le poète de la Seine :
Et la nuit de septembre s’achevait lentement
Les feux rouges des ponts s’éteignaient dans la Seine
Les étoiles mouraient le jour naissait à peine5.
1 Paris, L’Harmattan, 1996.
2 Paris, Éditions de l’EHESS, 2000.
3 « La noyade en Seine au xviiie siècle dans 27 paroisses riveraines de la Seine-Maritime », « Faits de société. Inventaires et corpus », Annales de Normandie, 37ᵉ année, no 4, 1987, p. 297-313.
4 Rainer Maria Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (1910), traduction, préface et notes de Claude David, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1991, p. 91.
5 « Vendémiaire », Alcools, éd. Michel Decaudin et Marcel Adéma, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1956, p. 152.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2045.html.
Quelques mots à propos de : Sylvain Ledda
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
