Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
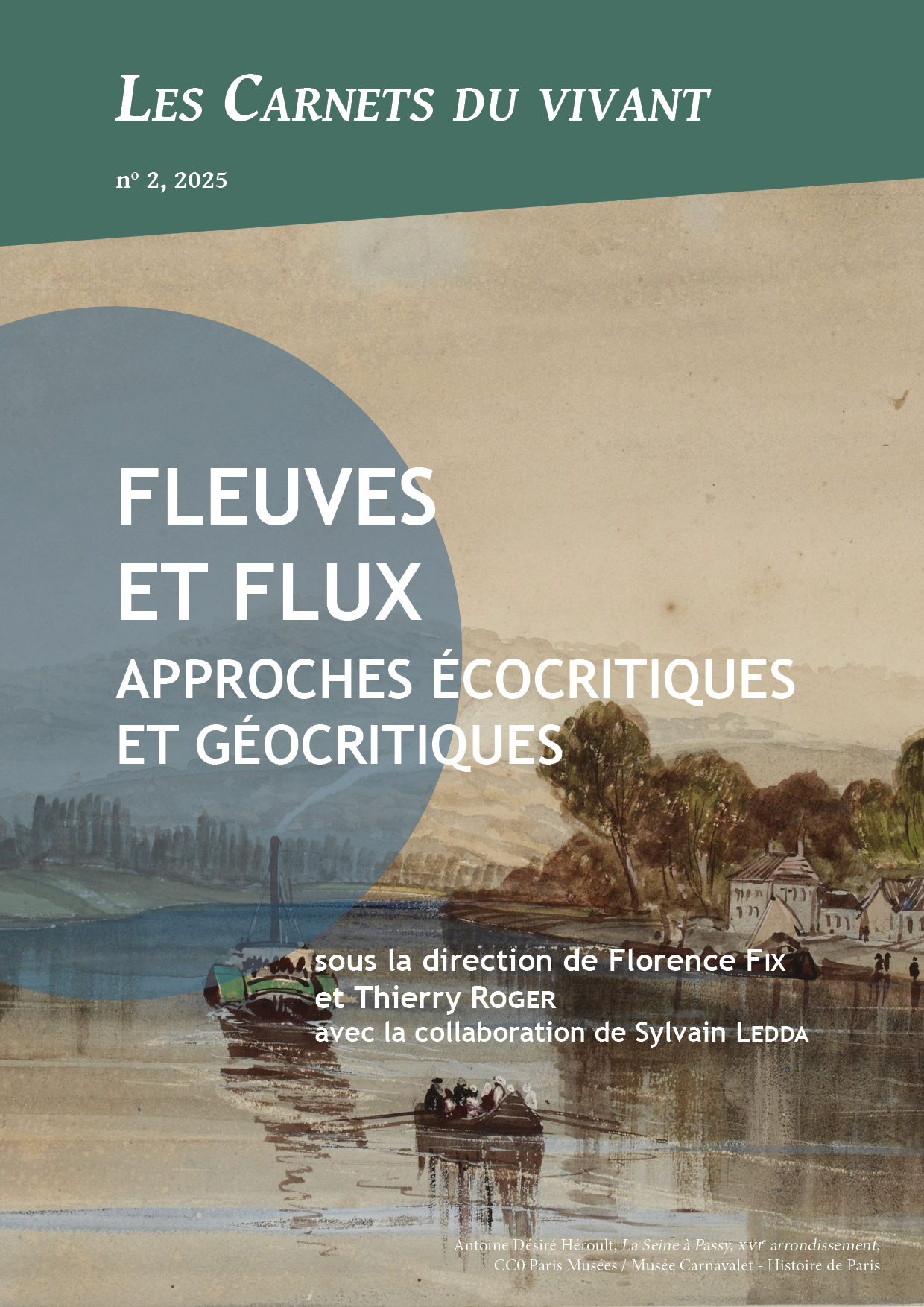
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
Tristan Guiot
1
Au milieu des fougères, des bruyères, des cyclamens, les pieds de leurs chevaux battent sourdement la mesure en silence. Pourquoi envahit-il tout comme un océan, ce silence des forêts kroumires ? Il est pourtant peuplé de multiples bruits et de milliers d’existences cachées. Des bédouins, des gibiers, des sources, des écorces qui craquent, il y a de tout cela parmi le moutonnement foncé des chênes, ces chênes de toutes les races, depuis les zéens jusqu’aux lièges, verdure frisée qui couvre les petites montagnes et leurs harmonieuses vallées1.
2Parmi d’autres, un passage introduisant La Monnaie de singe, roman publié par Lucie Delarue-Mardrus2 en 1912, illustre l’importance du vivant dans l’œuvre de la poète. À partir de ce constat, cette réflexion propose, sous la forme d’une promenade parmi plusieurs poèmes parus dans deux de ses premiers recueils – Ferveurs, publié en 1902, et Horizons, paru en 1904 –, d’interroger les significations qu’y recouvrent les images du fleuve en nous appuyant sur la critique de l’imaginaire afin d’y considérer la possibilité d’une interprétation écocritique de ces œuvres.
L’imaginaire du fleuve dans les poèmes de Lucie Delarue-Mardrus
3En premier lieu, il convient de noter que le fleuve apparaît comme une image de l’adoucissement dans son œuvre, confirmant les analyses de Gaston Bachelard et de Gilbert Durand sur l’imaginaire de l’eau douce.
Le fleuve : une image de l’adoucissement
4En effet, Gaston Bachelard souligne que l’eau détient « toutes les qualités adoucissantes », lesquelles s’articulent en particulier autour des métaphores qui relient l’eau à « la douceur » et à la « fraîcheur3 ». Cette analyse conduit le philosophe à décréter la suprématie de l’eau douce sur l’eau salée. Il nous offre alors un élément de réflexion permettant d’envisager plus particulièrement le fleuve. Gaston Bachelard dit ainsi :
C’est une perversion qui a salé les mers. Le sel entrave une rêverie, la rêverie de la douceur, une des rêveries les plus matérielles et les plus naturelles qui soient. La rêverie naturelle gardera toujours un privilège à l’eau douce, à l’eau qui rafraîchit, à l’eau qui désaltère4.
5À la suite du philosophe, Gilbert Durand analyse les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Dans cet ouvrage, l’auteur décrit un archétype dans lequel « viennent se condenser les intentions purificatrices », celui de « la limpidité de l’eau lustrale ». Gilbert Durand souligne que c’est la « limpidité antithétique » qui « jou[e] un rôle purificateur ». En ce sens, l’eau lustrale a « une valeur morale », elle « devient la substance même de la pureté », ce que redouble sensoriellement sa « fraîcheur5 ».
6Ainsi, les réflexions de Gaston Bachelard et de Gilbert Durand sur l’eau douce soulignent que cet adjectif prend tout son sens dans le cadre d’un travail sur l’imaginaire. De nombreux exemples peuvent être convoqués pour illustrer l’importance du schème de l’adoucissement par l’eau, nous n’en présentons qu’un seul puisque c’est un trait assez commun de l’imaginaire de l’eau que l’on retrouve dans ce poème de Lucie-Delarue-Mardrus, « L’échange ». La dernière strophe offre en effet l’image d’un fleuve qui apaise :
Et sans doute qu’un peu de forte dureté
Me viendra de ton âme impétueuse et neuve,
Et que tes durs instincts s’apaiseront au fleuve
De ma mélancolique et grave aménité6…
7Ici, le fleuve est une métaphore qui traduit le mouvement d’apaisement que produit la mélancolie du « je » lyrique, au cœur « gonflé d’expérience » (v. 1), vis-à-vis des « durs instincts » (v. 15) de l’allocutaire qui n’a « pas connu l’horreur de la souffrance » (v. 4). Ainsi, en plus de s’appuyer sur les « qualités adoucissantes7 » de l’eau afin de traduire un mouvement, dans la communion poétique des deux figures, qui fait évoluer leurs affects particuliers, le poème colore l’image du « fleuve » d’un motif temporel. L’impétuosité de la figure de l’allocutaire (évoquée au vers 14), associée à « un petit enfant » (v. 3), suscite alors l’image des eaux violentes à laquelle s’oppose celle du « fleuve » apaisant (v. 15) de la figure du « je » lyrique, « vieille comme une mère » (v. 6). En mobilisant des schèmes affectifs, relationnels et familiaux, ces images redoublent ainsi les qualités « adoucissantes » du fleuve en suggérant la continuité entre la vie affective et la vie aquatique. Cette métaphore du « fleuve » montre que les poèmes de Lucie Delarue-Mardrus intègrent bien l’adoucissement constitutif de l’imaginaire de l’eau douce analysé par Gaston Bachelard et Gilbert Durand. Ce premier point permet d’analyser la place d’un fleuve en particulier, la « Seine », dans l’œuvre de la poète.
La Seine : un fleuve au confluent de Paris et de la Normandie
8En effet, les qualités adoucissantes et lustrales de l’eau douce suscitent des images antithétiques, qui remplissent une fonction stratégique – ou « topologique8 » pour reprendre le mot de Jean-Pierre Richard – dans les poèmes de Lucie Delarue-Mardrus : celle d’opposer la ville et la campagne, Paris et la Normandie. Alors le Fleuve se particularise : c’est la Seine qui apparaît dans le poème « Les chalands », eux qui circulent, comme la poète, entre Paris et la Normandie :
À Ch. Th. Féret.
Aux tournants troubles de la Seine, mes chalands
Avec leurs mariniers blonds et roux à l’arrière,
Défilent sous mes yeux, à la remorque, lents,
Un pot de fleurs à leurs fenêtres batelières.
J’aime les regarder, bien chargés, bien fournis.
Ils sont assis sur leur reflet quand ils s’arrêtent,
Et l’eau douce vient caresser comme une bête
Et faire respirer leurs beaux ventres vernis.
La Seine de Paris sans verdure et sans grève,
Je voudrais la quitter pour m’en aller comme eux,
— Passant au fil de l’eau par Rouen et la Hève, —
Regagner l’estuaire avec son cap brumeux.
Car ils vont jusqu’au bout de ma Seine normande,
Et moi, certains soirs lourds ou certains matins clairs,
Je sens, rien qu’à les voir, que mon âme demande
Quelque chose… Et je suis en peine de la mer9.
9Ce poème est dédié à Charles-Théophile Féret (1858-1928), poète né à Sotteville-lès-Rouen qui fonde la « Société des écrivains normands » en 1923 au « Pavillon de la Reine ». L’Association perdure aujourd’hui et décernait encore en 2023 le « Prix Louis Bouilhet ».
10Dans ces vers, les « chalands » passant sur la « Seine » suscitent une rêverie du retour à la Normandie, à la campagne, qui s’appuie sur un rejet de « La Seine de Paris » et de la ville. En ce sens, la métaphore animalière de « l’eau douce » qui « vient caresser comme une bête » les « beaux ventres vernis » des chalands, faisant suite à celles des mariniers « assis sur leur reflet », s’inscrit dans le « Régime Nocturne de l’image10 » considéré par Gilbert Durand et produit une euphémisation. En effet, le philosophe rappelle que « le contenant prototype c’est le ventre digestif, avant que d’être sexuel11 ». Dans cette perspective, alors que le « symbole animal serait la figure de la libido sexuelle12 » d’après les développements de Jung dans Métamorphoses et symboles de la libido, le renversement de la figure caressant – ici la bête caresse le ventre du vaisseau – semble construire une image de la Seine marquée par l’intimité et la descente qui souligne le réconfort des symboles de la digestion et de la sexualité, confirmant l’analyse de Roland Barthes :
Le bateau peut bien être symbole de départ ; il est plus profondément chiffre de la clôture. Le goût du navire est toujours joie de s’enfermer parfaitement […]. De disposer d’un espace absolument fini : aimer les navires c’est d’abord aimer une maison superlative, parce que close sans rémission, et nullement les grands départs vagues : le navire est un fait d’habitat avant d’être un moyen de transport13.
11Cette rêverie de l’intimité suscitée par « Les chalands » traversant la Seine pour se rendre dans la Normandie natale suscite alors l’image rejetée : celle de « La Seine de Paris sans verdure et sans grève ». C’est toute une rêverie du retour au pays natal qui se déploie ensuite à partir de l’image du voyage fluvial. Le poème énumère les lieux rêvés « Rouen et la Hève », « l’estuaire avec son cap brumeux », et « ma Seine normande » – le déterminant possessif soulignant là encore l’intimité des images. Le fleuve permet alors de révéler à la figure du sujet lyrique l’intimité de son « âme », qui se trouve « en peine de la mer ». En ce sens, dans les poèmes de Lucie Delarue-Mardrus, les images du fleuve et plus particulièrement celles de la Seine s’inscrivent dans une opposition plus vaste entre la campagne normande natale, située du côté de la douceur et de l’intimité, et la ville parisienne qui semble au contraire rejetée.
12La Seine est encore au cœur de cette opposition entre Paris et la Normandie dans le poème « Essai » :
Nous irons sur le bord des eaux
D’avant Paris, claires et belles.
Nous aurons par les prés l’âme des bestiaux,
Leur bon regard dans les prunelles.
Et nous serons aussi contents
Devant l’ampleur des lignes naturelles
De la Seine qui tourne autour de ses coteaux,
Que de voir de tout près, bercé dans le beau temps,
Un bourdon roux sur une ombelle.
Ainsi, nous irons lentement et loin
Selon le trèfle, le sainfoin,
La belladone et la marguerite champêtre,
Cueillant de beaux bouquets, et roses de bien-être.
Et sans doute oublierons-nous un peu
À la longue, au bout de cette herbe tranquille,
De ces beaux peupliers en file,
De cette Seine au tournant bleu,
Au bout de tant d’odeurs, au bout de tant de fleurs
Où l’heure change de couleur,
— Monstrueusement belle et proche — notre ville14 ?
13Ce poème met en lumière deux éléments centraux dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus.
14D’une part, la description de la Seine montre là encore que le fleuve suscite une rêverie du retour au pays natal : il évoque le bonheur procuré par la campagne normande. Les images animales et végétales suscitées par la Seine s’inscrivent ainsi dans un rapport de continuité avec la vie du sujet lyrique. Les « lignes naturelles » produisent la réjouissance d’une figure plurielle, « nous », qui se définit dans son identité avec les vies animales – « Nous aurons par les prés l’âme des bestiaux » – définies par la bonté – « Leur bon regard dans les prunelles » – et la simplicité – « Et nous serons aussi contents ». Le fleuve déploie les images entomologiques – « bourdon roux » – et végétales – « beaux bouquets », « tant d’odeurs », « tant de fleurs » –, avec une précision notable – « ombelle », « sainfoin », « belladone », « marguerite champêtre » –, qui souligne la connaissance de l’univers de la campagne normande de l’enfance et marque le succès de la rêverie de l’intimité. Le poème décrit la topologie de la Seine en l’associant au mouvement dans un polyptote qui associe une forme conjuguée du verbe « tourner » à une forme substantivée de participe présent – « De la Seine qui tourne autour de ses coteaux », « De cette Seine au tournant bleu » – de sorte qu’il articule le fleuve animé aux formes de vies évoquées. L’heure même s’anime selon le modèle de la métonymie puisqu’elle renvoie au ciel en étant dotée d’une « couleur » – « Où l’heure change de couleur ». Renvoyant à l’imaginaire de la campagne, cet espace, marqué par le mouvement et la vie, permet ainsi aux promeneurs d’« oubli[er] » la « ville ».
15C’est là le deuxième point que ce poème éclaire : une fois de plus, la ville est décrite de façon négative comme l’illustre l’emploi de l’adverbe « monstrueusement », mais l’usage de l’adjectif « belle » introduit néanmoins une ambivalence. Les motifs de cette ambivalence apparaissent de façon plus développée dans d’autres poèmes de Lucie Delarue-Mardrus, à l’exemple de « Berges » :
Bien souvent nous courons, le soir, les mains aux poches,
Les guinguettes sentant la terre et le poisson,
Humides de baigner leur verdure au frisson
Incolore et luisant de la Seine tout proche.
Parmi les reflets tors et les chalands déteints,
Sur des couchants barrés d’usines et de branches,
Flânent, l’un après l’autre ou se tenant les hanches,
D’imberbes souteneurs et leurs pauvres catins.
Pour nous, à notre table, au clair d’une bougie
Où deux, trois papillons viennent brûler leurs vols,
Sous un berceau, dans un jardin de tournesols,
Nous nous taisons, contents de notre maigre orgie,
De manger à la main la salade aux œufs durs,
De joindre un coup de cidre à la friture blonde,
D’être gentils, d’être tout seuls et d’être obscurs,
L’un en face de l’autre et dans l’oubli du monde15.
16Dès la première strophe, l’image des « guinguettes » de « la Seine tout proche » apparaît. Elle constitue un motif artistique pictural important pour l’école impressionniste16. Dans la deuxième strophe, les « chalands déteints » évoquent la promenade sur les berges du fleuve. L’ensemble du poème célèbre la réjouissance du « je » lyrique s’adonnant au plaisir d’une vie simple – ce qu’illustrent les images de « notre table », de « notre maigre orgie » et celles du repas qui apparaissent dans l’ultime strophe, « manger à la main la salade aux œufs durs », « joindre un coup de cidre à la friture blonde » –, qui a pour horizon « d’être gentils ».
17L’esthétisation de la banlieue s’appuie sur des images du dénuement : le préfixe privatif dans l’adjectif « déteints » souligne le caractère vétuste des « chalands » et l’adjectif « maigre » rappelle la frugalité de l’« orgie ». En cela, ce poème esquisse les éléments qui soutiendront le développement d’une critique sociopolitique que nous retrouverons. C’est dans cet ensemble que l’image « D’imberbes souteneurs » et celle, solidaire, de « leurs pauvres catins » se laissent articuler aux « deux, trois papillons » qui « viennent brûler leurs vols » « sous un berceau ». En ce sens, si les « Berges » permettent la célébration d’une vie simple, c’est parce qu’elles accueillent des travailleurs pauvres et qu’elles forment un lieu de réjouissance fréquenté par les classes populaires. Dans ce contexte, le regard porté vers l’horizon introduit des motifs qui opposent l’espace à la vie hivernale mondaine parisienne et son pendant estival, la campagne bourgeoise normande : « Sur des couchants barrés d’usines et de branches ».
18Tandis que la vie sur les « Berges » du fleuve suscite un mouvement d’« oubli du monde » – de la mondanité – et des images de l’intimité – « être tous seuls », « L’un en face de l’autre » –, l’ambivalence de la ville « monstrueusement belle » apparaît plus clairement. Si la ville et ses usines défigurent le paysage bordant la Seine, Paris est un lieu de mondanités distinct de la banlieue où l’on vient s’encanailler et goûter les plaisirs populaires. D’un point de vue sociopolitique, la ville est toutefois problématique, et c’est ce qui confine à l’ambivalence le « je » lyrique rêvant au bord de la « Seine ». Le poème « Quais » approfondit cet aspect :
Le long du fleuve étreint de pierre et de ciment
Où quelque long reflet plonge et doucement file,
Nous t’aimons et nous t’admirons sauvagement,
Vie obscure, muette et dure de la Ville !
Quand nous les regardons en loques sans couleur
Sur ce fond glacial et mouvant de la Seine,
Tes hommes sont blafards de plâtre et de pâleur
Ou sont noirs de charbon, de révolte et de peine.
Une âme unique meut toutes leurs tristes peaux ;
Leur geste abat toujours l’éternelle besogne
De ceux-là qui n’auront de joie et de repos
Qu’en la fugace horreur d’un dimanche d’ivrogne.
Leurs yeux brûlent de vie ardue et d’âpreté,
Et la misère humaine est en eux qui les mange…
— Pourtant ! Pourtant ! Nos bras s’ouvraient à la beauté
Et nous avons voulu de prodigieux Ganges !
Nous avons espéré des châteaux de bonheur !
Nous avons appelé des foules exultantes !
Nous avons trépigné de délire et d’attente
Et peuplé les tournants des désirs de nos cœurs !
Et maintenant !… les bras retombés et sans proie,
Fixes, nous contemplons votre labeur amer,
Vous l’âme désolée et la sinistre chair
Du pauvre, vous, réponse à nos espoirs de joie17…
19Dès le premier vers, l’emploi adjectival du verbe « étreint » marque la passivation du « fleuve », et l’image de l’étreinte permet de souligner l’étau « de pierre et de ciment » dans lequel la Seine a été enserrée selon une perspective ambivalente puisqu’elle appelle également le motif de l’étreinte amoureuse. Dans ce poème, une critique sociopolitique portant sur les bords du fleuve apparaît de façon plus nette : le déterminant possessif « Tes hommes » fait des travailleurs des objets dépossédés d’eux-mêmes, appartenant à la « Ville » à laquelle la figure du sujet adresse ces vers. Ces hommes sont décrits à travers les matières qui les recouvrent – le « plâtre » et le « charbon » –, comme le ciment les bords du fleuve. Cependant, là encore, à ces matières s’articulent d’autres éléments, la « pâleur », indice d’une émotion ou d’un état de santé, et des états affectifs : la « révolte » et la « peine ». À travers ce procédé, la poète semble dessiner une continuité presque matérielle entre les conditions physiques du travail réalisé par ces hommes et les états intérieurs de ces derniers. Mues par « une âme unique », les figures des travailleurs apparaissent ainsi comme une entité unique définie par un statut social. La troisième strophe insiste sur « leur geste » qui « abat toujours l’éternelle besogne », et souligne « la fugace horreur d’un dimanche d’ivrogne » qui se trouve être leur seul « joie » et leur seul « repos » – allusion à une organisation du travail qui oppose la semaine à l’usine et le dimanche à la guinguette. On voit combien le « je » lyrique fait de la figure du travailleur une entité promise à un sort pathétique, celui de « la misère humaine ». Ceci est renforcé par le fait que la poète suggère qu’une fatalité pèse sur ces hommes, ce qu’indiquent l’adverbe « toujours » et l’adjectif « éternelle ». Le vers semi-ternaire final intègre un rejet externe – « la sinistre chair / Du pauvre, vous, réponse à nos espoirs de joie… » – qui met en valeur la figure du misérable. Les deux derniers vers évoquent sa condition physique et mobilisent le motif de la mort – « sinistre chair ». Cette description pathétique et cette critique sociopolitique tiennent peut-être à des sympathies politiques de l’autrice qui écrit pour La Revue blanche et fréquente alors des figures contestataires et anarchistes18.
20L’image du Gange évoque alors le rêve orientaliste – particulièrement important dans l’œuvre de Lucie Delarue-Mardrus et la réception de celle-ci19 – face auquel se dresse l’image douloureuse du « pauvre », et qui s’oppose au cauchemar de la vie industrielle européenne. Les formules anaphoriques des vers 17 à 19 soulignent la responsabilité de la communauté à travers l’emploi du pronom personnel « Nous ». Face aux espoirs, aux « désirs de nos cœurs », la réalité du « labeur amer » apparaît au « je » lyrique comme un motif de désenchantement, une « réponse à nos espoirs de joie… ».
21En ce sens, ces quelques poèmes permettent de saisir les enjeux de l’imaginaire de la Seine de Lucie Delarue-Mardrus. Tout en permettant d’opposer et de relier Paris à la campagne normande natale – et donc, par la même occasion, les âges de la vie de la poète –, le fleuve évoque l’ambivalence des différents paysages marqués par la redistribution industrielle : Paris, lieu de la mondanité ; la banlieue, espace populaire de la simplicité ; et la campagne normande, berceau d’une rêverie de l’intimité.
22Dans cet ensemble, l’image des « couchants barrés d’usines et de branches » suggère toutefois l’importance du motif de l’industrialisation dans les images du fleuve développées dans les poèmes de Lucie Delarue-Mardrus. À ce titre, la réflexion sur l’imaginaire du fleuve de la poète invite à considérer la façon dont l’œuvre poétique de Lucie Delarue-Mardrus introduit et développe ces images susceptibles de renvoyer à la pollution.
Imaginaire du fleuve et images de la pollution dans l’œuvre poétique de Lucie Delarue-Mardrus
23Si plusieurs poèmes de Lucie Delarue-Mardrus évoquant la Seine développent une critique sociopolitique qui confronte deux réalités sociales et géographiques – celle du bourgeois et celle du prolétaire –, certains d’entre eux, considérant le fleuve, rendent sensible l’évolution des paysages causée par l’activité humaine, à l’image d’« Encore les berges » :
Les maisons avec leur secret frisson
D’existence interne et savante,
Les jardins ordonnés que l’été calme évente,
La blanche vie à l’unisson,
Cela ! ce bonheur tranquillement le nôtre,
Nous le lâchons par les beaux soirs,
Las du luxe, saisis du soudain désespoir
D’être à bout de tout, l’un et l’autre.
Les maisons avec leur secret frisson,
Nous les fermons pour cette berge
Qui sent bon et mauvais le foin et le poisson,
Et dont plus d’un feu rouge émerge.
La Seine nous suit d’un laiteux détour
Quand nous marchons vers la guinguette ;
Assise sur l’eau douce et blanche, se reflète
L’île noire de Billancourt.
Et c’est l’aventure humide et vineuse
Que secrètent l’usine et l’eau,
La populace forte et louche, gueulant haut,
Les poings à ses hanches de gueuse.
La misère, ici, remplace l’ennui.
— Perdus dans cette vie éparse,
Nous faisons un repas de friture et de nuit
Comme un rôdeur avec sa garce20.
24Dans les deux premières strophes, la figure du locuteur exprime une lassitude à l’égard du « luxe » et un désir de quitter provisoirement la vie bourgeoise, évoquée à travers les images des « maisons » et des « jardins ordonnés ». Le quatrième vers nomme ainsi cette existence en lui associant une couleur : « La blanche vie à l’unisson ».
25À cette vie s’oppose celle de la « berge » « dont plus d’un feu rouge émerge », dans la troisième strophe. La reprise du premier vers au début de la troisième strophe souligne l’antithèse. Mais l’évocation des couleurs détermine également une opposition du blanc et du rouge importante dans l’œuvre poétique de Lucie Delarue-Mardrus. Dès la quatrième strophe, la Seine offre à nouveau l’image de la blancheur, elle suit le « je » lyrique « d’un laiteux détour », et l’énonciatrice s’assoit « sur l’eau douce et blanche ». Là encore, nous trouvons un phénomène d’inversion qui permet d’animer la Seine : c’est le fleuve qui suit le « je » et non l’inverse. Or comme le rappelle Gilbert Durand, « l’aliment primordial, l’archétype alimentaire, c’est bien le lait21 » et « l’image du lait est le symbole même de l’union substantielle22 ».
26Enfin, dans un troisième temps, une dernière couleur fait son apparition à travers l’image de « l’île noire de Billancourt ». Ainsi, ce poème oppose un fleuve blanc et laiteux, doux, réalisant l’union et permettant de jouir de l’intimité à une eau rouge et noire, qui suggère des éléments bien différents. D’une part, le rouge suggère la prostitution23, image sur laquelle se clôt le poème – « Comme un rôdeur avec sa garce » – ; qui renvoie à des considérations sociopolitiques sur les « berges ». D’autre part, l’association du rouge et du noir24 rappelle l’analyse de Gilbert Durand qui signale que l’« eau noire n’est finalement que le sang, que le mystère du sang qui fuit dans les veines ou s’échappe avec la vie par la blessure25 ». On peut alors reconnaître que ce poème est marqué par un « isomorphisme terrifiant, à dominante féminoïde, qui définit la poétique du sang, poétique du drame et des maléfices ténébreux26 ». En ce sens, « Encore les berges » oppose la « blanche vie à l’unisson » et le « laiteux détour » de la Seine à la berge au « feu rouge » où l’on aperçoit « l’île noire ».
27Dans la quatrième strophe, le poème présente alors ce qui pourrait s’apparenter à une rêverie de la souillure. L’image de « l’aventure humide et vineuse » sécrétée par « l’usine et l’eau » évoque « l’eau impure » dont Gaston Bachelard rappelait le sens :
L’eau impure, pour l’inconscient, est un réceptacle du mal, un réceptacle ouvert à tous les maux, c’est une substance du mal. Aussi, on pourra charger l’eau mauvaise d’une somme indéfinie de maléfices. On pourra la maléficier ; c’est-à-dire, par elle, on pourra mettre le mal sous une forme active27.
28En s’appuyant sur le motif nocturne, le « repas de friture et de nuit » redouble ce procédé qui consiste à mettre le mal sous une forme active. En ce sens, ces deux dernières strophes répondent aux images de la Seine laiteuse et de « l’île noire » en soulignant la souillure du fleuve à l’eau « vineuse ». De façon métonymique, l’adjectif introduit une image qui évoque l’alcoolisme des ouvriers fréquentant la guinguette. L’impureté est rapportée aux sécrétions de « l’usine », mais, articulée à des considérations sociopolitiques, elle se situe sur un plan moral conformément à l’analyse de Gilbert Durand : « l’imagination […] va s’acheminer insensiblement par le concept de la tache sanglante et de la souillure vers la nuance morale de la faute28 ». En ce sens, « Encore les berges » renvoie les figures moralement négatives de « la populace forte et louche » et celles du « rôdeur » et de « sa garce » à des effets sociaux de l’industrialisation, un mal ayant souillé les eaux laiteuses de la Seine et les abords du fleuve, confirmant ainsi l’analyse de Gaston Bachelard selon laquelle « une goutte d’eau pure suffit à purifier un océan, une goutte d’eau impure suffit à souiller un univers29 ».
29Le poème « La Seine » permet de prolonger ces réflexions sur l’imaginaire du fleuve et les images de la pollution dans les poèmes de Lucie Delarue-Mardrus :
Seine de Paris et de ses banlieues,
Long reptile dans l’herbe ou le ciment des bords,
Jardin mouvant, jardin d’algues des morts,
Eau pleine du reflet multiforme des lieues,
Native pureté dont le cours n’est plus clair,
Qui vas portant tout ce que ton flot berce
D’ordure et de secret, de rêve et de commerce
Séculairement à la mer,
Je t’aime d’épouser la Ville géniale
De ton méandre étroit et caressant,
Fleuve placide, ô Seine éternellement pâle
Et plus tragique que du sang30 !
30Dans la première strophe, la « Seine de Paris et de ses banlieues » est figurée en un long reptile, de sorte que c’est l’image animalière, propre à produire l’animation, qui la caractérise. L’animation est redoublée par sa figuration en un « jardin mouvant » et la description du « reflet multiforme » que porte l’eau. Cependant, l’image végétale du « jardin d’algues des morts » évoque les complexes de l’imaginaire aquatique reliés à la mort et considérés par Gaston Bachelard.
31À nouveau, dans la deuxième strophe, la Seine apparaît comme une image de la « pureté » souillée par l’activité humaine. Ainsi, son cours « n’est plus clair », et le fleuve porte à la mer des « ordure[s] », des « secret[s] », mais également des « rêve[s] » et du « commerce ». Cette double dimension rappelle l’opposition du rêve orientaliste et de la vie industrielle européenne que suscitait l’image du fleuve dans le poème « Quais31 ». L’image des « ordure[s] » sur le flot de la Seine évoque la pollution des eaux au début du xxe siècle. En effet, François Jarrige et Thomas Le Roux signalent que la circulation des déchets est en crise entre 1830 et 1914 :
La croissance urbaine aboutit à une crise de la circulation des déchets, tandis que la multiplication des hauts-fourneaux, des fonderies de métaux non ferreux et des usines de produits chimiques provoques des émissions de plus en plus préoccupantes en Europe et en Amérique du Nord ; une évolution qui gagne aussi de nouveaux territoires à la fin du siècle32.
32La dernière strophe articule alors le fleuve à la « Ville géniale » et mobilise encore le blanc – « ô Seine éternellement pâle » – et le rouge – « Et plus tragique que du sang ! ». On voit ici les différents éléments analysés jusqu’alors : le fleuve évoque une pureté originelle et une souillure rapportée à l’activité humaine et à l’industrialisation. En ce sens, si le « je » lyrique célèbre la beauté de la ville tout en soulignant sa responsabilité dans la pollution de la Seine selon l’image double considérée, il apparaît que ce poème développe une ambivalence esthétique et morale qui s’inscrit dans la continuité de la célébration de la simplicité des guinguettes et de la critique sociopolitique du sort des habitants des banlieues.
33Nous retrouvons des motifs similaires dans le poème « Heure33 » dans lequel l’image du lait est associée au fleuve : « La Seine de ce soir est un fleuve de lait ». Les deux derniers vers soulignent la pollution provoquée par l’industrie en passant du fleuve à l’astre lunaire : « Sous la rougeur de la lune d’hiver / Qu’enfume lourdement une usine sinistre34 !… » L’image évoque des exhalaisons qui font l’objet de dénonciations à cette période : « Les fumées de charbon touchent presque tous les territoires de l’industrie. Elles restent toutefois surtout dénoncées en ville, où elles sont directement au contact des populations35. » Le poème « Aurore », plutôt que d’évoquer la pollution atmosphérique, rend sensible la pollution sonore et visuelle aux abords du fleuve :
Voici l’heure. Les coqs chantent à rendre l’âme.
Un frôlement de jour s’insinue, et profane
Les gouffres de la nuit avec sa clarté neuve ;
Des bruits d’essieux s’en vont par les routes dormantes,
Et le cri des bateaux bouleverse les fleuves.
La terre de nouveau crève l’immensité
Avec les angles blancs et durs de ses cités,
Et voici que la vie inutile et poignante
Va reprendre devant ce miracle éternel :
L’aurore éclaboussant de triomphe le ciel !
Pour nous, surgis tous deux du néant du sommeil,
Étonnés et graves, songeons
Au sixième matin de la Création,
Et, debout dans la paix et l’amour de nos âmes,
Embrassons-nous devant le lever du soleil
Comme le premier homme et la première femme36.
34Le présentatif « voici » introduit le poème en soulignant l’attente dont fait l’objet l’heure de « l’aurore ». L’image animalière du coq chantant ouvre une rêverie cosmique qui parcourt le poème. L’opposition du jour et de la nuit appelle la métaphore de la souillure – le jour « s’insinue », il « profane » – et la souillure suscite l’image du fleuve bouleversé par l’activité humaine évoquée à travers les « bruits d’essieux » et « le cri des bateaux ». En ce sens, la première strophe développe un imaginaire du fleuve marqué par une pollution sonore.
35La strophe suivante évoque la pollution visuelle liée à l’activité humaine. Cependant, c’est « la terre » qui forme un contraste avec « l’immensité », elle-même associée aux « angles blancs et durs de ses cités ». Le poème se fait l’écho de la reprise de « la vie inutile et poignante », qui suggère une allusion aux figures humaines resituées dans un temps cyclique. Les antithèses du jour et de la nuit, du fleuve pur et des bateaux polluants, de la terre et des cités, rejouent toutes à un niveau cosmique l’opposition de l’élément pur et de ce qui le souille. L’aurore, « miracle éternel », apparaît alors comme un triomphe du « ciel » sur la « terre », nouvelle antithèse qui reconduit l’opposition.
36La dernière strophe marque un retour au sujet lyrique intégré à un « nous », au sortir du sommeil, et invite à prolonger la rêverie cosmique dans une rêverie cosmogonique : il s’agit de songer au « sixième matin de la Création » afin de trouver « la paix et l’amour de nos âmes » pour s’embrasser « comme le premier homme et la première femme ». Ainsi, le poème suit le mouvement d’une purification : la figure du sujet lyrique, qui progresse au fil des antithèses purificatrices, se déleste de toute souillure morale.
37En ce sens, l’imaginaire du fleuve qui se déploie dans ces poèmes intègre des motifs qui évoquent les pollutions provoquées par la « redistribution industrielle ». À cet égard, les guinguettes et l’espace de la banlieue constituent des lieux stratégiques puisque l’activité industrielle s’y déplace au cours du xixe siècle :
Dans un premier temps, les machines à vapeur et le métabolisme urbain favorisent l’implantation manufacturière en ville ; dans un second mouvement, la crainte des pollutions de la part de la bourgeoisie urbaine (associée à celle d’une forte concentration ouvrière) et les chemins de fer créent les conditions d’un redéploiement en périphérie, ou sur des sites à l’écart entièrement dédiés à l’industrie dans le cas des mines37.
Conclusion
38Il faudrait évoquer d’autres textes pour poursuivre cette réflexion. C’est pourquoi cette étude, à l’image d’une « promenade », parcourt quelques poèmes, afin de montrer que le fleuve et en particulier la Seine sont au cœur d’un propos sociopolitique dans l’œuvre de Lucie Delarue-Mardrus, et suscitent le développement d’images de la pollution qui évoquent les conséquences des évolutions industrielles du xixe siècle et du début du xxe siècle. Dans cette perspective, nous souhaitons achever cette analyse en invitant à poursuivre le parcours de l’œuvre de Lucie Delarue-Mardrus et à aborder d’autres poèmes qui, à l’image de « Du bout de ses tuyaux gris… », développent un imaginaire poétique marqué par la pollution et reconfigurent le motif du « gris d’un temps verlainien38 » :
Du bout de ses tuyaux gris,
Dans le ciel fume Paris ;
Le jardin se ramifie
Sur cette lithographie ;
Tout le long d’un rameau sec
Les moineaux se font le bec ;
Et quelque bateau qui passe
Sur la Seine lourde et lasse
Vient mêler de temps en temps
Son sanglot au mauvais temps39.
1 Lucie Delarue-Mardrus, La Monnaie de singe, Paris, Eugène Fasquelle, 1912, p. 3.
2 Lucie Delarue-Mardrus (1875-1945) est une autrice que Michel Décaudin associe au « lyrisme féminin » et dont il relève le « panthéisme vibrant » : « le rythme des saisons, les mouvements de la mer sont les forces naturelles auxquelles faute d’un objet plus précis s’abandonne sa sensualité. », Michel Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française, 1895-1914, Paris, Honoré Champion, 2013, p. 159. Elle publie notamment des recueils de poèmes et des romans, ainsi que des comptes-rendus critiques dans La Revue blanche où son époux, traducteur des Mille et Une Nuits, Joseph-Charles Mardrus, l’a introduite. Durant sa vie, elle logera à Paris et dans sa Normandie natale. Pour en connaître davantage sur la vie de l’autrice, nous renvoyons le lecteur à la biographie d’Hélène Plat, Lucie Delarue-Mardrus. Une femme de lettres des années folles, Paris, Bernard Grasset, 1994.
3 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Librairie générale française, « Le Livre de poche », 1993, p. 178.
4 Ibid., p. 177.
5 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale, Paris, Dunod, 1992, p. 194.
6 Lucie Delarue-Mardrus, « L’échange », Ferveurs, Paris, Éditions de La Revue blanche, 1902, p. 146-147.
7 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imagination de la matière, op. cit., p. 178.
8 Jean-Pierre Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé, Paris, Éditions du Seuil, 1961, p. 26.
9 Lucie Delarue-Mardrus, « Les chalands », Horizons, Paris, Eugène Fasquelle, 1904, p. 38-39.
10 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire…, op. cit., p. 224.
11 Ibid., p. 292.
12 Ibid., p. 74.
13 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Éditions du Seuil, « Points Essais », 2012, p. 88.
14 Lucie Delarue-Mardrus, « Essai », Horizons, éd. citée, p. 58-59.
15 Id., « Berges », Horizons, éd. citée, p. 42-43.
16 Alexandre Sumpf, « Représenter les guinguettes », Histoire par l’image [en ligne], https://histoire-image.org/etudes/representer-guinguettes, page consultée le 10 janvier 2025.
17 Lucie Delarue-Mardrus, « Quais », Horizons, éd. citée, p. 77-78.
18 « La Revue blanche présente un sommaire des plus prestigieux. Critique littéraire : Léon Blum ; chroniqueur musical : Claude Debussy ; revue des arts : Alfred Jarry. Cette publication bimensuelle réunit des contestataires, sinon des anarchistes, comme Félix Fénéon, secrétaire de rédaction. Elle met en cause les valeurs respectées par la bourgeoisie d’alors : la famille, violemment attaquée par Octave Mirbeau dans son Journal d’une femme de chambre, l’armée, avec Bernard Lazare qui défend Dreyfus et attaque l’antisémite Drumont… Des artistes comme Signac, Vallotton, Maurice Denis, Camille Claudel et même Picasso, sont encensés par Alfred Jarry et le poète Fagus. », Hélène Plat, Lucie Delarue-Mardrus. Une femme de lettres des années folles, op. cit., p. 74.
19 L’époux de l’autrice, Joseph Charles-Mardrus, fera paraître dans des magazines parisiens des portraits photographiques de son épouse figurée en femme orientale, les paupières parées de khôl, vêtue de tuniques qui évoquent un Orient fantastique et décadent. En publicitaire habile, il la surnommera la « princesse Amande », ibid., p. 113.
20 Lucie Delarue-Mardrus, « Encore les berges », Horizons, éd. citée, p. 44-45.
21 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire…, op. cit., p. 294.
22 Ibid., p. 295.
23 « D’une manière générale, le rouge, s’il n’est plus vraiment la couleur de la prostitution – ce qu’il a longtemps été –, reste la couleur de l’érotisme et de la féminité. », Michel Pastoureau, Rouge. Histoire d’une couleur, Paris, Éditions du Seuil, 2016, p. 185-186.
24 Michel Pastoureau note également que cette association est « particulièrement négative » dans la « culture médiévale » et sert à la représentation de « l’enfer », ibid., p. 106.
25 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire…, op. cit., p. 122.
26 Ibid., p. 120.
27 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imagination de la matière, op. cit., p. 160.
28 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire…, op. cit., p. 120.
29 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imagination de la matière, op. cit., p. 164.
30 Lucie Delarue-Mardrus, « La Seine », Horizons, éd. citée, p. 53.
31 Lucie Delarue-Mardrus, « Quais », Horizons, éd. citée, p. 77-78.
32 François Jarrige, Thomas Le Roux, La Contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel, Paris, Éditions du Seuil, 2017, p. 174.
33 Lucie Delarue-Mardrus, « Heure », Horizons, éd. citée, p. 70.
34 Ibid.
35 François Jarrige, Thomas Le Roux, La Contamination du monde…, op. cit., p. 188.
36 Lucie Delarue-Mardrus, « Aurore », Horizons, éd. citée, p. 16-17.
37 François Jarrige, Thomas Le Roux, La Contamination du monde…, op. cit., p. 183.
38 Lucie Delarue-Mardrus, « Pluie », Ferveurs, éd. citée, p. 123.
39 Id., « Du bout de ses tuyaux gris », ibid., p. 117.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2040.html.
Quelques mots à propos de : Tristan Guiot
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
