Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
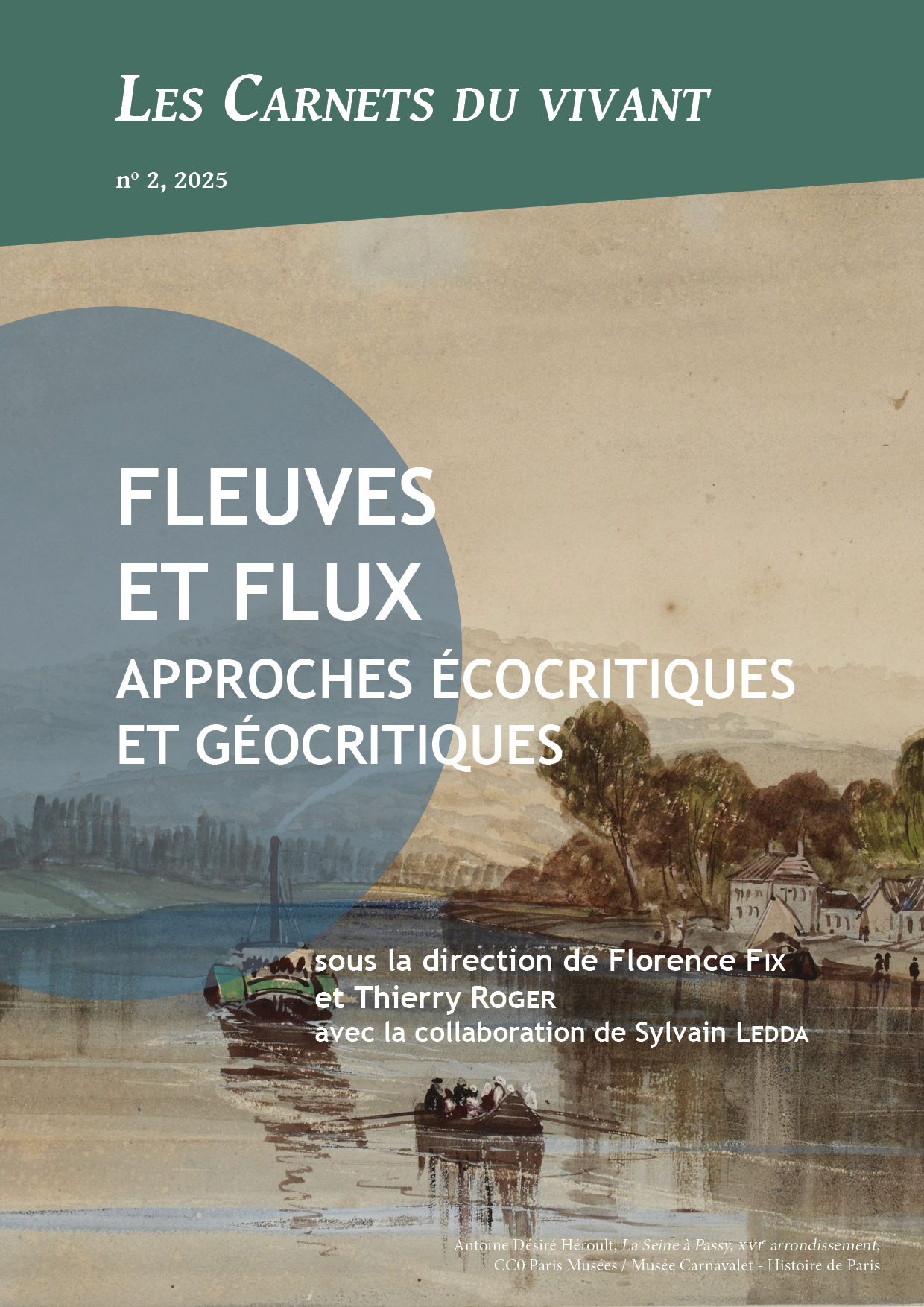
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
Amélie Goutaudier
« Le fleuve est beau en l’empire. Et l’on chante le fleuve ».
(Citadelle, chap. lxxxviii)
1Examiner la géopoétique du fleuve chez un écrivain de l’aviation relève assurément d’une gageure… Au nageur et au marinier, Antoine de Saint Exupéry préfère incontestablement l’aviateur et le radiotélégraphiste. Par ailleurs, s’écartant de la Saône ou de la Seine, ses écrits s’orientent davantage vers le Sahara ou la Cordillère des Andes. Enfin, chez lui les rêveries de vols supplantent à coup sûr les rêveries de berges.
2Pourtant, en dépit d’expériences restreintes du fleuve, la thématique fluviale affleure dans son œuvre de façon ponctuelle, presque fortuitement. Ici et là, ce sont tantôt l’Yser, la Seine ou la Saône qui apparaissent tour à tour dans leur simple parure virginale, réactivant la connivence romantique entre l’homme et la nature en présentant le fleuve comme réponse à la quête de l’authenticité d’une présence au monde. Mais le fleuve, chez Saint Exupéry, c’est également ce long cours d’eau que l’on voit du haut du ciel, à la fois point de repère et danger palpable, soumis à d’étranges anamorphoses. Enfin le fleuve, chez le pilote-écrivain, propose un imaginaire insolite dans la poétique de l’aviation, puisque ce sont des sensations fluviales qui parsèment l’expérience du vol.
3Cet article propose d’enquêter sur la triple déclinaison, spatiale, métaphorique et éthique du fleuve dans les écrits de Saint Exupéry, des poèmes de jeunesse (1915) à Citadelle (posthume, 1948). Il s’agira d’abord d’apprécier, dans une démarche géopoétique1, l’expérience sensorielle du fleuve, alternative à la réification des êtres et à la vacance du divin, le fleuve onirique pouvant également être sacralisé et offrir le cadre d’une épiphanie. Il conviendra ensuite de questionner la thématique fluviale dans la poétique de l’aviation, imaginaire qui intègre également le vaste domaine de la géopoétique puisqu’il renouvelle la disposition de l’être au monde.
L’expérience sensorielle du fleuve
4Chez Saint Exupéry, la géopoétique du fleuve est avant tout tributaire d’une approche sensible et relationnelle : fuyant l’univers frelaté qui menace son être dans sa profonde intimité, le personnage exupérien rêve auprès du fleuve pour tenter de retrouver, dans la logique d’une résilience, paix et sérénité – même si les ressources fluviales espérées ne résistent pas toujours à sa mélancolie. Cédant volontiers à l’imaginaire romantique puis symboliste dans l’œuvre de jeunesse, le fleuve onirique peut être sacralisé et cristalliser, dans la Lettre à un otage, l’émotion intense d’une épiphanie.
Fleuve onirique et ressources fluviales
5Tout d’abord, le fleuve onirique est avant tout conçu, dans l’imaginaire exupérien, comme un rempart naturel face aux violences de guerre. Bien avant la Lettre à un otage, qui localisera l’épiphanie fraternelle sur la Saône, les Poèmes de guerre, composés par l’adolescent entre 1914 et 1918, en offrent un exemple saisissant. Bien que l’Yser, petit fleuve côtier belge, ait été le théâtre d’opérations sanglantes, particulièrement en octobre 1914 (avec la Bataille d’Yser) et au printemps 1915, le jeune poète pense le fleuve comme échappatoire au tragique, et emprunte la vieille métaphore de l’accalmie amoureuse :
Printemps de guerre
Le coteau dort baigné par la lune sereine
La forêt, vague et bleue, oscille doucement
Et les arbres penchés s’égayent par moment
D’un rayon diapré sous les feuilles d’un frêne.
L’Yser dissimulé sous la brume incertaine
Roule dans ses flots purs des larmes de diamant,
On dirait que la guerre émeut le firmament
Dont l’éther s’attendrit aux exploits de la haine.
Parfois confusément sous un rayon lunaire,
Un soldat se détache incliné sur l’eau claire ;
Il rêve à son amour, il rêve à ses vingt ans !…
L’air pur frémit soudain d’une balle perdue,
Un râle va troubler le murmure des vents…
Ô, pourquoi sur des fleurs faut-il que l’on se tue2 ?…
Fribourg, décembre 1915.
6Composé alors que le jeune garçon de quinze ans était lycéen à Fribourg3, ce sonnet d’alexandrins, certes imprégné de l’imaginaire romantique, témoigne d’une sensibilité poétique précoce. Tandis que la langueur onirique du premier quatrain annonce déjà la thématique fluviale par le motif de l’oscillation de la « forêt, vague et bleue », le deuxième quatrain s’ouvre délicatement sur l’esquisse imprécise du fleuve, lui-même camouflé par la brume, nébuleuse indécise qui suggère sa part de mystère. Et si, comme le rappelle Bachelard, « l’eau s’offre […] comme un symbole naturel pour la pureté4 », « les flots purs » du fleuve redoublent ici le processus de valorisation d’une eau tristement chargée de « larmes de diamant ». La vocalisation du fleuve, dans le premier hémistiche du vers 6, alanguit encore la description du paysage poétique : le chiasme phonique reposant sur le retournement des consonnes liquide et vibrante (« Roule dans ses flots purs ») assouplit par sa rondeur la fluidité du cours d’eau ; le phonème [u] s’ouvre un court instant grâce à la voyelle mi-fermée [o] puis s’assourdit à nouveau dans la voyelle fermée [ü]. Comme le fleuve, le langage coule et lui donne une sonorité vivante. C’est donc tout naturellement dans ce climat poétique langoureux que « se détache » « confusément » la silhouette d’un soldat « incliné sur l’eau claire » et dont la courbe est encore arrondie par l’agencement phonétique puisque les phonèmes [kl] cerclent « l’eau ». Face à la guerre, le fleuve laisse entendre, un court instant, une musique d’humanité.
7Cette approche sensible et relationnelle, proposée dans ce poème au soldat, est une constante dans les écrits de jeunesse de Saint Exupéry, lui-même écrivant en 1922, revenant du Maroc, sa joie de retrouver la Seine, « ce cher vieux fleuve » : « Ma chère Dolly, […] il me semble qu’à mon retour je vais me coucher sur un pont et regarder des heures la Seine couler, si heureux de le retrouver, ce cher vieux fleuve5. » Ce rapport amical et fraternel avec le fleuve se dilue dans sa nouvelle Manon, danseuse, écrite en 1925.
8Plongée dans l’univers nocturne du dancing, immédiatement réduit à la métonymie de la « fumée des cigarettes [qui] l’étouffe », Manon, jeune danseuse et prostituée, s’extrait dès l’ouverture du récit de l’espace clos, « franchit le seuil » et « se jette dans la nuit glacée comme à la mer6 ». Témoin de l’apaisement progressif de Manon, la comparaison maritime s’adoucit d’abord grâce à l’image de la rivière : « Elle cherche une petite rue qu’elle connaît […]. Elle s’y hasarde comme à gué dans une rivière. […] Quel calme, pas un réverbère, un ciel si haut7… » Puis Manon, « berc[ée] d’une détresse romantique » en raison de sa virginité perdue et sans cesse entachée, se réfugie près de la Seine et « rêve8 » :
Manon, accoudée au parapet, jouit de la matinée comme d’un jardin nouveau. Les autres fois elle dormait, elle déposait ce corps. Mais aujourd’hui elle promène une fringale un peu acide, son insomnie. Elle s’étonne de cette vie réglée, de ces péniches, de ces manœuvres, s’étonne de cet homme qui est grave9.
9La Seine, qui pourtant dans le paragraphe précédent avait été décrite comme un fleuve encombré de « péniches plantées ras dans une eau lourde de lumières10 », se déleste de son poids et de son agitation dans la vision poétique de Manon. Miroir inversé du dancing, espace de la comédie et du carnavalesque duquel émane une joie vulgaire, la Seine concède à Manon une fraîcheur virginale, quoique éphémère : car l’homme « grave » qu’elle rencontre n’est en définitive pas différent des autres hommes. L’épisode de la Seine n’est qu’un indice supplémentaire de la soif de pureté de Manon.
10Courrier Sud (1929) prolonge la thématique fluviale en présentant la Seine non plus comme le contre-point du dancing, mais comme celui de l’église. En effet, Jacques Bernis, entré avec méfiance dans Notre-Dame, observe avec scepticisme l’édifice religieux puis le prédicateur. Opaque à la grâce divine, contrairement à son ancêtre Claudel, il ne peut être touché par aucun « Magnificat » : « Il sortit11 », ayant plus d’espoir en quelques « lampes à arc12 » qu’en la lumière divine. L’anti-conversion se clôture par ce passage du lieu saint vers les « berges de la Seine » dont l’horizontalité parachève le défaut de transcendance divine. Loin d’être tiré de la terre vers le ciel, Jacques Bernis s’enferme dans « la glu du crépuscule13 » :
Il sortit. Les lampes à arc s’allumeraient bientôt. Bernis marchait le long des berges de la Seine. Les arbres demeuraient immobiles, leurs branches en désordre prises dans la glu du crépuscule. Bernis marchait. Un calme s’était fait en lui, donné par la trêve du jour, et que l’on croit donné par la solution d’un problème14.
11Comme dans Manon, danseuse, le fleuve est ici associé à l’idée d’accalmie : fuyant l’espace frelaté du dancing ou l’univers décapé de tout sacré, le personnage pense trouver réconfort auprès du fleuve. Mais loin d’approuver Bernis, les arbres des berges fluviales semblent au contraire, par leur immobilité et leur vacarme silencieux, désavouer l’homme sans foi. Tandis que traditionnellement, selon Bachelard, « la pureté et la fraîcheur s’allient […] pour donner une allégresse spéciale que tous les amants de l’eau connaissent15 », dans ce passage, le fleuve est davantage associé au funeste et à la mort, ce qui sera corroboré plus tard par l’allusion à Orphée16. En définitive, le fleuve refuse à l’homme sceptique tout élan mystique.
12L’expérience du fleuve ne conduit donc pas nécessairement à résoudre la réification des êtres ou la vacance du divin. Cependant elle témoigne, dans l’œuvre de jeunesse, d’une réelle sensibilité environnementale d’inspiration romantique : désemparé, le personnage tourne son regard vers le fleuve, auquel il confie son désarroi.
13C’est ce même désarroi qui conduit le jeune poète vagabond des Poèmes pour Loulou à diriger ses pas vers la Seine. Déployant la thématique de l’impatience amoureuse, les Poèmes pour Loulou, composés entre 1921 et 192517, regroupent vingt-sept poèmes écrits au temps de la liaison d’Antoine de Saint Exupéry et de Louise de Vilmorin (leurs fiançailles sont rompues en 1923). Héritier symboliste de l’amant éploré18 confronté à l’opacité d’un être sans cesse évanescent mais qu’il vénère telle une madone, le jeune poète-vagabond quémande tendresse et pitié. Son errance dans la nuit lyrique et fiévreuse du désir amoureux le mène vers le fleuve parisien :
Ouvre-moi
[…]
Et comme, en te rêvant, j’ai flâné vers la Seine
Sur qui pour oublier on s’accoude la nuit
Je t’apporte sa paix, son brouillard, son haleine
Sa tristesse qui passe et ne fait pas de bruit,
Son cours profond et lourd qui dans l’ombre s’enfonce
Comme le flot des souvenirs… Je souffre encor
Pour ces gueux dont l’amour tremblant fut sans réponse.
Ouvre moi… Que la nuit soit douce, à tes remords19.
14Convoquant l’imaginaire traditionnel de la pureté, de l’accalmie ou de la féminité, la Seine offre à l’amant ce que la maison verrouillée de l’amante a décliné. Charitable confidente qui berce le poète éconduit, la Seine a un corps (« sur qui […] on s’accoude), une âme (« sa paix, son brouillard […] sa tristesse »), une voix (« son haleine ») : elle est un être total sur lequel se repose l’amant. Généreuse et empathique, elle s’empare de la désolation si grande, si profonde, si intime de l’amant, et emporte avec elle le fardeau mélancolique du vagabond.
15Le personnage exupérien, qu’il soit homme ou femme, soldat, pilote, prostituée ou vagabond, signale donc sa dévotion fluviale. L’imaginaire du fleuve est sans doute tributaire du double héritage littéraire, romantique et symboliste, dans l’œuvre de jeunesse20. Néanmoins, cet univers en émanation et saturé d’images vives témoigne d’une véritable connivence, voire d’une tentative de reconnexion de l’homme à son milieu originaire.
16À la fois réel et anonyme, le fleuve exupérien est un cours d’eau onirique et féminin, aux contours évanescents de la mère, de la sœur et de l’amante ; auréolé de sacré, il devient, dans la Lettre à un otage, un fleuve épiphanique.
Sacralité fluviale : la Saône, cadre d’une épiphanie
17« Véritable poème symphonique21 », la Lettre à un otage (1943) orchestre poétiquement, grâce à « un jeu très subtil d’échos22 », le passage de « l’évidence d’une civilisation touchée à mort » à « l’espoir d’une civilisation restaurée23 ». Comme l’analyse Michel Quesnel, « le début de la Lettre est enveloppé de présences marines » : les deux premiers chapitres développent la métaphore du navire, lequel « se fait signe d’une civilisation inquiète, livrée aux périls de la mer24 ». Au chapitre suivant, qui constitue un moment charnière – c’est le chapitre central –, « l’eau marine devient eau douce, l’aventure s’apaise25 » : les marins du « bateau fantôme26 » ou du « navire tous feux éteints27 » se font mariniers, la mer et ses « périls28 » angoissants remonte à contre-courant vers le fleuve, et nous voici « sur les bords de la Saône » :
C’était par une journée d’avant-guerre, sur les bords de la Saône, du côté de Tournus. Nous avions choisi, pour déjeuner, un restaurant dont le balcon de planches surplombait la rivière. […] Ce qui nous réjouissait était plus impalpable que la qualité de la lumière. […] Et, comme deux mariniers [l’un allemand, l’autre hollandais29], à quelques pas de nous, déchargeaient un chaland, nous avons invité les mariniers. […]
Le soleil était bon. Son miel tiède baignait les peupliers de l’autre berge, et la plaine jusqu’à l’horizon. Nous étions de plus en plus gais, toujours sans connaître pourquoi. Le soleil rassurait de bien éclairer, le fleuve de couler, le repas d’être repas, les mariniers d’avoir répondu à l’appel, la servante de nous servir avec une sorte de gentillesse heureuse, comme si elle eût présidé une fête éternelle. Nous étions pleinement en paix, bien insérés à l’abri du désordre dans une civilisation définitive. Nous goûtions une sorte d’état parfait où, tous les souhaits étant exaucés, nous n’avions plus rien à nous confier. Nous nous sentions purs, droits, lumineux et indulgents. […]
Ainsi savourions-nous cette entente muette et ces rites presque religieux. Bercés par le va-et-vient de la servante sacerdotale, les mariniers et nous trinquions comme les fidèles d’une même Église, bien que nous n’eussions su dire laquelle30.
18Ce troisième chapitre, consacré au déjeuner de Fleurville, constitue selon Françoise Gerbod un « instant capital qui associe la tendresse de l’amitié et la lumière d’un paysage31 » fluvial. Dans son journal du 22 février 1943, Léon Werth, qui accompagne ici Saint Exupéry, décrit davantage le fleuve : « La Saône, au lointain s’élargit, semble sans bornes, se mêle à l’horizon, un rideau d’arbres pâles32. » C’est bien ce sentiment d’élargissement propre au paysage fluvial qui prélude à l’extase fraternelle : l’ombre de la guerre33 se dissout dans la lumière presque palpable de l’espace sans limites et le soleil engendre une véritable cénesthésie.
19Dans ce climat fluvial d’eau et de feu, la réconciliation des peuples (français, allemand et hollandais) s’accomplit dans une sorte de régénération sacrée : le paysage fluvial et ensoleillé « nargue l’entropie34 » et revitalise, par son énergie, « l’entente muette » des hommes. Le sentiment de fête et d’accord parfait, sentiment sacralisé par un lexique délibérément religieux, échappe aux ravages du temps ; l’instant de béatitude, qui excède largement l’interaction entre soi et l’environnement fluvial, est l’instant d’une parturition qui ramène l’homme à ses origines, comme l’analyse Michel Quesnel : « l’homme, établi dans un au-delà du langage, y découvre sa vérité et reçoit comme la récompense de ce milieu qui le favorise – pur, droit, lumineux, indulgent – une innocence d’avant la faute35 ».
20Paysage fluvial éveillé aux accents de l’invisible, la Saône est donc le cadre d’une épiphanie fraternelle : à travers la rencontre avec les deux mariniers allemand et hollandais, cette scène symbolise l’entente universelle et témoigne du retentissement affectif d’une sensation presque religieuse qui restaure une civilisation disparue. Plus qu’une expérience sensorielle, l’épisode au bord de la Saône est une expérience cosmique puisqu’elle restitue la densité ontologique originelle en abolissant le temps profane de l’univers chaotique.
21Tels sont les prestiges du fleuve chez Saint Exupéry : la géopoétique du fleuve, soumise au double imaginaire romantique et symboliste dans l’œuvre de jeunesse, s’affine grâce au principe de régénération spirituelle et de retour à la matrice originelle. Le fleuve n’est donc pas un simple décor bucolique ; il n’est pas l’espace d’une simple cohabitation ; il est davantage conçu comme le foyer mystérieux d’une sacralité cosmique.
22Au-delà de cette approche sensible, la thématique fluviale se singularise, chez Saint Exupéry, par son imbrication dans la poétique de l’aviation.
Imaginaire du fleuve dans la poétique de l’aviation
23L’imaginaire poétique fluvial, l’effervescence de sensations fluviales et l’omniprésence d’une cartographie fluviale, réelle ou fantasmée, relient sans peine la poétique de l’aviation au vaste domaine de la géopoétique.
Le fleuve vu du ciel
24Tout d’abord, grâce au vol, l’écriture de l’espace, et particulièrement de l’espace fluvial, produit de singulières images et permet le renouvellement de la poétique du fleuve. En effet, la terre vue du ciel décale les perspectives : en corollaire, le fleuve observé de l’avion fournit de véritables anamorphoses. Dans sa première nouvelle consacrée à l’aviation (Un vol, 1923), le jeune écrivain traduit les sensations visuelles du pilote au moment de l’envol : progressivement, le paysage s’aplanit, devient un espace géométrique, et le fleuve paraît à son tour rétrécir : « La Seine à mesure qu’il montait se plissa36. » Outre cette impression de repliement du paysage fluvial, l’expérience du vol autorise également l’effusion d’images schématiques qui font irruption dans une sorte de collage cubiste : du haut du ciel, le pilote découvre un « paysage synthétique […] où près des fleuves bleus poussent des usines de pierre37 ».
25Ainsi, le fleuve vu du ciel permet l’expansion d’images. Dans Vol de nuit (1931) par exemple, le pilote Fabien est, dès l’incipit, associé au paysage fluvial et regarde, attendri, les troupeaux de ville « qui venaient boire au bord des fleuves » :
Et le pilote Fabien, qui ramenait de l’extrême Sud, vers Buenos Aires, le courrier de Patagonie, reconnaissait l’approche du soir aux mêmes signes que les eaux d’un port : à ce calme, à ces rides légères qu’à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse.
Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont, sans se presser, d’un troupeau à l’autre : il allait d’une ville à l’autre, il était le berger des petites villes. Toutes les deux heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui broutaient leur plaine38.
26La thématique fluviale, qui s’immisce dans le premier paragraphe grâce à la métaphore portuaire, permet d’inscrire le récit de vol dans la logique d’une pastorale, en démentant l’héroïsme épique des pionniers de l’aviation39. Se promenant lentement près des fleuves, le pilote-berger s’achemine, rêveur, vers Buenos Aires.
27Dans l’univers du vol, la ligne fluviale est aussi, pour le pilote, un point de repère : après avoir survécu à la mitraille au-dessus d’Arras, l’équipage de Pilote de guerre (1942) attend avec impatience de pouvoir « se repére[r] quelque part sur la Seine40 » ; le fleuve permet non seulement d’orienter l’équipage, mais il procure un plaisir puissant au pilote :
Dutertre vient de se repérer sur la Seine. Je suis descendu vers cent mètres. […] La Seine m’apparaît. Quand je la franchis en oblique, elle se dérobe, comme en pivotant sur elle-même. Ce mouvement me procure le même plaisir que la foulée souple d’un coup de faux41.
28Féminisée, la Seine « se dérobe » et « pivote » dans un ballet nocturne sous le regard ému du pilote ; néanmoins, mettant fin au lyrisme, l’écrivain recourt à la métaphore paysanne pour suggérer, grâce au sens tactile, la sensation provoquée – à plusieurs reprises dans Pilote de guerre, l’écrivain est tenté par le lyrisme qu’il révoque finalement, se méfiant d’une « poésie de pacotille42 » dans l’univers de la défaite43.
29S’il oriente le pilote, le fleuve est aussi un piège à éviter : séduisante, la Seine captive le pilote, mais elle est aussi un écueil, et l’avertissement retentit aussitôt qu’il s’en est approché : « Mon capitaine… ils tirent… nous sommes en zone interdite44… » C’est ainsi que le fleuve peut devenir un adversaire de taille auquel est confronté le pilote-guerrier, au même titre que les montagnes, les nuages et les mers. Vol de nuit s’achève précisément sur la menace latente des fleuves – bien que cette menace, suggérée par le pluriel emphatique, soit minimisée par le rire final et victorieux du pilote :
Les mains dans les poches, la tête renversée, face à des nuages, des montagnes, des fleuves et des mers, voici qu’il commençait un rire silencieux. […] Un faible rire, mais bien plus fort que ces nuages, ces montagnes, ces fleuves et ces mers45.
30L’imaginaire fluvial est donc convoité dans la poétique de l’aviation. Objet poétique, le fleuve a également une fonction doublement dramatique, puisqu’il oriente ou au contraire défie le pilote : en ce sens, la géopoétique du fleuve, chez Saint Exupéry, exhibe l’ambivalence d’une nature porteuse de vie et de mort, de laquelle émane une double ardeur vivifiante et destructrice. Mais la déclinaison métaphorique du fleuve se précise surtout dans l’expression des sensations de vol.
L’avion-péniche et les sensations fluviales de vol
31En effet, chez Saint Exupéry, l’imaginaire de l’aéronautique est profondément affecté par l’analogie fluviale. Avant Vol de nuit, dont l’incipit insiste, comme nous l’avons vu, sur la métaphore portuaire46, et qui établit immédiatement l’analogie fluviale en comparant l’avion du pilote au « chaland » du marinier47, Courrier Sud présente déjà l’avion de Bernis comme une « péniche » : « L’avion, péniche trop chargée, pèse48. » Le narrateur, lui-même pilote, entend à son tour son moteur vibrer comme un fleuve : « Mon moteur : un grondement de fleuve en marche. Ce fleuve en marche m’enveloppe et m’use49. » La métaphore fluviale a pour intérêt d’alourdir l’avion et d’enrayer la sensation de légèreté et d’ivresse de l’air, propre de la poétique de l’aviation50. Or cet avion-péniche, qui « fait entendre un grondement de fleuve en marche », convoque ce que Gaston Bachelard appelle l’« imagination musculaire51 » de l’eau : énergique et musclé, le fleuve gronde sa colère et l’analogie introduit la vision prémonitoire d’une fin funeste. La thématique de la noyade, sous-jacente grâce aux verbes « envelopper » et « user », rappelle incontestablement la dimension mortifère du fleuve : comme le fleuve, espace à la fois de vie et de mort, le vol est un temps d’allégresse et de trépas.
32La force indomptable du fleuve est également sollicitée dans la vision du paysage qui s’offre au pilote de la nouvelle intitulée Un vol : sous les yeux du pilote, la terre devient un immense et indocile fleuve :
Maintenant que la terre est proche, elle coule sous lui comme un fleuve, de l’horizon inépuisable elle charrie des villages en désordre, des forêts, des obstacles de plus en plus lourds.
[…] Et le terrain prévu comme une flaque d’eau s’étale, mais trop loin en avant, le pilote pour l’atteindre freine imprudemment sa descente, l’avion baigne dans un milieu sans consistance, oscille, s’enlise.
[…] Un grand remous happe alors le torrent des choses : entraînant ses maisons, ses arbres, ses clochers, carrousel ivre la terre tourne. Un repli de terrain s’arrondit comme un bol, le pilote voit passer encore, lancée par une fronde, une villa, puis la terre jaillit vers lui comme la mer vers le plongeur et le broie52.
33Cette comparaison avec le fleuve violent et incontrôlable, elle-même métaphorique d’un avion que le pilote ne contrôle plus, débouche sur la thématique d’une noyade : « l’avion baigne dans un milieu sans consistance, oscille, s’enlise. » Dans une progression tragique, le fleuve en courroux se transforme en « torrent » qui déverse sa colère sur le paysage, avant d’engloutir, par sa force volcanique, le « plongeur ».
34Contrastant avec l’accalmie fluviale qui introduisait Vol de nuit, la frénésie fluviale dont il est question ici permet de renforcer l’ambivalence du fleuve dans la poétique de l’aviation, elle-même représentative d’une mythocritique du fleuve, ligne serpentine qui incarne autant la docilité que l’indiscipline des eaux.
35La déclinaison métaphorique du fleuve prend un nouvel essor dans Pilote de guerre : la terre vue du ciel va en effet déployer une singulière cartographie de fleuves fantasmés et d’anti-fleuves.
Fleuves humains dans le ciel de guerre : des anti-fleuves
36Dans Pilote de guerre en effet, la narration expurge le fleuve de toute considération positive pour en faire la métaphore de l’exode des populations. Si l’on retrouve la prévalence du sens tactile pour décrire ces fleuves civils, il s’agit en réalité de fleuves pollués, embourbés, souillés : c’est donc une cartographie d’anti-fleuves qui s’impose au regard du pilote, cartographie métonymique d’un univers dans lequel le sacré s’est étiolé.
37Saint Exupéry conjugue en effet deux approches de la guerre : lorsque le pilote se trouve au sol, il fait face à un chaos innommable et cacophonique que renforcent les images animales53 ; mais du haut du ciel, le regard qu’il porte sur le monde terrestre est supérieur et presque fantasmé. Ainsi, il reprend l’image traditionnelle du fleuve vagabond, figure de l’exilé sans racines, en la dramatisant par le lexique de la souillure : l’exode est alors comparé à « un fleuve de boue », un « fleuve qui, alors, s’empâte et reflue », une « bouillie » :
Je survole donc des routes noires de l’interminable sirop qui n’en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n’est déjà plus vrai. Elles s’évacuent d’elles-mêmes. Il est une contagion démente dans cet exode. Car où vont-ils, ces vagabonds ? Ils se mettent en marche vers le sud, comme s’il était, là-bas, des logements et des aliments, comme s’il était, là-bas, des tendresses pour les accueillir. Mais il n’est, dans le Sud, que des villes pleines à craquer, où l’on couche dans les hangars et dont les provisions s’épuisent. Où les plus généreux se font peu à peu agressifs à cause de l’absurde de cette invasion qui, peu à peu, avec la lenteur d’un fleuve de boue, les engloutit. Une seule province ne peut ni loger ni nourrir la France !
[…] L’ennemi progresse plus vite que l’exode. Des voitures blindées, en certains points, doublent le fleuve qui, alors, s’empâte et reflue. Il est des divisions allemandes qui pataugent dans cette bouillie, et l’on rencontre ce paradoxe surprenant qu’en certains points ceux-là mêmes qui tuaient ailleurs, donnent à boire54.
38Ce « fleuve impérieux » qui emporte tout sur son passage est lui-même comparé à un « égout commun », un « bloc erratique » qui engloutit humain et non-humain :
Car la route est un fleuve impérieux. Où s’arrêter ? Les villages, qu’elle balaie, l’un après l’autre, s’y vident d’eux-mêmes, comme s’ils crevaient à leur tour dans l’égout commun55.
Après une heure d’efforts on a dégagé le camion. On l’a retourné vers le sud. Il suivra, emporté par lui, bloc erratique, le fleuve de civils56.
39La métaphore fluviale aiguise donc, par les réminiscences morbides, le sentiment de la défaite, dans un univers qui assiste tragiquement à l’étiolement du sacré. Force destructrice, le fleuve emporte tout, y compris la volonté humaine, et va jusqu’à tarir en l’homme le sentiment de sa propre grandeur.
40Ce fleuve sans rives, que nous offre Pilote de guerre, relève bien évidemment d’une superstructure mentale, puisque le paysage fluvial est plus mental que réel. Néanmoins, si l’on considère, avec Kenneth White, que la géopoétique, loin d’être cantonnée dans « une vague expression lyrique de la géographie », est avant tout « basée sur la trilogie eros (énergie vitale), logos (qui contient la logique mais est bien plus riche) et cosmos (une belle totalité en grec) », et qu’elle « essaie de créer une cohérence générale : une culture, un monde57 », on voit que l’anti-fleuve exupérien s’intègre dans une géopoétique du fleuve puisqu’il manifeste le rejet d’un monde sans énergie, sans logique et sans ordre.
41La thématique fluviale s’insère donc avec aisance dans la poétique de l’aviation puisqu’elle parvient à renforcer le complexe géographique de la terre vue du ciel.
Conclusion : Pour une géopoéthique du fleuve
42Pour paraphraser Bachelard, nous conclurons en disant que « le fleuve, malgré ses mille visages, reçoit une unique destinée58 » chez Saint Exupéry. En effet, le fleuve n’est chez lui l’occasion ni de descriptions rhétoriques, ni de considérations métaphysiques, ni de réflexions environnementales59. Néanmoins, l’esthétique du fleuve restaure la sensibilité et le discernement. Sa force vient donc de ce qu’il propose en définitive une géopoéthique du fleuve.
43Dans Citadelle, œuvre posthume et peut-être fluviale, écrite à partir des flux et des reflux des pensées nocturnes de l’écrivain, le fleuve perd ses capacités strictement poétiques pour diriger le lecteur vers les rives d’une éthique. En effet, dans le discours du caïd, le fleuve est l’indicateur d’une présence essentielle au monde. C’est pourquoi le caïd exalte le fleuve : « Car le fleuve est beau en l’empire. Et l’on chante le fleuve : “Toi, le nourricier de nos troupeaux, toi le sang lent de nos plaines, toi le conducteur de nos navires…”60 » Si le « fleuve [est] sens de l’empire61 », c’est bien parce que « le phénomène du fleuve a une affinité avec notre existence62 », comme le rappelle Kenneth White, affinité illustrée dans les propos du caïd, au chapitre lxxi, lorsqu’il établit le parallèle entre les « lignes de force63 » de la vie humaine, et celles du fleuve :
As-tu considéré le fleuve observé du haut des montagnes ? Il a rencontré ici le roc et, ne l’ayant point entamé, en a épousé le contour. Il a viré plus loin pour user d’une pente favorable. Dans cette plaine il s’est ralenti en méandres à cause du repos de forces qui ne le tiraient plus vers la mer. Ailleurs il s’est endormi dans un lac. Puis il a poussé cette branche en avant, rectiligne, pour la poser sur la plaine comme un glaive.
Ainsi me plaît que la danseuse rencontre des lignes de force. Que son geste ici se freine et là se délie. Que son sourire qui tout à l’heure était facile, maintenant peine pour durer comme une flamme par grand vent, que maintenant elle glisse avec facilité comme sur une invisible pente, mais que plus tard elle ralentisse, car les pas lui sont difficiles comme s’il s’agissait de gravir. […]
Car la danse est une destinée et démarche à travers la vie64.
44Corroborant la corrélation entre la géopoétique et l’éthique, la danse fluviale devient donc, chez Saint Exupéry, le plaidoyer d’une meilleure disposition de l’être au monde.
1 La géopoétique, concept fondé par Kenneth White (fondateur de l’International Institute of Geopoetics en 1989), est définie par Sara Buekens comme « une approche qui met l’accent sur la façon dont l’homme établit une relation avec l’espace à travers ses pensées, ses émotions et ses expériences sensorielles ». (Sara Buekens, « L’écopoétique : une nouvelle approche de la littérature française », Études de la littérature française des xxe et xxie siècles [En ligne], no 8 : « Extension du domaine de la littérature », dir. Alexandre Gefen et Claude Perez, 2019, mis en ligne le 10 septembre 2019, consulté le 16 janvier 2025. URL : https://doi.org/10.4000/elfe.1299).
2 Antoine de Saint Exupéry, Poèmes de guerre, « Printemps de guerre », dans Antoine de Saint Exupéry. Du vent du sable et des étoiles, éd. Alban Cerisier, Paris, Gallimard, « Quarto », 2018, p. 69-70.
3 Voir Stacy de La Bruyère, Saint Exupéry. Une vie à contre-courant, trad. Françoise Bouillot et Dominique Lablanche, Paris, Albin Michel, 1994, chap. IV, p. 73-90.
4 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves. Essai sur l’imagination et la matière [1942], Paris, José Corti, « Le Livre de Poche. Biblio essais », 1993, p. 181.
5 Antoine de Saint Exupéry, Lettre à Bernardine de Menthon, Saint-Maurice-de-Rémens, février 1922, éd. Alban Cerisier, op. cit., p. 91.
6 Id., Manon, danseuse, éd. Alban Cerisier, op. cit., p. 189-190.
7 Ibid.
8 Ibid., p. 192.
9 Ibid., p. 191.
10 Ibid.
11 Antoine de Saint Exupéry, Courrier Sud, IIe partie, chap. xi, Œuvres complètes, tome I, dir. Michel Autrand et Michel Quesnel, avec la collab. de Frédéric d’Agay, Paule Bounin et Françoise Gerbod, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 79. Nous désignerons cette édition des œuvres complètes, tome I (1994) et tome II (1999), par les abréviations suivantes : OC I, OC II.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, op. cit., p. 200.
16 « Le contrôleur le dévisageait. […] Il dut lire enfin en Bernis les trois vertus requises depuis Orphée pour ces voyages : le courage, la jeunesse, l’amour… » ; « Ce soir même, la carriole, l’omnibus, le rapide lui permettront cette fuite en chicane qui nous ramène vers le monde depuis Orphée […]. » (Antoine de Saint Exupéry, Courrier Sud, IIIe partie, chap. iv, OC I, op. cit., p. 95 et 96).
17 Composés entre 1921 et 1925, Les Poèmes pour Loulou ont été publiés en 2018 dans l’édition d’Alban Cerisier (op. cit., p. 152-187).
18 La lecture des poètes symbolistes tels qu’Albert Samain, Henri de Régnier et surtout Charles Baudelaire a certainement influencé la vision idéalisée du mystère féminin au cœur de la création poétique du jeune homme. Au sujet de la figure de la madone, constante majeure dans la poésie symboliste, voir Fabrizio Bertetti, « La Femme dans la poésie symboliste française. Les poètes mineurs », Italies, no 3 : « Femmes italiennes », 1999, p. 276-297.
19 Antoine de Saint Exupéry, Poèmes pour Loulou, « Ouvre-moi », éd. Alban Cerisier, op. cit., p. 159.
20 Sur ce double héritage, voir Antoine de Saint Exupéry, « Quelques livres dans ma mémoire », Harper’s Bazaar, avril 1941, OC II, op. cit., p. 49-50, ainsi que les lettres qu’il écrit à sa mère en 1919 (OC I, op. cit., p. 683-684, p. 684, p. 693).
21 Françoise Gerbod, « Notice » de Lettre à un otage, OC II, op. cit., p. 1263.
22 Ibid.
23 Michel Quesnel, « À propos de Lettre à un otage », Cahiers Saint Exupéry no II, Paris, N.R.F., 1981, repris dans les Cahiers Saint Exupéry no V, Thonon-les-Bains, Éditions de l’Astronome, 2021, p. 44.
24 Ibid., p. 45.
25 Ibid., p. 46.
26 Antoine de Saint Exupéry, Lettre à un otage, chap. i, OC II, op. cit., p. 91.
27 Ibid., chap. ii, p. 94.
28 Ibid.
29 « L’un des deux mariniers était hollandais. L’autre, allemand. Celui-ci avait autrefois fui le nazisme, poursuivi qu’il était là-bas comme communiste, ou comme trotskyste, ou comme catholique, ou comme juif. (Je ne me souviens plus de l’étiquette au nom de laquelle l’homme était proscrit.) Mais à cet instant-là le marinier était bien autre chose qu’une étiquette. C’est le contenu qui comptait. La pâte humaine. Il était un ami, tout simplement. Et nous étions d’accord, entre amis. » (Ibid., chap. iii, p. 96).
30 Ibid., p. 95-96.
31 Françoise Gerbod, « Notice » de Lettre à un otage, OC II, op. cit., p. 1266.
32 Léon Werth, Écrits de guerre 1939-1944, cité par Françoise Gerbod, « Notice » de Lettre à un otage, OC II, op. cit., p. 1266.
33 « Si, dans le récit de Léon Werth, il est dit que les conversations ont porté sur les menaces de guerre, Saint Exupéry, pour sa part, efface ces propos pour faire de cet épisode ce que Michel Quesnel nomme “la fable de la sérénité et de l’accueil”. » (Ibid., p. 1267).
34 Michel Quesnel, art. cité, p. 51.
35 Ibid., p. 52.
36 Antoine de Saint Exupéry, Un vol, éd. Alban Cerisier, op. cit., p. 137.
37 Ibid., p. 138.
38 Antoine de Saint Exupéry, Vol de nuit, chap. i, OC I, op. cit., p. 113.
39 Voir Olivier Odaert, Saint Exupéry écrivain. Poétique et Politique de la gravité, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2018, p. 27-37.
40 Antoine de Saint Exupéry, Pilote de guerre, chap. xxi, OC II, op. cit., p. 195.
41 Ibid., chap. xxiii, p. 204.
42 Ibid., chap. x, p. 146.
43 Voir Amélie Goutaudier, « Pilote de guerre : une poétique de la défaite ? », Cahiers Saint Exupéry no VI, Thonon-les-Bains, Éditions de l’Astronome, 2022, p. 75-77.
44 Antoine de Saint Exupéry, Pilote de guerre, chap. xxiii, OC II, op. cit., p. 204.
45 Id., Vol de nuit, chap. xxii, OC I, op. cit., p. 166.
46 La métaphore portuaire sera reprise au chapitre xii : « Pour le pilote, cette nuit était sans rivage puisqu’elle ne conduisait ni vers un port (ils semblaient tous inaccessibles), ni vers l’aube : l’essence manquerait dans une heure quarante. Puisque l’on serait obligé, tôt ou tard, de couler en aveugle, dans cette épaisseur. » (Ibid., chap. xii, p. 145).
47 « Trois pilotes, chacun à l’arrière d’un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol ». (Ibid., chap. ii, p. 116).
48 Antoine de Saint Exupéry, Courrier Sud, IIIe partie, chap. vi, OC I, op. cit., p. 102.
49 Ibid., IIIe partie, chap. vii, p. 106.
50 Légèreté et ivresse que l’on trouve par exemple chez Francy Lacroix (En plein ciel. Impressions d'aviateur, sensations de vol, la guerre en avion, 1918), Gabriele d’Annunzio (Forse che sì forse che no, 1910) ou Joseph Kessel (L’Équipage, 1923 ; Vent de sable, 1929).
51 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, op. cit., p. 27.
52 Antoine de Saint Exupéry, Un vol, éd. Alban Cerisier, op. cit., p. 138-139.
53 Les hommes de l’exode sont tantôt décrits comme des « vers », des « fourmis » (ibid., chap. xv, p. 163), des « moutons sans berger », des « sauterelles », des « poissons, hors de l’eau », des « parasites » et de la « vermine » (ibid., chap. xvi, p. 167-170) ; « C’est d’abord, avant tout, monstrueusement en dehors de l’humain » (ibid., p. 169). Pour une étude plus détaillée sur la description de l’exode, voir Amélie Goutaudier, « Pilote de guerre : une poétique de la défaite ? », art. cité, p. 73-75.
54 Antoine de Saint Exupéry, Pilote de guerre, chap. xv, OC II, op. cit., p. 162-163.
55 Ibid., chap. xvi, p. 169.
56 Ibid., chap. xvi, p. 174.
57 Kenneth White, « La géopoétique des fleuves », cycle « Les Rendez-vous fleuves », Festival Parole Ambulante, Bibliothèque municipale de Lyon, 18 octobre 2011, consulté le 1er février 2024. URL : https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=568.
58 Gaston Bachelard, op. cit., p. 205.
59 Si la réflexion environnementale, telle qu’elle sera développée dans l’univers romanesque à partir des années 1950 (voir Pierre Schoentjes, Littérature et Écologie. Le Mur des abeilles, Paris, Éditions José Corti, « Les Essais », 2020, p. 83), n’apparaît pas frontalement dans les écrits de Saint Exupéry, il est évident que chacune de ses œuvres redit sa conviction d’une liaison cosmique des êtres et de la nature, de sorte que nous sommes sans cesse conviés à une réflexion sur la façon dont l’homme habite la terre et, en corollaire, sur son rapport à l’environnement. Voir Amélie Goutaudier, « L’éthique écopoéticienne chez Antoine de Saint Exupéry », Mosaïque [En ligne], no 20 : « Terre et humains, un monde en partage », dir. Samy Bounoua, Lucia della Fontana et Blaise de Saint Phalle, Éditions de l’Université de Lille, décembre 2023, mis en ligne le 05 février 2024. URL : https://www.peren-revues.fr/mosaique/2404.
60 Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, chap. lxxxviii, OC II, op. cit., p. 560.
61 Ibid., chap. xcii, p. 566.
62 Kenneth White, op. cit.
63 Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, chap. lxxi, OC II, op. cit., p. 530.
64 Ibid.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2043.html.
Quelques mots à propos de : Amélie Goutaudier
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
