Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
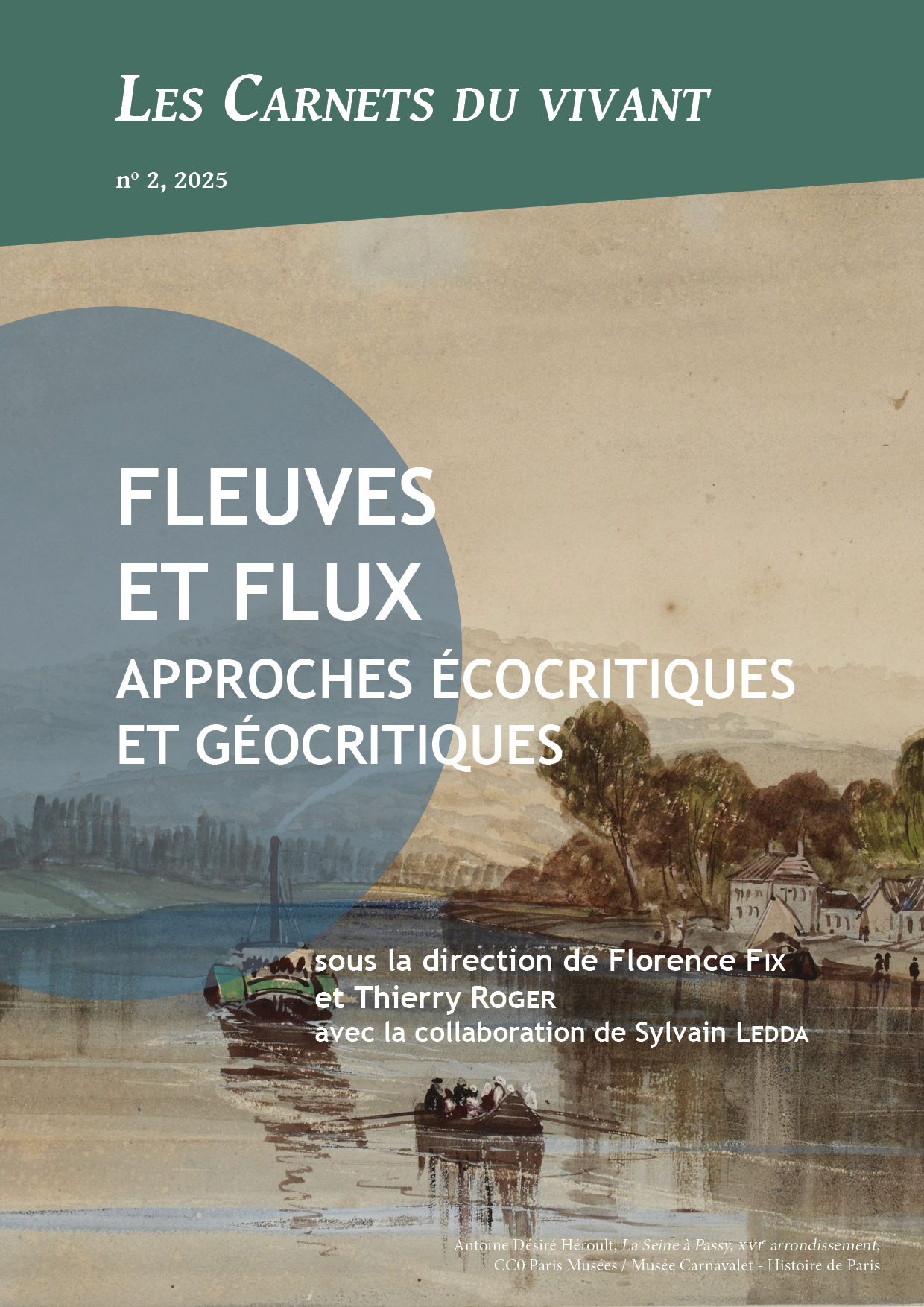
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
Alain Cresciucci
Je suis tenté dès que je vois l’eau… La plus petite raison ça va !… je ferais le tour du bassin des Tuileries au moindre prétexte ! dans un verre de montre si j’étais mouche un tout petit peu… n’importe quoi pour naviguer ! Je traverse tous les ponts pour des riens… Je voudrais que toutes les routes soient des fleuves… C’est l’envoûtement… l’ensorcellerie… c’est le mouvement de l’eau… (Guignol’s Band)
1Les fleuves traversent l’œuvre de Céline. De Voyage au bout de la nuit à Rigodon, il n’est pas un roman d’où un cours d’eau soit absent. Quatre fleuves : la Seine, la Tamise, le Congo et la Garonne (les deux derniers ne sont pas nommés mais le cotexte et la biographie du narrateur permettent de les identifier). Ce dernier point montre que le besoin de coller au réel n’est pas le souci premier de Céline… Dans un registre tout à fait différent, Giono dans Le Chant du monde n’a pas donné de nom au fleuve qui joue un rôle capital dans le roman… Céline, lui, nomme la Seine et la Tamise, fleuves appartenant à un patrimoine culturel universel difficile à occulter en régime réaliste mais, surtout, parlant de ses villes de prédilection.
2Le fleuve relève d’un thème dominant chez Céline : la liquidité. Il outrepasse, et de beaucoup, le premier degré d’illusion référentielle quasiment nécessaire à l’établissement de l’histoire – le récit se fonde en se localisant – et à la connivence avec le lecteur. Sa présence traduit (ou trahit) une vision du monde. Comme la ville, la campagne, la mer (le navire), le fleuve est un objet herméneutique de l’imagination matérielle, du thème obsédant euphorique ou dysphorique du liquide, lui-même lié aux thèmes du mouvement vs l’enlisement, de l’ouverture vs l’enfermement… Ce n’est pas de la nature brute, mais de la nature « greffée » ou, si l’on préfère, interprétée. Ce que je nomme imparfaitement l’interprétation (poétique) – d’autres, plus bachelardiens, préfèreraient « rêverie » – pouvant se combiner à des considérations historiques, voire idéologiques1.
3Introduisons en préambule deux cours d’eau, non mentionnés encore, la Sprée et le Danube, qui figurent brièvement dans la trilogie allemande2.
4La Spree, dans Nord, ne semble guère s’imposer pour peindre le Berlin sens dessus dessous de 1944 que traversent Céline, Lili et Bébert. Mais, outre un indice réaliste, la Sprée témoigne d’une attention particulière au fleuve :
[…] Berlin a jamais fait rire, personne ! un ciel que rien peut égayer, jamais… déjà à partir de Nancy, vous avez plus rien à attendre… que de plus en plus d’ennuis, sérieux, énormes labeurs, transes de tristesse, guerres de sept ans… mille ans… toujours !… regardez leurs visages !… même leurs eaux !… leur Spree… ce Styx des teutons… comme il passe, inexorable, lent… si limoneux, noir… que rien que le regarder il couperait la chique, l’envie de rire, à plusieurs peuples… on le regardait du parapet, nous là, Lili, moi, Bébert3…
5Ici se mêlent l’imaginaire, l’historique et l’idéologique. L’uniformité du paysage, la lenteur, la sombreur et l’épaisseur de l’eau – tout le contraire d’une eau vive – nous renvoient à l’un des aspects dominants de l’imaginaire célinien renforcé par l’allusion mythologique au fleuve des Enfers et donc à la mort… autre obsession majeure. L’allusion à ces terres de guerre permanente renvoie à l’actualité du narrateur fuyant l’avancée des « libérateurs ». Mais tout cela, dans un instant en suspens, en regardant le fleuve du haut d’un pont : l’eau est à la fois le véhicule de la rêverie et le miroir de la misérable condition de fugitifs.
6Élément essentiel du décor de la petite ville de Si(e)gmaringen avec son « biscornu » château des Hohenzollern, le Danube de D’un château l’autre dépasse le rôle d’indice de localisation. La pseudo enclave française où se sont retranchés le gouvernement de Vichy et ses derniers fidèles n’est qu’un trompeur décor d’opérette : « […] site très pittoresque !… touristique !… mieux que touristique !… rêveur, historique, et salubre !… idéal ! pour les poumons et pour les nerfs… un peu humide près du fleuve… peut-être… Le Danube… la berge, les roseaux4… ». Ce petit fleuve violent et gai, la blaue Donau de Strauss, que Céline qualifie ironiquement d’« optimiste » et d’« un immense avenir » a un côté inquiétant : « très sinueux, tourmenté, le Danube !… et puis tout d’un coup large ! très large… et plus du tout brisant, mousseux… un grand plan d’eau calme… tout de suite après le pont du chemin de fer5… » En fait, c’est bien un fleuve allemand, changeant, menaçant, « furieux, bruyant » qui a tout pour angoisser ces fuyards, d’autant que les chasseurs se rapprochent : la R.A.F6, et « l’armée Leclerc tout près… avançante… ses Sénégalais à coupe-coupe… pour nos têtes !… » Le fleuve témoigne de la guerre, comme en témoignait la Loire dans l’épisode du bombardement du pont d’Orléans de Guignol’s band… et la Seine, d’une manière plus hallucinée, dans Féerie pour une autre fois7. Au-delà de cette inscription dans l’histoire immédiate, Céline insère le Danube dans un songe apocalyptique – une des nombreuses variations de son obsession du néant – où, dans une colère élémentaire le fleuve liquidera des siècles et des siècles d’histoire :
[…] il [le château] sera parti au Danube !… le Schloss et la Bibliothèque ! labyrinthes !… boiseries !… et porcelaines et oubliettes !… au jus ! et souvenirs !… et tous les princes et rois du Diable !… au delta, là-bas !… ah ! Danube si brisant furieux ! il emportera tout !… ah ! Donau blau !… mon cul !… si fougueux colère frémissant fleuve d’emporter le Château et ses cloches… et tous les démons8 !…
7La Spree et le Danube sont des références limitées dans la chronique de l’odyssée allemande ; deux fleuves anonymes – le Congo et la Garonne –, qui n’occupent pas non plus un volume considérable, nous introduisent plus profondément dans la vision du monde célinienne. Si le Congo9 apparaît comme un constituant quasi obligatoire pour l’évocation de l’Afrique… au même titre que Fort-Gono (Douala), « précaire capitale » de la « Bragamance » (Cameroun), le comptoir de brousse, « Bikomimbo » ou la forêt équatoriale, il n’est pas certain que le cours d’eau méridional soit la Garonne. La Garonne absente de Toulouse (point de place du Capitole, ni de basilique Saint-Sernin non plus) ne contribue en rien au caractère vraisemblable de la ville, réduite ici à quelques stéréotypes de l’urbain ; c’est davantage le désir du lecteur de renforcer l’illusion référentielle que la nécessité narrative, qui pousse à cette identification.
8Le Congo de Voyage au bout de la nuit relève, comme la plupart des épisodes du roman, d’une transposition de la biographie de l’auteur. La description de la vie coloniale, de la forêt, du fleuve, de la moiteur qui dissout hommes et choses, Céline en a fait part à ses proches dans sa correspondance10. Mais l’Afrique célinienne relève aussi de l’actualité et, en ce sens, Céline se place dans la lignée du Gide de Voyage au Congo et du Retour du Tchad qui précèdent Voyage de quelques années et relatent longuement le long séjour en Afrique de l’écrivain chargé de mission par le ministère des Colonies. La remontée du Congo, l’observation de la vie indigène, la dénonciation des abus de la colonisation sur des centaines de pages se retrouvent dans les chapitres africains de Voyage, mais le ton de Céline est à mille lieues de la tessiture touriste éclairé gidienne… L’Afrique relève aussi de l’intertextualité romanesque. Céline s’est toujours montré très discret quant à ses influences ou ses modèles et beaucoup plus prolixe dans ses anathèmes. Plusieurs commentateurs ont noté le rapport à Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, peinture très sombre de la colonisation dans les dernières années du xixe siècle – Claude Lévi-Strauss fut le premier à rapprocher les deux œuvres11. La structure est la même, le récit d’un témoin-acteur de la pénétration, à partir du fleuve, d’un continent originaire où l’implantation de la civilisation occidentale se fait par la violence et conduit ses agents à une forme de « dé-civilisation », de barbarie. Céline ne parle jamais de Joseph Conrad mais quelques points de contact, en plus du fonds pessimiste et anticolonialiste sont frappants. Dès avant la remontée du fleuve, la vision de la côte depuis le vapeur poussif abonde en notations inquiétantes :
[…] au long d’une côte sans forme bordée par une barre dangereuse, comme si la nature elle-même eût voulu en écarter les intrus ; dans les eaux ou en vue de fleuves, vivants courants de mort, dont les berges pourrissaient parmi la vase, dont le flot, épaissi par la boue, inondait des palétuviers convulsés qui semblaient se tordre vers nous, comme dans l’excès d’un désespoir impuissant12.
9À quoi Bardamu répond avec moins de pathétique :
Nous cheminâmes ainsi en vue de la côte, infinie bande grise et touffue de menus arbres dans la chaleur aux buées dansantes. Quelle promenade ! Papaoutah fendait l’eau comme s’il l’avait suée toute lui-même, douloureusement. Il défaisait une vaguelette après l’autre avec des précautions de pansements13.
10Le fleuve est plus présent chez Conrad que chez Céline. En 1890, il a navigué sur le Congo et découvert les ravages de la colonisation, double prédatrice du milieu naturel et des indigènes. Cette expérience déprimante enrichit le roman d’un marin obligé de mener, sur un rafiot à la limite de l’épave, le directeur d’une compagnie de commerce et ses séides à la recherche d’un collecteur d’ivoire, Kurtz, qui s’est affranchi des règles du commerce colonial et de la civilisation occidentale.
11Chez Céline, la remontée du fleuve est un des motifs, simplement effleuré, de l’itinéraire de son héros : « Ce que furent les dix jours de remontée de ce fleuve, je m’en souviendrai longtemps… Passés à surveiller les tourbillons limoneux, au creux de la pirogue, à choisir un passage furtif après l’autre, entre les branchages énormes en dérive, souplement évités. Travail de forçats en rupture14. » Le « limoneux » apparente le Congo à la Sprée, mettant en valeur, en dépit de la distance géographique et climatique, la nature malsaine d’une eau lourde, fangeuse, symbole évident de son caractère mortifère… Comme chez Conrad, le fleuve est la voie par laquelle on pénètre « au cœur des ténèbres », mais sa fonction primordiale est de participer au vaste complexe thématique de la dissolution généralisée – chaleur, humidité, exubérance végétale, maladies – dont le narrateur imagine qu’il est un outil patient et efficace : « Peut-être que rien de tout cela n’est plus, que le petit Congo a léché Topo d’un grand coup de sa langue boueuse un soir de tornade en passant et que c’est fini, bien fini, que le nom lui-même a disparu des cartes15… »
12Céline professe une répugnance pour le Sud et la chaleur16, répugnance qu’exprime sa hantise de la déliquescence, son exécration du mou, du visqueux17… La juxtaposition du « Petit Congo » et de la Garonne (?), complètement différents, voire franchement opposés renforce pourtant la cohérence de son univers romanesque. À l’étouffement du trop-plein, du trop humide africain succède le trop vide, le trop sec :
On peut s’y prendre de deux façons pour pénétrer dans la forêt, soit qu’on s’y découpe un tunnel à la manière des rats dans les bottes de foin. C’est le moyen étouffant. Je renâclai. Ou alors subir la montée du fleuve, bien tassé dans le fond d’un tronc d’arbre, poussé à la pagaie de détours en bocages et guettant ainsi la fin des jours et des jours s’offrir en plein à toute la lumière, sans recours.
…………………………………………………………………….
Les rivières ne sont pas à leur aise dans le Midi. Elles souffrent qu’on dirait, elles sont toujours en train de sécher. Collines, soleil, pêcheurs, poissons, bateaux, petits fossés, lavoirs, raisins, saules pleureurs, tout le monde en veut, tout en réclame. De l’eau on leur en demande beaucoup trop, alors il en reste pas beaucoup dans le lit du fleuve. On dirait par endroits un chemin mal inondé plutôt qu’une vraie rivière18.
13Mais une même fatalité unit les deux fleuves : la chaleur. Cette chaleur – « Une chaleur étonnante, à faire fumer toutes les surfaces. » – s’accorde aussi bien à l’expédition en pirogue qu’à la promenade en barque. À regarder dans le détail, on repère même une forme de réécriture. Les pêcheurs, « jaloux d’apéritifs, et retranchés derrière leurs siphons », se réfugient au bistrot comme le « colonisateur » « soudé à son apéritif glacé par l’habitude » renonce à affronter les rigueurs du climat de Fort-Gono, et la balade au fil du fleuve prend des allures de remontée du Congo avec les « longs remous plats », les « branches mortes » et les « rives brûlantes » d’une Garonne pourtant à l’étiage.
14Dans l’épisode toulousain, Bardamu, devenu médecin en banlieue parisienne, rend visite à son ami Robinson en convalescence à Toulouse. L’épisode parait plus arbitraire que le séjour africain. En fait, les deux se répondent car ils convergent, de manière plus dérisoire pour le second, vers le même dégoût du manque de tenue de l’animal humain… La promenade au bord du fleuve de Bardamu, Robinson et Madelon commence par une parenthèse enchantée, malgré la connotation négative de la chaleur, lorsque le trio tombe sur une péniche (la péniche est un attribut thématique du fleuve, comme le pont), « une péniche pour habiter seulement » d’où s’échappent les bruits d’une fête d’anniversaire. Mais la leçon en est amère :
Ferme tes jolis yeux, car les heures sont brèves…
Au pays merveilleux, au doux pays du rê-ê-ve,
Voilà ce qu’ils chantaient dans l’intérieur, des voix d’hommes et de femmes mélangées, un peu faux, mais bien agréablement tout de même à cause de l’endroit. Ça allait avec la chaleur et la campagne, et l’heure qu’il était et la rivière19.
15Cliché de littérature populaire, fête de famille, partie de campagne… pourquoi pas du Maupassant des bords de Garonne. Invités avec ses amis à partager les réjouissances, Bardamu sombre, après une courte euphorie dans un anéantissement douçâtre, refusant une intimité fusionnelle dont, par lâcheté, il ne cherche pas vraiment à sortir, conscient du double mensonge de cette béatitude de pacotille et de ce navire, amarré sur un fleuve faux, condamné à l’immobilité, davantage signe de clôture que de départ.
16Les statuts romanesques de la Seine et de la Tamise sont fort dissemblables. La Seine court à travers le paysage parisien (essentiellement la banlieue) de Voyage au bout de la nuit à Rigodon sous des modalités diverses et rarement sous des couleurs attractives. C’est dans Voyage qu’elle est la plus présente et chargée des représentations symboliques – fondées sur des données incontestables du réel – les plus insistantes, négatives le plus souvent…
17Avant d’aborder la Seine romanesque, un arrêt sur une considération politico-écologique de Bagatelles pour un massacre dont les échos, toutefois, sont audibles dans l’univers romanesque. Critiquant le manque d’ambition de l’Exposition universelle de 1937, Céline développe un projet d’aménagement de la Seine :
Par exemple tripler la Seine jusqu’à la mer, en large comme en profondeur… Voilà un programme qui existe ! C’est des choses qui peuvent compter ! Rendre la Seine super-maritime ! Assez de ces « bergeries »… ces rognages de bout d’égouts, ces épissures de « collecteurs »… Qu’on en sorte sacré nom de Dieu ! une bonne fois pour toutes ! C’est horrible tous ces petits biefs en suints de vidanges, ces lourds dépotoirs stagnants, ces décantages pestilentiels de tout le purin de vingt provinces… À la mer ! Vos péniches elles naviguent même plus, elles rampent visqueuses sur la merde. La Seine maritimisante, c’est déjà fort beau, mais ça ne suffît pas !… Non ! Non ! Non. Je décréterais davantage, il faut amplifier le trafic direction la mer d’une manière très monstrueuse ! léviathane ! Je décréterais la construction du plus bel autostrade du monde, d’une immense ampleur alors, cinquante mètres de large, quatre voies, direction Rouen et la Manche. Vous voyez ça20?…
18Ce programme absolument chimérique témoigne que l’imaginaire fonctionne également dans le genre pamphlétaire ; Céline convoque le même champ lexical, parfois les mêmes termes que dans le roman – la Seine « égout », « dépotoir », l’engluement dans le visqueux… Les développements politiques sur le fleuve, sur la politique industrielle et de santé publique qui suivent – le programme s’étend sur plusieurs pages émaillées d’invectives antisémites – sont comme une proposition positive au constat accablé / accablant de Voyage.
19La Seine n’est pas uniquement le fleuve pollué, déchu21 de Voyage au bout de la nuit, elle peut être, de temps en temps, un fleuve vivant et parfois jusqu’à la colère… Mort à crédit, roman de Paris, n’est pas un roman de la Seine, mais, dans une des premières séquences, le narrateur rappelle sa naissance rampe du Pont, à Courbevoie : « C’est sur ce quai-là, au 18, que mes bons parents firent de bien tristes affaires pendant l’hiver 92, ça nous remet loin. […] La Seine a gelé cette année-là. Je suis né en mai22. »
20Pour Ferdinand enfant, la Seine est d’abord effrayante quand il la traverse la nuit avec son père pour rentrer à leur domicile de la rue de Babylone : un « grand gouffre au fond, qui bouge et ronchonne ». Par contre, vue des coteaux d’Athis-Mons où le bohème oncle Arthur s’est installé, le spectacle du fleuve est un enchantement :
La Seine jusqu’à Villeneuve-Saint-Georges et de l’autre côté les bois de Sénart. On pouvait pas rêver mieux. […] On a regardé les remorqueurs, le mouvement du sas des péniches qu’ont l’air si sensibles, fragiles comme du verre contre les murailles… Elles osent aborder nulle part. L’éclusier bouffi crache trois fois sa chique, tombe la veste, ramone et râle sur la chignole… La porte aux pivots tremblote, grince et démarre à petits coups… Les remous pèsent… les battants suintent et cèdent enfin… l’Arthémise pique un long sifflet… le convoi rentre… Plus loin, c’est Villeneuve-Saint-Georges… La travée grise de l’Yvette après les coteaux… En bas, la campagne… la plaine… le vent qui prend son élan… trébuche au fleuve… tourmente le bateau-lavoir… C’est l’infini clapotis… les triolets des branches dans l’eau23…
21Sans aucun doute les images les plus heureuses – que l’on retrouvera à propos de la Tamise. Tous les éléments de la féerie du fleuve sont réunis : l’ampleur du point de vue, les navires – remorqueurs et péniches –, les mouvements de l’air et de l’eau…
22Le prologue de D’un château l’autre, qui met en scène l’auteur dans sa maison de Bellevue sur les hauteurs de Meudon, reprend un instant le motif heureux du panorama du fleuve, redoublé par la nostalgie (étonnante !) de son enfance :
[…] regardez ce panorama ! les collines, Longchamp, les Tribunes, Suresnes, les boucles de la Seine… deux… trois boucles… au pont, tout contre, l’île à Renault, le dernier bouquet de pins, à la pointe… Bien sûr c’était bien plus campagne quand nous venions avec mon père livrer la guipure, l’éventail… les mêmes sentiers vers 190024…
23Mais retenons avant tout le long épisode de La Publique, version célinienne de la barque de Caron… En visite chez une patiente la nuit tombée, le docteur Destouches aperçoit sur le quai une foule de fantômes se dirigeant vers un étrange navire, péniche ou bateau-mouche. L’acteur Robert Le Vigan (pourtant exilé en Argentine !) l’aborde sur le quai et lui explique que La Publique est la barque de Caron qui embarque les morts – en fait des collaborateurs exécutés ou lynchés à la Libération – vers les Enfers… non sans avoir préalablement prélevé son obole et sévèrement châtié ses passagers, faisant ainsi à nouveau office de juge et de vengeur. Craignant de se voir embarqué et battu par Caron, donc de nouveau condamné, Céline se dispute avec Le Vigan et Émile (un ancien de la L.V.F.) et remonte précipitamment vers sa maison… L’épisode se termine par la rencontre avec sa femme sur le chemin du retour. Délire causé par la fièvre, sentiment exacerbé d’une culpabilité imprescriptible ? Céline nous procure sa variation du « complexe de Caron » – la Seine, ici, devenant Styx (comme la Sprée de Nord), le bateau-mouche funèbre symbolisant la mort comme voyage perpétuel… un « crédit » qui ne se solde jamais.
24Dans Féerie et Rigodon, la Seine n’a qu’un rôle mineur. Céline rappelle les grandes crues : une fois pour parler d’un déboire professionnel – la faillite d’une maison de Santé à Sannois par la faute d’une année pluvieuse : « Les rives de la Seine arrachées ! Des inondations en juillet ! » – l’autre, souvenir de la crue centennale de 1910. Ce n’est pas pour vouer le monde à un déluge liquidateur qu’il revient sur cette catastrophe naturelle historique ; au contraire, elle lui remet en mémoire son habileté et sa chance dans ses jeunes années… dont il aurait bien besoin pour passer d’Allemagne au Danemark :
[…] y a toujours une petite chance, très fluette, au cours des pires calamités… je voyais à Ablon, tout môme, pendant les inondations, vous savez 1910, vous aviez qu’à friser la berge, les cailloux, à la godille, et vous remontiez peinard… un chouïa de travers ? hop !… vous vous retrouviez à Choisy, embarqué toupie dans les remous… quille en l’air !… votre fin25 !…
25La première occurrence du mot « Seine », dans Voyage au bout de la nuit, n’a rien à voir avec le fluvial : une comparaison des artères temporales du général des Entrayes avec les « méandres de la Seine à la sortie de Paris ». Curieux mais pas inexplicable…
26La seule mention d’une Seine parisienne (deuxième occurrence) se distingue par sa tonalité et sa portée symbolique. Le docteur Bardamu s’est rendu à Paris pour demander conseil à propos de la maladie du jeune Bébert. Au retour, au moment de traverser la Seine pour rentrer à Rancy, il hésite à franchir son Rubicon à lui – « Tout le monde n’est pas César ! » – et s’arrête, contemplatif :
Au bord du quai les pêcheurs ne prenaient rien. Ils n’avaient même pas l’air de tenir beaucoup à en prendre des poissons. Les poissons devaient les connaître. Ils restaient là tous à faire semblant. Un joli dernier soleil tenait encore un peu de chaleur autour de nous, faisant sauter sur l’eau des petits reflets coupés de bleu et d’or. Du vent, il en venait du tout frais d’en face à travers les grands arbres, tout souriant le vent, se penchant à travers mille feuilles, en rafales douces. On était bien26.
27La méditation existentielle et lyrique sur le temps qui passe – le fleuve en littérature est propice à ce genre de spéculation – s’achève à la tombée de la nuit quand Bardamu se décide à passer rive droite après avoir acheté à une bouquiniste un « vieux petit Montaigne » qui comporte une consolation de l’écrivain à sa femme après la mort de leur fille. Le passage est vraiment unique par la rupture de ton qu’il introduit dans le roman et par sa construction. N’allons pas jusqu’à dire que Céline « fait son Rousseau » ou « son Lamartine », mais le fleuve devient véritablement état d’âme, passant de la mélancolie vague et douce – « joli dernier soleil » (« joli » n’est pas un adjectif fréquent dans Voyage), « un peu de chaleur », les reflets « bleu et or », le vent « tout frais » – à la tristesse de la nuit tombante quand la Seine tourne « au sombre » et que l’eau devient « toute lourde ».
28Dès l’installation à Rancy, dans la seconde partie, la Seine est inséparable du décor déprimant de la banlieue nord-ouest. Tout de suite, le ton est donné, le fleuve est un « gros égout qui montre tout » : « Plus au fond encore, c’est toujours la Seine à circuler comme un grand glaire en zigzag d’un pont à l’autre27. » En quelques mots, elle est thématiquement rattachée à la liquidité négative – elle ne coule pas, elle zigzague – corrompue – elle est associée à la « gadoue » et semble générer la « poisse », au double sens du terme, qui enveloppe le paysage.
29Céline, par les yeux de Bardamu, intègre la Seine et Rancy dans sa Weltanschauung obsédée par la hantise de la débâcle, physique et morale, à laquelle sont promis êtres et choses. La traduction anthropomorphique du monde extérieur favorise et justifie une métaphysique de l’imagination qui appelle les interprétations thématiciennes. On aura cependant du mal à les placer dans la continuité bachelardienne de « l’eau et les rêves » ou de « la terre et les rêveries du repos ». Plutôt : la ville, le fleuve et les cauchemars de la matière ! Le fleuve s’inscrit dans la réalité socio-économique de l’entre-deux guerres ; le faubourg devient banlieue et ce développement de la périphérie de la ville s’accompagne d’une dégradation, d’une précarisation supplémentaire. Ainsi, Vigny, autrefois village de Seine-et-Oise, est progressivement absorbé par la modernité, l’« américanisation » : « La Seine a tué ses poissons et s’américanise entre une rangée double de verseurs-tracteurs-pousseurs qui lui forment au ras des rives un terrible râtelier de pourritures et de ferrailles. Trois lotisseurs viennent d’entrer en prison. On s’organise28. » On observe qu’à la différence des quais parisiens où une complicité s’est établie entre pêcheurs et poissons, à Vigny la Seine a « tué » ses poissons ; elle est devenue un fleuve industriel ou plus exactement un fleuve industriellement et brutalement exploité comme l’exprime la suite agressive des phonèmes /R/ du « terrible râtelier de pourritures et de ferrailles ».
30Et cependant… Cet univers de détresse n’est pas sans poésie, poésie cafardeuse que l’on retrouve dans le réalisme-poétique cinématographique. L’eau est, malgré tout, le véhicule d’une rêverie, fût-elle désespérée. Plusieurs fois le narrateur succombe à la magie du fleuve et de ses berges et nous peint des tableaux impressionnistes comme ce « Du pont de Gennevilliers » :
Les brumes lentes du fleuve se déchirent au ras de l’eau, se pressent, passent, s’élancent, chancellent et vont retomber de l’autre côté du parapet autour des quinquets acides. La grosse usine des tracteurs qui est à gauche se cache dans un grand morceau de nuit. Elle a ses fenêtres ouvertes par un incendie morne qui la brûle en dedans et n’en finit jamais29.
31Même la matière infecte et malodorante contribue au charme du fleuve… quand l’âme et l’heure s’y prêtent :
Elle n’en avait plus de couleur cette boue, tellement qu’elle était vieille et fatiguée par des crues. Sur les soirs l’été, elle devenait parfois comme douce, la boue, quand le ciel, en rose, tournait au sentiment. C’est là sur le pont qu’on venait pour écouter l’accordéon, celui des péniches, pendant qu’elles attendent devant la porte, que la nuit finisse pour passer au fleuve. Surtout celles qui descendent de Belgique sont musicales, elles portent de la couleur partout, du vert et du jaune, et à sécher des linges plein des ficelles et encore des combinaisons framboise que le vent gonfle en sautant dedans par bouffées30.
32On notera le contraste avec les objets, les couleurs et les sonorités de la première évocation de la Seine à Vigny… plus de râtelier et de ferrailles, tout est apaisé au son de l’accordéon, comme à Toulouse, mais cette fois, c’est une musique authentique, pas un divertissement d’artiste. Commencée dans les coloris pastel, estompés, qui conviennent aux humeurs maussades, la description finit sur l’image des péniches – la péniche célinienne, artisanale, populaire, est l’enfant du fleuve –, bouquets de fleurs porteuses de promesses érotiques.
33Voyage au bout de la nuit finit au bord de l’eau par une rêverie de demi-sommeil de Bardamu. Le fleuve, alors, occupe une place fantasmatique qui mêle en une condensation saisissante les principaux composants imaginaires et matériels du thème fluvial. D’une part, le pont, l’écluse, la péniche et surtout le remorqueur ; d’autre part, l’idée de la disparition du monde par effacement, dissolution (comme Topo, anéanti par une colère du Congo). Le remorqueur, outil funeste du progrès, tel le joueur de flûte de Hamelin, attire le monde dans un néant liquide, remise ses objets, les êtres et la Seine aussi dans l’oubli :
De loin, le remorqueur a sifflé ; son appel a passé le pont, encore une arche, une autre, l’écluse, un autre pont, loin, plus loin… Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qu’il emmenait, la Seine aussi, tout, qu’on n’en parle plus31.
34Que Guignol’s band où se rencontrent les références à la Tamise soit écrit à une époque où Londres est interdit à Céline – son narrateur reconnaît que « C’est fini tout ça », qu’on ne lui permettra jamais de retourner à Londres – stimule son imaginaire. Le roman redécouvert, Londres, premier jet d’un roman complet, qui date des années 1934-1935, raconte une histoire assez proche de Guignol’s band mais en plus sombre, plus hard, en moins rêveur, et qui laisse moins de place à la magie du fleuve.
35Dans le sombre univers de Céline, Guignol’s band – auquel il faut donc maintenant adjoindre Londres –, roman inachevé et méconnu, est sans aucun doute l’œuvre qui concentre le plus d’allégresse et d’enchantement. Il serait tout de même abusif d’y voir un roman de la joie de vivre : le fond en est bien inquiétant, car Ferdinand, plus ou moins hors-la-loi, vit avec l’angoisse d’être renvoyé au front.
36J’emprunte à Londres l’épigraphe de cette balade sur la Tamise : « La Tamise c’est beau. C’est la nuit du monde qui coule, sous les ponts. Ils se lèvent comme des bras pour qu’elle passe. Ça me tente moi la Tamise, ça m’a toujours tenté32. » Londres est la ville que Céline a le plus aimée, elle tient son charme de sa double nature de ville-fleuve et de ville-port. L’image globale que l’on en retire relève du rêve et de la féerie – « Tous les grands rêves naissent à Londres. » Dans les moments les plus noirs où le fleuve semble participer à la morosité du climat, le narrateur trouve malgré tout un motif de consolation ; même le brouillard et les fumées du port qui noient la ville ont leur petit mérite :
De La Vaillance, le pub en face, on le voit plus du tout l’Hospital les jours vraiment où ça rafflue… où les buées déferlent en vapeur, en énormes torrents… Juste on aperçoit les petites lueurs… que ça cligne un peu dans les fenêtres… et le gros fanal jaune à la porte… C’est bien déjà presque effacé… C’est pas mauvais pour les soucis… ça s’en va… ça vous laisse tranquille33…
37La Tamise ne véhicule ni le pessimisme métaphysique ni la critique écologique dont la Seine de Voyage est l’un des prétextes. Ce qui ne signifie pas que Londres soit un site riant et la Tamise un lieu de plaisirs. Une partie des pages londoniennes rapportent les activités louches des docks, la faune qui hante ses pubs, les rixes, le cache-cache avec la police, les « bourres du Yard ». Mais Ferdinand sans cesse menacé, sans cesse embarqué dans des entreprises calamiteuses, garde néanmoins un brin d’espoir en contemplant le spectacle du fleuve. Spectacle, au sens propre, non dépourvu d’un émerveillement enfantin, tel ce panorama du Tower Bridge au matin :
Le grand Tower Bridge au loin sort doucement des brumes, il ouvre tout lentement son donjon, hausse tout haut ses géants bras d’arches, en plein fleuve comme ça, que les navires entrent… Les gros vapeurs vaporants, pouf ! pouf ! pouf ! en grands falbalas… branlent, s’avancent… en fumées noires… à grands panaches buées bleues, mauves, roses… Pavane au fleuve… au grand matin… Pavois d’atours… Les berges là-bas à l’est scintillent à mille falots, agitent, tremblotent… les corvées agglutinent… attroupent… attaquent aux échelons… noir sur gris… C’est le grand branle-bas des abords… les équipes qui rallient à l’aube déboulinent aux docks… l’échange des bras… la nuit, les nuiteux qui débrayent… deux trois treuils qui hoquent, broyent horrible… jusqu’aux cieux que ça cogne… grince… et puis tout rengrène, tchutt ! tchutt ! tchutt ! à la petite vapeur… La colosse Portland la grue beugle un farouche coup… Le réveil est là. Le fleuve qu’est frétillé, croisé, fouetté dans tous les sens… Cent petits canots précipitent, foncent au trafic… à la godille… à teuf ! teuf ! teuf !… à souquer… raffluent de partout… aux sillages… aux étraves… aux poupes… à faufiler clampins d’étraves… bouchons d’écume… à frôler tout… arches… hélices… brassantes furieuses !… ardentes drisses au vol saisies… de bord à bord… poussahs cargos… écrasants monstres… fretins pilotes au petit jour de mousses en mousses prestes échappent… giclent plus loin… plus vifs encore… toupillent dandinent de vague en vague… éclaboussent34…
38La Tamise, possède le double caractère, bénéfique, d’être encore fleuve et déjà mer, d’où la cohabitation d’embarcations de toutes sortes, du youyou aux cargos et aux fins voiliers. C’est sur ces derniers que le narrateur s’exalte ; leur élancement et leur légèreté en font des créatures mythiques à la fois maritimes et aériennes, propices à son rêve de fuite… de fuite en beauté. Mais la lourdeur du cargo n’est pas négative car il transporte les marchandises du monde entier et par cette faculté de sillonner le globe brise symboliquement la clôture qui retient Ferdinand – à la fin du roman, il essaie en vain d’embarquer sur le Kong Hamsun en partance pour l’Argentine.
39L’opposition avec la Seine repose sur quelques traits communs dont les propriétés sont inversées. Le premier concerne leur configuration. Au resserrement de la Seine prisonnière du dispositif industriel – « usines », « treuils », « palissades » – répond la largeur de la Tamise, ce qui, dans le registre réaliste justifie la présence des gros navires et l’encombrement des quais et, dans l’ordre de l’imaginaire outrepasse le simple visuel pour déboucher sur la rêverie du grand large :
Elle a bien trois ou quatre cents mètres la Tamise à cet endroit-là. Une beauté d’étendue ! Je me sens en train de vous raconter encore une fois, encore un coup, ce fastueux spectacle des eaux, à la perspective du trafic, les paquebots, les cargos qui peinent, crachinent, poumonent à la remonte, au juste des rives, à précaution des balises, à friser les bouées, coquets monstres, tout pavoisés, cernés d’envols, mouettes et courlis filant l’âme, mouillant ci, là, pétales du ciel au clapotis35.
40Pour que cette « étendue » et le fastueux spectacle soient perceptibles, il faut un regard dominant. Le point de vue sur la Seine se situe au ras des berges (sauf pour uriner quand « les gens grimpent sur les tas » et lors de l’arrêt sur les quais parisiens lorsque Bardamu observe les pêcheurs). À Rancy ou Vigny la Seine est perçue comme enfoncée, prise, comme les hommes, dans les « gadoues noires ». Même le pont, celui de Gennevilliers, ne prend pas de hauteur, il est « tout plat, tendu sur la Seine ». Au contraire, dans Guignol’s, le pont permet d’embrasser plus largement la perspective – ainsi le London Bridge : « Il est haut… de la Trooley Street je veux dire… C’est une escalade… Mais de la rampe alors on découvre ! On voit presque jusqu’à Woolwich, tout le panorama, tout le fleuve jusqu’à Manor Way… les Docks King… C’est une admirable perspective36… » Ce choix d’un lieu élevé – où Proust thématicien décèle « un certain sentiment de l’altitude se liant à la vie spirituelle », chez Stendhal – revient plusieurs fois et ouvre sur l’espoir-rêverie de départ :
Ça se trouvait situé admirable, un peu en dehors de Greenwich, en plein sur le parc et puis au loin sur la Tamise, tout le panorama du fleuve… une féerie de spectacle… De ses fenêtres au premier étage on apercevait les gréements, tout l’Indian Dock, les premières voiles, les agrès, les clippers d’Avril, les long-courriers d’Australie… Plus loin encore, passé Poplar, les cheminées ocre, les wharfs des Peninsulars, les paquebots des Straits, blanc éclatant à superponts37…
41Le plus remarquable de ces traits tient au mouvement et à l’activité fluviale. La Seine de Voyage se traîne, « zigzague », étouffée par la pollution, écrasée par le poids du ciel, couvercle grisâtre qu’aucun souffle de vent ne semble jamais dissiper. La Tamise, par contre, est vive, agitée par le trafic incessant et balayée par un grand courant d’air qui remonte de l’estuaire – « les bouffées de la mer » :
C’est par là vraiment le gros trafic, le grand charroi vers les docks… On peut dire que ça n’arrête pas !… le tohu-bohu perpétuel… ça s’engouffre entre les murailles, les pans, les hauteurs de falaises… Ça ronfle… fracasse là-dedans, déboule, cahote… limonniers… fardiers, camions lourds jusqu’aux soutes, jusqu’au bord de l’eau, en plein décor, la scène du fleuve, toute la lumière, où le vent déferle, le songe emporte38…
42Nous ne savons pas ce que charrient les péniches de Voyage, sans doute du charbon, du grain, divers matériaux, mais nous connaissons dans le détail les trésors que renferment les docks londoniens. À la différence de la Seine, la Tamise est un fleuve nourricier… et commercial. Guignol’s band manifeste une euphorie de la marchandise bien surprenante chez Céline. La liste est longue, souvent formulée dans un langage poétique, des produits débarqués sur les différents « wharfs » – l’énumération hyperbolique de ces produits en un désordre surréaliste et non dépourvu d’effets comiques soulignant que Céline, l’ascète, ne s’est pas converti au dogme de la consommation39.
43Céline n’a pas délibérément opposé la Seine et la Tamise, c’est pourtant l’impression que donne la lecture comparée des pages consacrées aux deux fleuves, en quoi on peut voir une expression de la double postulation de l’imaginaire célinien. L’interprétation de l’imaginaire célinien réduit au nihilisme, à l’anti-humanisme agressif, à l’obscénité, néglige son versant enthousiaste. Londres et la Tamise fournissent l’occasion de l’explorer : féerie des enfants, féerie du port et de ses bruits, des couleurs changeantes du fleuve, de la brume (moins du brouillard), sans oublier le lyrisme amoureux de la passion de Ferdinand pour la jeune Virginie.
1 Sur l’imagination spatiale et matérielle chez Céline, l’ensemble des éléments sensibles qui constituent la matière de son expérience créatrice, voir, par exemple, Alain Cresciucci, Les Territoires céliniens, Paris, Aux amateurs de livres-Klincksieck, 1990 ; « Climatologie », dans Céline. Actes du colloque de Paris (1992), Tusson, Éditions du Lérot et Société des Études céliniennes, 1993, p. 91-100.
2 Je laisse de côté la Medway, petit fleuve côtier du Sud de l’Angleterre, qui coule au bas de la pension de Ferdinand à Rochester. Nora, amoureuse de son jeune pensionnaire, s’y suicide – l’eau « est la vraie matière de la mort bien féminine » – nous fournissant un très bel exemple du « complexe d’Ophélie » cher au Bachelard de L’Eau et les Rêves.
3 Louis-Ferdinand Céline, Nord, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome II, 1974, p. 334. Toutes les références données ci-après sont issues de l’ancienne édition « Bibliothèque de la Pléiade », soit t. 1, 1981, t. II, 1974, t. III, 1988, t. IV, 1993.
4 Louis-Ferdinand Céline, D’un château l’autre, t. II, p. 102.
5 Ibid., p. 112.
6 « … mais la R.A.F. cherchait le pont… juste le pont ! au moment précis !… pas du mirage !… ils lâchaient tous leurs chapelets de bombes au-dessus du pont, à pic ! tout à trac !… trois quatre avions à la fois… comment ils faisaient pour le louper ?… leurs chapelets de bombes faisaient geysers ! le Danube en bouillait ! et de ces éclaboussements de vase !… et dans les labours !… trois… quatre kilomètres dans les champs !… », ibid., p. 132.
7 « Y a de la rage à la D.C.A. !… les sirènes arrêtent plus de miauler, pas le même ton que les avions, mais presque… tout l’horizon est en dentelles… en fines résilles de lumières… projectoires, balles crépitantes… on voit bien les coteaux d’Enghien !… et la trouée vers Mantes, Meulan, l’argent, les voltes de la Seine… maintenant par l’effet des bombes la Seine bouillonne !… jugez l’effet !… », Louis-Ferdinand Céline, Féerie pour une autre fois, t. IV, p. 187.
8 Louis-Ferdinand Céline, D’un château l’autre, t. II, p. 132.
9 Le nom Congo vient deux fois dans le récit de Bardamu : pour désigner la société qui l’emploie – la Compagnie Pordurière du Petit Congo – et le fleuve qui baigne Topo, le poste où il débarque avant de gagner sa « factorie ».
10 Voir Cahiers Céline 4 – Lettres et premiers écrits d’Afrique, 1916-1917, Paris, Gallimard, 1978.
11 « On pense à Conrad, mais un Conrad dont les brumes de poésie et de mystère se seraient coagulées et solidifiées en arêtes coupantes, où les aventuriers sont plus simplement des exploiteurs et des escrocs, les indigènes secrets, des imbéciles, et le cerveau des Européens, troublé par le climat et l’atmosphère exotique, une masse moisissante d’alcool, de vérole et de fièvre. », « Louis-Ferdinand Céline : Voyage au bout de la nuit », L’Étudiant socialiste, 4, 1933, p. 13-14.
12 Joseph Conrad, Jeunesse suivi de Au cœur des ténèbres, La Bibliothèque électronique du Québec, [s. d.], p. 128.
13 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, t. 1, p. 148.
14 Ibid., p. 61. À comparer au lyrisme de Conrad : « Remonter ce fleuve, c’était comme voyager en arrière vers les premiers commencements du monde, quand la végétation couvrait follement la terre et que les grands arbres étaient rois. Un cours d’eau vide, un grand silence, une forêt impénétrable. L’air était chaud, épais, lourd, languide. Il n’y avait pas de joie dans l’éclat du soleil. » (Au cœur des ténèbres, op. cit., p. 185).
15 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, t. 1, p. 162.
16 « Le Nord au moins ça vous conserve les viandes ; ils sont pâles une fois pour toutes les gens du Nord. Entre un Suédois mort et un jeune homme qui a mal dormi, peu de différence. Mais le colonial il est déjà tout rempli d’asticots un jour après son débarquement. », ibid., p. 116.
17 Sur cette question, voir en particulier les analyses fondatrices de Jean-Pierre Richard : Nausée de Céline (1973) et Microlectures (1979).
18 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, t. 1, p. 162 et p. 399.
19 Ibid., p. 401.
20 Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, Paris, Denoël, 1937, p. 236.
21 Au début de L’École des cadavres, Céline, déprimé par un procès en diffamation, déambulant le long de la Seine du côté de Courbevoie remarque une « péniche en pleine vase, renversée dessus-dessous » et plus loin « une sirène qui barbotait entre deux eaux, bourbeuses alors, très infectes… une fange pleine de bulles… » On ne peut mieux formuler la négativité de l’eau que par le renversement de deux motifs positifs : la péniche et la sirène.
22 Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit, t. I, p. 526.
23 Ibid., p. 612-613.
24 Louis-Ferdinand Céline, D’un château l’autre, t. II, p. 54.
25 Louis-Ferdinand Céline, Rigodon, t. II, p. 907. Plus avant, il a expliqué à Marcel Aymé, les subtilités de la navigation à la godille, apprise lors de ses nombreux séjours à Ablon durant son enfance : « … j’ai su remonter, glisser au port, à la remontée de l’énorme courant, au milli ! d’une cuillère, artiste ! crois-le ! un poil en deçà : le torrent t’emporte youyou, bonhomme, qu’un cri ! fini !… j’’tais phénomène à la crue ! j’ai su faufiler, au poignet, entre convois, remorqueurs, péniches moustachues, mortels gouvernails, bien avant de savoir les quatre règles, et même l’addition… » (ibid., p. 727).
26 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, t. I, p. 288.
27 Ibid., p. 238.
28 Ibid., p. 423.
29 Ibid., p. 461.
30 Ibid., p. 445.
31 Ibid., p. 505.
32 Louis-Ferdinand Céline, Londres, Paris, Gallimard, 2022, p. 67.
33 Louis-Ferdinand Céline, Guignol’s band, t. III, p. 157.
34 Ibid., p. 747.
35 Ibid., p. 662.
36 Ibid., p. 756.
37 Ibid., p. 189.
38 Ibid., p. 530.
39 « Éponges à sécher la Tamise ! de telles quantités !… Des laines à étouffer l’Europe sous monceaux de chaleur choyante… Des harengs à combler les mers ! Des Himalayas de sucre en poudre… Des allumettes à frire les pôles !… Du poivre par énormes avalanches à faire éternuer Sept Déluges !… Mille bateaux d’oignons déversés, à pleurer pendant cinq cents guerres… […] Je vous parle maintenant des confitures, vraiment colossales comme douceur, des Forums de pots de mirabelles, des Océans de houles d’oranges, de tous les côtés ascendants, débordants les toits, par flottes complètes d’Afghanistan !… Les loukoums dorés d’Istanbul, pur sucre, tout en feuilles d’acacias… Des myrtes de Smyrne et Karachi… Prunelles de Finlande… Chaos, vallons de fruits précieux entreposés sous portes triples, des choix à pas croire de saveur, des féeries de Mille et Une Nuits en amphores sucrées ravissantes, des joies pour l’enfance éternelle promises du fond des Écritures… », ibid., p. 109-110.
