Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
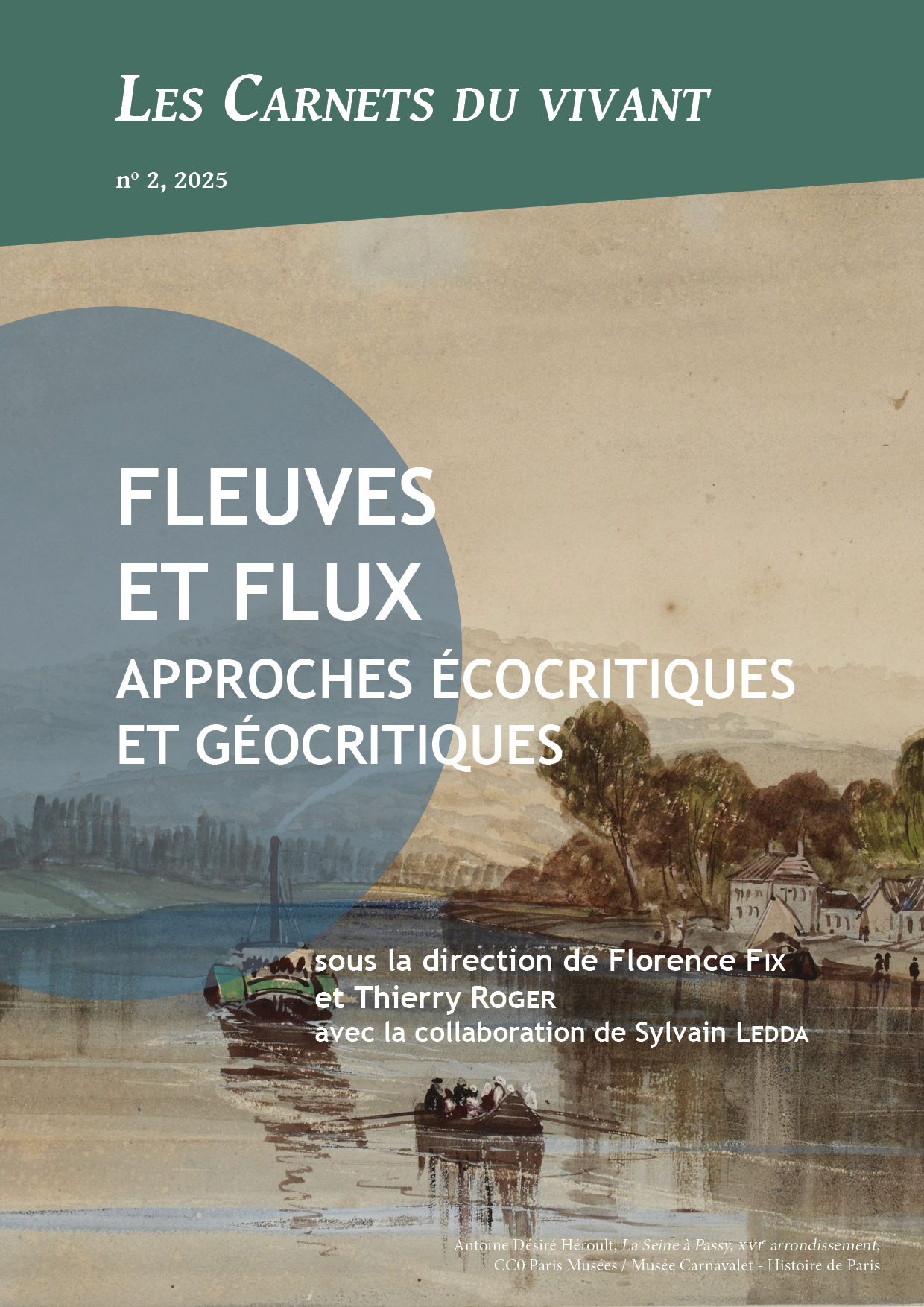
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
Ralf Junkerjürgen
1Déjà dans Cinq semaines en ballon, le roman initial des Voyages extraordinaires de Jules Verne, les fleuves jouent un rôle central. L’équipe d’explorateurs menée par le Britannique Fergusson veut d’abord atteindre en ballon les sources du Nil, encore inconnues à l’époque. Ce que d’autres chercheurs n’ont pas pu faire à pied, l’aérostat le fait si facilement que l’objectif de l’expédition se déplace rapidement. Les sources du Nil ne s’avèrent plus du tout être le point d’arrivée, mais le point de départ, ou pour reprendre les termes de Fergusson : « voici que nous commençons véritablement notre traversée africaine. Jusqu’ici nous avons surtout suivi les traces de nos devanciers. Nous allons nous lancer dans l’inconnu désormais1. » Le Nil devient ainsi une frontière à franchir pour pénétrer dans la terra incognita africaine. L’intérieur du continent se caractérise plutôt par un manque d’eau, prétexte à un récit dont le point culminant est un épisode dans le désert où les aérostiers risquent de mourir de soif. Le salut viendra finalement d’un autre fleuve, le Sénégal, que les explorateurs devront traverser pour se mettre à l’abri de dangereux bandits. Sur l’autre rive, ils sont accueillis par des soldats français et se trouvent à nouveau dans une région dominée par les Européens. Si les fleuves et leurs sources représentent donc d’une part des enjeux de recherche importants pour l’expédition géographique, ils constituent d’autre part des frontières réelles et sémantiques au sens de Lotman2. En effet, ils séparent les espaces connus des espaces inconnus, les espaces civilisés des espaces non civilisés, les espaces non dangereux des espaces dangereux.
2Dans Michel Strogoff également, les cours d’eau sont intéressants sur le plan de la création de suspense, surtout lorsqu’ils doivent être traversés. Dans le récit, ils marquent à la fois des obstacles et des zones de danger. En traversant l’Irtyche, Strogoff et sa compagne Nadia sont attaqués par des Tartares et séparés l’un de l’autre. Quant au fleuve Obi, Strogoff le traverse ensuite lorsqu’il s’enfuit et trouve refuge sur l’autre rive. Plus tard, le large Yeniseï est également traversé dans une calèche qui est emportée par le courant. Michel Strogoff est sans doute l’un des romans les plus corporels de Jules Verne, par ailleurs plutôt discret dans ce domaine, car le voyage du courrier de Moscou à Irkoutsk est un véritable tour de force. Par corporel, j’entends aussi que Strogoff est toujours en contact physique avec l’eau lors de la traversée des fleuves et rivières. Cela peut paraître banal, mais nous verrons dans les exemples ultérieurs que le contact direct entre l’élément et le corps constitue plutôt une exception chez Verne.
3En effet, si chez Verne les fleuves ne sont pas traversés mais utilisés comme voie navigable, l’élément et les personnages restent séparés de manière frappante. Michel Strogoff commence lui aussi par un voyage sur la Volga et la Kama. Curieusement, les cours d’eau restent alors souvent peu visibles, car les regards se concentrent plutôt sur les paysages des rives. Cette perspective, qui tend à s’éloigner de l’eau et du fleuve, caractérise également de manière générale trois titres que l’on peut considérer au sens strict comme les romans fluviaux de Verne, La Jangada. 800 lieues sur l’Amazone (1881), Le Superbe Orénoque (1898) et Le Beau Danube jaune (1901/1985)3, que j’aimerais examiner de plus près dans ce qui suit4.
Les romans fluviaux verniens : aspects de genre et de mythocritique
4Avec les Voyages extraordinaires, auxquels appartiennent ces trois titres, Verne a lancé un genre alors nouveau, le roman scientifique, que son éditeur Hetzel a défini de manière programmatique dans un avertissement du roman Voyages et aventures du Capitaine Hatteras (1865) de la manière suivante : « Son but est, en effet, de résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques, amassées par la science moderne, et de refaire, sous la forme attrayante et pittoresque qui lui est propre, l’histoire de l’univers5. »
5Les trois romans fluviaux répondent également pleinement à cette exigence encyclopédique. Ils reposent sur un important travail de sources, que le studieux Verne a effectué de manière systématique. Il a souvent repris des détails zoologiques de l’Histoire naturelle de Buffon, dans le cas de l’Amazone et de l’Orénoque, il s’est informé par le biais des rapports d’Alexander von Humboldt ou de Jean Chaffanjon, dont il mentionne régulièrement l’ouvrage sur l’Orénoque dans Le Superbe Orénoque6. De plus, les éditions illustrées des deux premiers romans fluviaux de Verne sont accompagnées de cartes géographiques qui permettent aux lecteurs de connaître la géographie exacte des fleuves. Dans l’ensemble, Verne traite et déploie un vaste savoir fluvial qui décrit les fleuves comme un système écologique complexe, composé de géographie, de flore, de faune et d’anthropologie s’étendant des formes d’habitat aux embarcations spécifiques à la culture respective de chaque environnement. À ce niveau, le voyage sur le fleuve consiste en une juxtaposition additive de courtes unités de connaissances de tous ces aspects.
6Néanmoins, les formats encyclopédiques ne peuvent pas être simplement coulés dans une forme romanesque sans passer par un filtre. En dehors des informations générales de base, Verne s’oriente principalement autour de deux facteurs lors de la sélection du savoir : premièrement, il a besoin de paysages qui peuvent générer un suspense épisodique et deuxièmement, il a besoin de l’« extraordinaire », promis dès le titre de la série. L’« extraordinaire », il le trouve surtout dans des détails exotiques et curieux. Il n’est pas rare qu’il tente d’utiliser de telles particularités pour créer du suspense. Dans le domaine fluvial, l’exemple le plus parlant se trouve dans Le Chancellor, un roman de naufrage de 1875 inspiré par le célèbre accident de La Méduse de 1816. Chez Jules Verne, les survivants dérivent sur un radeau dans l’Atlantique au large de l’Amérique du Sud. Alors qu’une dispute éclate entre eux parce qu’ils ont faim et soif, le narrateur est poussé par-dessus bord et manque de se noyer. Au moment où l’eau pénètre dans sa bouche, il constate qu’elle est douce, au beau milieu de l’océan, ce qui sauve les hommes du groupe. Mais comment cela est-il possible ? Le capitaine explique :
[…] la terre est invisible, mais elle est là ! […]
– Quelle terre ? demanda le bosseman.
– La terre d’Amérique, la terre où coule l’Amazone, le seul fleuve qui ait un courant assez fort pour dessaler l’Océan jusqu’à vingt milles de son embouchure7 !
7Verne a conservé ce modèle de base du « roman scientifique » de manière systématique depuis son premier roman paru en 1863 jusqu’à sa mort en 1905. Il a encore défendu sa conception positiviste du roman dans une interview pour la Pittsburgh Gazette en 1902, se montrant pessimiste quant à l’avenir du roman en général. Il partait du principe que les romans seraient bientôt remplacés par les journaux, car les journalistes avaient vraiment bien appris à donner des couleurs aux événements quotidiens afin de transmettre à la postérité une image exacte de l’époque8. En conséquence, il ne s’attendait probablement pas à ce que ses propres œuvres soient encore lues 120 ans plus tard.
8Mais si les romans de Verne se limitaient à leur aspect positiviste et encyclopédique, ils n’auraient probablement pas survécu jusqu’à aujourd’hui. Les chercheurs verniens ont très tôt mis en évidence des structures mythologiques dans son œuvre, dont la plus importante est le schéma initiatique qui, au-delà de Verne, est fondamentalement une caractéristique de la littérature d’aventure. Les romans fluviaux, cependant, « ne présentent plus que de vagues échos initiatiques9 », selon Simone Vierne : La Jangada « n’est pas organisée selon un canevas proprement initiatique », et dans Le Superbe Orénoque, « la part documentaire submerge littéralement le roman10. »
9En général, le schéma initiatique est fondé sur une structure circulaire qui se divise en deux parties, un aller et un retour. Le novice quitte la sécurité de son foyer, traverse des épreuves et revient ensuite au point de départ en tant qu’initié. Or, les voyages fluviaux de Verne sont conçus de manière linéaire menant d’un point à un autre, sans que le retour au point de départ joue un rôle central. Dans Le Beau Danube jaune, le voyage du pêcheur hongrois Ilia Krusch est même d’emblée un voyage retour, puisqu’après avoir participé à une compétition en Allemagne, il regagne son pays par le Danube.
10La structure linéaire correspond plutôt à une structure de révélation qui se reflète dans les intrigues parallèles du voyage fluvial : dans La Jangada, on découvre l’identité du père de famille Joam Garral, qui s’appelle en réalité Joam Dacosta et qui a été injustement condamné à mort dans le passé, mais qui a échappé à la peine capitale en s’enfuyant. Même sa famille n’est pas au courant de son identité d’origine, de sorte que la révélation ne concerne pas seulement le lecteur, mais réside dans la fiction même11.
11La mise au jour de fausses identités constitue également l’intrigue parallèle du Superbe Orénoque. Le jeune Jean de Kermor, qui veut retrouver son père près des sources de l’Orénoque, se révèle être Jeanne de Kermor à la fin de la première partie, et le Père Esperante, un ecclésiastique qui a fondé une mission à Santa Juana, est sans surprise l’ancien militaire de Kermor et le père de Jeanne. Mais Jules Verne s’est ensuite manifestement lassé des histoires de famille. Le 28 juillet 1898, il écrit à Hetzel fils : « […] j’en ai absolument fini avec les enfants qui cherchent leur père, les pères qui cherchent leurs enfants, les femmes qui cherchent leurs maris, etc. L’Orénoque aura été le dernier de ce genre12. » Dans Le Beau Danube jaune, la question de l’identité ne concerne donc plus un membre de la famille, mais un mystérieux compagnon de Krusch, qui se révèle finalement être le chef de la police, à la recherche d’un dangereux chef de bande de contrebandiers.
12La structure linéaire, les découvertes et les révélations reflètent bien sûr aussi le grand récit du progrès qui est à la base du roman scientifique en général. En effet, le processus scientifique est une chaîne de falsifications et par essence infini, comme il est dit dans Voyage au centre de la terre : « c’est que la science est éminemment perfectible, et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle13. »
13Or, la linéarité seule ne suffit pas, car, comme le souligne Simone Vierne, il faut encore distinguer le fait de remonter ou de descendre un fleuve. À la différence de la descente, la remontée du fleuve apparaît comme une quête des origines, un voyage à contre-courant du temps. Cela renvoie d’abord au grand intérêt de la géographie de l’époque pour les sources des fleuves. Dans Le Superbe Orénoque, Verne développe ainsi une intrigue parallèle dans laquelle deux scientifiques se disputent pour savoir quel cours d’eau doit être considéré comme la source de l’Orénoque. Verne relie cependant ces questions à celle de l’origine du personnage principal adolescent, qui est à la recherche de son père. Les descriptions constantes des affluents de l’Amazone et de l’Orénoque créent visuellement une sorte d’arbre généalogique fluvial dont les filiations reflètent les questions sur l’origine14.
14« L’imagination du voyage correspond chez Verne », comme l’a formulé Roland Barthes, « à une exploration de la clôture, et l’accord de Verne et de l’enfance ne vient pas d’une mystique banale de l’aventure, mais au contraire d’un bonheur du fini, que l’on retrouve dans la passion enfantine des cabanes et des tentes : s’enclore et s’installer, tel est le rêve existentiel de l’enfance et de Verne15. »
15C’est particulièrement vrai pour les romans fluviaux, car
Le geste profond de Jules Verne, c’est donc, incontestablement, l’appropriation. L’image du bateau, si importante dans la mythologie de Verne, n’y contredit nullement, bien au contraire : le bateau peut bien être symbole de départ ; il est, plus profondément, chiffre de la clôture. Le goût du navire est toujours joie de s’enfermer parfaitement, de tenir sous sa main le plus grand nombre possible d’objets16.
16Même si cette description a été développée à partir de l’exemple du Nautilus, elle s’applique également à l’immense radeau – appelé la Jangada – sur lequel les voyageurs naviguent sur l’Amazone, si grand qu’il abrite des maisons pour la famille.
17Cette « exploration de la clôture » se lit aussi, à mon avis, dans le rapport des personnages à l’élément aquatique. En effet, le voyage en bateau ou en radeau entraîne paradoxalement chez Verne une séparation physique marquée entre les personnages et l’eau. Ils ne se baignent pas dans les rivières, ils ne mettent même pas les pieds dans l’eau. Cela se manifeste aussi lors de la prise de nourriture. Alors que la chasse constitue un topos fixe des romans et sert entre autres aux personnages pour se procurer de la nourriture, il n’est jamais dit qu’ils boivent quelque chose, ni de l’eau, ni même du vin. La sensualité du récit de Verne se limite entièrement au domaine visuel, une caractéristique qui a amené Jean Macé à qualifier le roman Cinq semaines en ballon d’« un long regard17 ». Il en va de même pour les romans fluviaux. Chez Verne, le fleuve et le paysage sont des événements éminemment visuels, on ne peut ni les entendre, ni les sentir, ni les goûter.
18Jetons donc un coup d’œil à l’une des deux scènes (les deux seules des trois romans) dans lesquelles les personnages doivent exceptionnellement entrer en contact avec l’eau du fleuve. La plus impressionnante se trouve dans La Jangada : après un duel, le corps de l’adversaire Torrès est tombé dans l’Amazone. Comme il porte sur lui une pièce à conviction importante, l’un des personnages principaux, Benito Garral, est mis à l’eau avec un scaphandre pour rechercher son corps. Le scaphandre solide fait que le personnage n’est pas en contact direct avec l’eau. Les impressions visuelles dominent ici de manière frappante, comme en témoigne la description détaillée que fait Verne de la luminosité :
La lumière pénétrait assez profondément alors ces eaux claires, sur lesquelles un magnifique soleil, éclatant dans un ciel sans nuages, dardait presque normalement ses rayons. Dans les conditions ordinaires de visibilité sous une couche liquide, une profondeur de vingt pieds suffit pour que la vue soit extrêmement bornée ; mais ici les eaux semblaient être comme imprégnées du fluide lumineux, et Benito pouvait descendre plus bas encore, sans que les ténèbres lui dérobassent le fond du fleuve18.
19Verne rend la lumière si intense que l’eau devient en fait invisible et finit par disparaître. Même les poissons que le plongeur effraie sont métaphorisés en oiseaux et en apparitions lumineuses :
Le jeune homme suivit doucement la berge. Son bâton ferré en fouillait les herbes et les détritus accumulés à sa base. Des « volées » de poissons, si l’on peut s’exprimer ainsi, s’échappaient comme des bandes d’oiseaux hors d’un épais buisson. On eût dit des milliers de morceaux d’un miroir brisé, qui frétillaient à travers les eaux19.
20C’est alors que le plongeur est attaqué par un « gymnote ou couleuvre électrique20 » qui le paralyse par ses décharges électriques et le mène à la frontière de la mort21. Si l’on considère le roman scientifique d’un point de vue historique et civilisationnel comme l’expression d’une sécularisation, l’anguille électrique apparaît comme le pendant sécularisé des créatures aquatiques mythologiques. Un regard sur la représentation littéraire de l’animal et de son attaque montre que Verne reste attaché à une iconographie traditionnelle. Il y a tout d’abord le choix de l’animal lui-même. Le gymnote répond certes aux exigences susmentionnées en matière de curiosité et d’exotisme, mais Verne aurait pu choisir ici un crocodile. D’ailleurs, au début, le plongeur Benito tombe sur le cadavre d’un crocodile lors de ses recherches, une option que Verne avait donc manifestement en tête, mais qu’il a ensuite délibérément écartée. Le gymnote est présenté comme un être hybride : d’une part Verne l’appelle « couleuvre électrique » et le déclare ainsi serpent, d’autre part, une ligne plus loin seulement, il décrit cet animal comme « ces sortes d’anguilles à peau noirâtre et gluante22 ». Lorsque le gymnote attaque, il paralyse Benito de ses décharges électriques et « se frottait lentement sur son corps et l’enlaçait de ses replis » si bien que « Benito sentit la pensée l’abandonner tout à fait. Ses yeux s’obscurcirent peu à peu, ses membres se raidirent23 !… »
21À partir de cette dernière phrase, Sigmund Freud serait allé plus loin dans l’interprétation de la picturalité de cette scène. D’un point de vue civilisationnel, l’électrisante créature serpentine et métissée s’inscrit dans la tradition des créatures aquatiques féminines qui séduisent l’homme et signifient souvent sa mort, depuis les sirènes d’Homère jusqu’au romantisme24. Gaston Bachelard a qualifié le nexus de la féminité et de l’eau de complexe de Nausicaa et voit la fonction sexuelle de la rivière dans l’évocation de « la nudité féminine25 », qui résonne d’ailleurs dans le nom de l’animal gymnote, car il vient de la langue savante et signifie « dos nu », dérivé du grec gymnos « nu ». Si l’imagerie traditionnelle reste largement présente, chez Verne, la naïade est remplacée par un animal qui peut être catégorisé de manière zoologique et qui ne possède plus aucune part de transcendance26.
22Tout bien considéré, le rapport de Verne à la mythologie fluviale, comme à la mythologie en général, reste ambivalent. On peut d’une part considérer le roman scientifique comme mythoclaste, parce qu’il substitue un savoir factuel à un savoir mythologique, mais d’autre part, ces faits ont aussi des couches mythologiques.
23En traitant les questions de genre et les aspects mythocritiques des Voyages extraordinaires, je suis resté dans le sillage traditionnel de la recherche vernienne. Pour finir, j’aimerais me concentrer sur le fleuve dans le cadre d’une perspective culturelle, ce qui n’a été que peu fait jusqu’à présent, bien que les Voyages extraordinaires fournissent un large matériel d’illustration pour la culture du romantisme jusqu’au début du xxe siècle.
Le fleuve comme tiers-lieu
24Le lien entre l’eau, le développement de l’habitat humain et les processus de civilisation a conduit le géographe allemand Ernst Kapp à définir en 1845
une typologie morphologique de l’histoire du monde sur la base de l’eau, comme une succession de trois formes de culture : il commence par la culture potamique, la culture fluviale, représentée surtout par la région de l’Euphrate / Tigre et la culture du Nil en Egypte ; s’impose ensuite la culture thalassale qui se forme […] surtout dans le bassin méditerranéen, jusqu’à ce qu’on atteigne enfin le niveau de culture océanique, dont le type le plus pur est celui de la puissance maritime anglaise depuis le xviie siècle. C’est ainsi qu’est formé, au xixe siècle, le système océanique27.
25Ces transitions sont liées à des révolutions fondamentales au cours desquelles les pouvoirs se répartissent en fonction de la société qui a su le mieux réaliser, philosophiquement, techniquement et politiquement, les nouvelles dimensions spatiales qui se redessinaient à chaque fois. Les puissances terrestres traditionnelles se retrouvent en deuxième position, à l’instar des puissances thalassales comme Venise.
26Les romans fluviaux de Verne auraient donc été écrits à l’époque océanique, ce qui peut expliquer pourquoi ils ne sont pas sortis de l’ombre de ses romans « océaniques », en premier lieu bien sûr Vingt mille lieues sous les mers et L’Ile mystérieuse, mais aussi le tour du monde de Philéas Fogg, avec la traversée du Pacifique et de l’Atlantique.
27Comparés à ces dimensions globales, les romans fluviaux paraissent contemplatifs, bien que le lien entre fleuve et civilisation y soit aussi clairement perceptible. Dans Le Superbe Orénoque, la remontée du fleuve s’apparente à un voyage dans le temps, puisque les voyageurs s’éloignent de plus en plus des centres de civilisation à mesure qu’ils se rapprochent des sources. Les nombreuses tribus indigènes vivant le long du fleuve et de ses affluents sont certes généralement mentionnées par Verne, mais elles ne jouent guère de rôle dans l’intrigue et font plutôt partie de la composante anthropologique générale du paysage fluvial.
28La question de l’État est également étroitement liée à la corrélation entre le fleuve et la civilisation. Les fleuves géants que sont l’Amazone, l’Orénoque et le Danube se caractérisent par le fait qu’ils traversent plusieurs pays, voire de nombreux pays dans le cas du Danube28. Dans Le Beau Danube jaune, l’internationalité du fleuve est un pivot pour faire apparaître la région du fleuve comme une sorte de tiers-lieu entre des territoires étatiques.
29Dans ce roman, le caractère contemplatif des romans fluviaux est particulièrement marqué, puisque le personnage principal est un pêcheur hongrois du nom d’Ilia Krusch, qui remporte le premier prix d’une association de pêche, la Ligne danubienne, dans le Bade-Wurtemberg, et qui se met alors en tête de descendre tout le Danube jusqu’à la mer Noire avec sa barque, en pêchant et en vivant de la vente du poisson tout au long du parcours. Cette intrigue à suspense ne possède certes plus guère les attributs d’un voyage extraordinaire, mais elle est particulièrement intéressante dans ce contexte, car elle dresse le panorama d’une culture fluviale. Certes, un savoir encyclopédique concernant la géographie et la zoologie est ici aussi déroulé, mais le lien entre le fleuve et les sociétés humaines est particulièrement bien mis en évidence. Malgré sa répartition entre différents États, le bassin du Danube est perçu comme un système économique cohérent grâce au fleuve. C’est par le fleuve que passent le commerce et l’autosuffisance, comme le démontre Krusch, qui pêche chaque jour suffisamment pour pouvoir vivre. De plus, ce roman, bien plus que les précédents, présente le tourisme fluvial comme une autre perspective économique. Krusch apparaît lui-même comme un touriste fluvial, car son voyage, y compris ses excursions à terre pour visiter les villes voisines d’Ulm, de Regensburg, Passau et même Linz et Vienne, etc. ne se distingue pas d’un voyage touristique. Le narrateur de Verne adopte explicitement le point de vue d’un touriste, et ne le cache pas lorsqu’il dit littéralement qu’un « touriste se fût certainement maintes fois arrêté pour contempler de plus près et plus longuement les merveilles que le fleuve offre alors aux yeux29. »
30Bien que le roman ait été écrit au début du xxe siècle, Verne situe l’action dans les années 1860 et la fait débuter en Allemagne, une Allemagne d’avant la fondation de l’Empire, ce qui fait que le fleuve traverse plusieurs Länder allemands, une partie de la Prusse, le Bade-Wurtemberg et la Bavière. De cette manière, Verne expose la complexité des questions relatives au caractère étatique du cours du fleuve30 car selon lui, ces États ont déjà eu une existence historique, ce qui renvoie à l’instabilité des entités étatiques, contrastant avec le territoire fluvial qui s’avère plus durable.
31La culture fluviale dans le roman est mise en scène à travers trois organisations fluviales. La plus importante d’entre elles est l’association de pêche « La ligne danubienne, société internationale de Pêcheurs, pour la plupart de nationalité allemande, autrichienne et hongroise31 », où, comme nous l’avons dit, « allemande » désigne donc des Prussiens, Wurtembergeois et Bavarois, mais où sont également mentionnés plus tard Serbes, Valaques, Moldaves, Bessarabiens et Bulgares. L’association existe depuis cinq ans et prospère avec ses 273 membres qui portent leur propre uniforme et organisent en outre une fois par an un concours de pêche. Celui-ci est organisé chaque année dans un pays danubien différent. L’association dispose également d’un statut juridique propre :
Elle se tenait au courant de la législation en matière de pêche fluviale, soutenant ses droits aussi bien contre l’État que contre les particuliers, et, en tout pays, on le sait, chacun peut pêcher dans les fleuves, rivières, cours d’eau navigables, soit à la ligne flottante, soit à la ligne de fond32.
32Sous la forme de l’association de pêche, Verne évoque la dynamique propre de l’espace fluvial, qui entre en tension avec les appartenances nationales. L’association de pêcheurs est – même si Verne l’évoque parfois avec ironie – une société poursuivant des intérêts particuliers organisée au niveau supranational. La fierté nationale s’accompagne d’une fierté fluviale, lorsqu’il est dit du personnage principal Krusch qu’il « était un enthousiaste admirateur de son fleuve » et lorsqu’il déclare qu’« il n’y a pas au monde de plus beau fleuve que le Danube33 ». C’est finalement dans les dernières lignes du roman que le pêcheur est clairement présenté comme un personnage typiquement issu d’un milieu fluvial : « Et après ce récit, qui oserait plaisanter cet homme sage, prudent, philosophe qu’est en tout temps et en tout pays le pêcheur à la ligne34 ? »
33La deuxième organisation fluviale est constituée d’une bande de contrebandiers internationaux : « Il semblait qu’il existât une association de fraudeurs, parfaitement organisée, qui fonctionnait à l’extrême préjudice des intéressés, et les pertes du fisc montaient déjà à un chiffre considérable35. » Elle profite du fleuve pour contourner les frontières étatiques. Ici aussi, le fleuve entre en tension avec l’État et apparaît comme un tiers-lieu, étant donné qu’« [i]l n’était pas d’ailleurs probable que la contrebande s’effectuât par terre, et tout donnait à penser qu’elle prenait la voie du fleuve36. »
34La troisième société fluviale, une commission internationale de police chargée de mettre fin à la contrebande, entre alors en scène à son tour. Certes, chaque État avait déjà tenté de réagir en effectuant des contrôles : « Mais, enfin, ces moyens n’avaient point abouti, peut-être par manque d’unité de direction entre des agents de nationalités diverses, et c’est à cet état de choses que la Commission entendait remédier37. »
35Lors de la réunion constitutive de la Commission, il apparaît que le fleuve soit le point de départ d’organisations supranationales concrètes :
Or, précisément, dans cette séance, et sans que les petits États voulussent se reconnaître inférieurs aux grands, un violent débat allait les mettre tous aux prises à propos de l’élection du président et du secrétaire. En cette circonstance, Bade, la Serbie, le Wurtemberg, la Moldavie, la Bulgarie, la Bessarabie émettaient leurs prétentions que ne pouvaient accepter ni la Bavière, ni la Hongrie, ni l’Autriche. Et, cependant, les sympathies ou antipathies de race n’avaient que faire dans la question soumise à ces commissaires38.
36La proximité avec les dynamiques de l’Union européenne est ici clairement perceptible. Jules Verne n’y a peut-être pas pensé, mais il crée dans la fiction une image prémonitoire de la manière dont la région qui se forme par le biais du fleuve constitue un contrepoids à l’État-nation et met donc les États riverains au défi de former des associations supranationales. Ainsi, les romans fluviaux de Verne, qui parlent de l’extraordinaire avec des réminiscences mythologiques, aboutissent finalement à la tranquillité du Danube, dans laquelle ils perdent certes leur exotisme, mais qui renvoie à des dynamiques collectives qui occupent encore l’Europe actuelle.
1 Jules Verne, Cinq semaines en ballon (1863), Paris, Le Livre de Poche, 1989, p. 158.
2 Jurij M. Lotman, Die Struktur literarischer Texte, München, Fink, 1972, p. 311-329.
3 Le Beau Danube jaune est un roman posthume dont l’histoire doit être brièvement commentée. Après la mort de Jules Verne, ses manuscrits et notes ont été transmis par testament à son fils Michel. Parmi eux se trouvait Le Beau Danube jaune, terminé à quelques mots près, que Verne avait déjà achevé en 1901. En 1909, une version remaniée et fortement modifiée par Michel parut sous le titre Le Pilote du Danube. Pendant longtemps, ces interventions sont restées inconnues. En 1977, des copies des manuscrits ont été retrouvées dans le fonds de la maison d’édition Hetzel et ont finalement été éditées sous forme de livres par la Société Jules Verne en 1985. C’est à cette version que je me réfère ci-après.
4 Les voyages fluviaux ont également une dimension biographique chez Jules Verne, puisqu’il a grandi au bord de la Loire à Nantes. À cela s’ajoute le fait que son père a acheté en 1838 une maison de campagne à Chantenay, où ils séjournaient souvent en été et où Jules et son frère Paul se promenaient sur la Loire en barque à rames. Dans Le Superbe Orénoque, ce lien est même explicitement établi, puisqu’un chapitre se déroule à Chantenay (t. II, chap. 1). En 1868, Verne s’achète ensuite son premier voilier, deux autres suivront jusqu’en 1884, le plus luxueux étant le yacht à vapeur Saint Michel III. Depuis Le Crotoy, il entreprend de nombreux voyages, dont un de Rotterdam à Copenhague en 1881, au cours duquel il traverse le canal de l’Eider (voir Ralf Junkerjürgen, Jules Verne, Darmstadt, wbg Theiss, 2018, p. 100 et 123).
5 Jules Hetzel, « Avertissement de l’éditeur », dans Jules Verne, Voyages et aventures du capitaine Hatteras, Paris, Hetzel, 1866, p. 1-2, ici p. 2.
6 Même l’illustrateur George Roux s’est fortement inspiré des modèles du récit de voyage. Voir Olivier Dumas, « À propos de Verne et Chaffanjon », Bulletin de la Société Jules Verne, 32, 125, 1998, p. 10-14.
7 Jules Verne, Le Chancellor, Paris, Hetzel, 1877, p. 170.
8 Jules Verne, « Jules Verne sagt, dass der Roman bald sterben wird », dans Jules Verne. Stimmen und Deutungen zu seinem Werk, dir. Volker Dehs, Ralf Junkerjürgen, Wetzlar, Phantastische Bibliothek, 2005, p. 78-81, ici p. 79.
9 Simone Vierne, Jules Verne et le roman initiatique, Paris, Sirac, 1973, p. 113.
10 Ibid., p. 113.
11 Le symbole central de l’acte de révélation ou du processus de prise de conscience est un cryptogramme, dont le décryptage permet finalement de prouver l’innocence du père de famille.
12 Correspondance inédite de Jules et Michel Verne avec l’éditeur Louis-Jules Hetzel (1886-1914), établie par Olivier Dumas, Volker Dehs et Piero Gondolo della Riva, tome II, 1897-1914, Genève, Slatkine, 2006, p. 49.
13 Jules Verne, Voyage au centre de la terre (1864), Paris, Le Livre de Poche, 1972, p. 48.
14 Voir Simone Vierne, « Le superbe Orénoque et le fleuve des Amazones ou la rêverie des sources », dans Le Voyage sur le fleuve, dir. Jean Marigny, Grenoble, ELLUG, 1986, p. 89-101, ici p. 92.
15 Roland Barthes, « Nautilus et Bateau ivre », dans Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 80-82, ici p. 80.
16 Ibid., p. 81.
17 11 avril 1863 dans le feuilleton de L’Opinion nationale.
18 Jules Verne, La Jangada, Paris, Hetzel, 1881, t. 2, p. 91. Même lorsque Benito descend encore plus bas lors de la deuxième plongée, la visibilité est maintenue : « Le milieu liquide était plus obscur alors, mais la limpidité de ces eaux transparentes laissait pénétrer encore assez de lumière pour que Benito pût distinguer suffisamment les objets épars sur le fond du fleuve et se diriger avec quelque sûreté. D’ailleurs le sable, semé de mica, semblait former une sorte de réflecteur, et l’on aurait pu en compter les grains, qui miroitaient comme une poussière lumineuse. » (La Jangada, t. 2, p. 96.)
19 La Jangada, t. 2, p. 92. Lors de la deuxième plongée, au cours de laquelle Benito doit descendre jusqu’à 60 pieds de profondeur, l’eau se fait sentir comme une pression accrue, mais dans la représentation de Verne, cela se limite aux capacités mentales. Voici ce que lui conseille un ami avant d’entrer dans l’eau : « Ne t’aventure donc qu’avec une extrême lenteur, ou la présence d’esprit pourrait t’abandonner. Tu ne saurais plus où tu es, ni ce que tu es allé faire. Si ta tête se serre comme dans un étau, si tes oreilles bourdonnent avec continuité, n’hésite pas à donner le signal, et nous te remonterons à la surface. » (La Jangada, t. 2, p. 94.) La plongée en Amazonie ne diffère d’ailleurs guère d’une plongée en mer telle que Verne l’avait décrite dans Vingt mille lieues sous les mers.
20 Ibid., p. 99.
21 Mais il se passe alors quelque chose d’étrange : on entend d’abord une détonation, puis le corps qu’il cherche se détache du sol et remonte à la surface. Ce qui semble à première vue être une coïncidence étrange, voire surnaturelle, trouve ensuite une explication rationnelle : « Un phénomène purement physique, dont voici l’explication. / [À une détonation d’un coup de canon] un effet de vibration s’était produit à la surface des eaux, et ces vibrations, se propageant jusqu’au fond du fleuve, avaient suffi à relever le corps. » (La Jangada, p. 104). C’est un parfait exemple de ce que Todorov a appelé « l’étrange pur » (Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970, p. 49 et suivantes.)
22 La Jangada, p. 100.
23 Ibid., p. 101.
24 Dans le contexte historique, il faut également tenir compte du grand intérêt scientifique et public pour l’électricité, à laquelle une exposition spécifique, l’Exposition internationale d’Électricité, a été consacrée pour la première fois à Paris en 1881, c’est-à-dire l’année de la parution du roman.
25 Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, José Corti, 1942, p. 48.
26 Mentionnons brièvement le deuxième exemple, cette fois-ci tiré du Superbe Orénoque. Lorsque les bateaux se heurtent dans un tourbillon à la fin de la première partie, le jeune Jean est projeté à l’eau et sauvé par un jeune compagnon qui finit par découvrir que le garçon est en fait une fille (voir p. 378). Certes, comme d’habitude chez Verne, il n’y a pas d’indications explicites sur la manière dont le jeune homme a constaté que Jean était une Jeanne, mais implicitement, cela permet de comprendre qu’elle est sexuellement mûre et que, sans surprise, elle épousera le jeune homme à la fin du roman.
27 Hartmut Böhme, « Umriß einer Kulturgeschichte des Wassers. Eine Einleitung », dans Kulturgeschichte des Wassers, dir. Hartmut Böhme, Frankfurt, Suhrkamp, 1988, p. 7-42, ici p. 32. Pour Kapp, voir Ernst Kapp, Philosophische oder Vergleichende allgemeine Erdkunde, Bd. 1, Braunschweig, Westermann, 1845.
28 Dans La Jangada, le passage de la frontière entre le Pérou et le Brésil constitue un élément de suspense important, car le personnage principal est toujours recherché à tort comme criminel au Brésil.
29 Jules Verne, Le Beau Danube jaune (1901), Paris, Gallimard, 2002, p. 246.
30 D’autre part, il évite également d’écrire sur l’Empire allemand actuel et se souvient d’une phase où l’image romantique de l’Allemagne prévalait en France. Verne lui-même avait poursuivi cela dans Voyage au centre de la terre, un roman qui commence à Hambourg en 1863. La guerre franco-allemande de 1870-1871 a ensuite conduit Verne à réévaluer le pays voisin et a déclenché un fort ressentiment qui se reflète dans son œuvre, surtout dans Les 500 millions de la Bégum.
31 Jules Verne, Le Beau Danube jaune, op. cit., p. 27.
32 Ibid., p. 30.
33 Ibid., p. 120.
34 Ibid., p. 299.
35 Ibid., p. 64.
36 Ibid.
37 Ibid., p. 72.
38 Ibid., p. 63.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2038.html.
Quelques mots à propos de : Ralf Junkerjürgen
Universität Regensburg
