Sommaire
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Les Carnets du vivant, n° 2
Dossier coordonné par Florence Fix et Thierry Roger (avec la collaboration de Sylvain Ledda)
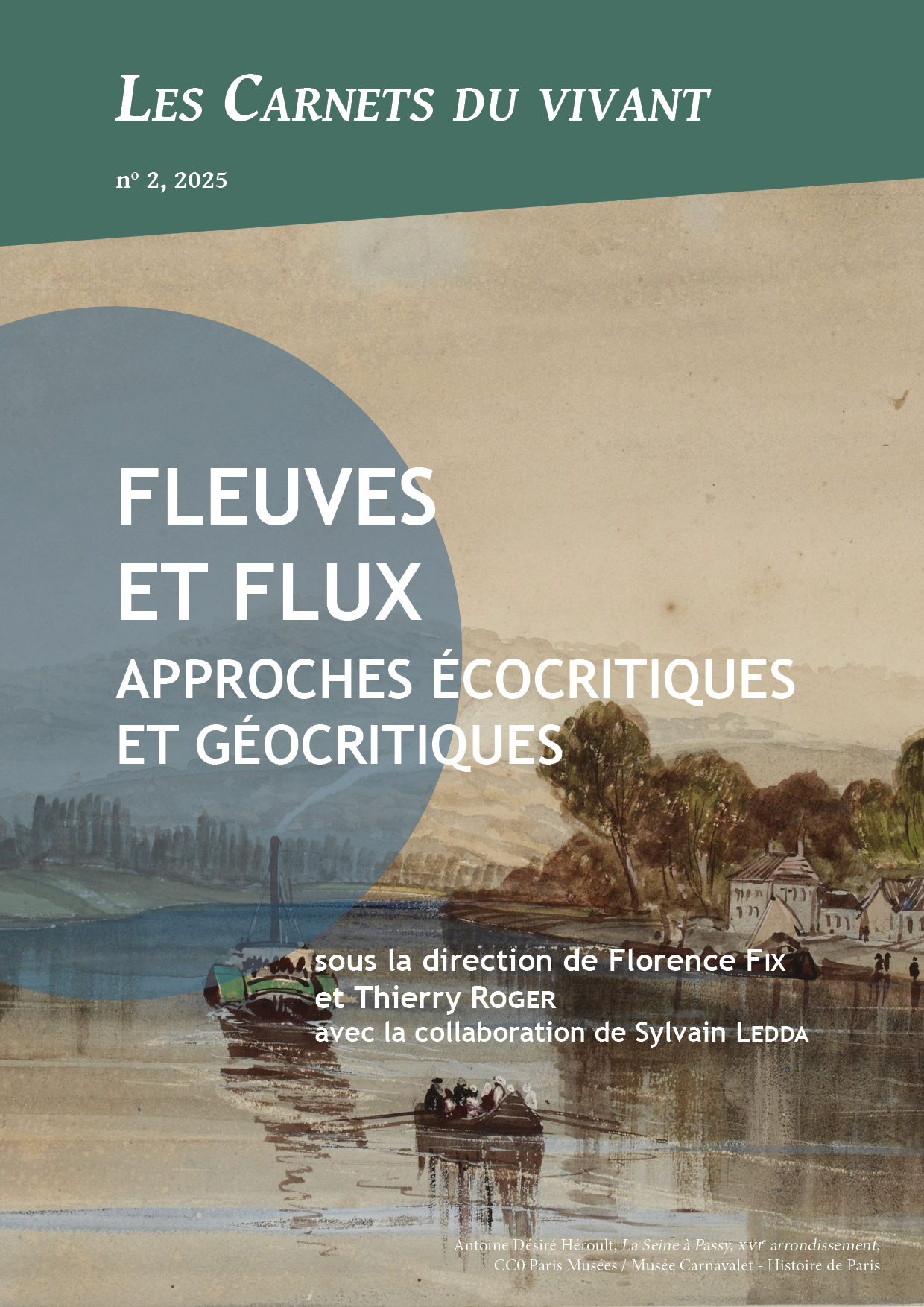
- Florence Fix et Thierry Roger Introduction
- Adélaïde Guillou De la fable au fleuve, du fleuve au dire poétique : le fleuve comme modèle de composition dans les Douze Fables de Fleuves ou Fontaines de Pontus de Tyard
- Judith le Blanc La place de l’imaginaire fluvial dans l’opéra français des xviie et xviiie siècles
- Ralf Junkerjürgen Amazone, Orénoque, Danube. Le fleuve dans l’œuvre de Jules Verne
- Tristan Guiot De la « Seine de Paris » à la « Seine normande » : promenade dans l’imaginaire du fleuve de Lucie Delarue-Mardrus
- Alain Cresciucci D’un fleuve l’autre, promenades céliniennes
- Amélie Goutaudier Rêveries fluviales chez Saint Exupéry
- Camille Thermes Éprouver le fleuve. Amazonia de Patrick Deville ou la réinvention de l’exploration
- Corinne Fournier Kiss Les cours d’eau « invisibles » d’Amazonie : rivières intermittentes et rivières volantes
- Bertrand Guest La crue indomptable. Métaphorologie du fleuve comme puissance à ne pas maîtriser
- Sylvain Ledda Mon beau fleuve, Ô ma mémoire…
Fleuves et flux : approches écocritiques et géocritiques
Introduction
Florence Fix et Thierry Roger
1Aujourd’hui, aux fleuves des Enfers de la mythocritique s’ajoute la mort des fleuves et des rivières apportée par « l’événement Anthropocène1 », sur fond de dépassement de six des neuf « limites planétaires », et en particulier celle relative à l’usage de l’eau douce. Plus que jamais, sur d’autres bases que celles analysées par la critique bachelardienne, « tous les fleuves rejoignent le Fleuve des morts2 » et les « dieux-fleuves » de l’Antiquité, représentés comme des vieillards, sont usés par l’industrie, le transport, le tourisme. On sait que le sens moderne du mot « pollution » émerge dans l’Angleterre industrielle de la fin du xviiie siècle, pour désigner la pollution des rivières puis celle de la Tamise3. Comme le montre l’œuvre du géographe anarchiste Élisée Reclus, auteur d’une « histoire d’un ruisseau4 », les cours d’eau ne relèvent pas de la seule logique de l’espace ; ils ont désormais un régime d’historicité propre, qui mêle temps de la nature et temps des hommes. L’agir technique humain affecte tout le cycle, de la source à l’estuaire, de la mer à la montagne, en passant par les « fontaines de la vallée », les « sinuosités et les remous », « l’inondation », « les rives et les îlots », « la promenade », « le bain », « l’irrigation », « le moulin et l’usine », « la barque et le train de bois », et « l’eau dans la cité », pour décliner les titres des principaux chapitres du livre de Reclus. Disparitions, asséchements, dérivations et utilisations des fleuves se superposent aux imaginaires de la force, de la vivacité, de l’impétuosité dont la statuaire (à l’exemple de la Fontana dei quattro Fiumi, Fontaine des quatre-fleuves à Rome) et la peinture ont donné de saisissantes représentations anthropomorphiques. Les métamorphoses des dieux-fleuves prennent d’autres visages, venant également bousculer les paysages rêvés de rivières invariables aux rives calmes et au flot uniforme. Comme le rappelle Mathieu Duperrex, l’unité du fleuve est un mythe, une photographie aérienne : de près, un très long fleuve n’a pas attendu d’être partagé en pays, en barrages hydrauliques, en usages divers et en habitats culturellement et sociologiquement marqués, pour être multiforme. Néanmoins « le paysage-fleuve cultive la rémanence d’une scène primitive et pastorale5 » et le regard du voyageur, puis du touriste, a voulu y déceler une permanence et une cohérence. Si la pollution et l’industrialisation de la Seine ou de la Loire sont déjà remarquées par Flaubert, Maxime Du Camp ou Charles Nodier, comme par Claude Monet, elles sont intégrées dans une émotion esthétique, une représentation paysagère les reléguant en arrière-plan du miroitement de l’eau. La sensibilité du fleuve, l’expérience sensible du (des) fleuve(s) sont marquées par un « effet-paysage » (riverscape), soit autant d’imaginaires du fleuve liés à ses usages métaphoriques et allégoriques. Les strates du fleuve, ses usages et aménagements, ses évolutions et modifications nécessitent une approche historicisée6, mobilisant tous ses récits.
2Le tournant socio-environnemental des études littéraires nous conduit à envisager la littérature en particulier, et l’art en général, comme une réponse spécifique donnée à la question de cette « crise de la sensibilité7 » diagnostiquée par Baptiste Morizot, dans le sillage de David Abram8, qui constitue l’un des versants décisifs de la « crise écologique » globale. Si l’on considère que le désastre bioclimatique en cours, sur le plan de l’histoire culturelle, trouve en partie ses origines dans un processus de chosification du non-humain, d’instauration d’un rapport d’extériorité entre l’homme et ce qui a (eu) nom « nature » – l’anthropologue Philippe Descola désigne par « naturalisme » une telle « ontologie » majoritairement née avec la « révolution scientifique du xviie siècle9 – les domaines du sens et du sensible se voient investis d’un rôle capital à jouer dans ce que l’écrivain et juriste Camille de Toledo appelle une « réanimation10 » du monde, au double sens médical et animiste du terme.
3Notre époque, celle du « soulèvement légal de la terre11 » inspiré par le mouvement des peuples autochtones visant une affirmation des « droits de la nature », cherche à donner une existence pleine et entière, en particulier juridique, aux fleuves, aux rivières, aux cours d’eau. Le séminaire qui s’est tenu à l’université de Rouen en 2023-2024 a souhaité réfléchir à la manière de compléter cet animisme juridique, naissant un peu partout sur Terre, par un animisme artistique, les deux pouvant se conforter l’un l’autre. Cette réflexion commune a ainsi tenté de décliner toutes les alternatives données, du point de vue de l’art, à la réification prédatrice des fleuves et des rivières (transports, stratégie géopolitique, frontières, administration fluviale, économie et énergie), au regret de leur étiage, ou encore d’enquêter de manière généalogique sur ce processus de réification. Aussi les textes présentés ici envisagent, du xvie siècle au xxie siècle, des expériences diverses du fleuve, des promenades sur les rives et de la navigation sur l’eau, représentations immanquablement subjectives et parcellaires, esthétisantes et documentées, toujours situées, suivant la trace du fleuve-objet de récit.
4Le Mallarmé de Valvins disait, de cette sacralité fluviale qu’est pour lui la Seine aux abords de Fontainebleau : « j’honore la rivière », quand Heidegger, dans « La question de la technique » (1953), oppose « le Rhin » de la poésie d’Hölderlin, « l’homme qui habite cette terre en poète », à la « pro-vocation » de la modernité12, qui le « somme (stellt) de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tourner13 ». Face au fleuve-chose ou au fleuve-objet, envisagé comme ressource exploitable, route commerciale ou zone de refroidissement pour la centrale nucléaire, simple décor bucolique pris dans l’industrie culturelle et touristique, carte postale ou arrière-plan invisible, milieu pollué et biologiquement appauvri, l’art et la littérature font re-surgir dans ces paysages altérés14, entendre, voir et sentir un fleuve-être, un fleuve-sujet, un fleuve-personnage, un fleuve-personne, voire un peuple-fleuve15. Il convient de réfléchir ici, à partir de l’art, comment une éthique du fleuve, une écopolitique du fleuve, et non seulement une esthétique, peuvent orienter notre présent, dans le sillage de la land ethic d’Aldo Leopold : « l’éthique de la terre élargit simplement les frontières de la communauté de manière à y inclure le sol, l’eau, les plantes et les animaux, ou collectivement, la terre16. » Le changement de paradigme revient alors à « penser comme une montagne17 », ou « comme un fleuve ». La mémoire du fleuve, ses sédiments et alluvions, composent une matière fluide18 dont les articles qui suivent ont souhaité mesurer la teneur et la perception. Quand Chateaubriand ressentait une vive mélancolie à la vue d’aqueducs romains en ruines, c’est désormais la disparition de l’eau qui fait surgir l’inquiétude. Dans Lorenzaccio de Musset l’Arno est décor et métaphore, cadre scénique et miroir des tourments des personnages. Le fleuve-sujet a d’autres tourments à exprimer encore.
5On sait que cette réalité complexe, à la fois biogéologique, économique et géopolitique, reste inséparable d’un imaginaire, de mythes, de rites, de « complexes » bachelardiens : la frontière et le passage (Charon ; passer le Rubicon), la rive et le pont, la route et le carrefour (le partage des eaux), l’anabase et la catabase, la remontée et la descente, la noyade (Ophélie ; Colossus) et le reflet (Narcisse). Entité une et multiple, mobile et immobile, figure de la conscience héraclitéenne ou mélancolique du temps, le monde fluvial (avec ses spécificités géographiques et climatiques, rivières urbaines, fleuves côtiers, gués, torrents de montagnes, fleuves plurinationaux, rias, abers, fjords etc.) nourrit la création littéraire, fournit un modèle de composition et de disposition : « la liquidité est, d’après nous, le désir même du langage. Le langage veut couler19. » Si l’on considère que le fleuve fabrique le territoire sans être un territoire à part entière comme le rappelle Jean-Christophe Bailly dans Le Dépaysement, qu’il modèle un « bassin-versant20 », il apparait qu’il y a bien un poïen fluvial, un faire hydrologique, et donc un style propre, lié à un débit, un type de pente, de rives, de fond – le style de la Loire ou de Loire, « le plus français des fleuves français21 », n’est pas le style de Rhône, de Garonne, de Seine, d’Amazonie ou de Danube – que le poïen artistique continue, déplace, métaphorise, symbolise, entre roman-fleuve et poème-goutte, pour démarquer la formule de Marcel Béalu22, qui en appelait au « roman-goutte ». On sait aussi que le fleuve et son cours, l’eau et son fil, l’eau et son cycle, qu’il faudrait considérer comme archétypes, schèmes, paradigmes, métaphores conceptuelles, et non simples thèmes ou motifs, permettent, fondamentalement, de figurer un certain rapport au temps, pour la parole intérieure, le récit, le poème, le vivant. Le fleuve ne connaît pas la marée, mais il connaît les variations de flux, l’eau vive et l’eau stagnante, le canotage et le haut débit, l’aimable baignade et l’accident, la catastrophe historique (la Berezina) et la catastrophe intime (Léopoldine Hugo). Le cinéma a fait grand usage du fugitif dont le passage par le fleuve permet la disparition, l’effacement des traces : le fleuve économique, touristique et domestiqué a aussi son envers anarchique, d’habitats dissidents ou contestataires, de fuites ou de cachettes, ses rives appelant les tractations suspectes et les morts violentes des romans policiers.
6En outre, depuis la mise en mots de la dimension liquide de la métamorphose ovidienne nouant pythagorisme et animisme, depuis les affinités électives tissées dans le lyrisme – cette « parole de l’eau » dit Bachelard, cette musique du fleuve qui appelle la valse (Strauss) ou le quintette (Schubert) – entre le logos du poème et la dynamis fluviale, chaque époque décline une rencontre entre l’écrivain et son fleuve, l’écrivain et sa rivière, entre fabulation, célébration et déploration, à l’instar d’un Huysmans constatant la laideur de la Bièvre (d’autant plus « intéressante » qu’elle est « débile et navrée »)23. Du Bellay et la Loire, Hölderlin, Hugo et le Rhin, Apollinaire et la Seine, Char et la Sorgue, mais aussi Pierre Vinclair et le Rhône ou la Singapore River (Une Éducation géographique ; Bumboat), en ajoutant entre autres exemples Jean de La Ville de Mirmont et la Garonne, Pierre Benoit et l’estuaire de la Gironde, Franck Venaille et l’Escaut, Jacques Darras et la Maye, etc. Les histoires du Danube, de l’Amazonie et du Mississippi, la remontée du Congo dans Heart of Darkness proposent des médiations avec le fleuve qui ne sont pas toutes heureuses et font vaciller l’aventurier amateur. Le « pittoresque » des représentations du fleuve entre en collision avec les perceptions corporelles directes qu’il engage (bruits, miroitement, luminosité, matières) pour l’écrivain. De même, le roman contemporain écrit le fleuve et ses riverains, ses navigants ou ses passagers, de La Traversée de la France à la nage (Pierre Patrolin) au Pont de Bézons (Jean Rolin), en passant par la Trilogie des rives (Emmanuelle Pagano), Pourquoi les oiseaux meurent (Victor Pouchet), ou La Rivière (Peter Heller). La conscience écologique ne fait que raviver tragiquement une cohabitation séculaire entre les hommes et les fleuves, entre les lignes d’eau et les formes symboliques. Si les métaphores du fleuve l’ont depuis l’Antiquité associé à la puissance, à l’inondation, au débordement généreux et dangereux, célébrant la fertilité d’un limon renouvelé comme le péril d’un habitat noyé, elles doivent aujourd’hui penser le flux comme vulnérabilité, comme absence et comme trace : rivières asséchées, niveau de l’eau qui baisse, qualité de l’eau qui se détériore accompagnent la conscience du territoire fluvial. Aussi ce carnet est-il ouvert aux « fleuves » et aux voix plurielles qui les font passer d’objets à sujets.
1 Voir Jason M. Kelly (dir.), Rivers of the Anthropocene, Oakland, University of California Press, 2018.
2 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves [1942], Paris, Le Livre de Poche, 1994, p. 89.
3 Sur cette question, voir François Jarrige et Thomas Le Roux, La Contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel, Paris, Seuil, 2017, p. 16-20.
4 Élisée Reclus, Histoire d’un ruisseau [1869], suivi de Histoire d’une montagne, Paris, Arthaud poche, 2017.
5 Matthieu Duperrex, « Le paysage-fleuve, une chorographie environnementale », Focales, no 5 : « Le paysage-temps photographié », 2021, en ligne : http://journals.openedition.org/focales/391, page consultée le 3 juillet 2025.
6 Voir par exemple Isabelle Backouche, La Trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850), Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2016 (2000). Nous posons ici que l’étude des représentations et récits littéraires et artistiques est de nature également à déceler les traces, résurgences, absences et stratifications des fleuves.
7 Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes Sud, 2020.
8 David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens [1996], Paris, La Découverte, 2020.
9 Philippe Descola, Par-delà nature et culture [2005], Paris, Gallimard, 2015.
10 Camile de Toledo, « Du langage des êtres de la nature », dans Le Fleuve qui voulait écrire, Paris, Manuella Éditions et Les Liens qui Libèrent, 2021, p. 8.
11 Ibid.
12 Lucien Febvre dans Le Rhin. Histoires, mythes et réalités, Paris, Perrin, 1998 (1935) a tracé l’histoire géopolitique de cette « frontière » fluviale. Voir, en outre, pour une historiographie du fleuve, notamment à propos du Rhône et de Lyon, les travaux fondateurs de Jacques Rossiaud, Le Rhône au Moyen Âge. Histoire et représentation d’un fleuve européen, Paris, Aubier, 2007 ; Lyon. La rivière et le fleuve, Lyon, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2013 ; Villes et fleuves en Europe, Lyon, Silvana, 2016.
13 Martin Heidegger, « La questions de la technique », dans Essais et conférences, traduction d’André Préau, Paris, Gallimard, 1958, p. 9-48, ici p. 21
14 Peter E. Pool, The Altered Landscape, Reno, Nevada Museum of Art, 1999.
15 Voir Sophie Gosselin, David Gé Bartoli, La Condition terrestre. Habiter la Terre en communs, Paris, Seuil, 2022.
16 Aldo Leopold, « Le concept de communauté », dans Almanach d’un comté des sables [1949], préface de Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Paris, Flammarion, « GF », 2000, p. 258.
17 Ibid., p. 168.
18 Voir Matt Edgeworth, Fluid Pasts. Archaelogy of Flow, Bristol, Bristol Classical Press, 2011.
19 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, op. cit., p. 210.
20 Marin Schaffner, Mathias Rollot, François Guerroué (éd.), Les Veines de la Terre. Une anthologie des bassins-versants, Marseille, Wildproject, 2021.
21 Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves, dans Œuvres complètes, tome 10, Paris, Le Club de l’honnête homme, 1974, p. 37.
22 Voir Marcel Béalu, La Rivière, Paramé, Éditions du Goëland, 1938.
23 Sur la Bièvre du Huysmans des Croquis parisiens, voir par exemple Carine Roucan, « La Bièvre, cette fille de la campagne ‘devenue mégissière’ », dans La Nature à Paris au xixe siècle. Du réel à l’imaginaire, dir. Gisèle Séginger, Versailles, Éditions Quae, p. 75-81.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 2, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2024.html.
Quelques mots à propos de : Thierry Roger
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
Quelques mots à propos de : Florence Fix
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
