Sommaire
Littérature et occulture
Programme de recherche
Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou
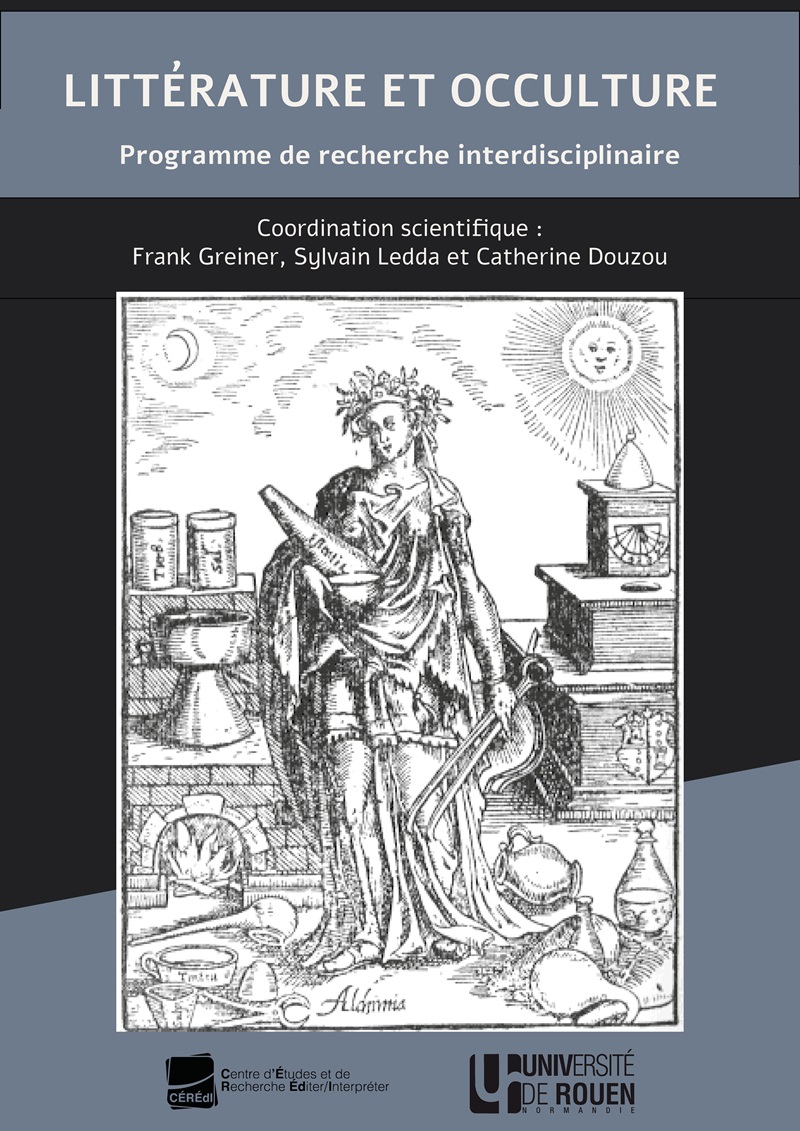
- Première partie : Lectures ésotériques des textes littéraires – Coord. scientifique : Frank Greiner
- Frank Greiner Introduction
- Tom Fischer Pantheum alchemicum, ou quand l’alchimie s’intéresse à la mythologie gréco-romaine
- Piero Latino La littérature française et l’ésotérisme de Dante
- Caroline Legrand L’arithmosophie dans Lorenzaccio : pour une herméneutique du nombre ?
- Frank Greiner À propos d’Umberto Eco et de la sémiosis hermétique
- Agnès Parmentier Quelques caractéristiques d’une herméneutique ésotérique. Le Märchen de J. W. von Goethe lu par Oswald Wirth et Rudolf Steiner
- Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda
- Sylvain Ledda Présentation
- Laurence Danguy Comment regarder le tarot de Marseille ?
- Antony Glinoer Les vies transmédiatiques des Atouts d’Ambre
- Esther Nka Manyol Les arcanes du tarot dans Sépulcre de Kate Mosse
- Stéphane Pouyaud Le crime au miroir du jeu de cartes : parties de cartes et cartomancie chez Agatha Christie
- Martin Hervé Augurer de l’écriture. La voyance littéraire d’après Sophie Létourneau et Anne-Renée Caillé
- Piero Latino Les arcanes majeurs selon Ouspensky, Guaita et le Père Gabriele Amorth
Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda
Le crime au miroir du jeu de cartes : parties de cartes et cartomancie chez Agatha Christie
Stéphane Pouyaud
1Les cartes sont très présentes chez Agatha Christie, des châteaux de cartes qu’Hercule Poirot construit pour aider sa concentration aux diverses parties de bridge, de piquet ou de rami qui émaillent les romans, en passant par de rares évocations de tirages de cartes. On pourrait imaginer que la mention des parties de cartes, très récurrente pour peu qu’on y fasse attention, serait un élément purement ornemental, permettant de caractériser la bonne société anglaise friande de bridge que mettent en scène ces œuvres, ou, à la rigueur, qu’elles serviraient à peindre un décor de légère insouciance que le crime viendrait brusquement dérouter. Pourtant, loin d’être un pur effet de réel, la partie de cartes joue presque toujours un rôle dans l’intrigue dont elle apparaît souvent comme un moment déterminant, soit du point de vue du criminel, parce que c’est pendant une partie de cartes que le meurtre est commis, soit, pour le lecteur, comme un concentré d’indices, la manière de jouer semblant à même de révéler le caractère des personnages. Pour évoquer ce rapport d’Agatha Christie aux cartes, au sein du grand nombre d’œuvres que l’on pourrait citer, on s’intéressera plus particulièrement à deux de ses romans qui mettent en scène des parties de cartes. La primauté sera évidemment accordée à Cartes sur table (1936), roman dans lequel un personnage est tué pendant une partie de bridge qu’il a organisée chez lui, dans la pièce même où jouent les quatre suspects, mais aussi au Vallon (1946), où les deux acceptions que cet article entend donner aux cartes se croisent : la partie de cartes mais aussi le tirage de cartes en vue de prédire l’avenir.
2Ces deux sens des jeux de cartes seront abordés tour à tour, ainsi que la problématique spécifique que chacun pose, l’un par leur abondance – les cartes à jouer – l’autre par leur rareté – les cartes de divination –, pour montrer comment la façon de jouer aux cartes ou de les manier, dans l’œuvre d’Agatha Christie, constitue autant d’indices qui s’intègrent dans la mise en place de l’univers policier, et comment elles doivent être lues comme des signes à déchiffrer de la part du lecteur. Entre vocation ludique et signifiance, les cartes semblent ainsi constituer aussi bien l’outil que le miroir de la fiction policière.
3Il sera d’abord question des cartes à jouer, récurrentes chez Agatha Christie. Nombreux sont en effet les romans dans lesquels une partie de cartes coïncide avec le moment du meurtre : c’est le cas dans Les Sept Cadrans (1929), dans Un cadavre dans la bibliothèque (1941) et, surtout, dans Cartes sur table (1936).
4L’intrigue de Cartes sur table est la suivante : Shaitana, un riche extravagant à la nationalité inconnue, qualifié de « métèque », et qui se plaît à cultiver sa ressemblance avec Méphistophélès convie Hercule Poirot à un dîner avec sept autres invités. D’un côté, le clan des enquêteurs, Poirot, le superintendant Battle, le colonel Race et Ariadne Oliver, l’écrivaine de romans policiers et amie d’Hercule Poirot ; de l’autre, deux hommes, le Dr Roberts et le major Despard, et deux femmes, Miss Meredith et Mrs Lorrimer, qui ont en commun que Shaitana les croie précédés d’un passé criminel – ce qui s’avérera pour trois d’entre eux. À la fin du dîner, durant lequel Shaitana a proféré des propos de nature à inquiéter un éventuel assassin, l’hôte propose à ses invités une partie de bridge, ou plutôt deux parties, réunissant chaque fois quatre d’entre eux dans deux pièces séparées : les enquêteurs d’un côté et, d’un autre, les quatre présumés meurtriers, que Shaitana observe depuis un fauteuil près du feu. Ce qui devait arriver arrive : Shaitana est retrouvé poignardé, au milieu de la quatrième manche.
5L’enquête consécutive d’Hercule Poirot illustre bien comment, dans ce roman comme dans d’autres, les cartes semblent s’accorder au paradigme indiciel qui veut que rien ne soit tout à fait gratuit dans un roman policier, a fortiori pour l’œil exercé d’Hercule Poirot qui tire des conclusions psychologiques de faits anodins pour tout autre et, partant, pour le lecteur, qui voit lui aussi dans les parties de cartes des indices à interpréter, en ce qu’elles constituent, d’abord, un formidable révélateur de personnalité au service de l’enquête.
6Que la partie de cartes soit à même de révéler la personnalité des joueurs, c’est le thème même de Cartes sur tables, puisque là où Battle, l’enquêteur officiel, s’échine à établir des alibis et à reconstituer les faits et gestes de chacun des suspects au cours de longs interrogatoires, Hercule Poirot préfère, lui, se concentrer sur des questions qui concernent doublement le bridge. Pour commencer, il interroge les différents joueurs sur les parties jouées et plus précisément sur la manière dont ils évaluent leurs adversaires en tant que bridgeurs. Ensuite, il se prête à une analyse serrée de la feuille de scores, à partir d’un mélange d’analyse des parties – leurs moments forts, les enchères, les contres, une demande de grand chelem, etc. – et de graphologie, puisque chacun des personnages a noté les scores tour à tour. La feuille de scores est obligeamment « reproduite » dans le livre :

Marques de bridge reproduites dans le roman (Agatha Christie, Cards on the Table, Londres, Harper Collins, 2016, p. 46-47).
7Partant du postulat que la nature du crime, exécuté rapidement, avec audace, voire avec une certaine hubris, répond à celle de son auteur, Poirot en conclut qu’elle doit aussi répondre à son attitude de joueur. La partie de bridge apparaît donc comme un révélateur de personnalités à même de mener à la découverte du coupable. Un seul passage permettra de saisir la manière dont Agatha Christie décide de faire de la manière de jouer au bridge un miroir des personnages et du crime :
Mrs Lorrimer, d’une voix claire et décidée :
— Un sans atout.
Le Dr Roberts, agressif :
— Trois cœurs.
Anne Meredith, paisible :
— Je passe.
Un court silence, toujours, avant qu’on n’entende la voix de Despard. Non qu’il eût l’esprit lent, mais il ne parlait jamais sans avoir pris le temps de la réflexion1.
8Vous le devinez à sa brutalité réactive, qui contraste le calme des autres joueurs, l’assassin se révèle être le Dr Roberts. Or, son crime correspond à son profil de joueur : les personnages ne cessent de souligner sa tendance à surjouer, à tenter le tout pour le tout dans des moments où la prudence et le bon sens dicteraient la prudence. C’est ce qu’en dit Despard : « Roberts surestime son jeu de façon ridicule. Il mériterait de chuter plus qu’il ne le fait » (p. 53), ou Mrs Lorrimer : « Le Dr Roberts fait des annonces trop fortes mais joue brillamment » (p. 41) ou encore Roberts lui-même : « J’ai tendance à surestimer mon jeu, c’est ce qu’on me dit. Mais ça m’a toujours réussi » (p. 36). Cela n’échappe pas à Hercule Poirot quand il livre ses premières opinions sur l’affaire :
Nous savons quel genre de meurtre a été commis et la manière dont il a été commis. Si nous avions affaire à quelqu’un qui, d’un point de vue psychologique, ne pourrait pas avoir commis un crime de ce style-là, il faudrait le rayer de notre liste. Nous savons déjà quelque chose de ces gens. Nous avons notre propre estimation sur leur compte, nous connaissons la ligne de défense que chacun d’eux a adoptée, et nous avons une idée de leur caractère par leur manière de jouer au bridge et par l’étude de leurs écritures. Mais hélas ! il est bien difficile de se prononcer avec certitude. Ce meurtre a exigé de l’audace, des nerfs – quelqu’un capable de prendre des risques. Eh bien, nous avons le Dr Roberts, un bluffeur qui fait des annonces supérieures à son jeu et qui fait totalement confiance à son habileté pour se sortir d'une situation risquée. Un caractère tout à fait conforme au crime. (p. 59)
9Le crime requiert du culot, le Dr Roberts est un joueur qui prend des risques, il se place donc en bonne place pour le rôle d’assassin. Son hubris se heurtera au flair d’Hercule Poirot qui le démasque selon le raisonnement suivant :
Lorsque l’on examine avec attention, d’un point de vue psychologique et non physique, les deux meurtres attribués au Dr Roberts, on voit bien qu’ils sont exactement calqués. […] [A]cculé, il risque le tout pour le tout et tente sa chance, exactement comme il le fait au bridge. De même qu’au bridge, en assassinant Mr Shaitana, il a pris un gros risque et il a bien joué ses cartes. Le coup a été porté sans faute et au bon moment. (p. 217)
10L’analogie entre bridge et crime est donc ici explicitement soulignée2.
11Ce qu’Hercule Poirot a pu retracer de la partie indique bien, outre l’identité du criminel, le moment du meurtre à travers la seule feuille de scores :
Vous vous souvenez que je me suis intéressé à ces scores depuis le début. Ils m’ont renseigné sur ceux qui les ont écrits, mais ils ont fait plus encore. Ils m’ont mis sur une piste valable. J’ai tout de suite remarqué, dans la troisième partie, le chiffre de 1500. Il ne pouvait représenter qu’une seule chose : une annonce de grand chelem. Maintenant, si quelqu’un décide de commettre un meurtre dans des circonstances aussi peu indiquées – c’est-à-dire durant une partie de bridge – cette personne prend deux risques sérieux. Le premier, c’est que la victime peut crier et le second, même si la victime ne crie pas, c’est que l’un des trois autres joueurs peut lever les yeux au moment psychologique et voir ce qui se passe.
Pour ce qui est du premier risque, il n’y a rien à faire. Mais on peut diminuer le second. On comprend aisément que, pendant une partie intéressante et excitante, l’attention des joueurs soit concentrée sur le jeu, alors qu’on a tendance à regarder autour de soi quand on s’ennuie. Une demande de grand chelem est toujours excitante. Et très souvent contrée – comme ça a été le cas ici. Chacun des trois joueurs est attentif – l’annonceur à remplir son contrat, ses adversaires à se défausser prudemment et à le faire chuter. Il existait donc une sérieuse possibilité que le meurtre ait été commis à ce moment-là et j’ai décidé de chercher à savoir comment s’étaient déroulées les annonces. J’ai vite découvert que, durant cette partie, c’était le Dr Roberts qui avait fait le mort3. […] Le grand chelem avait été annoncé par le Dr Roberts – sans justification – et il l’avait demandé non dans sa couleur, mais dans celle de sa partenaire, ce qui obligeait Mrs Lorrimer à jouer. (p. 218)
12Si la feuille de scores révèle donc le moment du meurtre, l’attitude des joueurs pendant la partie trahit également d’autres émotions. C’est le cas lorsque Miss Meredith découvre le cadavre de Shaitana mais, perturbée et craignant d’être accusée, préfère garder la nouvelle de sa mort pour elle. Son trouble n’échappe pas au Dr Roberts, même s’il le met sur le compte d’autres facteurs :
Miss Meredith a fait des fautes… Une ou deux fois… je m’en souviens. Vers la fin de la soirée. Mais peut-être simplement parce qu’elle était fatiguée. Elle manque d’expérience, sa main tremblait aussi…
Il s’arrêta.
— À quel moment sa main a-t-elle tremblé ?
— À quel moment ? Je ne m’en souviens plus. Je pense juste qu’elle était un peu nerveuse, M. Poirot. (p. 80)
13Ces traits de personnalité comme ces émotions ponctuelles révélés par le bridge ne sont pas seulement, structurellement, ce qui permet à Hercule Poirot de parvenir à la découverte de l’assassin ; ils constituent aussi pour le lecteur un réservoir d’indices qui pointent de manière ostensible vers l’assassin.
14Dans Cartes sur table, le criminel donc se laisse deviner avec le joueur et on joue bien aux cartes comme on commet un crime. Car, on l’a vu, si le Dr Roberts a bien tué Shaitana, deux autres joueuses de la partie, Miss Meredith et Mrs Lorrimer sont également des meurtrières. Et, pour elles aussi, le modus operandi rejoint le modus ludendi.
15Miss Meredith est timorée, sa manière de jouer aux cartes le révèle : c’est ce que note Mrs Lorrimer la jugeant comme bridgeuse : « Miss Meredith est une bonne petite joueuse, mais trop prudente » (p. 41). Ce jugement rejoint l’intuition d’Hercule Poirot, selon laquelle la jeune femme ne serait susceptible de commettre un crime qu’à condition d’être totalement aculée :
On pourrait dire aussi que Miss Meredith, automatiquement, en sort lavée. Elle est timide, timorée au jeu, prudente, économe, et elle manque de confiance en elle. Ce serait bien la dernière à tenter un coup aussi risqué. Mais la panique peut également amener une personne timide à tuer. Quelqu’un qui a l’air fragile et qui se sent fait comme un rat peut, par désespoir, se mettre tout à coup à montrer les dents. Miss Meredith, à supposer qu’elle ait déjà commis un meurtre auparavant, et qu’elle ait pensé que monsieur Shaitana était au courant et s’apprêtait à la livrer à la justice, aurait pu devenir folle de terreur et ne reculer devant rien pour se tirer de ce mauvais pas. (p. 60-61)
16Or, non seulement on découvre qu’elle a auparavant tué, acculée, une de ses patronnes qui avait découvert qu’elle s’était livrée à des larcins, mais elle tente de tuer à la fin du roman sa meilleure amie dont elle craint que, connaissant des éléments de ce crime ancien, elle ne contribue à orienter l’attention des enquêteurs sur elle.
17Quant à Mrs Lorrimer, elle a tué son mari – ce qu’elle ne justifie jamais. Persuadée, par erreur, que c’est Miss Meredith qui a tué Shaitana, condamnée de toute façon par une grave maladie, elle décide de la protéger en se dénonçant à Hercule Poirot, mais le Belge ne peut la croire en raison des discordances entre son caractère et la nature du crime commis, caractère que la partie de bridge a permis de révéler. Voici sa réaction quand il reçoit cette fausse confession :
Dans ce cas, c’est que je suis fou. Irrémédiablement fou… Non, sacré nom d’un petit bonhomme, je ne suis pas fou. J’ai raison. Je dois avoir raison. Je suis disposé à croire que vous avez tué Mr Shaitana… Mais vous ne pouvez pas l’avoir tué de la manière que vous prétendez. Personne ne peut faire quelque chose qui n’est pas dans son caractère. […] Ou le meurtre de Shaitana a été prémédité, ou vous ne l’avez pas tué. (p. 189)
18Cette propension à la préméditation4 fait écho à la capacité de stratégie de la joueuse et à sa faculté d’anticipation, nécessaire dans ce jeu.
19De même, dans « L’invraisemblable vol », nouvelle tirée de Poirot résout trois énigmes (1937), la nature d’espionne séductrice de Mrs Vanderlyn s’épanouit notamment lorsqu’elle dit à son partenaire de bridge, ravi :
C’était follement habile de votre part cette annonce de quatre sans atout […]. C’était le fruit d’une déduction étonnante. Vous avez compris, d’après les annonces, dans quelles mains se trouvaient les cartes et vous avez joué en conséquence. Tout cela m’a paru brillantissime5.
20Comme le commente in petto une femme qui assiste à la scène « sa pommade, elle l’étale au couteau6 » ; la réaction rougissante du jeune homme à qui est adressée cette tirade tend à le mettre hors de cause de l’épouvantable vol qu’annonce le titre. En revanche, les soupçons de Poirot seront attirés plus loin sur le propriétaire qui a déclaré le vol, notamment parce qu’un personnage dit à Poirot qu’il n’a cessé de cumuler les erreurs d’annonces le soir du vol. Ce sera lui le coupable.
21Les parties de bridge sont aussi l’occasion de souligner la malhonnêteté de tel ou tel personnage, Lady Coote dans Les Sept Cadrans (1929) s’avérant « une fieffée tricheuse7 », dès lors suspecte de mensonges. Dans Les Sept Cadrans encore, c’est la manière de distribuer les cartes qui révèle qu’un personnage est ambidextre, faisant signe vers le tueur gaucher que l’on cherche. La manière de jouer aux cartes est donc révélatrice du caractère des personnages, de leurs sentiments et potentiellement de leur éthos éventuel de meurtrier. Et comme le bridge est un jeu mettant en scène des duos, il est aussi l’occasion de mettre en évidence les liens qui unissent les partenaires d’un soir.
22Notons de manière préliminaire que la récurrence du bridge, bien plus présent dans l’œuvre d’Agatha Christie que d’autres jeux de cartes évoqués ponctuellement, comme le rami, le poker ou le piquet, relève aussi d’un effet de réel : il s’agit de montrer une société anglaise apparemment harmonieuse, qui, après le dîner, s’abîme dans des parties sans fin (c’est le cas dans Poirot quitte la scène (1975) où les parties de bridge rythment les après-dîners de la petite société réunie). Mais ce sont aussi les dysharmonies, les failles de ces sociétés apparemment policées ou leurs idiosyncrasies qui sont ainsi exhibées : dans Le Meurtre de Roger Ackroyd (1926), le célèbre narrateur, le Dr Sheppard, note ainsi que les habitants de King’s Abbott ont abandonné le bridge au profit du mah-jong pour des raisons hautement primordiales :
Ce soir-là, nous eûmes une de ces petites réunions où l’on joue au mah-jong, distraction très en faveur à King’s Abbott. […] Les discussions vont bon train dans ce type de soirée, ce qui parfois perturbe sérieusement la partie en cours. Avant, nous jouions au bridge, jeu tout à fait incompatible avec le papotage. Le résultat a été désastreux, et nous trouvons le mah-jong infiniment plus pacifique8.
23Le mah-jong remplace donc avantageusement le bridge pour une société obsédée par les cancans et qui, de fait, dans la suite de la scène entre deux « pong » et deux « tcho », commentera allègrement le meurtre de Roger Ackroyd9.
24On le sait, le bridge se joue à quatre, par équipes de deux qui tournent entre chaque manche. Les duos ainsi formés laissent entrevoir leurs relations dès lors qu’ils se retrouvent ensemble. Aussi bien dans Poirot quitte la scène que dans Les Sept Cadrans, les rapports au bridge entre mari et femme révèlent leurs relations personnelles, l’un ou l’autre ne se privant pas de critiquer les choix stratégiques de l’autre, quitte à générer quelques tensions. Dans le dernier roman mettant en scène le détective belge, Poirot quitte la scène (1975), l’autoritarisme d’une femme envers son mari met en place les conditions du coup de fusil que celui-ci lui destinera plus loin dans le roman, plus ou moins accidentellement :
Plus tard, je jouais à plusieurs reprises avec le colonel Luttrell, et je pus constater qu’il n’était pas, somme toute, tellement mauvais. C’était ce que j’appellerai un joueur prudent. Seulement, il était souvent distrait, ce qui lui faisait parfois commettre des fautes graves. Et lorsqu’il jouait avec sa femme, il les cumulait. Elle le rendait manifestement nerveux, et cela le faisait jouer trois fois plus mal. La colonelle était, elle, une excellente joueuse, mais il était assez éprouvant d’être son partenaire. Elle profitait au maximum de toutes les possibilités, ignorait délibérément les règles si son adversaire n’y prêtait pas attention, mais elle ne manquait jamais de les faire respecter quand elles étaient à son avantage. Elle était aussi extrêmement habile pour jeter des coups d’œil obliques sur le jeu de ses adversaires. En d’autres termes, elle jouait pour gagner.
Et je compris aussi ce que Poirot avait voulu dire quand il avait parlé de sa langue acérée. Lorsqu’elle jouait au bridge, sa retenue habituelle l’abandonnait, et elle faisait des reproches cinglants à son mari toutes les fois qu’il commettait une erreur10.
25Ce simple descriptif d’une partie de bridge permet de poser les relations entre les personnages, mais aussi les jalons du crime à venir.
26D’une manière similaire, dans Le Vallon, la partie de bridge sert à souligner, plus encore que les autres scènes auxquelles le lecteur a pu assister, le peu d’estime que John Christow, future victime, éprouve pour sa femme Gerda, mépris qu’elle ressent et qui ne fait que la rendre plus gauche, alimentant ainsi l’agacement de son mari. Or, Gerda se révèlera être l’assassin de son mari, guidée par sa jalousie, mais aussi en raison du plaisir qu’elle tire du fait d’élaborer un crime dont personne, à commencer par son mari, ne la croit capable. La partie de bridge reflète donc déjà les failles de ce couple et son mode de fonctionnement mortifère, même si le motif réel du meurtre, tel que l’exprimera Gerda, n’apparaît qu’en filigrane :
[Gerda] n’était pas totalement nulle au bridge – loin de John, elle pouvait même passer pour une joueuse convenable –, mais elle était nerveuse, manquait de jugement, et ne savait pas apprécier la valeur de sa main. Quoiqu’un peu trop sûr de lui, John jouait très bien11.
27Il faut ajouter à ce duo le personnage d’Henrietta, maîtresse de John étonnamment compatissante envers Gerda, ce qu’illustre entre autres scènes la partie de cartes où elle fait équipe avec elle :
Pour [Gerda], c’était une simple partie de bridge à laquelle, pour une fois, elle prenait plaisir. Elle se sentait même grisée par l’excitation du jeu. De difficiles décisions […] avaient été providentiellement évitées [à Gerda] par Henrietta qui avait enchéri sur ses annonces et joué ainsi à sa place.
Quand John – incapable de s’empêcher de la critiquer et minant par là sa confiance beaucoup plus qu’il ne l’imaginait – s’exclamait : « pourquoi diable ouvrir à trèfle Gerda ? », Henrietta le contrait aussitôt : « Ne sois pas bouché, John, bien sûr qu’il fallait qu’elle ouvre à trèfle ! C’était la seule chose à faire. » (p. 73)
28Notons que l’usage du terme « contrer » « countered », propre au bridge, est ici utilisé dans un sens plus courant, comme pour souligner que ce qui se joue dans la relation entre le mari et la femme est médié par la maîtresse, au bridge comme dans la vie. C’est encore confirmé quelques lignes plus loin lorsque le lecteur apprend qu’Henrietta, pour aider Gerda, n’a pas hésité à tricher et regarder dans son jeu, comme le lui dit John :
Tu voulais à tout prix que Gerda gagne ce robre, oui. Quand il s’agit de faire plaisir aux autres, tu es prête à aller jusqu’à tricher. (p. 74)
29Cette volonté de faire plaisir fait en effet partie du caractère d’Henrietta, tout comme son instinct protecteur envers Gerda, notamment contre la brutalité de son mari. Or, plus loin, Henrietta fera tout pour éloigner les soupçons de la police de Gerda qu’elle a vu commettre son meurtre, embrouillant ainsi singulièrement l’enquête d’Hercule Poirot.
30Cette même partie de bridge révèle également d’autres relations qui sont aussi au fondement de la stratégie de dissimulation d’Agatha Christie, puisque John note, au sujet d’un autre personnage amoureux d’Henrietta et qui deviendra donc l’un des suspects privilégiés de l’enquête : « Quant à tes désirs, ils ont semblé partagés par mon partenaire » (p. 74). La narration précise alors, se focalisant sur le point de vue d’Henrietta :
Henrietta trouvait ça inquiétant. Edward n’était pas du genre à fausser son jeu dans le seul but de la laisser gagner. Il était bien trop imbu de fair-play britannique pour se livrer à ce genre de choses. Non, le problème, c’était plutôt que voir John remporter un succès de plus lui avait paru intolérable. (p. 74)
31On le voit donc, la partie de cartes, en l’occurrence de bridge, sert non seulement à mettre en place les rapports des personnages, mais aussi, ce faisant, à disséminer pour le lecteur des indices qu’il réexploitera dans son enquête. Ce n’est pas le même rôle que joue le deuxième type de recours aux cartes qui nous intéresse : la cartomancie.
32Même si Agatha Christie s’intéressait aux phénomènes occultes, et leur accorde une certaine place dans ses textes, ils ne sont généralement que des écrans de fumée, destinés à dissimuler sous des dehors magiques des crimes prosaïques. C’est ce qu’explique Poirot dans une nouvelle aux allures surnaturelles, mais aux allures seulement, « La malédiction du tombeau égyptien » (1924) :
Je crois au pouvoir terrifiant qu’exercent les superstitions. Une fois qu’il est fermement établi que la disparition en série de plusieurs personnes est surnaturelle, on peut poignarder un homme en plein jour, sa mort sera également mise sur le compte de la malédiction. Cette propension à adhérer d’instinct au surnaturel et si fortement ancré chez l’être humain12 !
33On peut recenser un certain nombre de cas où l’attrait de l’occulte sert à enrober de mystère des motifs humains : dans Le Cheval pâle (1961), trois femmes adeptes de sorcellerie jettent des sorts censément capables de tuer. Pourtant, le crime qui occupe le roman n’a rien qui relève du surnaturel. Dans Cinq heures vingt-cinq (1931), des esprits annoncent pendant une table tournante l’heure du crime éponyme ; mais ce n’est là encore qu’une mystification. Dans La Nuit qui ne finit pas (1967), la malédiction censée frapper le terrain où Michael Rogers et sa riche femme font construire une maison, accompagnée d’annonces de mort imminente par la gitane Mrs Lee, appartiennent à une construction destinée à dissimuler un meurtre conjugal. Même dans Le Flambeau (1933)13, recueil de nouvelles généralement présenté comme regroupant des textes qui ont trait au surnaturel, plusieurs nouvelles ne recourent à l’occulte qu’en apparence14. Si d’autres nouvelles du recueil reposent sur de l’occulte ou de l’ésotérique qui ne seront jamais rationalisés15 (prémonitions, fantômes, phénomènes psychiques rares, spiritisme, voyance, communication entre les mondes visible et invisible esprits, affaires de possession, lévitation…), elles apparaissent presque comme des hapax dans l’œuvre d’Agatha Christie qui fait par ailleurs dire dans Cinq heures vingt-cinq à l’un de ses personnages : « je déteste le surnaturel16. »
34Pourquoi donc cette quasi-absence de surnaturel efficient, d’autant plus remarquable que le surnaturel existe bien chez Agatha Christie, mais presque uniquement comme élément de mystification ? Probablement parce que le roman policier à énigme ne peut s’en accommoder, a fortiori dans les romans où opèrent Miss Marple et Hercule Poirot qui ne fondent leurs enquêtes que sur la psychologie et la rationalité. Faire intervenir le surnaturel en le rendant à un degré quelconque responsable de la solution de l’énigme revient à briser le pacte policier propre au roman de détection des débuts et notamment à Agatha Christie, qui veut que la solution soit non seulement rationnelle, mais devinable pour le lecteur. Or le lecteur ne saurait qu’être déçu par un deus ex machina magique, lui qui supporte déjà mal coïncidences, lapins dans le chapeau et même témoins de dernière minute. Van Dine, l’élaborateur des 20 règles du récit de détection l’avait d’ailleurs théorisé – d’une manière normative :
L’énigme posée par le crime doit être résolue à l’aide de moyens strictement réalistes. Apprendre la vérité par une ardoise ou une planche de ouija, la télépathie, le spiritisme ou les boules de cristal est strictement interdit. Un lecteur peut rivaliser avec un détective qui recourt aux méthodes rationnelles. S’il doit rivaliser avec les esprits et la quatrième dimension, il a perdu d’avance17.
35Le roman à énigme ne saurait donc recourir au surnaturel sans risquer de décevoir le lecteur voire de le trahir. Or Agatha Christie n’a jamais entendu franchir le pas de la déception, toute déterminée qu’elle était à faire mentir et provoquer Van Dine.
36En revanche, elle n’a jamais cessé de jouer avec les règles de Van Dine et les frontières de la trahison. Et l’élément surnaturel, bien que masque de fumée, ne relève pas toujours de la manipulation, mais il se trouve parfois coïncider avec le réel, sans que cela ne soit explicité, ni le fruit d’une volonté humaine mystificatrice.
37C’est le cas dans Le Vallon déjà mentionné : la fille de John Christow, le futur mort, avant qu’il ne parte au Vallon pour une de ces réunions familiales à huis clos dont Agatha Christie a le secret, décide de lui tirer les cartes. La petite fille est très jeune, elle ne réapparaîtra pas et rien ne dit qu’elle est douée d’un pouvoir quelconque. Pourtant, le tirage que fait John consiste dans la parfaite description de sa situation et aussi dans l’anticipation de ce que sera son destin :
— Le roi de cœur, au milieu, c’est vous, papa. La personne à qui on prédit son avenir, c’est toujours le roi de cœur. Je donne les autres cartes, face cachée. Deux à votre droite, deux à votre gauche, une par-dessus votre tête – elle a pouvoir sur vous –, et une autre à vos pieds – vous avez pouvoir sur elle. Et celle-là, elle vous couvre ! Et maintenant, poursuivit Zena avec un soupir de tragédienne, nous les retournons. La reine de carreau est à droite… tout près de vous. « Henrietta, pensa-t-il », amusé par la gravité de Zena.
— Et la suivante, c’est le valet de trèfle … Un jeune homme bien tranquille. À gauche, le 8 de pique … Ça, c’est un ennemi secret. Vous avez un ennemi secret, papa ?
— Pas à ma connaissance.
— Et derrière, la reine de pique… C’est une dame plus toute jeune.
— Lady Angkatell, dit-il.
— Et maintenant, la carte qui est au-dessus de votre tête et qui a tout pouvoir sur vous… La reine de cœur !
« Veronica, se dit-il, Veronica ! pauvre idiot ! pensa-t-il aussitôt, Veronica ne représente plus rien pour moi. »
— Et celle qui est sous vos pieds, sur qui vous avez le pouvoir… la dame de trèfle.
Gerda arriva, courant presque :
— Je suis prête, John.
— Oh, attendez, maman, attendez, je tire les cartes à papa ! Juste la dernière, papa, la plus importante. Celle qui vous recouvre…
Zena la retourna de ses petits doigts poisseux. Elle étouffa un cri :
— Oh… c’est l’as de pique ! D’habitude, c’est la mort… Mais…
— Ta mère va écraser quelqu’un en sortant de Londres. En route, Gerda. Au revoir, vous deux. Soyez sages. (p. 49-50)
38Le tirage met en place le crime à venir ainsi que les principales suspectes de celui-ci, le trio de femmes de la vie de John Christow : Gerda, sa femme, Henrietta, sa maîtresse, et Veronica, qu’il a follement aimée. La nature de leurs relations est aussi mise en évidence : la première est dominée par John, la deuxième le protège, la troisième le domine. Là encore, la dimension occulte confirmée par la suite des événements ne doit pas masquer l’utilité narrative de cette intervention surnaturelle : il s’agit surtout de tenir le lecteur en haleine et de lui indiquer ce qui va se dérouler. L’évocation de Veronica, ancienne maîtresse de John qui n’a pas encore paru à ce moment du roman, constitue en ce sens un indice en même temps qu’une annonce. De plus, en dehors de la mort, la petite fille ne fait que désigner des figures que son père relie à des femmes qu’il connaît, mais selon un pouvoir de suggestion qui constitue aussi ce qui peut pousser à remettre en question le pouvoir des cartes.
39À ce titre, on va quitter pendant quelques lignes Agatha Christie pour mentionner une de ses épigones, Ruth Ware, écrivaine contemporaine de whodunit. Dans La Mort de Mrs Westaway (2018), l’héroïne, Hal, est une tireuse de tarots professionnelle qui en dénonce l’inanité, ne leur reconnaissant que le pouvoir d’orienter les choix de ceux qui sont venus la consulter :
Tout ce que [les cartes de tarot] montrent, c’est la façon dont les choses pourraient tourner en fonction des énergies que vous avez apportées avec vous aujourd’hui. Elles sont un guide pour vous permettre de déterminer vos actes, pas une prison18.
40Elle transforme ainsi le caractère censément prophétique des tarots en une projection vers l’action qui confirmera, en les induisant, leurs prédictions. Pour Hal les tarots dépendent donc de l’interprétation que leur donnent ceux qui s’en enquièrent :
Les cartes ne prédisent pas l’avenir – elles n’indiquent pas une solution infaillible. Elles vous disent simplement ce qui pourrait, tel jour de l’année, être une issue possible à votre problème. Certaines situations n’ont pas de résolution simple ; tout ce que nous pouvons faire, c’est choisir la direction qui cause le moins de peine. (p. 61)
41Cette lecture, qui répond assez au passage du Vallon qu’on vient de citer, désigne, outre les ressorts psychologiques qui guident celui qui se fait tirer les cartes, métalittérairement la méthode même du roman à énigme, dont tous les éléments indécidables – les détectandes selon l’expression d’Annie Combes19 –, sont là pour être interprétés par le lecteur qui leur donne la valeur qui sied le mieux à son hypothèse. Chez Ruth Ware comme chez Agatha Christie, l’attrait pour l’occulte et pour la divination par les cartes n’est que l’un des indices glissés au lecteur et, là encore, un révélateur du caractère des personnages, toutes troublantes que soient les prédictions. Quant à l’atmosphère surnaturelle, elle enchante le lecteur et le glisse dans une ambiance rare dans le roman à énigme, tout en l’en tirant à temps, par le triomphe de la rationalité et des agissements humains.
42Pour conclure, si la dimension occulte des cartes, la thématique de la divination par ce médium, est presque absente de chez Agatha Christie, c’est parce qu’elle contredit les principes mêmes du roman à énigme. Et, quand elle est quand même sollicitée, c’est toujours pour servir la narration et donc l’enquête. Car les cartes, chez Agatha Christie, sont avant tout un moteur narratif et une mine de renseignements pour le lecteur – et le détective. Elles contribuent donc, plus que nombre de motifs récurrents, comme le mécanisme de la comptine, au paradigme indiciel qui est propre au genre et, ainsi, au triomphe du rationnel, de l’analyse psychologique et des intentions humaines. Agatha Christie le dit dans son avant-propos à Cartes sur table :
Le raisonnement sera exclusivement psychologique. Mais l’intérêt n’en aura pas diminué pour autant car tout étant dit et fait, c’est sur ce qui se passe dans la tête du meurtrier que se portera l’intérêt suprême. (p. 5)
43Après tout, le genre du whodunit n’est pas celui du whatdunit, et encore moins celui du whatwasthat.
1 Agatha Christie, Cartes sur table [1936], trad. Alexis Champon, Paris, Le Livre de Poche, 2010, p. 23. À partir de la première citation, pour ce roman comme pour les autres, les numéros de page seront donnés entre parenthèses. J’ai choisi de donner les citations en traduction, pour une plus grande lisibilité.
2 Une autre analogie jalonne le roman, celle de la métaphore des cartes comme miroir non plus du crime, mais de l’enquête policière : Battle demande par exemple à Poirot : « Eh bien, monsieur Poirot, quelles sont vos cartes ? vous n’avez pas encore abattu votre jeu » (p. 151) ; le chapitre qui annonce la solution – la fameuse réunion des suspects – s’intitule « Cartes sur tables » (Cards on the table, dans l’original, la métaphore fonctionnant aussi en anglais) et Hercule Poirot lui-même ne cesse de filer cette métaphore : « Madame, je vais parler franchement. Je vais jouer cartes sur table, dit-il en souriant. Votre mari n’a pas été tué par les fièvres. Il a été tué par une balle. » (p. 156) Ou encore, au sujet du Dr Roberts, l’assassin, et de son crime : « Il a perdu son sang-froid et, encore une fois, a surestimé son jeu. Il a sorti de mauvaises cartes et a chuté. […] Hercule Poirot bondit ! Ainsi le joueur ne pourra plus tricher pour se tirer d’affaire. Il a jeté ses cartes sur la table. C’est fini. » (p. 220-221)
3 Notons que, malheureusement, l’ironie que fait ressentir en français l’expression de « mort » pour qualifier celui des quatre qui ne joue pas dans chaque partie, seul moment où le crime peut être commis, n’est pas le même en anglais, qui parle de dummy, soit un terme tiré du domaine théâtral qui qualifie un personnage muet, un figurant.
4 « Je dois avouer que si c’est Mrs Lorrimer qui a commis ce crime, je pencherai pour la préméditation. Je la vois très bien organisant son crime avec lenteur et prudence, s’assurant que son plan ne comporte pas de faille. C’est pour cette raison qu’elle me semble un suspect nettement moins vraisemblable que les trois autres », déclare Poirot à son sujet avant qu’elle ne s’accuse (p. 60).
5 Agatha Christie, « L’invraisemblable vol », dans Poirot résout trois énigmes [1937], trad. Alexis Champon, Paris, Le Livre de Poche, 2012, p. 82.
6 Ibid.
7 Agatha Christie, Les Sept Cadrans [1929], trad. Alexis Champon, Paris, Le Livre de Poche, 2013, p. 18.
8 Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd [1926], trad. Françoise Jamoul, Paris, Le Livre de Poche, 2012, p. 142.
9 Les conditions de jeu des deux divertissements sont d’ailleurs à peu près les mêmes puisque le mah-jong se joue à quatre, avec, comme au bridge, des directions (Nord, Sud, Est, Ouest), mais la solennité propice à la tension du bridge est ici remplacée par la légèreté d’un jeu plus rapide et qui requiert moins de silence et de concentration.
10 Agatha Christie, Poirot quitte la scène [1975], trad. Jean-André Rey, Paris, Le Livre de Poche, 2012, p. 51.
11 Agatha Christie, Le Vallon [1946], trad. Alexis Champon, Paris, Le Livre de Poche, 2011, p. 73.
12 Agatha Christie, « La malédiction du tombeau égyptien », dans Les Enquêtes d’Hercule Poirot [1924], trad. Marie-Josée Lacube, Laure Terilli et Michel Averlant, Paris, Le Livre de Poche, 2014, p. 102.
13 Agatha Christie, Le Flambeau [1933], trad. Jean-Paul Martin, Paris, Le Livre de Poche, 2011. Notons que le traitement de l’occulte dans ce recueil est souvent mélangé à un intérêt pour les phénomènes psychiques et la psychiatrie – particulièrement le rôle du subconscient.
14 « TSF », « Témoin à charge », « Le mystère du vase bleu », « SOS ». Le surnaturel apparaît alors comme un écran de fumée visant à cacher des intentions malveillantes et bien humaines, dans le dessein de créer une atmosphère inquiétante pour la victime à venir – et pour le lecteur aussi, bien sûr.
15 « Le quatrième homme », « La gitane », « Le flambeau », « Le cas étrange de Sir Arthur Carmichael », « Dans un battement d’ailes », « La dernière séance ». Un troisième type de nouvelles, de type fantastique au sens de Todorov, maintiennent l’hésitation entre interprétations surnaturelle et rationnelle (« Le chien de la mort » et, dans une certaine mesure « Le signal rouge » qui mélange une séance de spiritisme dont les prédictions s’avéreront et une machination humaine).
16 Agatha Christie, Cinq heures vingt-cinq [1931], trad. Élisabeth Luc, Paris, Le Livre de Poche, 1982, p. 51.
17 S. S. Van Dine, règle no 8 de ses Twenty Rules for Writing Detective Stories, je traduis.
18 Ruth Ware, La Mort de Mrs Westaway [2018], trad. Héloïse Esquié, Paris, Pockett, 2019, p. 47.
19 Annie Combes, Agatha Christie. L’écriture du crime, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 1989. Le terme de détectande recouvre tous les éléments détectables comme indices ou comme leurres.
Programme de recherche
Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 29, 2023
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1914.
Quelques mots à propos de : Stéphane Pouyaud
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
Stéphane Pouyaud est maîtresse de conférences en littérature comparée à l’Université de Rouen. Un pan de ses recherches porte sur les questions narratologiques dans le roman policier et plus particulièrement sur Agatha Christie :
– « Folie criminelle et folie narrative dans Endless Night d’Agatha Christie », dans Les Narrateurs fous/Mad Narrators, dir. Nathalie Jaëck, Clara Mallier, Arnaud Schmitt, Romain Girard, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014.
– « Quand le narrateur se révèle antipathique : narratueur et pacte de lecture policier chez Agatha Christie », journée d’études « Le narrateur antipathique », organisée à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, mars 2017, disponible à l’adresse suivante : https://www.univ-reims.fr/media-files/13151/article-stephane-pouyaud.pdf.
