Sommaire
Littérature et occulture
Programme de recherche
Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou
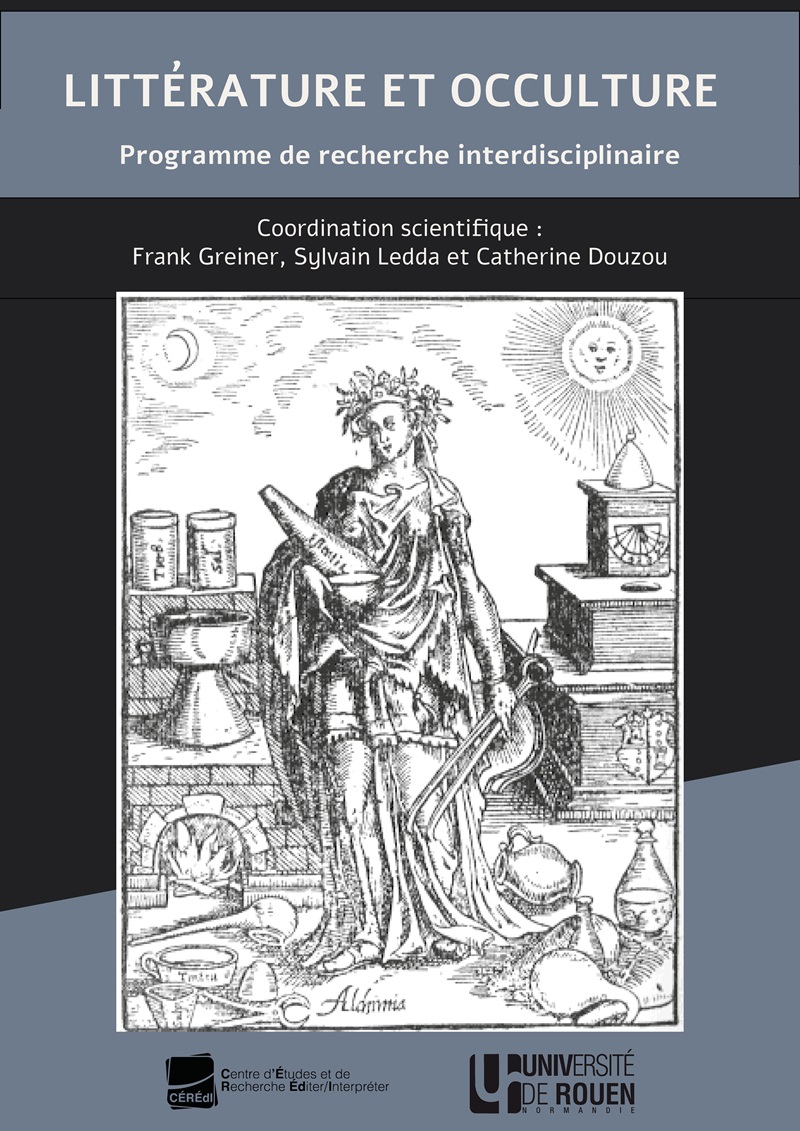
- Première partie : Lectures ésotériques des textes littéraires – Coord. scientifique : Frank Greiner
- Frank Greiner Introduction
- Tom Fischer Pantheum alchemicum, ou quand l’alchimie s’intéresse à la mythologie gréco-romaine
- Piero Latino La littérature française et l’ésotérisme de Dante
- Caroline Legrand L’arithmosophie dans Lorenzaccio : pour une herméneutique du nombre ?
- Frank Greiner À propos d’Umberto Eco et de la sémiosis hermétique
- Agnès Parmentier Quelques caractéristiques d’une herméneutique ésotérique. Le Märchen de J. W. von Goethe lu par Oswald Wirth et Rudolf Steiner
- Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda
- Sylvain Ledda Présentation
- Laurence Danguy Comment regarder le tarot de Marseille ?
- Antony Glinoer Les vies transmédiatiques des Atouts d’Ambre
- Esther Nka Manyol Les arcanes du tarot dans Sépulcre de Kate Mosse
- Stéphane Pouyaud Le crime au miroir du jeu de cartes : parties de cartes et cartomancie chez Agatha Christie
- Martin Hervé Augurer de l’écriture. La voyance littéraire d’après Sophie Létourneau et Anne-Renée Caillé
- Piero Latino Les arcanes majeurs selon Ouspensky, Guaita et le Père Gabriele Amorth
Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda
Augurer de l’écriture. La voyance littéraire d’après Sophie Létourneau et Anne-Renée Caillé
Martin Hervé
1Depuis quelques années se démarque un contexte spécifique de production littéraire au Québec en lien avec les arts de la voyance et de la médiumnité. Qu’on songe à Clairvoyantes, un « oracle littéraire » sous forme de jeu de tarot ayant réuni une quinzaine d’écrivaines sous la houlette d’Audrée Wilhelmy. Dans la même veine, on pourrait citer Zodiaque, un collectif rassemblé par Ariane Lessard et Sébastien Dulude, dont chacune des autrices était invitée à écrire librement à partir d’un signe astrologique. Cela sans compter bien sûr les autres formes d’expressions esthétiques de cet intérêt pour les pratiques divinatoires hors du domaine strictement littéraire – il n’y a qu’à se souvenir de la pièce Lau, mise en scène au théâtre Duceppe de Montréal en automne 20231. Sans prétendre embrasser totalement l’ampleur du phénomène de la voyance littéraire, ces quelques coups de sonde ont surtout pour vocation de pointer, d’une part son caractère majoritairement collectif et féminin (j’y reviendrai), d’autre part l’effort de revalorisation auquel celui-ci contribue à l’égard de l’ésotérisme, de l’occulte et, plus largement, de l’irrationnel.
2Certainement faut-il déjà situer cet effort par rapport à la critique historique qu’il renouvèle à l’égard d’une vision entièrement positiviste, cartésienne et matérialiste du monde, ayant débouché sur sa rationalisation et son exploitation systématiques. Porté autrefois dans le domaine esthétique par les mouvances romantique et surréaliste, un tel effort se ressource actuellement à la croisée de plusieurs discours, notamment celui que mobilise la frange spirituelle de l’écoféminisme, dont l’une des figures de proue est la sorcière néopaïenne américaine Starhawk2. Il est l’une des expressions principales de ce qu’on désigne aujourd’hui sous le terme hautement volatil de « réenchantement » du monde3, lequel se décline en autant de manifestations que de tentatives de définition dans des champs aussi variés que la philosophie, l’anthropologie, la sociologie, la littérature et l’urbanisme. C’est que ce terme, plastique et axiologiquement orienté, se prête à une multitude d’usages qui assurent autant son succès dans l’ordre du discours qu’un certain flou théorique.
3On peine néanmoins à ressaisir de quoi le réenchantement est minimalement le nom si on ne le remet pas en perspective avec la courbe que son préfixe inverse : « le désenchantement ». Il est devenu courant de souligner que c’est toute l’aventure postmoderne qui se jouerait entre désenchantement et réenchantement4. Au constat formulé autrefois par Max Weber d’une modernité désenchantée, car privée de ses repères culturels et symboliques traditionnels, s’opposerait la volonté de le réenchanter par le biais d’une dénonciation des valeurs épistémologiques et politiques héritées d’une culture occidentale rationnelle5. C’est ce qu’est venu confirmer à sa manière Jean-François Lyotard qui, s’il ne ciblait pas précisément l’irrationalité comme une attitude ou un trait propre à la condition postmoderne, voyait dans « l’incrédulité à l’égard des métarécits6 » et le bouleversement des cadres de légitimation du savoir l’aménagement d’un espace possible pour des systèmes de pensée et des épistémès n’ayant pas le logos comme étalon-mètre.
4Au sein du mouvement global de réenchantement, la tendance au Québec que j’appelle « voyance littéraire » occupe ainsi une place récente mais notable. Les récits Chasse à l’homme de Sophie Létourneau et Voyances d’Anne-Renée Caillé en relèvent assurément. Tout comme les initiatives collectives – sororales mêmes –, que j’évoquais au départ, ces deux autofictions assument une forme d’écriture située qui ne fait jamais l’économie des questions de genre. Chez Létourneau, cela passe par la mise en jeu d’un possible désir au féminin, portant l’attention sur les attendus et les violences auxquels il se trouve toujours confronté. Du côté de Caillé, c’est l’enjeu de la maternité qui en incarne la principale expression, même si ses incidences pragmatiques et les déterminismes sociaux que sa narratrice prend soin de souligner semblent devoir aussi renvoyer à l’épineuse question de la transmission et du deuil.
5Dans le cadre de ce volume consacré aux enjeux littéraire du tarot et des cartes, on ne pourra aborder que de manière latérale cette dimension réflexive et critique de Chasse à l’homme et Voyances à l’égard des assignations du genre. Il faut pourtant l’avoir pleinement à l’esprit pour deux raisons. La première relève de l’histoire littéraire québécoise. L’inscription du jeu de tarot, non seulement comme objet narratif, mais surtout comme dispositif surdéterminant le sens du récit, est une voie empruntée auparavant par une figure importante du champ des lettres contemporaines : Nelly Arcan, avec son récit Folle7. Quand on sait la place que celle-ci occupe au Québec dans l’imaginaire littéraire et féministe actuel – la narratrice de Chasse à l’homme ne manque pas à ce propos d’intégrer la date de son suicide dans le régime de coïncidences que tisse son récit8 –, il est difficile de ne pas remettre les textes qui gravitent dans la même orbite en regard de celui d’Arcan.
6L’autre raison me paraît être une autre facette de la première. Car à travers les textes de Létourneau, de Caillé et d’Arcan, ainsi que les collectifs réunis par Wilhelmy, Lessard et Dulude, force est de constater un rapprochement toujours plus assumé entre l’écriture située et le tarot, l’astrologie, l’ésotérisme et le vaste champ des nouvelles spiritualités. Tout se passe en fait comme s’il n’était désormais possible de faire de la voyance un authentique sujet littéraire, et donc de lui accorder une certaine légitimité au regard du canon, qu’en investissant frontalement l’association trop rapidement faite entre l’occultisme et le genre, les pratiques divinatoires et une disposition prétendument féminine à la légèreté et à l’imagination, à la frivolité et à l’irrationalité. En mobilisant souvent avec ironie et une bonne dose de ludisme postmoderne des clichés culturels associés à la féminité, il s’agirait pour toutes ces écrivaines de ne jamais faire oublier l’arrière-plan éminent politique du problème tel qu’il continue encore de se poser.
7Au seuil de cette introduction, l’on voit donc à quel point les deux pistes que nous avons suivies jusque-là pour ressaisir le phénomène de la voyance littéraire – à savoir la revalorisation postmoderne de l’irrationnel et la perspective genrée (voire féministe) – s’avèrent étroitement solidaires. Mon hypothèse est que celles-ci se rejoignent même pour dessiner une idée de la littérature dont l’ambivalence mérite que l’on s’y attarde. Prendre pour objet la cartomancie, c’est en effet pour Létourneau et Caillé faire d’un élément narratif un puissant moteur de l’écriture, puisque leur récit ne cesse de s’engendrer ou d’être relancé à l’horizon d’un avenir qui écrirait le passé. La médiumnité y est l’occasion d’explorer d’autres formes de savoir et de narration. Or tant la recherche d’une forme apte à traduire des temporalités hétérodoxes que le recours à une connaissance d’ordre conjectural restent tributaires chez elles d’une réflexion en creux sur la nécessité d’écrire. En reparamétrant les coordonnées du réel et de l’imagination, en tissant également de nouveaux liens entre épistémologie et esthétique, elles trouvent dans l’autofiction un mode de spéculation critique à l’égard de la littérature qui la veut ouverte à tous les possibles.
Ruser avec le temps
8De l’aveu de la narratrice et alter-ego de Sophie Létourneau, Chasse à l’homme n’est « [p]as un roman, mais une mosaïque d’anecdotes et de coïncidences portées par un désir d’écrire » (CH, 175). Celle-ci est conduite par désœuvrement et ennui à consulter une voyante, alors que son avenir sentimental, littéraire et académique est au point mort. Elle apprend de la bouche de la cartomancienne que c’est seulement en partant à Paris qu’elle pourra rencontrer un « petit Français » (CH, 19), qui sera comme le prodrome, l’étape obligatoire avant le véritable amour de sa vie, lequel ne pourra advenir que bien plus tard et à sa suite. Dont acte : malgré les embûches, Sophie embarque pour la France, partagée entre l’amusement et la curiosité, mais animée surtout du désir de faire d’une prédiction la matière d’une vie littéraire. Si elle part « pour des raisons narratives » (CH, 20), c’est parce qu’elle compte prendre la mesure de la valeur prémonitoire de la fiction qui lui a été faite, afin d’écrire depuis ce point où « l’écriture porte la mémoire de l’avenir » (CH, 118).
9Tout au long de Chasse à l’homme, les augures de la cartomancienne, consultée à quelques reprises, cohabitent avec un faisceau de correspondances troublantes et de prémonitions. Ce qui n’était au départ qu’une constellation d’événements épars va être réuni en collier ou en « mosaïque » pour former une histoire, tous les hasards, les intuitions et les signes venant progressivement s’assembler pour produire des dynamiques signifiantes nouvelles. C’est ainsi la composition du texte qui donne sa gravité et sa profondeur à des situations qui, dans le réel, n’en recèlent sans doute pas autant ou, en tout cas, pas avec autant évidence. Le travail d’interprétation du lecteur est orienté en fonction de l’acte que l’écriture pose, c’est-à-dire en fonction de l’événement surdéterminé qu’elle reconstruit à partir de situations historiques ayant des causalités qui ne sont pas foncièrement homogènes. L’écriture de Chasse à l’homme fonde de la sorte une nouvelle forme de récit, au sens que lui donnait Paul Ricœur, le récit étant à entendre comme une manière de ruser ou de composer avec les apories du temps sur le mode d’une « refiguration9 » ordonnatrice de sens. Il s’offre comme un outil de problématisation de tout ce qui conditionne phénoménologiquement l’expérience que l’on fait du temps.
10À l’instar de la narratrice de Chasse à l’homme, pour qui les « comme si10 » vont désormais rythmer une existence placée sous le signe de l’anticipation, il s’agit pour le lecteur de faire « comme si » il était dupe du montage textuel et de la fenêtre que celui-ci ménage pour orienter son regard. Si le récit est un art de duper le temps selon Ricœur, alors pour Létourneau, il implique également toujours de se duper un peu soi-même, tout en gardant une certaine lucidité ou distance critique. Nous sommes ici en plein dans le régime du « je sais bien, mais quand même ». Au lieu de la certitude, c’est l’ouverture et la fluidité interprétatives qui semblent privilégiées, moins pour fixer que pour relancer continuellement le sens, à l’instar de Sophie qui relance sa course entre Montréal, Québec, Paris et Tokyo, dans une démarche plus suspensive que conclusive. C’est pourquoi, nous, lecteurs, nous trouvons simultanément et toujours comme elle pris de vitesse par le jeu littéraire, dès lors que la réalité semble dépasser les plus grandes invraisemblances ou coïncidences que peut offrir la fiction.
11Vaille que vaille, Sophie remet la main à l’ouvrage. Même si on la plagie par anticipation et que la vie ressemble parfois à s’y méprendre aux scènes de son roman en cours de rédaction, elle consent toujours plus au brouillage du vrai et du faux, en assurant ne pas savoir vers quoi elle se trouve portée : « Ce n’était plus un jeu. Et cela me plaisait. J’étais d’autant plus déterminée à faire en sorte que cette histoire devienne vraie. » (CH, 56) Pourtant cette sorte de volontarisme, cette totale disponibilité à se laisser prendre au « jeu », pourrait sembler accentuer le caractère artificiel de la composition narrative et temporelle de Chasse à l’homme. Comme si tout cela ne servait qu’à dramatiser dans l’après-coup les instants disparates qui composent une vie en leur conférant l’étoffe d’un destin. Dans son projet littéraire d’appréhender le réel comme une machination, il est ainsi toujours possible de feinter et d’avoir le dernier mot. Que gagne-t-on toutefois à penser l’autofiction de Létourneau en termes de supercherie littéraire ?
12Du propre aveu de sa narratrice, l’essentiel avec Chasse à l’homme est de créer « un livre de petites histoires dont on ne saurait pas si elles seraient vraies » (CH, 178), cela dans l’idée de convaincre (elle-même comme le lecteur) que « la littérature l’aurait emporté sur la réalité » (CH, 48). Il n’est donc guère étonnant de retrouver cité sous sa plume le nom de Pierre Bayard. C’est particulièrement à Demain est écrit que la narratrice de Létourneau fait référence, eu égard à la dimension prophétique de la littérature qu’y défend Bayard à travers les œuvres de Marcel Proust, Joë Bousquet et Oscar Wilde. S’il importe aussi pour elle d’inventer d’autres diagonales du temps, nul doute que c’est surtout au dernier qu’elle emprunte son modèle, lequel tient plus de « l’action » que de la prédiction. Wilde est en effet pour Bayard celui « qui confère à l’écriture et à la création en général une véritable puissance d’action sur la réalité. L’art invente un monde et la réalité, individuelle ou collective, vient ensuite s’y plier. Nous ne sommes plus dans la logique de la prédiction – même si l’événement est, là encore, postérieur à son écriture – mais de l’action11 »
13En reparcourant à sa façon les différentes stations de la pensée bayardienne sur l’anticipation, Sophie semble en définitive vouloir faire sienne l’efficience rêvée du littéraire qu’on retrouve chez Wilde. Car elle-même rappelle combien elle adhère non pas à une hypothèse irrationnelle (le surnaturel), ni à une hypothèse ludique (et donc rationnelle : une tromperie plus ou moins assumée), mais trouve entre les deux une autre voie. Une voie dont le propre est de rendre droit à la part inconsciente du fantasme dans le sens que prennent nos vies : « L’avenir n’est peut-être pas écrit. Ce sont plutôt nos désirs qui possèdent une force dont on ne mesure la portée qu’à posteriori. » (CH, 160) Ce que nous montre par conséquent en filigrane Chasse à l’homme, c’est que seule l’écriture est susceptible de ressaisir les lignes de cette force désirante et insondable, jusqu’à non seulement en recomposer la trajectoire, mais surtout la parachever dans son exercice même.
14La pratique littéraire réalise, au sens plein du mot, l’existence, autant parce qu’elle la révèle à elle-même que parce qu’elle en poursuit, réfléchit et déplie l’impulsion, sous la forme d’une méditation sur la fiction dont les conséquences s’avèrent souvent inattendues, pour ne pas dire extraordinaires. Au sein de ce nouveau roman sentimental et expérimental, le désir est la clef de voûte d’un modèle de prédiction subsumé par la diction. Toute porte alors à croire que le « hasard objectif » cher à André Breton trouve chez Létourneau un prolongement, si on entend par là un événement « provoquant une émotion poétique par la révélation d’un désir ayant trouvé à se manifester12 ». Entre l’un et l’autre, c’est en effet le maillage voulu toujours plus serré de la vie et de l’imaginaire qui se reconnaît, là où une certaine nécessité doit l’emporter sur la contingence, tandis que la littérature paraît parfois l’unique moyen de repassionner la vie.
15Étudier dans Chasse à l’homme la logique du « comme si » sous le signe de la feinte ou de la supercherie littéraire demande en cela d’élargir la focale. La mystification se trouve ici mise en récit afin d’occuper une fonction narrative précise, qui est de renvoyer le lecteur à l’épineuse question des frontières de la fiction et à sa capacité d’adhérer à l’illusion, au-dedans mais aussi en dehors de l’acte de lecture13. Solidaire de cette fonction est d’ailleurs la forme littéraire adoptée par Chasse à l’homme : l’autofiction. Il s’agit moins toutefois d’aggraver l’antagonisme des termes qui la composent que d’en ratifier l’inextricabilité. Après tout, on a encore trop souvent tendance à renvoyer le genre à un critère de vérité et de réalisme, en le bornant à une recréation ou à une simple traduction du « réel » (sans interroger d’ailleurs ce qui détermine notre vocabulaire descriptif et nos outils pour désigner le « réel »).
16Instiller de l’irrationnel dans l’autofiction, assumer pleinement le pacte autobiographique comme une œuvre portée par l’affabulation, n’est-ce pas plutôt réduire la prétendue marge entre fiction et réel ? Cela ne revient-il pas à déplacer les attentes d’un lecteur qui, comme le rappelle Arnaud Schmitt, reste toujours près de lire l’autobiographie derrière l’autofiction14 ? Car c’est justement la référentialité (à savoir la voyance à l’origine du geste d’écriture) qui s’inscrit, non pas dans l’ordre du vraisemblable et de la véridicité, mais dans celui du fantasme, de l’incertifiable et de l’imagination. Nous ne sommes donc jamais plus proches de la réalité de Chasse à l’homme que lorsque nous souscrivons aux effets de l’expérience divinatoire rapportée par sa narratrice. Voilà qui déplace les critères de ce que Jacques Rancière nomme la « rationalité de la fiction15 ». Chez Létourneau, la mystification littéraire est une manière de multiplier des strates de signification, dont les interconnexions annulent l’idéal d’une clôture du texte sur lui-même16.
Désir d’écrire, désir d’avenir
17Si les problèmes de l’autofiction et de la voyance se comprennent habituellement en termes de supercherie (« Ce qui m’est raconté, est-ce fiable ? Est-ce un mensonge ? »), l’intérêt d’un livre comme Chasse à l’homme tient au fait qu’il jette un éclairage différent, non seulement sur le critère habituel et ontologique de la vérité, mais aussi sur celui parallèle de l’efficience de la fiction, sur ses usages et sa capacité à agir sur nous et sur le réel, tout en restant un produit de l’imagination et de sa recréation littéraire. Le récit nourrit pour cela en creux une réflexion sur l’écriture et ce qui l’impulse. On doit dans cette optique s’arrêter sur la nature du dispositif médiumnique qui relance la quête amoureuse et littéraire de la narratrice, Sophie. En tant que tels, les tirages de cartes sont à peine mentionnés. Au détour d’une phrase, l’on apprend que le « sept de carreau » (CH, 106) annonce l’idylle avec l’amant aux deux accents, tandis que la seule véritable description d’une séance reste suspendue à sa mise en place17. Sans réelle relation avec le support qui les a vues s’engendrer, les prédictions de la cartomancienne sont quant à elles livrées de façon toujours parcellaire.
18Moins que le dispositif ou que les divers éléments le constituant, c’est en fait le discours sur la voyance qui nous révèle sa réelle portée esthétique chez Létourneau : « La voyance offre une expérience fragmentaire, reconnaît ainsi son alter-ego. À partir de détails incongrus, de bouts de phrases, on se bricole une histoire qu’on voudrait plus lisse qu’elle ne l’est. Comme une tasse dont on aurait recollé les morceaux. » (CH, 167) L’on découvre ici combien la composition même du texte – qui s’apparente, rappelons-le, à une « mosaïque d’anecdotes et de coïncidences » – est tributaire du thème qu’il s’est donné pour but d’explorer. En faisant coïncider le fond et la forme, l’art de ruser avec le temps dont se prévaut Létourneau n’est en fait jamais que la transposition scripturaire du principe régissant toute pratique divinatoire : celui qui veut qu’« on bricole une histoire », en interprétant et en réagençant fabuleusement une suite de signes. J’ajouterais qu’il s’agit d’un principe de liaison et de ligature, tout en continuité et même en rotondité, si on se fie aux images que Chasse à l’homme convoque, que ce soient celle de la tasse « dont on aurait recollé les morceaux » ou celle du globe terrestre parcouru :
La perspective de boucler mes études universitaires avait ceci de terrifiant que j’approchais la fin du monde connu. Comme un voilier avant Magellan, l’horizon m’était un vide dans lequel basculer. […] À vingt-huit ans, j’ai voulu que la terre soit ronde. Mon avenir, un nouveau continent. Tania m’avait parlé d’une cartomancienne. J’ai eu l’idée de la consulter. À la question de mon avenir, je répondrais en me basant sur l’histoire que m’aurait raconté la voyante. (CH, 14. Je souligne)
19Le récit de Létourneau s’organise donc en fonction du champ métaphorique de la rondeur et ce qu’il induit d’un point de vue spatial – le cercle, la boucle. Le commencement y est toujours déjà réfléchi à l’aune de sa fin, par une sorte de téléologie concentrique qui voit le temps ne cesser de spiraler sur lui-même. Une logique de la spécularité en organise d’ailleurs les manifestations en autant d’effets de symétrie et de dédoublement.
20On en a un exemple typique dans la forme d’écriture que choisit Sophie, laquelle forme ne tient pas uniquement de la voyance, mais d’un genre parallèle. Car dans ce texte que nous lisons et que sa narratrice souhaite « sérieusement frivole » (CH, 30), non pas triste mais « euphorique », exorcisant la morosité d’un présent bouché, l’important est de fabriquer sa propre « histoire à suivre » (CH, 47). En somme, il lui importe d’écrire un livre comme si elle écrivait une petite annonce littéraire, ce genre bien particulier alliant écriture du désir et désir constamment réinsufflé de l’écriture : « La petite annonce est un genre littéraire peu étudié. Si j’avais à le décrire, je dirais qu’il s’agit d’une histoire qui aspire à se poursuivre. Plus que l’amorce d’une intrigue : un appel à l’univers, une demande narrative, un récit qui rêve à sa fin. » (CH, 79) Comme de juste, lorsque nous découvrirons enfin l’identité du mystérieux « homme de sa vie », à savoir le poète et artiste multidisciplinaire Marc-Antoine K. Phaneuf, la boucle sera entièrement bouclée, le désir trouvera son objet et la littérature, son double. La petite annonce littéraire qu’est Chasse à l’homme, à travers laquelle K. Phaneuf se sera reconnu au moment de s’éprendre de Sophie, apparaîtra dans les dernières pages du texte forgée à l’image de ce qui a fait son propre succès artistique, à savoir ses collages de petites annonces. Alors celle qui rêvait de trouver en son amant un « égal » (CH, 178) verra son désir littéralement accompli.
21Chasse à l’homme est en définitive le temps de l’imaginaire au pouvoir. À tel point d’ailleurs que l’hypothèse d’une sortie du régime de la prédiction, d’un temps d’après les présages et les signes laisse transparaître une autre hypothèse : celle d’une sortie ou d’une tromperie de l’amour. Comme si l’histoire, en bouclant sa ligne narrative par une fatale conclusion, voyait son caractère construit ou arbitraire être requalifié, pour devenir moins l’occasion d’un jeu que d’une inquiétude :
L’histoire que m’avait racontée la voyante, cette histoire interminable, mal ficelée, était finalement arrivée. Plutôt que de l’exaltation, l’accomplissement de cette prédiction m’a entraînée dans une certaine paranoïa. Je n’avais pas de preuve, en effet, que la chasse à l’homme était bel et bien terminée. Qu’est-ce qui me prouvait que ce que nous vivions, c’était de l’amour ? Que ferais-je si un autre écrivain se déclarait ? Si tu me quittais ? Ou si je me piquais d’un autre homme ? D’une autre femme ? Qu’est-ce que cela signifiait, "l’homme de ma vie" ? À partir de quel moment saurais-je que notre amour était celui d’une vie ? L’histoire ne le disait pas. (CH, 192)
22Dans cet emballement interprétatif qualifié de « paranoïa », il faut voir toutefois plus qu’un clin d’œil intertextuel au système logique qui irrigue toute la pensée de Bayard. Car le dispositif validé, l’amour trouvé, c’est avec une certaine mélancolie bien connue que la narratrice menace de se retrouver, celle-là même qu’elle avait tâché de fuir « en prenant à la lettre une fantaisie » pour mieux « semer [s]on ennui » (CH, 143). Si bien qu’il ne lui reste à qu’à poser ce constat : « J’imagine rarement ce qu’aurait été ma vie si je n’avais pas écouté la prédiction de la voyante en m’installant en France. Car les souvenirs que je garde de cette époque voyageuse ont un supplément d’âme que les autres – mes souvenirs “naturels”, si je puis dire, ceux que je n’ai pas provoqués – n’ont pas. » (CH, 142) Là se trouve sans doute le sens profond de Chasse à l’homme, où derrière le témoignage de ce destin bohème et transfrontalier, toujours conjugué au futur antérieur, l’essentiel réside dans le désir qu’il fait miroiter comme un signe ouvert sur l’horizon, se prêtant à toutes les interprétations, à toutes les projections et à toutes les rêveries.
L’arcane ou le je ?
23Du côté de Voyances d’Anne-Renée Caillé, la cartomancie s’impose dès le départ de façon très nette à la proue du texte. Afin de répondre à une commande sur le thème de la sorcellerie et de l’occultisme, la narratrice de cette nouvelle autofiction nous apprend avoir, en lieu et place d’une réponse personnelle, choisi de consigner les prédictions d’une cartomancienne. Très vite pourtant, la curiosité la pousse à se lancer dans un projet de plus vaste ampleur. Elle entend compiler méticuleusement les propos tenus par des cartomanciens et astrologues qu’elle rencontre, au moment où sa vie professionnelle et affective est bouleversée, autant par la pandémie mondiale que par un déménagement et la naissance d’un enfant.
24Rien de comparable ici cependant quant à la place occupée par l’objet médiumnique. Si les cartes constituent un centre absent dans Chasse à l’homme, le tarot acquiert en revanche une envergure narrative considérable dans le récit de Caillé. Celle-ci détaille séance après séance les interprétations minutieuses que tirent des arcanes les voyants avec qui sa narratrice dialogue. Il en va là comme d’une hypertrophie descriptive et pleinement assumée, relevant d’une rigueur formelle qu’on pourrait assimiler à une éthique documentaire de la littérature :
Je fantasme sur un objet formaliste entièrement constitué de verbatim des rencontres avec les voyants, manipulations esthétiques et censures maintenues au minimum. Ainsi, l’intention serait nette. Formelle et littérale. À contre-courant d’une tendance. On ne pourrait distinguer ce qui relève d’un intérêt de premier degré ou de second degré. Le rapport à l’ironie. Car ce serait factuel, des voix, c’est tout18.
25Au gré de ce formalisme tenu au ras du réel, assez proche de ce qui est pensé aujourd’hui sous le nom de non-fiction (« creative nonfiction », en anglais) ce qui tend à disparaître, c’est toutefois le sujet de l’écriture lui-même19. Ce qui s’évanouit derrière les séquences de Pendu, de Maison de la Fortune ou d’Impératrice, c’est une certaine épaisseur du je, cela alors que la voyance suppose un minimum de révélation et d’exhibition de qui souhaite y prendre part. Même s’il envisage d’en faire un objet d’étude, le sujet de la voyance est nécessairement pris dans cette pratique intersubjective dont son intimité (cachée, oubliée ou à venir) constitue l’horizon d’attente. Voyances répond ainsi à une forme hautement contradictoire d’écriture de soi, laquelle apparaît de façon manifeste au moment où la narratrice avoue rencontrer des voyants pour déléguer à autrui le soin de parler d’elle. Il lui importe certes par-là de maximiser les virtualités signifiantes et les constructions fictionnelles liées à sa propre existence, mais c’est semble-t-il pour mieux s’effacer au moment même d’occuper le centre de la scène : « Je veux que l’oracle m’offre un récit de moi par un autre que moi, confesse-t-elle. Probablement que je choisis cette feinte, que d’autres racontent, me racontent à un niveau de spéculation rarement atteint. » (V, 30)
26Pour cette raison, on ne s’étonne pas que la retenue dans la dimension autobiographique de Voyances se double d’une retenue dans l’attitude de sa narratrice, souvent méfiante face à nombre de médiums. Il s’instaure d’ailleurs là-encore une forme de spécularité entre celui qu’elle suppose être un déchiffreur des signes, toujours suspecté de frauder, notamment quand il cherche à confirmer ou à infléchir son oracle à la faveur des tics du visage ou de la posture de ses interlocuteurs, et l’écrivaine qu’elle est elle-même, décidée à déchiffrer à son tour le déchiffreur, à duper le dupeur. « Je ne veux pas avoir l’air sceptique ou fermée, je veux qu’elle s’abandonne et, pour cela, je dois m’abandonner » finit-elle par consentir (V, 141), en renouant du même coup avec l’analogie filée tout du long entre l’écrivaine et la voyante. Dans cette perspective, l’admiration dont la narratrice de Caillé témoigne devant « l’imagination débordante, la mythomanie fantastique » (V, 151) de certaines voyantes peut être assimilée à une forme d’identification, comme si l’écrivaine s’astreignant au pain sec de la non-fiction acquérait depuis ce point de vue un autre regard sur les puissances de l’imagination libérée.
27Tout le sens de Voyances semble tenir dans cette tension irrésolue entre la littérature ou la vie, l’imaginaire et le factuel, la fantaisie et la connaissance. Il y aurait ainsi d’une part l’ascèse d’une écriture sur la voyance, aspirant à en dégager les mécanismes et à reconstruire sa logique interne, si trompeurs soient les résultats qu’elle engendre ; et, d’autre part, l’effet dessaisissant de découvrir que l’existence est constamment précédée, innervée ou métamorphosée par la fiction. En s’appropriant les codes de la démarche documentaire, Caillé tâche en fait de produire une écriture du réel dont le propre est de mettre en péril la souveraineté de la catégorie qui la fonde. Prendre pour objet la voyance, c’est en effet élargir l’idée même de réel en choisissant les cadres et les méthodes parmi les plus discrédités par la pensée positive pour en rendre compte20. C’est redonner à l’irrationnel une certaine valeur spéculative, moins toutefois au nom de la véracité ou de l’exactitude des significations qu’il peut directement produire que pour ce qu’il traduit déjà de la difficulté d’objectiver le réel, eu égard à sa porosité, son opacité et son instabilité. Tout ce dont l’aventure postmoderne constitue d’ailleurs l’incessant témoignage21.
28Il faut alors souligner combien la voyance littéraire selon Caillé relève plus largement d’un mouvement qui tend à renouveler « le partage du sensible », lequel demeure, selon Jacques Rancière, ce qui peut nous donner à voir « l’existence d’un commun22 ». Elle fait partie de ces « collectifs d’énonciation qui remettent en question la distribution des rôles, des territoires et des langages23 », lorsqu’elle défend au travers d’une proposition esthétique qui lui est propre l’idée que l’intuition, l’affect et l’imaginaire peuvent participer – de plein droit ou obliquement – à nos modes de connaissance et à nos formes de relation. C’est bien pour cela que les écritures contemporaines du surnaturel, parmi lesquelles se rangent les récits de tarot et de prédiction de Caillé et de Létourneau, doivent être appréhendées dans leur portée critique. Véritables « instruments épistémologiques24 », tel que l’avance Anne-Sophie Donnarieix, de telles écritures s’avèrent également et de façon concomitante des modalités d’hypothétisation et de mise à l’épreuve de nos agencements politiques.
Une assomption de l’écriture
29D’un point de vue plus strictement littéraire, la voyance prise comme objet esthétique restaure à sa façon la dignité de la fonction fabulatrice. C’est qu’elle révèle depuis sa position excentrée l’importance de celle-ci dans le mouvement de requalification des liens que la littérature tisse aujourd’hui avec d’autres champs du savoir – qu’on songe par exemple aux littératures de terrain25 ou aux enquêtes littéraires26. Comme chez Létourneau, la narratrice de Caillé ne cesse de souligner combien le problème n’est pas de croire ou de ne pas croire aux prédictions, mais plutôt de s’inscrire de façon intermittente dans un régime de vérité ambivalent où l’affirmation et la négation cohabitent sans s’annuler, créant même sa propre alternative. C’est par là que peut s’acquérir une forme infra-sensible de connaissance sur soi comme sur le monde. Voyances le prouve, il en va d’une ambition autant esthétique qu’épistémologique de la littérature médiumnique, laquelle ambition revêt pour principe de problématiser le fameux « retour au réel27 » qui caractériserait les écritures contemporaines de langue française. Elle nous montre de façon exemplaire combien ce retour témoigne moins d’une aspiration à un néo-réalisme qu’à repenser en profondeur ce qu’on appelle « le réel », la voyance littéraire revendiquant de ce fait sa place singulière mais authentique parmi les procédés littéraires de réinvention du réalisme.
30On ne saurait trop insister sur le fait que la voyance littéraire telle que l’investit Caillé renégocie les rapports entre littérature et imagination, lesquels se situent aujourd’hui « à l’intersection du factuel et du fictif […] jouant sur la frontière, faisant se rejoindre ces deux modalités du rapport au monde, le fantasme et l’artefact, l’impossible et le déjà-là28 ». Tout porte à croire d’ailleurs que le parcours suivi par la narratrice de Voyances en thématise la tension sous la forme d’une aventure à la fois intérieure et littéraire. La retenue, le contrôle, la méfiance : tout ce qui manifestait sa « résistance » initiale va en effet progressivement trouver à s’atténuer. Face au refus des cartomanciens et astrologues, elle sera d’abord obligée de remiser le dispositif d’enregistrement qu’elle voulait imposer lors des séances. Une parole plus libre et moins consciente d’elle-même pourra alors émerger, tout comme apparaîtra la nécessité de reconstituer ladite parole par le travail de la mémoire, dans les battements d’un après-coup aux conséquences inattendues. La narratrice fera ainsi sienne la leçon médiumnique prodiguée par une voyante de ses amies :
L’astrologie est une explication qui accepte en même temps notre complexité et nous remet face à notre condition de rien du tout, de chien dans un jeu de quille. Elle embrasse le ridicule. Elle accueille les mauvaises années et les coups de chance. Elle est effrayante et accueillante. Elle laisse à la nuit ce qui appartient à la nuit. (V, 70)
31En ses propres termes, Voyances souligne ainsi combien l’imaginaire n’est pas synonyme d’irréalité. Il n’est pas hors ou à l’avant du monde, mais il y participe pleinement, en nous y ancrant selon une logique qui dépasse souvent notre régime de perception. La fiction n’y est plus ce qui s’oppose au réel ou ce qui s’y substitue, mais un moyen supplémentaire de l’appréhender dans toute sa complexité. Dans cette optique, la distinction entre la littérature et la vie ne tient plus. En témoigne l’altération de la règle que s’était fixée la narratrice de Caillé : celle d’une stricte approche formelle, du détour par la parole de l’autre et d’une diététique de l’imagination. Peu à peu, celle-ci laisse place à une écriture plus intime et à un style délayé. Et lorsqu’elle reconnaît aimer « l’idée de livrer un peu de soi à une forme d’inconnu et d’irraisonnable, d’accepter de ne pas être toujours maître de ses pensées, de déposer sa rationalité en échange de surprises » (V, 71), c’est pour avoir livré du même coup davantage de soi.
32Tout se passe en définitive comme si le récit de Caillé nous racontait en creux une assomption de l’écriture. Une assomption qui apparaît toujours solidaire ici d’un avènement au je, puisqu’on découvre que l’image de l’arcane du tarot que le texte disposait jusque-là entre l’écriture et la vie cachait, comme un écran, le corps mort de la mère. Récit d’un travail de deuil en sourdine, récit sur les difficultés de la maternité et sur l’énigme corollaire de la transmission, Voyances s’apparente pour cette raison à un texte charnière, tenu entre les époques : entre la mère qui est morte et sa fille qu’elle a laissée ; et la mère que cette fille est aujourd’hui devenue et son propre fils29. Il s’agit d’un livre hanté par le passé et ses désastres, mais ouvert sur l’avenir parce qu’il s’invente, à l’image des médiums, comme une « mémoire hospitalière, ouverte comme un grand canal lumineux » (V, 166).
33« Il faut travailler la matière » (V, 14) : telle était à vrai dire la recommandation répétée par le premier voyant à la lecture des cartes. Tout le texte de Caillé semble se hisser au niveau de cette exigence, en travaillant la riche matière imaginante du tarot, sans se contenter toutefois de sa seule potentialité figurative. On peut néanmoins entendre dans ce mot la « m-ati-ère », autrement dit l’image acoustique du mot « mère », dissimulée à l’avant et à l’arrière du mot « matière ». Voilà en tout cas une hypothèse qui donne un nouveau relief à l’idée de « travailler la matière » – tout en mobilisant certains des mécanismes interprétatifs que les arts divinatoires ne cessent de nous donner à réfléchir. À la suivre, c’est le geste de l’écriture que l’on découvre animé par cette idée de « travailler », de s’autoriser à parler de la mère et, à travers elle, de parler de l’enfant qu’on est restée tout en étant devenue soi-même mère. Exercice d’engendrement, la non-fiction voit de cette façon sa promesse s’accomplir par le truchement d’une parole autofictive pleinement assumée, où l’incertifiable, la fabulation et le recours au mythe ramènent plus sûrement à soi.
34Au sein de la mouvance actuelle de la voyance littéraire, Chasse à l’homme et Voyances tracent deux sillons divergents par l’usage qu’ils font de l’objet divinatoire. Dans un cas, les cartes n’agissent que sur le mode de l’éclipse et souvent sans réelle valeur expressive, tandis que dans l’autre elles sont omniprésentes par leur charge figurative et leur potentiel créatif, au point de remplir une fonction d’écran. Depuis leurs positions mutuelles, ces récits portent néanmoins tous deux une réflexion sur les rapports entre littérature et imagination, par l’exacerbation des hybridités génériques qui sont au fondement de l’autofiction. « C’est le principe de l’autofiction d’inoculer le réel, de ne pas rester dans le livre » (CH, 35), nous précise au détour d’une page Létourneau. On comprend par-là que, pour elle comme pour Caillé, c’est seulement à travers les voies d’une autofiction avec un pied, au moins par définition, situé dans le réel que le principe d’enchantement de l’écriture pouvait être mis à l’épreuve. Il peut se trouver alors maximisé jusqu’aux limites du vraisemblable et de la raison et, par conséquent, jusqu’aux limites qu’on lui a fixées.
35Chasse à l’homme et Voyances font d’un thème – la cartomancie – l’occasion d’une ressaisie des données de la littérature à l’heure de la postmodernité. Le savoir littéraire qu’ils donnent à penser n’est pas de l’ordre de la chronologie, ni ne relève d’un régime d’historicité construit autour de la rationalité. C’est plutôt celui qui rend compte de l’instant comme d’une coalescence de différentes temporalités et que seule peut-être l’écriture parvient à exprimer dans toute sa profondeur énigmatique, sans forcément l’expliquer et toujours en ses termes singuliers. Le scénario est d’ailleurs identique dans chaque cas : la prise de conscience est permise par un arrêt ou un suspens du temps (conclusion des études ou d’une idylle ; déménagement et maternité suivis d’une pandémie mondiale), comme si la sensibilité aux coïncidences, au ressassement du passé et à la cyclicité de l’histoire ne pouvait advenir que depuis une position d’excentrement ou de contre-point30. Il faut d’ailleurs prêter attention à la fonction bien particulière que remplit dans les deux cas la remontée d’un souvenir, au sein duquel la vie apparaît placée dès l’enfance sous le signe de l’écriture. Chez Caillé, ce souvenir renvoie à un journal intime avec lequel la narratrice se rappelle s’être initiée aux vertus de l’introspection et de l’écriture au je, tandis que chez Létourneau, c’est la première tentative d’écrire son nom, à l’âge de cinq ans, qui lui fait redécouvrir combien « les mots ont le pouvoir de rendre le monde plus beau » (CH, 161).
36Augurer de l’écriture : à travers ces mises en scène d’une jeunesse littéraire, il importe sans doute autant de retrouver les prémisses d’une venue à la littérature que de restaurer à travers celle-ci ce que Létourneau appelle une certaine forme de joie, la joie n’étant que ce qui « nous est connue : elle est ce qu’on connaît, ce qui réapparaît. » (CH, 159) Voyances et Chasse à l’homme sont en ce sens autant des livres portés vers l’avenir qu’aspirant au retour, à la réapparition d’un émerveillement à soi comme au monde, dont l’écriture est depuis toujours la promesse. Mais s’ils se veulent ouverts sur la joie, Voyances et Chasse à l’homme ne trouvent leur élan que depuis un fond de perte ou de mélancolie que rien ne parvient entièrement à entamer. Or je crois bien que cette ambivalence affective traduit, dans un registre sensible, une conception bien particulière de la littérature. On découvre en effet au fil de Chasse à l’homme et Voyances une vision souvent transitionnelle, si ce n’est même magique des pouvoirs de l’écriture. Elle se décline sous une forme visiblement idéalisée chez Létourneau, qu’on dit sorcière et qui prétend écrire comme on jette un sort, sans jamais pourtant que ne soit perdue de vue la logique du « comme si » ordonnant son projet littéraire. Chez Caillé, une telle conception apparaît plus nettement déceptive. Sa narratrice n’envisage la littérature que comme une pratique du négatif, incapable de réveiller les morts comme de guérir les vivants. Malgré cela, elle ne trouve à ses yeux son souffle et son sens qu’à se mesurer à cette impossibilité, en une façon obstinée de la déjouer au moment de la resignifier.
37Pour toutes ces raisons, il me semble que Sophie Létourneau et Anne-Renée Caillé s’inscrivent à leur façon dans la longue tradition des « enchantements littéraires31 » dont Yves Vadé a montré que le xixe siècle avait signifié le triomphe concomitant au sacre de l’écrivain. Marie-Hélène Boblet en a d’ailleurs poursuivi certaines hypothèses avec des écrivains comme Alain-Fournier, André Breton et Julien Gracq, lorsqu’elle a travaillé sur les façons dont se renégocia au xxe siècle le programme à la fois esthétique et ontologique du romantisme, sous l’effet du renversement des données de la transcendance et de l’immanence32. Sans doute Létourneau et Caillé proposent-elles par les voies contemporaines de l’autofiction une ambition comparable, puisqu’elles n’abordent la question de la croyance qu’obliquement, le merveilleux n’advenant dans leur cas également que sous la forme d’une impulsion à la rêverie et à la création. Aussi peut-on dire que la longue tradition des « enchantements littéraires », Chasse à l’homme et Voyances la réinterprètent de façon ambiguë. Ils la revivifient bien qu’en la mettant en question, comme s’il fallait d’un même tenant dénoncer le caractère illusoire d’une efficience de la parole pour mieux en redéployer le geste dans l’acte même que l’écriture pose, relance et annonce. Peut-être parce qu’en temps de postmodernité, il n’est plus possible d’aborder la littérature et sa transitivité autrement que sous ce signe hautement ambigu, partagé entre la méfiance et la nostalgie, ou comme je l’ai dit ailleurs, entre la mélancolie et l’enchantement33. Létourneau et Caillé participent donc d’un certain réenchantement de la littérature contemporaine par l’hybridation de l’imaginaire et du factuel, tout comme d’une aspiration à réenchanter le monde par les moyens propres à la littérature. Il faut toutefois préciser qu’elles en conjurent tout éventuel prestige, cherchant plutôt à rendre droit à l’ombre et au doute qui la ruinent tout en la portant.
1 Voir Audrée Wilhelmy (dir.), Clairvoyantes, Québec, Alto, 2022 ; Ariane Lessard et Sébastien Dulude (dir.), Zodiaque, Montréal, La Mèche, 2019 ; Lau, de Marie-Pier Audet, mise en scène par Frédéric Blanchette, Théâtre Duceppe, octobre 2023.
2 Voir à ce sujet en particulier : Starhawk, Rêver l’obscur. Femmes, magie et politique, trad. Morbic, Paris, Cambourakis, coll. « Sorcières », 2015 [2003]. Le texte est initialement paru aux États-Unis en 1982.
3 Il revient à la philosophe américaine Jane Bennett d’avoir inauguré le mouvement récent de popularisation du terme « réenchantement », avec son ouvrage The Enchantment of Modern Life. Attachments, Crossings, and Ethics, Princeton, Princeton University Press, 2001. Pour un aperçu sur la pluralité des perspectives de recherche et des cadres disciplinaires que le sujet accueille aujourd’hui, se reporter aux contributions rassemblées dans Rachel Brahy et al. (dir.), L’Enchantement qui revient, Paris, Hermann, coll. « Colloque de Cerisy », 2023. Enfin, d’un point de vue littéraire, on peut se reporter au travail de Bénédicte Meillon qui défend une approche écopoétique : Ecopoetics of Reenchantement. Liminal Realism and Poetic Echoes of the Earth, Lanham, Boulder, New York & Londres, Lexington Books, coll. « Ecocritical Theory and Practice », 2022.
4 Brian McHale, Postmodernist Fiction, New York, Methuen, 1987.
5 Sur les enjeux de la sécularisation moderne et du désenchantement, on ne pourra malheureusement pas entrer dans le détail des débats théoriques qui s’y rapportent, notamment à l’égard des effets historiques de continuité et de rupture ou encore du statut à donner au reflux supposé des croyances religieuses, qui n’est selon certains penseurs qu’un déplacement des objets de la croyance. Le lecteur pourra toutefois consulter à profit les repères suivants : Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. I. Kalinowski, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2017 [1904-1905] ; Morris Berman, The Reenchantments of the World, Ithaca (États-Unis), Cornell University Press, 1981 ; Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985 ; Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge, Harvard University Press, 2007 ; Amer Meziane, Des Empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation, Paris, La Découverte, coll. « Sciences humaines », 2021.
6 Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Minuit, 1979, p. 7.
7 Voir Nelly Arcan, Folle, Paris, Seuil, coll. « Cadre rouge », 2004.
8 Sophie Létourneau, Chasse à l’homme, Saguenay, La Peuplade, 2020, p. 120. Désormais désigné par le sigle CH entre parenthèses dans le corps du texte, suivi du numéro de page.
9 Paul Ricœur, Temps et récit, tome I, Paris, Seuil, coll. « L’ordre historique », 1983, p. 87.
10 « On ferait comme si le petit Français existait. On dirait que je le chercherais. On dirait que je suis une fille qui cherche l’amour à Paris. Un cliché, je sais, que j’embrasserais sur la bouche. Je le pousserai jusqu’à ce qu’il cède, exaspéré. Je ferais comme si, mais je le ferais pour de vrai. Ce serait la faille et la beauté de ce projet. De cette histoire remâchée, un jour, je dirais qu’elle m’était arrivée. » (Sophie Létourneau, op. cit., p. 27).
11 Pierre Bayard, Demain est écrit, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2005, p. 105.
12 Marie-Hélène Boblet, Terres promises. Émerveillement et récit au xxe siècle (Alain-Fournier, Breton, Gracq, Dhôtel, Germain), Paris, Corti, coll. « Les essais », 2011, p. 127.
13 Sur ce problème et les questions qu’il pose actuellement pour les théoriciens, on peut se reporter à la somme de Françoise Lavocat, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016.
14 Voir Arnaud Schmitt, « De l’autonarration à la fiction du réel : les mobilités subjectives », dans Claude Burgelin, Isabelle Grell et Roger-Yves Roche (dir.), Autofiction(s), actes du colloque de Cerisy, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, coll. « Autofictions, etc. », 2010, p. 417-440.
15 Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000, p. 55.
16 Chasse à l’homme fait donc la jonction entre les théories traditionnelles de la fiction comme tromperie et la réflexion pragmatique d’un penseur comme Jean-Marie Schaeffer, qui a plutôt mis en valeur dans la fiction sa qualité ludique et sa capacité à être partagée (voir Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, 1999).
17 « Elle a sorti un jeu de cartes qu’elle a posé sur la table pour le séparer en deux paquets, qu’elle a réunis, puis elle a brassé les cartes d’un geste routinier. Elle a étendu le jeu sur la table, retourné les cartes, carreau, pique, cœur, trèfle, avant de les assembler à nouveau en un paquet. La voyante a étiré le bras pour déposer la pile devant moi. J’allais couper, mais avant que je commence, elle m’a demandé pourquoi j’étais venue, qu’elle était ma question, ce que je désirais que les cartes me révèlent. » (Sophie Létourneau, op. cit., p. 166) À noter qu’un court extrait de Chasse à l’homme a été prépublié en revue, sous un titre qui renvoie directement au tirage des cartes : Sophie Létourneau, « Carreau pique cœur trèfle », Tristesse, nº 4, 2019, p. 6-7.
18 Anne-Renée Caillé, Voyances, Montréal, Héliotrope, 2021, p. 25. Désormais désigné par le sigle V entre parenthèses dans le corps du texte, suivi du numéro de page.
19 Sur les formes et enjeux de la non-fiction, on peut consulter les articles réunis dans Alexandre Gefen (dir.), Territoires de la non-fiction. Cartographie d’un genre émergent, Leyde, Brill / Rodopi, coll. « Chiasma », 2020.
20 C’est dans une perspective analogue que Muriel Pic a souligné l’importance du modèle conjectural comme outil d’investigation spéculative pour tout un pan de la pensée philosophique et philologique du xxe siècle (Benjamin, Warburg, Ginzburg, etc.), en établissant les fondements historiques et critiques d’une « épistémologie de type divinatoire ». Voir à ce sujet : Muriel Pic, « Deviner le passé. À propos d’une note de bas de page de Carlo Ginzburg », Études littéraires, vol. 52, nº 1 (« Le lyrisme critique », dir. G. Surin), 2023, p. 119-159.
21 « Les écritures qui éprouvent aujourd’hui le réel avec le plus d’intensité sont celles qui circonscrivent un champ d’expériences données, en instituent des configurations signifiantes, et incluent comme l’une de ses données nécessaires leur propre implication dans le système figuratif ainsi élaboré, assumant leur part de responsabilité, sinon d’engagement esthétique, dans ce qui s’apparente moins à une représentation mimétique du réel qu’à une délibération critique autour du réel, c’est-à-dire à une réflexion appliquée sur les champs qu’il recouvre et les tensions qui le sous-tendent. (Bruno Blanckeman, « Objectif : réel », dans Barbara Havercroft, Pascal Michelucci et Pascal Riendeau (dir.), Le Roman français de l’extrême contemporain. Écriture, engagements, énonciation, Québec, Nota bene, coll. « Contemporanéités », 2010, p. 224-225.
22 Jacques Rancière, op. cit., p. 12.
23 Ibid., p. 64.
24 Anne-Sophie Donnarieix, Puissances de l’ombre. Le surnaturel du roman contemporain, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2022, p. 23.
25 Voir Dominique Viart et Alison James (dir.), « Littérature de terrain », Fixxion, revue critique de fiction française contemporaine, nº 18, 2019, en ligne : https://journals.openedition.org/fixxion/1254, page consultée le 7 novembre 2024 ; Robert Dion, Des Fictions sans fiction ou le partage du réel, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018.
26 Voir Laurent Demanze, Un Nouvel âge de l’enquête : portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur, Paris, Corti, coll. « Les essais », 2019.
27 Voir Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent – Héritage, modernité, mutations, Paris, Bordas, coll. « La bibliothèque », 2005.
28 Hélène Baty-Delalande, Aurélie Foglia et Laurent Zimmerman, « Avant-propos », Littérature, nº 190 (« Recours à l’imagination », dir. H. Baty-Delalande, A. Foglia et L. Zimmerman), 2018, p. 7.
29 Sans oublier le père, bien entendu, dont on apprend qu’il s’est un temps cru doté de dons de clairvoyance (V, 116-118), tout comme il aurait appris à « soigner » sa propre mère morte en choisissant pour métier celui d’embaumeur (V, 169).
30 On pourrait déduire de ces postures individuelles que l’engouement actuel en littérature pour les pratiques divinatoires viserait à exorciser le sentiment d’être plongé dans les « temps de la fin », ce que la catastrophe climatique et le désastre politique viendraient encore exacerber. Pour séduisante qu’elle soit, une telle hypothèse me paraît escomater plusieurs aspects de la question. Elle ne lui offre en effet qu’une solution linéaire et réactive, opposant à la difficulté d’imaginer le futur un désir d’avenir sous une forme littéraire. S’il convient sans doute de l’indiquer, je ne ferai donc pas de cette piste contre-collapsologique une réponse tranchée et finale.
31 Voir Yves Vadé, L’Enchantement littéraire. Écriture et magie de Chateaubriand à Rimbaud, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1990.
32 Voir Marie-Hélène Boblet, op. cit.
33 Voir Martin Hervé, « La sorcière : le sexe et la mélancolie de la littérature », Fixxion : revue critique de fiction contemporaine, nº 23 : « Statut du personnage dans la fiction contemporaine », dir. F. Martin-Achard, N. Piégay et D. Rabaté, 2021, en ligne : https://journals.openedition.org/fixxion/709, page consultée le 7 novembre 2024. C’est une conclusion vers laquelle convergent également les ouvrages précédemment cités de Donnarieix et de Boblet.
Programme de recherche
Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 29, 2023
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1871.
Quelques mots à propos de : Martin Hervé
Martin Hervé est docteur en études littéraires. Ses recherches portent sur les représentations et les théories de l’intériorité, sur les écritures de l’homosexualité ainsi que sur le réenchantement dans les littératures française et québécoise. Chercheur affilié au CRILCQ et au Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les sentiments hostiles (UQAM), il a publié ses travaux dans des ouvrages collectifs et différentes revues, parmi lesquelles Études littéraires, Voix et Images, Fixxion, Europe et Roman 20-50.
