Sommaire
Littérature et occulture
Programme de recherche
Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou
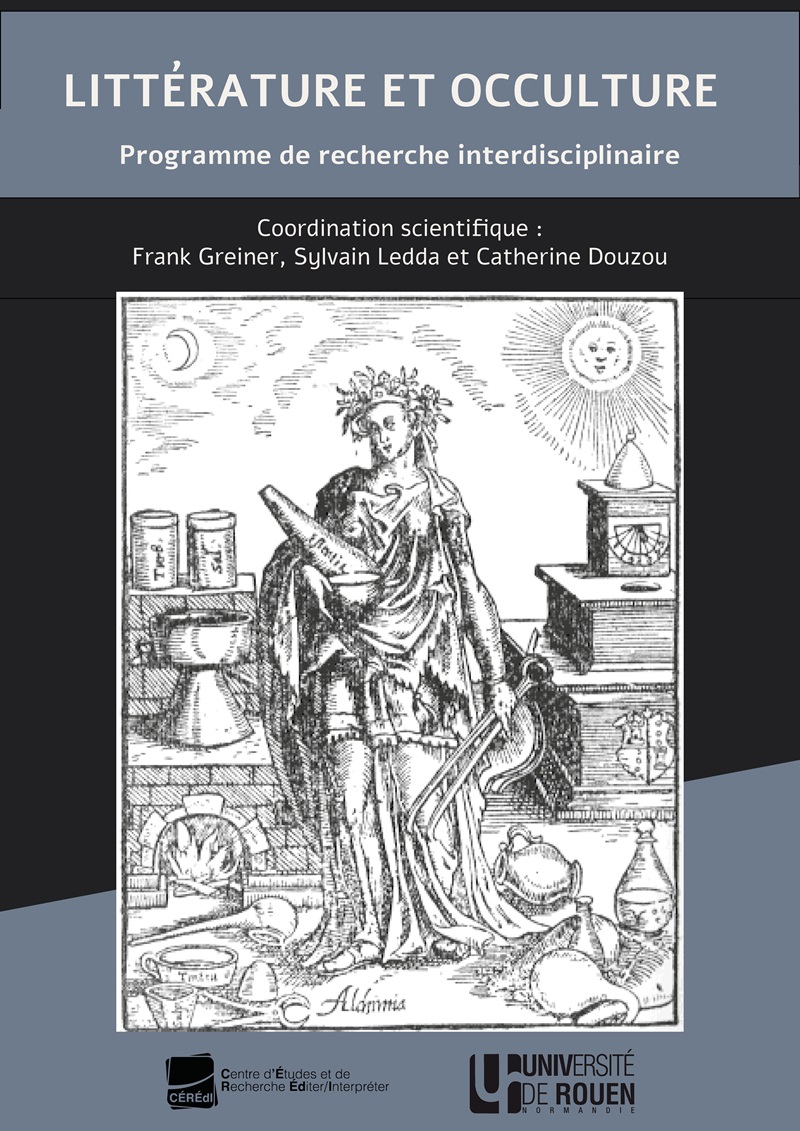
- Première partie : Lectures ésotériques des textes littéraires – Coord. scientifique : Frank Greiner
- Frank Greiner Introduction
- Tom Fischer Pantheum alchemicum, ou quand l’alchimie s’intéresse à la mythologie gréco-romaine
- Piero Latino La littérature française et l’ésotérisme de Dante
- Caroline Legrand L’arithmosophie dans Lorenzaccio : pour une herméneutique du nombre ?
- Frank Greiner À propos d’Umberto Eco et de la sémiosis hermétique
- Agnès Parmentier Quelques caractéristiques d’une herméneutique ésotérique. Le Märchen de J. W. von Goethe lu par Oswald Wirth et Rudolf Steiner
- Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda
- Sylvain Ledda Présentation
- Laurence Danguy Comment regarder le tarot de Marseille ?
- Antony Glinoer Les vies transmédiatiques des Atouts d’Ambre
- Esther Nka Manyol Les arcanes du tarot dans Sépulcre de Kate Mosse
- Stéphane Pouyaud Le crime au miroir du jeu de cartes : parties de cartes et cartomancie chez Agatha Christie
- Martin Hervé Augurer de l’écriture. La voyance littéraire d’après Sophie Létourneau et Anne-Renée Caillé
- Piero Latino Les arcanes majeurs selon Ouspensky, Guaita et le Père Gabriele Amorth
Deuxième partie : Cartes et tarots : imaginaire et représentations littéraires – Coord. scientifique : Sylvain Ledda
Comment regarder le tarot de Marseille ?
Laurence Danguy
1Le tarot de Marseille dénote une instabilité iconographique couplée à des usages changeants qui en rendent l’appréhension difficile. Son histoire est longue, plus méconnue qu’on ne le laisse souvent entendre, dans tous les cas complexe, et peu d’objets condensent à ce point récits fantaisistes et fantasmes. Pourtant, hormis l’incertitude qui pèse sur ses origines historiques mais surtout géographiques, liées à un Orient incertain, rien ne prédestinait ce jeu de cartes ludique, au destin sulfureux qu’on lui connait aujourd’hui. D’une première époque, où le jeu portait le simple nom de tarot, on conserve des exemplaires somptueux, dont les cartes empruntent aux emblèmes ainsi qu’aux iconographies militaire et chrétienne. Ces cartes italiennes réalisées autour de 1450, connues sous le nom de tarot de Visconti, sont parmi les premières à avoir été conservées1. Elles correspondent à l’un des deux moments de la longue histoire des tarots que reconnait l’histoire de l’art. Ce sont des pièces uniques, échappant à la reproduction, issues de jeux différents, tous incomplets qui renferment, sauf exception, 56 cartes et 22 atouts, en tout 78 cartes, soit la structure du tarot de Marseille2. Leur support est « sauvé » de l’imagerie populaire par une taille supérieure à celle des cartes à jouer courantes et surtout par une facture enluminée, associant une technique fine de dessin, des pigments rares et des dorures. Leur auteur est inconnu mais c’est à cette époque monnaie courante ; leur origine est noble et liée à la cour de Milan. Ces cartes remplissent donc les critères nécessaires à une valorisation artistique sans laquelle il n’y a pas d’objet d’art3.
2De ces cartes, on a recherché les usages incertains, probablement ludiques avec une composante initiatique, sans obtenir de certitudes. Cela dit, celles-ci n’ont guère souffert de leur lien profane au jeu, facilement occulté par une aura mystique, alors que les pratiques initiatiques pré-renaissantes et renaissantes sont valorisées par les historiens et les historiens de l’art. On s’est également attelé à la recherche de référentiels, préalable à l’identification de syncrétismes ainsi qu’à la reconstruction de filiations. D’un jeu à l’autre, cependant, l’iconographie des cartes anciennes diffère. Si l’on compare la carte du Monde d’un tarot de Visconti-Sforza avec celles de jeux issus de la même aire géographique, le Nord de l’Italie, on observe certes des convergences matérielles, un format en hauteur et une facture enluminée ; des similitudes dans l’organisation visuelle et une parenté iconographique, une composition en registres verticaux et des couleurs similaires (bleu, vert, rose, rouge, et doré) ainsi que la présence d’un cercle englobant un paysage où se détachent des édifices ; mais les figures y sont différentes : ce sont soit deux puttis debouts, soit une femme en buste vêtue de bleu et flottant, soit une femme de trois quarts habillée de rouge et perchée sur une sphère. Trois références iconographiques transparaissent pour la seule carte du Monde : la première est chrétienne avec la présence de la mandorle sur le modèle d’un Christ en majesté (aussi dit Christ en gloire ou pantocrator) ; la deuxième est également chrétienne et liée au modèle féminin de l’assomption de la Vierge, qui connait alors un essor important dans l’iconographie catholique et génère non seulement des figures féminines flottantes associées à un globe mais aussi de nombreux anges, dont des putti ; la troisième est allégorique à mi-chemin entre sacré et profane : il s’agit de l’allégorie de la Gloire, codifiée dans le traité de Cesare Ripa à la fin du xvie siècle mais dont l’iconographie préexiste. Cette dernière fournit ainsi le schéma d’une figure féminine tenant dans chacune de ses mains un attribut, en l’occurrence le globe et la victoire. La carte du Monde qui arrive en fin de jeu, selon les reconstructions qui ont pu être faites et la numérotation XXI qui lui est généralement attribuée, dominerait l’univers : ses modèles doivent par conséquent être glorieux. Le modèle iconographique le plus fort et qui va s’imposer est celui d’une femme juchée sur une sphère, un attribut dans chacune de ses mains (Figure 1). Pour chacune des cartes, une concurrence similaire entre différents modèles va s’exercer, qui va profiter à un système référentiel aux dépens des autres, révélant le caractère syncrétique du jeu et contribuant à son apparence disparate.

Figure 1 : Le Monde, carte du tarot dit de Charles VI (ou Gringonneur), 1475-1500. Crédits BnF.
3L’autre moment artistique du tarot, devenu entre-temps tarot de Marseille (et donc passé à la divination) est distant de cinq siècles. Il est lié aux avant-gardes du xxe siècle, auxquelles tout un pan de l’historiographie de l’art reconnait des origines occultes, d’ailleurs revendiquées par les artistes eux-mêmes, à commencer par Kandinsky dans Du spirituel dans l’art4, puis par les surréalistes et autres nouveaux réalistes. C’est notamment le cas des cartes créées par Roberto Matta pour Arcane 17 d’André Breton, au nombre de quatre dans la première édition5 ; du Jardin des tarots (Giardino dei Tarochhi) de Niki de Saint Phalle, l’une de ses œuvres phares, créée entre 1978 et 1996 ; du jeu dessiné par Salvador Dali en 1984 ou encore des créations filmiques d’Alejandro Jodorowsky, phénomène et maître es provocation dans l’écosystème artistique du xxe siècle. L’artiste Panique (selon le mouvement éponyme) est le créateur d’une technique thérapeutique d’inspiration jungienne, la psychomagie, où il recourt aux cartes du tarot de Marseille. Dans La Montagne sacrée (1973), l’un de ses films cultes, il met en scène des cartes du tarot, qui par ailleurs parcourent un œuvre où le jeu est omniprésent6.
4L’histoire de l’art s’emploie à replacer ces créations tarotiques, pour reprendre un vocabulaire d’initiés, dans l’œuvre entier. Le Monde de Niki de Saint Phalle sera ainsi regardé vis-à-vis des autres sculptures du Jardin des tarots, ainsi que face à un jeu de cartes dessiné en marge de ces sculptures, mais également en relation avec d’autres œuvres de la sculptrice formellement apparentées, tel L’Ange protecteur7. Trois choses méritent ici d’être relevées qui valent pour beaucoup de créations avant-gardistes incluant le tarot : le choix d’une carte comme base de création parmi les atouts / arcanes majeurs / lames, selon le vocabulaire que l’on privilégie ; une transposition médiale d’une carte à jouer à un dessin ou à une sculpture ; le flou du titre avec Le Choix au lieu de L’Amoureux (le titre courant) qui dénote une privatisation du jeu par l’artiste. Ceci permet de poser un premier diagnostic : si, d’une part, les questions posées aux jeux anciens sont relativement circonscrites – usages, iconographie, matérialité et technicité, auctorialité et circulation de modèles – et que l’on accepte volontiers d’en laisser une partie en suspens au motif de la distance temporelle ; si, d’autre part, les créations avant-gardistes peuvent être pensées devant l’histoire des avant-gardes du xxe siècle, cela ne peut valoir pour le tarot de Marseille dans son entier.
5Hormis ces deux chaînons esthétiquement valorisés, on se trouve, en effet, en présence d’un non-lieu de l’histoire de l’art, c’est à-dire d’un espace impensé et quasiment vide d’images.
6Que l’on se penche sur sa structure, son histoire, son iconographie, sa matérialité ou ses usages, le tarot de Marseille pose, en fait, une somme de questions plutôt inédite pour un objet de recherche qui dépasse le champ de l’histoire de l’art, comme du reste celui de n’importe quelle autre discipline, et impose une approche interdisciplinaire. Ces questions, ce sont celles :
– d’une histoire fortement grevée par des légendes et fantasmes, et marquée par une discontinuité et des ruptures ;
– d’une géographie compliquée avec une dissémination des cartes, des siècles durant, entre l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, la France et l’Angleterre ;
– d’un usage originel longtemps ludique qui pousse celles-ci du côté de la culture populaire et efface des origines artistiquement prestigieuses ;
– d’un usage qui évolue ensuite vers des pratiques divinatoires, ésotériques ou occultistes ;
– d’appropriations sous forme de processus mais aussi de coups de force, des occultistes notamment, et qui sont intimement liées à des croyances ;
– de lectures récentes dans le champ académique, telles celle genrée8, voire post-colonialiste en lien avec les usages et les représentations (à côté de quelques mages, les consultantes et les diseuses de bonne aventure outrageusement typées pullulent) ; mais également de chercheurs s’intéressant aux détournements savants des cartes9 ;
– du rapport texte / image qui se pose après le tournant divinatoire à la fin du xviiie siècle non seulement dans les cartes, entre l’image, le titre et le numéro, mais aussi hors l’image avec la somme des discours associés, exégèses et autres gloses ;
– d’une matérialité fragile et bon marché qui compromet la valeur, si l’on veut bien exclure les premiers jeux tenus pour des objets de collection ainsi que les créations avant-gardistes « forcément » artistiques ;
– d’une structure médiale entravée par la pluralité des cartes ; la reproductibilité des jeux ; les transferts de médiums (la transmédialité), très fréquents dans les périodiques illustrés des xixe et xxe siècles, changeant de forme avec les avant-gardes du xxe siècle, et à présent reconfigurés avec l’arrivée du jeu dans l’environnement numérique ; une tendance continue à la mise en abyme au travers de la représentation des cartes et des scènes de divination ;
– d’une iconographie complexe, à plusieurs titres : plurielle, du fait de cartes hétérogènes parmi les atouts / lames / arcanes majeurs ; répondant à plusieurs référentiels et conduisant invariablement à la question du syncrétisme ; finalement normée, quoique doublement, avec la coexistence à partir du début du xxe siècle de deux traditions standardisées, avec d’une part, en Angleterre, la création en 1909 du Rider-Smith Tarot Deck, dessiné par Pamela Colman-Smith et lié au Hermetic Order of the Golden Dawn (Figure 2) ; d’autre part, en Europe occidentale, la création en 1930 du tarot de Grimaud (Figure 3) ; de nombreux avatars créés à partir ou en marge de ces jeux normés ; quasi infinie par le jeu des combinaisons issues des tirages ;
– d’une image instable pour une carte qui peut être regardée à l’endroit ou à l’envers, voire sur les côtés, par exemple avec le Grand tarot d’Etteila ; instable également d’un jeu à l’autre avec des écarts iconographiques irritants, quoiqu’insuffisants pour imposer une singularité ; posant, enfin, très souvent la question de l’auctorialité.

Figure 2 : Le Monde, carte du tarot de Rider-Smith. Crédits Wikimedia Commons.

Figure 3 : Le Monde, carte du tarot de Grimaud, 1930 (facsimilé). Crédits Laurence Danguy.
7Parmi ces questions, certaines ne concernent pas ou peu l’histoire de l’art et d’une manière générale les études sur l’image. Les questions spécifiques sont celles médiales, iconographiques, de matérialité, d’auctorialité et d’usages. La difficulté à s’en saisir, au-delà de leur nombre, est d’abord liée aux critères de valeur et de légitimité : il faut typiquement trancher la question de savoir si l’on doit s’occuper d’un objet reproductible et lié au jeu, c’est-à-dire d’un objet peu légitime et longtemps taxé d’amoralité.
8Plusieurs de ces problématiques ont, de plus, tendance à se complexifier. Ainsi en est-il de l’auctorialité. On ne connait pas le créateur des cartes italiennes anciennes, c’est entendu. Le tarot de Grimaud est quant à lui la première version du jeu connue pour avoir été fabriquée de toutes pièces, alors que son créateur, Paul Marteau, directeur de la maison Grimaud et passionné d’ésotérisme10, met en avant un critère d’authenticité. Le jeu est présenté comme « l’ancien tarot de Marseille » : il prend, en réalité, comme modèle un tarot de Besançon, dont il modifie les couleurs en reprenant celles d’un tarot de Conver et substitue aux cartes de Jupiter et Junon celles du pape et de la papesse11. D’autres tarots « authentiques » ont été créés depuis, dont le tarot d’Alexandro Jodorowsky et Philippe Camoin, fabriqué par ordinateur à partir d’une dizaine de modèles de tarots anciens, et commercialisé en 199712. La création est ici relative et d’ailleurs assez proche des créations réalisées avec l’IA. La situation des cartes de Niki de Saint Phalle est inverse. Celles-ci sont connues d’après le nom de l’artiste et considérées comme résultant de son imagination. Le tarot de Marseille joue alors le rôle de support imaginal, et il faut noter la glose que l’artiste associe à la carte du Monde : « Le monde est la carte de la splendeur de la vie intérieure. C’est la dernière carte de l’arcane majeur et le dernier exercice spirituel du jeu. À l’intérieur de cette carte est le mystère du monde ; c’est la réponse du Sphinx. » L’auctorialité de cartes créées à partir d’un modèle de génération d’images fonctionnant d’après un prompt (un texte) – Stabble diffusion, par exemple – est d’évidence très indécise, et n’existe que par la formulation individuelle du texte et le choix opéré parmi une série d’images13. L’opération met d’ailleurs en évidence la construction très normée de la base de données d’après laquelle s’exercent les algorithmes, en révélant le modèle de l’assomption, pourtant effacé dans les cartes contemporaines.
9Ce qui, de fait, modifie profondément la donne est la conversion ésotérique du jeu à la fin du xviiie siècle, puis occultiste au xixe siècle. La véritable rupture dans l’histoire des tarots consiste dans le basculement du jeu vers la divination, alors que jusque-là, il s’agissait d’un jeu de fantaisie. Les acteurs de ce basculement sont bien connus : Antoine Court de Gébelin avec son Monde primitif, puis, à la suite, le comte de Mellet, alors qu’aucun des deux ne pratiquaient la divination. C’est en fait Alliette (dit Etteilla), sur le compte duquel on sait très peu de choses, qui inscrit véritablement le tarot de Marseille dans un usage divinatoire en s’appuyant sur les écrits de Court de Gébelin et de Mellet. Cette entrée dans l’ésotérisme est confortée par une série de personnages médiatiques : Mlle Lenormand, dite la sibylle des salons, Éliphas Lévi, de son vrai nom Alphonse Louis Constant, qui fait du jeu un objet occulte, puis Papus (Gérard Encausse)14, etc…
10Cette entrée dans le surnaturel génère trois phénomènes qui perturbent une appréhension du jeu et surtout de ses images : 1. des pratiques combinatoires des cartes obligeant à regarder des ensembles non stables, contrôlés par des mages ou des tireuses de cartes, puis par tout un chacun ; 2. de nombreuses gloses ésotériques (et donc du texte), intimement associées aux cartes en provenance de spécialistes auto-proclamés, toujours plus nombreux ; 3. un engouement populaire et une appropriation tous azimuts du jeu, y compris par les artistes. Le basculement vers la divination constitue à présent le pivot sur lequel fonctionne le tarot de Marseille. Il a pour conséquence une perception d’images qui tendent à être vues comme magiques, et qui sont livrées, tant pour leur création que pour leurs usages, à tout un chacun. Les usages du tarot de Marseille se distribue dès lors entre, d’une part, une pratique divinatoire, ouvrant sur un usage combinatoire des cartes, des incantations occultes, des pratiques interactives, des interprétations nombreuses et qui ne connaissent pas de limites rationnelles ; d’autre part, une pratique poétique, où une carte, plus rarement un ensemble de cartes va donner lieu à des recréations, avec une fréquente porosité entre les pratiques.
11Dès lors, que regarder et surtout comment ? On touche ici moins à des résistances disciplinaires, qui existent bel et bien et vont essentiellement porter sur l’effet de massification, qu’à un déficit conceptuel, à quelque chose qu’on ne sait tout simplement pas penser. La relégation des tarots dans les marges de l’histoire de l’art et plus largement son écartement par la communauté scientifique tient essentiellement à cette difficulté conceptuelle. Longtemps, la question combinatoire s’est imposée à moi comme le cœur du problème, alors qu’il s’agit en réalité de l’extension d’un problème de base tenant à la structure de l’image, et qui débute avec une carte unique. Comment, par exemple, lier la carte du Monde au discours d’exégètes « autorisés » ou moins autorisés, c’est-à-dire avec ou sans légitimation historiographique ?
12Arrêtons-nous à présent sur quelques exégèses émanant de l’historiographie très particulière du tarot :
– pour Court de Gébelin (1773), l’auteur du Monde Primitif :
Ce Tableau que les Cartiers ont appelé le Monde, parce qu’ils l’ont considéré comme l’origine de tout, représente le Tems15.[…] Dans le centre est la Déesse du Tems, avec son voile qui voltige & qui lui sert de ceinture ou de Péplum, comme l’appellent les Anciens. Elle est dans l’attitude de courir comme le Tems & dans un cercle qui représente les révolutions du Tems, ainsi que l’œuf d’où tout est sorti dans le Tems. Aux quatre coins du Tableau sont les emblêmes des quatre Saisons […]. L’Aigle représente le Printemps, où reparoissent les oiseaux. Le Lion, l’Eté ou les ardeurs du Soleil. Le Bœuf, l’automne, où on laboure & où on sème. Le Jeune Homme, l’Hiver où l’on se réunit en société16 ;
13– pour Alliette (1783), instigateur du tournant divinatoire : « Le Monde signifie voyage17 » ;
14– pour Papus (1889), grand occultiste de la Belle-Époque :
Une jeune fille nue tenant une baguette dans chacune de ses mains et les jambes croisées l’une sur l’autre (comme le Pendu de la douzième lame) est placée au milieu d’une ellipse. Aux quatre coins de celle-ci sont figurés les quatre animaux des Évangélistes et les quatre formes du Sphinx : L’Homme, le Lion, le Taureau et l’Aigle.
Ce symbole représente le Macrocosme et le Microcosme, c’est-à-dire Dieu et la Création ou la Loi de l’absolu. Les quatre figures placées aux quatre coins représentent les quatre lettres du nom sacré ou les quatre grands symboles du Tarot […]
Cette vingt et unième lame du Tarot nous montre donc en elle le résumé de tout notre travail et nous prouve rigoureusement la vérité de nos déductions. Une figure simple résume tout cela […]
Ce symbole nous donne aussi exactement la figure de la construction du Tarot lui-même si nous remarquons que la figure du centre reproduit un triangle (tête et deux bras étendus) surmontant une croix (jambe). […]
Les quatre coins reproduisent alors les quatre grands symboles du Tarot. Le milieu représente l’action de ces symboles entre eux figurée par les dix nombres des arcanes mineurs et les vingt-deux lettres des arcanes majeurs. Enfin le centre reproduit la loi septénaire des arcanes majeurs eux-mêmes18.
[L]e sens divinatoire est une réussite assurée19 ;
15– pour Oswald Wirth (1927), ésotériste suisse alémanique, proche de l’occultiste Stanislas de Guaita :
Il s’agit de l’achèvement, de la récompense, de l’apothéose, de l’influence de Jupiter-Soleil ; la carte peut être vue en bien (fortune majeure) ou en mal (obstacle formidable)20 ;
16– pour Paul Marteau (1949), créateur du tarot de Grimaud :
SENS ÉLÉMENTAIRE. Représente l’homme qui s’est équilibré en prenant appui sur les principes cosmiques : la sagesse et la spiritualité, la puissance génératrice et la puissance directrice, et qui exerce son pouvoir sur la Nature dans l’harmonie des lois universelles.
SENS CONCRET. Se trouvant au sommet des arcanes majeurs, elle concrétise harmonieusement les efforts de l’évolution indiquée par les Lames précédentes.
MENTAL (l’intelligence). Grande puissance sur ce plan. Tendance vers la perfection. Maîtrise mentale et psychique.
ANIMIQUE (les passions émotives). Elle conserve sa puissance sur ce plan et signifie élévation de l’esprit, sentiment d’amour altruiste, c’est-à-dire ni égoïste, ni sensuel (l’être représenté sur la lame étant androgyne). Amour de l’humanité. Tendance vers la perfection. Inspiration chez les artistes.
PHYSIQUE (le côté utilitaire de la vie). Elle perd, sur ce plan auquel elle n’est presque pas adaptée, une majeure partie de sa puissance. Acquis riches. Affaires solides et rayonnantes. Succès et mondanités. Santé bonne.
RENVERSÉE. Embûches, encombrements, insuccès. Négation d’un triomphe, de sentiments. Sacrifice de l’amour21 ;
17– pour Alexandro Jodorowsky (2004), qui s’exprime d’après le jeu qu’il a créé :
Il [l’arcane] représente la réalisation suprême. Nous y découvrons une femme qui semble danser au milieu d’une couronne de feuillages bleu ciel, avec dans sa main droite une fiole, principe réceptif et dans la gauche un bâton, principe actif. Comme dans le symbole du Tao, le Yang soutient le Yin et vice-versa. Une écharpe de couleur bleue (en haut et derrière elle) passe sur le devant de son corps et devient rouge. Bien que le personnage soit indéniablement féminin, c’est l’union des principes, l’androgyne réalisé qui est suggéré par cette figure. Dernier degré du chemin des Arcanes majeurs, Le Monde appelle à se reconnaitre dans sa réalité profonde, à accepter la plénitude de la réalisation. C’est aussi le moment où, délivré de l’autodestruction, on commence à entrevoir la souffrance de l’autre et à se mettre au service de l’humanité. Dans la tradition chrétienne, le Christ, la Vierge ou les saints sont parfois représentés ainsi à l’intérieur d’une figure ovale […] On pense aussi à l’œuf philosophique, évoqué entre autres dans la Turba philosophorum […] Cette carte est un miroir de la structure du tarot. Quatre figures encadrent la femme dans la mandorle, comme quatre énergies de base unies en harmonie au service d’un même centre. Dans la tradition chrétienne, l’ange, le bœuf, l’aigle et le lion représentent les quatre évangélistes. Ici, ces quatre éléments nous servent de base pour comprendre les quatre Couleurs ou symboles des Arcanes mineurs […] Les quatre énergies rayonnent autour du centre, entièrement réalisées. Et dans son œuf bleu, empli d’amour et de conscience pour tout l’univers, le personnage central danse en regardant vers la gauche, la réceptivité. […] À condition d’être placé en fin de phrase, dans sa position d’accomplissement, Le Monde indique une grande réalisation […] De même que l’Arcane XVI, La Maison Dieu pouvait évoquer un sexe masculin en pleine éjaculation, l’Arcane XXI évoque un sexe féminin habité par une exultation (l’orgasme) ou par un être (femme enceinte). […] En revanche, si la carte se trouve au début du jeu, elle représentera un commencement difficile : la réalisation est exigée avant tout action, elle n’est pas à sa place, elle devient un enfermement22 ;
18– pour Carole Sédillot (2011), « tarologue » contemporaine et adepte de la psychologie des profondeurs de Carl Jung, comme le sont actuellement la plupart des « tarologues » dans le sillage d’Alejandro Jodorowsky :
Chacun des arcanes précédents en œuvrant spécifiquement a révélé l’essentiel pour permettre l’aboutissement et l’apothéose promis par le Monde. L’arcane XXI est une étape de synthèse qui propose l’éclosion de l’homme achevé. […] L’adepte, libéré de ses entraves matérielles et humaines et d’une pesanteur morale et mentale, n’est plus limité, il reflète l’expression authentique du Soi véritable23.
19Pourquoi donc s’arrêter sur ces exégèses ? Parce que celles-ci mettent en évidence les interprétations différentes de regardeurs, qui ne peuvent être dissociés de leurs croyances et de leur imaginaire, et deviennent les locuteurs des cartes. Ces cartes représentent peu, puisqu’elles ne rendent pas présent un personnage absent, pas plus qu’elles ne révèlent vraiment le dispositif de leur créateur, selon l’acception du concept de représentation énoncé par Louis Marin, lui-même héritier de théories anciennes sur la représentation24. Par contre, elles se présentent fortement au travers d’un dispositif icono-discursif, qui n’est que peu situé du côté du créateur mais beaucoup du côté d’un regardeur, qui associe à ces images souvent esthétiquement simples un discours, celui d’un exégète ou le sien, le plus souvent un mélange des deux. Ce sont des images surdéterminées qui échappent à l’histoire de l’art, pour lesquelles, par exemple, les notions de commanditaire et de destinataire ne sont plus opérationnelles. Aucune théorie de l’image ne permet d’en saisir ni la structure ni l’efficacité, sauf à glaner ici ou là des bouts de concepts, de puissance de l’image et d’opacité, devenus les titres d’ouvrages de Louis Marin25 ; d’une économie qui ne serait pas rationnelle et produirait une efficacité « sombre », dite par Georges Didi-Huberman26 ; de volonté de l’image selon W. J. T. Mitchell27, etc. Il faut sans doute se tourner vers l’anthropologie religieuse pour situer ces cartes, et transposer le concept de recharge sacrale. Celui-ci a été introduit par Alphonse Dupront, historien et anthropologue du religieux (surtout du catholicisme), qui tenait pour acquis la survivance dans une société sécularisée d’un homo religiosus tendant à introduire du sacral dans des lieux, des productions, des créations, afin de mettre ceux-ci en accord avec son besoin de sacré28. Il ne s’agit, en l’espèce, que rarement d’une recharge sacrale mais, selon le regardeur, d’une recharge imaginale voire figurale, pour les artistes, par exemple ; d’une recharge ésotérique ou occultiste, pour les adeptes du tarot, spécimens d’un homo « symbolicus », selon le terme choisi par Céline Bryon-Portet29. La pluralité mais surtout la diversité des exégèses révèle un regard intimement lié aux croyances. Peu importe d’ailleurs le jeu que l’on retient, tarot de Grimaud, de Rider-Smith ou autre. La linéarité du langage, et donc la formulation de la pensée, oblige à choisir un jeu (et une carte) mais c’est, en fait, conceptuellement sans importance, puisque le raisonnement peut être transposé à un autre jeu ou à une autre carte. Les cartes du tarot de Marseille ont pour particularité d’être ce que l’on en fait, ce sont des images qui ne se limitent pas à leur surface représentationnelle mais des images augmentées par un supplément de sens. Elles témoignent d’une hypercomplexité sémantique mais surtout elles forcent le regard.
1 Thierry Depaulis (éd.), Tarot, jeu et magie, Paris, Bibliothèque nationale, 1984, p. 34-38.
2 Laurence Danguy, « Le tarot de Marseille. Regard sur les images d’un éphémère magique », dans Les Éphémères imprimés et l’image. Histoire et patrimonialisation, dir. Olivier Belin, Florence Ferrand et Bertrand Tillier, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, collection « Art, archéologie et patrimoine », 2023, p. 196-197.
3 Laurence Danguy, « Lieux et valeurs des biens culturels », dans A contrario. Le fabuleux destin des biens culturels. Ordre et désordres de la réception, Lausanne, BNS Press, 2016, p. 15-18.
4 Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der Malerei, Munich, R. Piper, 1911.
5 À ce sujet, voir la contribution de Gwenaël Beuchet.
6 Frédéric Aranzueque-Arrieta, Panique. Arrabal, Jodorowsky, Topor, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 15 ; Michel Larouche, Alexandro Jodorowsy. Cinéaste panique, Montréal, Les presses de l’Université de Montréal : Paris, Éditions Albatros, 1985, p. 135 ; Élisabeth Pouilly, L’« État d’esprit performatif » dans le théâtre et le cinéma d’Alejandro Jodorowky, Paris, Éditions Complicités, 2020, p. 288-289, 291-293, 372-373, 375-76.
7 Niki de Saint Phalle, L’ange protecteur, 1998, Lithographie en couleur et collage sur papier, 61 × 43,5 cm.
8 Voir plusieurs contributions de la journée d’étude, en particulier celle d’Hervé Martin
9 À ce sujet, voir Jean-François Bert, Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, Paris, Anamosa, 2018 ; Gwenaël Beuchet, « Les cartes à jouer à l’époque moderne, un objet paradoxal », dans Les Cartes à jouer du savoir. Détournements savants au xviiie siècle, dir. Jean-François Bert et Jérôme Lamy, Bâle, Schwabe Verlag, 2023, p. 27-55.
10 Thierry Depaulis, Tarot, jeu et magie, op. cit., p. 132.
11 Isabelle Naldony, Histoire du tarot. Origines. Iconographie. Symbolisme, Escalquens, Trajectoire, 2018, p. 112.
12 Ibid., p. 174.
13 Laurence Danguy et Julien Schuh, « L’œil numérique : vers une culture visuelle hybride », Sociétés & Représentations, no 55, 2023, p. 64-68.
14 Laurence Danguy, « Le tarot de Marseille. Regard sur les images d’un éphémère magique », art. cité, p. 197-198.
15 Voir la contribution de Frank Greiner qui relate que Court de Gébelin s’en prend à l’ignorance (supposée) des cartiers dans le Monde Primitif.
16 Court de Gébelin, Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne considéré dans son génie allégorique et dans les allégories auxquelles conduisit ce génie ; précédé du Plan général des diverses parties qui composeront ce Monde primitif, tome 1, Paris, Valleyre et Sorin, 1773., p. 378.
17 Etteilla (Alliette), Manière de se recréer avec le jeu de cartes nommées tarots. Pour servir de troisième Cahier à cet Ouvrage, Paris, A. Amsterdam, Segault, Legras, 1783, p. 6.
18 Papus, Le Tarot des bohémiens. Le plus ancien livre du monde, Paris, Ernest Flammarion, 1889, p. 194-195.
19 Ibid., p. 324.
20 Cité d’après Isabelle Nadolny, Histoire du tarot. Origines. Iconographie. Symbolisme, op. cit., p. 247 ; l’ouvrage d’Oswald Wirth est Le Tarot des imagiers du Moyen Âge , Paris, Tchou, 1927.
21 Cité d’après Isabelle Naldony, Histoire du tarot. Origines. Iconographie. Symbolisme, op. cit., p. 247.
22 Alexandro Jodorowsky et Marianne Costa, La Voie du tarot, Paris, Albin Michel, 2004, p. 263-265.
23 Carole Sédillot, Jeu et enjeu de la psyché : pensée jungienne, alchimie et archétypes du tarot, Paris, Dervy, 2011, p. 94.
24 Louis Marin, Le Portrait du roi, Paris, Les Éditions de Minuit, 1981, en particulier p. 11-13.
25 Ces concepts sont notamment développés dans trois ouvrages : Louis Marin, De la représentation, Paris, Seuil / Gallimard, 1994 ; Des pouvoirs de l’image, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1993 ; Opacité de la peinture, Paris, École des Hautes études en sciences sociales, 2006 (1989).
26 Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Les Éditions de Minuit, 1990, p. 174-175.
27 W. J. T. Mitchell, Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Dijon, Les Presses du réel, 2014 (2005).
28 Alphonse Dupront, Du sacré – Croisades et pèlerinages, images et langages, op. cit., p. 109, 115 et 125.
29 Céline Brion-Portet, « Le “pouvoir” des cartes », dans Cartomancie. Entre mystère et imaginaire, dir. Gwenaël Beuchet, numéro spécial de l’As de Trèfle, décembre 2019 (catalogue d’exposition au musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux, 11 décembre 2019-7 juin 2020), p. 79.
Programme de recherche
Coordination scientifique : Frank Greiner, Sylvain Ledda et Catherine Douzou
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 29, 2023
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1808.
Quelques mots à propos de : Laurence Danguy
Université de Lausanne
Laurence Danguy, docteure de l’EHESS et de l’Université de Constance (Allemagne), est chercheuse du Fonds national suisse à l’Université de Lausanne et enseigne au Collège des humanités de l’EPFL de Lausanne. Elle est également chercheuse associée de l’équipe ISOR du CRH XIX. Sa thèse de doctorat a été publiée en 2009 sous le titre L’Ange de la jeunesse. La revue Jugend le Jugendstil à Munich dans la collection « Philia » des éditions de la Maison des sciences de l’homme. Sa monographie Le Nebelspalter zurichois (1875-1921) : au cœur de l’Europe des revues et des arts (Projet FNS/Unil) est parue chez Droz en 2018. Elle a codirigé plusieurs publications (récemment L’Œil Numérique avec Julien Schuh, Société et Représentations, no 55) et est l’auteure de nombreux articles et contributions sur l’image populaire, les périodiques illustrés dans l’espace européen, la théorie de l’art. Elle a exposé ses recherches sur les cartes à jouer et le tarot de Marseille dans le cadre de divers colloques et séminaires. Elle a récemment publié « Le tarot de Marseille. Regard sur les images d’un éphémère magique », dans Les Éphémères imprimés et l’image. Histoire et patrimonialisation sous la direction d’Olivier Belin, Florence Ferrand et Bertrand Tillier (2023).
