Sommaire
L’Air des livres. Respirations, inspirations
Les Carnets du vivant, n° 1
Volume publié sous la direction de Thierry Roger
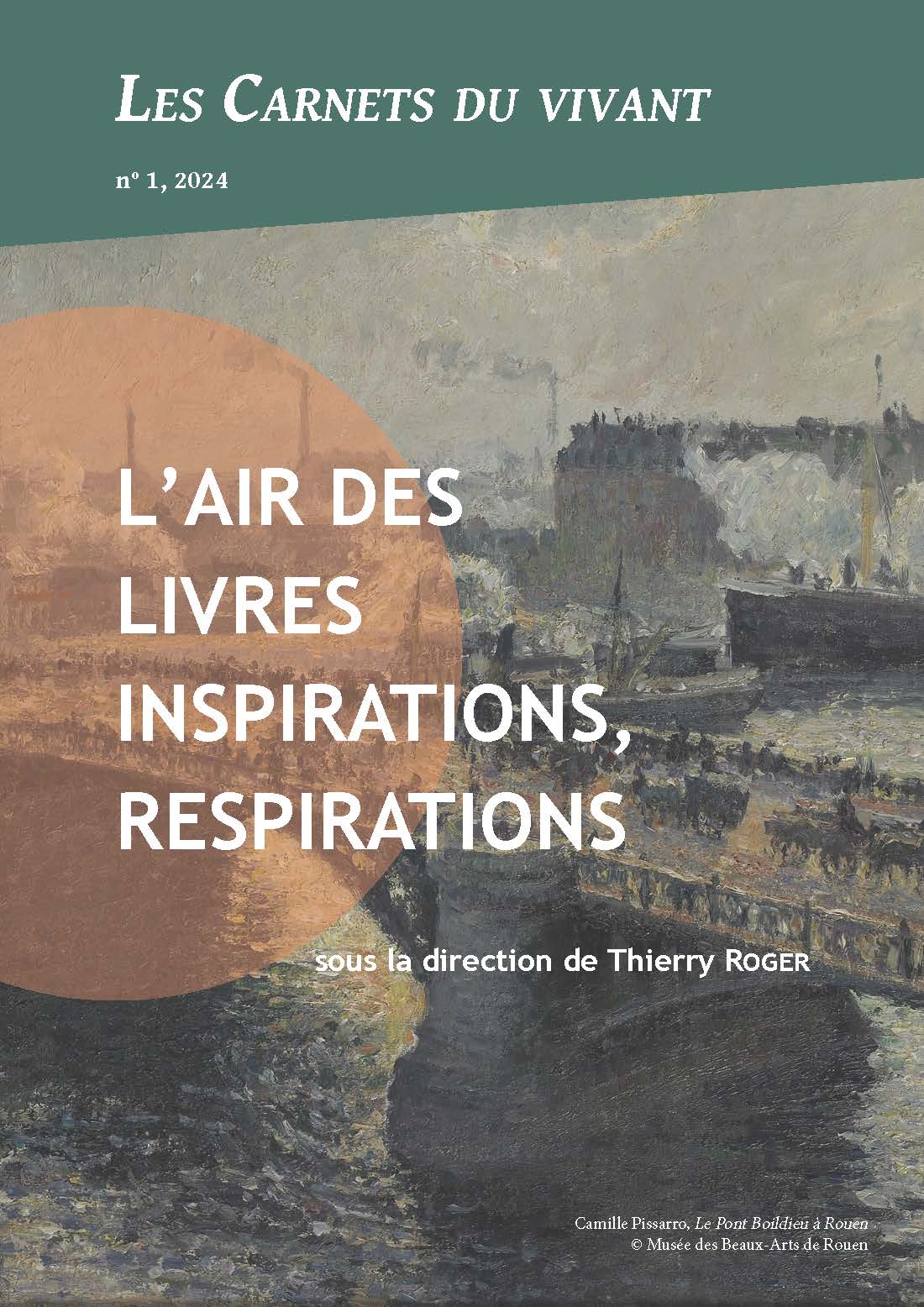
- Politiques de l'air
- François Vanoosthuyse L’asphyxie des ouvriers.
L’enjeu de la respiration dans les enquêtes d’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels sur le prolétariat anglais - Valérie Stiénon Un air de fin du monde : les asphyxiés du futur. Anticipation sociale et poétique de la raréfaction
- Bertrand Guest Poly-caco-phonies pour catastrophes inodores. De Tchernobyl à Somaland
- Patrick Suter Crise et poétique de l’air à la lumière de l’exigence situationniste
- Pneumatologiques
- Thomas Augais Air et voix dans la poésie d’André du Bouchet
- Lydie Cavelier Pierre Chappuis et l’espace du poème : créer un appel d’air
- Christèle Couleau Colonnes d’air et vents contraires – les « éolivres » d’Alain Damasio
Pneumatologiques
Air et voix dans la poésie d’André du Bouchet
Thomas Augais
1Si, depuis Claudel et Rilke, la poésie du xxe siècle a partie liée avec la respiration, elle doit se débattre au mitan du siècle avec un sentiment général d’asphyxie lié aux circonstances historiques. L’œuvre d’André du Bouchet (1924-2001) en témoigne de manière emblématique. Ses premiers développements sont en effet liés au contexte d’une guerre qui contraint le poète à l’exil lorsque les lois antijuives d’octobre 1940 interdisent à sa mère Nadia Wilter d’exercer la médecine. Quoiqu’il refuse de lier trop directement son œuvre aux circonstances historiques, Du Bouchet ne cessera de méditer sur ce que la violence politique fait à la langue, en particulier lorsque son amitié avec Paul Celan et son désir de traduire en français les poèmes de ce dernier l’inciteront à revenir sur les mots de l’auteur de Renverse du souffle1 : « Il y a quelque chose de pourri dans la poésie de Hölderlin2. »
2L’œuvre de la maturité rencontrera une autre forme de l’irrespirable, celle propre à ce début de troisième millénaire à l’aube duquel André du Bouchet décède en 2001 : une pollution atmosphérique dramatique, qui n’est qu’un aspect parmi d’autres du saccage généralisé par l’homme de son habitat. Une telle pollution incite à retourner la formule de Rimbaud qui plaisait tant à Breton – « que salubre est le vent ! » – en son contraire, « qu’insalubre est le vent » et particulièrement lors d’un événement comme l’incendie dans la zone de stockage de l’usine Lubrizol (Rouen) qui est à l’origine du colloque dont est issu ce dossier.
3Cette situation d’André du Bouchet permet de comprendre l’obsession de l’air qui traverse sa poésie, à tel point que le substantif « air », qui sert de titre à plusieurs poèmes et recueils d’époques très différentes, pourrait aussi désigner l’ensemble de son œuvre. Élément privilégié de l’imaginaire matériel du poète, l’air n’est cependant pas qu’une simple thématique de son œuvre. Le paradigme aérien ou pneumatologique engage son rapport à l’espace matériel de la page. Il est également la source d’une « physiologie de la lecture3 » dont les recherches articulatoires et phonatoires sont de plus en plus sensibles dans les lectures du poète à partir des années 1970. Nous nous proposons de penser le trajet qui mène du sentiment d’asphyxie qui caractérise le recueil Air (1951) à ces lectures des années 1970, qui témoignent d’une ample circulation du souffle.
Combattre l’asphyxie (Air, 1951)
4Le tropisme aérien d’André du Bouchet est un sujet trop vaste pour envisager de l’épuiser ici. À défaut de pouvoir embrasser l’ensemble de l’œuvre, nous allons dans un premier temps nous concentrer sur une partie peu commentée de celle-ci : ses premiers écrits, depuis son retour en France en 1948 jusqu’à la publication de son premier recueil, Air, chez Jean Aubier, en 1951. Nous nous appuierons sur ses premiers articles critiques4 ainsi que sur les carnets de cette période transcrits et publiés par Clément Layet aux éditions Le Bruit du Temps5, où se dessine ce qui apparaît comme une poétique du souffle coupé.
5Cette époque décisive dans l’élaboration de l’œuvre apparaît irrespirable au poète pour des raisons personnelles : bibliothécaire au service des microfilms du CNRS, il ne peut se consacrer comme il le souhaite à la poésie. Elle l’est également du fait d’un contexte politique et social étouffant. Ayant vécu douloureusement l’exil aux États-Unis, André du Bouchet rentre dans un pays en ruines et prend conscience de l’horreur qui a été traversée. Dans l’air qui l’entoure, il perçoit les relents des crimes nazis, évoquant dans l’un de ses cahiers la « fumée noire de Majdanek, de Buchenwald6 ». Le contexte social lui pèse également. Il s’est rapproché dès sa période américaine des idées communistes. Dans les lumières du couchant, il lui semble percevoir le reflet de « l’homme incendié en Corée7 ». Les carnets d’André du Bouchet témoignent de ce caractère irrespirable de l’époque ainsi que de son propre état d’asphyxie. Il éprouve l’impression de se débattre dans une « prison d’air8 » :
et ce qui nous fait
suffoquer
c’est la respiration
la terre
où je marche
l’air confiné9
6Née de ce sentiment de suffocation, la poésie se confond pour André du Bouchet avec l’acte même de la respiration, et c’est dans ce sens qu’il faut comprendre le titre de son premier recueil, Air, dont on peut relire la « prière d’insérer » :
À l’heure où la réalité coupe comme un morceau de vitre, on voit clairement les détails de la rue. Aussi reconnaissables qu’une chose jamais vue ni entendue. Quand la réalité se tait, comprenant alors qu’on est en dehors de la réalité, et qu’il faut y entrer.
[…]
Vraiment, il faut relever la tête pour pouvoir respirer10.
7Ce sentiment de n’être pas au monde associé à l’espoir que la poésie puisse être le « bouche-abîme du réel désiré qui manque11 », André du Bouchet le rencontre à cette époque dans la poésie de Pierre Reverdy, sur laquelle il commence à écrire dès le mois d’avril 1949. Il consacre une note de lecture au Chant des morts dans le no 42 des Temps modernes12. À la galerie Carré, où ce « livre de dialogue » entre Reverdy et Picasso est exposé, Du Bouchet est attentif à la manière dont les illustrations du peintre « perdent leur caractère d’illustration en se laissant aller au fil d’une écriture avec qui elles respirent et se confondent13 ». Cette auscultation des méandres pulmonaires du livre tient au fait qu’André du Bouchet est frappé par la manière dont, depuis trente-cinq ans, Reverdy incorpore à ses textes le consentement à l’oubli et à la dissolution qui signe l’authenticité de sa démarche poétique mais détourne le public de son œuvre. Cette œuvre tendue entre émergence et résurgence apparaît au jeune poète comme un « système respiratoire14 ».
8C’est donc un lecteur passionné de Reverdy15 qui publie en 1951 son premier recueil Air chez Jean Aubier. Dans ce livre placé sous le signe de « l’air sans cesse renouvelé16 », le sujet poétique affronte pourtant un sentiment de suffocation, l’air est placé sous le signe du manque, d’une faille existentielle :
AIR
D’air à air. Qui le dénonce à celui qui le dénonce. Sans trêve. Qui a faim et à qui on présente une poignée d’air.
Air sur air. Je respire. C’est un martyre commun, connu des portes et des rues17.
9L’imaginaire aérien est ici connoté négativement par la métaphore du « martyre ». L’air paraît une nourriture bien pauvre et frustrante pour calmer une faim existentielle qui n’est pas sans évoquer celle du Rimbaud des Fêtes de la faim qui n’a de goût « que pour la terre et les pierres ». Pourtant le poème « Air » propose un trajet et la figure de l’air se dédouble (« D’air à air »), de manière presque métadiscursive, comme s’il s’agissait de passer du titre du poème à celui du recueil.
10Il semble y avoir une corrosion de l’air, un versant noir du souffle présent dès l’origine dans l’œuvre d’André du Bouchet. Dans le poème « La porte verte », un air torride et irrespirable donne au sujet poétique la sensation que « La nuit bout18 ». La « fumée » est « visible aux angles du pavé » et cette aridité ne brûle pas que le poumon, elle touche également « la pupille à vif que l’air irrite19 ». Le point extrême de la suffocation est atteint dans un poème intitulé « Moteur de la nuit » :
Le ciel en brèche
l’eau n’a pas encore eu le temps de sécher
elle s’étale sur la chaussée comme une main
nuages en marche
il n’y a pas de vent
il n’y a pas de lumière
nuit
souffle coupé20.
11Malgré la marche des nuages, le trajet poétique semble ici atteindre un point aveugle où l’air et la lumière absents asphyxient. L’angoisse provoquée par l’atmosphère immobile et l’absence de lumière semble préfigurer un arrêt de tout : « Comment peut-on vivre après que l’air vous a coupé le souffle ?… après que l’air vous a frappé dans le cœur21 », s’interroge André du Bouchet. Il s’agit de traverser le point de suffocation où se joue l’accès à l’air inépuisable des « lointains », trouver le point de ressourcement où la mort se convertit en vie, et par-delà lequel le poète qui constatait « j’ai cessé22 » peut retrouver l’élan où puiser les mots « je pullule23 ».
12Le poème « Feu de vent24 » qui suit « Moteur de la nuit » évoque une telle possibilité de renaissance :
Ouvert à tous les courants
aux fouets du vent qui remue les loquets
les nappes brassées dans la lande violente
dans la cuve des blés où trempe la pénombre
les mains en feu
lampée d’or
de la lumière qui souffle de tous les coins du monde.
13La coupure du souffle se résout ici en ouverture à la vie « violente ». Dès le titre du poème, air et lumière apparaissent intimement mêlés. La vie se dissémine à tout le paysage comme l’évoque la synesthésie élémentaire de la lumière qui « souffle » : air et feu créateur semblent se conjoindre et ce qui brûle les poumons du poète est peut-être cette obsession de respirer la lumière. Tout le sort de l’œuvre ultérieure semble dès lors se jouer dans la capacité d’André du Bouchet à convertir le « moteur de la nuit » du recueil Air en « moteur blanc ». Le Moteur blanc, c’est bien sûr le titre de cette série de poèmes de 195625 qui est au point de bascule de l’écriture poétique d’André du Bouchet, une série qui trouve sa place en 1961 dans un recueil ouvert au jeu des blancs typographiques. L’étymologie du substantif moteur est indicatrice de mouvement, et le « moteur blanc » semble évoquer ce mouvement d’air et de lumière qui irrigue le poème « Feu de vent ».
14Née du besoin de renouer avec une respiration profonde, la poésie est également ce qui provoque l’asphyxie. L’une des sections du recueil Air est intitulée « Écorces ». Le sujet poétique semble vouloir arracher cette pellicule protectrice qui le protégeait du réel. Une telle mise à nu provoque une brûlure qui suffoque. La plaie de vivre est à vif, comme le diront d’une autre manière les premiers vers du « Moteur blanc » : « J’ai vite enlevé / Cette espèce de pansement arbitraire / Je me suis retrouvé / libre / et sans espoir26 ». L’opération poétique suppose une intensification du rapport au monde, porté à son point d’incandescence. Tant par les conditions extrêmes qu’elle exige pour se manifester dans toute sa violence que par ses multiples facettes réfléchissant la lumière, par sa pointe coupante, blessante, d’une dureté infrangible, la poésie devient pour André du Bouchet le « diamant de la respiration ». Cette métaphore apparaît dans les carnets de cette période27. Lorsque le sujet poétique se défait de sa gangue protectrice pour une plongée véritable dans « l’air indicible28 », il se voit privé de ses moyens d’expression. L’asphyxie équivaut alors à un sentiment d’aphasie né de l’écart entre le réel et le langage.
15Cette asphyxie poétique témoigne du refus d’un certain rapport à l’image, lorsque celle-ci se coupe du réel par abus de langage. En ce temps-là, « la poésie manquait d’air », constate André du Bouchet dans un carnet de 1951 : « L’écran d’images se pressait contre le front. Il faut le repousser […]. Retrouver l’air qui nous sépare et dont on vit29. » Cet air capable de percer l’écran des images lié à l’héritage poétique surréaliste, André du Bouchet le trouve alors dans la peinture de Pierre Tal Coat, jusqu’à s’exclamer : « C’est par les yeux que je gagne l’espace que je respire30. »
Aération de la page, profération du poème (lectures 1959-1976)
16Dans les années suivantes, André du Bouchet va s’efforcer lui aussi, en particulier par son travail sur les blancs typographiques à partir de 1961, de trouver par l’œil une issue vers un espace respirable. La question du souffle prendra alors une dimension nouvelle, lorsqu’il s’agira de convertir cet espace visuel de la page en expérience sonore, à travers l’acte de lecture. Mais l’élaboration de la page n’était elle-même que la traduction d’un rapport au monde se nouant dans un tumulte intérieur de voix et de silence. En effet, le poème n’est pas purement du domaine du spatial et du scriptural. Le blanc n’intervient en poésie que lorsqu’il s’agit de transcrire une parole sur le papier. Avant d’en venir au stade de l’écrit, cette parole n’est qu’articulation et phonation alimentées par le flux du souffle. Si le blanc ne vaut en peinture que comme vide médian31, alors le blanc du poète écrivant, c’est l’air, qui doit permettre l’ouverture de sa parole comme lieu d’échange vasculaire entre le sujet et le dehors. L’air n’est donc pas la métaphore du blanc pour André du Bouchet, blanc et air sont en rapport d’équivalence, lors de cette opération incessante de commutation par laquelle le réel poétiquement advient. Quel effet sur leur mise en voix provoque dès lors l’irruption du blanc dans les poèmes d’André du Bouchet à partir de la publication de Dans la chaleur vacante en 1961 ? Une telle irruption du souffle, brusquement rendu après l’asphyxie, est-elle audible lorsqu’André du Bouchet en vient à lire ces textes ?
17Il est d’abord nécessaire de revenir sur le travail d’écriture qui a permis de passer des deux premiers recueils, jamais republiés – Air (1951) et Sans couvercle (1953) – à ce troisième recueil, Dans la chaleur vacante, publié au Mercure de France en 1961, celui où Du Bouchet « devient véritablement du Bouchet32 », où il acquiert ce style du poème « en constellation » que Francis Ponge qualifiera d’inimitable33.
18Michel Collot, dans une étude sur les carnets d’André du Bouchet reprise dans son récent livre André du Bouchet, une écriture en marche34, a montré que dans les années qui précèdent la publication de Dans la chaleur vacante, le poète prélève dans ceux-ci des notations qu’il cherche à extraire de leur contexte d’origine ou de toute référence à des « circonstances trop précises ». Il les assemble alors en une « unité nouvelle, plus resserrée et plus cohérente35 ». Au départ, les notations sont dispersées, puis « les énoncés les plus fragmentaires sont réunis au sein de phrases plus complètes, au besoin en ajoutant des liaisons syntaxiques ». Cette étape passe par le dactylogramme corrigé à la main. Les poèmes publiés dans Sur le pas36 (1959) donnent à voir cette disposition caractéristique de la prose.
19Dans le texte publié chez Maeght, les failles ne sont pas marquées par des blancs typographiques mais par un usage abondant des tirets, utilisés de manière asymétrique – ouverts mais non refermés. Ceux-ci préfigurent une volonté d’espacement dans un texte qui pourtant fait encore bloc. Retravaillant ces poèmes pour le recueil Dans la chaleur vacante (1961), Du Bouchet introduit des blancs typographiques et des décrochements. Pour Michel Collot, les blancs sont des « indications précieuses pour scander la diction et la respiration37 ». Ils induisent une « physique de la parole, qui n’a rien d’abstrait ni de désincarné38 ». Du Bouchet s’inscrirait donc doublement dans l’héritage du Coup de Dés mallarméen, le travail visuel de mise en page étant inséparable de l’horizon d’une mise en voix, le poème dans l’espace se révélant « partition39 ». Qu’en est-il lors de la lecture par le poète de ses poèmes ? Comment l’obsession de l’air et de la respiration présente dès le premier recueil d’André du Bouchet et liée en particulier a son rapport avec la poésie de Reverdy, a-t-elle pu se trouver incorporée à l’espace même du poème, au point d’induire une « physiologie de la parole » ?
20Le 18 mars 1959, André du Bouchet enregistre les poèmes publiés la même année dans Sur le pas, lecture conservée dans les archives de l’INA40. Nous prendrons l’exemple du poème « Extinction ». Ce qui frappe à l’écoute de cette lecture, ce sont les accents très peu marqués et la rapidité du débit. La diction est peu accentuée, les « e » caducs devant consonne sont élidés. Ce qui correspondra, dans l’édition du Mercure de France (1961) de Dans la chaleur vacante, à des blancs typographiques ne donne lieu dans la lecture de 1959 qu’à un silence de moins d’une seconde, qui affecte très peu la lecture. C’est que dans la version de 1959 les blancs ne sont encore que des tirets, comme le montre l’édition de Sur le pas chez Maeght :
Le nœud du souffle qui rejoint, – plus
haut, l’air lié, et perdu
21Dans l’état du texte illustré par Tal Coat, il y a un effet de bloc que la lecture de 1959 restitue par cette pause très brève au point de suture des notes des carnets. Ce qui peut-être laisse pressentir les blancs typographiques introduits en 1961, c’est l’inflexion descendante de la voix du poète qui sera marquée visuellement dans l’espace de la page par le décrochage de « et perdu » :
Le nœud du souffle qui rejoint,
plus haut, l’air lié,
et perdu41
22En 1976, André du Bouchet lit une nouvelle fois « Extinction » pour l’émission Poésie ininterrompue (no 76), diffusée le 8 novembre 1976. Ce qui change d’une lecture à l’autre, à dix-sept années d’intervalle, c’est bien sûr la voix d’André du Bouchet qui a gagné en graves, mais surtout l’énergie mise dans une lecture tout en intensité. L’impression générale est de passer d’un texte intériorisé à son extériorisation. Le débit est un peu plus lent mais l’apparition des blancs typographiques ne se traduit pas directement par des temps de silence, indice qu’ils sont des articulations variables et non traduisibles objectivement en quantité de silence. La continuité de la phrase entre « qui rejoint » et « plus haut » n’est pas rompue, elle reste lue comme une unité. Ce qui change beaucoup, c’est l’articulation et la phonation. Les consonnes, comme le [n] initial de « nœud » deviennent de véritables points d’appui, la voix insiste sur le [n] qui sert de tremplin pour faire entendre le son vocalique [ø] fortement. Le plus impressionnant est la façon du poète de rentrer dans le [ʁ] initial de « rejoint ». Contrairement à la lecture de 1959 où la descente était progressive, ici il y a une intonation ascendante jusqu’à « lié » (acmé) puis un effet de chute sur « et perdu », et c’est peut-être là où réside dans la lecture la traduction de la spatialité du poème. Alors que le « i » de « lié » était quasiment une semi-consonne dans la lecture de 1959 – [lje] – les 3 syllabes de « l’air / li/é » sont ici nettement détachées, avec lenteur, en faisant entendre chaque son.
23Ce que nous apprennent ces lectures, c’est que placer un mot dans l’espace de la page apparaît pour André du Bouchet comme une expérience strictement équivalente à celle de le placer par l’intermédiaire de la voix et du souffle dans l’espace sonore. Pour André du Bouchet, la poésie est une manière de se situer dans un monde caractérisé par son instabilité, où les rapports entre le sujet, la parole et le dehors sont en reconfiguration constante. Sensible par sa proximité avec les peintres aux accidents de la lumière, il est enclin à apprécier dans la lecture à haute voix le fait qu’elle arrache le poème à la fixité de l’écrit et permet de remettre en jeu ses rapports avec un monde en déplacement.
Le souffle et le sens
24En 1976, André du Bouchet retravaille les textes de son premier recueil Air pour en publier une nouvelle version aux éditions Clivages42 (le volume paraît en 1977). Cette publication est l’occasion d’un entretien avec Pascal Quignard43 dans lequel le poète s’exprime sur son rapport à ce premier recueil, sur son obsession du mot « air » et sur la place du souffle dans son œuvre. Les poèmes de 1951 lui paraissent en 1976 « indéfendables44 » et André du Bouchet explique que le titre seul du recueil lui paraît survivre. Ce « seul mot à sauver de ce premier ensemble » devient le titre d’un second ensemble chez Maeght en 1971 avec des gravures d’Antoni Tapiès. Les poèmes en sont totalement différents. En mentionnant en 1976 la date d’écriture initiale de ces poèmes (1950-1953), André du Bouchet précise qu’il ne pourrait « pas les écrire aujourd’hui » car ses « rapports avec la langue, [ses] rapports avec ce mot se sont déplacés ». L’air bouscule l’œuvre et l’emporte, le lien tissé par le titre du recueil entre 1951 et 1976 indique la permanence de l’activité poétique, la tension vers un insaisissable que les mots ne parviennent à accrocher que momentanément, l’existence étant définie par André du Bouchet comme ce « souffle sur lequel les signes jamais ne conservent prise45 ».
25« Air » est un mot banal, courant, qu’André du Bouchet avoue employer souvent, « jusqu’à l’obsession » mais qui « n’a jamais deux fois la même valeur », il est « incarné d’instant en instant » à mesure que les rapports du poète avec le langage se modifient au sein d’un monde lui-même en état de flux, ce qui explique aussi l’évolution du poète dans la façon de lire ses textes. Pour André du Bouchet, « ’jour’ est comme ‘air’ un mot susceptible de significations incalculables […] chacun y met ce que chacun vit, donc le sens est disponible à l’infini […] ». « Air » et « jour », dans leur évanescence monosyllabique, sont des « mots communs au point d’en apparaître vides mais dès l’instant où nous les assumons, où nous les prononçons, ça devient quelque chose d’original, d’originel, de singulier, d’irréductible même à l’expression ».
26Le dialogue avec Pascal Quignard est extrêmement intéressant car il oppose deux conceptions du livre : André du Bouchet remet en question la capacité du livre à défier le temps, à le traverser pour insister sur son essentielle précarité et refuser de l’extraire d’un monde avant tout perçu dans sa mouvance. Pour lui, l’écrit « s’évanouit dans la durée », alors que ce qui n’est pas inscrit « s’évanouit sans durer ». Sans cesse balloté par le réel, tout livre véritable semble à André du Bouchet création d’un appel d’air qui engage à le prononcer. Cette suscitation du désir de lecture est le signe par lequel le livre affirme sa « vitalité ». Un tel rapport établi entre l’écriture et le réel envisagé dans sa matérialité physique suscite l’indignation de Pascal Quignard et une forme de dégoût, comme s’il s’agissait là d’une prostitution de la littérature, d’une déchéance de la parole poétique consentant à sombrer dans l’universel reportage46 :
Il y a un an et demi, lorsque vous avez déjà fait cette émission, vous avez lu des textes, lorsque j’ai appris que vous alliez lire, non pas quand je vous ai entendu lire, j’ai été tout à fait stupéfait, consterné à l’idée que vous alliez lire, laissant croire ainsi que la voix pouvait traduire l’écrit, que vous alliez faire parler ce qui précisément effondrait tout langage, tout discours tenu, tout ce qui se rapporte au monde et à la circulation des objets marchands ayant sens du monde.
27Lorsqu’André du Bouchet évoque la voix comme « gouvernant l’écrit », pour Pascal Quignard, « ce n’est pas tout à fait vrai », il perçoit cette valorisation du souffle comme une façon d’insinuer qu’il y aurait une « carence de la voix » dans un poème privé du souffle réel de l’auteur lisant, un défaut de l’écrit qu’il se refuse à envisager. Pascal Quignard ne peut croire que la parole du livre puisse être considérée comme une « parole engourdie » qui serait « à réveiller » par le moyen du souffle : « […] il n’y a pas de voix qui prononce un poème jamais, c’est pour cela qu’il est écrit, si vous vouliez mettre en acte, vous ne l’écririez pas, en cela le souffle est lui-même une fiction […] si les mots se rejoignaient jusqu’au souffle organique qui les porte, ce ne seraient plus des mots ». L’idée d’« aérer » la page, d’envisager le blanc comme l’air du poème ne peut alors être que métaphorique pour lui. « Ni plus ni moins [métaphorique] que le mot jour, qui tantôt éclaire, tantôt aveugle », répond Du Bouchet.
28Si l’air n’est pas une métaphore, c’est que pour André du Bouchet, la parole est dans une relation avec le monde qui ne peut être figée, et dont l’écrit n’est qu’une des modalités. Il préfère ainsi au terme « mot » celui de « vocable » dans son texte « Peinture47 » car « ne compte pas à [s]es yeux un livre qui ne renverrait pas à autre chose qu’un livre ». Le terme de vocable est choisi car il « renvoie à la bouche » et à « tout ce avec quoi on communique par la bouche et par l’air qu’on respire », à « la voix que l’on émet » : « le livre n’est qu’un moment de passage nécessaire ». La lecture permet de trouer le « monde mental » de l’écrit, nulle part André du Bouchet n’a précisé cette idée plus clairement que dans un texte intitulé L’Écrit à haute voix, publié en partie dans le livre de Pierre Chappuis48. Le poète y avance la notion de péremption de la langue, une langue dont la lecture à voix haute permettrait d’envisager « l’altération », la « déperdition » car « c’est dans la bouche qu’elle s’altère le plus vite, selon l’accent, l’intonation, qui est affaire de souffle aussi, de sens et de souffle, parfois même on se dit que le souffle ou l’essoufflement l’emporte sur le sens ».
29Le pneuma vibrant de cette poésie n’est donc pas l’indice d’un primat du spirituel, l’air du livre rayonne littéralement et dans tous les sens, il n’est pas séparé de l’air que nous respirons et ne se laisse pas restreindre à un dire métaphorique. Si métaphore il y a, elle est à prendre au sens étymologique, car l’enjeu de la circulation du verbe poétique – entre l’oral et l’écrit – est bien affaire de transport. L’écart est en renouvellement constant. Il ne s’agit pas de délaisser l’oral pour l’écrit ni l’écrit pour l’oral mais jouant de la tension non résolue entre le lisible et le prononçable, de maintenir l’espace littéraire dans un état de turbulence au sein duquel l’air afflue, un espace respirable. Rendre les mots à l’air, consentir à s’en déposséder, c’est considérer la poésie comme un moyen, l’instrument d’une saisie du réel qu’elle n’a pas vocation à obturer sous le « couvercle49 » du langage.
30Plongé à corps perdu dans l’asphyxie de son époque, André du Bouchet aura donc demandé à la poésie d’être un espace de respiration sans faire de cet espace un rempart rassurant contre le réel ni renouer avec la pensée dualiste qui sous-tend les théories de l’inspiration. Ayant réalisé à l’approche des artistes modernes que la figure a moins d’importance que le fond d’où elle surgit et que c’est ce fond qui dans l’œuvre doit être maintenu vivant, il laisse affluer dans sa page cette blancheur « sur laquelle les signes jamais ne conservent prise50 », indice d’une parole qui ne voile pas le réel mais le laisse transparaître. Ayant donné de l’air à sa page, il comprend que ce geste serait incomplet s’il ne consentait à prêter à cette page son propre souffle pour contrarier la tendance de l’écrit au figement et conjurer la menace d’un retour d’asphyxie. Brouillant les pistes en désaccordant pratique d’écriture et pratique de lecture pour s’engouffrer dans l’aspiration de leur contradiction, il s’est arraché à l’embâcle des significations figées.
1 Paul Celan, Atemwende, Berlin, Suhrkamp, 1967.
2 André du Bouchet, « Tübingen, le 22 mai 1986 », dans Désaccordée comme par de la neige, Paris, Mercure de France, 1989, p. 75.
3 Ossip Mandelstam, Physiologie de la lecture, trad. André du Bouchet, Paris, Fourbis, 1989.
4 André du Bouchet, Aveuglante ou banale. Essais sur la poésie, 1949-1959, édition établie par Clément Layet et François Tison, préface de Clément Layet, Paris, Le Bruit du temps, 2011.
5 André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, édition établie et préfacée par Clément Layet, Paris, Le Bruit du temps, 2011.
6 Ibid., p. 64.
7 Ibid., p. 95.
8 Ibid., p. 140.
9 Ibid.
10 André du Bouchet, Aveuglante ou banale, op. cit., p. 64.
11 Pierre Reverdy, En vrac, dans Œuvres complètes, t. II, Paris, Flammarion, 2010, p. 940-941.
12 Texte republié par Clément Layet, voir Aveuglante ou banale, op. cit., p. 29-34.
13 Ibid., p. 29.
14 Ibid., p. 31.
15 Sur le dialogue entre Du Bouchet et Reverdy, voir Serge Linarès, Poésie en partage. Sur Pierre Reverdy et André du Bouchet, Paris, Éditions de l’Herne, coll. « Essais », 2018.
16 André du Bouchet, Air, Paris, Jean Aubier, 1951, p. 10.
17 Ibid., p. 60.
18 Ibid., p. 81.
19 Ibid.
20 Ibid., p. 77.
21 Ibid., p. 100.
22 Ibid., p. 21.
23 Ibid., p. 59.
24 Ibid., p. 78.
25 André du Bouchet, Le Moteur blanc, Paris, GLM, 1956. Une eau-forte originale d’Alberto Giacometti en frontispice.
26 André du Bouchet, « Le moteur blanc », dans Dans la chaleur vacante suivi de Ou le soleil, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1991, p. 59.
27 André du Bouchet, Aveuglante ou banale, op. cit., p. 131.
28 Expression qui figure dans Air, op. cit., p. 61.
29 André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, op. cit., p. 105.
30 Ibid., p. 108.
31 Voir, à propos de Pierre Tal Coat, « Écart non déchirement » (1954), dans La Peinture n’a jamais existé, Écrits sur l’art 1949-1999, éd. Thomas Augais, Paris, Le Bruit du temps, 2017, p. 75.
32 Pour parodier une expression qu’André du Bouchet lui-même emploie pour décrire le moment où Tal Coat découvre qu’il faut peindre à partir du blanc. Voir la conférence prononcée par André du Bouchet à l’occasion de l’exposition Tal Coat devant l’image, Kunstmuseum, Winterthur, février-mai 1998 (La Peinture n’a jamais existé, op. cit., p. 429).
33 Francis Ponge, « Pour André du Bouchet (Quelques notes) », L’Ire des vents, nos 6-8, 1983, 6 feuillets reproduits en fac-similé avec la pagination manuscrite de Ponge. Repris dans Œuvres complètes, t. II, dir. B. Beugnot, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 1319-1322 (citation p. 1320).
34 Michel Collot, André du Bouchet, une écriture en marche, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2021.
35 Ibid., p. 58.
36 André du Bouchet, Sur le pas, Paris, Maeght, 1959, avec 15 aquatintes de Pierre Tal Coat (200 exemplaires).
37 Michel Collot, André du Bouchet, une écriture en marche, op. cit., p. 17.
38 Ibid.
39 Voir Stéphane Mallarmé, « Observation relative au poème Un coup de dé jamais n’abolira le hasard », dans Œuvres complètes, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, 1998, p. 392.
40 Lecture enregistrée le 18 mars 1959. « Images et poèmes ». Durée : 00.04.06. Sur le pas. – 1. « Par la voie rêche » [0’35] 0.01.000 – 0.36.000. | 2. « Le nouvel amour » [0’39]. 0.38.000 – 1.17.000. | 3. « Extinction » [0’34]. 1.19.000 – 1.53.000. | 4. « Loin du souffle » [0’37] 1.56.000 – 2.33.000. | 5. « Nivellement » [0’33]. 2.36.000 – 3.09.000. | 6. « Cession » [0’54]. 3.11.000 – 4.05.000. Collection : RDF / RTF / Autres (1949-1963). Numéro de notice INA : PHL11011124.
41 André du Bouchet, « Extinction », dans Dans la chaleur vacante suivi de Ou le soleil, op. cit., p. 103.
42 André du Bouchet, Air (1950-1953), Paris, Clivages, 1977.
43 Poésie ininterrompue, no 76, « André du Bouchet ». Entretien avec Pascal Quignard. Émission diffusée le 8 novembre 1976. Voir https://obvil.huma-num.fr/asp/files/original/11064/BOUCHET_quignard_8novembre1976_Poesieininterrompue76.pdf, page consultée le 18 juillet 2022.
44 Les citations suivantes, sauf mention contraire, ont été transcrites par moi à partir de l’entretien d’André du Bouchet avec Pascal Quignard (voir note précédente).
45 André du Bouchet, Qui n’est pas tourné vers nous, Paris, Mercure de France, 1972, p. 37.
46 Sur le refus de la pensée mallarméenne du Livre comme terme du monde, voir Thomas Augais, « André du Bouchet et Mallarmé : antimatière de l’interlocuteur », dans Contre Mallarmé. Contre-attaque, contrepoint, contretemps, dir. Thierry Roger, Revue des Sciences Humaines, 340, 4 / 2020, Villeneuve d’Ascq, PU du Septentrion, 2021, p. 19-48.
47 Publié dans L’Incohérence, Hachette, 1979, [s. n. p.].
48 Pierre Chappuis, André du Bouchet, Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », no 239, 1979.
49 Ce mot baudelairien titre le deuxième recueil d’André du Bouchet : Sans couvercle, Paris, GLM, 1953.
50 André du Bouchet, Qui n’est pas tourné vers nous, op. cit., p. 37.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 1, 2024
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1572.
Quelques mots à propos de : Thomas Augais
Sorbonne Université
CELLF 19-21 – UMR 8599
