Sommaire
L’Air des livres. Respirations, inspirations
Les Carnets du vivant, n° 1
Volume publié sous la direction de Thierry Roger
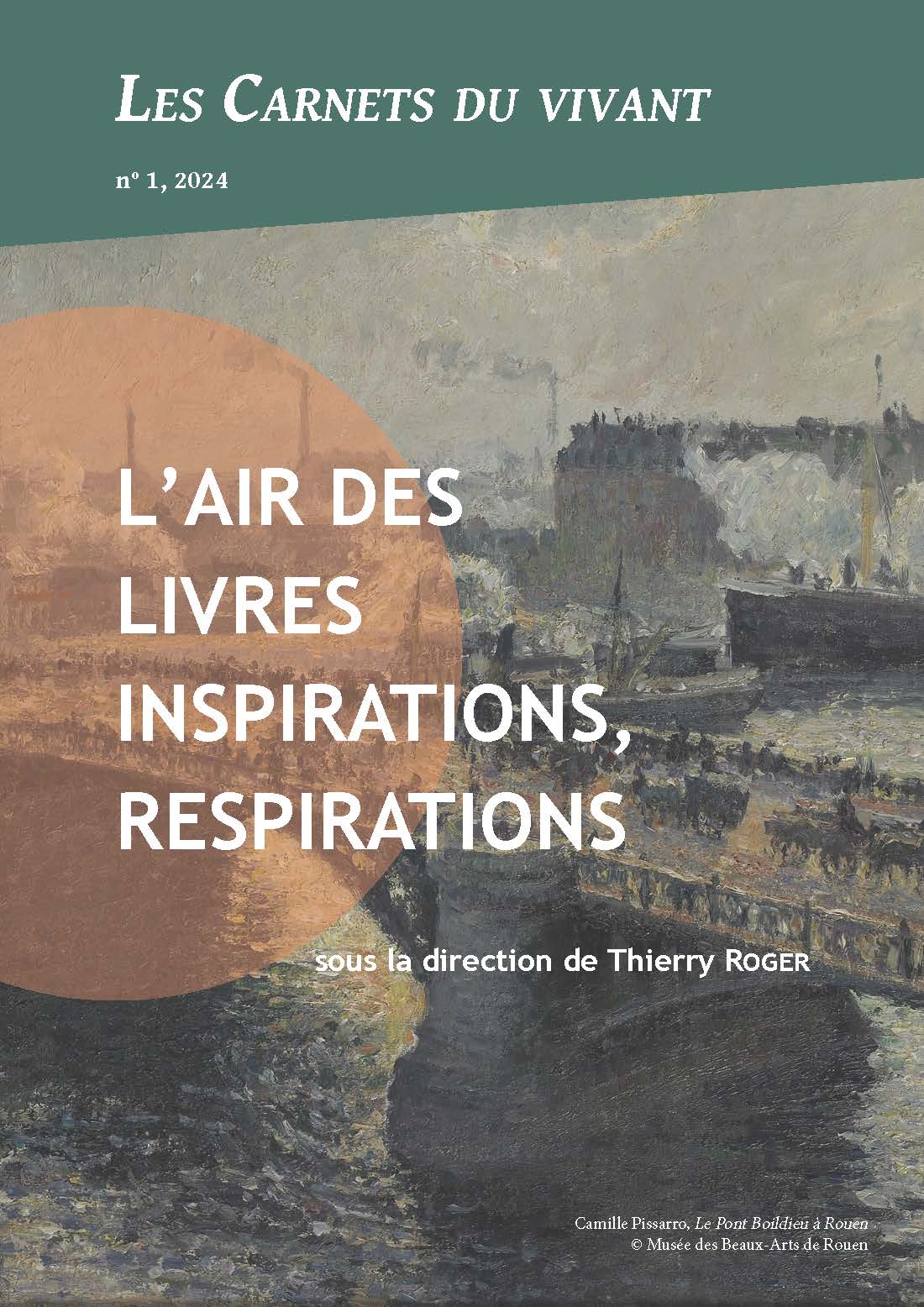
- Politiques de l'air
- François Vanoosthuyse L’asphyxie des ouvriers.
L’enjeu de la respiration dans les enquêtes d’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels sur le prolétariat anglais - Valérie Stiénon Un air de fin du monde : les asphyxiés du futur. Anticipation sociale et poétique de la raréfaction
- Bertrand Guest Poly-caco-phonies pour catastrophes inodores. De Tchernobyl à Somaland
- Patrick Suter Crise et poétique de l’air à la lumière de l’exigence situationniste
- Pneumatologiques
- Thomas Augais Air et voix dans la poésie d’André du Bouchet
- Lydie Cavelier Pierre Chappuis et l’espace du poème : créer un appel d’air
- Christèle Couleau Colonnes d’air et vents contraires – les « éolivres » d’Alain Damasio
Politiques de l'air
L’asphyxie des ouvriers.
L’enjeu de la respiration dans les enquêtes d’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels sur le prolétariat anglais
François Vanoosthuyse
1Des travaux récents ont démontré qu’il est possible d’écrire une histoire de la pollution des villes, des banlieues et des campagnes au xixe siècle, à partir d’une documentation variée et concordante1. Le phénomène, qui est principalement lié à l’extraction minière et à l’essor de la chimie, a pris une certaine ampleur en France dès la fin de l’Ancien Régime.
2Cette historiographie consiste à faire précisément état d’une part de la réalité des pollutions industrielles, d’autre part des logiques économiques, des politiques et des montages juridiques qui ont permis de contourner les anciennes règles de police et de justice relatives à l’enjeu de la pollution de l’air et des eaux. Parmi les leviers facilitant l’implantation d’usines polluantes en zone urbaine ou rurale dans la France du premier xixe siècle, François Jarrige et Thomas Le Roux signalent notamment le fait que les Conseils de salubrité, chargés d’évaluer les risques des nouvelles installations industrielles, aient été composés de chimistes qui étaient en même temps des industriels (par exemple Chaptal2), et de médecins hygiénistes acquis à la cause du progrès industriel3. Ils indiquent également le bénéfice tiré par les entrepreneurs de la notion de norme de sécurité, qui est définie par l’administration en tenant compte d’enjeux relatifs à la concurrence économique et au marché4. Le discours des hygiénistes, prompts à pointer les inconséquences et les vices des ouvriers, complète opportunément la propagande des industriels eux-mêmes, qui certifie que leurs usines sont propres, bien pensées et bien gérées. L’imagerie du travail en usine confirme volontiers cette idée fausse5. L’un des lieux communs du discours industrialiste est que le principal danger que courent les prolétaires est d’être victimes de leurs propres négligences, de leur indiscipline et du vice de la boisson. Par exemple, on oppose aux ouvriers d’une usine de céruse que c’est parce qu’ils ne respectent pas les consignes de sécurité qu’ils s’exposent aux vapeurs toxiques6. Un argument scientifique (au sens où il est formulé par des chimistes) permet de retourner les constats relatifs à la pollution qui peuvent être faits empiriquement par les enquêteurs sociaux : c’est l’argument de la propriété antiseptique des acides, du chlore par exemple et de la soude, qui sont justement conçus pour nettoyer, pour désodoriser, pour éliminer les miasmes et la pestilence des déchets organiques (charognes, excréments, ordures). Les fumées qui s’échappent des usines chimiques, qui noircissent les maisons des ouvriers et même y pénètrent sous la forme de poussières, sont en réalité bénéfiques, de même que, si les acides des tanneries et des teintureries déversés dans les rivières tuent les poissons et rendent la pêche, la baignade ou la lessive impossibles, ils ont aussi la vertu d’éliminer les effets délétères des excreta qui y sont déversés par les vidangeurs7.
3Dans la France de l’Empire, de la Restauration et de la monarchie de Juillet, les raisons pour lesquelles l’autorité judiciaire est susceptible d’ordonner la fermeture ou le déplacement d’un établissement industriel sont de deux types : soit la dangerosité de l’usine pour les riverains, à condition qu’ils puissent financer une action en justice, soit le préjudice financier pour les propriétaires des terrains alentours. La motivation des décisions ne concerne pas ou rarement la santé des ouvriers8, et de façon générale les dangers relatifs à la pollution ne sont pas mis en avant par l’État, bien au contraire. Ainsi, on peut dire qu’à cette époque (qui n’est pas tout à fait révolue) ceux qui disposent d’un savoir suffisant pour envisager les risques sanitaires liés aux gaz, aux fumées, aux poussières, aux déchets industriels, les nient, tandis que ceux qui y sont principalement exposés, faute de savoir, de légitimité sociale, de ressources et de force, n’ont guère la possibilité de les dénoncer9.
4C’est dans ce contexte qu’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels rédigent leurs enquêtes sur les conditions de vie et les conditions de travail des classes ouvrières10, en choisissant le terrain anglais, où l’industrialisation est plus avancée, où la population ouvrière est plus ancienne et plus nombreuse, et qui est perçu pour ces raisons comme la matrice de la transformation de toute l’Europe et en particulier de la France et de l’Allemagne11.
5La manière dont la population ouvrière elle-même perçoit la pollution au début du xixe siècle, en particulier la pollution de l’air, est un aspect délicat de cette histoire. Les témoignages individuels sont visiblement très rares, et dans leur majorité les protestations ouvrières concernent d’autres sujets que la pollution. Cependant, certains dossiers sont ouverts et témoignent du fait que les ouvriers sont conscients des dangers qu’ils courent. Au début des années 1840, le journal L’Atelier lance plusieurs appels à témoignages et publie les réponses12. En 1845, ce même journal qualifie l’usine de céruse de Clichy d’« abattoir humain13 » ; en 1846, il publie une pétition de deux cents ouvriers qui revendiquent le droit de respirer deux heures de bon air par jour14. En 1855, des émeutes éclatent en Belgique dans la région de la Basse-Sambre, parce qu’une usine de soude anéantit la principale ressource alimentaire de ses propres ouvriers, à savoir la récolte de pommes de terre dans les champs alentour. L’émeute est réprimée par l’armée qui fait feu et tue deux hommes15.
6De façon générale, la part des préoccupations écologiques dans le discours des réformistes sociaux et des socialistes des années 1840 est difficile à évaluer et fait aujourd’hui débat. Certains historiens considèrent que, dans la première moitié du xixe siècle, la pollution industrielle, dans son rapport avec l’enjeu de la santé publique, et plus précisément avec la santé des ouvriers, est un sujet encore mal cerné et jugé secondaire par la plupart des penseurs et des militants socialistes16. Il semble indiscutable que les années 1840 appartiennent encore à l’âge des commencements en ce qui concerne les combats écologiques et les luttes sociales à connotation écologique17. Nous verrons en particulier que la pollution, considérée en elle-même, n’est pas un enjeu central des enquêtes de Buret, Tristan et Engels. Mais cela ne signifie pas qu’ils l’ignorent. Serge Audier, qui s’attache à réévaluer la part de l’écologie dans l’histoire idéologique de la gauche, l’a bien montré à propos de Flora Tristan, dont il ne commente cependant qu’un chapitre18. L’enjeu de ce travail est de saisir quelle importance Buret, Tristan et Engels confèrent à l’enjeu de la pollution et de montrer comment ils en parlent.
L’enjeu de l’air et de la respiration dans les enquêtes de Buret, Tristan et Engels
7Disons-le d’entrée de jeu, les préoccupations majeures de nos trois auteurs ne sont pas relatives à la destruction de l’environnement, ni à la modification par l’industrie de la composition de l’air que les hommes respirent. Soit ils ne disposent pas des savoirs nécessaires dans le domaine de la chimie (à une époque où, comme on l’a vu, il y a débat sur la nocivité des déchets industriels), soit ils jugent que cet aspect de la réalité, s’ils l’approfondissaient, les éloignerait de leur sujet central – soit ces deux raisons jouent ensemble : c’est l’hypothèse qu’on retiendra. Ils se concentrent sur les aspects matériels les plus tangibles de la condition prolétarienne : la durée de la journée de travail, la confusion de la nuit et du jour par le travail de nuit obligatoire, le phénomène massif du travail des enfants, le niveau extraordinairement bas des salaires, le délabrement et le sous-équipement de l’habitat ouvrier, l’absence de cadre juridique contraignant pour les employeurs, les abus et cruautés des surveillants, y compris sur les enfants, la punition des ouvriers par l’amende, le chômage structurellement lié au machinisme, en bref les grands enjeux de droit, à une époque où il n’existe précisément pas de droit du travail ni plus généralement de droit social.
8Engels, dans la description qu’il donne des maladies et plus généralement des maux physiques dont souffrent les ouvriers d’usine, met en exergue des pathologies qu’il juge absolument caractéristiques de leur condition : en particulier celles qui affectent l’ossature et les muscles. Les déformations des squelettes et les atrophies musculaires constituent à ses yeux un phénomène très frappant, et en se fondant sur ses lectures médicales19, il invoque le caractère répétitif, excessivement fréquent et contre-nature de l’effort musculaire en usine, l’obligation de rester debout durant quinze, seize, dix-huit heures par jour. Dans le même esprit, il évoque les accidents qui provoquent amputations et handicaps20. Les maladies pulmonaires n’ont pas exactement le même statut, même si l’auteur constate qu’elles affectent massivement les ouvriers, sans doute parce qu’on est susceptible de les rencontrer dans toutes les classes et qu’elles sont depuis longtemps recensées par les médecins, tandis que la déformation rapide des corps de centaines de milliers d’individus jeunes est un phénomène nouveau et spécifique.
9En outre, on peut supposer qu’Engels – comme Buret et Tristan – fait le raisonnement suivant : si l’exposition à des substances toxiques fait partie des risques que les ouvriers courent nécessairement, parce que l’activité industrielle le commande, ce n’est donc pas sur ce point précis que doit porter prioritairement la dénonciation. Le combat doit concerner d’abord ce qui peut être changé, qui relève de la responsabilité des employeurs et de l’État : en particulier les graves nuisances occasionnées par le délabrement, l’exiguïté et le sous-équipement de l’habitat ouvrier. Mais c’est précisément en s’intéressant à ce sujet qu’Engels rencontre l’enjeu de la pollution, exactement comme Buret et Tristan avant lui.
10Car, même si la conservation de l’environnement ni la préservation de la santé humaine en général ne sont leurs sujets, les trois auteurs réunissent suffisamment d’indices pour que leurs textes puissent être interprétés de façon pertinente dans la perspective d’une histoire de la pollution industrielle du Royaume-Uni. Ils décrivent l’énormité des rejets, dans l’air et dans les cours d’eau ; ils remarquent la pénétration de la suie dans l’habitat, la présence des gaz, des filaments, des particules dans l’air que respirent les ouvriers d’usine et les chambrelans. Flora Tristan donne par exemple dans une description mémorable, au chapitre II des Promenades dans Londres intitulé « Du climat de Londres », l’image d’un phénomène mortifère au caractère infernal :
À cette énorme masse de fumée surchargée de suie, qu’exhalent les milliers de cheminées de la ville monstre, se réunit un brouillard épais, et le nuage noir dont Londres est enveloppé ne laisse pénétrer qu’un jour terne et répand sur les objets comme un voile funèbre21.
11Le point de vue de nos auteurs (et d’autres22) sur le développement industriel extraordinaire de l’Angleterre s’en trouve affecté. Le jeune Engels par exemple ne regarde jamais les cheminées d’usine avec une satisfaction d’esthète ni avec une confiance émue dans le progrès humain23. Mais il coordonne systématiquement le constat de « la contamination du monde » et la mise en relief de l’ordre qui structure ce même monde. Sa description de Manchester comporte par exemple cette remarque que la pollution est perçue comme une gêne voire comme une menace par les classes aisées, et qu’elles dessinent leur territoire en fonction de l’orientation des fumées :
Cette partie est et nord-est de Manchester est la seule où la bourgeoisie ne soit pas installée, pour la bonne raison que le vent dominant qui souffle dix ou onze mois de l’année de l’ouest et du sud-ouest apporte de ce côté-là la fumée de toutes les usines – et ce n’est pas peu dire. Cette fumée-là, les ouvriers peuvent bien la respirer tout seuls24.
12Cette dernière phrase est exemplaire de la démarche et de la méthode d’Engels, même s’il n’est pas le seul à remarquer que la classe ouvrière est davantage exposée que les autres à la pollution. Il articule vigoureusement deux constats en signalant que l’énormité de la pollution aérienne motive la discrimination territoriale des classes, que l’injustice sociale systémique est lisible dans la topographie urbaine, et qu’elle comporte un volet sanitaire. Il propose une image complexe de la ville industrielle, qui rend compte en même temps des flux de matières polluantes et des logiques discriminatoires25.
13Dans La Société écologique et ses ennemis, Serge Audier accorde très peu d’attention au texte d’Engels, pour la raison (peu pertinente en l’occurrence) qu’il écrit plus spécifiquement une histoire de la gauche non-marxiste26. Il est certain que le propos d’Engels, contrairement à d’autres qui lui sont contemporains, n’a pas pour objet d’examiner et d’expliquer les conséquences de la pollution sur l’environnement. C’est une possibilité de son discours qu’il n’approfondit pas. Mais nous nous trouvons à cet égard dans une situation très ordinaire pour un commentateur de textes du xixe siècle, et il n’y a pas lieu de traiter ce texte différemment des autres : nous reconnaissons les phénomènes décrits par l’auteur, comme étant plus ou moins cohérents avec notre propre expérience du monde (et nous faisons le même constat à la lecture de Buret et de Tristan), mais nous percevons aussi le décalage entre la manière dont il parle de ces phénomènes et la façon dont les sciences de l’environnement, dont les résultats retiennent notre attention, conçoivent et mesurent aujourd’hui le risque écologique global27. Mais le fait que l’inégalité face au danger industriel soit du point de vue d’Engels un sujet aussi fondamental que l’existence du danger lui-même ne signifie pas qu’il le néglige. Et chacun sait qu’aujourd’hui comme au xixe siècle les logiques de discrimination territoriale existent, si même elles n’ont pas empiré, et qu’elles ont notamment pour raison d’être la pollution de l’air.
Les causes de l’asphyxie
14Approfondissons toutefois la différence entre le discours sur la pollution des réformistes sociaux et des socialistes des années 1840 et celui des sciences modernes de l’environnement. L’une des caractéristiques majeures des considérations de Buret, Tristan et Engels sur la pollution est qu’ils ne s’appuient pas sur la littérature des chimistes. La chimie est, dans le contexte où ils s’expriment, la science des dominants, la science appliquée et instrumentalisée par les industriels : ils n’y puisent pas leurs arguments ; ils ne contrent pas les industriels sur leur propre terrain. Ils se fondent sur leurs observations (donc sur du visible, ou plus généralement du sensible, mais pas nécessairement sur du mesurable), et sur la lecture des très nombreux rapports médicaux qui paraissent dès les premières décennies du xixe siècle au Royaume-Uni. Dans cette perspective le manque d’air, ou la nécessité de respirer un air vicié nuit et jour, est pour eux l’un des signes les plus indubitables de la grande misère, un signe immédiatement associé aux notions de souffrance et de dépérissement. Mais quand ils envisagent les causes des maladies respiratoires dont les ouvriers sont affectés, ils ne les hiérarchisent pas clairement. En particulier, ils n’accordent pas une plus grande importance à la nature des substances que les ouvriers respirent qu’à des données telles que les températures extrêmes et le taux d’humidité, la surpopulation des quartiers ouvriers et leur immonde saleté.
15Il est significatif à cet égard qu’ils envisagent davantage l’enjeu de l’air quand ils pénètrent dans les venelles des quartiers ouvriers et dans les habitations que quand ils visitent les usines. Ce n’est pas, encore une fois, qu’ils ignorent l’existence de substances toxiques. Mais en général et sauf exception, dans leurs descriptions d’usines, ils signalent davantage l’absence de ventilation que la présence de ces substances, et l’extrême chaleur, la moiteur, la pestilence, éventuellement la poussière, plus souvent que les gaz et les particules.
16Ainsi, dans sa mémorable description d’une usine à gaz, Flora Tristan se montre d’abord attentive à la chaleur infernale à laquelle les ouvriers sont exposés, et au danger que constitue le passage brutal du chaud au froid :
Nous entrâmes dans le grand chauffoir : les deux rangées de fourneaux placés de chaque côté étaient allumés [sic] ; cette fournaise ne rappelle pas mal les descriptions que l’imagination des poètes de l’Antiquité nous a laissées des forges de Vulcain, avec cette différence qu’une activité et une intelligence divines animaient les cyclopes, tandis que les noirs serviteurs des fournaises anglaises sont mornes, silencieux et anéantis. Il se trouvait là une vingtaine d’hommes remplissant leur tâche avec exactitude, mais lenteur. Ceux qui n’étaient pas occupés restaient immobiles, les yeux fixés à terre ; ils n’avaient pas même assez d’énergie pour essuyer la sueur qui leur coulait de toute part. Trois ou quatre me regardèrent avec des yeux dont la vue s’était enfuie ; les autres ne détournèrent pas la tête. Le foreman me dit qu’on choisissait les chauffeurs parmi les hommes les plus forts ; que néanmoins tous devenaient poitrinaires au bout de sept ou huit ans d’exercice et mouraient de phtisie. Cela m’expliqua la tristesse, l’apathie empreintes sur la figure et dans tous les mouvements de ces malheureux.
On exige d’eux un travail auquel les forces humaines ne peuvent résister. Ils sont nus, sauf un petit caleçon de toile ; quand ils sortent, ils jettent un paletot sur leurs épaules28.
17Dans le développement qui suit, la présence des gaz nocifs est mise sur le même plan que la douleur et la suffocation provoquées par la chaleur, la puanteur des exhalaisons organiques, le caractère malsain des eaux stagnantes :
Quoique l’espace qui sépare les deux rangées de fourneaux me parût avoir de cinquante à soixante pieds, le plancher était tellement chaud que la chaleur pénétra mes souliers immédiatement, au point de me faire lever les pieds comme si je les eusse posés sur des charbons ardents. On me fit monter sur une grosse pierre, et bien qu’isolée du sol, elle était chaude. Je ne pus rester dans cet enfer, ma poitrine s’emplissait, l’odeur du gaz me montait au cerveau, la chaleur me suffoquait […].
L’air qu’on respire dans cette usine est réellement empesté ! À chaque instant des miasmes méphitiques viennent vous saisir. Je sortis de dessous un hangar, espérant respirer dans la cour un air plus pur ; mais partout j’étais poursuivie par les exhalaisons infectes du gaz et les odeurs de houille, de goudron, etc.
Je dois dire aussi que le local est très sale. La cour, remplie d’eaux stagnantes, de monceaux d’ordures, témoigne de l’extrême négligence dans ce qui concerne la propreté. À la vérité, la nature des matières dont on extrait le gaz exigerait un service très actif pour entretenir la propreté ; deux hommes suffiraient à cette tâche, et, avec cette légère augmentation de dépense, on assainirait l’établissement29.
18Lorsqu’on envoie les ouvriers se reposer deux heures dans un hangar ouvert à tout vent, s’allonger sur la saleté d’un mauvais matelas « qu’on ne distingue point du charbon qui l’entoure », encore nus et suants sous un simple paletot lui-même « très sale, pénétré de sueur et de poussière de charbon à un tel point qu’on n’en [peut] deviner la couleur », Flora Tristan rapporte le mot que lui adresse le contremaître : « Voilà […] comment ces hommes deviennent poitrinaires. C’est en passant sans nulle précaution du chaud au froid30. » Ce propos, qui illustre le déni cynique du patronat et la posture culpabilisante qu’il adopte à l’égard de ses ouvriers, est perçu par Flora Tristan comme une criante injustice. Mais le fait est qu’elle a mis elle-même plus ou moins sur le même plan les deux éléments les plus saillants de la scène qu’elle décrit : la nocivité des gaz et le défaut d’hygiène. L’intervention qu’elle envisage pour améliorer la situation des ouvriers concerne spécifiquement l’hygiène, et non l’exposition au gaz. De son point de vue, si le gaz est de toute évidence l’une des causes de la mortalité précoce des ouvriers de cette usine, il est aussi l’une des propriétés mystérieuses de celle-ci, qui participe de ce qu’elle a de terrifiant et de fascinant, avec le feu et la matière en fusion, la suie qui recouvre les corps, la toiture qui s’ouvre pour laisser s’échapper la fumée :
Le chauffoir est au premier étage, au-dessous se trouve la cave destinée à recevoir le coke ; les chauffeurs, armés de longs fourgons en fer, ouvrirent les fours et en tirèrent le coke, qui, tout enflammé, tomba par torrents dans cette cave. Rien de plus terrible, de plus majestueux que ces bouches vomissant des flammes ! Rien de plus magique que cette cave soudainement éclairée par les charbons ardents qui se précipitaient, comme du bout d’un rocher les flots de la cataracte, et comme eux s’engouffrent dans l’abîme ! Rien de plus effrayant que la vue des chauffeurs qui ruissellent, de même que s’ils sortaient de l’eau, et sont éclairés devant et derrière par ces horribles brasiers dont les langues de feu paraissent s’avancer sur eux comme pour les dévorer. Oh ! non, il est impossible de voir un spectacle plus effrayant !
Quand les fours furent à moitié vides, des hommes montés sur des cuves placées au quatre coins de la cave jetèrent de l’eau pour éteindre le coke ; alors l’aspect du chauffoir changea : il s’éleva de la cave une trombe de fumée noire, épaisse et brûlante, qui monta majestueusement et sortit par la toiture qu’on avait ouverte exprès pour lui livrer passage. Je ne distinguai plus les bouches des fours qu’à travers ce nuage qui rendait les flammes plus rouges, les lames de feu plus effrayantes ; les corps des chauffeurs, de blancs qu’ils étaient, devinrent noirs, et ces infortunés, qu’on aurait pris pour des diables, se confondirent dans ce chaos infernal31.
19Les fumées et les gaz, quoi qu’il en soit de leurs propriétés étouffantes et irritantes32, de leur capacité à pénétrer dans l’organisme, conservent semble-t-il quelque chose du prestige de la science qui les a créés ; et leur pouvoir de nuisance, qui tient à des causes que seule la science peut expliquer, est en partie effacé par le spectacle prodigieux que constitue leur déchaînement. Le style imagé et expressif de Tristan dit à la fois la révolte et la fascination.
20Dans sa description d’une filature, Engels met plus rigoureusement en rapport l’inhalation de matières toxiques et la mauvaise santé des ouvriers. Il se fonde pour cela sur ses lectures médicales :
Il y a en outre quelques branches du travail industriel dont les effets sont particulièrement néfastes. Dans de nombreux ateliers de filature du coton et du lin flottent des poussières de fibres, en suspension dans l’air, qui provoquent, notamment dans les ateliers à carder et à sérancer, des affections pulmonaires. Certaines constitutions peuvent les supporter, d’autres non. Mais l’ouvrier n’a pas le choix ; il doit bien accepter l’atelier où il y a du travail pour lui, peu importe que ses poumons soient bons ou mauvais. Les conséquences les plus habituelles de l’inspiration de cette poussière sont des crachements de sang, une respiration pénible et sifflante, des douleurs dans la poitrine, de la toux, de l’insomnie, bref, tous les symptômes de l’asthme, qui dans les cas extrêmes dégénère en phtisie […]33.
21Mais Engels, on l’a vu, ne consacre pas de chapitre spécifique à cet enjeu ; et, comme Flora Tristan, procédant par addition, il réunit dans un même constat toutes les causes des maladies pulmonaires dont souffrent les ouvriers. Après avoir évoqué les poussières de fibres, il passe immédiatement au sujet de l’humidité malsaine des filatures :
Le filage humide du fil de lin, pratiqué par des jeunes filles et des enfants, est particulièrement malsain. L’eau jaillissant des broches les éclabousse, si bien que le devant de leurs vêtements est constamment trempé jusqu’à la peau et qu’il y a toujours des flaques d’eau sur le sol. Même chose dans les ateliers à doubler des fabriques de coton, mais à un degré moindre, ce qui entraîne des rhumes chroniques et des affections pulmonaires. Tous les ouvriers d’usine ont la même voix enrouée et rauque, mais singulièrement les fileurs humides et les doubleurs. Stuart, Mackintosh et Sir D. Barry soulignent avec une extrême énergie le caractère malsain de ce travail et l’insouciance de la plupart des industriels pour ce qui est de la santé des jeunes filles qui accomplissent ces tâches34.
22Engels explique donc la gravité des maladies respiratoires au sein du prolétariat anglais par ses conditions de travail et par ses conditions de vie en général. En dehors des causes intrinsèquement liées aux substances produites ou transformées par les machines et par le travail des ouvriers, il identifie deux autres types de causalité. Dans le premier ensemble, on peut regrouper les conditions sanitaires liées au défaut d’équipement : le manque de vêtements et l’impossibilité d’en changer après qu’ils ont été trempés successivement par la sueur et par la pluie (problème aggravé par la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur de l’usine), l’exiguïté, la saleté, l’extrême humidité et l’absence de ventilation des habitations (nous y reviendrons) ; dans le second ensemble, on peut regrouper les causes liées à la fragilité des corps : l’exténuation des organismes par l’excès de travail six jours sur sept, voire un peu plus, le manque de sommeil quand ce n’est pas l’impossibilité de dormir, la malnutrition et la sous-alimentation, l’inquiétude permanente des esprits plongés dans l’incertitude, l’ignorance et l’inconfort le plus total. On ne peut qu’admirer le souci d’exhaustivité et le caractère extrêmement concret et précis des observations d’Engels. Il ne se trompe pas, quand il considère que toutes les causes s’accumulent. Il n’a pas la naïveté de relier les calamités qu’il décrit à une cause précise, dont la suppression pourrait miraculeusement entraîner le mieux-être de cette population ; il ne surévalue pas la pollution à cet égard. Il décrit un système complet d’exploitation et de maltraitance, dans ses aspects les plus sordides et les plus immoraux. Mais de ce fait, pas plus qu’aucun de ses contemporains, il ne construit pas de réflexion systématique sur la pollution, comme on l’a fait depuis – quand on s’est aperçu que la pollution affectait toutes les classes sociales, et non seulement le prolétariat industriel.
Être asphyxié chez soi : les descriptions de l’habitat ouvrier
23S’agissant de l’habitat ouvrier, les trois auteurs décrivent les mêmes atrocités. Buret35 écrit par exemple :
Voici les résultats d’une enquête faite à Manchester, à l’époque du choléra, par un conseil de salubrité : sur 687 rues inspectées, 248 n’étaient pas pavées, 53 partiellement pavées, 112 manquaient d’une bonne ventilation, et 352 contenaient des tas d’immondices, des amas d’eaux stagnantes et d’ordures. Sur 6 951 maisons visitées, 2 565 avaient besoin d’être nettoyées, 960 demandaient des réparations urgentes, 939 avaient les conduits des eaux en mauvais état, 1 435 étaient notées comme humides, 452 mal ventilées, et enfin 2 221 maisons étaient privées de lieux d’aisance36. Nous avons pris la peine de citer ces chiffres, parce qu’ils sont authentiques et qu’ils expliquent parfaitement la différence de mortalité qui se manifeste dans toutes les grandes villes entre la population pauvre et la population aisée37.
24Un peu plus loin nous lisons ceci :
À Nottingham, sur 11 000 maisons dont se compose la ville, 7 à 8 000 sont construites dos à dos, sans moyen de ventilation, et n’ayant ordinairement qu’une seule fosse d’aisance, pour plusieurs maisons. À l’époque où Nottingham fut visité par le choléra, on découvrit que beaucoup de maisons étaient placées sur des ruisseaux d’égouts, recouverts seulement par les planches du rez-de-chaussée de ces maisons. Quand les planchers se fendaient par la chaleur, il sortait de ces ruisseaux des exhalaisons qui endommageaient considérablement la santé des habitants38.
25Un problème de surpopulation, lui aussi facteur d’asphyxie, s’ajoute à la négligence des besoins élémentaires des habitants, aux défauts de conception et de construction des logements, et à l’état d’abandon dans lequel ils sont laissés par leurs propriétaires :
Les inspecteurs chargés de faire cette enquête ont fréquemment trouvé deux familles et plus, entassées dans une petite maison contenant seulement deux pièces, l’une, dans laquelle on couchait, l’autre, dans laquelle on prenait les repas ; souvent plus d’une famille vivait dans une cave humide, qui ne contenait qu’une seule pièce, dans l’atmosphère empestée de laquelle étaient entassées de 12 à 16 personnes ! À ces causes si actives de souffrances ajoutez encore des cochons ou d’autres animaux dans la maison, avec toutes les incommodités de la nature la plus révoltante que vous pourrez imaginer, et vous aurez une idée des habitations de la partie la plus misérable de Manchester39.
26Le « détail » de la présence d’animaux vivant au milieu des hommes, se nourrissant de leurs déchets et leur abandonnant les leurs, est confirmé par la lecture d’Engels40. Les propriétaires des habitations (qui bien souvent sont les employeurs des locataires) louent les cours surpeuplées à des éleveurs de porcs.
27Engels décrit avec précision, et en s’aidant de schémas, la conception de l’habitat ouvrier dans un quartier de Manchester. Nous sélectionnons ce qui, dans sa description, a trait à l’enjeu de l’air et de la respiration :
[…] les rues communiquent avec [les cours] par des passages couverts. Si ce mode de construction désordonné était déjà très préjudiciable à la santé des habitants, en ce qu’il empêchait l’aération, cette manière d’enfermer les ouvriers dans des cours encloses de tous côtés, l’est encore bien plus. Ici, l’air ne peut rigoureusement pas s’échapper ; les cheminées des maisons – tant que le feu n’est pas allumé – sont les seules évacuations possibles pour l’air pris au piège de la cour.
Il s’y ajoute encore, que les maisons autour de ces cours sont le plus souvent bâties par deux, leur mur du fond étant mitoyen, et cela suffit déjà à empêcher toute aération satisfaisante et complète41.
28Des populations considérables s’entassent dans ces lieux exigus et piégeux, à même le plancher d’une ou deux pièces, ou bien à même la terre battue d’une cave, sans que les générations soient séparées, ni les familles. L’unique porte sert aussi quelquefois d’unique fenêtre ; l’habitation minuscule est située dans un labyrinthe de venelles et de petites cours répugnantes. Les fosses d’aisance, jamais vidangées, sont situées à l’extérieur et sont en nombre insuffisant ; Engels cite à titre d’exemple des cabinets d’aisance qui sont censés servir à cent-vingt personnes des deux sexes42.
29Ces quartiers découpés en morceaux minuscules qui se chevauchent en partie, et qui ne bénéficient d’aucun des équipements modernes de distribution de l’eau, d’évacuation des eaux usées, ni plus généralement des déchets, ne font l’objet non plus d’aucun encadrement administratif, d’aucun entretien ni d’aucune surveillance. Ils ont cependant une valeur marchande et spéculative. Les vivants se font concurrence pour y succéder immédiatement aux morts, et l’on meurt dans ces ruelles et dans ces cours à un rythme élevé.
30Comment, devant le spectacle d’une telle injustice, songer à incriminer un acide, un goudron ou des filaments de coton ? La logique même est de dénoncer les puissances qui créent cet état de fait et les pouvoirs qui non seulement le tolèrent mais contribuent activement à son maintien : c’est ce que font, dans des styles très différents, nos trois auteurs.
Histoire sociale et histoire des sensibilités
31La moisissure, la pourriture, les excréments, l’urine, les déchets de toute nature, entassés dans les habitations ou à leur sortie, sollicitent vigoureusement le sens de l’olfaction et incommodent les trois enquêteurs. Eugène Buret caractérise d’entrée de jeu par « l’air impur » la « condition physique et morale des classes pauvres » (c’est le titre du second chapitre de son livre) :
Pour compléter l’inventaire social des nations, il nous reste à pénétrer au sein même des populations qui recèlent la misère, à respirer un moment l’air impur dans lequel elles vivent, ou plutôt dans lequel elles se corrompent et meurent43.
32Flora Tristan introduit ainsi sa description du quartier irlandais de Londres :
Ce n’est pas sans un sentiment d’effroi que le visiteur pénètre dans l’étroite et sombre ruelle de Baimbridge. À peine y a-t-il fait dix pas qu’il est suffoqué par une odeur méphitique. La ruelle, entièrement occupée par le grand magasin de charbon, est impraticable. À droite, nous entrâmes dans une autre ruelle non pavée, boueuse et remplie de petites mares où croupissent les eaux nauséabondes de savon, de vaisselle et autres plus fétides encore… Oh ! je dus alors maîtriser mes répugnances et réunir tout mon courage pour oser continuer ma marche à travers ce cloaque et toute cette fange ! Dans Saint-Gilles, on se sent asphyxié par les émanations ; l’air manque pour respirer, le jour pour se conduire44.
33Quant à Engels, décrivant à Manchester le misérable quartier qui borde l’Irk, il écrit :
En bas, coule, ou plutôt stagne, l’Irk, mince cours d’eau, noir comme de la poix et à l’odeur nauséabonde, plein d’immondices et de détritus, qu’il dépose sur sa rive droite qui est plus basse ; par temps sec, il subsiste sur cette rive toute une série de flaques boueuses, fétides, d’un vert noirâtre, du fond desquelles montent des bulles de gaz méphitique dégageant une odeur qui, même en haut sur le pont, à 40 ou 50 pieds au-dessus de l’eau, est encore insupportable45.
34On peut vérifier en lisant ces textes que les préoccupations sanitaires de l’époque sont immédiatement connectées, comme l’explique Alain Corbin dans Le Miasme et la Jonquille, à la sensibilité olfactive. Toutefois, ce n’est pas leur délicate sensibilité (caractéristique de l’abaissement du « seuil de tolérance olfactive46 », d’une « mutation sensorielle au sein des élites47 »), ce n’est pas non plus leur nostalgie du bon air, ni leur amour de l’ordre, qui détermine nos auteurs à approfondir ces descriptions. La sensation que l’Irk pue, ou la ruelle de Baimbridge, s’explique d’abord par la présence bien réelle, à un taux de concentration remarquable, de matières malodorantes. Quoique nos auteurs soulignent vigoureusement l’infection « méphitique », le désordre et le délabrement de l’univers qu’ils décrivent, leurs textes s’éloignent considérablement de l’esprit des tableaux du peuple de Paris à la Louis-Sébastien Mercier, des représentations de la foule infréquentable, qui rend l’existence incommode aux bourgeois, et qui les fait vivre dans la hantise du vol, du crime et du chaos politique. On a plutôt affaire aux descriptions d’un enfer sur Terre.
35L’un des topoï du discours hygiéniste, qu’analyse Corbin dans Le Miasme et la Jonquille, consiste à dire que les prolétaires sont insensibles à la puanteur dans laquelle ils vivent, qu’ils sont habitués à leurs conditions de travail, quoiqu’elles soient terribles48, et que, de même qu’ils n’ont aucune notion d’hygiène, ils ont perdu en raison de l’extrême promiscuité dans laquelle ils vivent toute idée de décence voire de moralité49 ; de sorte que, s’il convient d’assainir cette partie du monde social, c’est avant tout pour éviter que sa saleté, ses miasmes, ses fièvres, et son indécence, contaminent le reste de la société. Quelques accents de ce discours se retrouvent sans doute chez Buret, qui craint la contamination des fièvres50, et qui considère que le caractère délétère de la misère affecte non seulement ceux qui en souffrent mais la société tout entière51. Mais, en dépit des ressemblances plus ou moins ambiguës qui affleurent ici et là entre ces inquiétudes et celles qui sont formulées par les hygiénistes, il n’est pas opportun de les mettre sur le même plan. Il est très possible que ce soit par les hygiénistes que Buret, Tristan et Engels aient été sensibilisés au problème du manque de ventilation des rues et de l’habitat ouvrier, aux conséquences néfastes de l’absence de pavage, et aux problèmes de divers ordres que pose la surpopulation des maisons et des caves. Mais, en abordant ces sujets, ils signifient précisément leur étonnement que, à une époque où l’on estime qu’il est de toute première importance de ventiler, de paver, d’évacuer les excréments et de désentasser les vivants (et les cadavres)52, on tolère que des populations de plus en plus nombreuses, et qui travaillent, soient privées des aménagements jugés nécessaires pour les autres. Ces textes n’expriment aucune « obsession aériste » ni aucune « phobie du manque d’air53 » : ils témoignent de la réalité sociale ; et s’ils sont caractéristiques d’un « système de représentation », c’est d’abord d’une idéologie qui s’organise autour des notions de droit, de liberté et d’égalité.
36En outre, il semble que la pollution du Royaume-Uni et de la France par le développement phénoménal de l’extraction minière et de l’industrie, l’ascension au plus haut sommet de l’État de la bourgeoisie industrielle et de la banque, et la grande misère du prolétariat industriel, permettent de définir, autant sinon plus que les discursivités scientifiques, le contexte global dans lequel les sensibilités évoluent au cours du premier xixe siècle. C’est ainsi en tout cas que Buret, Tristan et Engels conçoivent le monde dans lequel ils vivent. Engels remarque que les ruines décrépites et insalubres qu’il décrit n’ont pourtant qu’une quarantaine d’années d’existence54. Ces bâtiments pourris par l’air chargé de suie, dont les propriétaires savent qu’ils n’ont pas besoin de les entretenir pour en tirer profit, et qu’ils n’en ont pas l’obligation, sont l’incarnation d’un changement d’époque, d’une rupture historique qui caractérise l’ordre social en même temps que l’environnement dans lequel les hommes passent leur existence. Dans la logique du discours de Corbin, l’évolution des sensibilités, autrement dit de ce qui définit le plus intime de la vie humaine, quoique ce soit du commun, est calquée sur l’évolution des savoirs scientifiques et des discours des dominants, lesquels sont étroitement liés. Il sollicite au premier chef et ensemble des sources scientifiques, médicales, administratives, judiciaires et politiques. Les deux grandes ruptures qui bornent son récit sont, au commencement, les découvertes de Lavoisier sur la composition de l’air et de l’eau, et à la fin la révolution pastorienne. Mais précisément, nous avons vu que la chimie avait peu d’influence sur le discours de nos trois enquêteurs, et qu’ils cherchaient à retourner les discours des hygiénistes et des gouvernements.
37Les populations ouvrières, dans leur diversité, ne sont pas directement concernées par « l’histoire sensorielle » que Corbin raconte : si elles y apparaissent, c’est comme des objets (et le plus souvent comme des objets de dégoût et de réprobation morale pour les auteurs qu’il cite), et non comme des sujets. Ainsi, même dans l’histoire des sensibilités, celle des prolétaires exposés aux nuisances de toutes sortes et en particulier au mauvais air, reste une case blanche. Or, s’il est vrai qu’il reste peu de traces des prolétaires, il est faux que les seules qu’ils laissent soient les marchandises qu’ils fabriquent, et, dans l’air, dans l’eau et dans les sols, les déchets du travail qui a consumé leur vie.
38Quel est le discours des ouvriers eux-mêmes sur leurs conditions de vie ? Les textes de Buret, Engels et Tristan ne permettent pas de le savoir ; sauf exceptions, ils ne leur donnent pas la parole : ils ne procèdent pas sous la forme d’enquêtes avec entretiens55. Mais on peut comprendre, par d’autres motifs qu’une trop grande tolérance olfactive, ou l’ignorance, pourquoi les ouvriers d’industrie du xixe siècle ont, sauf exceptions, globalement toléré le principe même de l’industrialisation du monde, de la transformation de leur territoire par les implantations industrielles et par la pollution déjà massive, en certains lieux, de l’air et de l’eau. Jarrige et Le Roux avancent trois raisons, qu’on ne mettra pas sur le même plan : l’impossibilité logique de contester l’existence de ce qui constitue votre seul moyen de subsistance, et qui vous définit socialement, l’impossibilité de financer une action en justice, et un certain « virilisme » qui serait propre à la classe ouvrière et qui interdirait de se plaindre56. On peut se demander si le « virilisme » prolétarien n’est pas aussi précisément ce qui lui a permis de se plaindre ; on pourrait en tout cas certainement formuler d’autres raisons ; mais l’essentiel est que, bien qu’on dispose de peu de documents, on puisse se représenter assez aisément pour quelles raisons le prolétariat industriel n’a jamais été le milieu social le plus préoccupé d’écologie, bien qu’il soit le plus exposé aux pollutions, aux pestilences et aux risques.
39Il n’y a pas lieu non plus de s’étonner que Buret, Tristan et Engels aient réservé à l’enjeu de la toxicité des fumées et des pluies une moindre importance que nous ne le faisons de nos jours, étant donné le caractère inouï des conditions d’existence qu’ils découvrent quand ils pénètrent les quartiers où leurs semblables ne vont jamais. Le fait majeur à leurs yeux, que Tristan ne parvient à formuler que par comparaison avec la traite et l’esclavage57, c’est que le corps du prolétaire anglais ne lui appartient pas, qu’il subit de constantes cruautés, qu’il ne respire pas pour lui-même, qu’il lui est impossible de rien fonder qui lui soit propre, à commencer par une famille telle que les définissent les normes bourgeoises. Le constat essentiel, c’est moins la misère, la disette, la précarité, que le fait que des populations entières se trouvent prises au piège dès la petite enfance et pour le restant de leurs jours, que leurs forces physiques soient exploitées jusqu’à la mort, et que leurs capacités intellectuelles soient niées. L’asphyxie est totale en ce sens, qui implique, outre l’exposition aux fumées et aux pluies acides, la ségrégation, la négation de l’enfance, la destruction du corps, la négation de l’esprit58.
40Un fait remarquable cependant, dans la perspective de l’écologie actuelle, est que ni Buret, ni Tristan, ni Engels n’adhère à l’argumentaire progressiste de l’industrialisme. L’imaginaire industrialiste, dans ses dimensions épiques ou paysagères, leur est globalement étranger, surtout à Buret et Engels, sans que ces deux hommes se recommandent non plus d’aucune nostalgie arcadienne. Ils ne parlent pas d’abord au nom de la nature, mais au nom des droits de l’homme, et c’est ce qui les éloigne de l’environnementalisme. Pour autant, ils ne sont pas étrangers à toute forme d’écologie.
1 Voir notamment Isabelle Parmentier, Histoire de l’environnement en pays de Charleroi (1730-1830). Pollution et nuisances dans un paysage en voie d’industrialisation, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2008 ; Thomas Le Roux, Le Laboratoire des pollutions industrielles (Paris, 1770-1830), Paris, Albin Michel, 2011 ; William Cavert, The Smoke of London : Energy and Environment in the Early Modern City, Cambridge, Cambridge University Press, 2016 ; François Jarrige et Thomas Le Roux, La Contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2017.
2 Sur Chaptal, voir la mise au point de Thomas Le Roux dans Les Paris de l’industrie 1750-1920. Paris au risque de l’industrie, Paris, Creaphis éditions, 2013, p. 28-29.
3 Voir La Contamination du monde, op. cit., chap. III et V. Voir également la mise au point d’Alain Corbin, dans Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social. xviiie-xixe siècles [1982, 1986], Paris, Flammarion, coll. « Champs Histoire », 2016, p. 192-197. Voir également Les Paris de l’industrie, op. cit., p. 30-33.
4 La Contamination du monde, op. cit., chap. III.
5 Voir Thomas Le Roux, Les Paris de l’industrie, op. cit., p. 108-117. Voir également La Contamination du monde, op. cit., p. 239.
6 Ibid., p. 226.
7 Voir ibid., p. 227, le passage consacré aux diagnostics optimistes de James Condamin, professeur à l’université catholique de Lyon, au sujet de la pollution du Giers par les acides et les matières tanniques, et de la fumée qui « sature […] l’air d’atomes de goudron dont l’inhalation est bienfaisante à la santé ».
8 Selon Alain Corbin, op. cit., p. 195 : « La santé de l’ouvrier entre à peine en considération […] ».
9 Voir La contamination du monde, op. cit., p. 257.
10 Eugène Buret, De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. De la nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes, et de l’insuffisance des remèdes qu’on lui a opposés jusqu’ici ; avec l’indication des moyens propres à en affranchir les sociétés, [Paris, 1840], Jules Reynouard et compagnie, Paris et Leipzig, 1841. Nous citerons cet ouvrage dans sa réimpression par Scientia Verlag, à Aalen, en 1979. Le texte de Buret répond au sujet mis au concours par l’Académie des Sciences morales et politique en 1839 : « Déterminer en quoi consiste et par quels signes se manifeste la misère en divers pays. Rechercher les causes qui la produisent » ; il obtient la médaille d’or. Flora Tristan, Promenades dans Londres ou l’aristocratie & les prolétaires anglais, paru à Paris chez Delloye et à Londres chez William Jeffs en 1840. Nous citerons ce texte dans l’édition parue en 1978 chez François Maspero. Friedrich Engels, La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, d’après les observations de l’auteur et des sources authentiques, paru à Leipzig en 1845 (traduction en anglais en 1855). Nous citerons ce texte dans l’édition de 1975 (Éditions sociales, traduction de Gilbert Badia et Jean Frédéric). Le choix de ces trois textes est arbitraire : ils sont particulièrement remarquables, mais représentatifs des préoccupations et des activités militantes réformistes ou socialistes des années 1830-1840, dont rend compte par exemple, s’agissant de la France, entre autres nombreuses références possibles, l’ouvrage dirigé par Thomas Bouchet, Vincent Bourdeau, Edward Castleton, Ludovic Frobert et François Jarrige, Quand les socialistes inventaient l’avenir. 1825-1860, Paris, La Découverte, 2015. Cette période est également marquée par les mobilisations politiques des ouvriers, en particulier parisiens et lyonnais, qui ont été abondamment étudiées. Voir par exemple Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée 1789-1848, Paris, La Découverte, 2014, en particulier les chapitres 8 et 9.
11 Edward P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise [1963], trad. française, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2012. Sur les emprunts des enquêteurs sociaux français tels que Buret et Tristan aux enquêteurs britanniques, voir par exemple l’ouvrage classique de Louis Chevalier, Classes dangereuses et classes laborieuses à Paris pendant la première moitié du xixe siècle, Paris, Perrin, [1958], 2007, p. 147-149.
12 Voir à ce sujet François Jarrige et Marie Lauricella, « Un forum pour la classe ouvrière. L’expérience de L’Atelier », dans Quand les socialistes inventaient l’avenir. 1825-1860, op. cit., p. 226-238.
13 La Contamination du monde, op. cit., p. 225. Ce combat (qui aboutit à l’interdiction du blanc de céruse) est fréquemment évoqué, par les historiens du monde ouvrier comme par les spécialistes de l’histoire de l’écologie. Voir par exemple Serge Audier, La Société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, Paris, La Découverte, 2017, p. 277.
14 La Contamination du monde, op. cit., p. 252.
15 Ibid., p. 264. Jarrige et Le Roux fournissent d’autres exemples remarquables.
16 Par exemple, on ne rencontre pas d’article « Pollution » dans la récente Histoire globale des socialismes. xixe-xxie siècles, parue aux PUF en 2021 sous la direction de Jean-Numa Ducange, Razmig Keucheyan et Stéphanie Roza.
17 Voir Anne-Claude Ambroise-Rendu, Steve Hagimont, Charles-François Mathis, Alexis Vrignon, Une histoire des luttes pour l’environnement. xviiie-xxe. Trois siècles de débats et de combats, Paris, Textuel, 2021.
18 Op. cit., p. 255-258. Voir également Brigitte Krulic, Flora Tristan, Paris, Gallimard, coll. « Biographies », 2022.
19 Engels cite au fil de sa démonstration (p. 200-215) les rapports de nombreux médecins : le docteur James Philip Kay, le docteur William Hey de Leeds, les chirurgiens Francis Sharp et Beaumont de Bradford, le docteur Loudon, Sir D. Barry, les docteurs Hawkins, Roberton, Stuart, etc. Il cite également Andrew Ure, auteur d’une Philosophy of Manufactures (1835).
20 Op. cit., p. 201-210. Marx fait de même dans le chapitre qu’il consacre à la journée de travail dans Le Capital, Livre I, trad. J. Roy, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1985, p. 177-224.
21 Promenades dans Londres, op. cit., p. 72.
22 On songe au Voyage dans le Yorkshire de John Stuart Mill (Journal of a tour in Yorkshire and the Lake district, 1831), au Voyage en Angleterre et en Irlande de Tocqueville (1835), et bien sûr aux Temps difficiles de Dickens (1854). À propos de ces textes, voir Serge Audier, op. cit., chapitre 5.
23 Les auteurs de La Contamination du monde, op. cit., p. 240, donnent un exemple du point de vue contraire, datant de 1905. Ce sont les Souvenirs à coloration vernienne, parus en 1905 à Paris, de Gustave Bonnefond, « vieil ingénieur au Creusot » : il décrit placidement une ville propre, des ouvriers en bonne santé et heureux, des fumées de toutes les couleurs.
24 Friedrich Engels, La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, op. cit., p. 100.
25 Sa description de Manchester est également attentive aux phénomènes de seuil dans la topographie, et notamment à la manière dont la misère des quartiers ouvriers est masquée aux classes aisées et aux visiteurs par des aménagements urbains tels que les boulevards (voir p. 85-88). Flora Tristan et Eugène Buret font le même type de remarques, avec moins de précision toutefois, à propos de Londres. Voir Buret, op. cit., tome 1, p. 317-318, et Tristan, op. cit., p. 190-191.
26 L’auteur fait simplement allusion au livre du jeune Engels, en suggérant qu’il est surtout redevable à d’autres auteurs (dont Buret et Tristan), ce qui est inexact.
27 Sur la notion de « société du risque », voir Serge Audier, op. cit., p. 96-99.
28 Flora Tristan, op. cit., p. 118.
29 Ibid., p. 119.
30 Ibid., p. 120.
31 Ibid., p. 119-120. Toute une imagerie effrayante en même temps qu’héroïque, épique, de la modernité et de la société capitaliste industrielle, est en germe dans ce texte. On songe par exemple au Metropolis de Fritz Lang.
32 Ibid., p. 119 : « J’étais asphyxiée, j’avais hâte de fuir ce foyer de puanteur, lorsque le foreman me dit : “Restez encore un instant, vous verrez quelque chose de curieux : les chauffeurs vont retirer le coke des fours.” »
33 Friedrich Engels, La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, op. cit., p. 213-214.
34 Ibid.
35 Sur Buret, enquêteur social moins connu que les deux autres auteurs évoqués ici, sans doute en raison du fait qu’il n’appartient pas à la sphère socialiste, voir par exemple Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, op. cit., p. 160-163.
36 Ici Buret introduit une note renvoyant à l’ouvrage de Kay, également cité par Engels : The moral and physical condition of the working classes employed in the cotton manufactures in Manchester, by James Philips Kay, p. 30-31.
37 Eugène Buret, op. cit., p. 331. Ces statistiques sont également citées par Engels, op. cit., p. 105.
38 Ibid., p. 335. Eugène Buret rédige ici cette note : State of Nottingham, by W. Felkin, Journal of statistical society of London, jan. 1840.
39 Ibid., p. 331-332.
40 Friedrich Engels, op. cit., p. 93-95.
41 Ibid., p. 95-96.
42 Ibid., p. 101.
43 Eugène Buret, op. cit., t. 1, p. 312-313.
44 Flora Tristan, op. cit., p. 191.
45 Friedrich Engels, op. cit., p. 90. La description souligne ensuite la proximité des habitations : « En amont du pont, s’élèvent de hautes tanneries, des fabriques de noir animal et des usines à gaz dont les eaux usées et les déchets aboutissent tous dans l’Irk, qui recueille en outre le contenu des égouts et cabinets qui y débouchent. On peut donc imaginer la nature des résidus qu’abandonne le fleuve. En aval du pont, on a vue sur les tas d’ordures, les immondices, la saleté et le délabrement des cours, située sur la rive gauche, abrupte ; les maisons sont tassées les unes contre les autres et la pente de la rive ne permet d’apercevoir qu’une fraction de chacune d’elles, toutes noires de fumée, décrépites, vétustes, avec leurs fenêtres aux vitres et aux châssis cassés. L’arrière-plan est constitué par de vieilles bâtisses d’usine, ressemblant à des casernes. […] »
46 Le Miasme et la Jonquille, op. cit., p. 90.
47 Ibid., p. 229.
48 Ibid., p. 197.
49 Alain Corbin, op. cit., p. 200, évoque « l’attention portée » au xixe siècle par les hygiénistes et par les autorités « à la désinvolture olfactive et la puanteur du pauvre ». Sur les discours dénonçant la « fétidité » et « la puanteur du pauvre » au xixe siècle, et sur leurs prolongements moraux, voir p. 207-236.
50 Eugène Buret, op. cit., t. 1, p. 321. L’opinion de Buret est conforme à celle des médecins anglais qu’il cite.
51 Dans son introduction, il appelle le paupérisme « cet ennemi menaçant de notre civilisation » (ibid., p. 69), et cherche à se ménager la bienveillance des conservateurs (il brigue un prix de l’Institut) en écrivant : « Personne n’éprouve plus d’horreur que nous pour les vices effroyables qui corrompent les basses classes, surtout les classes industrielles » (ibid., p. 79).
52 Sur les « stratégies de la désodorisation » sur la période, voir Le Miasme et la Jonquille, op. cit., p. 133-163.
53 Ibid., respectivement p. 224 et 225.
54 Friedrich Engels, op. cit., p. 99.
55 Quelquefois, chez Flora Tristan et chez Engels (pas chez Buret), et beaucoup plus souvent chez Marx (dans Le Capital), la parole est donnée aux ouvriers. Chez Marx, qui est le plus coutumier du fait, elle est souvent rapportée telle quelle, fautes d’orthographe et déformations lexicales comprises quand il s’agit de lettres. Voir par exemple Le Capital, op. cit., p. 186-189.
56 La Contamination du monde, op. cit., p. 261.
57 Flora Tristan, op. cit., p. 120 : « Ainsi la vie des hommes est à prix d’argent ; et, quand la tâche exigée doit les faire mourir, l’industriel en est quitte pour augmenter les salaires !!! Mais c’est encore pis que la traite des nègres !… Au-dessus de cette énormité monstrueuse, je ne vois que l’anthropophagie !!! Les propriétaires d’usines, de manufactures peuvent, sans en être empêchés par la loi, disposer de la jeunesse, de la sève de centaines d’hommes, acheter leur existence et la sacrifier, afin de gagner de l’argent ! […] » Voir également p. 111 et p. 196, ce crédo : « Les nègres de la Jamaïque sont, sans nul doute, moins malheureux que l’ouvrier des manufactures anglaises […] ».
58 Marx insiste tout particulièrement sur ce point dans le livre I du Capital (chapitre sur la journée de travail, encore) : l’un des aspects du scandale est que les prolétaires soient mis au travail dès la petite enfance, privés d’éducation, et de la possibilité de s’accomplir comme êtres pensants et comme êtres sensibles. Voir également sur ce point Engels, op. cit., p. 198-200.
L’enjeu de la respiration dans les enquêtes d’Eugène Buret, Flora Tristan et Friedrich Engels sur le prolétariat anglais » dans L’Air des livres. Respirations, inspirations,
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Les Carnets du vivant », n° 1, 2024
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1565.
Quelques mots à propos de : François Vanoosthuyse
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – UR 3229
