Sommaire
Henry Becque, prince de l’amertume
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en mai 2019, publiés par Marianne Bouchardon
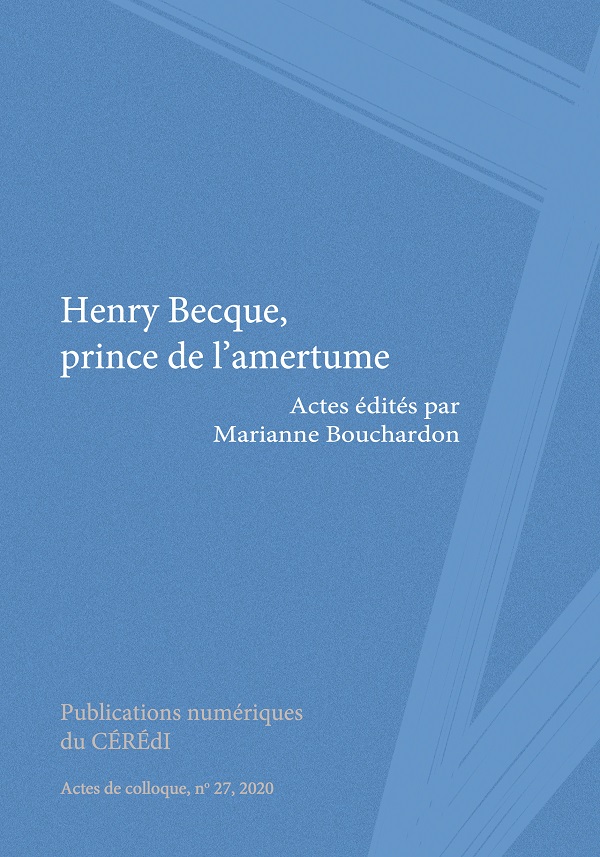
- Marianne Bouchardon Introduction
- Inspirations et influences
- Isabelle Moindrot Sardanapale de Becque et Joncières au Théâtre-Lyrique (1867) : un début paradoxal ?
- Sylvain Ledda Becque balzacien ? À propos des Corbeaux et de La Parisienne
- Olivier Goetz Ce que Becque doit à Sardou
- Le théâtre et les mœurs
- Florence Fix La science pour rire : mérite de l’inventeur chez Becque
- Aline Marchadier L’Enlèvement : drame de la séparation, comédie du langage
- Écrire Les Corbeaux
- Roxane Martin Les ficelles mélodramatiques à l’œuvre dans Les Corbeaux
- Céline Hersant Les Corbeaux : une spéculation spatiale ?
- Jouer Les Corbeaux et La Parisienne
- Konstanza Georgakaki Henry Becque à Athènes
- Jean-Pierre Vincent Pour la journée Henry Becque, 2019
- Jean-Pierre Vincent Les Corbeaux (1982)
- Jean-Pierre Vincent Projet de mise en scène de La Parisienne
Jouer Les Corbeaux et La Parisienne
Pour la journée Henry Becque, 2019
Jean-Pierre Vincent
1Bonjour à toutes et tous,
2Désolé de ne pas être parmi vous aujourd’hui. Cette journée Becque a été pour moi une surprise peut-être aussi grande que ma découverte de Becque lui-même. Mon chemin vers Henry Becque a commencé de loin, très tôt. Je dois vous raconter nos premiers pas dans le théâtre, les miens, certes, mais aussi notre atelier permanent avec Patrice Chéreau.
3C’était donc au Groupe Théâtral du Lycée Louis-le-Grand à Paris, entre 1958 et 1964, groupe créé après la guerre par un professeur de lettres classiques. Son répertoire puisait dans ce que l’on pourrait appeler « les raretés du répertoire ». Il n’était pas question d’aller vers les grands titres des théâtres parisiens, en particulier des Théâtres Nationaux. Raretés mondiales (Amal et la Lettre du Roi de Rabindranath Tagore, L’Étoile de Séville de Lope de Vega, Oreste d’Alfieri), mais aussi « second tiroir du théâtre français » (Clitandre de Corneille). Toute ma vie j’ai conservé un vrai goût, une attirance vers ce théâtre oublié par les dominants.
4Ainsi, Chéreau et moi, jeunes animateurs du groupe, avons commencé par L’Intervention de Victor Hugo (totalement inconnue à l’époque) ou La Religion des Imbéciles et les Scènes Populaires de 1830 d’Henry Monnier.
5Plus tard (1965) est venue L’Affaire de la Rue de Lourcine d’après Labiche On peut deviner, à travers ces titres, que nous avions une cible privilégiée : la petite-bourgeoisie (française) dont nous nous extirpions alors. Petite-bourgeoisie du xixe siècle, son époque triomphante, décortiquée, satirisée, caricaturée, de Balzac à Flaubert, de Monnier à Labiche, de Gavarni à Daumier, jusqu’à notre Henry Becque.
6Je ne me souviens plus précisément quand et comment je suis tombé sur Becque et La Parisienne. Nous lisions beaucoup (Barthes, De Beauvoir, Foucault, Brecht et Marx, bien sûr, et beaucoup de Théâtre à la Bibliothèque de l’Arsenal). Dans La Parisienne, ce qui m’avait d’abord éberlué, c’est cette fameuse première scène, scène de ménage entre mari et femme, où l’on s’aperçoit à la fin de la scène que le vrai mari revient à la maison ! S’ensuit, comme on sait, une série de tromperies assez crasseuses – malgré le féminisme réel du propos – mais tout cela finit à peu près bien. Cela fait bien sûr penser à Labiche, méchant observateur de ces messieurs-dames, mais qui sauve ses crapules à l’heure du dénouement.
7La pièce me passionnait, mais je n’aimais guère le dénouement en forme de happy end obligé. L’idée m’est alors venue de monter la pièce deux fois – ou disons « une fois et demi » – dans un décor double, qui représenterait, côté jardin, un décor bourgeois chic, et côté cour, rien, c’est à dire la scène vide et nue, de la machinerie, des coulisses un peu poussiéreuses. Histoire aussi de confronter deux styles de jeu : la pseudo-liberté insouciante du théâtre des parisiens contre la rude observation réaliste. Certaines scènes auraient été jouées deux fois, sur un ton évidemment différent ; ou bien, elles se seraient enchaînées en changeant d’atmosphère dans l’instant ; ou bien encore croisées, « tuilées », comme on dit. Et, après la fin bourgeoise et les rituels saluts des acteurs au public, nouveau dénouement en coulisses où le mari tue l’amant d’un coup de pistolet, dans le couloir des loges qui mène à la sortie.
8Je n’ai pas mis en scène cette Parisienne. Cette idée, comme bien d’autres, est restée à l’état de projet ; mais j’avais gardé deux ou trois documents. Ce qui m’a attiré vers ce théâtre-là, c’est aussi une autre raison. Dès 1830, la bourgeoisie parisienne règne sur la France, sur le plan culturel en particulier. Elle a fait triompher un théâtre du bon plaisir. Pas question pour elle de fouiller (en public) les coins sombres de sa vie de famille… Nous n’avons pas de Tchékhov, pas d’Ibsen, pas de Strindberg, pas de Hauptmann, mais nous avons Labiche et Offenbach. Ladite bourgeoisie a curieusement été beaucoup plus libérale avec le roman (Balzac, Flaubert, Zola). Certes il y a eu au théâtre Germinie Lacerteux des frères Goncourt, et une filière secrète, minoritaire, qui nous mène à Henry Becque. Il faut attendre André Antoine, Jacques Copeau, Firmin Gémier, mais aussi les auteurs qu’ils ont entraînés avec eux – mes préférés : Henri-René Lenormand, Charles Vildrac... J’ai toujours un coin de mon répertoire personnel pour ces œuvres-là.
9C’est ce qui m’a mené vers Les Corbeaux. En 1981, Jacques Toja, alors administrateur général de la Comédie-Française, me proposa de venir mettre en scène un spectacle Salle Richelieu. Je dirigeais alors le Théâtre National de Strasbourg depuis six ans. Je me suis dit que ce petit détour était intéressant : je lorgnais vers des actrices et des acteurs formidables que j’avais vu jouer – en particulier dans La Trilogie de la Villégiature de Goldoni avec Strehler.
10Mais quoi monter avec eux ? Une fois de plus, le « second tiroir » est venu à mon secours : Les Corbeaux ! Je gardais la pièce en tête depuis longtemps. Mais ma condition première, c’était de travailler avec la crème de la troupe : et ce furent effectivement Denise Gence, Claude Winter, Catherine Hiegel, Christine Murillo, la toute jeune Anne Consigny, la vénérable Andrée Tainsy, et côté messieurs : Michel Aumont, Roland Bertin, Gérard Giroudon, Dominique Rozan, Yves Gasc…
11Cette fois-ci, pas de double récit. Tout ce que je pouvais ressentir de la force et de l’originalité de Becque tenait en un seul discours. Le décalage venait aussi du décor, décor du peintre Chambas, sur grand fond rouge, les fleurs du papier peint comme grossies à la loupe, mais occupant seulement de petites parties (symboliques) du décor. Pour le pauvre logement du IVe acte, il nous suffisait de vider le décor de ses meubles, de ses décorations florales, et l’espace, lumières aidant, sentait aussitôt le dénuement et la détresse. Mais tout venait du travail intense des actrices et des acteurs, travail serré sur le texte et sa vérité. Pas d’effets abusifs. Je me souvenais de l’anecdote racontant que Becque écrivant se levait de sa chaise pour aller devant son armoire à glace, y jouer la réplique et vérifier sa véracité. Ce fut une magnifique expérience. Nous l’avons repris la saison suivante, chose rare pour une pièce si peu connue.
12Robert Badinter entraîna François Mitterrand à venir voir le spectacle. Le lendemain, Jack Lang me proposait de succéder à Jacques Toja. Dois-je vous dire que j’ai longuement hésité ? Premier administrateur général de 40 ans, premier metteur-en-scène, premier à venir de la décentralisation. Le défi était grave. Et la réalité l’a été !
13Je suis heureusement revenu au Français par la suite, invité par certains de mes successeurs, et je me suis chargé de remettre à l’honneur le « second tiroir » et ses chefs d’œuvre bêtement délaissés : en 1989, La Mère Coupable de Beaumarchais, à l’appel d’Antoine Vitez ; en 1996, Léo Burckhardt d’Alfred de Vigny, à l’appel de Jean-Pierre Miquel ; et même, dirais-je, en 2009, Ubu Roi que l’on n’attendait guère en ce haut lieu, à l’appel de Muriel Mayette. Et cerise sur le gâteau, La Dame aux Jambes d’Azur de Labiche, en 2015. Bon, mais j’ai monté de grands chefs d’œuvre aussi !
14Et chemin faisant, je rouvre parfois le texte des Polichinelles qui est toujours sur mon étagère. Qui vivra verra… Becque n’est pas une religion pour moi, mais une sorte de fidélité émue. Fidélité polémique aussi envers ce que je considère trop souvent dilettante, superflu, dans le théâtre français (parisien, veux-je dire). C’est toute ma lutte artistique, avec Becque toujours en son cœur secret.
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en mai 2019, publiés par Marianne Bouchardon
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 27, 2020
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1076.
