Sommaire
Henry Becque, prince de l’amertume
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en mai 2019, publiés par Marianne Bouchardon
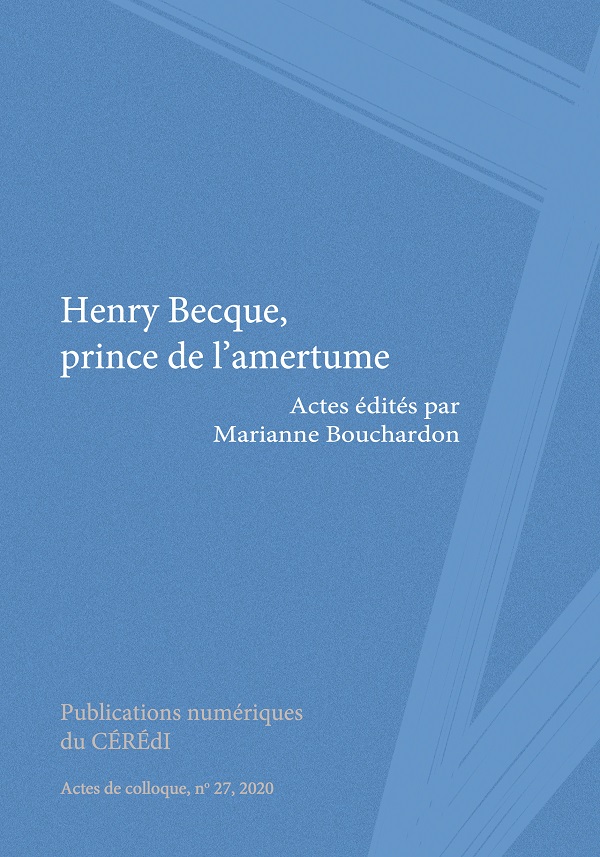
- Marianne Bouchardon Introduction
- Isabelle Moindrot Sardanapale de Becque et Joncières au Théâtre-Lyrique (1867) : un début paradoxal ?
- Sylvain Ledda Becque balzacien ? À propos des Corbeaux et de La Parisienne
- Olivier Goetz Ce que Becque doit à Sardou
- Florence Fix La science pour rire : mérite de l’inventeur chez Becque
- Aline Marchadier L’Enlèvement : drame de la séparation, comédie du langage
- Roxane Martin Les ficelles mélodramatiques à l’œuvre dans Les Corbeaux
- Céline Hersant Les Corbeaux : une spéculation spatiale ?
- Konstanza Georgakaki Henry Becque à Athènes
- Jean-Pierre Vincent Pour la journée Henry Becque, 2019
- Jean-Pierre Vincent Les Corbeaux (1982)
- Jean-Pierre Vincent Projet de mise en scène de La Parisienne
Henry Becque, prince de l’amertume
Introduction
Marianne Bouchardon
1Louis Jouvet, auquel est emprunté le titre de cette publication, disait de Henry Becque, dans une conférence de 1935 :
Il n’y a, tout au long de cette existence, qu’un concours de circonstances mystérieusement néfastes, de conjonctures occultement sinistres, qui n’apparaissent pas au premier abord, tant elles sont sournoises et malignes, mais dont les symptômes réguliers, constants et comme cadencés, font découvrir tout à coup, dans sa vie et son œuvre, une trame de deuil1.
2Pour contredire et renverser cette légende d’un Becque poursuivi par le mauvais sort, il ne fallait pas moins que la rencontre dont les actes sont ici publiés, et dont tous les participants méritent d’être très vivement remerciés.
3Reste que, pour évoquer la figure de Becque, l’on est obligé de repartir de l’échec qui a été son lot perpétuel : la liste des refus qu’il a essuyés avant de faire jouer chacune de ses pièces est impressionnante, et, une fois mises à la scène, toutes ont fait des fours ou causé des scandales. Il faut dire que c’est un paradoxe que l’obstination et l’âpreté avec lesquelles ce misanthrope s’est efforcé toute sa vie d’atteindre à la popularité. Aussi avide de faire applaudir ses pièces qu’acharné à proclamer sa haine pour la société en général et les hommes de théâtre en particulier, Becque semble avoir réuni en lui le complexe d’Oronte et le complexe d’Alceste. Nul n’a plus que lui recherché le succès, multiplié les démarches, les tentatives, les efforts en ce sens. Nul ne l’a plus que lui repoussé, en se brouillant avec les directeurs, les comédiens, les critiques, et en tendant au public un miroir dans lequel ce dernier ne pouvait accepter de se reconnaître. Difficile, dès lors, de débrouiller l’écheveau des causes et des effets. Qu’il ait échoué par excès de bile ou que l’échec ait aggravé sa mélancolie, la contradiction reste : Henry Becque ou l’atrabilaire ambitieux.
4Son œuvre dramatique elle-même est mince : elle compte peu de pièces, dont beaucoup de courtes : un livret d’opéra (Sardanapale, 1867), un vaudeville (L’Enfant prodigue, 1868), un drame social (Michel Pauper, 1869) une pièce à thèse (L’Enlèvement, 1871), six comédies de mœurs, dont Les Corbeaux (1882) et La Parisienne (1885), trois comédies en un acte (La Navette en 1878, Les Honnêtes Femmes en 1880, Le Départ en 1886), une autre inachevée (Les Polichinelles), quelques levers de rideaux. Ce « théâtricule2 », pour reprendre une expression de Jules Wogue, passant en revue toutes les classes sociales, des plus basses aux plus hautes, forme une sorte de comédie humaine en miniature, qui brosse le sombre tableau d’un monde contemporain soumis au règne universel d’or et de la chair, de l’intérêt et du plaisir. La noirceur et le pessimisme en sont la marque de fabrique. Chez Becque, la violence de la satire ne s’éclaire d’aucune lueur d’espoir ou d’humanité. Pour lui, il fait « noir clair dans tout l’univers3 », comme dira plus tard le Clov de Beckett. Dans son personnel dramatique, l’on chercherait en vain un personnage sympathique : l’on ne trouve pas chez lui, comme chez Augier, Dumas fils ou Sardou, un de ces « raisonneurs », héritier des Chrysalde, des Cléante ou des Ariste de Molière, dont la position raisonnable et modéré puisse être érigée en modèle. Quant à ses dénouements, ils sont toujours plus ou moins malheureux : soit que ses pièces finissent mal, soit qu’elles finissent faussement bien. Le théâtre de Becque se rapproche, en ce sens, de ce que Jean Jullien appelle dans « Le théâtre vivant » la représentation d’une « tranche de vie4 » : à la fin, le conflit n’est pas résolu, rien n’est réglé, tout continue, et il n’est pas possible au spectateur de quitter la salle avec le sentiment réconfortant et la conviction rassurante que le monde est en ordre.
5Mince, l’œuvre dramatique de Becque est inégale et ne compte, à vrai dire, que deux chefs-d’œuvre. Dans Les Corbeaux et La Parisienne, l’auteur, au sommet de son art, fait preuve d’une maîtrise et d’une maturité qui lui faisait défaut dans ses premières tentatives et qu’il ne retrouvera pas dans ses dernières ébauches. Mais, à elles seules, ces deux pièces ont suffi pour le désigner un temps comme le grand rénovateur de la comédie de mœurs. Rompant avec la technique de l’intrigue, ce que Zola appelle la « fabrication » ou « l’arrangement5 », il renonce à fonder l’écriture dramatique sur l’habile combinaison des événements et l’ingénieux agencement des péripéties : l’action de ses pièces, préférant développer les caractères plutôt que d’enchaîner les épisodes, frappe par sa pureté et son dépouillement. Renonçant à toute forme de grandiloquence, Becque impose, en outre, un langage simple et concis, tablant sur une nouvelle forme d’efficacité, dont le demi-mot, l’implicite et l’allusion sont les principaux facteurs. Par exemple, dans le premier acte des Corbeaux, quand Madame de Saint-Genis entre dans le salon des Vigneron, alors que son fils doit encore épouser leur fille, l’embarras avec lequel elle répond à la question de savoir si les deux témoins de son fils viendront bras dessus-bras dessous suffit à faire comprendre au spectateur que les témoins en question (un général des armées et un chef de bureau) sont deux de ses anciens amants, que le fils ne doit qu’aux charmes de sa mère sa place au ministère, et l’intrigante est repérée.
6Dans la première scène de La Parisienne, il suffit de trois mots pour désigner Clotilde comme une rouée, rompue à la pratique du mensonge et de la dissimulation : « Lafont – Il vous arrive quelquefois de vous contredire. Clotilde – Ça m’étonne6. » Becque se distingue, enfin, par son art subtil d’inquiéter le spectateur, en brouillant l’opposition entre le bien et le mal, en problématisant le partage entre le vice et la vertu, de telle manière qu’il n’y a chez lui ni francs coupables ni purs innocents. Les corbeaux sont simplement des hommes d’affaires qui, à ce titre, font passer leurs intérêts avant ceux d’autrui, et qui les défendent en toute légalité. L’héroïne de La Parisienne est, certes, hypocrite et volage, mais tellement charmante et bienfaisante, qu’il est difficile de la blâmer totalement. La déstabilisation morale qui en résulte est d’autant plus troublante pour le spectateur, partagé entre indignation et complaisance, entre condamnation et indulgence, qu’il en vient à douter de sa propre intégrité, et à suspecter que l’ambiguïté des personnages ne soient en réalité la sienne. Comme l’explique Octave Mirbeau, « Avec Becque, je ne me sens pas à l’aise ; il me secoue violemment sur mon fauteuil, me prend à la gorge, me crie : Regarde-toi dans ce personnage… Voilà pourtant comment vous êtes faits, tous7 ! »
7Dans l’histoire du théâtre, Becque se laisse difficilement situer, lui qui occupe une place intermédiaire entre deux générations. Né en 1837, il est plus jeune qu’Émile Augier, Alexandre Dumas fils et Victorien Sardou, la fameuse triade « Audusar » dont l’éclatant triomphe se confirme au-delà même des frontières françaises durant près d’un demi-siècle, plus vieux que Léon Hennique, Henry Céard, Georges Ancey, Fernand Icres, qui font les beaux jours du Théâtre-Libre d’André Antoine et sont, pour cette raison, souvent rassemblés sous le nom de « génération de 1887 ». Lui-même se complaît dans rôle du solitaire et de l’isolé et, loin d’avoir jamais rallié aucune école ni aucun mouvement, il rechigne à se laisser embrigader dans des combats qui ne sont pas les siens. Au début de sa carrière, il est parfois rattaché à « l’école brutale » – étiquette forgée en 1870 à l’occasion de la création quasi-concomitante des pièces de trois jeunes auteurs : Le Bâtard d’Alfred Touroude, Père et Mari d’Émile Bergerat et Michel Pauper de Becque, dont il semblait à Barbey d’Aurevilly que la devise commune était « À outrance8 ! » et qui ont paru marquer le tournant réaliste à la scène.
8Strictement contemporaine des Rougon-Macquart, son œuvre dramatique entretient avec le naturalisme des rapports complexes : son refus d’adoucir ou embellir la réalité, son goût pour la vérité dure ou crue, incite à la ranger sous cette bannière. D’autant que dans Les Polichinelles, par exemple, le banquier Tavernier, personnage-repoussoir, s’en prend violemment à Émile Zola auquel il préfère Georges Ohnet, et sa réplique métathéâtrale pourrait passer pour l’indice d’une connivence avec le naturalisme. Pourtant, Becque s’est toujours tenu à distance de son chef de file, proclamant n’avoir « jamais eu de goût pour les assassins, les hystériques, les alcooliques, pour les martyrs de l’hérédité et les victimes de l’évolution9 ».
9Il ne manque pas une occasion, en revanche, d’afficher sa sympathie pour Antoine, qui, en retour, revendique son patronage, ce qui accrédite l’hypothèse d’un Becque précurseur de la « comédie rosse » – genre qui a notamment prospéré sur les planches du Théâtre-Libre. Non que Becque soit à proprement parler l’inventeur de la rosserie au théâtre. Chez Molière, Jules Lemaître le souligne, l’on relève déjà des mots rosses : il cite en exemple celui de Charlotte voulant consoler son amoureux éconduit : « Va, va, Piarrot, ne te mets point en peine. Si je sis madame, je te ferai gagner queuque chose, et tu apporteras du beurre et du fromage cheux nous10 », ou celui d’Orgon voulant donner une idée de ses progrès dans la perfection chrétienne : « Et je verrais mourir père, enfants, mère et femme, / Que je m’en soucierais autant que de cela11. » Mais chez Becque, ces mots rosses ne sont pas l’exception, ils sont la règle. Ses personnages passent leur temps à être ignobles avec candeur, cyniques avec ingénuité : l’inconscience dans le mal est un trait commun aux hommes d’affaires des Corbeaux et à l’héroïne de La Parisienne, que Georges Ancey, Henry Céard, Émile Fabre, à leur tour, pousseront à son paroxysme.
10Puis, dans le premier quart du xxᵉ siècle, une autre lecture va peu à peu s’imposer : celle qui fait de Becque un « pur classique », et le rattache à la tradition des grandes comédies de Molière.
11En effet, Les Corbeaux réinvestissent et subvertissent le schéma de la comédie classique : ils commencent comme la plupart finissent : par la promesse d’un mariage heureux entre deux jeunes gens qui s’aiment d’un amour réciproque. Ils s’achèvent comme débutent L’École des femmes, Tartuffe ou L’Avare : par une union révoltante entre une jeune fille et un vieillard. Teissier rassemble en lui les traits de Tartuffe, d’Arnolphe et d’Harpagon : comme le premier, il vit en parasite dans une famille dont il entend détourner l’héritage et épouser la fille ; comme le second, il est un barbon qui s’éprend d’un tendron ; du troisième, il partage l’avarice et la cupidité. La Parisienne, quant à elle, s’ouvre sur un alexandrin, « Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre12 », qui souligne combien les scènes de jalousie que Lafont inflige à Clotilde sont redevables à celles qu’Alceste fait subir à Célimène.
12Or, il n’est pas indifférent de choisir d’interpréter le théâtre de Becque comme le produit de son époque ou comme une création détachée de son temps, de préférer le situer par rapport au xixᵉ siècle ou par rapport au xviiᵉ siècle, car de la situation qui en est proposée dépend la réception qui en est faite. Autant la parenté de Becque avec ses contemporains brutaux, rosses ou naturalistes freine sa reconnaissance, autant le patronage de l’auteur classique par excellence favorise sa consécration.
13De son vivant, malgré le soutien que lui accorde Mirbeau et la notoriété que lui attire La Parisienne, Becque n’aura jamais compté au nombre des grands auteurs dramatiques. Sa gloire, posthume, atteint son apogée dans les années 1920. Faute d’avoir jamais conquis un large public, il jouit alors de la reconnaissance unanime et incontestée du monde des lettres, et la critique dramatique ne craint pas de juxtaposer les noms de Molière, Beaumarchais et Becque. En 1925, alors que ses œuvres complètes viennent d’être rééditées par son petit neveu Jean Robaglia, la Comédie-Française lui consacre une exposition et reprend triomphalement Les Corbeaux, qui sont même inscrits au programme de l’agrégation ! Sa réputation d’artiste maudit lui vaut même d’être adoubé par les surréalistes. Breton raconte que Nadja avait pour habitude d’aller consulter, comme un oracle, le buste de Becque par Rodin, à l’angle de l’avenue de Villiers et du boulevard de Courcelles. Et quand les avis qu’elle rapportait lui était défavorables, Breton rétorquait : « Il est impossible que Becque, qui était un homme intelligent, t’ait dit cela. » C’est encore de cette époque que datent les rares thèses qui lui ont été consacrées.
14« Un éclair, puis la nuit13 ! » pourrait-on dire avec Baudelaire, car cette gloire tardive est aussi fragile et éphémère. Aujourd’hui, l’œuvre de Becque, complètement sortie des programmes scolaires et universitaires, rarement reprise sur de grandes scènes nationales, est à peu près tombée dans l’oubli. Les Honnêtes Femmes, qui ont été un temps la plus jouée de ses pièces, n’a pas été reprise depuis 1964, La Navette a été montée pour la dernière fois à la Comédie-Française en 1977, Les Corbeaux ont, certes, fait l’objet d’une mise en scène magistrale par Jean-Pierre Vincent à l’occasion de leur centenaire, en 1982, mais cette initiative est demeurée sans postérité. En réalité, La Parisienne poursuit seule la carrière de Becque à la scène, surtout dans les théâtres privés (le Théâtre des Mathurins en 2003 ; le Théâtre-Montparnasse en 2010), qu’attire sans doute la dimension boulevardière de l’intrigue triangulaire. Au final, la figure de l’oxymore est sans doute celle qui permet le mieux de rendre compte de l’étrange destinée de Becque : comme l’écrit Mirbeau, Les Corbeaux et La Parisienne sont « deux chefs-d’œuvre inconnus14 », dont l’auteur, mort dans une « triomphante obscurité15 », n’aura connu qu’une gloire ténébreuse.
1 Louis Jouvet, « la disgrâce de Becque », La Revue hebdomadaire, no 32, 10 août 1935.
2 Jules Wogue, « Le théâtre de Henry Becque », La Grande Revue, 1er juin 1899, p. 605.
3 Samuel Beckett, Fin de partie, Paris, Éditions de Minuit, 1957, p. 48.
4 Jean Jullien, « Le Théâtre vivant », Le Théâtre vivant, essai théorique et pratique, Paris, Charpentier, 1892, p. 11.
5 Émile Zola, Le Naturalisme au théâtre, Paris, Charpentier, 1881, p. 236.
6 Acte I, scène 1.
7 Octave Mirbeau, Gil Blas, 26 décembre 1886.
8 Jules Barbey d’Aurevilly, Le Théâtre contemporain, 1870-1883, Paris, Tresse et Stock, t. I, p. 7.
9 Henry Becque, Œuvres complètes, Théâtre, Paris, Éditions G. Crès & Cie, 1924, t. 2, p. 339.
10 Molière, Dom Juan, acte II, scène 3.
11 Molière, Tartuffe, acte I, scène 5, v. 278-279.
12 Acte I, scène 1.
13 Charles Baudelaire, « À une passante », Les Fleurs du mal (1861), Paris, Poésie Gallimard, 1972, p. 134.
14 Octave Mirbeau, Le Figaro, 29 novembre 1890, repris dans Gens de théâtre, Paris, Flammarion, 1924, p. 65.
15 Ibid.
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en mai 2019, publiés par Marianne Bouchardon
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 27, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1063.html.
Quelques mots à propos de : Marianne Bouchardon
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
