Sommaire
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
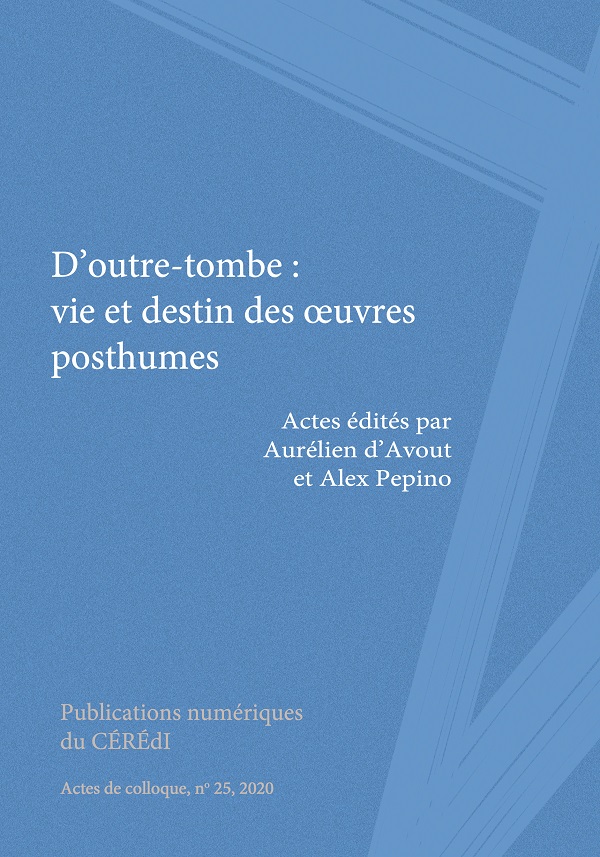
- Aurélien d’Avout et Alex Pepino Introduction
- Hugues Pradier Comment continuer à grandir un peu une fois mort
- David Soulier L’Examen d’André Vésale (1564) : un débat d’anatomie manqué
- Tony Gheeraert « Ruines de Palmyre ». Les Pensées de Pascal ou le deuil impossible
- Yves Ansel Travailler à sa survie : le cas Stendhal
- Diane Garat « D’un monsieur qui écrit de l’au-delà » : La Lettre écarlate (1850) de Nathaniel Hawthorne (1804-1864), œuvre « posthume » ?
- Gwenaëlle Sifferlen Publier les Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, une aventure éditoriale singulière
- Yvan Leclerc « Ici s’arrête le manuscrit de Gustave Flaubert » : œuvres posthumes et inédites
- Antoine Piantoni « Lieu sans routes où cheminent fixement les yeux du mort » : la survie éditoriale de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin
- Sébastien Bost Faire jouer la transparence d’une femme en noir : les mémoires de Barbara à l’épreuve du posthume
- Mara Capraro Une trahison « reconstructrice » : la réhabilitation posthume de L’Art de la joie de Goliarda Sapienza en France
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
Faire jouer la transparence d’une femme en noir : les mémoires de Barbara à l’épreuve du posthume
Sébastien Bost
1À l’automne 1998, la publication posthume des mémoires de Barbara1 crée l’événement.
2Dans le champ d’étude des œuvres posthumes, il convient de distinguer trois cas de figure : l’œuvre envisagée dès sa genèse par l’auteur comme devant être publiée après sa mort ; la production à caractère privé ou non destinée à la publication, que l’on exhume néanmoins après la mort de l’auteur pour enrichir la compréhension de son œuvre ; celle qu’un auteur compte publier de son vivant mais dont l’élaboration est interrompue par sa mort et qui est finalement présentée au public dans un état d’inachèvement. Les Mémoires Interrompus de Barbara appartiennent à cette troisième catégorie.
3La chanteuse est en 1998 une figure très connue du grand public. Première femme auteur-compositeur-interprète de l’histoire de la variété française2, elle est considérée comme une artiste majeure du xxe siècle, une sorte de monument patrimonial au même titre qu’Édith Piaf dont elle fait figure d’héritière, surtout après son triomphe à l’Olympia en 1968, et plus encore après l’immense succès populaire de L’Aigle noir qui, au début des années 1970, lui a permis d’élargir un public jusqu’alors constitué d’amateurs de chansons à texte, habitués des cabarets « rive gauche ». La publication de ses mémoires suscite d’autant plus l’intérêt et la curiosité que Barbara, privilégiant la scène et construisant avec son public une relation intime et forte, n’apparaissait jamais dans les médias, au risque de passer pour une femme étrange et mystérieuse alors qu’elle menait simplement en dehors des tournées une vie discrète et répugnait à se confier sur sa vie personnelle, considérant que tout ce qu’elle avait à dire sur elle était dans ses chansons et qu’elle n’avait rien à ajouter.
4Son livre répond aussi à une attente dans la mesure où il répare le lien brisé avec le public un an auparavant par sa mort prématurée3 : il comble un manque, le vide ressenti par des milliers d’inconditionnels depuis son départ. « Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. […] Écrire, aujourd’hui, est un moyen de continuer le dialogue » écrit-elle4 dans le texte liminaire qui tient lieu de pacte autobiographique. Sans en avoir peut-être conscience, elle explique ici le pouvoir d’une œuvre posthume de ressusciter son auteur, à tout le moins de perpétuer, de pérenniser sa présence parmi nous.
5Mais si la publication d’Il était un piano noir crée l’événement, c’est surtout parce que Barbara y révèle dès les premières pages avoir été victime d’inceste dans son enfance, révélation rapidement diffusée dans les médias pour promouvoir la sortie du livre. Je voudrais mettre en avant le caractère problématique de cette révélation pour interroger plus largement la réception parfois hasardeuse d’une œuvre posthume, à laquelle on peut faire tenir, même en toute bonne foi et sans esprit malveillant, des propos éloignés des intentions de départ de son auteur, qu’il rectifierait sans doute s’il pouvait de vive voix préciser sa pensée et ses motivations.
6Barbara consacre une large partie de son livre à raconter sa trajectoire d’auteur-compositeur-interprète autodidacte, inscrite comme l’exige le genre des mémoires dans une époque – la guerre, l’après-guerre et les Trente Glorieuses – dont elle reconstitue avec saveur l’atmosphère. Elle donne de nombreuses explications sur sa manière d’écrire et de « travailler » une chanson, sur les coulisses de ses spectacles et de ses tournées, et livre des réflexions très personnelles sur son métier et son ethos de « femme qui chante5 ». L’ouvrage, à visée d’abord esthétique, a beau être d’une grande richesse informative, on n’en retient vite sur cent trente pages que les vingt lignes dans lesquelles elle révèle avoir été abusée par son père dans la tourmente de la guerre6 :
J’ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait.
J’ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler ? Et que lui dire ? Que je trouve le comportement de mon père bizarre ? Je me tais.
Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l’horreur. J’ai dix ans et demi.
Les enfants se taisent parce qu’on refuse de les croire.
Parce qu’on les soupçonne d’affabuler.
Parce qu’ils ont honte et qu’ils se sentent coupables.
Parce qu’ils ont peur.
Parce qu’ils croient qu’ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret.
De ces humiliations infligées à l’enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j’ai toujours resurgi. Sûr, il m’a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d’être heureuse, une sacrée volonté d’atteindre le plaisir dans les bras d’un homme, pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après.
J’écris cela avec des larmes qui me viennent.
C’est quoi, ces larmes ?
Qu’importe, on continue7 !
7Il est bien sûr légitime de prendre en considération ce passage pour éclairer le parcours de vie de Barbara, a fortiori son parcours d’artiste. Une critique d’inspiration psychanalytique s’en empare aussitôt pour enrichir la compréhension de son répertoire. On exhume par exemple l’un de ses albums enregistré dans les années 1970 intitulé Amours Incestueuses ; on réécoute différemment plusieurs de ses chansons, notamment Attendez que ma joie revienne8, Mon Enfance9 et surtout Nantes, premier grand succès écrit au début des année 1960, évoquant la mort de son père. Barbara y confie son désarroi d’être arrivée trop tard à son chevet alors qu’il agonisait sur un lit d’hôpital ; faute d’avoir été prévenue à temps10, elle n’a pu répondre à son appel et lui accorder le pardon qu’il réclamait peut-être :
25 rue de la Grange-aux-Loups
Je m’en souviens du rendez-vous
Et j’ai gravé dans ma mémoire
Cette chambre au fond d’un couloir
Assis près d’une cheminée
J’ai vu quatre hommes se lever
La lumière était froide et blanche
Ils portaient l’habit du dimanche
Je n’ai pas posé de question
À ces étranges compagnons
J’ai rien dit mais à leur regard
J’ai compris qu’il était trop tard
Pourtant j’étais au rendez-vous
25 rue de la Grange-aux-Loups
Mais il ne m’a jamais revu
Il avait déjà disparu
Voilà tu la connais l’histoire
Il était revenu un soir
Et ce fut son dernier voyage
Et ce fut son dernier rivage
Il voulait avant de mourir
Se réchauffer à mon sourire
Mais il mourut à la nuit même
Sans un adieu sans un je t’aime
8On se souvient alors que l’écrivain Marie Chaix, dans un livre publié à la fin des années 1980, c’est-à-dire du vivant de Barbara, avait déjà opéré des rapprochements entre Nantes, Au Cœur de la nuit et L’Aigle noir11, trois chansons formant selon elle un triptyque autour de la figure paternelle. Difficile en effet, dans Au Cœur de la nuit, de ne pas voir dans la présence que Barbara dit sentir une nuit à la porte de sa chambre l’âme errante de son père cherchant à expier son crime :
Soudain je me suis éveillée
Il y avait une présence
Soudain je me suis éveillée
Dans une demi-somnolence
C’était au-dehors on parlait
À voix basse comme un murmure
Comme un sanglot étouffé
Au-dehors j’en étais sûre
J’ai souvenir qu’une nuit
Une nuit de mon enfance
Toute pareille à celle-ci
Froide et lourde de silence
J’allais à demi éveillée
Longeant une allée obscure
J’allais à demi-éveillée
Guidée par l’étrange murmure
[…]
Qui es-tu pour me revenir
Quel est donc le mal qui t’enchaîne
Qui es-tu pour me revenir
Et veux-tu que vers toi je vienne ?
9Trois ans plus tard dans L’Aigle noir, la scène semble se reproduire :
Un beau jour ou peut-être une nuit
Près d’un lac je m’étais endormie
Quand soudain semblant crever le ciel
Et venant de nulle part
Surgit un aigle noir
[…]
De son bec il a touché ma joue
Dans sa main il a glissé son cou
C’est alors que je l’ai reconnu
Surgissant du passé
Il m’était revenu.
10Selon Philippe Grimbert, l’aigle représente le père de Barbara et, dans sa chanson qui évoquerait l’inceste, l’artiste « détaillerait le […] souvenir de ses noces noires avec l’oiseau couronné, tentative poétique de faire définitivement le deuil de l’événement traumatique ou du moins d’en assurer la maîtrise12. » Pour étayer son raisonnement, il ajoute : « Je pense que le message le plus profond de la chanson pourrait se résumer en cela : mon père a déchu, mon père s’est livré à un acte qu’il n’aurait jamais dû faire, j’ai besoin d’en faire une rêverie, un poème, une chanson, de façon à essayer de reconstruire ce personnage tel qu’il était avant13. »
11Il n’est pas question de remettre en cause la pertinence d’une telle analyse. Le problème réside plutôt dans l’emballement herméneutique qu’involontairement elle autorise. Car la tentation est grande, et on n’a pas manqué d’y céder, de relire toutes les chansons de Barbara comme des messages cryptés faisant référence à l’inceste, bientôt érigé comme principale clé d’interprétation de tout son répertoire. S’agissant de L’Aigle noir, ce parti pris est d’autant plus regrettable qu’il épuise la richesse d’un texte susceptible de nombreuses autres approches : Bertrand Dicale et André Manoukian ont par exemple rappelé qu’on pouvait voir dans la figure du rapace « une métaphore de la menace de l’extrême-droite sur la France […], le retour du patriarcat dans une société où les femmes se libèrent, la nature qui proteste contre sa destruction par la civilisation moderne14… »
12Boris Cyrulnik prend aussi appui sur la révélation de l’inceste pour faire de Barbara un modèle de résilience, artiste ayant surmonté ses drames grâce à la chanson, outil cathartique par excellence15. Là encore, il ne s’agit pas de contester l’intérêt d’une telle appréciation mais son hégémonie, comme s’il n’était désormais plus possible de considérer Barbara autrement que comme la pauvre petite fille violée devenue chanteuse pour se libérer d’un passé traumatisant. On mesure ici toute l’ambiguïté d’une publication posthume qui d’un côté enrichit rétrospectivement l’étude d’une œuvre et d’une vie, mais de l’autre les appauvrit en les réduisant à une unique grille de lecture. Une publication posthume, si elle ouvre des perspectives, peut aussi malgré elle fermer des portes.
13Barbara était suffisamment intelligente pour mesurer l’impact de son livre, rédigé en pleine possession de ses moyens. Pour autant, il faut garder à l’esprit qu’elle n’a pu en achever l’écriture ni en assurer elle-même la publication. Interrompu par son décès brutal, le manuscrit que nous lisons aujourd’hui ne correspond sûrement pas à la version définitive qu’elle aurait souhaité faire éditer : ses frères et sœur, ayants droit, précisent d’ailleurs, dans un avant-propos, qu’elle l’aurait, comme à son habitude, remanié sans cesse. Respectant l’avancée de son travail, ils l’ont divisé en deux parties très différentes : la première, intitulée « récit inachevé », présente la première mouture d’un long texte assez travaillé consacré à son enfance et à ses débuts, envoyé quelques jours avant sa mort chez Fayard pour relecture ; la seconde, intitulée « fragments », juxtapose des notes, des textes ou ébauches de chapitres en cours d’élaboration. À la mort de Barbara, son manuscrit toujours « en chantier » est donc publié comme tel, ce qui place notre lecture sous le signe de l’aléatoire, presque de l’effraction : il est bon de s’en souvenir chaque fois que l’on brandit le viol et l’inceste pour prétendre tout comprendre d’elle.
14D’ailleurs, si l’on relit attentivement dans la partie « récit inachevé » le passage qui nous intéresse et qui a tant fait couler d’encre, on s’aperçoit que Barbara a pris toutes les précautions pour ne pas voir son œuvre et sa vie réduites au drame de son enfance. Le mot « inceste » n’est ainsi jamais écrit, et on ne le trouve nulle part dans son livre ni dans les quelques brouillons dont disposent aujourd’hui sa famille et l’association Barbara Perlimpinpin. Plusieurs périphrases – « horreur », « humiliations », « hautes turbulences » – lèvent certes toute ambiguïté sur la nature des actes commis par son père (et réitérés si l’on se fie à l’emploi du pluriel), mais Barbara ne les nomme pas et n’en précise bien sûr pas le détail. Que l’on songe pourtant un instant à tout ce que les points qui séparent les phrases suivantes contiennent de douleur :
Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l’horreur. J’ai dix ans et demi.
Les enfants se taisent parce qu’on refuse de les croire16.
15Je vois dans cet art maîtrisé de l’ellipse et de l’implicite l’expression chez Barbara d’une déchirure entre la nécessité de dire et la pudeur de garder pour elle seule cette part de passé intime et violente qui lui appartient, la volonté surtout d’en signifier le dépassement. Dire par le non dire, c’est rétablir un fait tout en le mettant à distance, c’est plutôt que d’en faire resurgir le caractère traumatique en le nommant, montrer que l’on s’en est au contraire émancipé17, que ses effets dévastateurs ont été depuis longtemps conjurés, qu’il n’est donc pas utile ni pertinent de toujours nous y ramener : « Qu’importe, on continue ! » prend-elle soin d’écrire cette fois en toutes lettres. Et c’est dans le seul but de délivrer ce message positif que selon moi Barbara se résout à lever pudiquement le voile sur l’épisode terrible qui a marqué son enfance.
16Elle opère en deux temps. D’abord elle cherche à diriger l’attention des lecteurs sur les êtres vulnérables dont les appels à l’aide ne sont pas pris en compte : plutôt que de s’épancher sur son expérience personnelle et de céder à la victimisation, elle passe ainsi très vite et sans transition du « je » aux « enfants ». Il est vrai qu’elle-même a essuyé l’indifférence de son entourage au temps de « l’horreur », celle de sa mère qui semble n’avoir jamais compris le drame qui se jouait dans sa famille, celle de la société surtout, incarnée par des brigadiers de gendarmerie qui la sermonnent et lui intiment de rentrer sagement chez elle lorsqu’elle leur demande secours18. Barbara révèle donc ce qui lui est arrivé pour éveiller les consciences, lever un tabou qui ronge, elle le sait, de nombreuses familles et alerter sur la nécessité de « vigiler », néologisme qu’elle crée et utilise régulièrement pour désigner le devoir d’attention et d’assistance que l’on doit aux autres, notamment lorsqu’ils se murent dans le silence, un silence qui ne doit pas tromper sur la détresse qu’ils éprouvent à coup sûr.
17Barbara ne cède néanmoins pas à la facilité de nous faire la morale. Dans un deuxième temps, c’est pour donner du courage aux nombreux laissés-pour-compte qui constituent une large partie de son public – proscrits, détenus, malades du sida, femmes battues, adolescents en proie au mal de vivre, gens souffrant de solitude – qu’elle ose révéler ce qui lui est arrivé. Son but n’est pas d’affirmer qu’elle est devenue chanteuse parce qu’ayant été violée elle avait en quelque sorte une revanche à prendre sur la vie, mais plutôt d’expliquer que le drame de son enfance ne l’a pas détournée du rêve qu’elle avait depuis toute petite de devenir artiste, qu’il n’a en rien compromis ses chances de le réaliser, et que comme elle nous pouvons nous aussi atteindre nos objectifs et mener une vie heureuse quel que soit notre passé. À aucun moment dans son livre elle ne dit s’être réfugiée dans la chanson pour guérir ses blessures d’enfance et se reconstruire ; sans doute ces blessures ont-elles influencé sa création et son répertoire, mais jamais elle ne le suggère, préférant mettre en avant « une sacrée envie d’être heureuse » et sa volonté de réussir en tant qu’artiste, forces qui l’animent et lui tiennent lieu, selon elle, de destin.
18On a souvent présenté Barbara, à l’instar de Damia, Fréhel et Piaf, comme une tragédienne de la chanson. C’est à mon avis une erreur. Barbara n’est pas du côté de la tragédie : elle exprime certes les maux de l’existence – Le Mal de vivre, La Solitude, La Mort, Les Insomnies… – mais propose toujours un dépassement constructif en postulant que notre volonté, notre élan vital, dans son cas « l’ouragan et la rage de vivre », « le torrent et la force de vivre » qu’elle concrétise dans sa « folie de chanter19 », peuvent faire plier la fatalité. Si elle compare à plusieurs reprises son métier à celui d’une assistante sociale20, c’est parce qu’elle chante avant tout pour redonner confiance : après « l’angoisse qui nous tient », « ce mal de vivre qu’il faut bien vivre vaille que vivre », revient toujours « sans prévenir » la joie de vivre21 :
Quand tu ne crois plus
Que tout est perdu
Quand trompé déçu meurtri
Quand assis par terre
Plus rien pouvoir faire
Tout seul dans ton désert
Quand mal trop mal
On marche à genoux
[…]
N’oublie pas
Que l’aube revient quand même
Même pâle le jour se lève encore
[…]
Même si tout semble fini
N’oublions jamais
Qu’au bout de la nuit
Doucement l’aube revient quand même
Même pâle le jour se lève encore
Tu verras le jour se lève encore
Étonnés
On reprend le corps à corps
On continue
Le soleil se lève encore22.
19« Qu’importe, on continue ! » Là gît le message essentiel de Barbara, formulé dans une chanson et sur scène avant d’être fixé par écrit dans ses mémoires posthumes, la pudique évocation de son drame personnel n’étant là que pour lui donner toute sa légitimité, toute sa puissance.
Discographie
20Barbara, Comme un soleil noir : intégrale 1955-1996, Mercury / Universal, 2017. Réalisée à l’occasion du vingtième anniversaire de la disparition de Barbara, cette intégrale de 22 CD reconstitue la chronologie de tous ses enregistrements en studio (tous formats et toutes maisons de disques confondus), y compris l’enregistrement inédit de l’album studio Lily Passion. Autre inédit : l’enregistrement du concert donné au Théâtre des Capucines le 5 novembre 1963, date de la création de Nantes. Figurent aussi dans cette intégrale le Musicorama donné à L’Olympia en 1968, le spectacle donné à Pantin en 1981, l’enregistrement des Lettres à un jeune poète de Rilke réalisé en 1991 pour les éditions Claudine-Ducaté et de nombreuses archives sonores.
Bibliographie
21Barbara, Il était un piano noir… mémoires interrompus, Paris, Fayard, 1998.
22Barbara, À Cœur qui bat, à cœur battant, l’intégrale des chansons, édition publiée sous la direction de Joël July, Paris, L’Archipel, 2017.
23Chaix Marie, Barbara, Paris, Calmann-Lévy, 1986.
24Cyrulnik Boris, Les Vilains petits canards, Paris, Odile Jacob, 2001.
25Dicale Bertrand et Manoukian André, « L’Aigle noir », dans La Vie secrète des chansons françaises, Vanves, Chêne E/P/A, 2016, p. 212-217.
26Garcin Jérôme, Barbara, Claire de nuit, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2002.
27Grimbert Philippe, « “L’Aigle noir” ou l’impair d’un père », dans Chantons sous la psy, Paris, Hachette, 2002, p. 59-71.
28July Joël, « L’espace autobiographique de Barbara ou les signes en chanson de la seiche », dans ATeM (Archives Texte et Musique), no 1, 2016.
29Lehoux Valérie, Barbara : Portrait en clair-obscur, Paris, Fayard, 2007.
30Millot Didier, Et je signe… Barbara, Paris, Artena, 2007.
Document radiophonique
31Barbara en noir et blanc. Série de neuf émissions produites par Francis Legault pour les Radios Francophones Publiques, qui présente de nombreux témoignages d’artistes et de proches de Barbara ainsi que des interviews de la chanteuse puisées dans les archives de Radio France, Radio Télévision Suisse (RTS), Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) et Radio-Canada, diffusées sur France Inter du 1er juillet au 25 août 2012, © RFP, 2012.
1 Barbara, Il était un piano noir… mémoires interrompus, Paris, Fayard, 1998.
2 Avec Nicole Louvier et Anne Sylvestre qui ont comme elle débuté au début des année 1950.
3 Barbara succombe à une intoxication alimentaire le 24 novembre 1997 à l’âge de 67 ans.
4 Barbara, op. cit., p. 9-10.
5 Périphrase inscrite sur le programme de son Olympia 1969 et qu’elle utilise tout au long de sa vie pour se définir.
6 L’enfance de Barbara, née en 1930, coïncide avec les années de l’Occupation. D’origine juive alsacienne par son père, moldave par sa mère, elle connaît l’exode avec ses parents, son frère aîné et sa sœur, échappant plusieurs fois à des dénonciations, mais aussi au bombardement d’un train dans la plaine de Châtillon-sur-Indre durant l’été 1940 ; elle est également témoin en 1943 dans le Vercors de l’arrestation et de l’exécution d’un maquisard à qui elle dédie la chanson Il me revient, enregistrée sur son dernier album en 1996. Album Barbara, Philips, 534 269-2, 1996.
7 Barbara, Il était un piano noir… mémoires interrompus, op. cit., p. 31-32.
8 « J’attendrai que ma joie revienne / Et que soit mort le souvenir / De cet amour de tant de peine / Pour lequel j’ai voulu mourir / La voix que j’entends c’est la sienne / Ils sont vivants mes souvenirs / Le passé ne veut pas mourir. »
9 « Il ne faut jamais revenir / Au temps caché des souvenirs / Du temps béni de son enfance / Car parmi tous les souvenirs / Ceux de l’enfance sont les pires / Ceux de l’enfance nous déchirent. »
10 Jacques Serf quitte brutalement le foyer familial en 1949, laissant sa femme seule avec leurs quatre enfants ; il disparaît sans donner d’explications ni de ses nouvelles jusqu’à ce que, dix ans plus tard, l’hôpital de Nantes contacte Barbara pour l’informer de son décès.
11 Marie Chaix, Barbara, Paris, Calmann-Lévy, 1986, p. 69-70. Sœur d’Anne Sylvestre, l’auteure a été l’assistante de Barbara de 1966 à 1969. Elle préside aujourd’hui l’association Barbara Perlimpinpin qui gère le patrimoine artistique de la chanteuse avec le soutien des ayants droit.
12 Philippe Grimbert, « “L’Aigle noir” ou l’impair d’un père », dans Chantons sous la psy, Paris, Hachette Littératures, 2002, p. 70.
13 Témoignage extrait de Barbara en noir et blanc : « la femme ». Septième des neuf émissions produites en 2012 par Francis Legault pour les Radios Francophones Publiques.
14 Bertrand Dicale et André Manoukian, La Vie secrète des chansons françaises, Vanves, Chêne E/P/A, 2016, p. 212.
15 Boris Cyrulnik popularise au début des années 2000 le principe de résilience en tant que disposition psychologique d’un individu à trouver dans ses traumatismes de quoi nourrir sa volonté et développer des ressources pour se reconstruire et aller de l’avant. Dans Les Vilains petits canards (Paris, Odile Jacob, coll. « Poches/psychologie », 2004), il prend de nombreux exemples à l’appui de sa démonstration, parmi lesquels Barbara, citée dès le début de l’introduction.
16 Voir supra, note 7.
17 Barbara, rappelons-le, s’appelle en réalité Monique Serf. En choisissant elle-même son nom de scène, en l’imposant dès ses débuts dans les années 1950 alors qu’elle n’a pas encore de répertoire et laisse sceptiques à la fois public et gens de métier, elle accomplit un acte à forte dimension symbolique : d’une part elle marque sa volonté de s’affranchir d’un passé douloureux, d’une famille que des drames intimes ont fait éclater, de l’autre elle s’affirme comme une femme libre, singulière, qui agit selon ses propres codes. Nom de scène performatif qui sonne comme une déclaration d’indépendance : dans « Barbara », on entend bien sûr « la barbare », c’est-à-dire celle qui au sens étymologique du terme se distingue des autres par son langage, ses principes et son caractère et bouscule ainsi l’ordre établi.
18 Au cours de l’été 1946, à Trégastel où adolescente elle passe quelques jours de vacances avec ses parents.
19 Expressions extraites du Soleil noir (1968) et de Monsieur Victor (1981).
20 « J’exerce un métier d’assistante sociale qui essaie d’apaiser les tourments de chacun avec des mots, des musiques et une voix. », L’Aurore, 24 janvier 1975.
21 Extraits de La Ligne droite (1973, coécrite avec Georges Moustaki) et du Mal de vivre (1965).
22 Extrait du Jour se lève encore (1996).
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 25, 2020
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=871.
Quelques mots à propos de : Sébastien Bost
Université François-Rabelais de Tours
ICD – EA 6297
