Sommaire
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
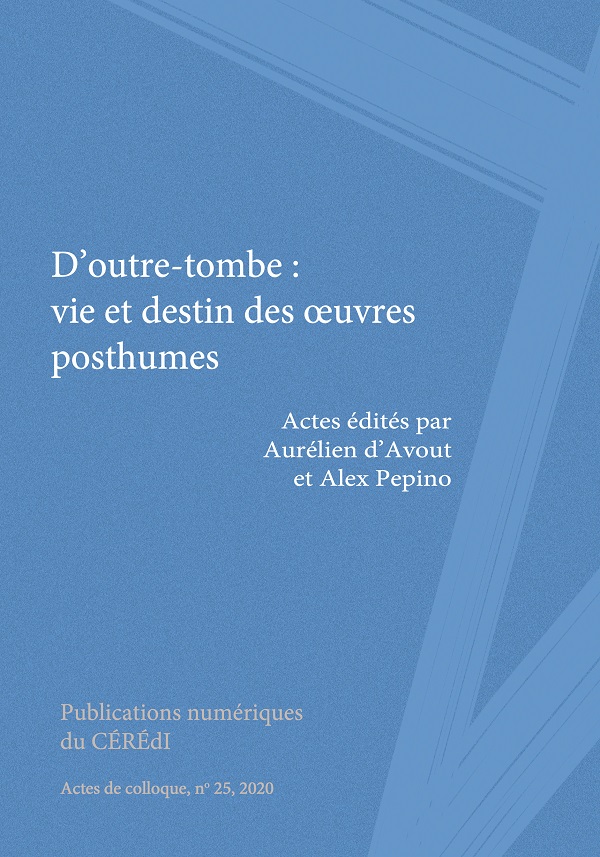
- Aurélien d’Avout et Alex Pepino Introduction
- Hugues Pradier Comment continuer à grandir un peu une fois mort
- David Soulier L’Examen d’André Vésale (1564) : un débat d’anatomie manqué
- Tony Gheeraert « Ruines de Palmyre ». Les Pensées de Pascal ou le deuil impossible
- Yves Ansel Travailler à sa survie : le cas Stendhal
- Diane Garat « D’un monsieur qui écrit de l’au-delà » : La Lettre écarlate (1850) de Nathaniel Hawthorne (1804-1864), œuvre « posthume » ?
- Gwenaëlle Sifferlen Publier les Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, une aventure éditoriale singulière
- Yvan Leclerc « Ici s’arrête le manuscrit de Gustave Flaubert » : œuvres posthumes et inédites
- Antoine Piantoni « Lieu sans routes où cheminent fixement les yeux du mort » : la survie éditoriale de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin
- Sébastien Bost Faire jouer la transparence d’une femme en noir : les mémoires de Barbara à l’épreuve du posthume
- Mara Capraro Une trahison « reconstructrice » : la réhabilitation posthume de L’Art de la joie de Goliarda Sapienza en France
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
Travailler à sa survie : le cas Stendhal
Yves Ansel
1S’il est un écrivain qui répond idéalement au thème du colloque, c’est bien Stendhal. Non seulement parce que l’écrivain a été révélé par la postérité, mais parce que la moitié au moins de ses écrits a été publiée après sa mort. Et quelle moitié ! Non les fonds de tiroir inexploités des auteurs célèbres dont on publie « tout » à des fins éditoriales plus ou moins intéressées, mais d’authentiques chefs-d’œuvre. Lucien Leuwen, la Vie de Henry Brulard et Lamiel, pour ne parler que de ces trois écrits restés dans des dossiers, ne sont pas des « restes », mais des sommets, des « géants1 ». Kafka excepté, quel autre écrivain pour avoir laissé inachevés et impubliés des écrits de cette qualité ? Même si bien des hommes de plume meurent sans avoir songé à faire paraître toutes leurs productions (Flaubert se refuse à publier ses écrits de jeunesse, parce qu’il n’en est pas satisfait, et il n’a certes jamais pensé que ses lettres puissent être un jour rendues publiques), même s’il reste toujours des inédits (en chantier ou définitivement abandonnés) à la mort des écrivains, l’auteur de La Chartreuse de Parme reste tout de même « un cas d’école ».
Pourquoi tant d’œuvres posthumes ?
2À considérer l’ensemble du corpus stendhalien, la première question qui ne peut manquer de se poser est : à quoi doit-on tant d’œuvres posthumes ? Quatre grandes raisons à cela.
3a) Stendhal n’est ni Flaubert (un rentier qui a le temps de peaufiner ses phrases à loisir) ni Victor Hugo, Alexandre Dumas ou George Sand (qui vivent de leur plume) : il n’est que temporairement un écrivain à temps plein (de 1814 à 1830). Toute la durée de son emploi au service de l’Empereur (1806-1814), Beyle écrit, mais ne publie rien. Pourquoi le ferait-il ? L’homme vit dans l’aisance, mène grand train, fait des dettes, et ne s’inquiète pas de l’avenir, persuadé que son père va lui laisser un héritage conséquent. C’est quand il « tombe » avec Napoléon en 18142 et qu’il se retrouve tout à la fois démobilisé et désargenté que Beyle, désoccupé, songe enfin à « imprimer » (les Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase, 1815, et l’Histoire de la peinture en Italie, 1817, sont publiés à compte d’auteur)3. Plus tard, après que, chassé d’Italie par la police de Metternich en 1821, il revient à Paris avec seulement une petite rente et sa demi-solde pour vivre (car son père, Chérubin Beyle, n’a rien laissé à sa mort en 18184), Stendhal écrit et publie « for money » et sans discontinuer (cette période est la plus productive de sa vie d’écrivain). En 1831, quand il retrouve un emploi stable (consul à Civita-Vecchia), il écrit quand « l’officiel » ne l’occupe pas tout entier, et il écrit sans vraiment songer à publier. De là une production égrenée, très irrégulière, de là aussi tous ces écrits abandonnés sans autre raison que celle-ci : disposant de revenus suffisants, rien ne pousse Beyle à achever ce qu’il écrit, à publier, et ce dernier peut donc royalement se permettre de laisser en plan ce qu’il a en chantier, sans préavis et sans regret. C’est ainsi que les Souvenirs d’égotisme s’achèvent brutalement sur cette notation : « La chaleur m’ôte les idées à 1 heure et demie5 », et que la Vie de Henry Brulard est stoppée, coupée court, à la suite de l’obtention d’un congé pour Paris : « annonce du congé for Lutèce. L’imagination vole ailleurs ; ce travail en est interrompu6. »
4b) Par définition, en mettant à part la correspondance privée et le journal intime (écrits non destinés à la publication), ce sont naturellement les écrits abandonnés, partant non imprimés, qui constituent le fonds essentiel des œuvres posthumes d’un écrivain. Or le fait est notoire : « La part de l’inachèvement est immense dans l’œuvre de Stendhal. […] il n’est pas excessif de dire qu’un destin de mutilation pèse sur l’essentiel de cette œuvre7. » De nombreuses raisons, toutes plus judicieuses les unes que les autres, ont été avancées pour expliquer cet « immense » part d’inachèvement, mais ce sont toujours les états de santé (maladies physiques, fatigue, déboires sentimentaux, états dépressifs, etc.) ou la psychologie (perte de l’élan créateur, déficit d’invention, paresse et découragement, etc.8) qui se retrouvent chargés de rendre compte de cette prétendue propension stendhalienne à laisser tomber une foule de textes en cours, jamais les contraintes matérielles pesant sur l’écriture, lesquelles sont pourtant absolument déterminantes – éclairantes. Il suffit de mettre en regard les œuvres et la vie (non pas la passion de Dominique pour l’amour, la musique, les idées, les voyages, etc., mais, plus prosaïquement, la vie sociale, la fonction officielle de Beyle en poste à Civita-Vecchia) du consul pour trouver et comprendre la matérialiste origine de ce mystérieux « destin de mutilation ». Lorsqu’il rentre en France en 1821 et qu’il lui faut trouver de l’argent pour améliorer son quotidien (la vie à Paris est nettement plus chère qu’à Milan), Stendhal écrit, finit, et publie allègrement de nombreux ouvrages (De l’amour, 1822 ; Vie de Rossini, 1823 ; Racine et Shakespeare, 1823, 1825 ; Rome, Naples et Florence, 1827 ; Armance, 1827 ; Promenades dans Rome, 1829 ; Vanina Vanini, 1829 ; Le Rouge et le Noir, 1830), dans le même temps qu’il alimente régulièrement les revues anglaises (de 1822 à 18299) et collabore au Journal de Paris (rubriques musique10 et peinture11, de 1824 à 1827). Durant toute cette période d’intense activité littéraire, très manifestement, aucune « mutilation » particulière ne « pèse » sur les écrits : les textes achevés et printed se ramassent à la pelle, les textes inachevés sont minoritaires, rarissimes même (Mina de Vanghel, déc. 1829-janv. 1830, est le seul texte de quelque ampleur qui reste sans emploi). C’est que Beyle, totalement désoccupé (comme en témoigne le récit de ses longues journées parisiennes inactives, totalement « vides », dans Souvenirs d’égotisme) peut alors mener une vraie « vie d’écrivain12 », s’adonner à l’écriture à loisir, en toute liberté (celle que lui donne son existence de célibataire solitaire sans métier et sans attaches). Tout change lorsque l’homme obtient un poste de consul et que ce métier lui vole son temps, l’empêche d’écrire comme il veut, autant qu’il veut et quand il veut (lorsqu’il a « le feu ») :
J’ai commencé ceci [Lucien Leuwen] le 5 mai 1834. Mais pendant les courses de 2 mois à Albano je ne l’ai ouvert qu’une fois. Et le métier me saisit souvent dans le plus grand feu, comme mardi dernier pour me jeter pour 2 ou 3 jours dans le style officiel où je ne suis pas assez lourd13.
Toute la disposition de mon cœur était d’écrire un livre d’imagination sur une intrigue d’amour […], mais les petits devoirs de ma place m’interrompent assez souvent, ou, pour mieux dire, je ne puis jamais en prenant mon papier être sûr de passer une heure sans être interrompu. Cette petite contrariété éteint net l’imagination chez moi. Quand je reprends ma fiction, je suis dégoûté de ce que je pensais14.
5C’est après l’entrée dans « l’ornière administrative15 » que Stendhal se lance dans les récits courts (exigeant moins de suivi dans la rédaction, plus faciles à reprendre et à achever ; les nouvelles connues sous le nom de Chroniques italiennes bénéficient de ce choix contraint des formes brèves), dans les écrits autobiographiques (parce que ceux-ci, aux dires de l’auteur lui-même, sont moins accaparants qu’un « ouvrage d’imagination16 »), ne publie pratiquement rien (Vittoria Accoramboni, Les Cenci, 1837), commence et abandonne une très importante quantité de textes fictionnels. Les écrits inaboutis prolifèrent sous le consulat de Beyle, et la raison de ce foisonnement de l’inachèvement s’impose d’elle-même : ce sont les exigences du métier (et non quelque tropisme psychologique) qui conduisent à d’aussi nombreux essais sans suite. De 1814 à 1830, peines de cœur ou pas, aucune notable panne créatrice : les publications sont régulières, nombreuses, les écrits inachevés rares ; de 1831 à 1842, quand le consul est rémunéré et assigné à résidence, enchaîné à son poste (les deux écrits les plus substantiels de cette période consulaire : les Mémoires d’un touriste et La Chartreuse de Parme, écrits et publiés pendant le long congé de Beyle à Paris, trois ans, de mai 1836 à juillet 1839. Deux « petits faits vrais » clairs et nets : inutile de commenter), c’est l’inverse : publications rares, abandons à foison. Il apparaît que c’est dans la période consulaire seulement que le « destin de mutilation pèse » manifestement, et continûment, sur les écrits de Stendhal, et que ce « destin » est intimement lié au « métier » qui « pèse » de tout son poids sur l’écriture17. L’essentiel des œuvres posthumes de Stendhal, c’est au métier de consul qu’on les doit.
6c) Outre un métier prenant, une autre raison capitale explique l’importante proportion de textes inachevés dans le corpus stendhalien : l’irrésistible penchant de Stendhal pour les écrits polémiques, dérangeants, « stendhalisants », pour des sujets politiquement incorrects, parfois a priori impubliables, et, par conséquent, voués à demeurer inédits. Relèvent de cette catégorie d’ouvrages irrecevables, non publiables : Vie de Napoléon (1817-1818), Une position sociale (1832), Lucien Leuwen (1834-1835), Vie de Henry Brulard (1835-1836), écrits sulfureux, trop « politiquement incorrects », et restés en plan, inachevés à cause de la vétilleuse censure. Dans le « destin de mutilation » qui frappe l’œuvre stendhalienne, la « police » entre donc pour une part (et non la moindre)18.
7d) Dans le capitaliste commerce des « ouvrages de l’esprit » qui transforme les livres en marchandises (voir Illusions perdues), les éditeurs sont naturellement peu empressés de publier les œuvres d’une plume qui, en dépit d’une certaine notoriété (Vie de Rossini, Promenades dans Rome sont des ouvrages qui ont fait quelque bruit), ne fait pas recette. Fort peu de temps avant sa mort (le 23 mars 1842), Stendhal note : « Je n’ai pas de réputation en 184219. » Un constat désabusé, mais juste, comme le prouvent sans ambiguïté les contrats signés avec ses « libraires » (Didot, Egron, Delaunay, Mongie, Bossange, Sautelet), différents et nombreux parce que, sur le marché éditorial, Stendhal n’était pas une bonne affaire, si bien qu’aucun de ses éditeurs ne tenait à se l’attacher, à faire affaire avec un plumitif aussi peu rentable. L’auteur du Rouge et le Noir commençait tout juste à être une valeur sûre (le 15 mars 1842, il signe un accord avantageux – 5 000 francs : le plus fabuleux contrat d’auteur de sa carrière – avec la Revue des Deux Mondes), quand il est tombé dans la rue. C’est faute d’avoir toujours trouvé « preneur » que Stendhal, à sa mort, laisse autant d’œuvres non publiées ; les auteurs renommés (qui écrivent plus vite que leur ombre, et trouvent éditeurs avant qu’ait été écrite la moindre ligne), les auteurs « vendeurs » (Victor Hugo, Alexandre Dumas, Eugène Sue, George Sand, à l’époque, Jean d’Ormesson, aujourd’hui), eux, laissent peu à glaner après leur décès.
La fortune posthume de Stendhal : des billets de loterie « gagnants »…
8Ces nombreux inédits auraient pu le rester si Stendhal n’avait été exhumé en 1880. Qui a sorti Stendhal de l’ombre ? À quelles fins ? Dans quel ordre, ont été publié les inédits ? Autant de questions qui font de l’examen de la postérité de Stendhal un exemple « idéaltypique » (Max Weber), en tous points riche d’enseignements. Mais une telle « fortune posthume » (pour reprendre ici l’expression de Gustave Lanson) conduit à se poser cette autre question : l’auteur exhumé doit-il sa survie à la chance, à la seule postérité (bonne fée qui aurait réparé l’injustice faite à un génie méconnu), ou bien cette survie « réparatrice » n’a-t-elle pas été visée, recherchée, voire programmée par l’auteur lui-même ?
9On connaît l’idée que se fait Stendhal de la postérité, une « loterie » : « Nous écrivons au hasard chacun ce qui nous semble vrai, et chacun dément son voisin. Je vois dans nos livres autant de billets de loterie ; ils n’ont réellement pas plus de valeur20».
10L’écrivain avait parié sur la postérité : être lu en 188021, 190022, 193523, ou 200024. Par un heureux hasard sur lequel se sont extasiés bien des beylistes, « le lecteur de 1880 » fut exact au rendez-vous. Et ce, parce que, ainsi que l’a fait fort justement remarquer André Malraux, en ce temps-là, Stendhal est opportunément loué, stratégiquement glorifié, pour faire pièce au naturalisme :
La découverte de Stendhal fut à la fois celle d’un frère de Balzac, et d’un analyste immunisé contre le péché balzacien, c’est-à-dire contre l’héritage qui reliait Balzac à Zola. Un romancier pouvait donc n’être pas réaliste, sans être le contraire ? Et comment le public si distingué de Paul Bourget (souvent, d’Anna Karénine), n’eût-il pas exalté une analyse de l’amour aussi délicate que celle de La Chartreuse de Parme, alors qu’on mettait si haut l’analyse, l’amour et la délicatesse ? De même que Coupeau était né contre Jean Valjean, Stendhal ressuscitait contre Zola25.
11Alors, Stendhal devient visible, et lisible : d’une part, de grands noms (Hippolyte Taine, Paul Bourget, Barbey d’Aurevilly, Barrès) célèbrent à l’envi le talent d’un auteur très injustement ignoré ; d’autre part, la fin du siècle voit la publication de nombreux inédits (Casimir Stryienski publie le Journal en 1888, Lamiel en 1889, la Vie de Henry Brulard en 1890, les Souvenirs d’égotisme en 1893 ; Jean de Mitty publie Lucien Leuwen en 1894)26.
12Dans les vies et destins posthumes des œuvres de Stendhal, il y a d’abord eu ce premier déplacement en 1880 : du journaliste, du pamphlétaire, du dilettante amateur d’art et de musique, du connaisseur de l’Italie, de l’homme des salons (autant de facettes de l’homme de lettres parisien relativement connu de ses contemporains) au romancier (les deux « billets gagnants » : Le Rouge et La Chartreuse) et à l’homme même (révélé par la publication du Journal, des Souvenirs d’égotisme, de la Vie de Henry Brulard). Environ un siècle plus tard, autre décentrement (en cours) généré par « la critique des professeurs » (Albert Thibaudet) qui remanie une seconde fois le corpus stendhalien. Ce ne sont plus seulement les œuvres (désormais devenues) canoniques qui se trouvent placées sous les feux du projecteur académique, mais tous les écrits de la plume de Stendhal, « sans distinction ni hiérarchie27 », qui se trouvent passés au peigne fin, avec une surprenante et inédite valeur ajoutée accordée à ce qui est resté en plan(s), puisque, d’un strict point de vue génétique, Lamiel, roman ébauché, non publié, est plus… intéressant que Le Rouge, roman publié, texte fini (dont le manuscrit, de surcroît, a été détruit).
13Pourquoi ce déport de l’analyse vers des textes très mineurs (aucun inestimable « trésor » en vue, puisque les inédits importants de Stendhal ont tous été dévoilés et édités à la fin du xixe siècle, et que, dorénavant, pour emprunter à La Bruyère, « l’on ne fait que glaner » : les actuelles éditions d’inédits ratissent les fonds de tiroir, exhument des textes, des papiers, des marginalia sans grand intérêt, objectivement sans grande valeur littéraire), périphériques, marginaux ? Ni l’apparition d’un autre « outillage mental » (Lucien Febvre) ni les innovations technologiques (pas de critique génétique sans informatique) ni les mutations de l’œil historique (l’intérêt actuel pour les esquisses, « la fabrique du texte » ou le work in progress), ne suffisent à expliquer cet épidémique engouement pour les brouillons, ratures et variantes d’écrits informes. Car le sort réservé aux « inachevés » de Beyle est commun, statistique : tous les autres « grands auteurs » voient aussi des nuées de chercheurs fouiller dans les cartons, déterrer et gloser les textes les plus insignifiants, doctement disserter sur des riens. Depuis quelques lustres, l’étude des « restes » s’est en quelque sorte démocratisée, banalisée, et ce parce qu’elle répond à une forte demande institutionnelle : celle du grand nombre de doctorants peu ou prou forcés de se colleter avec des textes d’auteurs déjà infiniment commentés. Et comment diable produire un discours relativement neuf sur des écrivains aussi étudiés, aussi (par)courus que Voltaire, Flaubert, Stendhal, Baudelaire ou Apollinaire ? Réponse : en délaissant les écrits les plus célèbres, partant les plus souvent explorés (les plus « saturés »), pour se rabattre sur les textes mineurs, méconnus, ou, mieux encore : les inédits.
14« Les grands auteurs » ont produit de « grandes œuvres », mais aussi des petites, dévaluées ou négligées. Comme la postérité est hyper-sélective, quantitativement les « œuvres mineures » sont très majoritaires. De Stendhal, on connaît surtout Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme (et, séquelle pédagogique du formalisme, Vanina Vanini, courte nouvelle propice à une étude structurale en classe). Reste… tout le reste, qui est donc progressivement et systématiquement, exploré, exploité ou réédité : les voyages, la correspondance, les chroniques journalistiques, les journaux intimes et les textes autobiographiques, les Vies, les pamphlets, les essais, en attendant les futures publications « scientifiques » des malheureuses tentatives théâtrales, des journaux, papiers et travaux de jeunesse, etc. C’est dire s’il reste encore « du » Stendhal à inventorier, à prospecter, et nombreux sont ceux qui s’y emploient. Pour l’heure, s’il est difficile d’avoir du recul, d’évaluer quelles seront les retombées de l’immense travail éditorial des dernières décennies – qui n’a d’autre équivalent que celui qui avait contribué à la révélation de Stendhal à la fin du xixe siècle, au cours de ce que Philippe Berthier a justement appelé « les dix glorieuses (1889-1899)28 » –, une chose est d’ores et déjà sûre : on a touché à Stendhal.
15Ainsi considérée, l’extraordinaire postérité de Stendhal a l’air de tomber du ciel, de venir de l’extérieur : en 1880, parce que Stendhal peut être utile, peut faire de l’usage contre Zola, Paul Bourget fait l’apologie du « psychologue » et, de tout son poids plume, contribue à « ressusciter » l’auteur du Rouge et le Noir qui, depuis lors, est sorti du purgatoire, a définitivement échappé à l’oubli qui guette la majorité des écrits et des écrivains. Mais est-ce à dire qu’un livre est seulement une bouteille à la mer, que c’est la postérité qui tranche, que l’écrivain n’est pour rien dans le sort futur de ses œuvres ? Sans vouloir minimiser l’importance capitale du rôle du « lecteur de 1880 » dans la « découverte » de Stendhal, reste qu’il faut faire la part des choses, et rendre à César ce qui est à César, id est accorder à l’écrivain un rôle déterminant, reconnaître l’active part de travail qui lui revient dans la chance qui lui a souri, parce qu’il avait eu soin de truquer le jeu, de marquer les « billets gagnants ».
… ou des « billets » gagnés par calcul, par stratégie ?
16En dépit de la légende, pieusement, amoureusement colportée (et l’on voit bien le pourquoi de cette fiction intéressée : c’est une oblique manière d’attribuer aux lecteurs un mérite qui ne reviendrait pas à l’écrivain ; c’est, au fond, amplifier ingénument le rôle des mouches du coche – les professeurs –, légitimer l’existence même du beylisme, du stendhalisme, de « la critique des professeurs »), Stendhal n’a nullement été « révélé » en 1880 par hasard et par miracle. La postérité ne réimprime pas aveuglément les « billets gagnants » : les œuvres déclarées « gagnantes » ont en elles des ingrédients, des « conservateurs » qui retardent la date de péremption usuelle des écrits communs, lesquels vivent et meurent avec leur époque. De cela, Beyle, depuis toujours hanté par la gloire (« the fame » dans le Journal), taraudé dès ses premiers essais de « comic bard » (c’est ainsi qu’il se définit dans son journal, contemporain de ses tentatives d’écriture théâtrale) par le désir d’écrire des pièces immortelles, était particulièrement conscient, l’expert Stendhal s’est chargé lui-même de sa survie. Sa « fortune posthume », Stendhal l’a calculée, travaillée à mort. Il n’est que de voir sur pièces (les manuscrits inédits29) comment œuvre l’écrivain, combien il corrige, rature, rajoute, souffre, trime sur Lucien Leuwen ou Lamiel, pour mesurer à quel point le romancier est « flaubertien », est un artisan attaché à la moindre nuance, au style, et pour prendre conscience que sa fabuleuse chance post mortem n’est pas seulement un divin cadeau du ciel, mais un résultat recherché, anticipé, programmé. Obsédé par son projet de toujours : « to make chef-d’œuvre30 », Stendhal a sciemment, délibérément, fait en sorte de fabriquer des « billets gagnants31 ».
17Dans le cadre de cette communication, il ne saurait être question d’entrer ici dans le détail de cette méticuleuse gestion anthume de la postérité, matérialisée par l’existence des nombreux « testaments » de l’écrivain veillant à ce que ses manuscrits ne tombent pas entre de mauvaises mains32, ne soient pas perdus, détruits, brûlés. Nous nous bornerons seulement à noter que la rédaction et la précision de ces testaments dépendent de la foi de l’auteur dans l’avenir de certains textes, sont une manière de signifier la valeur de ceux-ci à ses propres yeux. De ce credo intime témoigne exemplairement « le don » des manuscrits autographes de Lucien Leuwen à sa sœur, accompagné de consignes particulières afin de donner toutes ses chances au roman :
Si le ciel m’appelle à jouir de la récompense de mes vertus avant que this novel ne soit printed, je crains que ces volumes ne soient privés d’un fair trial et ne tombent dans les mains de quelque marchand mercier, par état ou par esprit, qui se servira de ce papier pour allumer des fagots verts. Afin de donner à ces volumes quelque prix aux yeux des sots, j’y ai fait placer quelques eaux-fortes. Je laisse bien ces volumes à Mme Périer-Lagrange, qui sait lire mon écriture, mais probablement elle sera devenue dévote et les jettera au feu. Il faudrait les faire revoir par quelque écrivain, mais non pas de ceux qui sont adonnés au style à la mode et à l’affectation, outre qu’ils coûteraient trop cher. Ne pas demander les soins de MM. Jules Janin, Balzac, mais prier M. Ph. Chasles, que je n’ai jamais vu, de corriger le style, de supprimer les redites, mais de laisser les extravagances. Le siècle est si adonné à la platitude que ce qui nous semble extravagant en 35 sera à peine suffisant pour amuser en 1890. À cette époque, ce roman sera peinture des temps anciens, comme Waverley (sans faire comparaison de talents33).
18Comme l’atteste clairement ce legs, Stendhal « teste » parce qu’il croit en ce qu’il a écrit, parce que « ces volumes » ont du prix pour lui (même sans les eaux-fortes !), et, selon une habitude qui lui est coutumière34, il imagine ses volumes imprimés dans une cinquantaine d’années (1835-1890) – la durée qui, pour l’écrivain, est l’unité de mesure de l’immortalité35 –, et anticipe le lecteur à venir, lequel d’ailleurs est tout à fait conciliant, « bénévole » puisqu’il est présupposé valider les propres choix de testateur (il ne faut pas corriger le style, il faut laisser les « extravagances » qui n’en seront plus : autrement dit, il faut seulement ôter les redites, et imprimer « this novel » tel quel !).
19Comme tout grand artiste qui sait pertinemment ce qu’il fait quand il fait ce qu’il fait, l’écrivain Stendhal a fait le tri, a « balayé » autour de ses œuvres :
OPUS. L’excellente habitude des compositeurs. Ils n’accordent un numéro d’opus qu’aux œuvres qu’ils estiment « valables ». Ils ne numérotent pas celles qui appartiennent à leur immaturité, à une occasion passagère qui relève de l’exercice. Un Beethoven non numéroté, par exemple les Variations à Salieri, c’est vraiment faible, mais cela ne vous déçoit pas, le compositeur lui-même nous a avertis. Question fondamentale pour tout artiste : par quel ouvrage commence son œuvre « valable » ? Janacek n’a trouvé son originalité qu’après ses quarante-cinq ans. Je souffre quand j’entends les quelques compositions qui sont restées de sa période antérieure. Avant sa mort, Debussy a détruit toutes les esquisses, tout ce qu’il a laissé d’inachevé. Le moindre service qu’un auteur peut rendre à ses œuvres : balayer autour d’elles36.
20Stendhal, en effet, a clairement signifié quelles étaient les œuvres qui, pour lui, étaient au-dessus du lot, étaient « valables », dignes de (lui) survivre. Ces œuvres sont au nombre de cinq : Histoire de la peinture en Italie (à Louis Crozet, Stendhal écrit : « Ces deux volumes peuvent avoir cent cinquante ans dans le ventre37 »), Le Rouge et le Noir, Lucien Leuwen, la Vie de Henry Brulard et La Chartreuse de Parme. Pour ces cinq écrits, et pour ceux-là seulement, dans la correspondance, les marginalia ou les testaments, l’auteur en appelle expressément à une évaluation future, prend date.
21« Le texte stendhalien, marges et bretelles comprises, est un38 » : rien de plus faux qu’une telle assertion, invalidée aussi bien par l’ensemble des diverses et incompatibles productions du polygraphe que par l’auteur himself. Aux yeux de Stendhal, il y a les écrits à obsolescence programmée, périssables par nature, et qui ne valent donc pas d’être remis vingt fois sur le métier, d’être travaillés « de rage pied » (loc. cit.) puisque, dans tous les cas, ces écrits ne sauraient prétendre durer. Les chroniques journalistiques (fatalement éphémères), les récits de voyage (Rome, Naples et Florence en 1817 : en datant expressément son premier « tour », Stendhal entend bien signifier qu’il ne s’agit pas de parler de l’Italie éternelle, mais de témoigner de l’Italie présente, de l’Italie après la chute de Napoléon : par définition, un voyage de cette nature – et tous les « tours » de Stendhal sont des relations expressément datées, historiques – n’est pas destiné à rester longtemps vrai, pertinent), les Vies (qu’il s’agisse de la Vie de Rossini ou de la Vie de Napoléon, l’auteur n’ignore pas que ce qu’il écrit est étroitement lié à l’actualité39 et à la documentation disponible, partant voué à être rapidement dépassé, périmé40), les livres engagés, les textes satiriques, polémiques ont, par essence, une espérance de vie très limitée (un pamphlet est éminemment mortel, est « tout à fait démodé au bout de six mois41 »). Ce n’est donc pas avec ce genre d’écrits-là que Stendhal espère gagner le gros lot à la loterie de la postérité, et du reste il n’y songe guère. Sa gloire posthume, il l’attend des « ouvrages d’imagination », et, plus particulièrement, du roman, mais d’un roman travaillé à cette fin.
22Pour éviter la mort subite, le roman doit tenir en lisière, sublimer, transcender les « intérêts passagers et âpres de la politique du moment42 », et, en conséquence, prendre de la distance, tendre vers une certaine objectivité. Pour le romancier qui ambitionne d’écrire un « chef-d’œuvre », c’est une question de (sur)vie ou de mort. S’il veut avoir quelque chance de tirer des « billets gagnants », l’homme de plume doit s’autocensurer, doit rectifier sa posture instinctive, doit faire taire en lui le militant tranchant, le pamphlétaire agressif et engagé dans les combats de l’heure, éviter les « dissertations » (sur les sujets journalistiques à la mode), tempérer les prises de position du citoyen libéral, faire en sorte de se placer sinon au-dessus de la mêlée (une position impossible), du moins détaché des clivages idéologiques et politiques de l’heure :
Par malheur pour eux, ils [ces volumes] ne racontent point une action passée il y a cent ans, les personnages sont contemporains ; ils vivaient, ce me semble, il y a deux ou trois ans. Est-ce la faute de l’auteur, si quelques-uns sont légitimistes décidés, et si d’autres parlent comme des républicains ? L’auteur restera-t-il convaincu d’être à la fois légitimiste et républicain43 ?
Plan – […] Prendre garde que l’homme de parti ne cache l’homme passionné. L’homme de parti sera bien froid dans 50 ans, il en faut seulement ce qui sera intéressant quand le procès sera jugé44.
23L’adoption de cette posture inédite (en tous points délibérée, construite, puisque contre nature, contraire aux habitudes invétérées, « normales », de l’écrivain, plus porté à polémiquer qu’à afficher une neutralité de bon aloi) qui conduit à la théorie du « roman miroir », selon laquelle l’auteur ne fait que représenter ce qui est, sans prendre parti45, est nécessaire mais non suffisante. Il ne suffit pas à l’auteur de changer la pose, il lui faut aussi s’interroger sur les moyens susceptibles de retarder, de déprogrammer, autant que faire se peut, l’obsolescence rapide du « roman comique », social, politique, historique. « Le Roman est-il une composition essentiellement éphémère ? Si vous voulez plaire infiniment aujourd’hui, il faut vous résoudre à être ridicule dans 20 ans46 ». « Plaire infiniment aujourd’hui » ou être lu plus tard, beaucoup plus tard ? Stendhal, qui ne cherche pas à plaire au « grand nombre », choisit évidemment la seconde option, et intègre les conséquences de ce choix dans ses « ouvrages d’imagination ».
24Si, faute de manuscrits, nous en savons assez peu sur les principes qui ont guidé l’élaboration des romans publiés, nous disposons toutefois d’un document exceptionnel dans lequel l’écrivain explicite a posteriori ses intentions de romancier : un « projet d’article sur Le Rouge et le Noir », rédigé en 1832, et destiné à présenter la « chronique de 1830 » aux lecteurs italiens47. Dans cet article, Stendhal révèle clairement ses objectifs : écrire un roman qui peigne « la France grave, morale, morose », les « mœurs nouvelles » générées par l’empire des « jésuites », des « congrégations » et des « Bourbons de 1814 à 1830 ». Le roman fait donc « le portrait de la société de 1829 », et pour que ce portrait soit ressemblant, sans pour autant tomber dans le pittoresque, l’anecdotique, l’actualité du jour, l’auteur a inventé des lieux emblématiques (Verrières « est le type des villes de province »), des situations typiques (leséjour de Julien au séminaire constitue « la partie remarquable de ce roman comme peinture des mœurs » ; la montée de Julien à Paris offre « une peinture bien vraie des salons du faubourg Saint-Germain »), des personnages « peints avec vérité » qui incarnent des « caractères » symboliques de l’époque : Valenod et M. de Rênal « sont les portraits de la moitié des gens aisés en France vers l’an 1825 », Mme de Rênal « est une charmante femme comme il y en a beaucoup en province », Mathilde de La Mole incarne la vraie Parisienne et « l’amour de tête » tel qu’il existe dans la capitale en 1830, etc. Bien avant que Le Rouge et le Noir ne soit étiqueté roman « réaliste » (dans l’évolution qui conduit le roman à se rapprocher de plus en plus du monde réel48, la « chronique de 1830 » est un maillon essentiel), Stendhal sait pertinemment qu’il a réussi un « exploit cognitif » (Milan Kundera), qu’il a fait ce que « personne avant M. de S. » n’avait « osé » : « la peinture de son époque ». C’est précisément à cause des impératifs catégoriques de cette poétique du roman selon « M. de S. » que Julien Gracq peut faire remarquer que, dans cette « chronique de 1830 », aucun des acteurs réels de la période historique n’est expressément nommé, ni même clairement identifiable :
La politique dans Le Rouge et le Noir. J’aime qu’aucun nom inventé n’y soit clairement traduisible pour l’historien (encore que plus d’une fois à propos de la conspiration, il en vienne un sur le bout de la langue). Mon principe s’en trouve confirmé : dans la fiction, tout doit être fictif : Stendhal réussit même à éviter le nom du monarque régnant49.
25Que Charles X apparaisse (une seule fois, et très elliptiquement) dans le récit50 n’enlève rien à la pertinence du propos, bien au contraire. Dans le fil du roman, aucun lecteur bénévole ne prête attention à cette mention du « monarque régnant » parce que, de fait, cette allusion reste fugitive, et de nulle importance. J. Gracq a tout à fait raison : ce qui est le plus remarquable dans cette « chronique de 1830 », c’est bien que Stendhal ait fait en sorte de ne dire mot de la Révolution de juillet et de « démarquer » ainsi tous les noms51.
26Ce que ce sidérant « projet d’article » révèle quant aux intentions et ambitions de l’écrivain se trouve concrètement et amplement confirmé par les manuscrits de Lucien Leuwen. Tout au long de la composition de cette « chronique de 1834 » (Anne-Marie Meininger), un œil constamment rivé sur la ligne bleue du futur, l’écrivain évite sciemment, dans la mesure du possible, tout ce qui pourrait dater, et rapidement périmer la fiction. Il met donc à distance le réel immédiat, cherche à en saisir l’essence, transplante, dépayse, synthétise, stylise les anecdotes (dans le roman « l’affaire Kortis » se déroule à Paris, pont d’Austerlitz ; le « pilotis », l’affaire Corteys, s’était déroulée à Lyon52), écarte « le détail » qui « vieillit53 », veille à ne pas mettre en scène des caricatures54 ou des « personnages à clefs55 », « ôte la ressemblance56 » pour éviter les « applications57 », la satire58, et surtout, construit des personnages qui, comme M. de Rênal et Valenod dans Le Rouge, soient des personnages emblématiques, typiques :
Excuse bouffonne mais cependant sérieuse pour l’absence de personnalité cherchée. MM. les ministres récemment nommés sont tellement connus pour leur esprit, leur probité et la fermeté de leur caractère, etc., etc., que je n’ai eu que peu d’efforts à faire pour éviter le plat reproche de personnalité cherchée. Rien de plus facile que d’essayer le portrait d’un de ces messieurs, mais un tel portrait eût semblé bien ennuyeux au bout d’un an ou deux, lorsque les Français seront d’accord sur les deux ou trois lignes que l’histoire doit leur accorder. Éloigné de toute personnalité par le dégoût, j’ai cherché à présenter une moyenne proportionnelle entre les ministres de l’époque qui vient de s’écouler, et ce n’est point le portrait de l’un d’eux ; j’ai eu soin d’effacer les traits d’esprit contre quelques-unes de ces Excellences.
13 novembre 1834. Civita-Vecchia59.
27Plus que tout autre réflexion en marge de Lucien Leuwen (et il n’en manque pas !), ce commentaire montre clairement quels sont les objectifs du romancier. Ce n’est nullement par prudence que le romancier s’abstient de donner des noms, d’épingler les « heureux du budget », et cherche à « présenter une moyenne proportionnelle entre les ministres de l’époque » ; cette « moyenne proportionnelle » est une question de principe et d’esthétique. Exactement comme le fait Balzac, Stendhal fabrique, compose ses personnages pour en faire des « types » moyens, représentatifs des mœurs, de l’époque. Et s’il fait cela, c’est à la fois pour éviter « l’application » (pas plus que Le Rouge et le Noir, Lucien Leuwen n’est un roman à clefs), mais aussi parce qu’un portrait trop près du modèle vieillit rapidement, et que Stendhal veut écrire un « ouvrage d’imagination » qui dure bien plus que le régime de Juillet…
28Même s’il aimait à écrire que la postérité relevait purement du hasard, était une « loterie », Stendhal ne pensait pas vraiment ce qu’il disait puisque, dans le même temps, le romancier a délibérément, ostensiblement, œuvré pour mettre tous les atouts, toutes les chances de son côté afin de tirer des « billets gagnants ». L’auteur du Rouge et le Noir a beaucoup travaillé à sa gloire future, et a mérité sa fabuleuse fortune posthume. Depuis son entrée en immortalité en 1880, la cote de Stendhal n’a plus baissé, et ses œuvres posthumes mêmes – exhumations toujours recommencées – sont loin d’avoir livré leur dernier mot.
1 « Nous possédons de cet écrivain dont la bizarrerie est incomparable beaucoup de livres inachevés (et parmi eux : la Vie de Henry Brulard, Lucien Leuwen, Lamiel, donc des géants) et […] on a trouvé beaucoup de causes à ces inachèvements » (J. Laurent, Stendhal comme Stendhal ou le mensonge ambigu, Paris, Grasset, 1984, p. 96).
2 « Je tombai avec Nap[oléon] en avril 1814 » (Vie de Henry Brulard, dans Œuvres intimes, t. II [en abrégé : OI II], éd. V. Del Litto, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1982, p. 540).
3 Dans un sommaire CV (consigné en 1831) de sa vie (The history of his life), Stendhal use de cette formule lapidaire : « 1815 : papier noirci » (OI II, p. 155). Rien de plus éclairant que ce constat rétrospectif : naturellement, Beyle a noirci du papier bien avant 1815, mais c’est seulement après la chute de Napoléon, quand les écrits cessent d’être « intimes », quand le scripteur cherche à les publier, et même, paie « to print », que le « papier noirci » change de statut, acquiert une autre valeur, fait de Beyle un écrivain.
4 « Ce trou [Civita-Vecchia] est plus laid que Saint-Cloud. Mais papa s’est ruiné » (lettre à A. de Mareste, 26 avril 1831, dans Correspondance, t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1967, p. 280).
5 Souvenirs d’égotisme [en abrégé : SE], OI II, p. 521**.
6 Vie de Henry Brulard [en abrégé : VHB], OI II, p. 959*.
7 G. Genette, « Stendhal », dans Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 175.
8 Voir sur ce point l’article emblématique de M. Crouzet, « De l’inachèvement » (préface aux Romans abandonnés, Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1968, p.9-51), ainsi que l’entrée – tout aussi emblématique – « Inachèvement » (Ph. Jousset), dans le Dictionnaire de Stendhal, Paris, Champion, 2003, p. 341-344.
9 Ces nombreuses et substantielles chroniques journalistiques ont été réunies sous le titre Paris-Londres chroniques, éd. Renée Dénier, Paris, Stock, 1997 (968 p.).
10 Ces comptes rendus musicaux, regroupés sous le titre Notes d’un dilettante, ont été réunis par Suzanne Esquier dans L’Âme et la Musique, Paris, Stock, 1999, p. 773-876.
11 Ces papiers (portant sur les expositions annuelles au Louvre) ont été réunis et publiés par Stéphane Géguan et Martine Reid, dans Salons, Paris, Gallimard, 2002 (202 p.).
12 « En 1830, au mois de septembre, je rentre dans l’ornière administrative où je suis encore, regrettant la vie d’écrivain au troisième étage de l’hôtel de Valois, rue de Richelieu, no 71 » (VHB, p. 541).
13 Note en marge de Lucien Leuwen [en abrégé : LL], dans Stendhal, Œuvres romanesques complètes, t. II [en abrégé : ORC II], Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 885) ; « For me. – Il ne faut pas relire plus de deux pages en commençant la séance de travail, autrement le feu s’use à corriger » (Journal, 10 janvier 1835, OI II, p. 225)
14 SE, OI II, p. 430.
15 Loc. cit.
16 « Je suis heureux en écrivant ceci. Le travail officiel m’a occupé en quelque façon jour et nuit depuis trois jours (juin 1832). Je ne pourrais reprendre à 4 heures, mes lettres aux ministres cachetées, un ouvrage d’imagination. Je fais ceci sans autre peine et plan que me souvenir » (SE, p. 487**).
17 Le constat est généralisable : les écrivains qui ont « un second métier » sont conduits à faire de l’écriture une activité seconde, tributaire du « premier métier » (vital, nécessaire, prioritaire). On sait ce que les textes brefs de F. Ponge, et les textes brefs et inachevés de F. Kafka, doivent à leur situation d’hommes de plume obligés d’écrire par intermittence, après leur temps de travail forcé. Même s’il n’est guère dans la tradition de considérer les écrits de Stendhal sous cet angle, les faits pourtant parlent haut et fort : Stendhal a mené une « vie d’écrivain » (c’est lui qui le dit expressément) de 1815 à 1830, tandis que de 1831 à 1842 il a partagé la vie de tous les écrivains contraints de cumuler les activités, de composer avec un métier qui prend du temps, de l’énergie, dont pâtit naturellement la pratique littéraire (et la différence entre ces deux modes de vie contrastés – 1814-1830, 1831-1842 – se retrouve à l’évidence dans l’écriture et la nature des textes).
18 Sur ce point, voir « Stendhal et la police », dans Y. Ansel, Pour un autre Stendhal, Paris, Garnier, 2012, p.118-136.
19 Journal (18 janvier 1842), OI II, p. 423.
20 De l’amour (I, chap. XXIV), éd. X. Bourdenet, Paris, Garnier-Flammarion, 2014, p. 102-103.
21 VHB, p. 536, 593, 597, 625, 685…
22 SE, p. 474.
23 VHB, p. 745.
24 « Je pourrais faire un ouvrage qui ne plairait qu’à moi et qui serait reconnu beau en 2000 » (Journal, 31 décembre 1804, dans Œuvres intimes, t. I, éd. V. Del Litto, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. 167). Dans les dates que Stendhal se fixe pour être « reconnu » bien après sa mort, la date « 2000 » ne correspond à rien. Dans l’esprit d’un jeune homme qui, en 1804, n’a encore rien écrit, et qui se projette dans le futur, « 2000 » est une date lointaine et un compte rond, un millésime bien fait pour matérialiser mentalement la très lointaine postérité quand on est en 1804. En revanche, 1880, 1900 et 1935 sont des dates non aléatoires, motivées par l’écriture en cours, et reposant sur des calculs coutumiers à l’auteur dans ses projections sur l’immortalité. Voir à ce propos Y. Ansel, « Stendhal lecteur de Stendhal : “Lecteur de 1880” et “Chronique de 1930” », dans Stendhal littéral. Le Rouge et le Noir, Paris, Kimé, 2001, p. 193-200.
25 A. Malraux, L’Homme précaire et la littérature, Paris, Gallimard, 1977, p. 129.
26 Sur cette glorieuse période, voir l’ouvrage fondamental de Ph Berthier, Stendhal en miroir. Histoire du stendhalisme en France (1842-2004), Paris, Champion, p. 113-148.
27 « Le texte stendhalien, marges et bretelles comprises, est un. Rien ne permet d’y isoler cette sorte de super-texte précieusement élaboré ne varietur, l’œuvre de Stendhal. Tout ce que trace la plume de Beyle (ou sa canne, ou son canif, ou Dieu sait quoi) est Stendhal, sans distinction ni hiérarchie » (G. Genette, art. cité, p. 169). Toutefois, accorder autant d’importance aux textes inaboutis qu’aux textes publiés, aux textes de Beyle qu’à ceux de Stendhal, ne faire aucune « distinction » entre les différentes productions écrites, c’est proprement assassiner le travail de l’écrivain (si tout a de la valeur, rien n’en a) qui, lui, avait des « hiérarchies », faisait des « distinctions », et savait lesquelles de ses œuvres avaient « du prix », lesquelles en avaient moins.
28 Ph. Berthier, Stendhal en miroir, op. cit., p. 129-148.
29 Nous n’avons aucun manuscrit des œuvres publiées : aussi les manuscrits inédits sont-ils la principale source de notre savoir sur la manière dont Stendhal travaillait. Reste que les notes et réflexions du Journal, que certaines lettres donnent de précieuses indications sur la genèse et l’élaboration des textes publiés. C’est ainsi que, grâce à la correspondance de Stendhal avec Louis Crozet (ami chargé de superviser la publication, à Paris, de l’Histoire de la peinture en Italie, parce que Stendhal séjourne alors à Milan), nous savons combien la rédaction de cette Histoire a été laborieuse, vingt fois remise sur le métier : « J’ai donc travaillé quatre à six heures par jour, et, en deux ans de maladie et de passion, j’ai fait ces deux volumes. Il est vrai que je me suis formé le style » (lettre à L. Crozet, 30 septembre 1816, dans Correspondance, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1968, p. 824) ; « Je me suis tué à la lettre for this work par le café et des huit heures de travail pendant des trente ou quarante jours de rage pied. Je réduisais par là à vingt pages ce qui en avait d’abord cinquante » (lettre à L. Crozet, 26 décembre 1816, ibid., p. 845).
30 « On me – Quelle différence, his life in Civita-Vecchia and his life rue d’Angivilliers, au café de Rouen ! 1803 et 1835 ! Tout était pour l’esprit en 1803. Mais, au fond, la véritable occupation de l’âme était la même : to make chef-d’œuvre » (note en marge du chap. XV de LL, ORC II, p. 206 A).
31 Voir sur ce point Y. Ansel, Stendhal, le temps et l’histoire (chap. V. « Stendhal et la postérité », p. 295-341), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2000, et l’entrée « Postérité » dans le Dictionnaire de Stendhal, op. cit., p. 549-551.
32 « Supposons que je continue ce manuscrit et qu’une fois écrit je ne le brûle pas ; je le léguerai non à un ami qui pourrait devenir dévot ou vendu à un parti […] ; je le léguerai à un libraire, par exemple à M. Levavasseur (place Vendôme, Paris) » (VHB, p. 535).
33 LL (testament daté du 17 février 1835), ORC II, p. 909.
34 Dans un projet d’article sur Le Rouge et le Noir, (1832), Stendhal termine sa présentation du roman par cette phrase : « Un jour, ce roman peindra les temps antiques comme ceux de Walter Scott » (Stendhal, Œuvres romanesques complètes, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2005, p. 838).
35 Voir Stendhal littéral, op. cit., p. 195.
36 M. Kundera, L’Art du roman (1986), dans Œuvre, t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2011, p. 730.
37 Lettre à Louis Crozet (30 septembre 1816), dans Correspondance, t. I, éd. citée, p. 824. C’est là un propos sans équivoque : quand Stendhal fait ainsi crédit à l’avenir, c’est qu’à ses yeux l’œuvre est « valable », a une valeur certaine.
38 G. Genette, loc. cit.
39 La Vie de Rossini a eu du succès à sa parution (novembre 1823) parce que l’ouvrage était opportun, collait à l’actualité immédiate (venue à Paris du maestro), mais ce qui a fait le succès de cette Vie à sa parution est cela même qui a conduit à son relatif oubli (le texte a ensuite été peu réédité), et la rend obscure : « La Vie de Rossini est effectivement un texte malaisé à lire aujourd’hui, en raison de ce qui fit son succès lors de sa parution : sa dimension d’actualité » (S. Esquier, « Préface à la Vie de Rossini », dans L’Âme et la Musique, Paris, Stock, 1999, p. 329).
40 « Chaque année qui va suivre va fournir de nouvelles lumières. […] Ce qui suit est l’extrait de ce qu’on sait le 1er février 1818. D’ici à cinquante ans, il faudra refaire l’histoire de Napoléon tous les ans, à mesure que paraîtront les mémoires de Fouché, Lucien, Réal, Regnault, Caulaincourt, Sieyès, Le Brun, etc. etc. » (Préface à la Vie de Napoléon, dans Napoléon, éd. C. Mariette, Paris, Stock, 1998, p. 13).
41 Paris-Londres, op. cit., p. 843.
42 « On a vu, chez nos voisins [les Anglais] les hommes du plus grand talent frapper de mort des ouvrages fort agréables en y introduisant des allusions aux intérêts passagers et âpres de la politique du moment. Pour comprendre Swift, il faut un commentaire pénible, et personne ne se donne la peine de lire ce commentaire. L’effet somnifère de la politique mêlée à la littérature est un axiome en Angleterre » (Racine et Shakespeare no II, 1825, dans Racine et Shakespeare, éd. R. Fayolle, Paris, Garnier-Flammarion, 1970, p. 115).
43 Le Chasseur vert (Troisième préface, 1836), ORC II, p. 723.
44 En marge du chap. XLIII de Lucien Leuwen, ORC II, p. 418 C.
45 Voir Armance (Avant-propos), Œuvres romanesques complètes, t. I [en abrégé : ORC I], p. 86 ; Le Rouge et le Noir (II, 19, et II, 22), ibid., p. 671, 688 ; Le Chasseur vert (Première Préface, Deuxième préface réelle, Troisième préface), ORC II, p. 721-723.
46 Question (1834) en marge de l’exemplaire Bucci du Rouge, ORC I, p. 1024.
47 « Projet d’article sur Le Rouge et le Noir » (1832), ORC I, p. 822-838. Toutes les citations qui suivent sont extraites de cet article, p. 823,827, 828, 830, 836-837.
48 « Les fictions, dans le relais des œuvres, perdent en grandeur, se rapprochent peu à peu du réel. Julien Sorel rêve d’être Napoléon, Rastignac, de conquérir Paris, Emma, de fuir avec Rodolphe, Frédéric Moreau, de ne rien faire. […] Le parcours du roman au xixe siècle, qui, en quelques générations à peine, passe des vertus idéales d’une Corinne ou d’un René à la seule capacité de copier de Bouvard et de Pécuchet, ne fait pas que manifester les transformations rapides vécues partout ailleurs dans la société même si celles-ci l’ont profondément marqué. Il a aussi sa logique propre qui est celle d’une réduction, au cours du xixe siècle, de la distance entre les mondes fictifs et le réel » (I. Daunais, Frontière du roman. Le personnage réaliste et ses fictions, Presses universitaires de Montréal et Presses universitaires de Vincennes, 2002, p. 126-127).
49 J. Gracq, En lisant en écrivant, dans Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1995, p. 572.
50 Le Rouge et le Noir (II, 45), ORC I, p. 803.
51 Soit dit en passant, la critique érudite qui cherche les « sources » (sous Verrières quelle ville réelle ?), les « modèles » (qui se cache derrière Valenod, le marquis de la Mole, Mathilde, ou les conspirateurs de la note secrète ?) s’évertue à défaire ce que le romancier a voulu faire, et fait : brouiller les pistes, « ôter les personnalités », faire en sorte qu’aucun des personnages ne soit reconnaissable, ne semble un « personnage à clefs ».
52 LL (chap XLIII, XLIV, XLV), p. 418-441.
53 « Éviter le détail, cela vieillit dans quatre ans au plus » (LL, p. 209 D).
54 « Beware ! Donner quelque chose d’humain, quelques détails vrais (et les placer près du commencement) aux personnages odieux, comme le comte de Vaize et Mme Gran(gou)det ; autrement j’en ferai, et ils seront sans que je m’en doute, de simples mannequins à abominations ministérielles, comme les personnages de M. le Préfet de Lamothe-Langon. 25 janvier 1835. Oui, 7 février » (LL, p. 646 B).
55 « Gare la personnalité, indigne of Dominique ! » (LL, p. 410 A) ; « Ôter la personnalité [Carlier] » (LL, p. 418 B) ; « Personnalité à éviter en corrigeant » (LL, p. 439 A) ; « Personnalité. C’est un vilain défaut, c’est mêler du vinaigre à de la crème » (LL, p. 634 A).
56 « Modèle. M. Kousin [Cousin]. Ôter la ressemblance si on la voit. Jamais de satire » (LL, p. 88 A).
57 « For me. Ôter l’application before printing » (LL, p. 307 A).
58 « En arrivant à Paris, il me faut faire de grands efforts pour ne pas tomber dans quelque personnalité. […] Mais la satire de ces heureux du budget n’entre pas dans mon plan » (LL, Seconde partie, p. 359-360).
59 LL, p. 412 A.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 25, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/862.html.
Quelques mots à propos de : Yves Ansel
Université de Nantes
