Sommaire
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
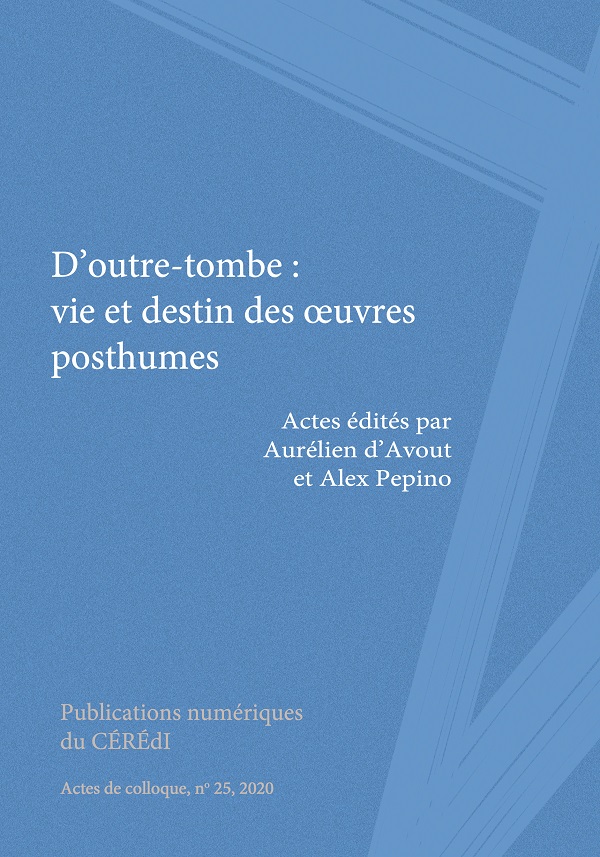
- Aurélien d’Avout et Alex Pepino Introduction
- Hugues Pradier Comment continuer à grandir un peu une fois mort
- David Soulier L’Examen d’André Vésale (1564) : un débat d’anatomie manqué
- Tony Gheeraert « Ruines de Palmyre ». Les Pensées de Pascal ou le deuil impossible
- Yves Ansel Travailler à sa survie : le cas Stendhal
- Diane Garat « D’un monsieur qui écrit de l’au-delà » : La Lettre écarlate (1850) de Nathaniel Hawthorne (1804-1864), œuvre « posthume » ?
- Gwenaëlle Sifferlen Publier les Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, une aventure éditoriale singulière
- Yvan Leclerc « Ici s’arrête le manuscrit de Gustave Flaubert » : œuvres posthumes et inédites
- Antoine Piantoni « Lieu sans routes où cheminent fixement les yeux du mort » : la survie éditoriale de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin
- Sébastien Bost Faire jouer la transparence d’une femme en noir : les mémoires de Barbara à l’épreuve du posthume
- Mara Capraro Une trahison « reconstructrice » : la réhabilitation posthume de L’Art de la joie de Goliarda Sapienza en France
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
« Lieu sans routes où cheminent fixement les yeux du mort » : la survie éditoriale de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin
Antoine Piantoni
1Le groupe des poètes fantaisistes est mort jeune. Cette petite pléiade de poètes, pour la plupart provinciaux, s’est organisée en l’espace de quelques années, à l’extrême fin de la Belle Époque avant d’être frappée sévèrement par la Première Guerre mondiale. Cette dernière va façonner une image enténébrée par l’absence irrémédiable des défunts. La réception de la figure et de l’œuvre de deux de ces absents, Jean-Marc Bernard (1881-1915) et Jean Pellerin (1885-1921), sera modelée par cette expérience terminale de la guerre : le premier, mort au combat, bénéficie encore d’une représentation dans les anthologies, comme celle d’André Gide pour la « Bibliothèque de la Pléiade », mais elle s’ente sur le seul poème de guerre « De Profundis », qui est devenu une sorte d’épitomé du genre ; le second, survivant en maigre sursis qui s’éteint trois ans après la fin du conflit, ne connaîtra donc pas le destin du martyr, mais celui d’ancien combattant mal acclimaté à son retour à la vie civile, la seule plaquette poétique parue de son vivant étant La Romance du retour. Selon des modalités différentes, mais parallèles, ces deux poètes ne jouissent que d’une image tronquée : l’un est devenu l’auteur d’un seul texte et l’objet d’un accaparement idéologique, l’autre est devenu poète pour reliquaire. On se propose d’examiner les manières dont les œuvres posthumes de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin s’intègrent dans un processus de réception complexe qui combine éléments biographiques et projets éditoriaux spécifiques. À proprement parler, les recueils compilant les œuvres de ces deux poètes ne leur confèrent pas une existence littéraire dont ils n’auraient pu jouir de leur vivant : ils ne naissent pas écrivains après leur mort, car leurs productions avaient déjà trouvé un débouché dans la presse et l’édition. Ce qui retient particulièrement l’attention, c’est la dimension mémorielle et funéraire de ces publications post mortem, principalement envisagées comme des réceptacles censés garantir une forme de pérennité malgré l’interruption brutale de ces existences fugitives.
Les stèles du souvenir
2Jean-Marc Bernard connaîtra plusieurs honneurs posthumes mais très rapidement s’exprime le besoin d’un lieu de recueillement après les années de conflit. André Mabille de Poncheville réclame pour Bernard et Raoul Monier, qui fut un ami proche du poète et mourut également au front, un monument aux morts même s’il a garde de rejeter tout faste inapproprié :
J’écris à dessein des pierres, pour ce que le mot de monument comporte de pompeux et de trop souvent faux. Je ne souhaite point à Jean-Marc Bernard, vers lequel ma pensée se tourne en cet instant, un mausolée. Je voudrais seulement qu’au bord du Rhône, à Saint-Rambert-d’Albon où il a promené sa mobile et parfois fiévreuse rêverie, on puisse trouver son nom gravé sur un des blocs de moraine roulés jusque-là dans les âges précédents et qu’il ne faudrait que dégager de l’argile. Son nom, rien d’autre peut-être. On pourrait, si on le voulait, encastrer en plus dans la pierre un simple médaillon de marbre ou de bronze sur lequel ses traits revivraient. […]
Sur un autre bloc de pierre fruste, le nom, le médaillon jumeau de Raoul Monier regardant vers l’ami auquel il refusa de survivre plus d’un an1.
3Une plaque sera posée sur la maison familiale de Jean-Marc Bernard le 5 avril 1921 et on sait que les honneurs militaires lui furent rendus l’année suivante2. Ce n’est cependant pas suffisant dans le champ littéraire dont les us réclament une visibilité éditoriale qui vienne comme une traduction des événements de la vie civile. C’est exactement ce que déclare André Beaunier au moment de la publication des œuvres de Jean-Marc Bernard qui rassemblent textes déjà publiés et inédits :
La médaille militaire a été accordée à la mémoire de Jean-Marc Bernard. Et c’est l’hommage au bon soldat. Pour que le poète aussi fût préservé de l’oubli, ses amis viennent de réunir en deux volumes son œuvre de jeune homme, interrompue par la guerre et la mort3.
4Il s’agit, comme l’explique Laurence Campa dans l’ouvrage qu’elle a consacré aux poètes de la Grande Guerre, de garantir une préservation et une pérennité du nom qui se fasse non par la simple évocation, mais par une présence qui conjure la disparition physique :
Pour l’écrivain, être un « sans nom », c’est être sans œuvre. C’est pourquoi l’édition d’œuvres posthumes accomplit son travail de commémoration, de réappropriation et d’individualisation des défunts. Pratique séculaire et classique, lieu de méditation sur la mort et la littérature, elle connaît une ampleur sans précédent et un renouveau considérable. Ses tâches ne laissent pas d’être ambiguës. Elle souhaite rendre la parole à l’écrivain combattant, en amoindrissant la part du discours d’autrui, écarter la prosopopée au profit de la voix vive, mais doit se résigner à n’offrir qu’une parole médiate. Geste de deuil, elle désire dans le même mouvement conjurer la mort de l’homme en prolongeant la vie de l’auteur et de son œuvre ; finalement, elle se prend à renouer d’une manière nouvelle avec la fonction sacrée et thaumaturgique de la poésie qui devient, tout laïcisé que soit son cadre moderne, salut du défunt et promesse d’immortalité4.
5La Première Guerre mondiale, par sa durée inattendue et par l’hécatombe, jusqu’alors inégalée, qu’elle provoqua notamment dans les rangs de la jeunesse littéraire, a généré un ensemble de pratiques qu’on pourrait dire funéraires et qui s’inscrivent dans ce qu’il est de nos jours convenu d’appeler un travail de deuil5. Laurence Campa a très bien balisé ce domaine particulier :
Dans les années qui suivirent l’armistice, les milieux littéraires se livrèrent à un certain nombre de pratiques qui participaient du processus national de commémoration. Destinée à saluer les écrivains disparus et à les sauver de l’oubli, ces pratiques revêtent des formes variées. Tantôt elles prennent le parti de conserver la dimension collective de l’hécatombe, tantôt – et sans exclusive d’autres rituels – elles mettent l’accent sur la singularité du défunt et de son œuvre. […] Le poète devient l’objet d’un geste éditorial qui prolonge le rite funèbre en tissant héritages séculaires et pratiques nées du conflit. En assurant l’édition et la diffusion des poèmes du défunt, la publication posthume réaffirme l’individualité du poète au sein de la foule combattante et fait à sa manière une œuvre pieuse ; elle s’installe, non sans ambivalence, aux frontières du singulier et du collectif, du travail de deuil et du désir d’immortalité6.
6L’édition des œuvres de Jean-Marc Bernard obéit à cette démarche, de même que l’unique recueil poétique de Jean Pellerin, dont Francis Carco a assuré l’édition au lendemain de la mort du poète. Dans le cas de Jean-Marc Bernard, la plupart de ses confrères s’accordent à considérer son œuvre comme inachevée et interrompue ; le poète Fagus estime que Bernard s’inscrit dans cette lignée d’artistes à la tâche perpétuelle et par définition infinie : « Aussi bien, comme à tout artiste vrai, l’œuvre en cours n’était à Jean-Marc que Vestibule à l’œuvre prochaine7. » Henri Martineau esquisse une analogie architecturale qui est très révélatrice : « Nous le quittons donc à l’entrée, hélas ! au portique renversé d’une œuvre qui s’annonçait émouvante d’expérience méditée, de collaboration acceptée avec le destin, en somme de mélancolie assez âcre8 […]. » André Beaunier se propose quant à lui de « chercher dans l’œuvre de Jean-Marc Bernard, dans son œuvre qui est en décombres ou en chantier, les éléments de sa pensée dont il n’a pu dresser le monument9. » Il s’agit finalement d’édifier un tombeau10 pour le soldat et le poète : les deux volumes d’essais de Pierre Gilbert, critique littéraire monarchiste mort également au front dès septembre 1914, parus en 1918, ne sont pas par hasard intitulés La Forêt des Cippes, un cippe étant une petite colonne pouvant servir de stèle funéraire. L’image de la sépulture ressurgit avec d’autant plus d’acuité que le corps de Bernard ne fut apparemment jamais enseveli, bien que Charles Forot ait recueilli un témoignage qui indiquait l’existence d’une dépouille. C’est bien une pratique funéraire qui devient l’enjeu de ce travail d’édition :
Reliquaire et tombeau, le livre posthume conserve ce qui reste du poète défunt et devient lieu de recueillement. Il offre au mort une nouvelle communauté, celle d’une intimité élargie, élective, celle du compagnonnage poétique et de la camaraderie militaire, celles des lecteurs, amateurs et curieux. À une époque où la poésie épique vit ses derniers feux, où la commémoration littéraire ne saurait se limiter à la louange des grands écrivains morts pour la patrie, il s’agit moins de célébrer le héros que de faire rayonner l’œuvre pour garantir la survie de son auteur. Même si le paratexte cède souvent à l’éloge de circonstance, le recueil posthume s’efforce de rapprocher le plus possible le lecteur du poète en laissant à ce dernier l’essentiel de l’espace imprimé. Il est ainsi rendu à la poésie ce que la vie martiale s’était arrogé. Le chant louangeur d’autrui laisse place à la parole d’outre-tombe, qui prend partiellement en charge sa propre pérennité11.
7Il convient cependant de poser des limites catégorielles : bien que sa situation l’y apparente, Jean-Marc Bernard n’est pas un poète de guerre au sens où sa production ne prend pas pour objet l’expérience de la guerre ; c’est l’hapax que constitue le « De Profundis » qui a redéterminé le statut de Jean-Marc Bernard non plus comme un fantaisiste mais comme un poète de guerre. Comme la plupart des jeunes auteurs morts sans publication en volume à leur actif, Bernard, bien qu’il n’ait pas seulement publié en revue et que sa bibliographie soit déjà consistante, s’inscrit dans un programme informel d’édition qu’esquissent les différents hommages parus dans les revues pendant ou juste après le conflit12. Laurence Campa aborde à ce sujet une question épineuse, celle qui envisage la légitimité de la publication par l’argument de la mort au front :
La pratique des reliquiae, qui a pourtant pour vocation de maintenir vivant le souvenir des morts, délimite soigneusement le nom et l’œuvre des poètes tombés au combat. De facto, la publication posthume des œuvres de Jean-Marc Bernard ou de Lucien Rolmer contribue à placer toute leur œuvre sous le signe de la guerre – alors que leurs poèmes de guerre sont rares, et à prendre chaque indice pour une prémonition ou une prédestination. Au fond, leurs œuvres ne vivent que d’avoir été écrites par des morts au champ d’honneur. Ces poètes, très actifs avant-guerre, auraient vraisemblablement connu un oubli bien plus massif s’ils n’étaient tombés au combat. La condition de leur survie littéraire est leur propre mort13.
8De fait, la plupart des hommages rendus à Jean-Marc Bernard tombent dans le champ d’attraction du « De Profundis » qui a cette particularité d’être un texte dont le substrat est l’expérience immédiate de la guerre mais dont la forme renvoie aux débuts de la littérature ; donnons-le à lire ici :
Du plus profond de la tranchée
Nous élevons les mains vers vous
Seigneur : Ayez pitié de nous
Et de notre âme desséchée !
Car plus encor que notre chair
Notre âme est lasse et sans courage.
Sur nous s’est abattu l’orage
Des eaux, de la flamme et du fer,
Vous nous voyez couverts de boue
Déchirés, hâves et rendus…
Mais nos cœurs, les avez-vous vus ?
Et faut-il, mon Dieu, qu’on l’avoue,
Nous sommes si privés d’espoir
La paix est toujours si lointaine
Que parfois nous savons à peine
Où se trouve notre devoir.
Éclairez-nous dans ce marasme
Réconfortez-nous et chassez
L’angoisse des cœurs harassés
Ah ! rendez-nous l’enthousiasme !
Mais aux morts, qui ont tous été
Couchés dans la glaise et le sable
Donnez le repos ineffable,
Seigneur ! ils l’ont bien mérité.
9La ballade rappelle François Villon et active une interprétation à la fois esthétique et idéologique. Le retour à une poésie codifiée et traditionnelle signale une continuité dans la modernité en opposition avec les tentatives d’avant-garde ; parallèlement, cette tradition excède le champ littéraire français d’avant 1914 et se présente comme une défense de la langue française, ou une arme offensive culturelle contre l’ennemi allemand. Toutefois, un autre problème se pose : dans la mouvance où semblait se situer Jean-Marc Bernard, comment peut être reçu un poème tant empreint de pessimisme qu’il pourrait passer pour pacifiste ? La solution est fournie dans le paratexte de la lettre qui contient le « De Profundis » ; il est notamment cité dans la notice nécrologique rédigée par Raoul Monier et parue les 9 et 10 août 1915 dans Le Messager de Valence. Mgr Bellet est l’un des premiers à le reprendre : « Voici quelques vers, écrits dans une heure de découragement ; inutile de vous dire que si ces strophes traduisent un moment de mon cœur, elles ne sont plus maintenant à jour14 […] ». Manque le « pendant » que Bernard envisageait d’écrire, « une paraphrase du Dies Irae » dont il ne reste apparemment que les deux vers suivants qui ont eux aussi été cités jusqu’à satiété : « Jour de colère que ce jour / Où nous sortirons des tranchées ». De nouveau, à ne considérer que le poème emblématique de Bernard, on est vis-à-vis d’une forme d’incomplétude que l’édition des œuvres posthumes ne peut pallier.
10En effet, le « De Profundis » figure bien dans les œuvres posthumes de Jean-Marc Bernard. Cette édition fut dirigée par Henri Clouard et Henri Martineau et publiée au Divan. Le projet en remonte au milieu des années de guerre juste après la mort de Raoul Monier, comme on l’apprend par une lettre de l’oncle de ce dernier à Georges Le Cardonnel qui avait annoncé la publication des œuvres de Jean-Marc Bernard dans un article paru dans Le Journal du 29 octobre 1923 :
En ma qualité d’héritier et d’exécuteur testamentaire de mon regretté neveu M. Raoul Monier qui par codicille en date du 4 août mille neuf cent quinze à son testament du 4 août 1914 avait recommandé la publication des œuvres de son ami Jean-Marc Bernard et confié ce soin à M. Henri Clouard, en affectant une somme de 1 000 francs à cet usage, j’avais fait délivrer scrupuleusement ce legs à M. Henri Clouard par M. Clément notaire à Valence et je sais que M. Clouard a été mis en possession.
N’ayant plus entendu parler de rien, n’ayant plus revu M. Clouard depuis 1917 (j’ai même perdu son adresse) je pensais que mon cher neveu qui pouvait supposer qu’en 1914 ou 15 la somme de 1 000 francs était suffisante pour une édition, n’avait pas prévu l’augmentation extraordinaire de toutes choses qui s’est produite depuis son décès, et que M. Clouard n’avait pu satisfaire les désirs du testateur : Il aurait pu d’ailleurs m’en parler15.
11C’est sans doute ce financement resté secret qui, combiné à la cristallisation de l’image du duo martyr tombé au champ d’honneur, a déterminé les éditeurs à adjoindre comme appendice au premier volume des œuvres de Bernard un ensemble de reliquiae de Monier. Cette adjonction fut problématique car Monier, correspondant en ce sens à la typologie que dégage Laurence Campa, n’avait rien fait paraître que des articles dispersés. Les Reliquiae constituent un cénotaphe plus conforme aux prérogatives du genre que les œuvres mêmes de Jean-Marc Bernard dont certaines avaient déjà connu des publications avant la guerre. Comme le déplore Henri Clouard : « Non, hélas ! il ne laisse aucune œuvre ; on ne peut donner ce nom à de rares feuillets dispersés, dont nous avons fait ses Reliquiae. Encore lui était-ce arraché. Voilà tout ce qui reste de témoignages écrits pour une sagesse que soutenait une infatigable lecture16. »
12L’édition posthume des œuvres de Jean-Marc Bernard est évidemment le résultat d’un processus concerté de sélection, voire de filtration et d’épuration. En effet, nulle trace au sommaire des poèmes en vers libres de jeunesse ouvertement influencés par l’unanimisme comme en témoigne la correspondance entre Jean-Marc Bernard et Jules Romains17. Il ne s’agit certes pas d’œuvres complètes, mais une restitution fidèle de la trajectoire poétique de Bernard aurait imposé la présence de ces textes qui signalent une ouverture et une réceptivité à la nouveauté que Clouard ne nie d’ailleurs pas : « Dès après la fin des Guêpes, je le sus prêt – tout à fait d’accord avec Monier – à se moderniser résolument18. »
13L’exemplarité presque forcée de la figure qu’est devenu Jean-Marc Bernard dans la mort prend source dans une dialectique inévitable dès lors qu’il s’agit de célébrer les défunts. Laurence Campa insiste sur la dimension éminemment sociale de ces pratiques qui créent une tension entre le désir d’intemporalité de l’œuvre de l’écrivain disparu et l’ancrage chronologique décisif et irréductible que constitue la mort de ce dernier, condition sine qua non de sa célébration :
Quoiqu’elle s’en défende, la rhétorique commémorative des milieux littéraires n’évite pas toujours de substituer le monument et la statuaire au souvenir vivant, l’homogénéité du groupe social à la diversité des groupements littéraires et à l’individualité des écrivains. C’est pourquoi divers types de discours se donnent pour mission la singularisation or, tous, même les plus singularisants d’entre eux, partagent avec la louange officielle le souci de sceller la communauté funèbre pour prolonger dans le trépas la fraternité d’armes, assurer la cohésion des vivants et des morts, et éviter au défunt d’être irrémédiablement seul, c’est-à-dire oublié19.
La couronne mortuaire de Jean Pellerin
14Jean Pellerin n’est pas mort au combat, bien qu’il soit indirectement mort pour la France. Ce contretemps est d’autant plus saisissant que la reconnaissance en tant que poète s’est également faite en déphasage avec la vie de l’auteur. De son vivant, Pellerin ne publie que quelques romans et nouvelles, l’essentiel de sa production poétique demeurant éparse dans les revues. Un premier projet de recueil prit forme dès 1913, dans le cadre de la « Collection des Cinq » qui devait accueillir la plupart des membres du groupe fantaisiste, mais la défection de l’éditeur marseillais Jules-Aurélien Coulanges interrompit l’initiative comme elle ralentit celle de la publication des Contrerimes de Paul-Jean Toulet, parrain du groupe qui ne verra pas la publication de son recueil. Il faudra attendre dix ans pour que Pellerin, la même année que Bernard, accède à une visibilité éditoriale digne de sa production.
15C’est Francis Carco qui s’occupe de la publication de cet unique recueil poétique, Le Bouquet inutile, qu’il a composé avec l’accord de la mère de Pellerin20. Cette année 1923 est décidément celle de la commémoration et des livres-stèles21. L’apparition de tels recueils permet une homogénéisation à contretemps de la représentation éditoriale des membres du groupe, offrant même à certains d’entre eux une véritable existence en tant que poètes. Cela est particulièrement patent pour Jean Pellerin qui n’avait presque rien fait paraître de sa production poétique hors des petites revues, à l’exception du Petit Carquois en 1913 en collaboration avec André du Fresnois, mais de façon anonyme. On prend la mesure de cette unification tardive dans certains comptes rendus consacrés à ces éditions ; Henri de Régnier rassemble presque tous les noms des fantaisistes à l’occasion d’une double recension :
C’était du talent aussi, et un talent d’une rare distinction et d’une fine qualité qu’annonçaient les premières productions de Jean-Marc Bernard, tué en pleine jeunesse le 15 août 1915, entre Souchez et le Cabaret Rouge. Ses premiers poèmes comprenaient une longue églogue païenne : La Mort de Narcisse qui, à travers des influences symbolistes, attestait d’un don original que révèle son recueil : Sub tegmine fagi. […] Par ce recueil, Jean-Marc Bernard prend place dans le voisinage de MM. Francis Carco et Tristan Derême [sic]. Aussi est-ce M. Henri Martineau, le vigilant et pieux éditeur des Contrerimes de Toulet, qui nous donne une fort belle édition en deux volumes des écrits de vers et de prose laissés par ce délicieux poète que je ne séparerai certes pas de Jean Pellerin, mort aussi prématurément et dont Le Bouquet inutile contient des poèmes exquis en leur chantante brièveté22.
16Dans sa chronique des livres, Henry Bidou rend également compte du Bouquet inutile, « Laurier mélancolique planté sur une tombe ». C’est le seul critique à rappeler que l’on a affaire à un recueil qui rassemble une production de plusieurs années et il reproche, à juste titre, l’absence de chronologie explicite qui renseignerait sur l’évolution poétique de Pellerin : « Je regrette que les poèmes ne soient pas datés. Un livre posthume appartient à l’histoire et mérite ces soins. Une dizaine d’années, selon toute apparence, séparent les premiers vers des derniers23. » Au rebours du cénotaphe des Œuvres de Jean-Marc Bernard, Le Bouquet inutile fait davantage penser à un catafalque dressé par l’ami intime. Carco et Pellerin se connurent à Grenoble, lors de leur service militaire ; les liens d’amitié se tressèrent avec les affinités littéraires et les deux amis participèrent à plusieurs projets de revues, notamment celui des Petites Feuilles qui ne connurent qu’un numéro au début de l’année 1909. Ils travaillèrent tous deux pour la presse, notamment dans les colonnes de L’Homme libre de Clemenceau. L’éditeur est donc un familier, ce qui influe sur la présentation qu’il fait de ce recueil qu’il a partiellement assemblé lui-même. La préface qu’il fait figurer en tête du volume se met au diapason des circonstances :
Les amis de Jean Pellerin ne pleurent pas que le poète mais ce grand garçon vif et charmant qu’il était avec ceux qu’il aimait, et sa nature pleine de franchise. Hélas ! Jean Pellerin n’est plus. Il nous a quittés, jeune encore, au moment où ses livres rencontraient des lecteurs et où les dons qu’il cultivait depuis déjà de longues années, devenaient – chaque jour – plus plaisants. Comment ainsi ne pas porter deux fois son deuil et ne pas demeurer inconsolables de cette mort qui nous atteint, en même temps que dans une amitié constante, dans le respect et l’amour des beaux vers joints aux jeux les plus clairvoyants de l’esprit24 ?
17Carco verse explicitement dans l’éloge funèbre et toute la préface fonctionne comme une défense de la mémoire de Pellerin :
Non. Il n’est pas question ici de perdre une seconde fois Jean Pellerin. L’œuvre qu’il a construite, de son vivant, demeure après sa mort et c’est cette œuvre qui, sans le secours de personne, défend à présent de la mort tant de beautés et de trésors nouveaux dont nous ne serons pas les seuls à être visités25.
18Si l’œuvre paraît ici tenir d’elle-même et reposer comme un monument funéraire, Carco reviendra quelques années plus tard sur l’entreprise de sauvetage et de collecte des disjecta membra qu’il a échafaudée afin de sauver de l’oubli le Pellerin poète :
Hélas ! Jean Pellerin n’aura pas vu de son vivant paraître ce livre auquel il donnait tant de soins ! La Romance du Retour ne contient qu’un poème, qu’un beau, qu’un déchirant poème. Les autres, dispersés dans de modestes publications, attendaient qu’on les rassemblât. Il a fallu sa mort pour que, réalisant enfin l’ambition de Jean Pellerin, j’entreprisse à sa place d’offrir au grand public l’œuvre qu’il nous a laissée. Puisse-t-elle conserver longuement ses couleurs diaprées, son arome [sic], son arrangement fier et tendre. Ce n’est point un bouquet de fête cueilli dans une [sic] parterre bourgeois, mais un de ces bouquets que, seuls, achètent les camarades près d’un cimetière pour en orner une tombe devant laquelle ils se découvrent. Humbles fleurs, quoique brillantes et délicatement choisies les vers de Jean Pellerin sont de ceux que l’on n’oublie guère après qu’on les a lus. Ils ont l’accent de la jeunesse, de sa jeunesse blessée par bien des abandons, de sa jeunesse toujours vivante, même si elle se désole à compter ce qui reste, après de longues années, des amours et des trahisons26.
19Le ton est mêlé de mélancolie et de nostalgie. L’évocation de Carco s’inscrit dans un sous-genre mémorialiste que Roland Dorgelès et lui-même ne manqueront pas d’illustrer jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale27. Le titre du recueil est ici pour ainsi dire sémantiquement rechargé : la dimension de minor qui accompagnait l’adjectif inutile renvoyait l’œuvre dans le dérisoire, mais la couronne mortuaire, le bouquet (ou l’anthologie ou le florilège, dans leur sens originel de collection de fleurs choisies) déposé sur une tombe lui confère de la grandeur dans la vanité. L’imagerie mortuaire n’oriente cependant pas l’œuvre de Pellerin vers la « revie » littéraire : on constate plutôt une forme de repli mémoriel. C’est que Carco ne sépare pas sa jeunesse de l’aventure fantaisiste. Par attraction sentimentale, il associe l’œuvre de Pellerin à cette époque, au risque de l’y réduire28. La citation de Régnier indiquait bien que Pellerin et son œuvre pouvaient difficilement être envisagés en dehors de la constellation fantaisiste. Mais ce qui est encore plus révélateur d’un groupe qui s’unifie à contretemps et est véritablement perçu comme tel, c’est le fait que Henry Bidou, à l’instar de Henri de Régnier, procède à des rapprochements opportuns. Il est ici sollicité par le jeu de dédicaces réciproques entre Le Bouquet inutile et La Bohème et mon cœur, recueil de Carco qui reparaît augmenté en 1922 :
Le livre de Jean Pellerin est dédié à Francis Carco ; le livre de Francis Carco, La Bohème et mon cœur, est dédié à la mémoire de Jean Pellerin. Ce sont aussi de petites chansons faites avec la tristesse de tous les jours, des rêves envolés et des rêves cueillis. Les deux tempéraments sont assez différents. Il y a chez Pellerin plus de grâce éparse et envolée, chez Carco un tour plus ferme, un rythme plus marqué, un timbre plus sonore. La même rêverie se condense en deux matières différentes. On dirait que les poèmes de Carco sont plus palpables et d’un relief plus arrêté. Ceux de Pellerin sont si fluides qu’ils tiennent assemblés par un charmant miracle, et on attend qu’ils se défassent comme un mirage, comme une nuée, comme un son. Ceux de Carco même les plus souples, restent solides et définis29.
20Tout se passe véritablement comme si se constituait dès la parution une historiographie par la critique qui travaille à une cristallisation dans le collectif ; celle-ci pèse immanquablement sur le destin individuel de l’œuvre posthume, d’autant plus qu’aucune édition ultérieure, critique ou non, n’est venue redéfinir les contours de l’œuvre de Pellerin.
21Carco ne s’est pas contenté de produire des souvenirs évoquant ses amis défunts. Il faut se pencher sur la mort non plus comme circonstance conjoncturelle sur laquelle s’appuie la visibilité éditoriale, comme c’est le propre de l’œuvre posthume, mais comme terreau poétique. En effet, Carco a consacré un long poème « À l’amitié » qui renferme des hommages poignants. Ce sont ceux adressés à Jean Pellerin et Jean-Marc Bernard qui forment comme un noyau sombre depuis lequel émane cette mélancolie qui semble définir la poésie de Carco. La camaraderie véritable qui l’unit à Jean Pellerin s’y exprime jusque dans les rites funéraires qui font écho au discours de Carco dans l’article paru dans Le Gaulois :
T’en souviens-tu, Jean Pellerin ?
Où sont ces aimables années ?
J’ai remplacé les fleurs fanées
De la tombe. Entends-tu les trains
Qui, nuit et jour, roulent et passent
À côté de l’étroit espace
Où tu reposes près des tiens ?
Ton nom s’efface sur la pierre.
Ta grille que disjoint le lierre,
Cède peu à peu sous ses liens
Mais, tel qu’au temps de la bohème,
Symbolique et touchant emblème,
Voici le brin de romarin
Qu’en te dédiant mes poèmes
J’ai cueilli – c’est toujours le même –
Pour orner ton froid souterrain.
Ne me réponds pas, dors tranquille,
Je reviendrai te voir encor.
Il pleut doucement sur la ville…
Il pleut doucement sur les morts30.
22L’hommage personnel se double ici de l’offrande poétique : la citation apocryphe de Rimbaud qui figure en épigraphe de la troisième ariette oubliée de Verlaine est déjà un relais symbolique de la fraternité poétique entre Carco et Pellerin, mais le vers suivant vient actualiser ce qui n’était que poétique en modifiant la citation pour l’adapter à une situation référentielle biographique. Suit une autre déploration en mémoire de Jean-Marc Bernard :
Mais quel long cri morne et funèbre,
Quel âpre appel désespéré
Lamentant un « miserere »,
Monte de l’opaque ténèbre ?
Jean-Marc, Dauphinois au cœur fier,
Je reconnais dans la tranchée
Ta voix ardente et desséchée
Par tous les brasiers de l’enfer.
Ombre farouche et douloureuse,
Reviens-tu parmi les roseaux
Du Rhône aux bondissantes eaux
Dont les vagues tumultueuses
Te charmaient mieux qu’un chant d’oiseau
Ou t’emplissaient de frénésie
Lorsque, debout, les regardant,
Tu te sentais tout débordant
De cette amère poésie
Qui bouillonnait avec ton sang ?
[…]
L’œil au créneau de la tranchée,
Hâve, épuisé, hagard, transi,
Les doigts crispés sur ton fusil,
L’âme absente, comme arrachée,
Voici que point ton dernier jour.
Dépose enfin toute espérance,
Hélas ! comme un fardeau trop lourd,
Jean-Marc Bernard, mort pour la France31.
23Ici, l’hommage se traduit par diverses allusions intertextuelles aux poèmes de Jean-Marc Bernard lui-même : la première et la troisième strophe proposent une réécriture dantesque du « De Profundis » de Bernard balisée par des citations ponctuelles32, tandis que la seconde strophe rappelle plusieurs pièces consacrées aux motifs du Rhône et du Dauphiné que l’on trouve dans les œuvres posthumes ; le dernier vers apparaît comme une épitaphe classique de monument aux morts de la Grande Guerre mais, ce qui nous semble capital, c’est le processus de création qui se nourrit conjointement de la perte de l’ami et du reliquat poétique de l’expérience de la guerre par ce dernier. Vie et poésie s’entremêlent et proposent des motifs qui se fondent les uns dans les autres.
24Les œuvres posthumes de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin, orbitant autour du cataclysme de 1914-1918, peinèrent et peinent encore à s’affranchir de cette dangereuse attraction. On prend ainsi la mesure de la versatilité de la réception de tout texte apparaissant ou réapparaissant après la mort de son auteur. Une grande distance entre œuvre et auteur semble pouvoir s’instaurer et abriter toute une mythologie, l’œuvre devenant une stèle, « lieu sans routes où cheminent fixement les yeux du mort », pour reprendre la fin de la « Stèle du Chemin de l’âme » de Segalen. Le cas de Bernard et Pellerin a ceci de particulier qu’il apparente l’édition des œuvres posthumes à un rite funéraire qui permet à la fois de conjurer l’oubli pour les défunts et reformer une communauté dissoute pour les survivants. Le groupe des poètes fantaisistes, bien qu’il ait existé quelques années avant la guerre, paraît bien davantage constitué des vestiges d’une époque, conservés dans ces éditions cénotaphes, pieusement rassemblés par d’autres vétérans que ceux revenus du front. Comme nous le disions au début de notre réflexion, le prisme ici utilisé n’est pas celui des œuvres posthumes stricto sensu telles qu’elles peuvent être décrites juridiquement, à savoir celles qui sont portées à la connaissance du public après la mort de leurs auteurs ; nous avons davantage tâché de considérer les éditions anthologiques posthumes de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin comme des marqueurs de l’existence littéraire. Le soin apporté à leur confection s’apparente à un effort de stabilisation du projet littéraire de chacun. Il s’agirait alors moins d’œuvres posthumes que d’une œuvre ne varietur, devenue close après la mort.
1 André Mabille de Poncheville, « Chronique – Des pierres de souvenir », La Revue critique des idées et des livres, 10 novembre 1920, p. 333-334.
2 La Croix de la Drôme en date du 26 novembre 1922 signale : « Nous apprenons avec fierté que par arrêté ministériel en date du 11 mai 1922 et publié au Journal officiel le 3 septembre 1922, la Médaille militaire a été attribuée à la mémoire du soldat Jean-Marc Bernard, du 97e R. d’Inf., tombé au Champ d’honneur. » Et l’échotier de citer enfin une strophe du désormais traditionnel « De Profundis ».
3 André Beaunier, « Un de nos morts : Jean-Marc Bernard », La Revue des deux mondes, 1er août 1923, p. 699. Ce texte a été partiellement repris dans le dernier numéro de La Revue critique des idées et des livres, mars-avril-mai 1924, p. 169-172.
4 Laurence Campa, Poètes de la Grande Guerre. Expérience combattante et activité poétique, Paris, Classiques Garnier, « Études de littérature des xxe et xxie siècles », 2010, p. 128-129.
5 Sur ce sujet, voir Carine Trévisan, Les Fables du deuil. La Grande Guerre : mort et écriture, Paris, PUF, « Perspectives littéraires », 2001.
6 Laurence Campa, Poètes de la Grande Guerre, op. cit., p. 124-125.
7 Fagus, « L’Âme et la Destinée d’un poète », La Revue critique des idées et des livres, novembre 1919, p. 496.
8 Henri Martineau, « Jean-Marc Bernard », Le Divan, octobre 1915, p. 391.
9 André Beaunier, « Un de nos morts : Jean-Marc Bernard », art. cité, p. 700.
10 Dominique Moncond’huy, analysant les pratiques de tombeau à la Renaissance, résume bien cette composante architecturale : « Un autre spécificité du tombeau au xvie siècle, en tout cas du tombeau collectif, est son rapport à l’architecture. D’abord à l’architecture du tombeau sculpté, ensemble souvent complexe et pouvant comporter plusieurs représentations. Mais aussi et plus encore parce que le livre lui-même se donne comme architecture élevée à la gloire du défunt – plus que tout autre texte, le tombeau mime le réel (tout en entendant le dépasser : c’est le thème récurrent de l’avantage du verbe sur la pierre, elle promise à la destruction) –, comme une architecture où se donne à lire aussi le “corps” constitué, et constitué ou réaffirmé comme tel par le texte même, des poètes “légitimes”. » (« Qu’est-ce qu’un tombeau poétique ? », La Licorne, « Le tombeau poétique en France », 29/1994, p. 11)
11 Laurence Campa, Poètes de la Grande Guerre, op. cit., p. 129-130.
12 À propos du Divan, Pierre Lièvre se félicite justement de cette tâche : « On sait, depuis la guerre, quel noble usage Le Divan a fait de ses forces et qu’il les a entièrement consacrées au souvenir des écrivains morts pour la Patrie. Des esquisses biographiques, des hommages funèbres mêlés à des pièces choisies parmi l’œuvre de ces morts forment une série de pierres d’attente par lui posées qui permettent de patienter jusqu’au jour où l’on pourra dresser le véritable monument de ces auteurs – je veux dire : éditer définitivement leurs œuvres. » (« Livres. Comme une fantaisie, par P.-J. Toulet », Les Marges, 15 mai 1928, p. 214).
13 Laurence Campa, Poètes de la Grande Guerre, op. cit., p. 27.
14 Charles-Félix Bellet, « Marc Bernard – Raoul Monier », Bulletin de la Société d’Archéologie et de Statistique de la Drôme, 1916, p. 426. Bellet, ecclésiastique grenoblois, était le président de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie de la Drôme.
15 Lettre datée du 30 octobre 1923, Archives départementales de la Drôme, fonds de la famille Le Cardonnel, 149 J 427.
16 Préface, Œuvres, t. I, Paris, Le Divan, 1923, p. XIII.
17 Clouard mentionne tout de même la passion de jeunesse de Bernard pour l’œuvre de Jules Romains dans sa préface.
18 Ibid., p. XVII.
19 Laurence Campa, Poètes de la Grande Guerre, op. cit., p. 127-128.
20 À peine un mois après la disparition de Pellerin, la mère de ce dernier remercie Carco de se préoccuper des manuscrits de son fils : « Comme vous le dîtes [sic], cher Monsieur, je ne puis vous donner beaucoup de renseignements au sujet des éditeurs de mon fils. Jean me tenait presque tous les jours au courant de son travail, mais je suis incapable cependant de me débrouiller seule dans les manuscrits. Jugez par là [sic], du service immense que vous me rendrez par votre aide !! » (Lettre datée du 13 août 1921, V. 26358 Rés., Bibliothèque d’étude et d’information de Grenoble).
21 Tristan Derème se désole du mince héritage poétique que laisse derrière lui Jean Pellerin : « Quelle tristesse à penser que l’on puisse maintenant lire les poésies complètes de Jean Pellerin ! Un seul livre – Le Bouquet inutile – contient à peu près tous ses vers, et les ébauches et les variantes ; et, en feuilletant ce recueil, on voit apparaître le visage tendre, fiévreux et tourmenté de ce jeune homme qui a cessé de vivre parmi nous. » (« Jean Pellerin », La Revue critique des idées et des livres, juin 1923, p. 370).
22 Henri de Régnier, « La Vie littéraire », Le Figaro, 24 juillet 1923.
23 Henry Bidou, « Parmi les livres », La Revue de Paris, 15 juin 1923, p. 939.
24 Le Bouquet inutile, 2e édition, Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1923, p. 7.
25 Ibid., p. 10.
26 Francis Carco, « Jean Pellerin », Le Gaulois, 2 octobre 1926.
27 On peut notamment citer, de Carco, De Montmartre au Quartier latin (1926), et de Dorgelès, Bouquet de bohème (1947).
28 Carco illustre ainsi d’une manière particulière l’une des motivations du tombeau poétique selon D. Moncond’huy, à savoir « la volonté de saisir toutes les occasions de manifester l’existence d’une “école” littéraire, d’un cénacle, ou, plus largement, du monde des lettres comme groupe cohérent, jamais mieux rassemblé que lors d’une telle commémoration. » (« Qu’est-ce qu’un tombeau poétique ? », art. cité, p. 7).
29 Henry Bidou, « Parmi les livres », art. cité, p. 942-943.
30 À l’Amitié (1937), repris dans La Bohème et mon cœur, Paris, Albin Michel, 1986, p. 228-229.
31 Ibid., p. 229-230.
32 On trouve effectivement des micro-citations qui laissent peu de doutes : l’« âme desséchée » des poilus s’est concentrée dans la « voix ardente et desséchée » de même que les corps des soldats « Déchirés, haves et rendus » se retrouvent dans celui de Bernard, « Hâve, épuisé, hagard, transi ».
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 25, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/869.html.
Quelques mots à propos de : Antoine Piantoni
Université Paris-Sorbonne
