Sommaire
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
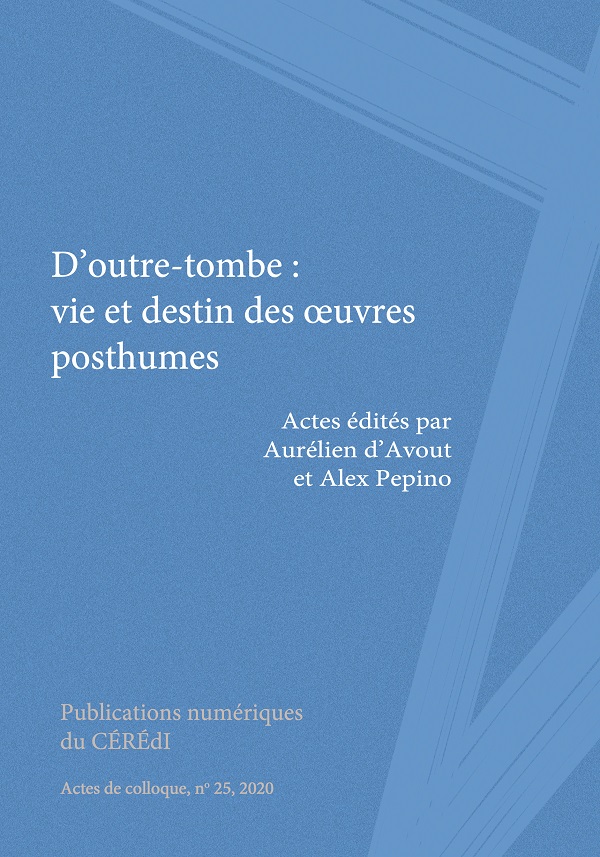
- Aurélien d’Avout et Alex Pepino Introduction
- Hugues Pradier Comment continuer à grandir un peu une fois mort
- David Soulier L’Examen d’André Vésale (1564) : un débat d’anatomie manqué
- Tony Gheeraert « Ruines de Palmyre ». Les Pensées de Pascal ou le deuil impossible
- Yves Ansel Travailler à sa survie : le cas Stendhal
- Diane Garat « D’un monsieur qui écrit de l’au-delà » : La Lettre écarlate (1850) de Nathaniel Hawthorne (1804-1864), œuvre « posthume » ?
- Gwenaëlle Sifferlen Publier les Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, une aventure éditoriale singulière
- Yvan Leclerc « Ici s’arrête le manuscrit de Gustave Flaubert » : œuvres posthumes et inédites
- Antoine Piantoni « Lieu sans routes où cheminent fixement les yeux du mort » : la survie éditoriale de Jean-Marc Bernard et Jean Pellerin
- Sébastien Bost Faire jouer la transparence d’une femme en noir : les mémoires de Barbara à l’épreuve du posthume
- Mara Capraro Une trahison « reconstructrice » : la réhabilitation posthume de L’Art de la joie de Goliarda Sapienza en France
D’outre-tombe : vie et destin des œuvres posthumes
Comment continuer à grandir un peu une fois mort
Hugues Pradier
1[Note de l’auteur]1
2Un paysage littéraire sans Mémoires d’outre-tombe, sans Temps retrouvé, sans Procès ni Château paraîtrait un peu désertique par endroits. Les œuvres posthumes font partie de nos vies de lecteurs – elles en font même si bien partie que l’on oublie parfois les particularités que leur vaut leur publication après la mort de l’auteur. Pourtant, malgré les efforts consentis par des générations d’éditeurs pour dissimuler l’inachèvement des textes, ni Lucien Leuwen ni Lamiel ne se lisent tout à fait comme Le Rouge et le Noir.
3Le premier à s’inquiéter de ces particularités et à tenter d’en contrôler les effets est souvent l’auteur lui-même, via ses dispositions testamentaires. Puis viennent, dans un ordre variable, et avec des préoccupations différentes quand elles ne sont pas antagonistes, son exécuteur littéraire, ses héritiers, son inconsolable éditeur, à l’occasion un agent avisé, des collectionneurs de manuscrits, les insatiables spécialistes de son œuvre, la presse littéraire, les lecteurs connaisseurs, sans oublier – on ne songe pas toujours à eux, mais on a tort, parce que ce qu’ils disent de ces œuvres est suggestif – le législateur et les tribunaux.
La loi et ses interprètes
4Jusqu’à une date récente, les œuvres publiées du vivant de l’auteur et les œuvres publiées après sa mort bénéficiaient, aux termes de la loi du 11 mars 1957, de périodes de protection comparables : cinquante ans après la mort de l’auteur pour les premières, cinquante ans après leur publication pour les secondes. La directive européenne du 29 octobre 19932 a changé tout cela. La durée de protection des droits patrimoniaux au profit des ayants droit de l’auteur a été portée à soixante-dix années après la mort de cet auteur3. Quant aux œuvres posthumes publiées pendant cette période de soixante-dix années, elles sont protégées aussi longtemps que le sont les œuvres parues du vivant de l’auteur, et elles tombent dans le domaine public en même temps que celles-ci – soixante-dix ans post mortem auctoris, donc –, quelle que soit la date de leur publication. Enfin, les œuvres publiées après la fin de la période des soixante-dix ans sont désormais protégées pendant une période de vingt-cinq années après leur publication – mais non plus au profit des ayants droit de l’auteur : au bénéfice des propriétaires de l’œuvre « qui effectuent ou font effectuer la publication4 ».
5Soulignons ce point : ce n’est pas de la possession d’un écrit inédit que le propriétaire tire ses droits éventuels, mais de la divulgation de cet écrit, qu’il l’ait publié lui-même ou qu’il l’ait fait publier par un tiers, par exemple par l’un des insatiables spécialistes mentionnés ci-dessus. Et encore ceci : les droits du publicateur, qui courent, on l’a vu, pendant vingt-cinq années, sont l’équivalent des droits patrimoniaux ; quant aux droits moraux, qui comprennent le droit de divulgation de l’œuvre inédite, ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles5 : ils restent acquis aux héritiers de l’auteur. Le propriétaire du document doit donc obtenir le consentement de l’héritier (ou de son représentant) titulaire du droit de divulgation pour pouvoir livrer au public de manière licite l’écrit dont il détient la propriété matérielle. Inutile de préciser que les intérêts des parties peuvent diverger.
6Qu’en est-il de l’intérêt de l’auteur disparu ? et de celui du public ? On ne saurait les oublier, mais il est difficile de les définir d’un mot. La divulgation étant considérée comme un acte intime, le législateur a fait en sorte qu’elle soit dévolue à une personne de confiance, capable d’exécuter les volontés exprimées par l’auteur6. Sage précaution, qui ne constitue évidemment pas une garantie absolue et encore moins définitive : si bien des exécuteurs testamentaires désignés par les auteurs sont compétents et honnêtes, aucun n’est éternel. C’est pourquoi il appartient souvent aux tribunaux de concilier les intérêts respectifs de l’auteur, du publicateur, du titulaire du droit de divulgation et du public.
7Publier une œuvre inédite peut constituer un abus manifeste, si la divulgation de cette œuvre porte atteinte au droit moral de l’auteur. Mais ne pas la publier aussi, pour peu que la non-publication relève d’une négligence coupable7. Et s’opposer sans motif valable à sa divulgation peut également être sanctionné. Dans un arrêt du 19 décembre 1997, la Cour d’appel de Paris estimait ainsi que le refus de l’ayant droit d’un grand écrivain de laisser publier le tome XXVI de ses Œuvres complètes (les tomes I à XXV ayant déjà paru) constituait « un abus dans le non-usage de son droit de divulgation des œuvres ». L’ayant droit se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté le 24 octobre 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation, dont l’un des attendus donne une sorte de définition du « bon usage » des œuvres posthumes : « le droit de divulgation post mortem », soulignent les magistrats, « n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ». En l’occurrence, l’édition incriminée par l’ayant droit avait été voulue par l’auteur et entreprise « dans le respect de son droit moral » ; elle pouvait donc se poursuivre8.
8« Pas absolu » : avis à qui serait tenté de divulguer un inédit au seul motif que « le public a le droit de savoir ». Quant à exercer le droit de divulgation « au service de l’œuvre », rien de plus sain, si ce critère n’était soumis à l’interprétation d’experts généralement autoproclamés. Enfin, la divulgation « en accord avec la volonté de l’auteur » paraît imparable – pour peu, évidemment, que ladite volonté soit clairement établie, et à moins que la volonté de l’auteur et l’intérêt du public ne divergent dangereusement, ce qui peut arriver. Des écrits dont les auteurs souhaitaient la diffusion posthume sont alors divulgués à retardement ou à reculons ; d’autres, à l’inverse, le sont dans l’intérêt supposé du public, mais au mépris de la volonté de l’auteur.
« Fallait-il publier ? »
9La volonté de Pierre Drieu la Rochelle était connue et elle était claire. Il en avait fait part à son frère Jean : le journal qu’il avait tenu de 1939 à sa mort en 1945 devrait être publié « intégralement, sans aucune hésitation bourgeoise9 ». Mais la situation n’était simple qu’en apparence, « ce journal de guerre explosant de la haine de Drieu contre tous et tout, les femmes, les Juifs, ses meilleurs amis et lui-même ». Ne pouvait-on considérer, dans ces conditions, que la volonté de l’auteur et ses intérêts étaient antagonistes (ce qui n’étonnera pas les lecteurs de Drieu) ? Quant au public, il n’était pas déraisonnable de mettre en balance l’intérêt qu’il trouverait à la lecture de « ce témoignage exceptionnel » et les blessures que risquait de lui infliger la haine tous azimuts de Drieu.
10Pendant quarante ans, Jean Drieu la Rochelle hésita à publier le journal de son frère. Il ne s’y résolut qu’à la veille de sa propre mort, en 1986. L’ouvrage parut en 1992, doté d’une annotation historique renforcée et précédé d’un « Avertissement de l’éditeur » dans lequel Pierre Nora évoque le dilemme qui a été le sien et celui des autres personnes concernées – « Fallait-il publier ? Ne pas publier ? » –, avant (chose rare) de s’excuser auprès des lecteurs qui seraient blessés « familialement ou personnellement » par « cette accumulation de violences verbales et de jugements odieux », et de révéler les motifs qui l’ont tout de même conduit à publier le livre dans l’une des collections placées sous sa direction.
11Ces motifs méritent qu’on s’y arrête, car ils font écho aux critères mis en avant par le législateur et par les magistrats. La divulgation du journal se fait en accord avec la volonté exprimée de l’auteur, et avec sa personnalité, puisque Drieu s’est lui-même placé « devant le jugement de l’histoire ». L’intérêt de son œuvre et celui d’un public averti (ou du moins invité à lire un avertissement) ne s’opposent pas : Drieu est un écrivain important, son journal a un « puissant intérêt ». D’autre part, d’imminentes publications pirates, qui seraient réalisées d’après des « copies invérifiées », menacent à la fois la qualité de l’information due au lecteur et les droits moraux et patrimoniaux de l’auteur. De là à estimer qu’une non-publication constituerait un cas de négligence coupable, et « un abus dans le non-usage » du droit de divulgation…
12La publication a donc eu lieu, quarante-sept ans après que l’auteur en eut manifesté le désir, et au prix de l’arsenal de précautions qui vient d’être décrit : avertissement, excuses, annotation renforcée et – il faut y prendre garde – recours à une collection bien choisie. En 1966, le grand roman posthume de Drieu, Mémoires de Dirk Raspe, avait paru dans la collection « Blanche », qui peut fort bien accueillir aussi des textes intimes. Mais le Journal 1939-1945, quant à lui, est publié dans « Témoins », collection recueillant documents et mémoires historiques. Pierre Nora parle de « cet encombrant document », de « ce témoignage exceptionnel », jamais d’une « œuvre » de Drieu. Mais qu’est-ce qu’une œuvre ? « Une œuvre, n’est-ce pas ce qu’a écrit celui qui est un auteur10 ? » Il semble bien, pourtant, que l’édition posthume d’un écrit inédit (fût-il destiné par son auteur à la publication : nous ne parlons pas ici de notes ou de brouillons) ne suffise pas toujours à faire de celui-ci une œuvre de plein droit. Encore le lecteur a-t-il son mot à dire : jusqu’à un certain point, c’est son regard qui fait l’œuvre.
13Le cas de L’Original de Laura, le roman auquel travaillait Vladimir Nabokov à la veille de sa mort, est fort différent. Nabokov avait demandé à sa femme d’en détruire le manuscrit si celui-ci était toujours inachevé à l’heure de sa disparition. Or à sa mort, en 1977, l’ouvrage est loin d’être terminé : on ne dispose que de cent trente-huit fiches partiellement rédigées et dont l’ordre même est douteux. Pourtant, Vera Nabokov, qui des années plus tôt avait sauvé du feu le manuscrit de Lolita, ne brûle pas Laura. Mais elle ne le publie pas non plus : à son décès, qui survient en 1991, son fils Dmitri hérite des fiches et du dilemme.
14À en croire l’introduction qu’il donnera au livre11, il hésite longtemps. Puis il finit par lire les fiches, en dicte la transcription, les ordonne et se convainc lui-même qu’il n’est plus question de brûler Laura : « j’éprouvais l’envie de le laisser poindre furtivement de ses ténèbres l’espace d’un instant12. » L’édition originale paraît en 2009. Les fiches, accompagnées de leur transcription, y sont reproduites en fac-similé et sont prédécoupées, de manière que le lecteur puisse les détacher et les placer dans l’ordre qui lui paraît le plus pertinent. Il aurait naturellement été impossible de dissimuler l’inachèvement du roman, qui saute aux yeux ; mais on a choisi l’option inverse, qui consiste à exhiber le support manuscrit.
15L’indéniable intérêt du procédé ne séduit pas tout le monde. On critique l’introduction de Dmitri, et l’on met en cause l’influence de l’agent qui gère l’œuvre de Nabokov (et qui est en effet influent). Des écrivains regrettent le non-respect de la volonté de l’auteur. Un admirateur de Nabokov, Aleksandar Hemon, estime que cette publication ne méconnaît pas seulement sa volonté, mais aussi sa « sensibilité esthétique », qu’il définit en citant la préface du maître à Eugène Onéguine : « Dans l’art, les objectifs et les plans ne sont rien, il n’y a que les résultats qui comptent13. » Or, dit-il (et ce n’est que trop évident), les fiches publiées ne correspondent pas au résultat visé par Nabokov.
16Le même Hemon, interrogé par L’Express, soulève indirectement un problème qui se pose à tout publicateur d’écrits posthumes au statut plus ou moins incertain : celui des bornes de l’œuvre d’un écrivain. « Si ce malheureux désordre [les fiches publiées] permet d’une manière ou d’une autre un regard sur l’esprit créatif du maître, pourquoi ne pas publier sa liste de courses ou ses talons de chèque14 ? » Manière peu subtile, sans doute, de poser la question, déjà effleurée ici, que Foucault avait abordée quarante ans plus tôt15 (lui ne parlait pas de « liste de courses », mais de « note de blanchisserie ») et à laquelle il s’était gardé de répondre, préférant constater : « La théorie de l’œuvre n’existe pas, et ceux qui ingénument entreprennent d’éditer des œuvres manquent d’une telle théorie et leur travail empirique s’en trouve bien vite paralysé. » Paralysé ? vraiment ?
17Face aux critiques, le publicateur, Dmitri Nabokov, affiche un humour distancié. Lui reproche-t-on d’avoir dit que son père lui était apparu en rêve pour l’inciter à publier Laura ? C’était pour rire, répond-il16. Mais il n’en évoque pas moins le spectre du père dans son introduction : « Je ne crois pas […] que mon père ou le fantôme de mon père se serait opposé à la sortie de Laura dès lors que Laura avait survécu si longtemps au bruissement du temps17. » Au premier abord, l’argument paraît étrange. À y réfléchir, il est profondément juste. En matière d’œuvres posthumes comme dans d’autres domaines, le temps rend possible, voire judicieux, ce qui paraissait impossible ou absurde. Nous y reviendrons.
18Dmitri déclarait aussi que son père, à la fin de sa vie, avait mentionné Laura parmi les œuvres qui comptaient à ses yeux. L’aurait-il fait s’il avait vraiment voulu que le manuscrit en fût détruit ? Et est-ce à sa femme qu’il aurait demandé de le brûler, alors qu’elle avait refusé d’anéantir Lolita ? Autrement dit, les écrivains veulent-ils toujours ce qu’ils disent vouloir ? Bonne question, dont le seul défaut est que l’on ne peut y répondre. La voie est libre pour les éditeurs de texte, que leur supposée paralysie ne semble guère handicaper.
Du bon usage de la trahison
19N’en déplaise au législateur, toutes les publications posthumes ne se font donc pas en accord avec la volonté exprimée de l’auteur. Les lecteurs de l’Énéide s’en plaignent rarement. Ceux de Kafka se font également une raison, même si certains, et non des moindres, reprochent à Max Brod d’avoir publié tous les papiers que son ami Franz lui avait demandé de détruire, y compris les écrits intimes, favorisant ainsi des interprétations fondées sur la biographie. Telle est à peu près la position de Milan Kundera, exposée dans son recueil de 1993, Les Testaments trahis18.
20Pour Kundera, Brod « a trahi son ami. Il a agi contre sa volonté, contre le sens et l’esprit de sa volonté ». Car «[p]ublier ce que l’auteur a supprimé est […] le même acte de viol que censurer ce qu’il a décidé de garder19 ». Les mots sont forts, et il est difficile de se défendre contre l’idée qu’en parlant de la sorte Kundera songe aussi à lui-même, à ce qu’il adviendra de son œuvre après sa disparition.
21Mais Kundera a beaucoup publié, et Kafka bien peu. Dès lors, la trahison de Brod n’était-elle pas nécessaire ? L’auteur des Testaments trahis, qui place Kafka plus haut que tout, reconnaît que son exécuteur testamentaire ne peut qu’être embarrassé face aux récits et aux romans inédits qu’il est censé détruire, et il pousse l’honnêteté jusqu’à avouer que lui-même n’aurait pu brûler les trois romans (mais le reste, si : exeunt par conséquent Préparatifs de noce à la campagne, Description d’un combat, Le Terrier, etc.). Il consacre à la question une page étonnante20. Il s’y dit certain d’être, « dans l’au-delà », en mesure de persuader Kafka qu’en sauvant et en faisant éditer ses romans il n’aurait trahi « ni lui ni son œuvre dont la perfection lui tenait tant à cœur ». Mais il ne se serait pas absous pour autant : il aurait agi « à [s]es propres risques moraux », « en tant que celui qui transgresse une loi, non pas en tant que celui qui la dénie et l’annule ».
22Quelque intenable que paraisse sa position, elle apporte au débat, en particulier à la question de l’inachèvement, une intéressante contribution. Kundera considère en effet que tout texte encore inédit à la mort de son auteur est par définition inachevé : pour lui, la publication est à la fois la cause et la condition de l’achèvement. « Car si un auteur n’a pas la perspective concrète d’éditer son manuscrit, rien ne le pousse à y mettre la dernière touche21. » Un écrivain épris de perfection – qu’il se nomme Kafka ou Kundera – ne peut donc admettre que l’on publie après sa mort ses œuvres inédites. CQFD.
23Mais si perfection et publication posthume sont incompatibles, un tiers autorisé ne peut-il, le moment venu, porter sur un inédit un jugement si favorable qu’il le conduise à en divulguer le texte sans avoir le sentiment de prendre un risque moral ? Kundera n’écarte pas tout à fait cette hypothèse : « ce qu’un auteur est dans l’impossibilité de voir peut apparaître clairement aux yeux de quelqu’un d’autre22. » Mais il n’en tire pas toutes les conséquences : pour lui, Brod a bel et bien trahi Kafka par action et par omission, et lui, Kundera, qui n’aurait pas détruit ses trois romans si l’occasion lui en avait été donnée, l’a trahi en pensée. Seul le jugement de l’auteur sur sa propre création lui paraît avoir force de loi. Il n’envisage pas que le temps puisse changer les données du problème.
24Pourtant, le temps joue un rôle, et Dmitri Nabokov avait raison de le faire observer. La publication posthume est l’une des étapes du processus au cours duquel l’auteur perd le contrôle de son œuvre. Ce processus commence en général avec sa mort (parfois avant). Il ne se confond nullement avec la période de soixante-dix années qui précède la tombée de l’œuvre dans le domaine public ; ici, ce n’est pas de droits patrimoniaux qu’il s’agit, ni même de droits moraux, mais d’un changement de perspective. Le contrôle passe peu à peu de l’émetteur (l’auteur ou son représentant) au récepteur : le lecteur, amateur ou professionnel, universitaire ou bénévole. C’est lui qui, en lisant en écrivant (et en parlant, bien entendu), fait que les conditions changent. « On sait maintenant que l’œuvre n’appartient pas à un projet de son auteur23 », disait Foucault. Bien sûr, les décisions (notamment de publication) restent l’affaire des ayants droit ou de l’exécuteur testamentaire. Mais le contexte qui rend possibles, désirables, voire indispensables les éditions posthumes ne dépend pas (seulement) d’eux.
25En 1770, Voltaire demande à son libraire de ne pas imprimer tout ce qu’il a pu écrire : « Je vous répète qu’on ne va point à la postérité avec un si gros bagage. […] il ne faut pas imprimer toutes les sottises des auteurs, mais le peu qui mérite d’être lu24. » Au lendemain de sa mort (1778), Panckouke puis Beaumarchais lancent la monumentale édition de Kehl : soixante-dix volumes paraîtront entre 1784 et 1787. Il ne s’agit pas de nier les bonnes raisons que l’auteur pouvait avoir de ne pas diffuser certains de ses écrits. « Ce n’est qu’avec tous les dehors de la parure qu’un écrivain hasarde de se montrer en public », lit-on dans l’« Avertissement » de 1795 placé en tête des Pensées diverses (posthumes) de Montesquieu. Mais vient un moment (Montesquieu est mort depuis quarante ans) où ces raisons perdent de leur force : « On dit que la famille de ce grand homme possède encore beaucoup de ses ouvrages manuscrits : s’ils offrent des vues aussi grandes et des instructions aussi utiles que celles qui sont imprimées, c’est trahir ses intentions que d’en priver le public25. »
26« Trahir ses intentions »… Les morts sont sans défense, et l’on peut impunément autopsier leurs intentions. Parfois pour la bonne cause : les publications posthumes sont susceptibles d’offrir à leur œuvre un supplément de vie. Sans doute pas l’immortalité, soyons raisonnables – ou bien, si, l’immortalité, mais alors au sens où l’entendait Gracq : « la permission pour quelques-uns de continuer à vieillir un peu une fois morts26 ».
Questions de méthode
27La vie des œuvres posthumes est parfois agitée, quelque précaution que l’on prenne avant que le rideau tombe. Chateaubriand, qui avait écrit les Mémoires d’outre-tombe « du fond de son cercueil », avait voulu qu’ils ne soient publiés que cinquante ans après sa mort et qu’ils paraissent en une seule fois. Las, la « triste nécessité » l’a contraint à « hypothéquer [s]a tombe27 » : il a renoncé aux cinquante ans, vendu l’ouvrage à une société en participation qui se chargerait de le faire paraître au lendemain de sa mort, et vu cette société vendre à Émile de Girardin le droit d’en publier le texte en feuilleton dans son journal, La Presse. Comme on pouvait s’y attendre, il réagit vivement à ce dernier accroc fait à sa volonté : « Je suis maître de mes cendres, et je ne permettrai jamais qu’on les jette au vent28 » – puis il laissa faire. Il n’avait guère le choix.
28Quand parurent la préoriginale des Mémoires dans La Presse puis, en 1849 et 1850, l’édition originale chez les frères Penaud, il n’était plus là pour réagir aux interventions de ses éditeurs et exécuteurs testamentaires. Ceux-ci, MM. Lenormant et Maujard, avaient en effet établi un texte imparfait, et timoré : coupes, affadissement stylistique, atténuation de certains jugements, etc. Les premiers lecteurs, dont certains avaient été appâtés par les morceaux choisis lus chez Mme Récamier à partir de 1834, sont déçus. Dans sa Causerie du lundi 18 mars 1850, Sainte-Beuve parle d’un « immense désappointement ». Sans doute ce sentiment n’est-il pas à mettre tout entier sur le compte des éditeurs et de la « publication morcelée29 », mais cela a joué, sans aucun doute.
29C’est une constante : le jugement porté sur un écrit posthume est d’une autre nature que celui que l’on porte sur un livre publié par son auteur. Avec les posthumes, on juge un livre et une édition, un livre à travers une édition. Le lecteur est tributaire, dans une mesure variable, des principes suivis par l’éditeur. Or le texte posthume, surtout lorsqu’il est difficile à établir, exige des interventions – il n’y a rien là que de normal, pour peu que les choix opérés soient pertinents – et, parfois, encourage les manipulations.
30D’où ce lieu commun des introductions et autres avertissements : toute nouvelle édition d’une œuvre posthume prétend restaurer celle-ci dans son authenticité. Cinquante ans après la mort de Chateaubriand paraît une nouvelle édition de ses Mémoires, due à Edmond Biré qui affirme que ce chef-d’œuvre nous est restitué « dans son intégrité première ». Passent encore cinquante années : Maurice Levaillant procure à son tour une édition nouvelle, censée « retrouver dans sa pureté, sinon dans son intégrité, le texte de l’ouvrage30 ».
31Pourtant, l’intégrité est problématique (et ne parlons pas de la pureté). La chercher dans le matériau brut, c’est-à-dire dans le respect aveugle des manuscrits, peut être risqué, et conduire à une relative illisibilité. La restaurer grâce à une profonde réélaboration du matériau (qui peut à l’occasion atténuer ou dissimuler l’inachèvement de l’œuvre) pose le problème de l’authenticité. La plupart des solutions raisonnables sont des compromis ; ceux-ci demandent seulement que l’on expose les règles suivies, et que l’on suive les règles exposées.
32Heureusement, tous les écrits posthumes ne présentent pas de difficultés comparables à celles qui attendent l’éditeur des Mémoires d’outre-tombe, de Lucien Leuwen ou d’Albertine disparue. Mais il arrive que l’intégrité de l’œuvre soit définitivement introuvable ou, pour le dire autrement, que l’intégrité du texte soit absolument incompatible avec la lisibilité de l’œuvre.
33Ce que l’on appelle Dialogues des carmélites, bien que Georges Bernanos n’ait jamais rien écrit qui porte ce titre, illustre bien cette situation. L’édition originale31, établie par Albert Béguin, paraît après la mort de l’auteur. L’ouvrage se présente comme une pièce de théâtre avec tableaux, scènes (certaines étant muettes), noms de personnages et didascalies : rien que de très classique.
34Mais on possède aussi le manuscrit de Bernanos. Y figure un titre autographe différent, La Dernière à l’échafaud. Les scènes muettes – dont le prologue et le dénouement ! – brillent par leur absence. Quant aux scènes dialoguées, elles ne sont pas regroupées en tableaux. L’identité des interlocuteurs est rarement précisée, et de nombreuses indications scéniques font défaut. Un texte inachevé, donc ? Pas vraiment.
35Bernanos n’écrivait pas une pièce de théâtre. On lui avait commandé les dialogues d’un film inspiré d’une nouvelle de Gertrud von Le Fort, La Dernière à l’échafaud, et il les avait écrits en s’appuyant sur le scénario tiré de cette nouvelle par le R. P. Bruckberger et Philippe Agostini. Un dialoguiste n’a que faire des scènes muettes prévues par un scénario : Bernanos ne les a pas recopiées dans son manuscrit, où figurent en revanche toutes les scènes dialoguées par ses soins. Quant aux indications scéniques, toutes ne lui étaient pas utiles, et il pouvait aussi se dispenser d’indiquer systématiquement les noms d’interlocuteurs : pour qui avait le scénario sous les yeux, la plupart d’entre eux allaient de soi.
36Voilà un cas extrême : le manuscrit de l’auteur et le livre publié sous son nom ne portent pas le même titre, n’appartiennent pas au même genre et ne proposent pas tout à fait le même texte. C’est que le film prévu ne s’est pas fait. Après la mort de Bernanos, et en accord avec ses héritiers, Albert Béguin a transformé La Dernière à l’échafaud en Dialogues des carmélites, c’est-à-dire un dialogue de film en pièce de théâtre. Il a normalisé la présentation des répliques, ajouté les scènes muettes d’après le scénario, puisé dans ce scénario ou rédigé lui-même les didascalies qu’il jugeait utiles, et même retenu des passages écartés par l’auteur mais qui lui semblaient préférables à la dernière version du dialogue. Il a, ce faisant, sauvé de l’oubli le dernier travail de Bernanos, et n’a pas cherché à dissimuler son propre rôle. Sa « Note de l’éditeur32 » évoque la démarche qui fut la sienne. Mais les éditions ultérieures omettent généralement cette note33 ; impossible dès lors de deviner que le romancier de Monsieur Ouine n’est pas devenu sur le tard un brillant auteur dramatique.
37Béguin avait compris qu’on ne pouvait établir un texte lisible à partir des seuls dialogues de Bernanos ; cette solution radicale n’aurait mené à rien de bon. Il a donc opté pour une radicalité inverse : il a produit les Dialogues des carmélites à partir des éléments à sa disposition. Lisibilité parfaite, authenticité douteuse. Il faudra attendre 2015 pour que paraisse une édition34 qui, tout en offrant un texte lisible, permette, grâce à quelques artifices typographiques, d’identifier immédiatement – sans avoir à se reporter à l’appareil critique – ce qui, dans Dialogues, appartient à Bernanos. La même édition donne en outre accès, en appendice, aux textes qui préexistaient à son manuscrit : la nouvelle et le scénario.
38Affaire d’époque. La méthode adoptée en 2015 n’était pas envisageable en 1949, de même qu’un montage et un lissage à la Béguin ne correspondent plus aux attentes d’un public exigeant. Il y a en matière d’édition de textes sinon des modes, du moins des tendances. Et la tendance n’est plus aux reconstitutions tacites, non plus qu’à l’effacement de l’inachèvement. Le fragment a désormais droit de cité ; la réception des œuvres inachevées en est modifiée.
39Ce qui ne signifie pas que les éditions historiques à l’authenticité douteuse soient négligeables. Si ce que l’on nomme Les « Pensées » de Port-Royal, c’est-à-dire la réécriture, conforme à la pensée janséniste, des Pensées de Pascal par Port-Royal, comporte des remaniements choquants à nos yeux, on ne saurait oublier que cette édition exerça une grande influence à partir de 1670 et qu’elle constitua longtemps le principal accès aux Pensées. « On ne peut pas comprendre et analyser cette influence sans recourir à cet état du texte35 », estime Michel Le Guern, qui publie par conséquent la version de Port-Royal en appendice à son édition des Pensées dans la Pléiade.
40Quant à Béguin, il bénéficie de la « jurisprudence Pascal ». Les scènes de Dialogues qu’il avait établies d’après des éléments écrits puis écartés par Bernanos ont certes été retranchées du texte, mais elles sont reproduites en appendice. L’histoire de l’œuvre posthume inclut l’histoire de ses éditions.
Paysages éditoriaux avec posthumes
41Quelle place pour l’ouvrage posthume au sein de l’œuvre de l’écrivain ? C’est dans le cadre des éditions collectives, celles qui réunissent plusieurs écrits d’un même auteur, que la question prend toute son importance. Non que le sommaire de telles éditions impose un ordre de lecture : le lecteur choisit librement sa porte d’entrée. Mais il donne à l’œuvre une forme qui n’est pas sans effet sur sa réception future. Ainsi, on ne lit pas Kafka de la même manière dans la première édition de ses Œuvres complètes établie pour la Pléiade par Claude David et dans celle qui vient de paraître sous la direction de Jean-Pierre Lefebvre.
42David se fondait sur la chronologie de rédaction. Les récits et les fragments posthumes étaient donc mêlés aux textes que Kafka avait fait paraître de son vivant. Même les trois recueils conçus par l’écrivain et publiés par lui étaient démembrés, leur contenu étant distribué en fonction de la date d’achèvement de chaque récit. Cela n’a pas échappé à Milan Kundera : « huit cents pages de proses de Kafka deviennent ainsi un flot où tout se dissout dans tout, un flot informe comme seule l’eau peut l’être, l’eau qui coule et entraîne avec elle bon et mauvais, achevé et non-achevé, fort et faible, esquisse et œuvre36. » Le jugement peut paraître sévère ; du moins est-il cohérent avec la condamnation par Kundera du mépris dans lequel les « kafkologues » auraient tenu la volonté esthétique de Kafka.
43Jean-Pierre Lefebvre, quant à lui, ouvre son édition sur les textes publiés par l’écrivain, en recueils, sous forme de plaquettes ou dans la presse. Les écrits posthumes viennent ensuite, et ils sont ordonnés en fonction de leur support : ceux qui sont tirés des cahiers contenant les journaux (lesquels servaient aussi de laboratoire à l’œuvre de fiction) précèdent ceux qui sont conservés dans les liasses ou les cahiers « narratifs » de Kafka, rangés selon leurs dates d’utilisation. Peu importe la section par laquelle le lecteur commence son exploration. Ce dispositif rend à chaque texte son statut et donne de Kafka une image plus nuancée que ne le veut sa légende.
44À chaque œuvre son profil, ses spécificités. Les textes dramatiques, par exemple, ont une double vie : à la scène, en librairie. Molière est censé avoir écrit et représenté deux petites pièces avant 1658. Mais ces farces, La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant, ne sont connues que par des copies manuscrites du xviiie siècle publiées au xixe. On n’a pas accès au texte joué au milieu du xviie. La tradition voulait pourtant que les deux pièces figurent en tête des éditions, conformément à l’ordre des créations. Mais placer à leur date de création des textes conservés dans une recension du xviiie siècle crée une distorsion et fausse la perspective. Dès lors qu’aucun manuscrit du temps de Molière n’a été conservé et que « l’unique voie d’accès à l’œuvre est le texte imprimé37 », il a paru préférable au dernier éditeur en date des œuvres de Molière, Georges Forestier, de donner à lire les imprimés dans l’ordre selon lequel l’auteur puis ses héritiers les ont fait connaître. Le tome I s’ouvre donc sur Les Précieuses ridicules, la première comédie que Molière se soit résigné à laisser publier, tandis que les œuvres posthumes figurent toutes au tome II, à leur date de publication. La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant, qui sont (peut-être) ses deux premières pièces, ferment la marche. Elles ne sont pas écartées du corpus, mais caveat emptor : leur position indique (et l’appareil critique confirme) que leur authenticité n’est pas aussi assurée que celle des pièces imprimées avant 1673, date de la mort de Molière.
45Dans les deux éditions évoquées, celles de Kafka et de Molière, il a donc semblé bon – pour des motifs et avec des résultats différents dans les deux cas – de séparer les posthumes des œuvres publiées par l’auteur. Mais cette solution ne saurait être généralisée. Pour d’autres écrivains, c’est le dispositif inverse qui a été adopté, là encore avec des raisons propres à chaque œuvre.
46Dans les Œuvres complètes de Flaubert en cours de publication dans la Pléiade, ce n’est qu’au tome III que l’on rencontre la première grande œuvre publiée par l’auteur, Madame Bovary ; presque tout ce qui précède est posthume – et aucun autre sommaire n’aurait été raisonnablement envisageable dans le cadre d’Œuvres complètes.
47De même, les Œuvres romanesques complètes de Stendhal sont ordonnées selon la chronologie de la rédaction, et non de la publication. « C’est bien ainsi l’aventure d’une écriture qui se déroule, avec sa logique interne, parfois apparemment illogique38 », annoncent dans la « Note sur la présente édition » Philippe Berthier et Yves Ansel, qui s’empressent d’ajouter que cette mesure inédite a conduit à démembrer les « prétendues Chroniques italiennes », qui étaient une fabrication posthume : « un livre qui n’existe que dans l’idée qu’on s’en fait ». Sur l’ensemble des trois volumes, le dispositif permet, nous dit-on, une « réévaluation de la place et du rôle des nouvelles dans le parcours stendhalien ».
48Chez Diderot aussi, les écrits posthumes sont mêlés aux ouvrages publiés par l’auteur. Mais la décision, ici, a d’autres motifs. Elle tient principalement au fait que certaines œuvres non imprimées du vivant de l’auteur ont connu avant sa mort une certaine diffusion, en particulier grâce à la Correspondance littéraire, périodique copié à la main ; et toute confidentielle qu’a pu être cette diffusion, ce serait jouer sur les mots que de considérer les œuvres qui en ont bénéficié comme des posthumes au sens strict : elles ont bel et bien été divulguées et ont parfois exercé une influence. Il aurait donc été peu pertinent, en l’occurrence, d’utiliser le critère de l’impression comme principe de classement.
49Aux raisons relevant de l’histoire littéraire ou de la nature des œuvres se superpose, on l’aura compris, ce que chaque éditeur veut montrer ou démontrer. Concevoir le sommaire d’une édition, favoriser un mode de lecture, c’est déjà faire de la critique. Dans l’exécution de ce dessein, les ouvrages posthumes sont de parfaits auxiliaires.
50Rien de plus éloquent à cet égard que la manière dont Jean-François Louette explique pourquoi, dans le volume de Romans et récits de Georges Bataille établi sous sa direction en 2004, tous les textes, qu’ils soient posthumes ou publiés par l’auteur, sont mêlés, et classés à leur date de rédaction, alors qu’en 1971 Thadée Klossowski avait séparé les Œuvres littéraires du même Bataille de ses Œuvres littéraires posthumes39.
Division traditionnelle [concède J.-F. Louette] mais moins naturelle qu’il ne paraît dans le cas d’un auteur qui écrit dans L’Expérience intérieure : « À l’extrémité fuyante de moi-même, déjà je suis mort, et je dans un état naissant de mort parle aux vivants : de la mort, de l’extrême » ; ou encore, dans un poème retiré de L’Archangélique : « Je parle de chez les morts40. »
51Prendre une décision, puis la faire endosser à l’auteur, sans le trahir, mais en lui empruntant l’expression d’une posture d’énonciation susceptible de renforcer le bien-fondé du dispositif adopté, ce n’est pas seulement habile, c’est du grand art.
52On multiplierait à l’infini les exemples. Après que leur auteur a trouvé refuge chez les morts, les œuvres importantes continuent à grandir, sous l’effet de différents désirs, parfois opposés. Ce que l’on sait de la volonté de l’écrivain est essentiel dans les premières années. Si l’on ne sait rien, ou si l’on a oublié ce que l’on savait, le passage du temps peut légitimer les audaces éditoriales et agréger, ou non, à l’œuvre anthume les suppléments mis au jour. Quand la greffe ne prend pas, le texte révélé reste un document d’archives et finit dans un appareil critique. Si au contraire il s’impose, l’œuvre s’en trouve relancée, rajeunie, parfois renouvelée. Publié en 1994, Le Premier Homme est depuis lors l’un des livres le plus lus de Camus41.
53Ajoutons à cela que les œuvres posthumes donnent à rêver. Leur éventuel ou, selon Milan Kundera, inéluctable inachèvement y est pour quelque chose. Le champ des possibles s’étend à perte de vue. Serait-ce ce qu’avait en tête Pier Paolo Pasolini en donnant à son dernier roman, Pétrole, la forme d’une ébauche, inachevée, inachevable42 ? Un roman fictivement posthume en somme. Hasard ou nécessité, il est devenu doublement posthume. Il a été publié pour la première fois, inachevé dans son inachèvement même, dix-sept ans après l’assassinat de son auteur. « Pauvre Pasolini, trahi en librairie », a titré la presse italienne, qui déplorait que l’on publie un « brouillon ». Refrain connu. Pétrole est aujourd’hui l’une des clefs qui ouvrent l’œuvre de Pasolini.
1 Ce texte prend appui sur notre article publié dans La Lettre de la Pléiade, no 63, février-mai 2018, p. 8-12 : « Les Œuvres posthumes : quand, pourquoi, comment ? ».
2 Entrée en vigueur le 1er juillet 1995, elle a été transposée en droit français par la loi du 27 mars 1997.
3 Voir le Code de la propriété intellectuelle (CPI), article L123-1. La période de soixante-dix années commence en fait le 1er janvier de l’année suivant l’année du décès.
4 CPI, article L123-4. On n’entrera pas ici dans le détail des exceptions qui compliquent l’application de ces dispositions.
5 Voir l’article L121-1 du CPI.
6 L’article L121-2 du CPI précise l’ordre de dévolution du droit de divulgation : au premier rang, l’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur, puis viennent les descendants, le conjoint non remarié, les héritiers autres que les descendants et les légataires universels. C’est donc le choix de l’auteur qui prime.
7 Voir l’article L121-3 du CPI.
8 Les juges rappelaient dans le même attendu que cet ayant droit « dévolutaire du droit de divulgation » avait été « investi plus de quarante ans après la mort du poète » : il n’avait donc pas été choisi par l’auteur.
9 Cité par Pierre Nora dans l’« Avertissement de l’éditeur » publié en tête du Journal 1939-1945 de P. Drieu la Rochelle, Paris, Gallimard, coll. « Témoins », 1992, p. 7-8. Les citations suivantes proviennent du même Avertissement.
10 Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (1969), dans Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 1262.
11 Elle est traduite par Maurice Couturier en tête de sa version française de L’Original de Laura (roman opportunément sous-titré : C’est plutôt drôle de mourir), Paris, Gallimard, 2010, p. 11-19.
12 Ibid., p. 19.
13 « Pourquoi L’Original de Laura de Nabokov n’aurait jamais dû être publié », Slate.fr, 17 novembre 2009.
14 « La parution de L’Original de Laura banalise le travail de Nabokov », propos recueillis par Marie Le Douaran, L’Express, 23 avril 2010.
15 Dans « Qu’est-ce qu’un auteur ? », art. cité, p. 1262-1263. Citations, p. 1263.
16 « Dmitri Nabokov : “ C’est comme si mon père apparaissait et me disait ‘Publie-le’ ” », propos recueillis par Pierre Thaulaz, L’Express, 22 décembre 2010.
17 Introduction à L’Original de Laura, éd. citée, p. 19.
18 Voir la IXe partie, « Là, vous n’êtes pas chez vous, mon cher », Œuvre, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 977-1004.
19 Ibid., p. 993 et 996.
20 Ibid., p. 1002. Parfois mal comprise, cette page a été retravaillée par Kundera à l’occasion de réimpressions des Testaments trahis.
21 Ibid., p. 985.
22 Ibid., p. 1002.
23 M. Foucault, « Sur les façons d’écrire l’histoire », entretien avec Raymond Bellour, Les Lettres françaises, 15-21 juin 1967 ; Dits et écrits, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001, t. I, p. 621.
24 Lettre à Gabriel Cramer, 31 mars 1770 ; Correspondance, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. X, p. 202.
25 Montesquieu, Œuvres complètes, t. XII, à Paris, chez Pierre Didot l’Aîné, An III / 1795, p. 189 et 190.
26 Julien Gracq, « Un centenaire intimidant » (1954), Préférences ; Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 926.
27 Chateaubriand, Avant-propos de 1846, Mémoires d’outre-tombe, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 2 et 1.
28 Déclaration reproduite dans La Mode du 5 décembre 1844 ; citée par Bruno Chaouat, « Restaurer les Mémoires d’outre-tombe : une fiction éditoriale », Romantisme, no 91, 1996, p. 106.
29 Sainte-Beuve, Causeries du lundi, 3e éd., Paris, Garnier Frères, 1857, t. I, p. 433.
30 Respectivement, Edmond Biré dans l’introduction de son édition des Mémoires, Paris, Garnier Frères, 1898, t. I, p. xxvii ; et Maurice Levaillant dans l’introduction de son édition dite « du Centenaire », Paris, Flammarion, 1948, t. I, p. lxxxviii. Voir B. Chaouat, art. cité, p. 100-101.
31 Georges Bernanos, Dialogues des carmélites, Neuchâtel, La Baconnière / Paris, Le Seuil, 1949.
32 Ibid., p. 233-237.
33 C’est le cas de l’édition publiée au Seuil dans la collection « Livre de vie ».
34 G. Bernanos, Œuvres romanesques complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, suivies de Dialogues des carmélites ; voir p. 789 et suiv.
35 Notice des « Pensées » de Port-Royal, Œuvres complètes de Pascal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 1596.
36 Les Testaments trahis ; Œuvre, éd. citée, t. II, p. 996.
37 Georges Forestier, « Note sur la présente édition », Œuvres complètes de Molière, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. cix.
38 Œuvres romanesques complètes de Stendhal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. lxxxiv. De même pour les citations suivantes.
39 Les premières se trouvent réunies au tome III, les secondes au tome IV des Œuvres complètes publiées dans la collection « Blanche ».
40 « Note sur la présente édition », Romans et récits de Georges Bataille, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. cxl.
41 Étant entendu que L’Étranger reste hors compétition.
42 Voir Daria Bardellotto, « Un roman né posthume », site Salon double. Observatoire de la littérature contemporaine, 2013, en ligne : http://salondouble.contemporain.info/article/un-roman-ne-posthume, page consultée le 27 avril 2020.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen Normandie en juin 2018, publiés par Aurélien d’Avout et Alex Pepino
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 25, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/857.html.
Quelques mots à propos de : Hugues Pradier
Directeur éditorial de la collection « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard
