Sommaire
Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières
Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot
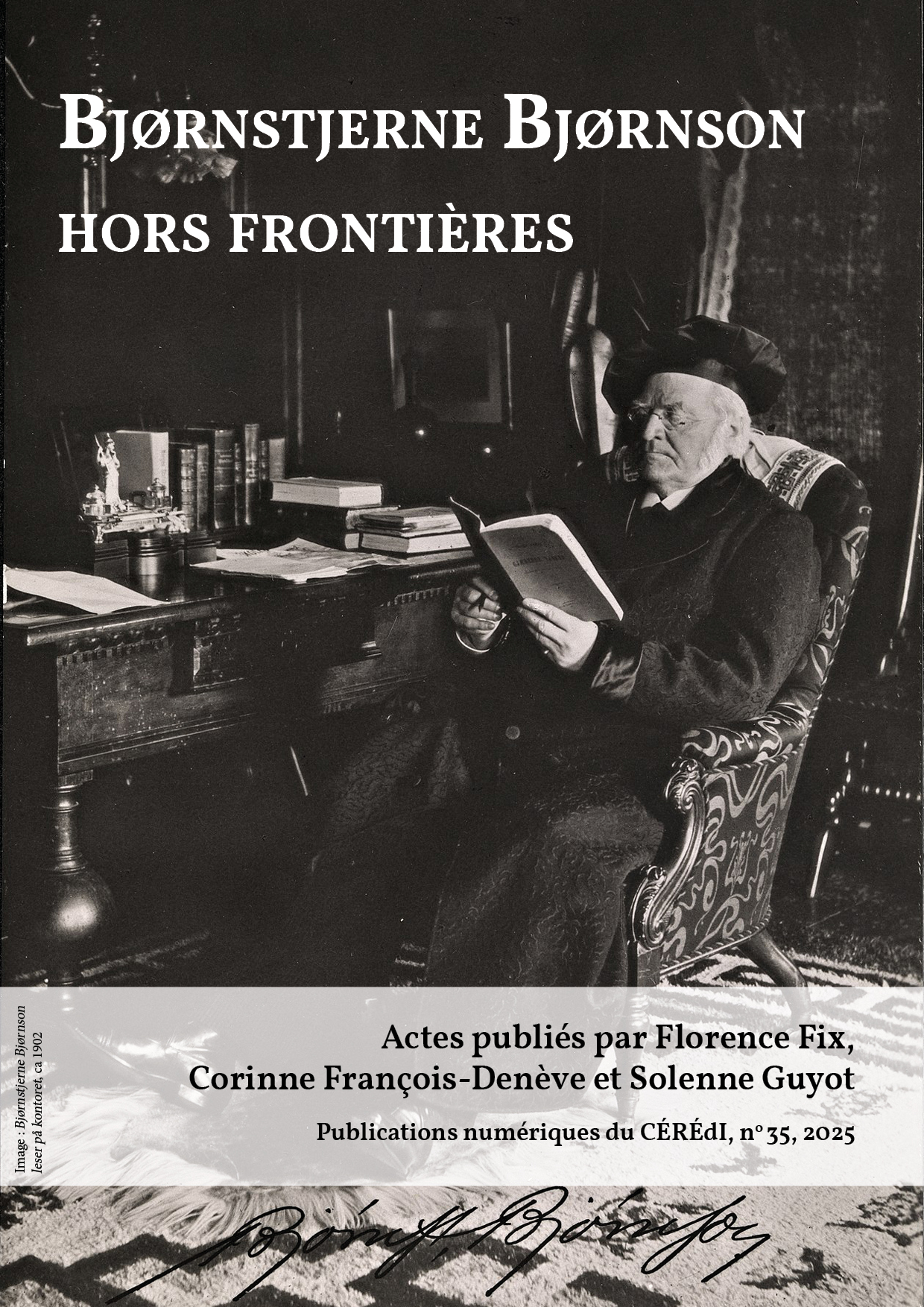
- Solenne Guyot Avant-propos
Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle - Corinne François-Denève et Solenne Guyot « Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]
- Annie Bourguignon Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart
- Cécile Leblanc Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin
- Nicolas Diassinous Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe
- Miloš Mistrík Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !
- Marthe Segrestin Leonarda et Nora, fausses jumelles
Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières
Leonarda et Nora, fausses jumelles
Marthe Segrestin
1[Note de l’auteur]1
2On a souvent comparé les auteurs norvégiens Bjørnstjerne Bjørnson et Henrik Ibsen, amis autant que rivaux. Nés respectivement en 1832 et 1828, ils ont de nombreux points communs : ils sont tous deux écrit leurs premières œuvres dans un contexte de renaissance nationale, et ont marqué l’histoire du théâtre norvégien en dirigeant successivement les mêmes théâtres, Det Norske Theater de Bergen, et le Christiania Theater, dans les années 1850 et 1860. Ils ont tous deux voyagé, et se sont ralliés, dans les années 1870, aux mots d’ordre de la percée moderne et à Georg Brandes, qui invitait à se détourner du romantisme national pour s’inspirer des grands noms du romantisme libéral européen, ancré dans le réel. Ibsen et Bjørnson, s’ils ont écrit tous deux des pièces historiques, ont aussi le souci de mettre en scène la société contemporaine et ses problèmes, ce qui leur vaut d’être classés parmi les premiers Hommes de la percée moderne par Georg Brandes en 18832. Celui-ci, qui compare les deux auteurs sous l’angle de la modernité, considère Ibsen comme « le plus moderne des modernes » (« den moderneste af de Moderne3 »), notamment dans ses dernières pièces4, mais salue aussi les pièces modernes de Bjørnson, dont Une faillite (En fallit, 1875), Le Journaliste (Redaktøren, 1875), qui sont pour lui ses premières œuvres majeures5. Ibsen et Bjørnson ont tous deux à cœur de mettre leur théâtre au service de la liberté et de la vérité. Dans un discours célèbre prononcé le 31 octobre 1877, devant l’Association des étudiants norvégiens (Det Norske Studentersamfund), intitulé « Om at være i Sandhed6 » (« Être dans la vérité »), Bjørnson rend d’ailleurs hommage à la pièce d’Ibsen parue la même année, Les Piliers de la Société (Samfundets støtter), qui est dédiée à « l’esprit de vérité et de liberté » (« sandhedens og frihedens ånd7 »).
3En 1879, paraissent et sont jouées Leonarda de Bjørnson et Une maison de poupée (Et dukkehjem) d’Ibsen, dont les principales protagonistes, Leonarda et Nora, ont plus d’un point commun, et que les contemporains ont immédiatement comparées : la première est séparée de son mari depuis plusieurs années quand commence l’action, la seconde quitte son mari et ses enfants à la fin de la pièce ; et toutes deux font le procès d’une morale sociale inique pour les femmes.
4Aujourd’hui, pour d’autres raisons, il est intéressant de comparer ces deux pièces, qui ont connu des destins contraires : alors même que Bjørnson jouissait de son vivant d’une popularité sans égale, sa pièce n’a pas passé l’épreuve du temps et n’est plus guère jouée en Norvège ni à l’étranger. Une maison de poupée, en revanche, est entrée dans le panthéon de la littérature mondiale, et a été inscrite, en 2001, dans le registre de la mémoire du monde de l’UNESCO8. Malgré les affinités entre Leonarda et Nora, c’est la réception de ces deux pièces qui permet d’identifier ce qui les oppose en réalité : Leonarda s’inscrit parfaitement dans l’horizon d’attente de son premier public ; au contraire, Une maison de poupée est insolite en 1879, son horizon d’attente étant en quelque sorte « déplacé, différé9 », Nora attendant le xxe siècle pour rencontrer son public.
Synopsis
5Quand Leonarda est créée au Christiania Theater en avril 1879, que Bjørnson a dirigé entre 1857 et 1859, celui-ci jouit déjà dans les pays scandinaves d’une grande renommée, comme romancier, poète, et dramaturge. Et Leonarda n’est pas son premier drame social, il a déjà écrit Une faillite (En fallit) et Le Journaliste (Redaktøren). Dans Leonarda, il poursuit sur cette lancée en attaquant le double standard régissant le mariage, la bonne société ostracisant les femmes ayant un « passé » alors qu’elle accueille à bras ouverts les hommes dans la même situation.
6Leonarda Falk n’est plus une jeune fille. Herman Bang, alors écrivain et journaliste danois renommé, la décrit dans le journal Nationaltidende, comme « la femme de trente ans, la femme à la fleur de l’âge et pleinement consciente de son pouvoir10 ». Cette femme a un passé, qui reste mystérieux. On apprend par l’évêque qu’elle s’est mariée, a divorcé à l’étranger, et est revenue en Norvège depuis huit ans, vivant seule et gérant seule son domaine. Son besoin d’amour s’est reporté sur sa nièce Ågåt, orpheline. Celle-ci, quand la pièce commence, vient présenter à sa tante son fiancé Hagbart, un étudiant en théologie qui a insulté en public Leonarda quelques semaines plus tôt, en la traitant de femme « équivoque » (« tvetydig »). Par amour pour sa nièce, Leonarda surmonte son antipathie pour aller parler mariage avec l’oncle du jeune Hagbart, qui est évêque. Le dialogue entre Leonarda et l’évêque, à l’acte II, est l’occasion d’une critique de la double morale : alors que l’évêque reçoit chez lui des hommes plus qu’équivoques, comme un certain général Rosen, il ne peut supporter l’idée de recevoir chez lui Leonarda, et refuse tout mariage de son neveu avec Ågåt à moins que la tante ne disparaisse.
7Un coup de théâtre vient compliquer l’intrigue à la fin de cet acte II, quand la perspicace Ågåt vient révéler ce dont Hagbart et sa tante ne sont eux-mêmes qu’à moitié conscients, à savoir que ceux-ci sont amoureux l’un de l’autre. Elle a vu juste, Leonarda et Hagbart s’avouent à l’acte III la passion irrépressible et réciproque qui les pousse dans les bras l’un de l’autre, et Ågåt vient assurer sa tante qu’elle se sacrifie sans amertume pour leur bonheur.
8Mais c’est finalement Leonarda qui se sacrifie, quand elle sent qu’elle s’apprête à faire le malheur de sa nièce. Elle va faire ses adieux à l’évêque, lui remet une lettre pour Ågåt, à qui elle laisse son domaine, et prie l’évêque de faire tout son possible pour que Hagbart et Ågåt soient heureux ensemble. Elle lui révèle qu’elle s’embarque pour les États-Unis avec le général Rosen, qui n’est autre que le mari dont elle est divorcée. Quand Hagbart et Ågåt arrivent chez l’évêque, à la fin de l’acte IV, Leonarda et Rosen sont partis. Ågåt s’évanouit et Hagbart tombe dans les bras de son oncle.
9Et dukkehjem, la pièce d’Ibsen, est créée quelques mois plus tard, en décembre 1879, non pas au Chritiania Theater comme celle de Bjørnson, mais sur la scène nationale du Danemark, au Kongelige teater de Copenhague.
10Tandis que Leonarda est séparée de son mari depuis huit ans, Nora, elle, est mariée depuis huit ans à l’avocat Helmer, qui vient d’être nommé directeur de banque, et mère de trois enfants. Elle rayonne à l’idée de l’aisance que va leur procurer cette nouvelle situation, d’autant plus qu’elle a quasiment fini de rembourser une dette qu’elle a contractée en secret quelques années plus tôt pour sauver la vie de son mari. Mais Krogstad, son créancier, menacé d’être renvoyé de son poste à la banque, vient rappeler à Nora son crime – elle a fait un faux pour obtenir le prêt – et menace de tout révéler à son mari si elle ne lui évite pas ce renvoi. Après plusieurs péripéties, Krogstad révèle tout à Helmer qui s’emporte violemment contre Nora, en qui il ne voit plus qu’une criminelle dénuée de morale et dangereuse pour leurs enfants. Il a beau retirer ses paroles une fois reçue la lettre de rétractation de Krogstad, le mal est fait. Nora devient sérieuse : profondément déstabilisée par les reproches de Helmer, elle se rend compte que personne – ni son père ni son mari – ne lui a donné les moyens de devenir autre chose qu’une simple poupée. Elle prend conscience alors qu’elle a le devoir de devenir « un être humain » (« et menneske ») à part entière, de s’éduquer, avant de pouvoir prétendre être quoi que ce soit d’autre, épouse ou mère. Après une longue scène où elle « règle ses comptes » à l’acte III, elle quitte la maison, abandonnant mari et enfants.
11Même si les personnalités et situations de leurs personnages étaient différentes, Bjørnson et Ibsen ont posé à peu près au même moment la question des femmes, et mis en scène deux femmes prenant ou ayant pris leur destin en main, face à des maris, une société ou une église qui les jugeaient sévèrement.
Deux pièces scandaleuses
12Les scandales provoqués par chacune des pièces ne sont pas du tout de même nature. Dans le cas de Leonarda, c’est le fait que le Kongelige teater de Copenhague ait rejeté la pièce qui fait scandale davantage que la pièce elle-même. Dans le cas d’Ibsen au contraire, c’est bien la pièce, créée au Kongelige teater, qui fait scandale.
13Leonarda reçoit un bon accueil en Norvège, au printemps 1879, au Christiania Theater, puis à la Komediehuset de Bergen11. Mais une polémique est déclenchée à la fin de l’été dans la presse au Danemark et en Norvège, quand la rumeur se confirme que la pièce a été refusée par le Kongelige Teater de Copenhague. Alors qu’au même moment Leonarda est publiée à Copenhague par les éditions Gyldendal (qui publieront en décembre Et dukkehjem), la presse danoise s’émeut de cette censure et de l’humiliation infligée à Bjørnson. La polémique allant croissant, Christian Knud Frederik Molbech, le responsable de la censure au Kongelige Teater, se justifie dans un long article publié le 3 octobre 1879 dans le Berlingske Politiske og Avertissementstidende, expliquant les raisons de l’avis négatif émis dès le mois d’avril, et énumérant les faiblesses de la pièce, qu’il n’était d’ailleurs pas le seul à pointer. Il résume longuement la pièce, se disant gêné par la vision trop caricaturale de la bonne société – l’évêque est en effet flanqué de quelques représentants assez grotesques de cette société – ainsi que par le « feu d’artifice érotique » (« erotisk fyrværkeri ») de la scène d’aveu de l’acte III entre les « nouveaux Roméo et Juliette12 ».
14Mais surtout, Molbech attaque la pièce de Bjørnson en la comparant à une pièce d’Eugène Scribe, Bataille de dames13, qui a été jouée à plusieurs reprises sur la scène du Christiania Theater à partir de 1852, et notamment en 1865, au moment où Bjørnson en était le directeur. Scribe jouit toujours, dans les pays scandinaves, d’une grande popularité, et Bataille de dames est pour Leonarda un hypotexte explicitement revendiqué, Ågåt indiquant à l’acte III à sa tante que leur situation lui rappelle la comédie de Scribe, si ce n’est que chez Scribe, le jeune Henri qui doit choisir entre une femme remarquable et sa nièce « sotte » (« dum ») et « insignifiante » (« ubetydelig »), choisit celle-ci14. Ågåt veut un autre dénouement pour le drame qu’elles rejouent, et entend s’effacer devant sa merveilleuse tante. Pour Molbech, non seulement Leonarda ne soutient pas la comparaison avec le glorieux hypotexte, mais le fait de s’en réclamer renforce encore l’impression de médiocrité laissée par la pièce et son dénouement, dont Molbech n’est pas le seul, d’ailleurs, à estimer qu’il est raté :
Dans Bataille de dames, la femme amoureuse se sacrifie, mais ne sacrifie qu’elle ; les deux jeunes s’aiment et n’ont pas connaissance de son sacrifice. Elle s’en va, simplement et sans phrases ; mais elle ne se jette pas dans les bras d’un homme qu’elle méprise. Ici, il y a réconciliation et conclusion, une résignation douce et mélancolique d’un côté, et une entière et pleine joie de l’autre ; sans parler du fait que l’idée principale, riche et belle, est également développée dans une intrigue intéressante, complexe et véritablement dramatique. Dans la pièce de Bjørnson, il n’y a rien de tout cela. Leonarda ne se contente pas de se sacrifier, elle sacrifie aussi l’homme qui l’aime, et peut-être une troisième personne, Aagot, si celle-ci et Hagbart se marient et deviennent malheureux15.
15La conclusion de Molbech est sans appel pour Leonarda : la réécriture de Bataille de dames est ratée, l’intrigue sèche et conventionnelle, sans développement dramatique, sans motivation claire, sans situations intéressantes et sans véritable dénouement.
16Ce jugement sévère aurait pu ne pas faire autant polémique si Molbech le censeur n’avait pas aussi été un dramaturge joué sur la scène du Kongelige teater. En 1878, sa pièce Ambrosius y a été représentée avec un certain succès, et en septembre 1879, on répète, toujours au Kongelige teater, sa nouvelle pièce, L’Anneau du pharaon (Faraos Ring), créée le 26 octobre 1879, jouée jusqu’en décembre, jusqu’à la création d’Une maison de poupée le 21 décembre !
17Edvard Brandes n’attend pas la première de L’Anneau du pharaon pour publier le 5 octobre dans Morgenbladet, anonymement, ce qu’il pense de la censure de Molbech. S’il peine à convaincre en faisant l’éloge de Leonarda, il devient acerbe quand il s’agit de comparer le grand auteur norvégien, qualifié de « digter » et de « forfatter » (« poète » et « écrivain »), et le « professor Molbech », reprochant à celui-ci de craindre la concurrence d’un auteur reconnu et indiscutable et concluant qu’il « n’y a pas le moindre soupçon d’argument dans sa censure16 ».
18Dès la fin octobre, la polémique s’envenime et déborde la question théâtrale pour devenir politique, opposant progressistes et conservateurs, ceux-ci ne pardonnant pas à Bjørnson ses positions radicales et anticléricales. Le scandale éclate lors de la création de L’Anneau du pharaon, le 26 octobre, au théâtre et dans la presse : deux camps s’opposent et s’affrontent, les conservateurs qui applaudissent Molbech et les progressistes qui le sifflent. Les représentations de L’Anneau du pharaon sont chahutées, et une certaine presse éreinte Molbech, dont la pièce est tellement mauvaise, pour le critique du Dagens nyheder (2 novembre 187917), que Leonarda, sans être excellente, est toujours meilleure par comparaison. Et quand le Folketeatret de Copenhague met en scène la pièce de Bjørnson le 26 janvier 1880, c’est de nouveau l’occasion d’une bataille rangée et de représentations troublées par des altercations entre partisans de Bjørnson et amis de Molbech. Edvard Brandes, qui avait défendu de façon anonyme Bjørnson dans Morgenbladet, décrit dans le magazine Ude og Hjemme la première de Leonarda au Folketeatret : « La première représentation de Leonarda au Folketeatret s’est déroulée dans un tel tumulte, le jeu étant interrompu de manière si brutale, que la poésie douce et modérée de la pièce n’a pas pu pleinement toucher le public18. »
19Ce scandale est donc le résultat d’une censure idiote, la pièce de Bjørnson n’ayant rien de bien scandaleux, si ce n’est un portrait assez peu flatteur des représentants de la société puritaine et la petite leçon de morale de Leonarda à l’évêque. Et la censure de Molbech paraît d’autant plus absurde et incompréhensible qu’elle ne s’applique pas à Une maison de poupée, créée au Kongelige teater le 21 décembre, comme le remarque encore Edvard Brandes : « il est difficile de comprendre pourquoi une pièce aussi révolutionnaire qu’Une maison de poupée est acceptée, alors qu’on rejette un drame comme Leonarda, dont la morale est la résignation et le sacrifice19. »
20La pièce d’Ibsen est en effet autrement scandaleuse, et le scandale se produit, éteignant à peu près instantanément l’incendie déclenché par la censure de Leonarda. On a cette fois un vrai scandale de théâtre, et un succès de scandale. La première édition, qui paraît quelques jours avant la création de la pièce à Copenhague, est épuisée en moins d’un mois20. Dès le début de l’année 1880, la pièce est jouée à Stockholm, Christiania (Oslo), Bergen, Helsingfors (Helsinki), puis en Allemagne, en Autriche, en Russie, en Pologne, avant de s’imposer dans toute l’Europe et aux États-Unis.
21Le dénouement, la désertion de Nora, est pour beaucoup dans la sidération des publics : Nora, en abandonnant mari et enfants, est érigée instantanément en porte-drapeau des féministes21, comme le rappelait Strindberg dans la préface de Mariés (Giftas) : « le fait que [la pièce] donna l’impression d’être un manifeste en faveur de la femme opprimée, et que le grand public l’interprétait ainsi, provoqua tout de suite une telle tempête que même les gens les plus calmes perdirent la tête22. » La mère au foyer gazouillante de l’acte I, a priori moins forte, moins armée que Leonarda, la femme divorcée, n’a pas d’abord la carrure de celle-ci, qui paraît plus mûre, plus disposée à défendre la cause des femmes. Mais Leonarda capitule tandis que Nora se redresse et quitte sa famille avec l’espoir de devenir un « être humain » (« et menneske »), récusant – déjà – le présupposé essentialiste cantonnant « la » femme à ses rôles « naturels » d’épouse et de mère.
22Par ailleurs, comme nous allons le voir, la pièce d’Ibsen ne déclenche pas seulement une tempête féministe, mais représente aussi un séisme esthétique. Alors que Bjørnson ne se démarque pas du tout du moule dramaturgique façonné par Scribe et repris par ses héritiers, Dumas fils et Augier, qui y ont ajouté une dimension sociale, Ibsen subvertit radicalement ce modèle, avec des personnages et des situations qui n’ont plus rien à voir avec les types et intrigues des pièces françaises, préfigurant un théâtre nouveau.
La question des femmes
23La « question des femmes » n’est pas nouvelle, au théâtre comme dans le roman. Dans les pays nordiques, des autrices ont devancé Ibsen et Bjørnson sur ce sujet : Camilla Collett a dénoncé dès 1855, dans Les Filles du préfet (Amtmandens døttre23), le manque d’éducation des femmes, Fredrika Bremer leur manque de liberté dans son roman Hertha24 ; en France, Alexandre Dumas fils et Émile Augier, deux dramaturges dont la popularité est attestée partout en Europe, ont abordé la question de la place des femmes dans la société. Dumas fils notamment, s’est donné pour mission de les défendre, fustigeant les lois faites par les hommes pour les hommes, défendant les droits des femmes dans une société qui ne leur assigne que des devoirs, dénonçant notamment les hypocrisies sociales et les anathèmes jetés sur les filles-mères25.
24Bjørnson, avec Leonarda, s’inscrit dans la continuité des pièces de Dumas fils et Augier, ceux pour lesquels Émile Faguet a cherché une étiquette, « comédie-drame » ou « drame-comédie de 185026 » :
Une pièce très peu gaie, souvent très triste, peignant des caractères ou des mœurs, à prétentions philosophiques ou sociologiques, très savamment charpentée et soutenue d’une intrigue compliquée, ornée ou surchargée de développements oratoires ou de digressions spirituelles27.
25Comme Dumas fils et Émile Augier, Bjørnson a été très marqué par Scribe : quand il dirige le Christiania Theater entre 1865 et 1867, plusieurs pièces de Scribe sont mises à l’affiche, parmi lesquelles En kone som springer ud af vinduet (Une femme qui se jette par la fenêtre), Kjærligheds Drømme (Rêves d’amour), Naar Damer føre Krig (Bataille de Dames) et Kammeraterne (La Camaraderie)28.
26Comme eux par ailleurs, dans ses pièces modernes, il incorpore des leçons de morale et des problèmes dans un moule dramaturgique qui fait encore recette dans les années 1870, que ce soit dans Une faillite, Le Journaliste, Le Nouveau Système, Leonarda ou Un gant. Contrairement à Ibsen, Bjørnson reconnaissait volontiers l’influence de ces auteurs sur son théâtre, à tel point que dans Det moderna dramat (Le Drame moderne), Martin Lamm le considère comme un auteur qui s’est fixé pour but d’être à la Norvège ce qu’Augier a été à la France29. Dans ses pièces à thèse, Bjørnson se bat sur plusieurs fronts, avec cette même volonté de faire œuvre utile, de changer la société : il y défend aussi bien la liberté de pensée que les droits des femmes, réclamant dans Leonarda et Un gant que les mêmes codes moraux s’appliquent aux hommes et aux femmes.
27Dans Leonarda, d’une façon très habile, Bjørnson intègre la leçon de morale sur le double standard dans un drame très conventionnel, où il ne manque aucun des ingrédients attendus : la rivalité amoureuse, le coup de foudre, les amours contrariées, les péripéties et le coup de théâtre final. Par ailleurs, Leonarda n’est pas seule contre tous pour plaider la cause des femmes divorcées : sa nièce est prête à se sacrifier pour le bonheur de sa tante, et le jeune Hagbart, qui s’est d’abord défié de cette femme douteuse, devient son plus fervent défenseur après leur coup de foudre. Et surtout, la révolte de Leonarda contre le procès qu’on lui fait n’a rien pour effrayer le public, car la leçon est distillée dans un drame passionnel qui transfigure l’héroïne, et métamorphose sa révolte en résignation. Leonarda est au bout du compte une féministe bien peu redoutable ; au contraire, elle finit même par s’attirer la compassion de l’évêque qui l’a d’abord condamnée. Elle paraît d’ailleurs aussi délicieuse aux quelques critiques français qui la découvrent à la fin du xixe siècle que Nora leur paraît odieuse. Dans le livre que Maurice Bigeon consacre au théâtre scandinave en 1894, Leonarda est encensée : elle est « la sublime amoureuse30 », par opposition aux femmes froides et révoltées d’Ibsen, et à Nora en particulier, qui se métamorphose en être cérébral et raisonneur, qui s’émancipe de tout amour, et donc de ce qui est alors l’apanage absolu du féminin.
28La même année 1894, dans la préface de la traduction française d’Auguste Monnier, Maurice Bigeon fait l’éloge de Leonarda, le « chef d’œuvre purement dramatique de Björnson, et le drame le plus sonore, le plus éclatant, le plus largement humain de tout le théâtre scandinave31 ». Il ne s’y est pas trompé : par rapport aux héroïnes d’Ibsen qu’Antoine, au Théâtre Libre, et Lugné-Poe au Théâtre de l’Œuvre, ont commencé à mettre en scène, Leonarda lui paraît touchée par « un rayon de la grâce latine », « sublime à force d’héroïsme, sainte à force de dévouement32 ». Leonarda est explicitement comparée à Nora, qui choisit la révolte, là où Leonarda choisit « l’amour infini » :
Mieux vaut donc la révolte ? Non, car Nora, qu’est-elle devenue ? et que fût devenue Madame Alving33 ? Elles auraient pu, sans doute, Leonarda pourrait comme elles s’en aller à travers la terre, droit devant elles, écrasant sous leurs pieds les préjugés fragiles, debout dans leur orgueil et dans leur volonté ; mais après34 ?
29Nora, en effet, au moment où Leonarda incarne la charité, représente pour les féministes et les progressistes l’incarnation de la révolte. Elle pose la question des femmes d’une façon qui a permis à des générations de femmes de s’identifier à celle qui refuse, à la fin de la pièce, d’être réduite à ses rôles d’épouse et mère :
helmer
Avant tout, tu es épouse et mère.
nora
Je ne crois plus à cela. Je crois qu’avant tout je suis un être humain, au même titre que toi… ou au moins que je dois essayer de le devenir35.
30Même si Ibsen s’est toujours défendu d’être un auteur féministe36, il n’a pu empêcher que Nora soit adoptée par les féministes, aussi bien à la fin du xixe siècle que tout au long du xxe siècle : elle est citée en exemple dans Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir (1949), dans le chapitre consacré à la situation de la femme mariée :
Il faudrait que le mariage fût la mise en commun de deux existences autonomes, non une retraite, une annexion, une fuite, un remède. C’est ce que comprend Nora quand elle décide qu’avant de pouvoir être une épouse et une mère, il lui faut devenir d’abord une personne37.
31Un peu plus tard, c’est Betty Friedan, autre grande figure du féminisme aux États-Unis, qui estime en 1963, dans The Feminine Mystique, que le message de Nora continue de résonner avec force :
When [Ibsen] said in the play “A Doll’s House” in 1879, that a woman was simply a human being, he struck a new note in literature. Thousands of women in middle-class Europe and America, in that Victorian time, saw themselves in Nora. And in 1960, almost a century later, millions of American housewives, who watched the play on television, also saw themselves38.
32Nora est bel et bien devenue un symbole des luttes féministes, comme cela apparaît dans l’argumentaire en anglais de l’inscription de la pièce dans le registre de la mémoire du monde de l’UNESCO39 (nous soulignons) :
In the twentieth century, the effect of the play spread to include Asia and the Third World, where its form became symbolic of modern Western drama and its content symbolic of values such as human rights and existential freedom. […] [Nora] has served and serves as a symbol throughout the world, for women fighting for liberation and equality.
33Cependant, le destin féministe de Nora n’est pas la seule chose qui la distingue de la « sublime » Leonarda, le seul élément qui expliquerait qu’elle soit devenue mythique alors que Leonarda n’a pas résisté au temps. Celle-ci ne dépare pas la galerie des personnages sympathiques des comédies-drames du xixe siècle, alors que Nora défigure son type, égarant son premier public dont Ibsen subvertit les repères.
Leonarda plus « repérable » que Nora
34Nora n’est pas devenue mythique seulement parce qu’elle a eu le courage de quitter son mari et ses enfants, mais aussi parce qu’elle reste une énigme. Si la dramaturgie d’Ibsen est si révolutionnaire à la fin des années 1870, c’est parce qu’il fait en sorte que ses personnages ne soient plus « repérables », pour reprendre une expression de Robert Abirached40.
35Dans les pièces « sociales » de Bjørnson, les personnages sont aussi repérables que ceux de Scribe, Dumas fils, Augier et Sardou : le schéma actantiel est clair, comptant les personnages sympathiques d’un côté, les personnages antipathiques de l’autre, le raisonneur, l’innocente. Dans ce théâtre utile, le message, la thèse, sont portés par des personnages sympathiques, parfois jusqu’à la caricature. Même Ferdinand Brunetière reconnaît à la fin du xixe siècle que le théâtre a abusé de ce type :
La mère à qui l’on a pris son enfant, le père dont on a déshonoré la fille, l’ouvrière séduite, le mari trompé, l’épouse trahie, le fils naturel, que sais-je encore ! voilà ce qu’on appelle vulgairement des personnages sympathiques, et je ne veux pas nier qu’on en ait singulièrement abusé, qu’on en abuse étrangement tous les jours41.
36Leonarda est elle-même parfaitement repérable, rappelant les femmes hyperboliquement sympathiques de Dumas fils : on pense bien sûr à Marguerite Gautier, qui se sacrifie dans La Dame aux camélias42, mais aussi, si l’on reste dans le registre sacrificiel, à Madame Aubray43, modèle de charité, d’abnégation, d’amour, qui forçait l’admiration de George Sand :
Madame Aubray est un type idéal et pourtant humain. Elle est bonne et maternelle par nature, enthousiaste, héroïque par conviction. Elle est humaine en ce sens qu’elle va quelquefois trop loin, sa témérité généreuse est essentiellement femme44.
37Dans Leonarda, Bjørnson n’invente rien. Merveilleusement belle, sublime, aimante et amoureuse, charitable, figure d’une « éclatante splendeur », Leonarda est conçue pour charmer le public. Le seul personnage qui ne soit pas si repérable dans cette pièce est l’évêque, dont quelques critiques contemporains ont noté qu’il n’était pas le personnage caricatural qu’on pouvait penser de prime abord45.
38Même si Bjørnson fait en sorte que Leonarda garde un certain temps une part de mystère, concernant son passé et ses relations avec le général Rosen, un ivrogne et un débauché, et que les raisons pour lesquelles elle n’est plus avec son mari ne sont pas clairement exprimées, le public comprend assez vite que dans cette séparation, c’est elle qui a souffert, et lui qui est coupable. Bien qu’elle s’attire la réprobation de l’évêque et de la bonne société, Bjørnson distille dès le début les indices permettant de « repérer » en Leonarda le personnage sympathique : elle est une femme de tête, indépendante, mais sensible, généreuse, dévouée, aimante.
39Avec Ibsen, ces repères volent en éclat, et c’est un des éléments révolutionnaires de sa dramaturgie. On ne peut plus dire que Krogstad ou Helmer sont antipathiques, et que Nora est sympathique. Et nul ne peut prétendre, à la fin de la pièce, connaître Nora, qui n’est jamais ce qu’elle paraît. Le thème du déguisement, qui sous-tend toute la pièce, introduit chez Nora une complexité inédite : on comprend que la femme enfant n’est qu’un rôle parmi d’autres, et que la conduite de Nora s’apparente à ce que Sartre décrira comme un comportement de mauvaise foi dans L’Être et le Néant46. Nora n’est pas lisse, elle accroche, elle est aussi responsable que victime, à l’image des personnages tragiques, Ibsen qualifiant d’ailleurs sa pièce de « tragédie contemporaine » dans une note datant de 187847. On comprend aussi, si l’on suit cette note préparatoire, qu’elle est certes une femme déterminée à devenir un être humain, mais aussi une femme dont les enfants et la famille restent la raison d’être. Dans cette optique, la fin est autant un acte de révolte qu’une catastrophe.
40Strindberg, qui détestait la pièce d’Ibsen et son héroïne, même s’il a, dans la préface de Mariés (Giftas, 188448), l’intuition de la complexité de Nora en évoquant un « rôle de sphinx » (« sfinxartade »), n’en juge pas moins la pièce à l’aune des comédies-drames français de 1850, comme de nombreux critiques de l’époque, cherchant à « repérer » Nora, accusant Ibsen d’avoir opposé de façon caricaturale une Nora « idéale » et sympathique et un mari imbécile et criminel. Ce faisant, Strindberg passe à côté de l’aspect le plus révolutionnaire de cette pièce, qui est moins une question de féminisme ou de radicalisme, qu’une question de dramaturgie : les personnages ne sont plus des types repérables mais des êtres vivants et donc ambivalents (on est avant Freud). Strindberg, qui prétendra avoir conçu des « caractères modernes » (« moderna karaktärer ») dans la préface de Mademoiselle Julie (Fröken Julie49), notamment parce qu’il récuse le type au profit de l’âme (« själ »), n’admet pas qu’Ibsen ait pu aussi subvertir les types, les catégories, auxquelles Strindberg veut absolument affilier les personnages d’Une maison de poupée.
41Pourtant c’est bien le cas : quoiqu’en dise Strindberg, qui estime qu’Ibsen a cherché à imposer un personnage « idéal », Nora n’a rien du type idéal, en cela fausse jumelle absolue de l’idéale Madame Aubray évoquée par George Sand, ou de la sublime Leonarda dont parle Maurice Bigeon. Nora n’est si sympathique, ni sublime, ni idéale. Elle se rend même compte, à la fin de la pièce, à quel point son esprit a été borné, à quel point son sens éthique a été cantonné au trop petit monde de sa famille, négligeant le reste du monde : Nora quitte le foyer en ayant conscience qu’elle doit s’éduquer, se transformer, avant de prétendre au titre de femme « idéale », Ibsen lui ayant seulement donné les moyens d’entrevoir son devoir absolu : « Il n’y a qu’une chose qui compte : la révolte des esprits humains50. » Nora, à la fin de la pièce d’Ibsen, est celle qui prend le parti de « la révolte des esprits », sans avoir jamais pu incarner la femme idéale ; elle admet qu’elle ne comprend rien à la société dans laquelle elle vit, et se fixe comme objectif de la comprendre et de s’amender.
42Nora n’est plus un personnage repérable, ne serait-ce que parce qu’elle est elle-même perdue, sans repères, déstabilisée à l’acte III, quand Helmer lui demande si elle n’a pas au moins la religion pour la guider. La réponse est édifiante : « La religion ? Je ne sais pas au juste ce que c’est51. »
43Leonarda quitte la scène avec le panache et l’assurance d’une femme mûre, qui fait en conscience le sacrifice de son grand amour à sa nièce, forçant l’admiration des critiques prêts à pardonner non seulement aux femmes amoureuses, mais plus encore aux femmes prodigues. Nora quitte la scène désorientée, démise de son rôle de mère par le jugement de son mari, doutant de son amour d’épouse, certaine seulement du chemin à accomplir pour devenir digne du titre d’être humain. En 1879, un tel pari est insolite, incompréhensible, et ne sera véritablement compris que plus tard52.
44Leonarda et Nora, les deux femmes qui font parler d’elles dans le théâtre nordique en 1879, qu’on a comparées, et qu’on est toujours tentés de comparer, n’ont rien en commun. Leonarda est un personnage du xixe siècle, avatar des dramatis personæ des « drames-comédies de 1850 » à la française ; Nora est un personnage du xxe siècle, devenue symbole des mouvements féministes, mais aussi de la crise du drame moderne et de la crise du personnage dans le drame moderne. La comparaison ne vise pas à établir un rapport hiérarchique entre Bjørnson et Ibsen, mais simplement à montrer que le théâtre utile de Bjørnson, comme celui des auteurs français, Augier et Dumas fils, a fortement marqué son temps, tandis que le théâtre « moderne » d’Ibsen, moins utile, plus humain, psychologique, précurseur, a dû attendre pour rencontrer son public.
45Ibsen est aujourd’hui un dramaturge de renommée mondiale et Une maison de poupée est devenue une pièce mythique53 ; Bjørnson, bien qu’il soit encore dans les mémoires en Norvège, ne serait-ce qu’en raison de l’hymne national dont il a composé les paroles (« Oui, nous aimons ce pays » / « Ja, vi elsker dette landet »), est loin d’avoir la même aura ; et même si on observe un regain d’intérêt pour son œuvre54, dans le prolongement du centenaire de sa mort en 2010, son théâtre n’est concerné que de façon très marginale.
1 Ce titre fait écho aux nombreuses « sœurs » de Nora Helmer dans la littérature mondiale depuis la création de Et dukkehjem. À l’occasion du centenaire de la mort d’Ibsen, en 2006, le ministère norvégien des affaires étrangères a parrainé un cycle international de séminaires intitulés « Noras søstre » (« Les sœurs de Nora »), non seulement en Europe, mais partout dans le monde.
2 Georg Brandes, Det moderne gjennembruds mænd, En række portræter, Kjøbenhavn, Gyldendal, 1883.
3 Ibid., p. 133.
4 Les douze dernières pièces d’Ibsen sont fréquemment appelées ses « pièces modernes ».
5 Georg Brandes, Det moderne gjennembruds mænd, op. cit., p. 47. À propos d’Une faillite, Brandes écrit : « Det var et Spring ind i det moderne Liv. » (« C’était un plongeon dans la vie moderne. »)
6 Bjørnstjerne Bjørnson, « Om at være i Sandhed », dans Artikler og taler, Første Bind, Kristiania og Kjøbenhavn, 1912, p. 438-455.
7 Ce sont les derniers mots de Lona Hessel dans la pièce : « sandhedens og frihedens ånd, – det er samfundets støtter » : « L’esprit de vérité et de liberté, – voilà les piliers de la société » (Samfundets støtter, Skuespil i fire akter, Kjøbenhavn, Gyldendal, 1877, p. 211).
8 https://www.unesco.org/fr/memory-world/henrik-ibsen-dolls-house, page consultée le 25 aout 2025.
9 Je reprends l’expression de Véronique Gély, qui voit dans l’horizon d’attente déplacé l’un des signes du mythisme d’une œuvre (« Le devenir-mythe des œuvres de fiction », dans Mythe et littérature, dir. Sylvie Parizet, Paris, SFLGC, coll. « Poétiques comparatistes », 2008.
10 Herman Bang, Nationaltidende, 2 novembre 1879 : « Fru Falk er Kvinden paa treti Aar, Kvinden i sin skjonneste Blomst og i den fulde Bevidsthed om sin Magt. »
11 La création a lieu le 22 avril 1879 au Chritiania Theater, avec Laura Gundersen dans le rôle de Leonarda. Source : Sceneweb, Nasjonalt Scenekunstarkiv, https://sceneweb.no/nb/artwork/16496/Leonarda, page consultée le 16 avril 2025.
12 Article consultable en ligne : https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A11c3c1e4-cd5e-4dfc-8ee1-96bf5439d08c, page consultée le 25 aout 2025.
13 Eugène Scribe et Ernest Legouvé, Bataille de dames, ou Un duel en amour, Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 1851 (créée à la Comédie-Française en 1851).
14 Leonarda, Kjøbenhavn, Gyldendal, 1879, p. 96 (traduction Auguste Monnier, Paris, L. Grasilier, 1894, p. 97).
15 « I “Bataille de dames” offrer den elskende kvinde sig selv, men kun sig selv; de to unge elske hinanden og faae intet at vide om hendes offer. Hun reiser bort, simpelthen og uden phraser; men hun kaster sig ikke i armene paa en Mand, som hun foragter. Her er Forsoning og Afslutning, stille veemodig resignation paa den ene Side, heel og fuld Lykke paa den anden; for ikke at tale om, at den rigtige og smukke Grundtanke tillige er udviklet i en interessant, svændende og ægte dramatisk Handling. I Bjørnsons Skuespil er der Intet af alt dette. Leonarda offrer ikke blot sig selv, men ogsaa en Anden, den Mand, som elsker hende, ja maaskee en Tredie, Aagot, hvis hun og Hagbart indgaae Ægteskab og blive ulykkelige » (Christian Knud Frederik Molbech, Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 3 novembre 1879, p. 2).
16 Morgenbladet, 5 octobre (critique anonyme d’Edvard Brandes) : « Il est tout à fait compréhensible que le professeur Molbech ne souhaite pas mettre sa lumière sous un boisseau, mais s’il essaie d’utiliser sa position pour éclipser d’autres lumières dont la flamme brille plus intensément que la sienne, son entreprise est vouée à l’échec. Il n’y a pas le moindre soupçon d’argument dans sa censure » / « At Hr. Molbech ikke ønsker at sætte sit eget lys under en Skjæppe, er ganske tilladeligt; men naar han forsøger at benytte sin Stilling til at ville slukke andre lys, hvis flamme overstraaler hans eget, saa maa det mislykkes for ham. Der findes end ikke Spor af Argument I hans Censur. » Disponible en ligne : https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A00cbfe8b-4cae-42e1-bdaa-ecd0846fc2d4, page consultée le 26 août 2025.
17 https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2f16d16f-885a-456d-b078-da594eb53ff6, page consultée le 26 août 2025.
18 Edvard Brandes, Ude og Hjemme, 1er février 1880, Nr. 122, p. 191. (repris dans Dagbladet, Kristiania, 3 février 1880) : « Folketheatrets første Opførelse af “Leonarda” foregik under saa megen Tumult, Spillet afbrødes saa brutalt, at Stykkets milde og dæmpede Poesi ingenlunde kunde virke fuldtud paa Tilskuerne » Disponible en ligne : https://archive.org/details/ude-og-hjemme-aarg-3/page/190/mode/2up?q=Leonarda&view=theater, page consultée le 26 août 2025.
19 Ibid., p. 192 : « [det] falder vanskeligt at forstaa, at et saa revolutionært Stykke som Et dukkehjem antages, naar man forkaster et Drama som Leonarda, hvis Moral er Resignation og Opofrelse ».
20 Henrik Ibsen, Et Dukkehjem, København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1879. Toutes les citations de Et dukkehjem seront tirées de l’édition en ligne de l’Université d’Oslo, disponible en ligne : https://www.ibsen.uio.no/DRVIT_Du|Du79.xhtml?facs=Ja, page consultée le 30 décembre 2024.
21 J’emploie le mot féminisme, tout en sachant que certaines personnes, dans les pays scandinaves comme en Europe, ne revendiquent pas encore, au début des années 1880, cette étiquette. Toutefois, Une maison de poupée étant devenue un symbole fort des luttes de ce qu’on a appelé plus tard la première vague féministe, il ne paraît pas exagéré d’utiliser ce terme, quitte à invoquer une « pratique contrôlée de l’anachronisme », pour reprendre une expression de Nicole Loraux (« Éloge de l’anachronisme en histoire », Le Genre humain 1993/1, no 27, p. 23-39).
22 August Strindberg, Mariés ! [VO 1884 ; VF 1986], trad. P. Morizet et E. Ahlstedt, Arles, Actes Sud « Babel », 2006, p. 18. « Att den gjorde intryck av och allmänt uppfattades som ett manifest för den förtryckta kvinnan, väckte genast en storm, under vilken även de lugna tappade huvudet » (Giftas, dans Samlade Skrifter, 14, Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1913, p. 19.
23 Camilla Collett, Amtmandens døttre, 1854-1855. VF Les Filles du préfet, trad. Éric Eydoux, Carouge, Éditions Zoé, coll. « Les classiques du monde », 2010.
24 Fredrika Bremer, Hertha, eller en själs historia, 1856. VF : Hertha, ou L’histoire d’une âme, traduit du suédois par A. Geffroy, Paris, C. Reinwald, 1856.
25 Voir notamment Le Fils naturel (1858), Un père prodigue (1859), et Les Idées de Madame Aubray (1867).
26 Émile Faguet, « La comédie contemporaine », préface aux Annales du Théâtre et de la Musique d’Edmond Stoullig, Paris, Paul Ollendorff, 1898, p. XXVI.
27 Ibid., p. XIV.
28 Voir Øyvind Anker, Christiania theater’s repertoire 1827-1899. Fullstending registrant over forestillinger, forfattere, oversettere og komponister. Sesongregister, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1956. Voir aussi Sceneweb, Nasjonalt Scenekunstarkiv, en ligne : https://sceneweb.no, page consultée le 26 août 2025.
29 Martin Lamm, Det moderna dramat, Stockholm, Bonniers, 1948.
30 Maurice Bigeon, Les Révoltés scandinaves, Paris, L. Grasilier Éditeur, 1894, p. 158.
31 Bjørnstjerne Bjørnson, Leonarda, trad. Auguste Monnier, éd. citée, préface de Maurice Bigeon, p. VII.
32 Ibid., p. VIII.
33 Madame Alving est l’héroïne des Revenants (Gengangere, 1881) d’Ibsen, qui a fait scandale autant qu’Une maison de poupée.
34 Maurice Bigeon, Préface de Leonarda, op. cit., p. VIII-IX.
35 Henrik Ibsen, Maison de poupée, trad. Prozor [1889], Paris, L. Grasilier, 1894 : « helmer. Du er først og fremst hustru og moder. / nora. Det tror jeg ikke længere på. Jeg tror, at jeg er først og fremst et menneske, jeg, ligesåvel som du, – eller ialfald, at jeg skal forsøge på at bli’e det. » (Et dukkehjem, op. cit., p. 171).
36 Quand il est invité à une fête donnée en son honneur par la ligue féministe de Norvège en mai 1898, il se présente ainsi : « Je ne suis pas membre de la ligue féministe. Il n’y a pas, dans tout ce que j’ai écrit, de tendance délibérée. Je suis plus poète et moins philosophe social qu’on a bien voulu le croire. Je vous remercie pour le banquet, mais je dois décliner l’honneur d’avoir lutté consciemment pour la cause féministe. Je ne vois même pas précisément ce qu’est la cause féministe. Pour moi, il s’est agi de la cause de l’humanité. » Cette allocution, dont l’extrait cité est le début, est reproduite dans le journal Morgenbladet le 27 mai 1898 (no 338) : « Jeg er ikke Medlem af Kvindesagsforeningen. Alt, hvad jeg har digtet, har ikke været ud af nogen bevidst Tendens. Jeg har været mere Digter, mindre Social‐Filosof, end man i Almindelighed synes tilbøielig til at tro. Jeg takker for Skaalen, men maa fralægge mig den Ære bevidst at skulle have virket for Kvindesagen. Jeg er ikke engang paa det Rene med, hvad Kvindesag egentlig er. For mig har det staaet som en Menneskesag ». En ligne : https://www.nb.no/items/070d85e8760aa0f28c9e7c4dd7eb9ea0?page=1&searchText=morgenbladet, page consultée le 30 décembre 2024.
37 Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe [1949], Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 321.
38 Betty Friedan, The Feminine mystique, New York, W. W. Norton and Co., 1963 [La Femme mystifiée, trad. Yvette Roudy, Genève, Paris, Gonthier, 1964]. Betty Friedan fait référence ici à une adaptation de la pièce réalisée par George Schaefer et diffusée à la télévision en novembre 1959.
39 Op. cit. L’argumentaire est également disponible en français, mais sans la répétition du mot « symbole » : « Au xxe siècle, la pièce est devenue célèbre, pour gagner l’Asie et le tiers monde, où sa forme est devenue le symbole du théâtre occidental moderne et son contenu celui de valeurs telles que les droits de l’homme et la liberté existentielle. […] [Nora] a été et reste l’emblème universel des femmes qui luttent pour leur libération et pour l’égalité. »
40 Robert Abirached, La Crise du personnage dans le théâtre moderne [Bernard Grasset, 1978], Paris, Gallimard, coll. « Tel »,1994, p. 151.
41 Ferdinand Brunetière, « Le personnage sympathique dans la littérature », Revue des Deux Mondes, tome 53, 15 octobre 1882, p. 944.
42 Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias, Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 1852 (créée au Théâtre du Vaudeville en février 1852).
43 Alexandre Dumas fils, Les Idées de Madame Aubray, Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, 1867.
44 George Sand, « À propos des idées de Madame Aubray », dans Questions d’art et de littérature, Œuvres complètes de George Sand, Paris, Calmann Lévy, 1878, p. 397.
45 Voir notamment dans le quotidien danois Fædrelandet, le 3 octobre 1879 : « Le personnage le mieux dessiné est celui de l’évêque ; il apparaît comme un homme doux et sérieux, mais aussi quelque peu anxieux et perdu. » (« Den bedst tegnede Skikkelse er Biskoppens; han staar som en mild og alvorlig, men noget ængstelig of henlsynsfuld Mand. ») En ligne : https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae0e2abb0-ccfe-4e82-abcf-81bf5dd278a5, page consultée le 26 août 2025.
46 Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant [1943], Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1976 (première partie, chapitre 2).
47 Henrik Ibsen, « Notes pour la tragédie contemporaine » (« Optegnelser til nutids-tragedien », Rome, 19/10/78, en ligne : http://ibsen.uio.no/DRVIT_Du%7CDu41113a_1r_1v.xhtml?facs=Ja, page consultée le 26 août 2025.
48 August Strindberg, préface de Mariés !, trad. P. Morizet et E. Ahlstedt, Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 1986 (Giftas [1884], dans Samlade Verk 16, éd. Ulf Boëthius, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1982).
49 August Strindberg, Förord till Fröken Julie [1888], dans Samlade Verk 27, éd. Gunnar Ollén, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1984, p. 104.
50 « Il n’y a qu’une chose qui compte : la révolte des esprits humains » (« Hvad det gjælder er menneskeåndens revoltering »), lettre à Georg Brandes du 20 décembre 1870.
51 Henrik Ibsen, Une maison de poupée, op. cit., p. 273 : « jeg ved jo slet ikke rigtigt, hvad religionen er » (Et dukkehjem, op. cit., p. 172).
52 Sur cette incompréhension des contemporains, et le besoin de corriger, réparer, conclure Une maison de poupée, voir Réparer Une maison de poupée d’Ibsen ? réécritures, remaniements et suites (1879-1903), dir. Marthe Segrestin, Paris, Classiques Garnier, 2022.
53 Voir notamment The Ibsen Stage Performance Database, dont un des projets (« A Global Doll’s House: Ibsen and Distant Visions ») donne une vision globale de la réception de la pièce dans le monde : https://ibsenstage.hf.uio.no/pages/project/100, page consultée le 26 août 2025.
54 Voir notamment Aldo Keel, Bjørnson i kamp for Europas undertrykte folk, Oslo, Nasjonalbiblioteket, 2010 (Bjørnson : son combat pour les peuples européens opprimés) ; Liv Bliksrud, Giuliano D’Amico, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund (dir.), Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier, Oslo, Novus Forlag, 2013 (Le cosmopolite engagé. Nouvelles études sur Bjørnson).
Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 35, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2064.html.
Quelques mots à propos de : Marthe Segrestin
Sorbonne Université
CRLC
Marthe Segrestin est Maîtresse de conférences en littérature comparée à Sorbonne Université. Ses recherches portent principalement sur le théâtre européen au tournant des xixe et xxe siècles, et plus spécifiquement sur les théâtres français, scandinave et allemand (dramaturgie, réception, traduction, mise en scène). Elle a dirigé en 2022 l’ouvrage Réparer Une maison de poupée d’Ibsen ? Réécritures, remaniements, suites (1879-1903), publié à Paris, aux éditions Classiques Garnier.
