Sommaire
Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières
Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot
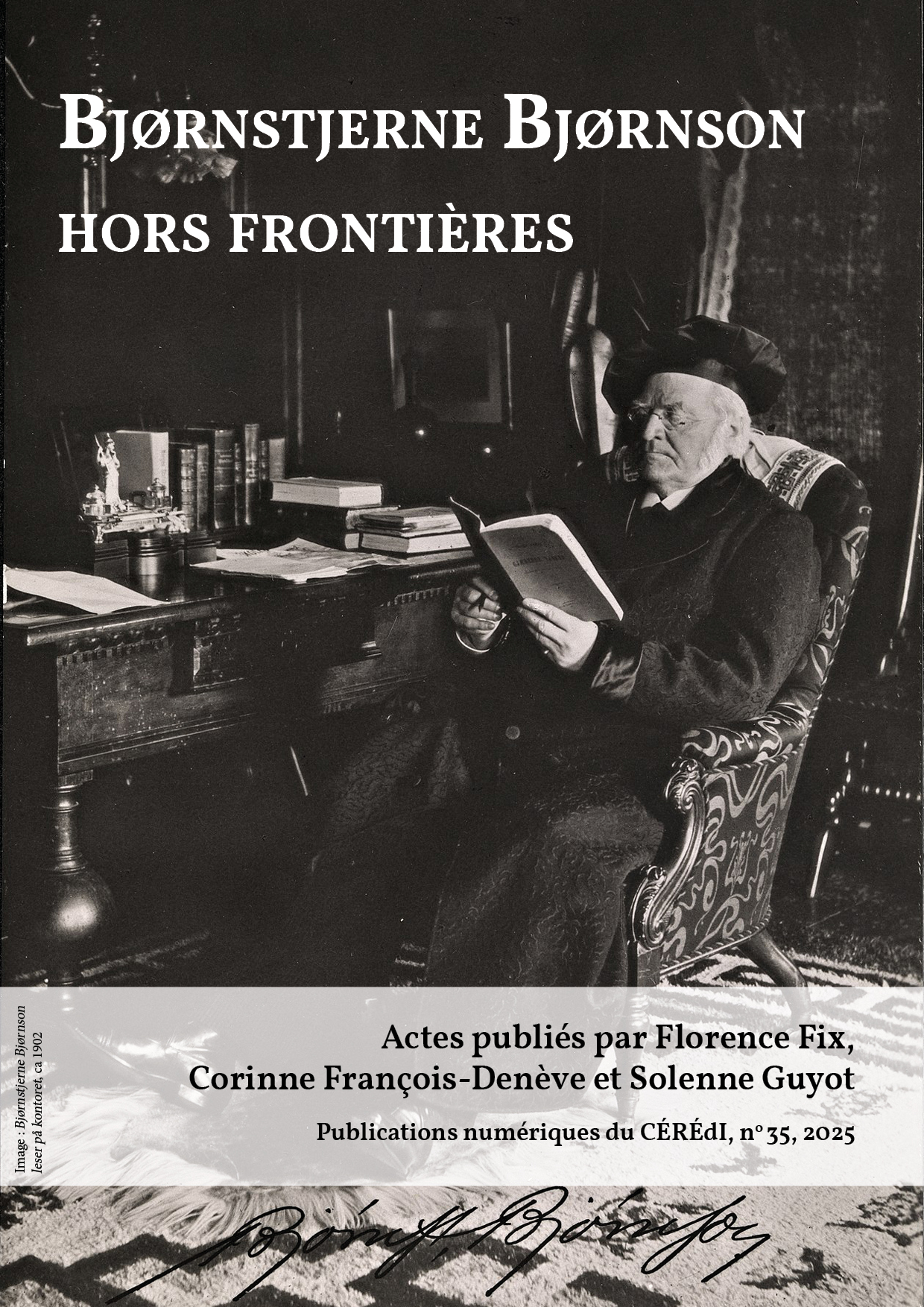
- Solenne Guyot Avant-propos
Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle - Corinne François-Denève et Solenne Guyot « Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]
- Annie Bourguignon Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart
- Cécile Leblanc Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin
- Nicolas Diassinous Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe
- Miloš Mistrík Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !
- Marthe Segrestin Leonarda et Nora, fausses jumelles
Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières
Avant-propos
Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle
Solenne Guyot
1En octobre 2023, le prix Nobel de littérature est décerné au dramaturge Jon Fosse (1959-). Il devient ainsi le quatrième récipiendaire de nationalité norvégienne à obtenir cette distinction, après Sigrid Undset (1882-1949) en 1928, Knut Hamsun (1859-1952) en 1920 et Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) en 19031. Des quatre, Bjørnson est certainement le moins connu du public français. En France, ses romans, contes et poèmes ont fait l’objet de peu de traductions récentes2 tandis que ses vingt-et-une pièces de théâtre ne sont plus jouées3. Il a pourtant été l’une des figures les plus importantes de sa génération. Son contemporain Hamsun considérait que c’était Bjørnson qui « régna avec le plus de puissance et [qui] eut la plus grande influence en Norvège4 » parmi les auteur·e·s de son temps. Toutefois, son influence était bien loin de se limiter à son pays natal et Jonas Gahr Støre, premier ministre norvégien (2021-), affirme que « même si Bjørnson était aussi Norvégien que les autres, il était peut-être le premier Européen parmi ses contemporains5 ». C’est précisément ce rayonnement européen qu’a abordé la journée d’études « Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières : un théâtre en jeu » tenue à l’Université de Strasbourg en avril 2024 avec le soutien des universités de Rouen Normandie et de Haute-Alsace, coorganisée par Florence Fix, Corinne François-Denève, Solenne Guyot et Raphaël Jamet, dont nous publions ici les actes.
Qui est Bjørnstjerne Bjørnson ?
2Tantôt rival, tantôt proche de Henrik Ibsen (1828-1906) dont il est le contemporain6, Bjørnson ne bénéficie aujourd’hui de la même notoriété ni en Norvège, ni à l’étranger, alors qu’il a eu de son vivant une aura considérable.
3Comme Ibsen et d’autres auteur·e·s de sa génération, il a contribué au nasjonalromantikken [« romantisme national »] lancé en Norvège à la suite de la séparation du Royaume dano-norvégien en 1814 qui réunissait les deux territoires sous la gouvernance danoise depuis le Moyen Âge. À une période où de nombreuses œuvres servent à donner corps, culturellement et politiquement, à la jeune nation norvégienne, Bjørnson publie notamment Synnøve Solbakken (1857), Arne (1859) et En glad gut [Un joyeux garçon] (1860) qui mettent en valeur le monde paysan qu’il imagine être au fondement de l’identité norvégienne moderne. De surcroît, l’engouement pour le romantisme national l’enjoint à écrire des drames historiques nationaux inspirés des sagas islandaises perçues par les historiens norvégiens du xixe siècle comme un patrimoine spécifiquement norvégien7. Ainsi, des pièces telles que Mellem Slagene [Entre les batailles] (1857), Halte-Hulda [Hulda la Boiteuse] (1858) ou Sigurd Jorsalfare (1872) mettent en avant les figures héroïques d’un Moyen Âge fantasmé comme étant le dernier moment de l’histoire où la Norvège a pu jouir pleinement de son indépendance8. Cependant, d’autres périodes historiques plus tardives ont intéressé Bjørnson à l’instar de la Renaissance comme en témoigne Maria Stuart i Skottland [Marie Stuart en Écosse] (1864). Le rôle de Bjørnson en tant que « porte-parole du nationalisme et des projets culturels liés à la construction de la nation9 » atteint son apogée lorsque son poème « Ja, vi elsker dette landet » [« Oui, nous aimons ce pays »] (1864) devient l’hymne national norvégien10.
4Progressivement, à partir des années 1870, Bjørnson s’engage dans le mouvement de la moderne gjennombrudd [« percée moderne »], qui consiste pour partie en une relecture critique du romantisme national scandinave auquel l’auteur reproche son désengagement quant aux questions de société qui se jouent alors. Les « fire store11 » [« quatre grands »] de la littérature norvégienne que sont Bjørnson, Ibsen, Jonas Lie (1833-1908) et Alexander Kielland (1849-1906) n’utilisent plus leurs plumes pour célébrer leur pays, mais pour dénoncer ses travers et ses incohérences dans un style réaliste et naturaliste. Ainsi Bjørnson lève le voile sur l’hypocrisie de la bourgeoisie dont il fait pourtant partie dans Redaktøren [Le Journaliste] (1875) et il condamne les inégalités de genre contre lesquelles les femmes s’insurgent avec Magnhild (1877) ou Leonarda (1879). En Fallit [Une faillite] (1875) illustre les réflexions critiques de Bjørnson sur le rôle prédominant de l’argent dans la société, et le fils de pasteur exprime un scepticisme de plus en plus affirmé à l’égard de la religion chrétienne dans På guds veje [Sur le chemin de Dieu] (1889) et Over Ævne I et II [Au-delà des forces humaines] (1883 ; 1895).
Un gant à l’origine d’une journée d’études sur Bjørnson
5Si Bjørnson fut un homme de lettres prolifique, il a également été « l’homme des foules, le tribun adulé et vilipendé qui, embrassant mille causes avec la même ardeur, joua un demi-siècle durant les premiers rôles sur les scènes politique et culturelle, nationale aussi bien qu’internationale12 ». En effet, l’auteur était de tous les débats de son époque et ses prises de position ont pu faire scandale. En Norvège, la postérité retient surtout son rôle dans le sedelighetsdebatt [« débat sur la morale sexuelle »] aussi connu comme la hanskestrid [« querelle du gant »] qui tient son nom de la pièce de Bjørnson En hanske [Le Gant], écrite en deux versions (1883 ; 1886)13. Le texte interroge une forme de naïveté ou d’idéalisme : Svava et Alfred s’apprêtent à se marier, mais lorsqu’elle apprend qu’il a eu une liaison avec une femme mariée avant leur rencontre alors qu’il lui avait promis chasteté, elle lui jette son gant au visage. Intransigeante, Svava refuse la double morale qui veut que les femmes se trouvent rejetées lorsqu’elles ont plusieurs amours, quand les hommes reçoivent pour le même comportement indulgence générale voire encouragement. Les exigences morales de Bjørnson sont soutenues par certaines défenseuses des droits des femmes de l’époque, à l’instar de la Danoise Elisabeth Grundtvig (1856-1945) qui donnera une conférence intitulée « Nutidens sædelige Lighedskrav » [« La demande de notre temps pour l’égalité devant la morale sexuelle »] en 1887. Cependant la position défendue par Svava est plus volontiers critiquée par les défenseurs norvégiens de l’amour libre tels que Hans Jæger (1854-1910) ou Christian Krohg (1852-1925). Les personnalités publiques scandinaves alimenteront le débat dans la presse ou dans des correspondances en soulignant l’hypocrisie de Bjørnson, tandis que les artistes prendront parti à travers leurs pièces de théâtre (Ibsen), nouvelles (Arne Garborg, August Strindberg) ou romans (Amalie Skram). Bjørnson réaffirmera ses opinions dans une conférence intitulée « Enegifte og mangegifte » [« Monogamie et polygamie »] donnée à partir de novembre 1886 plus d’une centaine de fois dans les pays scandinaves et publiée en 1888 sous la forme d’un pamphlet14.
6Si l’apport de Bjørnson à la littérature ne peut de loin pas se limiter à son rôle dans cette querelle d’idées, c’est pourtant En hanske [Le Gant] qui est l’origine de notre journée d’études. À l’occasion de la sortie de la nouvelle traduction française des deux versions de la pièce par Corinne François-Denève un séminaire avait été organisé au Centre universitaire de Norvège à Paris en avril 2023 autour de cette publication. Giuliano D’Amico (Senter for Ibsen Studier) y avait présenté la figure de Bjørnson en Scandinavie et s’était questionné sur des raisons possibles à son oubli par la postérité. Solenne Guyot avait recontextualisé En hanske dans le débat sur la morale sexuelle pour que le lectorat français puisse en saisir les enjeux et Corinne François-Denève était revenue sur les raisons qui l’ont poussée à traduire ce texte en 2023. Ces échanges autour de la traduction s’étaient prolongés à la bibliothèque Sainte-Geneviève lors d’un entretien mené par Solenne Guyot et semblable à celui retranscrit dans ce volume. La journée s’était terminée par une lecture menée en duo par le comédien Benoît Lepecq et par Corinne François-Denève elle-même.
7Au cours de cet événement, notre attention s’était portée sur plusieurs éléments dont celui-ci : alors qu’En hanske a lancé une polémique circonscrite aux pays scandinaves, des indices présents dans la pièce montrent que Bjørnson a été influencé par le théâtre français. En effet, la pièce tient autant du proverbe de Musset, du drame en habit noir de Dumas que du vaudeville à la Scribe. L’idée a alors émergé de s’interroger, le temps d’une journée d’étude, sur la place de Bjørnson en tant qu’homme de théâtre, pas seulement scandinave ou français, mais européen.
Dé-norvégianiser Bjørnson
8Nous le verrons ultérieurement, Bjørnson, directeur de théâtre et grand voyageur, a influencé et a été profondément influencé par le théâtre européen, mais également par les courants d’idées étrangers. Malgré l’engouement que ses œuvres et ses prises de parole suscitaient au tournant du xxe siècle, « Bjørnson est cependant l’auteur norvégien qui, d’un point de vue littéraire, a le plus régressé rétrospectivement15 ». Et lorsqu’en 2010 la Norvège s’apprête à célébrer l’anniversaire de la mort du dramaturge, l’objectif est double. Le choix de la devise « Bjørnson for vår tid16 » [« Bjørnson pour notre époque »] traduit une volonté de ressusciter l’intérêt des Norvégien·e·s pour ses œuvres en les réinterprétant au prisme des enjeux du xxie siècle puisqu’il n’apparaissait plus comme un auteur significatif17. D’autre part, il s’agissait également de brosser un portrait de Bjørnson allant au-delà de la figure du poète national afin de le réinscrire dans un contexte plus large18. C’est dans cette perspective qu’a été publié Bjørnson i kamp for Europas undertrykte folk [Bjørnson en lutte pour les peuples opprimés d’Europe] (2010) qui se concentre sur l’engagement social européen de Bjørnson et sur ses prises de position dans des débats qui ne le concernaient pas directement19. Trois ans plus tard, Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson studier [Le cosmopolite engagé. Nouvelles études sur Bjørnson] (2013) a complété les réflexions ainsi amorcées. L’objectif de cet ouvrage collectif était de souligner l’importance littéraire européenne de Bjørnson qui a permis à « la Norvège littéraire [de] pass[er] du statut de province à celui de centre de rayonnement européen20 » et qui a contribué « à créer une littérature norvégienne en dialogue constant avec les modèles et les courants littéraires en Scandinavie et sur le continent21 ».
9La journée d’études s’envisageait donc comme un prolongement de ces initiatives norvégiennes qui explorent les liens entretenus par Bjørnson avec d’autres pays et cultures, en abordant des pistes européennes encore peu exploitées et en se concentrant sur la production théâtrale de l’écrivain. Elle a également été l’occasion de contribuer à faire connaître au public français une grande figure européenne méconnue. Le volume permet ainsi d’envisager Bjørnson comme un homme de théâtre influencé par les pièces jouées à son époque en Europe, comme un dramaturge d’influence qui a eu une réception à l’étranger et comme un citoyen européen qui prenait part aux débats de son temps.
Bjørnson inspiré par le théâtre européen
10Bjørnson connaît bien le théâtre de son temps. Il a dirigé trois salles de spectacle : Det norske Theater à Bergen (1857-1859), le Christiania Theater (1865-1867) à Oslo22 et, toujours dans la capitale, le Kristiania Norske Teater également appelé Møllergadens Theater (1870-1872)23. Tharald Blanc, contemporain de Bjørnson, considère sa direction du Christiania Theater comme l’« une des périodes les plus intéressantes de l’histoire [du] théâtre24 ». Ses qualités en tant que directeur de théâtre semblent notamment liées à ses choix artistiques. Lise Lyche considère que la programmation de Bjørnson au théâtre de Bergen est « intéressante et audacieuse25 », tandis que Francis Bull salue un « répertoire extraordinairement riche et varié26 » au Christiania Theater. Bjørnson met en scène de nombreuses pièces qu’il traduit parfois lui-même27.
11La richesse du répertoire est illustrée par la diversité des genres. Le directeur propose aussi bien des drames historiques, des vaudevilles, des comédies que de l’opéra-comique. D’autre part, les origines des pièces sont variées28. Bjørnson choisit d’intégrer au programme les œuvres de ses compatriotes tels que Henrik Ibsen, Andreas Munch, ou encore Ivar Aasen, ainsi que les pièces danoises de Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, Dorothea Biehl et Henriette Nielsen. Toutefois, la programmation dépasse les frontières scandinaves comme en témoigne la présence de pièces de dramaturges anglais tels que William Shakespeare, Richard Brinsley Sheridan, Thomas Morton et Thomas Holcroft et allemand·e·s à l’instar de Charlotte Birch-Pfeiffer, Roderich Benedix, Karl Töpfer et Karl August Görner. Dans ce volume, Annie Bourguignon propose dans « Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart » une analyse comparative du drame allemand écrit soixante ans avant celui de Bjørnson.
12Les pièces françaises sont particulièrement mises à l’honneur dans les programmations de Bjørnson car à la mode. Il serait impossible de proposer une liste exhaustive des auteur·e·s français·e·s importé·e·s, mais parmi les plus connu·e·s nous pouvons citer Molière, Alexandre Dumas, Eugène Scribe, Alfred de Musset, Victorien Sardou, Émile Augier et George Sand. Hormis Shakespeare ou Molière, la programmation met l’accent sur les auteurs les plus connus de la scène parisienne contemporaine : mélodrames et drames sociaux (d’Ennery, Feuillet), comédies de mœurs (Labiche), grands noms de l’époque (Legouvé, Scribe, Sardou) avec un intérêt pour les pièces sérieuses, bien agencées, structurées sur une intrigue très identifiable, reposant sur un désordre sentimental, un dilemme dans un salon bourgeois, et des personnages motivés par des émotions fortes et une rectitude morale.
Bjørnson, inspirant les scènes européennes
13Le lien entretenu par Bjørnson avec le reste de l’Europe ne se résume pas à son contact avec des représentations de pièces étrangères. En effet, Bjørnson a passé une grande partie de sa carrière hors de la Scandinavie, comme de nombreux artistes de son époque qui s’exilent intellectuellement pour mieux écrire, tels qu’Ibsen, August Strindberg (1849-1912), Arne Garborg (1851-1924), Georg Brandes (1842-1927) ou Jonas Lie. Bjørnson habite à Munich entre 1867 et 1868, il séjourne brièvement à Paris en 1863 et 1878, et il s’y installe pendant plusieurs années, de 1882 à 188729. Il revient à Paris à la fin de sa vie pour se faire soigner et y meurt en 191030. Certaines de ses œuvres les plus notables sont écrites à Paris comme En hanske ou Over Ævne I. Deux articles de ce volume s’intéressent justement à la réception française des pièces de Bjørnson. Dans « Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin », il s’agit pour Cécile Leblanc de comprendre le processus de l’adaptation française de Halte-Hulda (1858) de Bjørnson sous la forme de l’opéra Hulda (1894). Nicolas Diassinous s’intéresse, quant à lui, dans « Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe » à la réception scénique parisienne de Bjørnson à la fin du xixe siècle.
14En outre, Bjørnson vivra au total une dizaine d’années en Italie de 1860 à 1862, de 1873 à 1875, de 1893 à 1895 et de 1907 à 190831. Il habitera principalement à Rome. Bjørnson sera également en Autriche, à Schwaz, de 1893 à 1895, ce qui a certainement contribué à le rendre sensible à la situation politique des minorités de l’Empire austro-hongrois.
Bjørnson, défenseur des droits des Européens
15Habitant plusieurs villes européennes, Bjørnson était un « observateu[r] attenti[f] des changements géopolitiques et des événements majeurs de la politique européenne, dont [il] interprétai[t] les significations locales dans des conférences, des discours et des articles largement diffusés32 ». En effet, l’écrivain a été rédacteur pour plusieurs journaux norvégiens : Illustreret Folkeblad (1857), Bergenposten (1858), Aftenbladet (1859-1860), Norsk Folkeblad (1866-1870) et ses nombreux articles sur les sujets brûlants de l’actualité européenne circulaient car ils étaient imprimés simultanément dans plusieurs langues33. À la fin de sa vie, Bjørnson prendra de plus en plus d’importance sur la scène politique internationale, ce qui fait dire à Karsten Alnæs que même si « Bjørnson n’est pas un nom dominant de la politique de la fin du xixe siècle […], il est partout34. »
16En effet, si Bjørnson a pris l’habitude de s’exprimer sur diverses thématiques de la vie politique locale telles que le scandinavisme et le pangermanisme35, c’est surtout à la fin de sa vie que ses articles incisifs le placent au centre des débats européens. Il prend par exemple position dans l’affaire Dreyfus en publiant en 1898 un article d’appui à Zola dans lequel il condamne les agissements du gouvernement français contre Dreyfus36. Prenant la plume pour dénoncer les injustices, Bjørnson se fait tout particulièrement défenseur des peuples opprimées et des droits de l’homme. En 1903, Bjørnson apporte son soutien aux Finlandais·e·s alors que l’autonomie de leur pays est de plus en plus affaiblie par une politique de russification qui entrave les expressions culturelles finlandaises et qui a conduit l’exil d’artistes finnois·e·s37. Il qualifie publiquement la situation de « tentative de génocide38 » et enjoint les pays européens à cesser de prêter de l’argent à l’Empire Russe39. Il publie également des poèmes tels que « Ved mottagelsen av siste post fra Finland40 » [« À la réception du dernier courrier venant de Finlande »] ou « Til de forviste finner41 ! » [« Aux Finlandais exilés ! »] dans lequel il oppose le triste avenir de la Finlande opprimée à l’avenir radieux de la Norvège.
17Bjørnson s’intéresse également de près à la situation des minorités qui ne peuvent disposer de leurs langues maternelles au début du xxe siècle. Il dénoncera dans des articles largement diffusés la situation « des Ruthènes, c’est-à-dire les Ukrainiens de Russie et de Galicie42, et celle des Slovaques dans l’empire habsbourgeois43 » qui luttent contre l’assimilation linguistique forcée44. Il utilise alors sa plume pour révéler aux yeux de l’Europe l’oppression des minorités comme le massacre de Cernová. Le lien entretenu par Bjørnson avec les Slovaques à cette période et a posteriori est l’objet de la contribution de Miloš Mistrík « Bjørnstjerne Bjørnson and Slovakia: First National Freedom, then National Theatre ».
18En septembre 1907, Bjørnson est le président d’honneur du xvie congrès international pour la paix à Munich45. Promouvant la paix, il s’en prend à l’hypocrisie d’hommes politiques qui osent se présenter à des assemblées internationales pour la paix alors qu’ils oppriment certaines populations sur leurs propres territoires.
19Malgré toutes ses implications dans la vie littéraire, théâtrale et politique européenne Bjørnson est aujourd’hui négligé par la postérité. Pour tenter d’expliquer cet oubli, Marthe Segrestin propose de comparer, dans « Leonarda et Nora, fausses jumelles », l’héroïne emblématique d’Ibsen à celle de Bjørnson qui n’a pas obtenu le même statut d’icône des revendications féministes. Une autre proposition de réponse a été donnée par la lecture-performance d’En hanske [Le Gant] pendant la journée d’études. Six étudiant·e·s de l’Université de Strasbourg ont (re)travaillé la première version du texte lors d’un atelier coanimé par Solenne Guyot et Raphaël Jamet. L’initiative avait eu le support artistique du comédien Benoît Lepecq et de la traductrice Corinne François-Denève dans le cadre du projet « Bokmål : lectures et mises en voix de textes nordiques par des étudiant·e·s » soutenu par « Strasbourg 2024 Capitale Mondiale du livre ».
1 Bjørnson était aussi membre du comité du prix Nobel de 1897 à 1905.
2 Les traductions françaises de ses textes narratifs en prose ont été réalisées à la fin du xixe siècle ou au début du xxe siècle et n’ont pas été rééditées depuis : Synnøve Solbakken [Synneuve Solbakken] par Frédéric Baetzmann et Alphonse Pagès, Paris, Tolmer, 1880 ; Fiskerjænten [La Fille de la pêcheuse] par Charles Bernard-Derosne, Paris, K. Nilsson, 1882 ; Brudeslåtten [Douce fiancée], Paris, H. Geffroy, 1894 ; En glad gut [Un joyeux compagnon] Paris, H. Geffroy, 1894 ; Arne [Les Âmes en peine] par Sébastien Voirol, Paris, La Renaissance du livre, 1911 ; Magnhild, traduit par Sébastien Voirol, Paris, E. Sansot, 1912. Pour ses poèmes : Quelques poèmes et chansons de Björnstjerne Björnson, trad. Dagny Bjørnson et Georges Sautreau, Paris, Société Générale d’Impression, 1922.
3 Il existe seulement deux traductions récentes de pièces de Bjørnson : En hanske [Le Gant], trad. Corinne François-Denève, Paris, L’Avant-scène théâtre, 2023 et Au-delà des forces I & II [Over Ævne I og II], trad. Éric Eydoux, Paris, Les Belles Lettres, 2010. Quelques autres pièces ont été traduites au tournant du xxe siècle : En Fallit [Une faillite], trad. Joseph J. Schürmann et Jacques Lemaire, Paris, Tresse & Stock, 1893. Leonarda, trad. Auguste Monnier, Paris, L. Grasilier, 1894 ; Geografi og Kærlighed [Amour et Géographie] et De nygifte [Les Nouveaux Mariés] trad. A. Albène et Auguste Monnier, Paris, A. Savine, 1895 ; Paul Lange og Tora Parsberg [Paul Lange] trad. M. Prozor, Revue bleue, 1898 ; Laboremus, trad. Mme Rémusat, Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1901 ; Redaktøren [Le Journaliste] et Kongen [Le Roi] trad. Auguste Monnier, Paris, Stock, 1901 ; Det ny System [Le Nouveau Système] trad. Auguste Monnier, Paris, Stock, 1904. À notre connaissance, les représentations théâtrales de Bjørnson en France se limitent à : Une faillite par André Antoine au Théâtre-Libre (1893) ; Au-dessus des forces humaines par Aurélien Lugné-Poë au Théâtre de l’Œuvre (1894, 1901) et Au-delà des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre (1897).
4 Knut Hamsun, « Le mouvement littéraire en Norvège », trad. Jean de Néthy, La Revue des revues, 1893, p. 724.
5 Jonas Gahr Støre, « Sterk stemme, skarp penn og gode gjerninger », dans Aldo Keel, Bjørnson i kamp for Europas undertrykte folk, Oslo, Nasjonalbibliotek, 2010, p. 10 : « Selv om Bjørnstjerne Bjørnson var så norsk som noen, var han samtidig kanskje den fremste europeer blant sine samtidige. »
6 Le fils d’Ibsen, Sigurd, épousera Bergliot, la fille de Bjørnson.
7 Guðmundur Hálfdanarson, « Interpreting the Nordic Past: Icelandic Medieval Manuscripts and the Construction of a Modern Nation », dans The Uses of the Middle Ages in Modern European States. History, Nationhood and the Search for Origins, dir. Robert John Weston Evans et Guy Marchal, New York, Palgrave Macmillan, 2011, p. 52-71.
8 La Norvège est un royaume indépendant jusqu’en 1397.
9 Keld Hyldig, « Ibsen, Bjørnson and the art of acting », Nordlit, 34, 2015, p. 291 : « spokesman for nationalism and for cultural nation building projects ».
10 Pour en savoir plus sur le rôle de Bjørnson dans l’édification de la nation norvégienne : Øystein Sørensen, Bjørnstjerne Bjørnson og nasjonalismen, Oslo, Cappelen, 1997.
11 Cette appellation était à l’origine utilisée par la maison d’édition norvégienne Gyldendal pour promouvoir ces quatre écrivains contemporains. L’expression est toujours utilisée par les histoires littéraires bien que l’on pourrait souligner l’importance d’autres auteur·e·s de la seconde partie du xixe siècle comme Amalie Skram ou Arne Garborg.
12 Érix Eydoux, Histoire de la littérature norvégienne, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 248.
13 Sur le rôle de Bjørnson dans cette controverse, voir Stenberg Lisbeth, « Sexualmoral och driftsfixering — förnuft och kön i 1880-talets sedlighetsdebatt », dans Nationell hängivenhet och europeisk klarhet - Den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900, dir. Barbro Kvist Dahlstedt et Sten Dahlstedt, Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag, 1999, p. 173-225 ; Elin B. Tinderholt, « Bjørnson og sedelighetens retorikk: Bjørnsons retoriske strategier innen forskjellige sjangre i sedelighetsdebatten », dans Bjørnson-årbok, vol. 2, Aulestad, Aulestad forlag, 1999, p. 19-31 ; Elias Bredsdorff, Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumentarisk fremstilling afsædelighedsdebatten i nordisk litteratur I 1880, Copenhague, Gyldendal, 1973 ; Elias Bredsdorff, « Moralists versus Immoralists: The Great Battle in Scandinavian Literature in the 1880’s », Scandinavica: International Journal of Scandinavian Studies, 6.1, 1969, p. 91-111.
14 Le texte est disponible en français : Enegifte og mangegifte [Monogamie et polygamie], trad. Auguste Monnier et Georges Montigna, Paris, Stock, 1897.
15 Per Thomas Andersen, Norsk litteraturhistorie, Oslo, Universitetsforlaget, 2012, p. 226 : « Bjørnson er imidlertid den av alle norske forfattere som i litterært henseende har falt dypest i ettertid. »
16 Vigdis Moe Skarstein, « Bjørnson for vår tid », Nasjonalbibliotekets fagmagasin, 21, 2010, p. 4.
17 Frode Lerum Boasson, « I nasjonens tjeneste? Norske forfatterjubileer 2006-2010 », Edda, vol. 104, 4, 2017, p. 332.
18 Ibid., p. 333.
19 Aldo Keel, op. cit.
20 Liv Bliskrud (et al.), « Innledning. Kunster og kosmopolitt », dans Liv Bliskrud (et al.), Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson studier, Oslo, Novus forlag, 2013, p. 12 : « Med Bjørnson i spissen utvikles det litterære Norge fra å være en provins og frem til å bli et europeisk kraftsentrum. »
21 Liv Bliskrud (et al.), ibid., p. 15 : « Bjørnson var med på å skape en norsk litteratur som sto i konstant dialog med litterære modeller og strømninger i Skandinavia og på kontinentet. »
22 Kristiania / Christiania est le nom donné à la ville d’Oslo de 1624 à 1924 en l’honneur de Kristian IV, roi de Danemark.
23 Keld Hyldig, art. cité, p. 297.
24 Tharald Blanc, Christiania Theaters Historie 1827-1877, Christiania, Cappelens forlag, 1899, p. 194 : « en av de mest interessante Perioder i vor Scenes Historie. »
25 Lise Lyche, Norges teater historie, Asker, Tell forlag, 1991, p. 79 : « dessuten innførte han et interessant og dristig repertoar i scene. »
26 Francis Bull, Norsk litteraturhistorie, Oslo, Aschehoug & Co, 1937, tome 4, p. 543 : « et overordentlig rikt og vekslende repertoire. »
27 Bjørnson a notamment traduit Der geheime Agent [L’Agent secret] (1851) de Friedrich Wilhelm Hackländer pour des représentations au Det norske Theater de Bergen en 1858-1859 (Den hemmelige Agent) ainsi qu’Il ne faut jurer de rien (1836) d’Alfred de Musset pour des représentations en automne 1866 au Christiania Theater (Man maa aldrig sværge paa Noget).
28 Les programmations sont mentionnées dans : Øyvind Anker, Christiania theater’s repertoire 1827-1899. Fullstending registrant over forestillinger, forfattere, oversettere og komponister. Sesongregister, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1956 ; Senter for Scenekunst Norge v/Sceneweb, https://sceneweb.no/.
29 Sylvain Briens, « Géographie de la percée moderne », dans Grands courants d’échanges intellectuels : Georg Brandes et la France, l’Allemagne, l’Angleterre, dir. Annie Bourguignon (et al.), Lausanne, Peter Lang, 2010, p. 252.
30 Johan A. Aarli, « Medisinsk behandling i utlandet : hvorfor Bjørnstjerne Bjørnson døde i Paris 1910 », Tidsskrift for Den norske legeforening, 115, 1995, p. 3740-3744.
31 Helge Dahl, Bjørnson i Roma. Europeer på klassisk grunn, Oslo, Messel forlag, 2008.
32 Stefan Nygård, « The geopolitics of the ‘Modern Breakthrough’: Cultural Internationalisation and geopolitical decline in Scandinavia 1870-1914 », Geopolitics vol. 28, 5, 2023, p. 1993 : « Standing at a relative distance to the centres of political decision-making, they were keen observers of geopolitical shifts and major events in European politics, the local meanings of which they interpreted in widely publicised lectures, speeches and articles. »
33 Aldo Keel, op. cit., p. 53.
34 Karsten Alnæs, Jeg velger meg Bjørnson ! : prosa og lyrikk i utvalg, Oslo, Gyldendal, 2010, p. 21 : « Bjørnson er ikke et dominerende navn i politikken i de siste av 1800-tallet. Men han er med overalt. »
35 Bjørnson promeut le scandinavisme – forme de fraternité entre le Danemark et les Royaumes unis de Suède et de Norvège et danois notamment lorsque le Danemark est menacé par la Prusse. Puis la position de pangermaniste que Bjørnson soutient, quelques années seulement après la fin de la guerre entre le Danemark et la Prusse qui a vu le Danemark amputé d’un tiers de son territoire au profit de l’Allemagne actuelle, a suscité de vives réactions. Voir le chapitre consacré au scandinavisme de Bjørnson dans Kari Haarder Ekman, « Mitt hems gränser vidgades » : en studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet, thèse de doctorat soutenue à l’Université de Göteborg, 2010, p. 167-205.
36 Ragnhild Henden, « Ambivalens og alvor. Bjørnstjerne Bjørnson i møte med europeisk antisemittisme », dans Liv Bliksrud (et al.), op. cit. ; Bernt Hagtvet, Hvor gjerne vilde jeg have været i Deres sted… ! Bjørnstjerne Bjørnson, de intellektuelle og Dreyfus-saken, Oslo, Aschehoug, 1998.
37 Aldo Keel, op. cit., p. 43.
38 Bjørnstjerne Bjørnson, « Hvis er skylden? » [« À qui la faute ? »], Morgenbladet, 22 mai 1903.
39 Id., « Folkenes samhørighed » [« La solidarité des peuples »], Aftenposten, 1er août 1903.
40 Id., « Ved mottagelsen av siste post fra Finland » [« À la réception du dernier courrier venant de Finlande »], Aftenposten, 9 mai 1903.
41 Id., « Til de forviste finner ! » [« Aux Finlandais exilés ! »], Aftenposten, 22 septembre 1903.
42 Id., « Polakkerne som undertrykkere » [« Les Polonais comme oppresseurs »], Samtiden, avril 1907.
43 Bjørnstjerne Bjørnson, « Madjarene som undertrykkere » [« Les Magyars comme oppresseurs »], Morgenbladet, janvier 1908. Citation de Karsten Alnæs, op. cit., p. 10 : « Han krevde dette for rutenerne, det vil si ukrainerne i Russland og Galicja, og for slovakene of rumenerne innenfor det habsburgske riket. »
44 Trygve Tonstad, Bjørnstjerne Bjørnson og slovakene, Oslo, Gyldendal, 1938.
45 Aldo Keel, op. cit., p. 17.
Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle » dans Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières,
Actes de la journée d'études organisée à l'Université de Strasbourg en 2024, publiés par Florence Fix, Corinne François-Denève et Solenne Guyot
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 35, 2025
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/2054.html.
Quelques mots à propos de : Solenne Guyot
Université de Strasbourg
Mondes Germaniques et Nord-Européens
Solenne Guyot est doctorante contractuelle en littérature norvégienne. Sa thèse est codirigée par Thomas Mohnike (Université de Strasbourg, Mondes Germaniques et Nord-Européens) et Giuliano D’Amico (Universitetet i Oslo, Senter for Ibsen-studier) et porte sur la présence du Moyen Âge – autrement dit, le médiévalisme – dans l’œuvre théâtrale de Henrik Ibsen. Elle est chargée d’enseignement en études culturelles et en études scandinaves (littérature du Moyen Âge et du xixe siècle) à l’Université de Strasbourg. Sont en cours de publication plusieurs articles et chapitres d’ouvrages qui s’inscrivent dans les champs de l’éco-critique, des études de genre et de l’intermédialité dans les œuvres d’auteur·e·s scandinaves comme Ibsen, Victoria Benedictsson, August Strindberg ou Gerd Brantenberg.
