Sommaire
Mallarmé herméneute
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
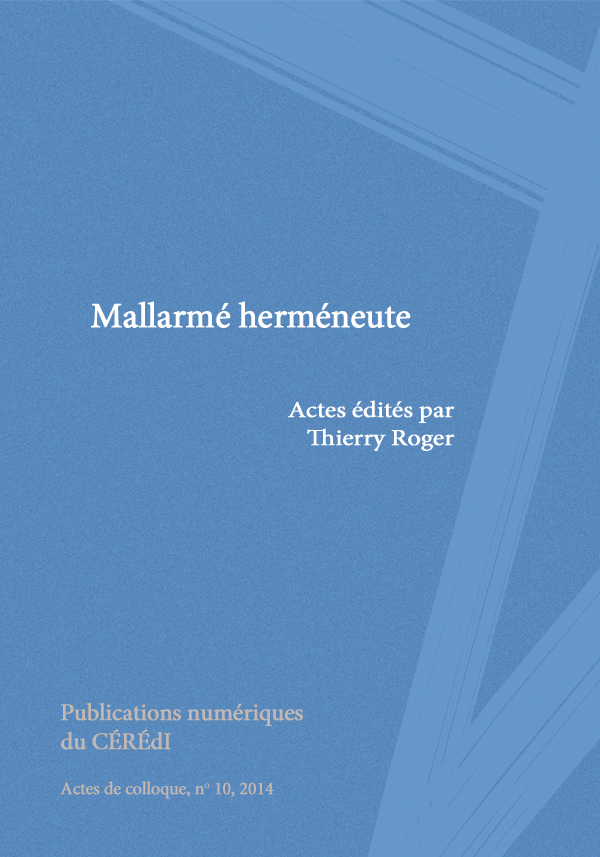
- Le « lecteur d’horizons »
- Pascal Durand Mallarmé dans la prison des signes
- Claude-Pierre Perez « Le cabinet des signes » : Mallarmé, Claudel et l’herméneutique
- Guillaume Artous-Bouvet Mallarmé et l’herméneutique de la nature
- Larissa Drigo Agostinho Lire ou interpréter après la découverte du Néant
- Robert Boncardo Badiou, Mallarmé et le dépassement de l’herméneutique
- Frédéric Torterat Lire avec Mallarmé, entre remémoration et démémoration
- Le lecteur empirique
- Barbara Bohac Mallarmé lecteur de Banville
- Alice Folco Portrait de Stéphane Mallarmé en spectateur
- Maria de Jesus Cabral Je ne sais quel miroitement en dessous : le théâtre, programme humain, outil herméneutique
- Adrien Cavallaro D’un article « plutôt défavorable et malin » : Mallarmé portraitiste de Rimbaud
- Marie Blaise Mallarmé et Poe : « la personne analogue » (À la mémoire de Claude Richard)
- Margot Favard Mallarmé lisant ses pairs, ou comment s’écrit la figure du poète en Maître (Sur « Quelques médaillons et portraits en pied »)
- Le lecteur implicite
- Patrick Thériault L’adresse à communiquer : le motif herméneutique de l’adresse en contexte de modernité poétique. L’exemple du salut mallarméen
- Arild Michel Bakken La figure du lecteur : l’auditoire auctorial dans les Poésies de Mallarmé
- Nelson Charest « La déclaration foraine » ou la réception tue dans les rets du poème
- Annick Ettlin Éloge de la non-lecture. Mallarmé et le mythe littéraire
- Joëlle Molina Mallarmé, passeur secret d’herméneutique ancienne ? La preuve par X.
Le lecteur implicite
L’adresse à communiquer : le motif herméneutique de l’adresse en contexte de modernité poétique. L’exemple du salut mallarméen
Patrick Thériault
La représentation en art est telle, par essence, qu’elle s’adresse à quelqu’un même quand personne n’est présent.
— Hans-Georg Gadamer1
1Dans le bilan qu’il trace de l’histoire et de l’héritage de la « théorie littéraire », Terry Eagleton résume les dispositions anti-essentialistes de la pensée textualiste des années 1960-1970 par référence au refus de ce qu’il appelle la « tromperie “humaniste” », c’est-à-dire
la notion naïve selon laquelle un texte littéraire est la transcription de la voix vivante d’une personne s’adressant à nous. Une telle façon de voir la littérature tend toujours à trouver dérangeante ce qui la distingue – le fait qu’elle est écrite : l’imprimé dans sa froide impersonnalité, sa masse encombrante entre nous et l’auteur. Si seulement nous pouvions parler à Cervantès en personne ! Une telle attitude « dématérialise » la littérature et réduit sa densité matérielle de langage à la rencontre intime de « personnes2 ».
2Le critique anglais offre un condensé suggestif de la relation d’identification auteur-lecteur qui fut au cœur, et comme le cœur vivant, de la « vieille critique » dénoncée par la génération structuraliste. Mais la « rencontre intime » qu’il évoque ne diffère pas substantiellement de l’espace imaginaire où l’herméneutique contemporaine nous invite à étudier le déploiement phénoménologique du « dialogue » de la lecture. De la vieille critique à l’herméneutique, de fait, une communauté de thèmes essentialistes – et peut-être surtout une même inspiration romantique3 – conduit à valoriser semblablement la dimension imaginaire ou identificatoire de la lecture. On comprend que les héritiers plus ou moins directs du structuralisme, de Lacan à Bourdieu, en passant par Badiou et Derrida, aient renouvelé et redirigé à l’endroit des représentants de l’herméneutique contemporaine – au premier chef, bien sûr, Gadamer et Ricœur – les motifs d’accusation que les premiers structuralistes, en critique littéraire, adressaient aux défenseurs de la tradition, sous ses deux versants positiviste et impressionniste. Au discours humaniste, on aura reproché sans détour sa conception naïve de la littérature ; à l’herméneutique, on aura ironiquement fait grief de son attitude par trop révérencieuse devant l’Œuvre, la Culture et la Tradition, en voyant dans cette « piété » un signe de sa nature (crypto)théologique4. Dans l’un et l’autre cas, structuralistes et poststructuralistes se seront appliqués à stigmatiser une même illusion ou « pensée essentialiste5 ».
3Marqué depuis une vingtaine d’années par le reflux des approches textualistes, le champ de la critique littéraire contemporaine n’est plus guère témoin d’attaques contre l’herméneutique et la « tromperie humaniste ». Quelques tirs isolés ici et là – en provenance d’approches devenues institutionnellement marginales comme la déconstruction – mais plus de feu nourri. En fait, le regain d’intérêt actuel pour l’histoire littéraire et la problématique de l’intersubjectivité – et corrélativement pour des motifs critiques plus « incarnés » sur le plan ontologique (l’ethos, la voix, la conscience, etc.) – semble plutôt annoncer le retour en grâce de l’herméneutique. Dans le sous-champ des études dix-neuviémistes, les travaux d’Alain Vaillant semblent confirmer cette tendance. De manière expresse ou non, ils éclairent presque tous la dimension de la parole et de l’intersubjectivité impliquée dans l’écrit, que ce soit par référence au cadre métadiscursif de la rhétorique, dans des genres comme l’épistolaire et la poésie moderne ou bien à travers des procédés discursifs comme l’humour6. Par là, ils veulent faire droit au désir, qui semble bel et bien poindre dans le champ littéraire, d’« entendre à nouveau aujourd’hui, par-delà les formes d’écriture, le bruissement des paroles disparues7 ». Par l’attention qu’ils accordent à cette « entente » (à prendre à tous les sens du mot), les travaux de Vaillant revêtent un caractère résolument herméneutique. D’ailleurs, la contextualisation historique et l’analyse textuelle s’y accompagnent presque toujours de considérations réflexives où les options épistémologiques de l’herméneutique sont souvent revendiquées comme telles.
4L’intérêt de ces travaux réside d’abord dans le fait qu’ils réactualisent le modèle de la « rencontre » imaginaire pour penser les médiations de la lecture littéraire. Mais il réside aussi dans le fait qu’ils recourent paradoxalement à ce modèle pour rendre compte de la littérature de la modernité, c’est-à-dire de cette même littérature qui, multipliant les fins de recevoir à ses lecteurs, prétend se définir par sa « vocation anti-communicationnelle8 »… D’où la question qu’ils posent : comment la modernité – haut lieu de l’affirmation formelle et de la sacralisation historique de l’écrit, et incidemment creuset de cette écriture que les structuralistes célèbreront un siècle plus tard – peut-elle encore nourrir, et même nourrir plus que jamais, l’imaginaire humaniste de la littérature comme espace de la parole échangée, lieu de la rencontre fantasmatique entre auteur et lecteur ? En quoi l’écrit moderne – la « densité matérielle » et la « froide impersonnalité » de l’écrit moderne, pour reprendre les termes d’Eagleton – est-il de nature à favoriser l’empathique « communication » littéraire vantée par la tradition ?
5L’articulation de cette problématique fait signe vers une conception à la fois nouvelle et traditionnelle de la communication littéraire et de la modernité. Cette conception engage un motif critique dont l’importance est par ailleurs confirmée dans différents champs du savoir – de l’herméneutique à la psychanalyse, en passant par la linguistique, les études littéraires et la rhétorique –, même si, là comme ailleurs, il a la particularité d’être peu thématisé. Ce motif déterminant et insuffisamment théorisé, c’est l’adresse. C’est cette composante de l’univers du discours – et plus particulièrement de l’imaginaire du discours9 – que nous nous proposons d’abord d’isoler de quelques développements critiques d’A. Vaillant avant de l’analyser brièvement et de la mettre en parallèle avec la symbolique et la poétique du salut mallarméen, en lequel elle trouve une illustration exemplaire.
La modernité : le salut inespéré de la littérature
La lecture relève de l’obscurité de la nuit – même si on lit en plein jour, dehors, la nuit se fait autour du livre.
— Marguerite Duras10
Je suis seul avec lui dans l’ombre, le soir va venir…
— André Suarès11
6Pour Alain Vaillant12, la modernité littéraire traduit d’abord et avant tout le passage de la littérature-discours, c’est-à-dire d’une littérature dominée par le modèle oratoire et interlocutoire de la rhétorique, tel qu’il présidait à l’esthétique classique et était encore prégnant dans le premier romantisme, à une littérature-texte : cette nouvelle donne symbolique correspond à un régime littéraire surdéterminé sur le plan herméneutique, où l’écriture se transforme en une forme de jeu de chiffrement et où la lecture, réciproquement, en vient à s’apparenter à une activité de déchiffrement. C’est dire que la littérature more rhetorico, telle qu’elle était marquée par le primat de la parole et la présence éthique du sujet de l’énonciation et de son destinataire, s’est plus ou moins brusquement muée en une réalité verbale – le texte – où s’affirme la dimension de l’écrit et où les indices de subjectivité tendent à s’effacer. La modernité « textuelle » que décrit ainsi Vaillant dessine ce qu’on pourrait appeler le devenir herméneutique de la littérature.
7À l’origine de cette mutation, le critique désigne un facteur qui est d’ordre plus diffusément social qu’étroitement politique : la naissance et le développement hégémonique du système médiatique sous la Monarchie de Juillet. C’est là une donnée déterminante dans la mesure où l’expansion de la presse aura eu pour effet, assez rapidement, d’uniformiser et de standardiser la chose écrite. Or, pour Vaillant, les phénomènes de « textualisation », d’« opacifiation » et de « littéralisation » qui correspondent aux principaux symptômes formels de la modernité sont essentiellement le fait de la réaction des écrivains à ce mouvement d’uniformatisation et de standardisation du discours : appréhendant dans l’expansion du système médiatique une menace de dépersonnalisation de la « communication » littéraire, les Hugo, Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé auraient été conduits à y réagir (sous l’effet d’une logique qui relève sous doute tout autant de l’initiative individuelle que de l’inconscient structurel du jeu littéraire13) en particularisant et en complexifiant leur écriture. En ce sens, le surcodage herméneutique et le surinvestissement stylistique qui caractérisent la littérature moderne comme régime du texte seraient l’expression de la dissidence des écrivains par rapport aux nouveaux codes communicationnels ; ils signifieraient leur refus d’adhérer à ces codes – ou d’y adhérer complètement, car, évidemment, la carrière sinon la survie de la quasi totalité d’entre eux dépend directement des revenus financiers et du capital symbolique auxquels l’activité journalistique donne accès.
8En conférant à la littérature l’épaisseur ou la compacité herméneutique qu’on lui connaît depuis, les écrivains modernes auraient cherché et finalement réussi à « sauver » ce que Vaillant appelle le « principe du geste littéraire » :
Les idéologies et les sociétés ont changé, sans modifier le principe du geste littéraire : du point de vue de l’écriture, l’obscurité et le refus des conventions sont, pour le xixe siècle, ce que représentaient à l’époque classique l’exigence de clarté et les règles de composition, à savoir les conditions formelles d’une communication réussie14.
9Ce « geste littéraire » auquel serait suspendue la communication littéraire « réussie », c’est ce que le critique appelle par ailleurs la « fonction médiatrice » de la littérature : à savoir la fonction qui serait traditionnellement sienne de faire « médiation entre les personnes15 », de réunir un auteur et un lecteur dans le cadre d’une rencontre imaginaire personnalisée, et qui se déploie phénoménologiquement sur le modèle de la conversation16. C’est cette exclusivité que la littérature moderne préserverait en tenant à distance, par sa difficulté caractéristique, le grand nombre et corrélativement en encourageant les « bons entendeurs », à travers et à la faveur du travail de l’interprétation, à nouer ou produire une relation imaginairement plus étroite avec l’auteur. En ce sens, il semble tout à fait juste et même judicieux de conclure que l’« inintelligibilité » de la littérature moderne représente pour certains de ses lecteurs la « promesse d’une intelligence complice17 ».
10On constate, en extrapolant quelque peu sur le propos de Vaillant, que cette « intelligence complice » relève d’une relation auteur-lecteur qui, parce qu’elle participe principalement de l’imaginaire de la lecture ou de l’Imaginaire comme dimension principielle de la lecture, n’est pas proprement traduisible dans les termes de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « contrat de lecture », lequel renvoie à une réalité légale et appartient comme tel au registre du symbolique. La relation que cette intelligence suppose est tout à la fois plus fondamentale et plus difficile à saisir, car forcément plus spéculative, que celle du contrat de lecture : s’assimilant à une forme de complicité, elle revêt plutôt le caractère officieux, et même quelque peu équivoque, d’un pacte ou d’une pactisation entre auteur et lecteur. Par là même, le « geste » qu’elle décrit métaphoriquement apparaît d’autant plus invitant aux yeux ou au regard de certains lecteurs – c’est-à-dire d’autant plus excitant du point de vue de leur imaginaire – qu’il semble électif : tout se passe en effet comme si l’auteur, dans le régime dense et opaque de la textualité moderne, s’adressait à ces lecteurs en particulier – et non au tout venant. Ou plus exactement : tout se passe comme si, sur le fond et au rebours de l’ensemble des discours sociaux en processus de démocratisation rapide, il continuait à formuler cette adresse élective et que, ce faisant, il reconduisait l’immémorial acte définitoire de la littérature comme acte de reconnaissance imaginaire entre élus.
11Sur le plan théorique, cette conception de la littérature (moderne) présente ainsi l’avantage de faire saillir l’adresse du discours. Comme nous le suggérions en introduction, ce motif se détache de presque tout l’univers de la pensée contemporaine, mais d’une manière éparse : en théorie littéraire, où il sert de base de définition à certains genres dits « de circonstance18 » ; en linguistique, où il n’est pas rare de le rencontrer dans l’analyse pragmatique19 ; en herméneutique, où il constitue une composante déterminante de la logique question-réponse20 ; enfin, en psychanalyse et en déconstruction, où il s’impose comme un terme clef de la problématique de la destination du discours21. En plus de ces occurrences critiques, la notion d’adresse semble se démarquer dans le domaine classique, à titre de sœur jumelle, ou sinon de proche parente, de la conuenientia, notion sous laquelle la rhétorique, comme on sait, désignait la propriété d’un discours dûment adapté à l’ethos de l’orateur et de l’auditeur22. En l’occurrence, la conception de Vaillant donne plus précisément à penser le motif de l’adresse en son versant imaginaire, c’est-à-dire sous l’angle où il s’avère être une composante centrale de la logique transférentielle impliquée dans les médiations herméneutiques. Elle postule que le « principe du geste littéraire » et la condition première de la « communication réussie » ne sont rien d’autre que l’adresse en tant que réalité imaginaire. En d’autres mots, elle invite à concevoir la littérature comme un acte verbal doublement adressé : une première fois, sur le plan structural (au sens où on dit que type d’énoncé et d’énonciation, quel qu’il soit, implique un destinataire ou un « super adressé », selon l’expression de Bakhtine23) ; une seconde fois, sur le plan imaginaire, où la littérature apparaît conférer une présence et prégnance fantasmatiques aux instances de l’auteur et du lecteur et instituer entre elles, par un « geste » de rapprochement qui vaut métaphoriquement pour une main tendue, une forme de dialogue. C’est l’adresse, prise en sa dimension imaginaire, qui fait de ces instances textuelles, par définition impersonnelles et universelles, des figures pour ainsi dire personnelles – l’Auteur et le Lecteur. C’est elle qui fait de la littérature – et qui nous permet de définir la littérature par cet attribut, à la suite et au-delà de l’analyse de Vaillant – comme un appel ou une demande de reconnaissance formulé – comme « dans la nuit » ou à contrejour du grand nombre – par un Moi désirant à un autre Moi désirant24.
12Cette mise en relief critique du motif de l’adresse signale l’importance de la parole et de l’interlocution dans un contexte littéraire, celui de la modernité, qu’on définit traditionnellement par opposition à l’idée même de communication. Reconnaître cette importance, c’est tracer un constat qui va à contresens du jugement dominant en la matière. C’est donc aussi contredire ceux qui estiment que la crise majeure que traverse aujourd’hui la littérature est l’effet des dispositions prétendument anti-communicationnelles de la modernité. Michel Brix se fait le porte-parole de cette idée : « Aujourd’hui, l’écrivain ne s’adresse à personne en particulier tandis qu’à l’âge classique, la question de la réception était primordiale : on considérait alors qu’il n’était nul besoin de créer des ouvrages littéraires que le public n’attendait pas25 ». Ce genre de diagnostique croit pouvoir s’autoriser des commentaires mêmes des écrivains modernes, en prenant aux mots, par exemple, un Mallarmé décrétant que le Livre « ne réclame approche du lecteur », qu’il « a lieu tout seul26 » ; ou bien un Flaubert affirmant modeler son écriture sur le patron idéal d’une œuvre « sans attache extérieure », qui se tiendrait d’elle-même « par la force interne de son style27 », comme coupée des médiations du discours ; ou bien encore un Baudelaire multipliant, dans ses journaux intimes, les passages à caractère misanthropique, jusqu’à laisser croire qu’il « ne cherche aucune complicité28 », dans la vie comme dans l’écrit. Or, on peut reprocher aux critiques qui s’inspirent de telles déclarations de ne pas suffisamment prêter attention à la dynamique discursive dans laquelle elles s’inscrivent et qu’elles tendent, par leur statut même de dénégations, à exciter. Cette dynamique discursive n’apparaît vraiment qu’à la lumière d’un point de vue critique informé par la problématique du désir. On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, qu’un fin analyste du désir comme René Girard en ait entrevu le principe fondamental, sous le motif de la séduction :
L’écrivain [contemporain] lance un anti-appel au public sous forme d’anti-poésie, d’anti-roman, ou d’anti-théâtre. On écrit pour prouver au lecteur qu’on se moque de ses suffrages. On tient à faire goûter à l’Autre la qualité rare, ineffable et nouvelle du mépris qu’on lui porte. […] Depuis la fin du xixe siècle, toute idée de réciprocité, même imparfaite, dans les rapports au public est devenue insupportable. L’écrivain se fait toujours imprimer mais, pour cacher ce crime, il fait tout pour empêcher qu’on le lise. Il a longtemps prétendu qu’il ne parlait qu’à lui seul, il prétend de nos jours qu’il parle pour ne rien dire.
Il ne dit pas la vérité. L’écrivain parle pour nous séduire, comme par le passé29.
13Girard, comme Vaillant, est d’avis qu’il n’y a pas solution de continuité entre la tradition et la modernité en matière de communication littéraire : en dépit de ce que peut laisser croire son apparent autisme ou narcissisme textuel, l’écrivain moderne continue à « parler », à adresser son écriture à la manière d’une parole, « comme par le passé ».
14Et le critique précise : s’il parle, c’est « pour nous séduire ». C’est suggérer qu’en son versant imaginaire, le « geste littéraire » ne représente pas seulement, comme y insistent les discours tendanciellement iréniques de l’humanisme et de l’herméneutique, un mouvement d’ouverture à l’autre, une invitation au dialogue, une main tendue à l’ami : il est également et plus fondamentalement un geste de séduction. C’est là une précision critique d’importance, telle à affecter notre appréciation de la communication littéraire ou, plus exactement, telle à montrer la nature affective de cette communication, son ancrage dans le registre des passions. De fait, entre l’auteur et le lecteur, il ne saurait y aller que d’une pure entente, car, comme dans toute relation marquée au coin de l’imaginaire, leurs rapports sont imprégnés de passion. Le terme « séduction », scandé comme « sé-duction », dit justement cette relation : ici comme ailleurs, il renvoie à un mouvement imaginaire consistant en l’élection et la mise à l’écart de l’Un sur le fond de l’ensemble indifférencié formé par les autres30. Le Moi lecteur est cet Un que l’auteur choisit en le détachant du grand nombre, c’est-à-dire du « public » auquel Girard fait référence. Croyant, sous la pression d’une sorte de « réflexe anagogique31 », que l’auteur lui fait signe, s’adresse à lui, il croit qu’il le désigne singulièrement et comme électivement. Au vu du narcissisme primaire qui gouverne le régime imaginaire des identifications, il n’est pas exagéré d’affirmer que le lecteur est dans la posture du seigneur à qui se dédie l’ode ou l’hymne – genres exemplaires, s’il en est, du motif de l’adresse. Réciproquement, l’auteur est aussi en situation imaginaire de demande, d’appel : comme le souligne Jacques Derrida, « dans toute adresse, il y a du “je t’aime, écoute”, “je t’aime entends-tu ?”, j’ajoute du “je t’aime, lis-tu ?”, du “peut-être m’entends-tu dans la nuit…”, j’ajoute encore du “peut-être me lis-tu dans la nuit32”… ».
15Il arrive que cette demande imaginaire – c’est une modalité constitutive de toute relation de séduction – se teinte de provocation. L’appel de l’auteur au lecteur prend alors l’insistance et le caractère jussif d’une pro-vocation : « lis-moi, en seras-tu jamais capable33 ? ». Cette question en forme de défi – qui exacerbe la tension et la passion contenue dans le tête-à-tête fantasmatique de l’auteur et du lecteur et qui, ce faisant, révèle la nature cachée de leur relation comme face-à-face imaginaire chargé d’agressivité –, c’est toute la textualité opaque de la modernité poétique qui l’articule. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’elle y prenne la forme explicite d’une provocation d’auteur adressée à son lecteur. C’est le cas, par exemple, lorsque le poète rimbaldien affirme crâneusement avoir « seul la clef de cette parade sauvage34 » ; ou bien, à la fin des Chants de Maldoror, lorsque le poète ducassien égare son lecteur dans un itinéraire parisien en forme de véritable labyrinthe herméneutique, avant de brutalement l’apostropher et de le mettre au défi : « allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire35. »
16Comme le suggèrent ces exemples de pro-vocation, le « principe du geste littéraire » comme adresse singulière à l’autre est radicalisé, et par là même rendu explicite sur le plan critique, par le type de textualité opaque en lequel Alain Vaillant voit les conditions de possibilité mêmes de la communication littéraire en régime de modernité. On peut désigner ce type de textualité sous le nom d’hermétisme, ce qui permet notamment de bien en montrer la filiation avec la tradition littéraire36. Par définition, l’œuvre hermétique se destine à une classe d’initiés, ou invite certains de ses lecteurs à se considérer tels (c’est là son efficace fantasmatique). Le modèle de communication qu’elle implique est clairement antidémocratique et c’est précisément en s’affichant ainsi qu’elle revêt une prégnance extraordinaire auprès de cette catégorie de lecteurs qu’on peut associer, avec Paul Valéry, au « petit nombre37 ». En ce sens, on pourrait dire de l’œuvre hermétique ce qu’un philosophe disait du secret : à savoir qu’elle « rapproche dans l’acte même par lequel [elle] tranche », qu’elle « dit non à l’un que pour dire oui à l’autre » et qu’elle est ainsi comparable à un « grand amour jaloux qui aime contre quelqu’un, qui a besoin de refus, de relief et de contrastes38 ».
17Dans la mesure où elle a pour motif express d’écarter la masse, l’œuvre hermétique extériorise la part non seulement de passion, mais de violence symbolique qui est impliquée dans le mouvement de sé-duction herméneutique. D’ailleurs, s’inscrivant dans l’hermétisme le plus classique, la formule de Mallarmé qui fait de la capacité de « détourner l’oisif39 » l’une des propriétés de la vraie communication poétique exprime cette violence symbolique d’une manière presque aussi transparente que le célèbre « vulgus arceo » de Horace40. Certes, l’auteur du Mystère dans les lettres présente ce « détournement » comme une marque de civilité, valant pour un « Salut, exact, de part et d’autre – ». Mais ce salut ne réalise ni sanctionne aucune proximité interpersonnelle. En fait, ce n’est rien d’autre qu’un bonjour, celui qu’on lance symétriquement, réciproquement, presque anonymement, au tout venant. Il ne manifeste pas tant la présence de l’autre (imaginaire) que la distance (socialement vitale, il est vrai) que l’Autre introduit entre les sujets et que quadrille l’ordre impersonnel et universel du symbolique.
18C’est par opposition à cette adresse de pure convention, qui représente le lien social minimal, que Mallarmé donne à penser le « véritable » salut. Celui-ci échappe au public et à la lumière de la publicité. Il vaut pour un rapprochement imaginaire entre auteur et lecteur qui se réalise sur un mode négatif : comme écart par rapport à la société, retranchement « ab oculis populi41 ». Comme tel, ce salut mallarméen est l’expression emblématique du type de communication à caractère électif qui, mettant à profit les « obscurités propices des transferts42 », pour reprendre une belle formule d’Édouard Glissant, s’avère « authentiquement » littéraire. Il convient pour cette raison que nous nous y attardions. D’autant plus que Mallarmé ne se contente pas, que ce soit dans Le Mystère dans les lettres ou ailleurs dans sa prose critique, d’évoquer en termes exemplaires la communication littéraire « réussie » : il s’applique aussi, avec plus de méthode, d’insistance et de talent qu’aucun autre écrivain moderne, à la mettre en œuvre, en articulant à travers sa textualité hermétique ce qu’il faut reconnaître comme une véritable poétique du salut.
Un « geste littéraire » exemplaire : le salut mallarméen
Je ne vois pas de différence de principe entre une poignée de main et un poème.
— Paul Celan43
19C’est peu dire que Mallarmé accorde une place de choix au motif du salut. Il n’est pas rare qu’il y fasse explicitement référence, comme dans « Toast funèbre », « Au seul souci de voyager », le « Cantique de saint Jean ». Et il est éminemment significatif qu’il le place à l’initiale même des Poésies, en s’en servant comme titre du sonnet épigraphe du recueil. Mais c’est surtout sur le plan formel, donc d’une manière implicite, que le motif du salut se recommande ici par son importance : en effet, il prend tout son relief critique comme emblème ou épure de ce qu’on peut concevoir comme la logique communicationnelle la plus typiquement mallarméenne. Cette logique discursive, que le poète n’a de cesse de surligner et de mettre à profit à travers les différents jeux énonciatifs auxquels il s’adonne, c’est celle de l’acte de langage comme don et, corrélativement, celle du réseau symbolique qui se déploie à partir de cet acte44. Aucun écrivain n’insiste avec autant d’habileté technique ni ne capitalise avec autant d’intelligence réflexive sur la fonction – dite « symbolique » – qui fait du langage le lieu et le lien même de l’intersubjectivité45. C’est cette fonction symbolique que Mallarmé traduit comme un salut et dont il cherche à maximaliser les effets dans le cadre et à la faveur de l’échange poétique. Les quatrains des « loisirs de la poste », les envois de cadeaux versifiés et toutes les autres attentions ou galanteries poético-postales qui forment le versant (expressément) événementiel du corpus mallarméen témoignent on ne peut plus clairement de cette surdétermination symbolique. De tels jeux accusent une tendance vocationnelle qui se confirme transversalement dans l’œuvre du poète46. Ils invitent comme tels à constater que, pour l’auteur des Poésies et des Divagations et même pour l’auteur des Notes sur le « Livre », l’acte poétique ne vise pas tant à faire sens qu’à faire signe : il se décline et s’offre en priorité comme un acte de reconnaissance47.
20Avant même de l’investir d’un sens sotériologique et d’en faire une composante-clé de la vaste problématique théologique et métaphysique de la mort de Dieu, le texte mallarméen met donc en exergue le motif du salut en tant que motif indicatif de l’adresse du discours. Et à travers lui il ne donne pas seulement à penser l’adresse sous son aspect symbolique. Il la révèle aussi sous l’angle imaginaire où elle exprime le « geste littéraire » comme relation de séduction et de connivence entre auteur et lecteur. (On remarquera que c’est même explicitement comme tel que l’acte de communication, sans renvoyer à un cadre étroitement littéraire, se réfléchit dans la correspondance du poète : comme l’ont noté un certain nombre de critiques, les lettres mallarméennes semblent en effet trahir une « curieuse obsession de la main tendue, “donnée48” » ; elles se terminent presque toutes par des formules de salutation qui font intervenir le motif de la main, du genre « votre main », « Je vous presse la main », ce « pressement de main, qui contient ma ferveur », etc. Ainsi, ces innombrables mains disent ce que l’écriture de Mallarmé cherche de manière générale à faire, à produire sur le plan imaginaire : à savoir quelque chose comme un salut, un geste d’amitié).
21Plus que tout autre poème, le sonnet « Salut » permet d’illustrer le mode de réalisation imaginaire de ce geste littéraire49. Il laisse entendre une certaine parole résiduelle, le fil d’une certaine voix comme amortie par la distance textuelle et rendue par là même d’autant plus attirante et mystérieuse. Au lecteur qui accepte d’y prêter l’oreille – c’est-à-dire de céder un tant soit peu à la passion de l’interprétation et de « suivre », contre la juste mesure classique, un auteur qui se laisse « toujours chercher », comme dirait Boileau50 –, le fil de cette voix conduit à une scène confidentielle : celle de l’énonciation du toast qui, sur le plan référentiel, fait signe vers le contexte d’origine du poème et qui, sur le plan imaginaire, vaut pour le foyer de son intersubjectivité. Par rapport aux autres composantes sémantiques (notamment l’isotopie de la navigation, qui entre étroitement en relation avec elle), cette scène recouvre une primauté herméneutique indéniable dans la mesure où elle seule permet de comprendre le régime d’énonciation particulier – le toast – à partir duquel se structure l’ensemble du poème. C’est pourquoi comprendre « Salut » implique d’entendre la parole du toast qui s’y formule. Et comme cette parole est considérablement opacifiée, littéralisée, textualisée, l’entendre signifie « sous-entendre » l’auteur, c’est-à-dire percevoir son « air ou chant, sous le texte51 ». Le rapprochement entre l’auteur et le lecteur ou, si on préfère, le sens imaginaire du poème comme salut, comme acte de connivence et de reconnaissance, se réalise dans cet art de l’entente.
22C’est sous cet angle que le poème liminaire des Poésies révèle le motif de l’adresse en ses modalités typiquement modernes, à savoir comme un phénomène imaginaire dépendant d’une certaine adresse – ou virtuosité technique. Mais il a également l’intérêt sur le plan herméneutique de réfléchir le portrait du lecteur – de l’adressé – tel que Mallarmé le conçoit et le conditionne par son écriture : par analogie à un ami (« Nous naviguons, ô mes divers / Amis […] »). Certes, l’image n’est pas nouvelle : depuis l’Antiquité, c’est par référence à l’amitié qu’on pense la relation herméneutique ; depuis toujours, c’est à des amis qu’on compare et que se comparent les partenaires de l’échange littéraire. Mais le texte mallarméen ne vise pas n’importe quelle sorte d’amis : il s’adresse à des amis que tout concourt à associer à des admis, c’est-à-dire des initiés ou, selon l’expression de Frank Kermode, à des « insiders » de l’imaginaire du texte52. « Salut » le signifie aussi pragmatiquement : loin de se réduire à une borne liminaire, il paramètre un passage, contrôle une admission. Ses modalités stylistiques, marquées par des effets d’ellipse qui en font l’un des écrits les plus emblématiquement difficiles de la poétique mallarméenne de la maturité, confèrent à l’entrée dans le recueil le sens fort d’une initiation ; par ce biais, l’auteur annonce au lecteur que l’expérience qui l’attend sera une traversée des signes certes jouissive, mais exigeante – jouissive car exigeante – propre en somme à l’éprouver, à le tester comme interprète. Dans ce pacte de lecture (au sens où, comme nous l’avons supposé, l’imaginaire de la lecture est justiciable d’un pacte, davantage que d’un contrat), quelque chose d’une expérience initiatique s’indique ; sur cette base de départ quelque chose d’une épreuve éliminatoire de nature à séparer lecteurs vulgaires et véritables lecteurs – et donc à attiser les passions rivales des uns et des autres – se met déjà en place, se pro-gramme. Ce que « Salut » adresse en tête des Poésies, autrement dit, c’est une « proposition d’identification53 » susceptible d’exciter la sensibilité et l’imaginaire des lecteurs d’exception.
23Si on peut qualifier ces lecteurs d’« authentiques » littéraires – en s’autorisant là encore du propos théorique de Mallarmé, qui n’hésite pas à faire d’un certain « besoin d’exception, comme de sel54 », l’un des traits fondamentaux de l’essence ou de l’habitus du lettré –, il faut admettre que leur visage reste indéfini. Le poète les apostrophe, mais d’une manière indéterminée ; il s’adresse à « divers amis » – comme s’il s’agissait d’emblée de signifier que l’amitié dont il y va dans ce poème et dans ce recueil, en tant qu’amitié herméneutique, est moins une condition a priori de la lecture qu’un produit imaginaire de la lecture.
24On peut malgré tout essayer de préciser les traits de ces « amis » en les considérant par référence à l’idée de complicité, donc comme des lecteurs-complices. On se souvient qu’Alain Vaillant suggérait cette qualification lorsqu’il comparait la relation auteur-lecteur propre à la modernité à une forme d’« intelligence complice ». La notion de complicité a d’abord l’avantage de renvoyer à l’univers du crime et de l’illicite, ou plus généralement à ce qui est suspect, louche, équivoque. Elle induit à concevoir l’auteur et le lecteur comme des « partenaires dans le crime ». Comme telle, non seulement entre-t-elle en résonance avec un registre thématique déterminant de la littérature moderne, celui de la criminalité, mais elle rappelle surtout que la connivence imaginaire à la base de communication littéraire, comme toute forme de connivence, est chargée de négativité, dans la mesure où elle repose sur l’exclusion du grand nombre, le rejet des « outsiders ». En quoi l’idée de complicité nous invite à reconnaître les « effets de discrimination de l’esthétique55 » ou, si on préfère, à ne plus méconnaître la vérité à quelque degré scandaleuse que la tradition herméneutique tend à dénier : à savoir qu’en matière d’interprétation comme ailleurs, l’amitié véritable revêt un caractère antidémocratique, contraire à l’idéal universaliste de l’éthique moderne, et qu’elle se soutient toujours d’un crime symbolique de nature « sacrificielle », comme dirait Jacques Derrida56, commis à l’endroit de tous les autres qu’elle exclut. Ce tiers exclus ou sacrifié grâce auquel se soude la connivence imaginaire entre auteur et lecteur, ce bouc émissaire à partir duquel se déploie la communication littéraire en modernité littéraire, correspond évidemment, sur le plan des représentations socioculturelles, au lecteur bourgeois.
25Enfin, si on a quelque raison de promouvoir l’idée de complicité pour décrire le modèle communicationnel qui se décalque de l’œuvre de Mallarmé et de la modernité poétique dans son ensemble, c’est aussi parce qu’elle a la particularité, par un tour heureux de la langue, de renvoyer étymologiquement au motif du pli (au verbe latin « plico »), et donc par analogie à ce qu’on peut concevoir, dans une perspective d’ailleurs toute mallarméenne, comme les plis ou les replis du style et les complications de l’écriture. Or, comme nous l’avons suggéré, c’est précisément parce qu’elle se complique et qu’elle se replie dans une fausse apparence d’intransitivité que la littérature comme celle de Mallarmé peut encore, par delà le classicisme et le règne de la rhétorique, prétendre susciter la rencontre de conscience à conscience ou la conversation imaginaire entre auteur et lecteur qui s’assimile à la « communication réussie ». Et c’est en procédant ainsi, en laissant deviner une certaine présence d’auteur derrière le rideau épais de la textualité, qu’un poème exemplaire comme « Salut » en arrive finalement à sauver la littérature comme espace imaginaire de connivence contre l’insignifiance de la rumeur sociale et les effets dépersonnalisants de la modernité médiatico-démocratique.
1 Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, Seuil, « L’Ordre philosophique », 1996, p. 128.
2 Critique et théorie littéraires. Une introduction, Paris, PUF., « Formes sémiotiques », 1994, p. 120.
3 Cette inspiration procède de la tendance lourde de la modernité que Jean-Marie Schaeffer a brillamment analysée sous le motif de la « théorie spéculative de l’Art » (L’Art de l’âge moderne. L’esthétique et la philosophie de l’art du xviiie siècle à nos jours, Paris, Gallimard, « NRF Essais », 1992).
4 Mieux que tout autre témoignage, la réflexion qui a accompagné et suivi la « rencontre » de Gadamer et de Derrida à Paris en avril 1981 permet de mesurer les profondes divisions qui séparent l’herméneutique et le poststructuralisme. Voir à ce sujet Diane P. Michelfelder et Richard E. Palmer (dir.), Dialogue and Deconstruction. Gadamer-Derrida Encounter, Albany, State University of New York Press, 1989.
5 L’expression est de Pierre Bourdieu (Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, « Points / Essais », 1998, p. 484).
6 Voir notamment Alain Vaillant (dir.), Le Rire moderne, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, RITM, 2013 ; L’Histoire littéraire, Paris, Armand Colin, « U », 2010 ; Baudelaire, poète comique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Interférences », 2007 ; La Crise de la littérature : romantisme et modernité, Grenoble, ELLUG, « Bibliothèque stendhalienne et romantique », 2005 ; L’Amour-fiction : discours amoureux et poétique du roman à l’époque moderne, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, « Essais et savoirs », 2002 et Écriture, parole, discours : littérature et rhétorique au xixe siècle, Saint-Étienne, Éditions Printer, « Lieux littéraires », 1992.
7 Alain Vaillant, Écriture, parole, discours…, op. cit., p. 9.
8 L’expression est de Jean-Pierre Bertrand, qui l’utilise par référence à la poétique de Jules Laforgue (préface aux Complaintes, Paris, GF Flammarion, 1997, p. 17).
9 Au vu de l’importance qu’elle recouvre pour la présente problématique, comme pour l’herméneutique en général, rappelons d’entrée de jeu que la notion d’imaginaire renvoie au registre qu’investit primordialement toute lecture littéraire : comme l’a bien vu Barthes, le sujet-lecteur est « tout en entier déporté sous le registre de l’Imaginaire » (Œuvres complètes, éd. É. Marty, t. IV, Paris, Seuil, 2003, p. 929). Pour Jacques Lacan qui, comme on sait, l’a théorisé à partir de son analyse séminale du stade du miroir, l’imaginaire désigne la dimension du Moi et de ses diverses productions ou projections fantasmatiques. C’est le champ de la subjectivité en tant que champ visuel ou champ marqué par le primat du regard, tel qu’il paramètre notamment l’optique de la conceptualité occidentale : la théorie (« theoria »), le phénomène (« phainomenon »), le fantasme (« phantasma ») l’essence et l’idéal (« eidos ») y puisent tous la racine de leur étymologie et la configuration spéculaire ou la portée spéculative de leur sens ; ils y rencontrent aussi leur limite épistémologique, dans la mesure où l’imaginaire est aussi la dimension d’une certaine automystification, où le narcissisme fondamental du sujet s’exerce à plein et où il tend constitutivement à prendre ses projections fantasmatiques — sur un plan d’idéalité qu’on pourrait comparer à une planche de Rorschach — pour des motifs de vérité. Dans le registre de l’affectivité, et nous aurons l’occasion de le constater, l’imaginaire est aussi l’élément de la passion où, comme le jeune enfant devant la glace, le Moi est confronté à l’image fascinante et irritante de son double, figure ambivalente du même (objet d’identification, d’attachement et d’amour) et de l’autre (objet de rejet, d’agressivité et de haine) dont il « s’hainamoure », pour reprendre le néologisme évocateur de Lacan (Le Séminaire. Encore, t. XX, Paris, Seuil, « Points / Essais », 1975). Une remarque méthodologique : chaque fois que nous aurons à référer aux acteurs de l’échange littéraire comme instances de l’imaginaire ainsi défini, nous utiliserons désormais la majuscule et écrirons « Auteur » et « Lecteur ». De même, nous privilégierons la forme capitalisée « Imaginaire ».
10 Le Camion (suivi d’Entretien avec Michèle Porte), Paris, Minuit, 1977, p. 112.
11 Cité par Jean-Louis Cabanès et Guy Larroux, dans Critique et théorie littéraires en France (1800-2000), Paris, Belin, « Belin Sup-Lettres », 2005, p. 224.
12 La brève synthèse que nous proposons ici s’inspire principalement des ouvrages L’Histoire littéraire, op. cit. (p. 251-269, 313-333) et Crise de la littérature…, op. cit. (p. 147-171, 361-383).
13 Un énoncé de Mallarmé manifeste sans détour la dimension consciente et même stratégique de cette réaction : « […] il faut, si l’on fait de la littérature, parler autrement que les journaux » (lettre à Jean Moréas du 28 octobre 1886, Correspondance (1886-1889), vol. III, Paris, Gallimard, 1969, p. 67).
14 L’Histoire littéraire, op. cit., p. 323.
15 Écriture, parole, discours…, op. cit., p. 22.
16 Notons qu’Alain Vaillant n’est certes pas le seul, dans le champ de la critique littéraire postérieure ou contemporaine au structuralisme, à donner une nouvelle vie au modèle communicationnel que dessine cette « rencontre » imaginaire. Mais il est sans doute le seul à le faire tout en faisant droit à la textualité. En cela, selon nous, son approche se distingue avantageusement de celle d’un Georges Poulet qui, tout en intégrant des éléments structuralistes, en venait trop souvent à ignorer ou aplanir les particularités textuelles de l’œuvre. On peut en juger sur ce commentaire, où la projection de la pensée du Lecteur dans l’œuvre (ici, mallarméenne) culmine en une fusion phénoménologique où la lettre, en effet, occupe peu de place : « […] un texte qui n’a de signification et même d’existence, que si le lecteur projette en lui sa propre pensée. Il n’y a de poème mallarméen qu’à partir du moment où il n’y a plus d’un côté le poème et de l’autre une pensée, avec, entre les deux, “l’espace vacant, face à la scène”. Il faut qu’il n’y ait plus qu’un seul et même lieu, celui où un même être se voit et se pense, où il se reconnaît en un spectacle qui n’est rien d’autre que le “spectacle de Soi”. Ainsi poème et lecteur, spectacle et spectateur se fondent en une même pensée, qui est tout simplement la pensée réflexive. Je me fonde et me trouve dans le moment parfait et dans le lieu absolu où je crée ma pensée et la reconnais pour mienne » (La Distance intérieure. Études sur le temps humain, t. II, Paris, Plon, 1952, p. 354).
17 L’Histoire littéraire, op. cit., p. 323.
18 Voir Anne Chamayou (dir.), Éloge de l’adresse. Actes du colloque de l’Université d’Artois du 2 et 3 avril 1998, Arras, Artois Presses Université, « Cahiers scientifiques de l’Université d’Artois », 2000.
19 Voir Béatrice Coffen, Histoire culturelle des pronoms d’adresse. Vers une typologie des systèmes allocutoires dans les langues romanes, Paris, Champion, « Bibliothèque de grammaire et de linguistique », 2002.
20 Voir Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode…, op. cit., p. 393-402.
21 Voir Jacques Derrida, La Carte postale, de Socrate à Freud et au-delà, Paris, Flammarion, « La philosophie en effet », 1980.
22 Voir Cicéron, De l’Orateur, livre premier, Paris, Les Belles Lettres, « Universités de France », 1950, p. 49.
23 Voir Mikhaïl Bakhtine, « The Problem of the Text in Linguistics, Philology and the Human Sciences », dans Speech Games and Other Late Essays, Caryl Emerson et Michael Holquist (dir.), Austin, Texas University Press, 1986, p. 126.
24 À ce sujet, il est très significatif que la critique structuraliste n’ait pu se satisfaire bien longtemps (si tant est qu’elle ne s’en est jamais vraiment satisfait) des prétentions immanentistes du textualisme radical et que celui-là même qui avait proclamé la « mort de l’auteur » ait été rapidement amené à le ressusciter, en tant que figure de l’Imaginaire : « Comme institution l’auteur est mort : sa personne civile, passionnelle, biographique, a disparu ; dépossédée, elle n’exerce plus sur son œuvre la formidable paternité dont l’histoire littéraire, l’enseignement, l’opinion avaient à charge d’établir et de renouveler le récit : mais dans le texte, d’une certaine façon, je désire l’auteur : j’ai besoin de sa figure (qui n’est ni sa représentation, ni sa projection), comme elle a besoin de la mienne (sauf à “babiller”) » (Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, « Points / Essais », 1982, p. 45-46).
25 Michel Brix, L’Entonnoir ou les tribulations de la littérature à l’ère de la modernité, Paris, Kimé, 2013, p. 101.
26 Œuvres complètes, t. II, éd. B. Marchal, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 217.
27 Correspondance, t. II, éd. J. Bruneau, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 31.
28 André Guyaux, dans la préface à Baudelaire, Fusées. Mon cœur mis à nu. La Belgique déshabillée. Amœnitates Belgicæ, Paris, Gallimard, « Folio / Classique », 1986, p. 29.
29 Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Le Livre de poche, « Pluriel », 1961, p. 296.
30 Sur la dynamique de la séduction, voir Jean Baudrillard, De la Séduction, Paris, Galilée, « L’espace critique », 1980 ; et, dans un perspective plus étroitement phénoménologique, Jean-Luc Marion Étant donné, Paris, PUF, « Épiméthée », 1997, p. 391-398.
31 Bruno Clément, L’Invention du commentaire. Augustin, Jacques Derrida, Paris, PUF, « Écriture », 2000, p. 50.
32 Cité par Michel Lisse dans L’Expérience de la lecture. 2. Le glissement, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 2001, p. 63.
33 Jacques Derrida, cité par Michel Lisse dans ibid., p. 130.
34 Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, éd. P. Brunel, Paris, Le Livre de poche, « La Pochothèque », 1999, p. 462.
35 Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Paris, Pocket, « Classiques », 1999, p. 246.
36 La définition que nous suggérons ici de l’hermétisme, en mettant l’accent les implications imaginaires de l’acte de lecture, diffère sensiblement de celle qu’en donne Alain Vaillant (voir La Crise de la littérature…, op. cit., p. 365-382 et « Verba hermetica, Mallarmé, Rimbaud, Hugo », Romantisme, n 95 (1997), p. 81-97).
37 Dans un bref mais pénétrant passage critique, Paul Valéry évoque en effet les principales prédispositions affectives des lecteurs qui apparaissent tendanciellement portés à s’identifier aux dénominations symboliques électives en les identifiant au « petit nombre ». Il permet ainsi de donner figure à cette catégorie de lecteurs susceptibles d’être ou de se croire, par opposition au « grand nombre » ou à la masse indifférenciée et en partie indifférente des lecteurs ordinaires, les destinataires choisis du texte hermétique : « Le petit nombre ne hait pas d’être petit nombre. Le grand nombre se réjouit d’être grand : ceux-ci se trouvent bien d’être indistinctement du même avis, de se sentir semblables, rassurés l’un par l’autre ; confirmés, augmentés dans leur “véritéˮ, comme des corps vivants qui se resserrent, se fond chaud l’un à l’autre, par ce rapport étroit de leurs tiédeurs égales. Mais le petit nombre est fait de personnes suffisamment divisées. Elles abhorrent la similitude, qui semble leur ôter toute raison d’être. À quoi bon ce Moi-même, (songent-elles sans le savoir), s’il en peut exister une infinité d’exemplaires ? » (Œuvres de Paul Valéry, t. I, éd. J. Hytier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957, p. 646-647). Pour ceux qui composent l’univers passionné du « petit nombre » (auquel le cénacle des Mardis de la rue de Rome – cela ne pouvait échapper au « bon disciple » Valéry – donne une illustration historique et une incarnation institutionnelle particulièrement vives), un texte hermétique comme celui de Mallarmé présente ainsi l’avantage de servir de support idéal à l’identification narcissique.
38 Vladimir Jankélévitch, L’Ironie, Paris, Flammarion, « Nouvelle Bibliothèque scientifique », 1964, p. 53. Cet effet simultanément inclusif et exclusif constitue d’ailleurs l’un des ressorts imaginaires de la « rhétorique de la fiction » analysée jadis par Wayne C. Booth, qui observait à ce sujet : « Whenever an author conveys to his reader an unspoken point, he creates a sense of collusion against all those, whether in the story or out of it, who do not get that point » (The Rhetoric of Fiction, Chicago, The University of Chicago Press, 1961, p. 304).
39 Œuvres complètes, t. II, op. cit., p. 291.
40 On notera que, pour être choquante, une telle division n’a rien de nouveau chez Mallarmé : à plus de trente ans d’intervalle, elle retrace la frontière symbolique que le poète lui-même, en 1862, dans son pamphlet « Hérésies littéraires. L’Art pour tous » (ibid., p. 360-364), avait déjà établie entre le « tout-venant » des lecteurs profanes et la classe ou la caste sacerdotale des lettrés. Le jeune poète exploitait alors le regain d’intérêt contemporain pour l’imaginaire ésotérique et radicalisait – avec l’intensité caractéristique dont témoignent ses premières interventions dans le champ littéraire – le dédain postural de ses confrères artistes vis-à-vis du (lecteur consommateur) bourgeois.
41 Cicéron, Œuvres complètes de Cicéron, vol. IV, Paris, éd. M. Nisard, Firmin-Didot, 1875, p. 570.
42 Poétique de la relation. Poétique III, Paris, Gallimard, « Blanche », 1990, p. 134.
43 Le Méridien et autres proses, Paris, Seuil, « Librairie du xxie siècle », 2002, p. 44.
44 Pascal Durand a montré l’extraordinaire extension et imprégnation de cette logique. Voir son ouvrage, ayant valeur de synthèse, Mallarmé. Du sens des formes au sens des formalités, Paris, Seuil, « Liber », 2008, p. 186. Voir aussi Vincent Kaufmann, Le Livre et ses adresses (Mallarmé, Ponge, Valéry, Blanchot), Paris, Méridiens Klincksieck, 1986.
45 Voir la caractérisation que Lacan propose de cette fonction, et qu’il illustre par référence au motif du signe de reconnaissance (Des Noms-du-Père, Paris, Seuil, « Champ freudien », 2005, p. 27-28).
46 À la lumière des fructueuses lectures sociologiques qu’elle suscite depuis une vingtaine d’années, on ne s’étonne plus guère que l’œuvre de Mallarmé fasse place aux petits « riens » de l’existence tout en spéculant sur l’imposant « Rien » métaphysique, ni que la circonstance mondaine se trouve à y dialoguer avec l’événement en apparence le plus chargé sur le plan ontologique. Voir le plus récent ouvrage sur la question : Barbara Bohac, Jouir partout ainsi qu’il sied : Mallarmé et l’esthétique du quotidien, Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2012.
47 Incidemment, cette surdétermination symbolique confère à la poétique de Mallarmé quelque chose de résolument ancien. On sait qu’en Antiquité, au cœur de l’humanisme classique, c’est la quasi-totalité des pratiques herméneutiques (la citation, la récitation, le commentaire, etc.) qui se réalisent, au sens fort et pragmatique du terme, comme des actes de reconnaissance entre lettrés (voir Florence Dupont, L’Invention de la littérature. De l’ivresse grecque au texte latin, Paris, La Découverte, « Poche », 1998, notamment p. 117, 190 et 268).
48 Yves Bonnefoy, dans la préface de Mallarmé, Correspondance complète (1862-1871), suivi de Lettres sur la poésie (1872-1898), Paris, Gallimard, « Folio / Classique », 1995, p. 14.
49 Nous avons déjà eu l’occasion d’offrir une analyse détaillée de « Salut » dans Le (Dé)montage de la Fiction : la révélation moderne de Mallarmé, Paris, Honoré Champion, « Romantisme et modernité », 2010, p. 54-113.
50 On se souvient que Boileau félicitait le lecteur qui « ne suit point un auteur qu’il faut toujours chercher » (Œuvres de Boileau Despréaux, vol. I, Paris, Firmin Didot, 1800, p. 200).
51 Mallarmé, Œuvres complètes, t. II, op. cit., p. 234.
52 The Genesis of Secrecy. On the Interpretation of Narrative, Cambridge, Harvard University Press, « The Charles Eliot Norton Lectures », 1979, p. 2-3.
53 Michel Picard, La Lecture comme jeu. Essai sur la littérature, Paris, Minuit, « Critique », 1986, p. 111. En un sens voisin, Vincent Kaufmann parle de « propositions contractuelles » (Le Livre et ses adresses…, op. cit., p. 16).
54 Œuvres complètes, t. II, op. cit., p. 247.
55 Alain Viala, « L’éloquence galante. Une problématique de l’adhésion », dans Images de soi dans le discours : la construction de l’ethos, Ruth Amossy (dir.), Lausanne et Paris, Delachaux & Niestlé, 1999, p. 192.
56 Voir Donner la mort, Paris, Galilée, « Incises », 1999, p. 97-101. Notons que ces dispositions antidémocratiques ne sont pas moins exacerbées par la littérature antérieure à la modernité. En fait, elles sont structurellement impliquées dans la communication connivente en laquelle nous proposons de reconnaître, dans le prolongement de l’hypothèse d’Alain Vaillant, la caractéristique définitoire du discours littéraire en général. Comme on sait, l’humanisme classique auquel s’est nourrie la culture occidentale se réclamait d’un « universalisme » qui était fondé sur une conception de l’universel assez restrictive… qui renvoyait imaginairement et correspondait empiriquement au « petit nombre » des lettrés. C’est dire que, sur ce point, la tradition humaniste a pour seule particularité, par rapport à la culture moderne, de ne jamais avoir eu à se faire un motif de honte ni à se justifier de son exclusivisme. Passant pour la condition même de la pratique des lettres, son « crime » éthique passait inaperçu.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 10, 2014
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=647.
Quelques mots à propos de : Patrick Thériault
Université de Toronto
Patrick Thériault est professeur de littérature française à l’Université de Toronto. Parallèlement à ses principaux projets de recherche sur la modernité poétique, il s’intéresse aux problématiques d’ordre herméneutique et à l’histoire de l’interprétation. Il a publié plusieurs articles en ces domaines et un ouvrage sur Mallarmé : Le (dé)montage impie de la Fiction : la révélation moderne de Mallarmé, Champion, 2010).
