Sommaire
Mallarmé herméneute
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
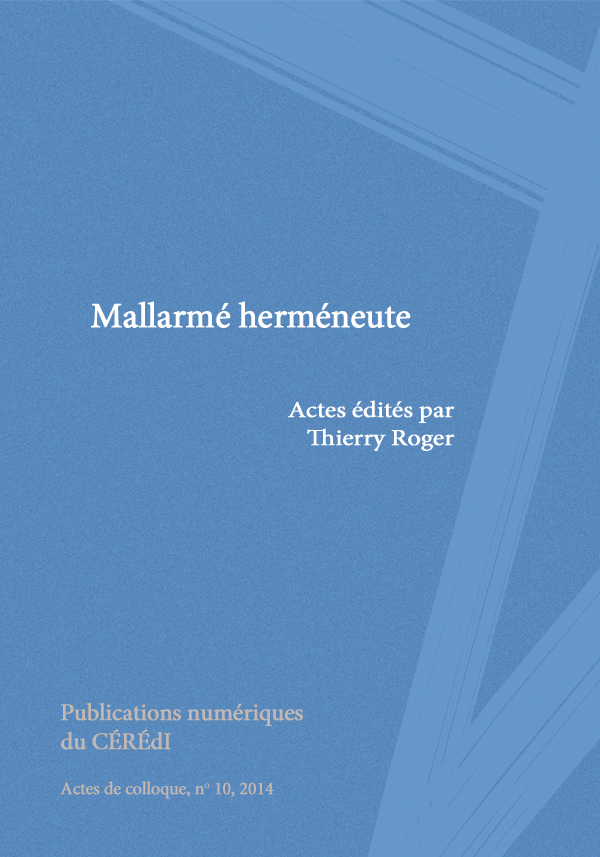
- Le « lecteur d’horizons »
- Pascal Durand Mallarmé dans la prison des signes
- Claude-Pierre Perez « Le cabinet des signes » : Mallarmé, Claudel et l’herméneutique
- Guillaume Artous-Bouvet Mallarmé et l’herméneutique de la nature
- Larissa Drigo Agostinho Lire ou interpréter après la découverte du Néant
- Robert Boncardo Badiou, Mallarmé et le dépassement de l’herméneutique
- Frédéric Torterat Lire avec Mallarmé, entre remémoration et démémoration
- Le lecteur empirique
- Barbara Bohac Mallarmé lecteur de Banville
- Alice Folco Portrait de Stéphane Mallarmé en spectateur
- Maria de Jesus Cabral Je ne sais quel miroitement en dessous : le théâtre, programme humain, outil herméneutique
- Adrien Cavallaro D’un article « plutôt défavorable et malin » : Mallarmé portraitiste de Rimbaud
- Marie Blaise Mallarmé et Poe : « la personne analogue » (À la mémoire de Claude Richard)
- Margot Favard Mallarmé lisant ses pairs, ou comment s’écrit la figure du poète en Maître (Sur « Quelques médaillons et portraits en pied »)
- Le lecteur implicite
- Patrick Thériault L’adresse à communiquer : le motif herméneutique de l’adresse en contexte de modernité poétique. L’exemple du salut mallarméen
- Arild Michel Bakken La figure du lecteur : l’auditoire auctorial dans les Poésies de Mallarmé
- Nelson Charest « La déclaration foraine » ou la réception tue dans les rets du poème
- Annick Ettlin Éloge de la non-lecture. Mallarmé et le mythe littéraire
- Joëlle Molina Mallarmé, passeur secret d’herméneutique ancienne ? La preuve par X.
Le « lecteur d’horizons »
Mallarmé et l’herméneutique de la nature
Guillaume Artous-Bouvet
Introduction
1Cet exposé s’intitule donc « Mallarmé et l’herméneutique de la nature ».
2Ce titre lui-même mérite éclaircissement, et c’est cet éclaircissement qui tiendra lieu d’introduction aux questions que je vais adresser à certains textes mallarméens : il s’agira essentiellement, je le précise, de proses issues des Divagations (1897). J’ai choisi ces textes parce qu’ils font apparaître une articulation critique entre la poésie (au sens de « production du poème ») et la poétique (au sens de « réflexion sur les conditions de production du poème ») : or cette articulation concerne précisément la capacité descriptive, ou mimétique, du poème, conçu, conformément à la prescription aristotélicienne, comme un opérateur d’imitation de la nature, c’est-à-dire, pour répéter la formule célèbre de l’« Avant-dire au Traité du verbe », de transposition d’« un fait de nature en sa presque disparition vibratoire1 ».
3Je formule donc pour commencer deux remarques concernant cet intitulé :
41/ Premièrement, la formule même d’une herméneutique de la nature, prise dans sa très grande généralité, fait paraître une ambivalence entre les deux modalités du génitif : le génitif objectif, d’une part, signalant le déchiffrement de la nature par l’homme ; le génitif subjectif, d’autre part, indiquant que la nature se donne elle-même comme une opération herméneutique, ou, pour le dire autrement, que la nature de la nature, c’est l’herméneutique – c’est-à-dire le déchiffrement. Ce qui nous reconduirait, à condition d’en supporter l’anachronie, aux remarques de Heidegger sur le mot grec phusis, disant l’apparition de « ce qui s’épanouit à partir de soi2 », mais une apparition, une « éclosion à partir de soi » dans laquelle « règne pourtant » une soustraction, un « se-soustraire ». La nature n’est donc « apparition » ou dévoilement que dans la stricte mesure où elle est retrait et dissimulation. Duplicité fondamentale d’un déchiffrement, ou d’un auto-déchiffrement, qui est donc en même temps « chiffrement », ou « chiffration mélodique tue », selon la formule de La Musique et les Lettres.
52/ Deuxième remarque, par conséquent : quel peut être le « sens » délivré par un tel effort de déchiffrement ? Si l’on prend pour exemple la récurrence, chez Mallarmé, de la formalité d’un « drame solaire », notamment repérée par Gardner Davies3, on s’avisera qu’un phénomène naturel spécial (le coucher de soleil), une fois interprété ou « déchiffré », paraît se proposer comme analogique du destin de l’homme. C’est bien d’ailleurs ce que marque Mallarmé, dans « Bucolique » : la nature, écrit-il, allume son bûcher « avec le virginal espoir d’en défendre l’interprétation au lecteur d’horizons », tandis que le poète persiste à penser que « le secret ne reste pas incompatible avec l’homme4 ». C’est encore ce que dit ce passage de « Hamlet », dans les Divagations :
Loin de tout, la Nature, en automne, prépare son Théâtre, sublime et pur, attendant pour éclairer, dans la solitude, de significatifs prestiges, que l’unique œil lucide qui en puisse pénétrer le sens (notoire, le destin de l’homme), un Poëte, soit rappelé à des plaisirs et à des soucis médiocres.5
6La difficulté, évidemment, est que le drame solaire n’exprime en dernière instance que le vide même du « destin de l’homme », dans l’après-coup hamlétien de la mort de Dieu. Comme le suggère Bertrand Marchal au sujet du poème « Quand l’ombre menaça… », il semble ainsi que cette mise en scène dans laquelle « les étoiles, qui dessinent imaginairement une chiffration universelle, disparaissent dans une agonie lumineuse », représente « moins l’abdication d’un rêve que la mort de Dieu6 ».
7Où l’on retrouve le jeu d’une ambivalence : comme l’écrit encore B. Marchal dans La Religion de Mallarmé, le poète semble avoir pris conscience que la nature est peut-être
le mythe unique et fondateur de l’humanité, celui qui structure profondément le psychisme humain comme le lieu d’une alternative impossible, celle qui fait d’Hamlet le héros tragique par excellence.7
8Mais si la nature est un « mythe », sa lecture dévoile paradoxalement l’absence de toute signification anthropologique. Car le sens du spectacle naturel n’est évidemment pas isomorphe à celui d’une œuvre d’art : c’est d’ailleurs précisément pour cette raison que certaines philosophies ont pu accorder une supériorité au beau naturel sur le beau artistique, comme l’explique Hans-Georg Gadamer au sujet de Kant. Gadamer écrit ainsi, dans Vérité et méthode (1960) :
les produits de l’art n’existent que pour nous adresser […] la parole alors qu’il n’en est absolument pas de même des objets de la nature. Voilà précisément ce qui donne tout son poids à l’intérêt pour le beau dans la nature : il a […] le pouvoir de nous faire prendre conscience de notre destinée morale. L’art ne peut pas nous faire accéder à la démarche où l’homme se retrouve dans une réalité dépourvue d’intention.8
9L’herméneutique de la nature apparaît donc comme l’épreuve même du sens : exercice par quoi un humain se confronte, au fond, à la question de son propre destin, dont la réponse n’est jamais explicitée une fois pour toute « dans la nature ». Une telle herméneutique, pratiquée en poésie et « en poème », supposera donc de répondre à une double injonction contradictoire : d’une part, assumer l’effort d’un déchiffrement, ou du moins d’une reconnaissance des signes naturels ; d’autre part, maintenir, dans cet effort même, la rigueur d’une soustraction du sens. Il s’agit donc au moins d’une herméneutique paradoxale, que l’on pourrait désigner peut-être plus heureusement comme une « hermétique », en tant qu’elle décrit (ou déchiffre) la nature comme cela même qui se tait.
Deux paysages
10L’herméneutique naturelle mallarméenne s’incarne d’abord dans l’exercice de la description : le poète « lecteur d’horizons » actualise ses lectures dans des textes divers, qui témoignent d’une pratique spécifique du discours descriptif, et notamment de la peinture de paysages naturels – je rappelle pour mémoire que Fontanier désigne comme topographie une description qui « a pour objet un lieu quelconque9 », et dont il donne, et pour cause, des exemples presque exclusivement naturels ou ruraux.
11Parmi les textes que je n’évoquerai pas, on trouve notamment, dans les poèmes, la « Scène » d’« Hérodiade », la « Prose pour des Esseintes », et dans les proses, « Le Phénomène futur », « Conflit », et « Confrontation ». Je ne prendrai ici que deux exemples : d’abord, un extrait d’un texte intitulé « Autrefois, en marge d’un Baudelaire », repris dans les Divagations, et qui est issu de la « Symphonie littéraire » de 1865. Ensuite, un poème en prose bien connu, « Le Nénuphar blanc », paru la première fois en 1885.
12« Autrefois, en marge d’un Baudelaire », d’abord :
Un paysage hante intense comme l’opium ; là-haut et à l’horizon, la nue livide, avec une trouée bleue de la Prière – pour végétation, souffrent des arbres dont l’écorce douloureuse enchevêtre des nerfs dénudés, leur croissance visible s’accompagne malgré l’air immobile, d’une plainte de violon qui, à l’extrémité frissonne en feuilles : leur ombre étale de taciturnes miroirs en des plates-bandes d’absent jardin, au granit noir du bord enchâssant l’oubli, avec tout le futur. Les bouquets à terre, alentour, quelques plumes d’aile déchues. Le jour, selon un rayon, puis d’autres, perd l’ennui, ils flamboient, une incompréhensible pourpre coule – du fard ? du sang10 ?
13La description mallarméenne, on le voit, est une analytique, au sens fort de ce terme, et elle use en tant que telle de toutes les ressources de la syntaxe. Elle poursuit ainsi un effort de division du visible : ici, en hauteur (« là-haut ») et en profondeur (« à l’horizon »). D’où, aussi, la division du présent de la perception, qui se trouve instamment dédoublé en un passé (« enchâssant l’oubli ») et un futur (« avec tout le futur »). Cette analytique, notons-le, revêt une vertu diagnostique : le déploiement descriptif semble en effet chercher la « cause », le principe du visible lui-même : ainsi de la mention de ces « arbres dont l’écorce douloureuse enchevêtre des nerfs dénudés », et dont « la croissance visible » frissonne « en feuilles ».
14Mais l’effort herméneutique, qui devrait conduire vers un au-delà du visible, selon la règle d’une syntaxe tout à la fois spatiale, temporelle et causale, ne délivre en dernier lieu qu’un « incompréhensible », ouvrant sur la rigueur « indécidable » d’une alternative, pour reprendre le terme jadis appliqué à Mallarmé par Derrida : « du fard ? du sang11 ? » C’est donc ultimement le sens même du paysage qui est en question, partagé qu’il demeure entre l’artefact du « fard », et la tragédie destinale du « sang ». Le paysage porte ainsi la trace d’une hantise (« un paysage hante »), c’est-à-dire, à condition d’entendre le terme en son étymologie, d’une habitation absentée : dans la nature, ainsi, quelque chose ou quelqu’un manque à sa place. D’où d’ailleurs la clausule de l’ensemble de cette prose, sous la forme de la question : « qu’est-ce que le ciel ? »
15J’en viens à présent à une lecture très brève du Nénuphar blanc, afin d’insister sur la dimension « soustractive » du paysage mallarméen ; je rappelle au passage que Michel Deguy, que je citerai un peu plus tard, a consacré une exégèse particulièrement stimulante à ce texte, dans le numéro 85 de la revue Po&sie12, intitulée « je remplis d’un beau non ce grand espace vide ». Je cite l’avant-dernier paragraphe du poème :
Résumer d’un regard la vierge absence éparse en cette solitude et, comme on cueille, en mémoire d’un site, l’un de ces magiques nénuphars clos qui y surgissent tout à coup, enveloppant de leur creuse blancheur un rien, fait de songes intacts, du bonheur qui n’aura pas lieu et de mon souffle ici retenu dans la peur d’une apparition, partir avec : tacitement, en déramant peu à peu sans du heurt briser l’illusion ni que le clapotis de la bulle visible d’écume enroulée à ma fuite ne jette aux pieds survenus de personne la ressemblance transparente du rapt de mon idéale fleur13.
16Mallarmé décrit ici, dans une stase métapoétique, l’opération même du poème. J’en retiens l’élément principal : le « résumé » du paysage (du « site », dans les termes de Mallarmé) se fait sous condition d’un « rien », ou d’un « bonheur qui n’aura pas lieu ». La description poétique maintient donc la rigueur d’une absence, qui rayonne sa hantise à travers l’ensemble du lieu. L’effort de déchiffrement du paysage, ainsi, le transit analytiquement : c’est-à-dire qu’il le sépare d’avec soi, d’avec son évidence perceptive, pour le rapporter à la rigueur d’un vide. Un paysage n’est ainsi rien d’autre, chez Mallarmé, que la disposition où se place une absence : femme ou divinité, dont les signes tangibles gardent le silence.
Une opération
17Dans le portrait de Théodore de Banville, dans les Divagations, et à l’intérieur d’une « analogie » musicale « en vue d’un éclaircissement ou de généraliser14 », Mallarmé écrit ceci : « les instruments détachent, selon un sortilège aisé à surprendre, la cime, pour ainsi voir, de naturels paysages : les évapore et les renoue, flottants, dans un état supérieur15 ». Phrase à rapporter évidemment à la formulation de « Crise de vers », évoquant la « merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole », visant à obtenir une « notion pure16 ». Reste à préciser le statut de cet « état supérieur » ou de cette « notion pure », qui semble résulter d’une opération proprement dialectique, supposant une perception (le paysage vu), une suppression (l’évaporation analytique), et une recomposition (le renouement).
18Michel Deguy, dans la préface qu’il a donnée aux Vues sur Mallarmé de Robert Greer Cohn, prend l’exemple de la description de l’opéra, dont il rend compte en ces termes :
je puis entrer à l’opéra avant le ballet, et remarquer que la voûte, là-haut, de l’architecture, est bien une voûte, mais je puis, jouissant de son envol, admirer « l’extatique impuissance à disparaître » de Loïe Fuller, « glaive, coupe, fleurs »… et penser que l’ascendance invisible de la coupole protège le spectacle et que c’est son vide qui rend possible l’apparition17.
19Il y a bien là une lecture, même si elle ne s’adresse pas à un paysage naturel : la lecture du poète consiste à déceler, dans un espace, le vide qui rendra possible l’apparition artistique, ou, pour le dire autrement, l’événement esthétique. L’analytique du paysage est donc bien une analytique soustractive, qui suppose d’abord un moment de « décomposition » du visible, pour aboutir à une recomposition qui fait sens, tout en réservant la puissance d’un secret, c’est-à-dire d’une apparition. Comme le dit encore Michel Deguy, en une formule remarquable de densité, « la suggestion métamorphose un élément descriptible en la valence figurative capable de revenir le hanter18. » Cette phrase mérite d’être explicitée, parce qu’elle permet de saisir, je crois, la spécificité de l’opération descriptive mallarméenne, et de questionner du même coup son apparente rigidité dialectique.
20Michel Deguy marque premièrement que le poème descriptif suppose qu’un élément descriptible préexistant soit « métamorphosé », c’est-à-dire converti. Cet « élément descriptible » correspond au « possible » d’un paysage déjà ordonné par les formes de la perception, qui sont en réalité inséparables des formes du langage « ordinaire », c’est-à-dire de ce que Mallarmé nomme « l’universel reportage19 ». Il s’agit donc, à partir de cet « élément » paysager, de fonder, par soustraction, une puissance (« valence ») qui excède les règles de l’évidence perceptive ou linguistique. Pour le dire autrement : l’opération poétique consiste à soustraire une perception à sa propre évidence (à son actualité), de telle sorte à en retrouver la puissance, que Mallarmé nomme « notion pure ». Mais cette notion n’est pas une idée, au sens idéaliste du terme : elle ne constitue pas l’essence apurée, modélisante, de la nature elle-même. Le résultat de la suggestion est, dit Deguy, une « hantise », c’est-à-dire un rapport entre la chose et son nom : au terme du geste descriptif, toute chose semble en puissance de noms, de même que tout nom, réciproquement, semble en puissance de choses, sans que jamais les deux niveaux se superposent ou se confondent.
21Afin de progresser vers le dernier temps de cet exposé, consacré à ce que j’appellerais provisoirement la citation, et qui serait donc la troisième composante de l’herméneutique naturelle (après l’analyse et la soustraction), je vais citer à nouveau « Crise de vers ». Dans ce texte, vous vous en souvenez, Mallarmé reprend, entre guillemets, un passage de La Musique et les Lettres. Ce passage réaffirme l’analogie musicale que je viens d’évoquer, et qui permet à Mallarmé de soutenir sa pensée poétique :
Les monuments, la mer, la face humaine, dans leur plénitude, natifs, conservant une vertu autrement attrayante que ne les voilera une description, évocation dites, allusion je sais, suggestion : cette terminologie quelque peu de hasard atteste la tendance, une très décisive, peut-être, qu’ait subie l’art littéraire, elle le borne et l’exempte. Son sortilège, à lui, si ce n’est libérer, hors d’une poignée de poussière ou réalité sans l’enclore, au livre, même comme texte, la dispersion volatile soit l’esprit, qui n’a que faire de rien outre la musicalité de tout20.
22Que dit le texte que j’ai cité ? a) Il comporte, d’abord, une thèse sur la littérature, qui fait fond de l’analogie musicale : le projet du livre de poésie, ce n’est pas d’« enclore » la nature (« les monuments, la mer ») dans le livre, mais d’en « libérer » l’esprit, dont le fond n’est rien d’autre que la « musicalité de tout ». b) Il signale ensuite que l’herméneutique de la nature excepte en quelque sorte la « nature » du livre, en la considérant comme un hors-texte absolu. c) Enfin, et on entre là, je crois, dans la véritable difficulté, ce passage est une citation, et plus exactement une auto-citation : il témoigne donc, dans un texte intitulé « Crise de vers », de la réflexivité proprement critique de la prose mallarméenne. Qui d’ailleurs ne suppose pas seulement la reprise pensive de la pratique poétique, mais encore la reprise citationnelle de la reprise elle-même : pour le dire plus simplement, « Crise de vers », texte de poétique, suppose la reprise d’un autre texte de poétique, La Musique et les Lettres. Or cette reprise, qui manifeste la complication « critique » et citationnelle du discours mallarméen, s’effectue précisément au moment où il s’agit pour le poète de méditer sur la capacité mimétique de la poésie quant à la nature elle-même.
Citation et réflexivité
23D’où mon hypothèse dernière, qui est double : d’une part, que la nature dont il s’agit chez Mallarmé est déjà un texte, et qu’il s’agira donc moins de convertir des perceptions en discours, par un travail descriptif, que de citer en la recomposant une textualité naturelle immanente (ce qui me reconduit à ma première remarque sur la nature herméneutique de la nature) ; d’autre part, que cette reconnaissance de la textualisation de toute nature oblige l’exercice poétique à se constituer et à se reconnaître comme « critique » : il n’est pas, en effet, en rapport immédiat avec les perceptions (c’est-à-dire avec la nature), mais se trouve pris dans une relation « sémiotique », indéfiniment médiatisée. Tout poème est donc irréductiblement citationnel et critique, et la prose des Divagations accomplit en ce sens le destin du poème.
24On trouve chez le poète contemporain Philippe Beck une intuition similaire concernant l’essence des perceptions. Selon Ph. Beck, si une perception peut donner lieu à une description, c’est que toute perception est en puissance de description : « la perception », écrit-il dans Beck, l’impersonnage, « est déjà discours silencieux, complexe ». De là, que toute description poétique soit en réalité une « description au carré ». Ph. Beck suppose enfin l’existence d’un troisième niveau qui constitue quant à lui le repli réflexif du second niveau « poétique » : il s’agit du « plan de la prose de l’entretien, dialogue philosophique au sens large21 ».
25D’où, je crois, l’inséparation, chez Mallarmé, de la poésie et de la prose « critique », c’est-à-dire du faire du poème, et de la réflexivité poétique qui le prend pour objet. J’en prendrai un seul exemple, là encore, issu de « Crise de vers » :
Je dis : une fleur ! et hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tout bouquet22.
26Ce passage, extrait d’une prose, est supposé dire ce que fait la poésie. À cette fin, Mallarmé donne un exemple : une phrase nominale minimale, exclamative (« une fleur ! »), suivie d’un bref commentaire sur l’événement qu’elle rend possible. Or il apparaît assez évident que la puissance de suggestion n’a pas « lieu » dans la profération substantive, mais bien dans son explicitation syntaxière, autrement plus efficiente, à savoir : « musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tout bouquet » – formulation qui finit d’ailleurs par un quasi-alexandrin. Dès lors, tout se passe comme si l’événement poétique n’avait plus lieu dans la phrase censée exemplifier le poème, mais dans son commentaire prosaïque : pour le dire autrement, le performatif se déplace de l’exemple (« une fleur ! ») vers le commentaire qui l’accompagne. Cette articulation singulière entre poème et prose critique me paraît caractéristique de l’écriture mallarméenne, qui disloque imperceptiblement, mais décisivement, le lieu même de l’événement poétique.
Conclusion
27Pour conclure, et pour ouvrir la discussion, j’essaie de formuler trois propositions rendant compte de ce que j’ai appelé l’herméneutique de la nature.
281/ Première proposition : la nature « en soi » est inintégrable dans le poème : ou, pour le dire autrement, s’il peut y avoir une herméneutique poétique de la nature, c’est parce que la nature a déjà été conçue comme un tissu de signes. Ce dont atteste notamment telle phrase de « Crise de vers » :
Abolie, la prétention, esthétiquement une erreur […] d’inclure au papier subtil du volume autre chose que par exemple l’horreur de la forêt, ou le tonnerre muet épars au feuillage : non le bois intrinsèque et dense des arbres23.
29Cela ne signifie évidemment pas, dans la perspective d’un textualisme généralisé ou hystérisé, qu’« il n’y a pas de nature », ou que toute perception est textuelle, mais que la perception, comme telle, est hors de portée du poème. Le poème n’a accès qu’à des « perceptions de perceptions », c’est-à-dire à une nature déjà textualisée.
302/ On affirmera donc que la nature en poème est une nature textualisée ou parlante. On se reportera par exemple aux vers 23 à 32 de L’Après-midi d’un faune (1876) :
Ô bords siciliens d’un calme marécage
Qu’à l’envi des soleils ma vanité saccage,
Tacites sous les fleurs d’étincelles, CONTEZ
« Que je coupais ici les creux roseaux domptés
Par le talent24… »
31Mais comme on sait si l’on se souvient de l’argument du faune, cette nature « parlante » ne témoigne (tacitement, d’ailleurs25) que de l’absence même des nymphes. On dira dès lors avec Michel Deguy commentant Le Nénuphar blanc, que l’absence féminine est la condition du poème : « c’est, écrit-il, à condition qu’elle n’apparaisse pas, qu’une femme change l’entour en sa “vacance exquise26” ».
323/ Si la nature est « parlante », toute description s’avère en dernière instance citation : et l’exercice poétique s’ouvre à la réflexivité syntaxière d’une prose. La prose poétique constitue la forme qui permet de tenir ensemble la capacité descriptive ou herméneutique du poème, et la lucidité quant à l’exception de la nature « même » au poème. De sorte qu’on peut supposer que la détermination de tout paysage comme « absence de quelqu’un » est non seulement le signe d’un dieu disparu, mais aussi le symptôme de l’impuissance poétique à contenir la nature et le monde.
1 Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, t. 2, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 213.
2 Voir à cet égard les citations proposées et commentées par Marlène Zarader dans Heidegger et les paroles de l’origine Paris, Librairie Jacques Vrin, « Bibliothèque d’histoire de la philosophie », 1990, p. 36 et p. 45.
3 Gardner Davies, Mallarmé et le drame solaire. Essai d’exégèse raisonnée, Paris, Librairie José Corti, 1959.
4 Œuvres complètes, t. 2, op. cit., p. 252.
5 Ibid., p. 166.
6 Bertrand Marchal, Lecture de Mallarmé. Poésies – Igitur – Le Coup de dés, Paris, Librairie José Corti, 1985, p. 178.
7 Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé, Paris, Librairie José Corti, 1988, p. 361.
8 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, Seuil, « L’Ordre philosophique », 1996, p. 68.
9 Pierre Fontanier, Les Figures du discours, Paris, Flammarion, « Champs », 1977, p. 422.
10 Œuvres complètes, t. 2, op. cit., p. 110.
11 Ibid.
12 Michel Deguy, « Je remplis d’un beau non ce grand espace vide », Po&sie, n° 85, Paris, Belin, septembre 1998, p. 82-94.
13 Ibid., p. 100.
14 Ibid., p. 144.
15 Ibid. Je souligne.
16 Ibid., p. 213.
17 Michel Deguy, Préface aux Vues sur Mallarmé de Robert Greer Cohn, Paris, Librairie Nizet, 1991, p. 16.
18 Ibid.
19 Œuvres complètes, t. 2, op. cit., p. 212.
20 Ibid., p. 210.
21 Philippe Beck et Gérard Tessier, Philippe Beck, l’impersonnage, Paris, Édition Argol, « Les singuliers », 2006, p. 171.
22 Œuvres complètes, t. 2, op. cit., p. 213.
23 Ibid., p. 210.
24 Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, t. 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 23.
25 L’origine du discours des « bords » est en effet indécidable, ce qui nous reconduit à notre première remarque : la nature est-elle ici parlante ou parlée ?
26 Art. cité, p. 85.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 10, 2014
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=616.
Quelques mots à propos de : Guillaume Artous-Bouvet
Université Paris 8 Saint-Denis
Équipe de Recherches sur la pluralité esthétique
Guillaume Artous-Bouvet est un ancien élève de l’ENS (Lyon), agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française de l’Université Paris 8. Principale publication : L’Exception littéraire (Belin, 2012), ouvrage consacré aux interactions entre littérature et philosophie en France au xxe siècle.
