Sommaire
Mallarmé herméneute
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
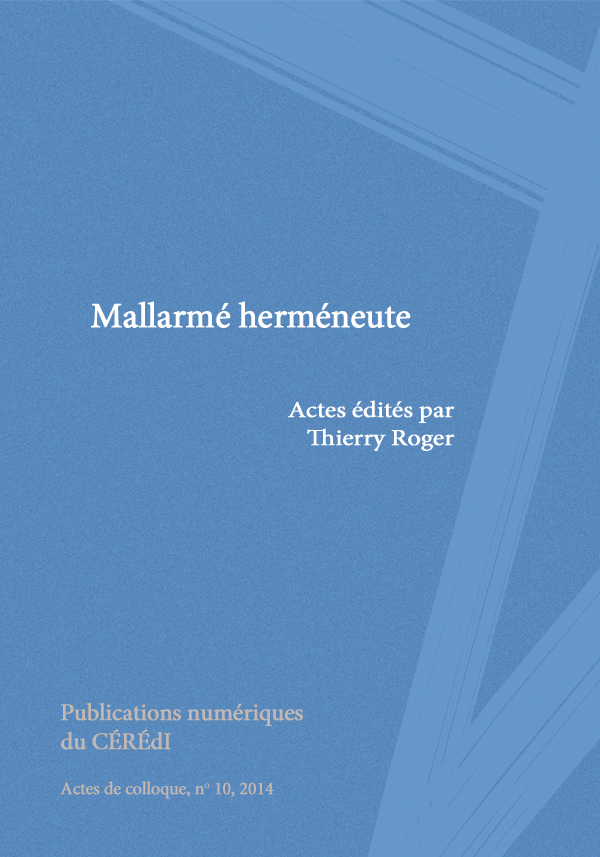
- Le « lecteur d’horizons »
- Pascal Durand Mallarmé dans la prison des signes
- Claude-Pierre Perez « Le cabinet des signes » : Mallarmé, Claudel et l’herméneutique
- Guillaume Artous-Bouvet Mallarmé et l’herméneutique de la nature
- Larissa Drigo Agostinho Lire ou interpréter après la découverte du Néant
- Robert Boncardo Badiou, Mallarmé et le dépassement de l’herméneutique
- Frédéric Torterat Lire avec Mallarmé, entre remémoration et démémoration
- Le lecteur empirique
- Barbara Bohac Mallarmé lecteur de Banville
- Alice Folco Portrait de Stéphane Mallarmé en spectateur
- Maria de Jesus Cabral Je ne sais quel miroitement en dessous : le théâtre, programme humain, outil herméneutique
- Adrien Cavallaro D’un article « plutôt défavorable et malin » : Mallarmé portraitiste de Rimbaud
- Marie Blaise Mallarmé et Poe : « la personne analogue » (À la mémoire de Claude Richard)
- Margot Favard Mallarmé lisant ses pairs, ou comment s’écrit la figure du poète en Maître (Sur « Quelques médaillons et portraits en pied »)
- Le lecteur implicite
- Patrick Thériault L’adresse à communiquer : le motif herméneutique de l’adresse en contexte de modernité poétique. L’exemple du salut mallarméen
- Arild Michel Bakken La figure du lecteur : l’auditoire auctorial dans les Poésies de Mallarmé
- Nelson Charest « La déclaration foraine » ou la réception tue dans les rets du poème
- Annick Ettlin Éloge de la non-lecture. Mallarmé et le mythe littéraire
- Joëlle Molina Mallarmé, passeur secret d’herméneutique ancienne ? La preuve par X.
Le « lecteur d’horizons »
Lire ou interpréter après la découverte du Néant
Larissa Drigo Agostinho
Introduction
1Madame de Staël, dans De la littérature, attribue à la nouvelle littérature et philosophie française postrévolutionnaire la mission de continuer et de prolonger la Révolution de 1789 : « Je me suis proposé d’examiner quelle est l’influence de la religion, des mœurs et des lois sur la littérature, et quelle est l’influence de la littérature sur la religion, les mœurs et les lois1 ». Selon l’auteur, pendant le siècle de Louis XIV l’objet principal des écrivains est le parachèvement de l’art d’écrire. Par la suite, au xviiie siècle, la littérature prend un nouvel aspect, elle cesse d’être un art ayant une fin en soi-même, elle devient un moyen, « une arme pour l’esprit humain, qu’elle s’était contentée jusqu’alors d’instruire et d’amuser2 ». Ces écrivains, déjà habités par l’esprit républicain, commencent l’évolution de la littérature. Après la révolution, une fois la république instituée « il faut achever cette révolution3 ».
2Dans les années 1960 et 1970, l’histoire se répète, écrivains, critiques littéraires et philosophes assignent à la littérature la mission d’établir une nouvelle société. La littérature est tenue pour une pratique capable de modifier la réalité sociale. Pour Derrida, par exemple, elle a comme mission la déconstruction des dispositifs qui font de la société ce qu’elle est. Pour Foucault la littérature fonctionne comme contre-épistème, toujours critique vis-à-vis des structures fondatrices du savoir de chaque époque. Dès lors, nous pouvons affirmer que pour le structuralisme et le poststructuralisme « la révolution se fera dans et par le langage et le discours ou ne se fera pas4 ».
3Nous savons que Mallarmé est un symbole majeur de cette révolution qui commence par le Livre pour aboutir à la place publique, néanmoins Mallarmé est aussi bien éloigné des premiers romantiques que des avant-gardes comme Tel quel et du structuralisme et poststructuralisme. L’antihistoricisme structuraliste fait obstacle à la prise de conscience de cette répétition historique. Cela est dû aux présupposés de la théorie structuraliste, que nous étudierons dans le but d’établir un argument qui puisse justifier la réponse à la question : « Pourquoi Mallarmé n’est pas structuraliste ? »
De l’interprétation
4Dans « Freud, Nietzsche, Marx » Foucault propose d’analyser les techniques d’interprétation de ces trois auteurs pour démontrer que le socle de la pensée moderne nouveau sens à des choses qui n’avaient pas de sens, ils changent la nature du signe et la façon dont il est interprété.
5Selon Foucault, la pensée moderne se fonde sur une herméneutique, sur l’interprétation, ce qui fait de la modernité un temps qui se réfléchit, un temps constitué sous le paradigme de l’interprétation. La modernité acquiert, ainsi un caractère descriptif qui fait du concept de modernité une description infinie :
Si l’interprétation ne peut jamais s’achever, c’est tout simplement qu’il n’y a rien à interpréter. Il n’y a rien d’absolument premier à interpréter, car au fond, tout est déjà interprétation, chaque signe est en lui-même non pas la chose qui s’offre à l’interprétation, mais l’interprétation d’autres signes5.
6Dans le développement de cette multiplication des interprétations, la référence à la constatation qui rend possible ce mouvement infini, « il n’y a rien d’absolument premier à interpréter », se perd et nous restons sans savoir quelles sont les raisons précises qui permettent l’élaboration de cette herméneutique. L’interprétation, toujours selon Foucault, « s’empare » « violemment » d’une autre interprétation et ainsi de suite, à l’infini. L’interprétation était déjà une tâche infinie au xvie siècle, mais à ce moment-là les signes se renvoyaient les uns aux autres car la ressemblance ne pouvait être que limitée. « À partir du xixe siècle, les signes s’enchaînent en un réseau inépuisable, lui aussi infini, non parce qu’ils reposent sur une ressemblance sans bordure, mais parce qu’il y a béance et ouverture irréductible6. » L’interprétation devient ainsi « inache-vée », « déchiquetée », toujours en suspens au bord d’elle-même ».
7Telle est la conséquence majeure de la thèse de Habermas que la modernité doit trouver en elle-même sa propre normativité7. Puisque la modernité se définit par une rupture avec le passé, son socle est le présent, elle doit en extraire sa normativité et par là produire sa légitimité :
Sans recours possibles, la modernité ne peut s’en remettre qu’à elle-même. Cela explique qu’elle soit si irritable quant à l’idée qu’elle se fait d’elle-même, cela explique aussi la dynamique de ses tentatives pour « se fixer » et « être fixée sur elle-même », poursuivies sans relâche jusqu’à nos jours8.
8Si l’interprétation devient une tâche infinie, la critique littéraire est plus que jamais un objet de pensée, la nécessité de l’établissement de son rôle s’impose. La question de savoir « qu’est-ce que lire ? » devient impérative. Derrida, lisant Mallarmé, soutient la notion de dissémination, en opposition à la polysémie du sens. Si la polysémie relève de l’explication ou du dénombrement du sens, la dissémination échappe à l’ontologie. Si « chaque fois que Mallarmé se sert du mot “opérationˮ, il ne se passe rien qui puisse être saisi comme événement présent, réalité, activité etc. », si « le Mime ne fait rien9 », « s’il n’y a pas d’acte », reste à savoir si la critique littéraire appartient à l’interprétation ontologique de la mimesis ou si elle est capable de faire face à la différence que le texte littéraire instaure10.
9Nous observons que la modernité est à la fois un problème historique et philosophique que relèverait de l’herméneutique. Nous aimerions penser la crise de 1866 comme une autre façon de poser la problématique herméneutique de la modernité, comme une réponse au sujet de sa légitimité et normativité, qui peut nous donner un point de départ pour répondre à la question « qu’est-ce que lire, selon Mallarmé ? »
La découverte du Néant ou contre l’interprétation
10C’est dans une lettre du 28 avril 1866 que Mallarmé annonce à Henri Cazalis, une découverte désormais capitale pour l’élaboration de sa poésie.
Malheureusement, en creusant le vers à ce point, j’ai rencontré deux abîmes, qui me désespèrent. L’un est le Néant, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme, et je ne suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail, que cette pensée écrasante m’a fait abandonner. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière – mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami ! Que je veux me donner ce spectacle de la matière, ayant conscience d’elle et, cependant, s’élançant forcenément dans le Rêve qu’elle sait n’être pas, chantant l’Âme et toutes divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant, devant le Rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges11 !
11L’abîme du Néant, se révèle être une « pensée écrasante », pensée qui met en question l’homme, et toutes les « vaines formes de la matière », « vaines » mais « sublimes » « pour avoir inventé Dieu ». Le Néant sera une des plus remarquables figures de sa poésie, il s’agit d’une pensée, d’une Idée, d’une vérité et peut-être la seule vérité humaine, celle qui transforme tout en mensonge. Cela se doit au fait que nous sommes des « vaines formes de la matière », c’est parce que le Néant est la seule vérité de l’existence humaine que la fiction existe comme un « mensonge », comme Dieu et l’âme, des explications du monde illusoires.
12Ainsi le Néant de Mallarmé est la réponse au concept de désir de vérité nietzschéen12 et porte en lui les mêmes conséquences. Selon Nietzche, le manque de sens de l’existence est ce qui pousse l’homme à créer des explications fictives du monde ; morale, religion, science ou, selon Mallarmé, « Dieu » lui-même. Ces explications du monde seraient aussi fictives que la littérature, un moyen par où l’homme montre son caractère « sublime », créateur. Mais pour que l’homme puisse être vraiment créateur, il doit être capable de créer du nouveau. C’est-à-dire non plus des explications du monde mensongères mais des nouvelles formes de vie qui correspondent à son caractère « sublime ».
13Le Néant est le fondement qui instaure la possibilité de la fiction, il assure au poète le droit d’opérer avec des signes, il démontre que l’homme dans ses systèmes d’explication du monde et en tant qu’être de langage, procède toujours en créateur, comme le poète. Cette absence ou manque de fondement pousse l’homme à créer des explications comme la religion, l’art, la morale, la science. À partir du Néant, c’est-à-dire dans la mesure où le Néant fournit la condition nécessaire pour que la poésie puisse être, Mallarmé propose un objectif à la poésie, « le démontage impie de la fiction », dévoiler le fondement (ou son absence, le Néant) assurant aux poètes le droit d’opérer avec les signes. Le poète dévoile la fiction, toute poésie devra exposer son caractère fictif, toute illusion sera toujours comprise comme telle. Le caractère illusoire de nos créations et valeurs sera toujours visible dans le poème, ce qui empêche toute mystification, ce qui empêche que le lecteur soit – comme dans les opéras de Wagner – amené à croire.
14De cette manière la modernité n’est pas le temps que doit produire à partir du présent sa propre légitimité mais le temps qui existe parce qu’il a une détermination négative. Si la modernité est le temps qui se définit par son absence de fondement, de base, et de détermination stable, être moderne implique la conscience d’être incapable de produire sa propre légitimité, c’est-à-dire, que les modernes doivent pouvoir vaincre le vertige provoqué par le gouffre, par l’absence de fondement de la vie et s’équilibrer dans l’absence d’un seuil de détermination positive de sens. Mallarmé fera de cette condition, qui est toujours la nôtre, le principe et la méthode de sa création, en dégageant de cette instabilité une force créatrice.
15Face au fait que le Néant est, qu’il n’y a rien à interpréter, la conclusion mallarméenne est : toute interprétation est vaine, incapable d’atteindre à la vérité cachée en amont du voile du réel et de l’apparence. Le monde ne doit pas être décrit, mais dévoilé comme structure fictive. Le poète ne décrit pas, n’interprète pas, n’explique pas, il crée, et en créant, tout ce qui est extérieur à la poésie prend la forme de la fiction, sa véritable forme. À l’intérieur du Livre le monde démontre sa vérité, sa fonction, aboutir à un Livre.
16Quand l’existence réelle croise la limite qui la sépare de la fiction et tend à faire partie de l’univers littéraire en devenant fiction, paradoxalement le réel apparaît dans sa vérité. C’est-à-dire que si nos explications du monde fonctionnent comme la fiction, celle-ci est un mécanisme structurant dans nos formes de vie. C’est pour cette raison que la découverte du Néant renverse la manière dont nous comprenons la littérature, ou le domaine de la fiction et son rapport au réel, questions que nous examinerons plus loin. Pour l’instant, il s’agit de préciser quelles seraient les conséquences de cette découverte pour la production poétique mallarméenne et la pratique de lecture que le poète construit.
De la lecture
17Mallarmé a répondu à l’accusation d’obscurité dirigée contre les poètes symbolistes en rétorquant que « des contemporains ne savent pas lire ». Et peut-être que nous ne sommes pas encore en mesure de lire le « signifiant fermé et caché, qui habite le commun », car devant une énigme la foule préfère renoncer en exclamant « Comprend pas ! » Or, si le signifiant caché habite le commun, l’écrit, sur champ obscur, dégage : « le rien de mystère ». C’est-à-dire que le rien et le mystère ne font qu’un ou que le mystère qui habite le commun est à la surface et non pas, comme nous avons l’habitude de penser, dans les profondeurs du texte, caché derrière un tissu infini de métaphores.
18De cette manière, un texte se lit, littéralement, sur la surface. Ainsi quand Mallarmé définit la lecture comme pratique il affirme : « indéfectiblement le blanc revient, tout à l’heure gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-delà et authentifier le silence ». La conclusion d’une lecture indique « rien au-delà », c’est-à-dire que l’au-delà n’existe pas, ni le mystère. Le silence est par là l’affirmation maximale du Néant, de la non-existence d’un au-delà. Car ce que Mallarmé découvre pendant la crise de 1866 est le Néant, élucidé en creusant le vers. C’est-à-dire qu’en creusant le vers Mallarmé se rend compte que dans les profondeurs du langage, au fond de la poésie, il y a un abîme ou il n’y a rien, il y a le Néant.
19Pour cette raison si énigme il y a dans la poésie de Mallarmé, elle doit être cherchée à l’exemple du texte de Poe « The purloined letter » (La lettre volée). Ce texte a comme épigraphe, une affirmation attribuée à Seneca ; il n’y a rien de plus offensant à la sagesse que l’excessive subtilité : « Nul sapientiae odious acumine nimio ». Or, qu’est-ce qui peut être plus subtil que le Néant ?
20Le lecteur peut rire, comme le préfet de police du conte qui demande conseil à Dupin. Le préfet de police est dans l’embarras, incapable de dénouer le mystère de la lettre volée. Un cas, pourtant très simple, puisqu’il connaît le voleur et l’objet volé. Dupin suggère au préfet de police que c’est justement la simplicité du cas qui le met en difficulté : « perhaps it is the very simplicity of the thing which puts you at fault13 ». Le préfet répond que cette affirmation relève du non-sens. Il rit, incapable de comprendre les propos de Dupin. Le très rusé personnage insiste que le mystère est peut-être trop simple, « perhaps the mystery is a little too plain » ou « to self-evident14 ». Le préfet rit toujours profondément amusé.
21Or, le préfet de police cherche une lettre qu’un poète aurait caché, car le ministre voleur n’est pas seulement un homme politique intelligent ou un mathématicien, il est aussi un poète qui sait que les mystères des lettres, et de la littérature s’écrit noir sur blanc, au moyen d’une inversion radicale de valeurs, normes et surtout de la logique et de la grammaire du sens commun. Si la lettre volée est abandonnée devant les yeux de tous ceux pouvant la repérer dans la chambre du ministre, le mystère de la littérature, des lettres, repose aussi sur la surface du texte, devant nos yeux. Ainsi, la leçon de Dupin nous enseigne que le plus difficile d’un problème ou énigme est de trouver ce qu’il y a de plus simple et qui se place sous notre regard. S’il est ainsi, nous pourrions peut-être nous demander si le mystère de la littérature, des lettres, ne repose pas également sur la surface du texte, s’il ne repose pas devant nos yeux ?
22Lire c’est d’abord un exercice d’oubli, en suivant les lignes du texte nous apprenons aussi à les quitter, à les laisser derrière nous. En écoutant un texte nous pouvons percevoir l’évanouissement des sons et l’approche de la fin, le silence. En lisant nous devrions être capable d’abandonner nos illusions et notre manière de voir et de comprendre pour pouvoir retrouver la vérité qui ne se cache plus, mais qui s’étale, quoique déguisée, devant nos yeux comme la lettre volée du conte de Poe.
23À titre d’exemple, nous pouvons examiner brièvement un poème :
À la nue accablante tu
Basse de basalte et des laves
À même les échos esclaves
Par une trompe sans vertu
Quel sépulcral naufrage (tu
Le sais, écume, mais y baves)
Suprême une entre les épaves
Abolit le mât dévêtu
Ou cela que furibond faute
De quelque perdition haute
Tout l’abîme vain éployé
Dans le si blanc cheveu qui traîne
Avarement aura noyé
Le flanc enfant d’une sirène
24Selon Badiou le poème nous pose la question de savoir si l’écume est la trace d’un navire naufragé ou la trace du plongeon d’une sirène. L’événement a une trace, un nom. Le poème doit « traiter la trace », « nommer le nom, c’est-à-dire, faire valoir comme nomination événementielle15 ». Rancière, d’autre part, formule le problème autrement. Pour lui le poème mallarméen comme le logos platonicien choisit à qui il convient ou ne convient pas de parler. Les deux hypothèses du poème sont :
25Première hypothèse : peut-être l’orgueilleuse nef poétique à la poursuite de son or ou de son étoile chimérique, s’est-elle fracassée contre le récif de son ambition même, dans la mer indifférente de l’époque et du grand public (…) Seconde hypothèse : peut-être la partie s’est-elle jouée différemment. L’abîme vain de l’époque et du public n’est aucunement indifférent à la grandeur des « perditions hautes ». (…) La fureur de cet « ouragan jaloux » ou de cette « émeute affamée » de grandeur ne peut qu’enfouir en son ventre dévorant la frêle sirène du poème nouveau16.
26Notre hypothèse est que le poème ne narre pas, ne décrit pas un événement, il est le propre événement. Ainsi il ne s’agit pas de savoir quel est l’événement en question, mais comment le poème peut avoir lieu. Nous voudrions suggérer que l’événement en question est la fiction. De cette manière le poème ne tourne pas autour de la nomination des traces de cet événement, il est lui-même la trace, la lettre écrite et fixée sur le papier qui nous autorise la constatation immédiate que quelque chose comme le poème a eu lieu, qu’il existe, qu’il est en soi événement. Néanmoins, il est aussi constitué d’un autre aspect, la musique, et c’est la musique qui nous permet d’inférer sur la nature de l’événement.
27L’abondance et la répétition de consonnes occlusives rendent la sonorité du poème très serrée et sombre comme si elles indiquaient une impasse ; tout se passe comme si un bateau trouvait soudainement sur son chemin un obstacle, un récif. Ces consonnes, brèves, explosives et répétitives figurent le manque de mouvement, la difficulté d’un bateau qui probablement s’est enfoncé contre un rocher. Choc qui aurait provoqué le naufrage. Une trombe d’eau aurait envahi le bateau, maintenant silencieux comme un poète naufragé qui, mort, se tait, tout en étant capable d’écouter, depuis la profondeur des mers, les « échos esclaves » de la terre, cette même terre qui lance des laves. Paradoxalement le naufrage va lentement faisant la place à l’entrée des consonnes constrictives, plus longues et plus suaves, plus délicates et légères, elles métamorphosent l’écume, témoin du naufrage poétique en sirène, un être de fiction. La voyelle « i » se fait chaque fois plus insistante dans les derniers tercets, indiquant la légèreté et la nature éphémère de la sirène / fiction, accentuée par l’abondance de consonnes « nasales » du dernier tercet. L’impact du bateau contre les rochers provoquant le naufrage donne progressivement lieu à une tentative de fixer l’image fugitive d’une sirène qui se prolonge par les consonnes nasales. C’est le mot « sépulcral » qui annonce la victoire du poète malgré le naufrage. Les consonnes occlusives sont comme vaincues par les deux « l » qui nous dirigent vers les profondeurs de la mer où finalement tout peut commencer.
28L’écume de la mer qui se confond avec « le flanc enfant d’une sirène » nous montre le caractère évanouissant de cet événement qu’est la poésie. Fiction qui, comme la sirène, n’a pas de place dans le monde réel mais néanmoins existe, comme l’écume de la mer, blanche, prête à se défaire mais pour former une nouvelle vague, et revenir à terre, en apportant éventuellement les restes du navire poétique naufragé. Le caractère évanouissant de la fiction est, selon Badiou, responsable de l’instauration du doute au sein du poème, il est aussi, selon Rancière, responsable de la mise en question du rôle social de la poésie. Mais puisqu’il est ici question d’affirmer qu’une poésie peut surgir après le naufrage, avoir sa source dans le néant, le caractère évanouissant du poème, doit être compris comme l’instauration d’une nouvelle forme d’être et de penser la poésie, l’avoir lieu poétique qui tout en étant fictif, c’est-à-dire dubitable, léger, presque imperceptible peut toutefois simplement être. Bercés par cette série des consonnes nasales, nous retrouvons la voyelle « è » la plus puissante qu’un poète puisse trouver, elle est responsable de la prolongation et de l’augmentation du timbre et de la puissance de cet événement si subtil.
29C’est ainsi que Mallarmé cherche à vaincre le naufrage « de l’homme » en le balayant avec des consonnes légères, mais longues, plus durables que les consonnes explosives qui provoquent le naufrage du navire et évoquent un rocher. C’est donc à la surface du texte que l’événement a lieu, presque imperceptible et néanmoins capable de faire surgir du fond d’un naufrage, une fiction nouvelle, « le flanc enfant d’une sirène ».
30Devant cette constatation, comment comprendre ces deux visions apparemment dissemblables et négatives de la lecture ? D’une part la lecture comme pratique visant à « authentifier le silence » ; d’autre part, l’affirmation que le Livre « ne réclame approche du lecteur. Tel sache, entre les accessoires humains, il a lieu tout seul : fait, étant17 » ?
31Le poème doit être lu comme chose en soi, objet concret, visible, palpable, matériel. Si Mallarmé réfléchit sur la poésie à partir de la configuration matérielle du livre c’est pour insister que la littérature commence dès la lettre. Elle se constitue à partir d’un matériel, le langage, qui doit reconquérir sa concrétude pour être travaillé par un poète (le fait divers n’annule-t-il pas la concrétude du langage en faisant de lui un ustensile représentatif ?). L’univocité de la poésie, son caractère singulier, unique, repose sur son existence concrète. Son existence prouve sa nécessité, malgré le discrédit et le mépris que la société lui voue. Cependant, un poème ne doit pas être lu comme un article de journal qui raconte un fait divers. Il ne s’agit pas de cerner son sens ou sa signification mais de reconstituer l’ensemble des procédés à l’origine de la fabrication d’un sens nouveau. Et sens ne doit pas être compris comme une signification univoque mais comme une direction, direction nouvelle que le poème donne à la poésie et qui vise rétablir la notion de ce qu’est un événement.
32Une poésie qui rémunère le défaut des langues est capable de faire événement dans le langage. Pour qu’un événement ait lieu la poésie reconstitue son espace et son temps. Pour cette raison Mallarmé transforme le livre, du mot-total jusqu’à la double page, en passant par la métrique du vers. La grande transformation dans le temps de la lecture concerne le caractère cyclique du Coup de dés. Dans la mesure où le poème termine en nous invitant à le relire, Mallarmé produit et présente un nouveau mode de lecture. Le poème sans fin nous inviterait ainsi à nous plonger dans l’univers de l’interprétation infinie ? La réponse est évidemment non, car il s’agit dans la lecture de repérer les mécanismes à partir d’où le nouveau est créé. Ainsi la poésie est création, invention, une expérience qui doit sans cesse se répéter, car la poésie est l’infinie création du nouveau. Si un poème fait sens, produit du sens, c’est dans la mesure où il place son lecteur face à un événement. Produire du sens c’est produire du nouveau. Le sens comme le vers du Coup de dés nous dirige vers un autre chemin pour retrouver des mondes que nous ne connaissons pas encore. Le sens ne surgit pas quand le lecteur interprète car interpréter signifie avoir recours à un répertoire d’informations déjà connues, établir des relations d’analogie ou de ressemblance. Lire c’est suivre la ligne du texte. Un lecteur, comme le préfet de police cité, poursuit la lettre du texte. C’est ainsi à la surface et non dans les profondeurs souterraines du langage que tout a lieu. La lecture du Coup de dés, la lecture de la littérature est une affaire de perception et la question à poser devant le Coup de dés serait « qu’est-ce qui a eu lieu ? ». Répondre à cette question implique surtout des considérations sur l’aspect formel du poème. La prosodie a visiblement éclaté. Les lettres ont changé. Le poète signale leur importance, maître des grandeurs, il les augmente ou les réduit. Ainsi le temps est lui aussi resserré ou allongé. Au poète revient le rôle de distinguer les faits divers des événements. Les lettres sont chargées d’établir une nouvelle dimension sur la feuille du Livre, et ainsi c’est le monde autour du lecteur qui gagne de nouveaux contours. Les lettres refont le Livre et le monde. Comme une constellation, le poème est composé de mots-étoiles dont le scintillement guide les lecteurs-voyageurs vers un monde nouveau. L’éclat fulgurant, léger ou lourd des lettres construit une polyphonie en spirale qui conjugue le hasard et l’infini. La constellation est l’idée qui donne forme au poème. Mais cette forme, écriture des astres sur le ciel, doit se composer dans un espace qui ne soit pas plat mais un continuum, un espace qui se dilate incessamment comme le ciel. Espace en train de s’élargir par le scintillement multiple des étoiles qui tracent un ballet. Les étoiles sont comme les notes musicales ou les mots du poème. Leur scintillement n’est pas linéaire, chaque étoile brille à son rythme, à son temps, avec des intensités différentes, ces pierres précieuses sont non seulement multiples mais elles ont des puissances multiples. Ainsi le ciel paraît être en constant mouvement. Pour cette raison le Coup de dés a la force d’une spirale qui ne cesse de s’élargir, la fin rejoint le début mais pour l’accroître car il ne s’agit pas seulement d’un acte, le coup de dés est aussi mouvement de la pensée.
33Les faits divers ou la littérature qui narrent et décrivent en reproduisant les choses à un « imperturbable premier plan » imitent et perpétuent l’interminable aveuglement de la foule. Nous ne sommes pas capables de voir, puisque le réel, puisque ce qui est et le Néant sont ce qu’il y a de plus subtil et échappent à notre regard. Ainsi il s’agit dans la poésie de capter l’extrême subtilité de ce dont le langage ordinaire nous éloigne. Si les dieux nous ont abandonnés, la poésie appartient seulement au monde ici-bas, et c’est à partir du contact avec la prose du monde qu’elle trouvera le chemin vers le nouveau. Pour cette raison la découverte mallarméenne du Néant est intimement liée au hasard.
34Ce qui s’étale devant nos yeux dans la poésie mallarméenne est le hasard, insignifiant et cependant très concret voire irrévocable. Vraisemblablement c’est la seule force qui détermine aussi bien la pensée que la poésie et la réalité. C’est ainsi que le Coup de dés enserre l’expérience poétique mallarméenne en affirmant que la pensée, comme un coup de dés, ne peut pas abolir le hasard, ce qu’il y a de plus réel. Un hasard qui apparaît dans les choix poétiques de Mallarmé depuis ses premiers poèmes. Dans « Le guignon » les poètes « mendieurs d’azur » sont les « dérisoires martyrs de hasards tortueux ». Et c’est justement à partir de hasards que les « Anecdotes ou poèmes » commencent, des rencontres réelles ou imaginaires déplacent la poésie de son lieu habituel. Les fêtes foraines et la campagne pénètrent la prose. D’un fait banal, d’une circonstance fortuite, voyage, éventail, amour, écume ou étoile, la poésie éclate pour inscrire la brume, la vague apparition ou l’évanouissement de ces rencontres éphémères avec des objets légers ou faits précaires.
Du hasard
35Un de célèbres mots mallarméens sur la poésie la « définit » comme l’union de la musique et des lettres. D’abord la poésie se constitue comme écrit ; l’écrit c’est la lettre qui assure l’existence de la pensée car « penser sans laisser des traces devient évanescent18 ». Néanmoins la littérature, la poésie, pour atteindre l’Idée est dotée de musique, un élément également évanescent : « la Musique et les Lettres sont la face alternative ici élargie vers l’obscur ; scintillante là, avec certitude, d’un phénomène, le seul, je l’appelai l’Idée19 ». Une idée, comme la lecture, instaure une page blanche, vierge. Elle ouvre un horizon sans fin. Une page blanche est un monde nouveau à inventer avec les 26 lettres de l’alphabet. Elle n’est pas symbole d’impuissance ou de désenchantement, mais un espace à remplir par un univers infini de possibilités. Une page blanche c’est la possibilité de réinventer le monde où nous aimerions vivre, l’idée est ce qui ouvre de nouveaux horizons.
36Une Idée, en majuscule, n’est pas une idée quelconque mais un « concept trop vierge à la société », elle est totalement nouvelle et annule nos habitudes cognitives et ce que nous connaissons. Une Idée est quelque chose de nouveau. D’où surgit le nouveau ? Comment se produit le nouveau ? Si Dieu est un mensonge, tout ce qui existe surgit du Néant. Le Néant lui-même, c’est le nouveau parce qu’il n’existe pas encore. Il doit être découvert, dévoilé. Il n’a jamais été pensé, considéré. Il est ce qu’il y a de plus subtil. Ainsi la question à laquelle nous devrions répondre, la plus difficile, est : comment faire exister le nouveau, comme faire pour qu’une idée devienne réelle ? C’est la question de la création poétique : qu’est-ce qu’un poème sinon la mise en forme d’une Idée, la mise en forme du nouveau ? Si un poème est la concrétisation d’une idée, il est une réalité et peut fournir la preuve que la poésie est aussi action, restreinte, car soumise au hasard et incontrôlable, mais encore un acte qui s’accomplit devant les yeux du lecteur.
37Si « toute pensée émet un coup de dés », toute pensée est ainsi un acte, mais nous savons qu’« un coup de dés n’abolira jamais le hasard ». Ainsi la réponse aux questions : « comment une idée devient réelle ? », « comment quelque chose a lieu ? » est : « par hasard ». Si tout ce qui existe est créé à partir du Néant, le passage du néant à l’être se fait par l’action du hasard. C’est-à-dire que tout au monde existe avec le concours du hasard. Ainsi le hasard n’est pas la limite de l’existence des idées, ce qui empêche la création poétique et trouble le poète. Le hasard est le principe qui fait que la poésie existe. Oui, le coup de dés démontre visuellement et littéralement que quelque chose comme les Lettres existent. Mais elles ne peuvent exister qu’à condition de se soumettre à un régime temporel d’existence, le poème se fait et se défait, chaque lettre écrite, chaque mot fixé est aussi un passage à l’autre, un devenir musical ; ils s’évanouissent pour ouvrir un espace, créer un silence qui sera rompu par d’autres lettres, d’autres mots, d’autres sons. Le poème, la poésie recommencera sans cesse, sans pouvoir jamais trouver un point ultime d’ancrage. Le hasard assure la possibilité de la poésie, puisqu’il est la puissance qui crée le réel, qui instaure la nouvelle réalité au sein du réel.
38Si le Néant définit la fiction, c’est parce que la fiction est l’autre du réel, ce qui n’est pas. La fiction a un mode d’être « virtuel », une possibilité, elle est tout en n’étant pas. Mais si la vérité ne peut être transmise que sous l’apparence d’une fiction, si elle a la structure d’une fiction, cela implique un renversement de notre notion de réalité, et du rapport qui semble si évident entre réalité et fiction. Si la vérité a la structure de la fiction, la réalité se dissout à l’encontre du Néant. Au fur et à mesure que la fiction dévoile le Néant, le caractère provisoire et fragile de nos explications du monde, c’est le réel qui devient un spectre illusoire et la poésie peut ainsi être un de ces « parages du vague où la réalité se dissout ». La réalité qui se dissout est la réalité comprise comme quelque chose de stable et d’extatique. Elle se dissout pour apparaître comme devenir.
39Puisque le réel est fugace, il est aussi difficile à penser que le Néant. Si aucune détermination n’est capable de nous montrer la vérité de ce qui est, car sa vérité repose dans sa propre existence, nous ne pouvons pas parler du Néant ou de ce qui n’est pas. La grammaire nous oblige à déterminer, à donner des prédicats à un sujet. Néanmoins, l’être, le Néant ou le hasard ne se laissent pas réduire à des déterminations stables. Ainsi le nouveau comme le hasard qui le fait surgir est de l’ordre de l’impensable, car il échappe à la raison, il échappe à notre contrôle, à la maîtrise, à la langue.
40Dans la mesure où la fiction se définit par rapport au réel comme ce qui n’est pas, ce qui ne peut pas être ou ce qui aurait pu être – qui fait des possibilités réalité – le hasard devient le principe de choix de la poésie. Il instaure le jeu entre réel et fiction, nous permettant de dépasser l’horizon des possibilités de l’art en transformant la page blanche, en créant une réalité d’une autre nature, fictive et capable de changer notre conception de ce qui est une réalité. C’est ainsi que le Coup de dés enserre l’expérience poétique mallarméenne en affirmant que la pensée, comme un coup de dés, ne peut pas abolir le hasard, ce qu’il y a de plus réel. Le poème accomplit ainsi un rapprochement entre littérature et monde, à partir du moment où la poésie et le réel se définissent sous le signe du hasard, l’écart de la fiction au réel devient fragile, sans fondement ni raison. Elle dépend d’un geste simple, tel un coup de dés.
41Pour finir, nous proposons un exercice au lecteur à partir de l’hypothèse suivante : plus le poème nous pose de questions, plus il élargit les limites de notre pensée et nous invite à construire de nouveaux modes de vie. Au lieu d’interpréter, de chercher les clés du texte ou ses codes secrets, un lecteur de Mallarmé est invité à poser des questions. Voici l’exercice : entre les mots, « un coup de dés », « jamais », « n’abolira » et « le hasard », combien de mots y a-t-il ? Comptez, mais sachez que c’est un hasard. Il aurait pu y avoir un mot de plus, deux de moins… Ce qui compte est la possibilité proposée par la poésie de jouer avec les mots, avec les signes, avec les normes de la grammaire et subvertir son ordre. La grammaire régit l’ordre de la vie et du sens-commun. Elle est la règle qui ordonne la pensée, qui gouverne et exclut. Quel est l’ordre de la grammaire ? Sujet, verbe, prédicat ou cause, action, conséquence.
42Une fois que les mots du poème sont posés sur le papier apparemment de manière arbitraire, il revient au lecteur de rétablir l’ordre syntaxique. Mais si au lieu de rétablir l’ordre, le poème nous invitait à nous questionner sur les possibilités qu’il offre ? Se questionner sur la grammaire en quête de l’ordre syntaxique signifie se demander : quel est le sujet ? combien de prédicats a un sujet ? quelle est la cause, pour quelle action ? qui provoque cet événement ? chaque sujet a-t-il une ou plusieurs déterminations ? lesquelles ? Cependant, nous pourrions faire encore un effort devant le hasard, et poser d’autres questions : pour quelle raison devrions-nous choisir, déterminer, classer, ordonner ? et si nous jouons les dés ?
43Jouons les dés et observons vers où ils vont. Ouvrons l’espace de la page pour qu’ils puissent aller plus loin. Plus longtemps ils rouleront plus il y aura de hasard, plus nous aurons de nouvelles possibilités. C’est une affaire d’espace et de temps, c’est entre les aspects visuels et sonores du poème que tout se joue, c’est à une interrogation perceptive, à une expérience concrète que nous sommes invités par le poème. Il nous invite à ouvrir à l’intérieur de la pensée des zones vides, des espaces blancs où pourra régner l’imprévisible hasard.
44Il est question de réorganiser l’esthétique transcendantale, c’est-à-dire de refaire les conditions de possibilité de notre expérience. Nous avons besoin d’espace, de plus d’espace et d’un temps se déroulant autrement. Un temps qui ne nous presse pas, qui ne nous oppresse pas, qui ne soit pas l’espace de répétition du même, ou une source d’ennui. Nous avons besoin de sentir plus, de prolonger le temps de sentir et de voir et par là prolonger les sensations, diversifier les émotions, laisser les détails prendre plus de corps et de forme. En élargissant la page du Livre, en cassant l’ordre syntaxique, Mallarmé change la façon dont la littérature opère avec des signes, elle cesse d’être production de significations pour devenir une machine à produire du sens, à produire des déplacements, des mouvements. Machine à produire diverses manières d’être et de changer, de devenir autre. Une poésie conçue à l’image du hasard, capable de transformer celui-ci dans son effet ou de le produire, créant un mécanisme capable d’engendrer sans cesse de nouvelles expériences. C’est-à-dire que la poésie est construite à l’image du hasard, parce qu’elle est le résultat d’une opération qui transforme le possible en réel, et elle est aussi capable de produire le hasard, dans la mesure où elle ne cesse de produire des nouvelles expériences.
45L’effet de cette rupture ? Si la littérature peut jouer avec les règles de la grammaire, les disloquer, élargir la phrase et la prolonger, jouer avec la prosodie, la pagination, et l’ordonnancement du Livre, elle introduit des éléments perturbateurs, provoque des questions difficiles qui changent sa nature, intégrant de nouvelles qualités, car il ne s’agit pas d’un changement numérique mesurable, mais qualitatif, qui part des mots pour questionner la pensée. Si un poème peut mettre en question les règles et normes qui déterminent la grammaire et structurent notre pensée ainsi que nos modes de vie, pourquoi ne pas élargir l’espace du poème ? Pourquoi ne pas transposer le Livre au monde, et continuer ce coup de dés ? Si le poème peut se bâtir en détournant les règles de la grammaire et l’ ordonnancement du Livre, si en jouant la littérature démontre qu’il est possible de créer de nouveaux rapports, de nouvelles idées, un autre mode de production capable de mettre en scène le nouveau, elle nous invite à faire un pas de plus, encore un effort (l’ultime), multiplier ce nouvel agencement de signes, à l’extérieur de la page du Livre, étendre l’espace de la littérature à l’intérieur de la vie sociale, et jouer tout en se posant les dernières questions : et si nous aimions autrement ? et si nous pensions autrement ? et si nous vivions autrement ?
Conclusion
46Si les lettres s’alignent dans un poème de telle manière que le hasard est vaincu « mot par mot20 », comment justifier que le hasard puisse fournir la forme à partir de laquelle la poésie mallarméenne se structure ? Si la poésie doit vaincre le hasard, affirmer que sa poésie se construit en faisant du hasard sa forme, n’est-ce pas trahir Mallarmé ?
47Le hasard est souvent compris comme insignifiant, ce qui n’est pas nécessaire, ce qui n’a pas de sens, ce qui ne construit rien, ce qui ne produit rien de significatif et, pour cette raison, il est rejeté par la raison qui ordonne, distribue, hiérarchise les faits, les événements, les sujets, selon leur importance, selon leur signification. Mais cet ordonnancement et cette hiérarchisation des événements et faits présupposent des valeurs et normes. C’est justement ces présupposés que le hasard interroge. Il nous met face à la question de savoir quels sont les bases et fondements de l’ordre social, des normes poétiques, de la détermination des valeurs et de la constitution des hiérarchies.
48À partir de la découverte du Néant, Mallarmé construit une critique de la nécessité de légitimation de la modernité. Le Néant démontre que l’ensemble de la vie sociale, religieuse, politique, économique, est construit à partir de discours « fictifs », arbitrairement fondés. Ainsi la pensée gagne un autre objectif : non plus interpréter et retrouver le fondement de la vie sociale mais construire des nouvelles formes de vie. Pour cette raison, Mallarmé entreprend, dans « Grands faits divers », une critique de l’économie politique, du système financier ainsi que de la démocratie représentative ; il cherchera à démontrer que le capitalisme financier ainsi que la démocratie se fondent sur des principes représentatifs. Si l’économie fait de l’argent un dieu régissant la vie sociale, la démocratie, par le suffrage universel, élit une minorité qui gouverne, en créant un système politique qui, en réalité est une aristocratie, gouvernement d’un nombre restreint de personnes et pas de tous les hommes. Ce mécanisme représentatif est une abstraction qui exclut la majorité du gouvernement ainsi que de l’économie en démontrant que nos systèmes d’explication et d’ordonnancement de la vie sociale sont essentiellement mensongers et doivent être transformés.
49Le hasard, puisqu’il est, tout en pouvant être autre, peut dissoudre la réalité, certes, mais il est aussi l’affirmation de son existence. Ce qui est, est par hasard, tout en pouvant être autre. De cette manière, le hasard est l’affirmation irrévocable de la nature contradictoire de toute réalité, de tout événement. Il est d’abord la force qui fait être, la puissance, l’exception qui fait que quelque chose peut avoir lieu. Dans ce sens, le hasard fait l’événement, quand il est la forme qui structure la poésie, il est capable de faire de celle-ci un événement. Un événement qui produit du nouveau. Car le hasard que Mallarmé cherche à mettre en forme dans son poème est la puissance qui élargit le domaine du possible, qui multiplie les possibilités d’une vie nouvelle. La puissance qui fait que la poésie peut recommencer après un naufrage, faire Histoire, inscrire une pensée dans une feuille de papier pour la sacrer, pour la faire durer. Le hasard est la puissance qui fait qu’un événement a lieu, en transformant tout ce qu’il touche, en fabricant du nouveau, véritable machine à créer l’infini avec les mille combinaisons possibles des 26 lettres de l’alphabet, présence matérielle et absolue du fait littéraire. Ainsi le hasard fait Histoire, il n’est pas seulement le fugace et momentanée mais l’inscription à l’intérieur du réel d’un autre mode d’être, d’un autre mode de présence, celui du simple possible, de la fiction, que nous invite à un voyage vers d’autres formes de vie.
50C’est en tant que puissance irrévocable de création de l’imprévisible nouveauté que le hasard répond au désir qui fait la littérature romantique ainsi que le structuralisme et poststructuralisme. Si le romantisme cherchait à « achever la révolution », construire un monde nouveau après la Révolution de 1789, le structuralisme est animé par le même désir de faire la révolution, peu importe si le romantisme cherche à faire ce monde nouveau en renouvelant les mœurs et les coutumes, et si le structuralisme et poststructuralisme cherchent à accomplir cette transformation à partir du langage. Ce qui compte est le désir du nouveau, qui parcourt la littérature et fait d’elle un espace privilégié de construction et d’invention des nouvelles formes de vie.
51Puisque le hasard est un processus de production du nouveau, ce qu’il produit fait sens, s’instaure dans la réalité et la transforme. La preuve est le propre poème qui existe, seul et rend visible les multiples combinaisons des mots, en établissant un ordre de valeurs, une hiérarchie qui se construit à partir du critérium de la capacité de réaliser la puissance propre au langage de faire événement. Si Mallarmé a autant critiqué le journal et l’universel reportage, c’est justement pour mettre en question le droit du journal à narrer et décrire le banal, en détruisant la hiérarchie entre événements et faits divers. De quel droit le journal peut déterminer ce qui a eu lieu, et choisir entre les faits ceux qui doivent être rapportés ? À partir de quel critère le journal décide de ce qui a eu lieu ? La poésie ne narre pas de faits ordinaires qui se répètent incessamment, elle nous rend présent une absence, un futur, le nouveau qui n’a pas encore eu lieu, une exception qui fonctionne en créant une autre logique des faits, un autre monde.
52Le paradoxe du hasard est qu’il est toujours présent dans le processus de création, dans la mesure où il est production du nouveau mais il cesse d’exister à partir du moment où les dés cessent de rouler. Le hasard est présent à chaque coup de dés, néanmoins à partir du moment où les dés nous montrent le nombre unique, le hasard est aboli par la nécessité. Le poème, accomplissement du coup de dés, est ainsi nécessaire, absolu ; il existe. Mais son existence, tout en étant nécessaire, est le résultat du hasard. Pour cette raison, elle sera toujours hantée par la possibilité de son évanouissement. Le hasard est cette contradiction, il est tout en pouvant ne pas être. C’est ainsi que se définit la fiction. Elle existe dans le livre, un espace restreint de la vie sociale, cependant le livre est un objet matériel où la pensée laisse ses traces pour toujours. Comme un possible ou comme le propre réel, la poésie peut toujours être autre, être autrement, et pour cette raison elle est le meilleur instrument pour mettre en scène ce qui est de l’ordre du nouveau et inviter ses lecteurs à naviguer à la quête de l’inconnu.
1 Madame de Staël. De la Littérature, Paris, GF-Flammarion, 1991, p. 65.
2 Ibid., p. 308.
3 Ibid., p. 308.
4 V. Kaufmann, La Faute à Mallarmé. L’aventure de la théorie littéraire, Paris, Seuil, 2011, p. 91.
5 M. Foucault, Dits et écrits I, 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001, p. 599.
6 Ibid., p. 600.
7 Habermas, Le Discours philosophique de la modernité, traduction de Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz. Paris, Gallimard, 1988, p. 9. Voir aussi F. Jameson, A singular modernity: essay on the ontology of the present, London, New York, Verso, 2002.
8 Ibid., p. 9-10.
9 J. Derrida, La Dissémination, Paris, Seuil, p. 266.
10 Ibid., p. 299.
11 Mallarmé, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 696.
12 F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra dans Œuvres, Paris, Flammarion, 2000, p. 422. Voir aussi Le Crépuscule des idoles, trad. Jean-Claude Hémery, Paris, Gallimard, 1974, p. 42.
13 Edgar Allan Poe, The Fall of the house of Usher and other writings, London, Pinguin classics, 2003, p. 295.
14 Ibid.
15 A; Badiou, « La méthode de Mallarmé : soustraction et isolement » dans Conditions, Paris, Seuil, 1992, p. 111.
16 J. Rancière, Mallarmé : Politique de la sirène, Paris, Hachette, 1996, p. 23.
17 Mallarmé, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 217.
18 Ibid., p. 215.
19 Ibid., p. 69.
20 Ibid., p. 234.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 10, 2014
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=618.
Quelques mots à propos de : Larissa Drigo Agostinho
Université Paris IV-Sorbonne
Doctorante à l’Université de Paris-Sorbonne, Larissa Drigo Agostinho a notamment publié « Quand le hasard fait l’œuvre », Revue d’écho des études romanes, IX, 2013.
