Sommaire
Mallarmé herméneute
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
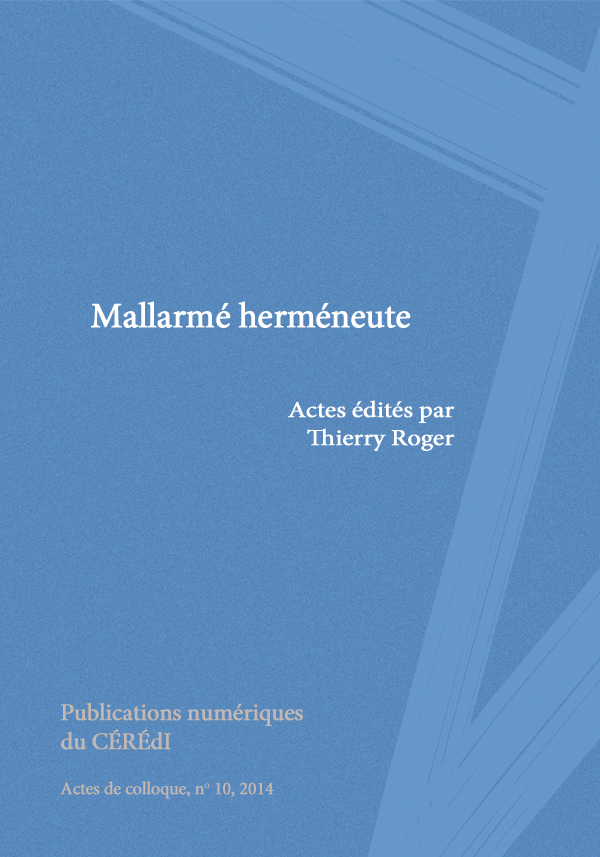
- Le « lecteur d’horizons »
- Pascal Durand Mallarmé dans la prison des signes
- Claude-Pierre Perez « Le cabinet des signes » : Mallarmé, Claudel et l’herméneutique
- Guillaume Artous-Bouvet Mallarmé et l’herméneutique de la nature
- Larissa Drigo Agostinho Lire ou interpréter après la découverte du Néant
- Robert Boncardo Badiou, Mallarmé et le dépassement de l’herméneutique
- Frédéric Torterat Lire avec Mallarmé, entre remémoration et démémoration
- Le lecteur empirique
- Barbara Bohac Mallarmé lecteur de Banville
- Alice Folco Portrait de Stéphane Mallarmé en spectateur
- Maria de Jesus Cabral Je ne sais quel miroitement en dessous : le théâtre, programme humain, outil herméneutique
- Adrien Cavallaro D’un article « plutôt défavorable et malin » : Mallarmé portraitiste de Rimbaud
- Marie Blaise Mallarmé et Poe : « la personne analogue » (À la mémoire de Claude Richard)
- Margot Favard Mallarmé lisant ses pairs, ou comment s’écrit la figure du poète en Maître (Sur « Quelques médaillons et portraits en pied »)
- Le lecteur implicite
- Patrick Thériault L’adresse à communiquer : le motif herméneutique de l’adresse en contexte de modernité poétique. L’exemple du salut mallarméen
- Arild Michel Bakken La figure du lecteur : l’auditoire auctorial dans les Poésies de Mallarmé
- Nelson Charest « La déclaration foraine » ou la réception tue dans les rets du poème
- Annick Ettlin Éloge de la non-lecture. Mallarmé et le mythe littéraire
- Joëlle Molina Mallarmé, passeur secret d’herméneutique ancienne ? La preuve par X.
Le « lecteur d’horizons »
« Le cabinet des signes » : Mallarmé, Claudel et l’herméneutique
Claude-Pierre Perez
1Barthes cite rarement Claudel, même – surtout – quand on attendrait qu’il le fasse. Dans son livre sur le Japon, par exemple, il l’évite soigneusement, tout en lui empruntant le titre d’un de ses chapitres (« Le cabinet des signes ») ; et le titre du livre lui même n’est peut-être qu’une transformation hyperbolique de la locution claudélienne.
2Il arrive toutefois que Barthes mentionne Claudel quand on ne l’attend pas : c’est le cas dans son article de 1974 « Théorie du texte », pour l’Encyclopedia universalis. Il se sert alors de « La catastrophe d’Igitur » pour plaider contre la restriction du concept de « texte » à l’écrit et à la littérature. Il est légitime au contraire, estime-t-il, d’étendre l’aire de pertinence de la textualité et « pour reprendre un mot de Claudel à propos de Mallarmé, de « se placer devant l’extérieur, non comme devant un spectacle […], mais comme devant un texte ».
3Cette citation, dans cet article, ne s’inscrit évidemment pas dans le cadre d’une apologie de l’herméneutique ; l’herméneutique n’apparaît ici qu’une seule fois, et c’est pour être identifiée au « monologisme », à la « métaphysique de la vérité », à la déplorable passion du sens unique. L’herméneutique ici dédaignée, c’est celle que Friedrich Wolf, définissait (en 1831) comme un art permettant de « comprendre et expliquer les pensées d’autrui d’après leurs signes1 », et dont le but est atteint quand elle a rejoint l’intention de l’auteur.
4Voici donc Claudel, si souvent accusé d’être un gardien du Sens, enrôlé par Barthes au service d’un éloge de la « signifiance », par quoi il entend « un procès, au cours duquel le sujet, échappant à la logique de l’ego-cogito […] se débat avec le sens ». Claudel et Mallarmé servent ainsi conjointement un plaidoyer en faveur d’une sémiotique généralisée, d’une interprétation affranchie de toute limite : celle qu’imposerait la tradition, ou l’intentio auctoris, aussi bien que celle qui voudrait séparer par exemple les objets naturels des choses produites de main d’homme.
5Je partage tout à fait la vision de l’herméneutique claudélienne que Barthes suggère ici; et si je cite ici ce petit texte, c’est qu’il touche l’un des nœuds de la relation complexe que Claudel a entretenue avec Mallarmé.
6Claudel est à la fois très constant et très mobile. Il n’a jamais varié ni dans son affection pour l’homme Mallarmé, ni dans son admiration pour l’artiste, ni dans son aversion envers ce qu’il appelle (avec d’autres) son matérialisme. Remarquable constance surtout – et c’est cela qui m’intéresse aujourd’hui – des raisons qu’il donne à son admiration et à son intérêt. Des raisons, ou plutôt de la raison, puisque, depuis 1913 au moins et jusqu’à la fin, Claudel rapporte massivement toute l’influence et toute l’importance de Mallarmé à une raison et à une seule. Cette raison est une question, qu’il aurait apprise rue de Rome, une question très simple, très claire, d’autant plus claire qu’elle est plus simple, une question qui est la formule même de l’herméneutique : « Qu’est-ce que ça veut dire ? »
7Je pourrais citer plusieurs textes. Je cite l’un des plus développés, dans les Mémoires improvisés, enregistrés en 1951-52. Il y a, dit alors Claudel, une parole de Mallarmé qui a
profondément marqué mon intelligence, et qui est à peu près le seul enseignement que je reçus de lui, et c’est un enseignement capital : je me rappelle toujours un certain soir où Mallarmé, à propos des naturalistes, de Loti ou de Zola ou de Goncourt, disait :
Tous ces gens-là, après tout, qu’est-ce qu’ils font ? Des devoirs de français, des narrations françaises. Ils décrivent le Trocadéro, les Halles, le Japon, enfin tout ce que vous voudrez. Tout ça ce sont des narrations, ce sont des devoirs.
8Et Mallarmé oppose ensuite à cela sa façon à lui de se placer « devant un spectacle » :
Moi il m’a dit : « Ce que j’apporte dans la littérature, c’est que je ne me place pas devant un spectacle en disant : “Quel est ce spectacle ? Qu’est-ce que c’est ?ˮ en essayant de le décrire autant que je peux, mais en disant : Qu’est-ce que ça veut dire ? Cette remarque m’a profondément influé et depuis, dans la vie, je me suis toujours placé devant une chose non pas en essayant de la décrire telle quelle, par l’impression qu’elle faisait sur mes sens ou sur mes dispositions momentanées, mes dispositions sentimentales, mais en essayant de comprendre, de la comprendre, de savoir ce qu’elle veut dire2. »
9Je ne ferai guère qu’interroger ces propos.
10Première remarque : Claudel simplifie.
11En simplifiant, il éclaire, il trace une ligne intelligible. Mais aussi, il dé-finit, il résorbe une « influence » (je reprends son mot) qui est bien plus diffuse, plus difficile à circonscrire. Il tranche dans le nœud gordien des rapports existant entre lui et son « maître ». La fréquentation et la lecture de Mallarmé, son enseignement, la rumination de ses œuvres durant une grosse soixantaine d’années, ont eu des effets plus nombreux, plus divers, plus insinuants, que Claudel ne le marque ici, c’est tout à fait évident. Manifestement, il s’agit, tout en s’acquittant une dette, de mettre une borne au crédit, et tout en saluant Mallarmé, d’en finir avec lui. Il s’agit, si je puis dire, de régler son compte :
Après cette question tout le profit que je pouvais tirer de la fréquentation de Mallarmé était inutile [un « profit inutile », étrange et remarquable raccourci]. J’en avais fini en somme avec lui3.
12Deuxième remarque : ce rabattement de Mallarmé sur la question du sens, et sur elle seule, peut étonner. Elle étonne bien sûr parce qu’elle paraît prendre à rebours toute une réception critique (blanchotienne, derridéenne) qui a été longtemps dominante, et qui a fait de Mallarmé le paradigme d’une littérature sans référent et sans en-deçà, une littérature bien empêchée de demander « ce que ça veut dire » puisque sa singularité et sa nouveauté serait précisément d’être sans « ça », sans objet devant elle que son propre procès.
13Bien sûr, ce discours critique a cessé aujourd’hui de prévaloir. Et le texte dans lequel Thierry Roger définit la problématique de ce colloque lorsqu’il demande, en citant « Bucolique » si la « conception du poète comme “lecteur d’horizonˮ jette les bases d’une herméneutique de la terre, ou de la nature, qui resterait à définir » – ce texte, donc, projette devant nous un Mallarmé bien différent de celui des années 1860 et 1870, un Mallarmé parfaitement compatible avec celui dont se souvient le vieux Claudel des Mémoires, et avec les propos qu’il lui prête alors, à près de soixante-dix ans de distance.
14L’étonnement persiste cependant, quand ce ne serait qu’en raison de la définition que Mallarmé donne (chez Claudel) de sa place dans l’histoire, de ce qu’il appelle son « apport ». On est forcément surpris de lire que jusqu’à Mallarmé « pendant tout un siècle depuis Balzac, la littérature avait vécu d’inventaires et de descriptions4 ».
15Je ne vais pas citer à présent tous les représentants de l’herméneutique romantique : Balzac, par exemple, recommandant dans Séraphîta (dès 1834, par conséquent) d’étudier les correspondances « entre les choses visibles et pondérables du monde terrestre et les choses invisibles et impondérables du monde spirituel » afin, disait-il, « d’avoir les cieux dans son entendement5 ». Ou encore Baudelaire :
Qu’est-ce qu’un poète (je prends ce mot dans son acception la plus large) si ce n’est un traducteur, un déchiffreur6 ?
16Et je rappelle aussi Hugo, qui bien avant que Claudel n’évoque l’« innombrable parabole » des choses autour de nous, dit entendre « sous chaque objet sourdre la parabole », ou encore vante à Goncourt les mérites de la « cage de cristal » qu’il a fait bâtir à grands frais sur le toit de sa maison de Guernesey « pour étudier le sens des tempêtes7 ».
17« Trop longtemps », assure Claudel, « les romantiques nous ont fait croire que la création était muette8 ». On peut dire bien des choses du romantisme ; mais cette chose-là est un peu forte. L’herméneutique des objets naturels est un des lieux communs du romantisme, un des outils qui lui permet de confier à la poésie une fonction de révélation ontologique : ce que Schaeffer a appelé la théorie spéculative de l’Art.
18Claudel l’ignorait-il ? J’ai du mal à le croire. S’il n’en dit mot, s’il veut l’ignorer, c’est probablement afin de composer à sa guise son propre roman de formation, en écartant tout apparentement avec le romantisme. Et c’est aussi à cause de ce goût qui est le sien pour les événements dramatiques, les « coups de théâtre », comme on dit si bien. Le sens est toujours chez lui un événement, ou un avènement ; et la rencontre de la question herméneutique, un certain soir, dans l’appartement de la rue de Rome, survient de la même manière dramatique que la rencontre de Rimbaud ou celle de Dieu, à Notre Dame, durant les vêpres de Noël de 1886.
19Mais cette raison est-elle la seule ? Dès lors que Claudel, et Mallarmé dans le récit de Claudel, écartent Hugo et Baudelaire et tous les autres avec eux, il est nécessaire de se demander si ce pourrait être, pour partie au moins, à bon droit : parce que Mallarmé aurait employé la question herméneutique d’une manière qui serait singulière, qui ne serait pas celle de ses devanciers. Ou pour le dire autrement : il faut essayer de comprendre mieux le sens que Claudel et Mallarmé donnent à la question du sens ; mieux comprendre ce que signifie la question formulée « un certain soir » rue de Rome ; tenter de préciser ce que veut dire le fameux : « Qu’est-ce que ça veut dire ? ».
20Cette question si simple, en dépit ou à cause de sa simplicité, n’offre pas un sens mais plusieurs. Dans les récits et dans les commentaires de Claudel, elle est susceptible de recevoir plusieurs sens, ou du moins plusieurs inflexions. J’en distingue trois : tantôt, il appuie sur la valeur critique; tantôt, il nous oriente du côté d’une analogie avec la science contemporaine; tantôt enfin il met l’accent sur ce qu’il appelle « volonté ». Je développerai successivement ces trois inflexions.
211. La conversion réflexive
22Dans les « Notes sur Mallarmé », qui ont été consignées sur 2 feuillets en janvier 1913 et qui rendent compte de la lecture du livre de Thibaudet paru l’année précédente aux éditions de la NRF, le point 2 dit ceci :
Mallarmé, qui était tout le passé fut aussi tout l’avenir par ce grand principe qu’il nous enseigne : devant toute chose, se demander : qu’est-ce que cela veut dire ? Se placer dans une attitude critique. L’intelligence, source et ressource de la poésie (parmi d’autres)9.
23L’adjectif « critique » est glosé (on vient de l’entendre) dans la proposition qui suit, par le mot « intelligence », qui est un mot d’époque et qui vient souvent aussi sous la plume de Thibaudet dans le volume dont Claudel rend compte ici. Il peut y avoir une part de provocation, ou de protestation, dans l’usage de ce mot à propos d’un auteur si souvent déclaré « inintelligible ». Mais l’essentiel n’est pas là : l’essentiel est ce « grand principe » par lequel Mallarmé (un Mallarmé Janus, on le voit, un visage tourné vers l’avenir et un autre vers le passé : ni le Mallarmé Mao de Kristeva, au lendemain de la Révolution culturelle, ni celui de Bénichou, donné pour le dernier rejeton du romantisme) Mallarmé donc s’identifie à l’histoire tout entière de la poésie : récapitulant son passé, re-parcourant toute l’expérience de ses devanciers pour ouvrir un âge nouveau que, suivant Claudel, je nommerai critique.
24Une « attitude critique », qu’est-ce que c’est sinon une attitude (je cite le TLF) « qui implique une méthode d’examen » ou encore « qui implique l’examen raisonné auquel on soumet quelqu’un ou quelque chose » ; examen qui suppose des « facultés de jugement et de discernement ». Poésie non pas essentiellement chantante, donc, mais essentiellement questionnante ; non pas lyrique, mais critique ; poésie non pas du ah ! de l’exclamation, mais du questionnement. Poésie donc, placée sous le signe d’Animus ; poésie « sentimentale » au sens de Schiller, à rebours de toute naïveté : le rapport du sujet à la nature (« toute chose ») a cessé d’être immédiat, spontané, harmonique, pour devenir interrogatif, réflexif. On pourrait dire, en détournant une expression de Merleau-Ponty, que par sa question Mallarmé opère la « conversion réflexive » de la poésie.
25On peut reconnaître ici une manière d’écrire l’histoire de la poésie qui nous est aujourd’hui familière. On reconnaît aussi la méditation poursuivie toute sa vie par Claudel sur le débat de l’intelligence et de l’instinct, du réflexif et du pulsionnel, d’Athéna et de Dionysos.
262. Science et poésie
27Mon point d’appui ici c’est « La catastrophe d’Igitur » dans lequel Claudel après avoir expliqué que Mallarmé est « le premier » qui se soit placé devant l’extérieur muni de la question du sens, Claudel donc, poursuit en disant :
Question qui pour lui d’ailleurs comportait non pas une réponse, non pas une explication, mais une authentification par le moyen de cette abréviation incantatoire qu’est le Vers, comme le savant dit qu’il a expliqué un phénomène quand il en a fourni un dessin schématique10.
28Claudel glose ici évidemment une proposition fameuse de Crise de vers et de l’Avant-dire au Traité du Verbe de René Ghil, où (si j’en crois les dictionnaires) l’épithète « incantatoire » a fait son apparition dans la langue française :
Le vers qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de la parole : niant, d’un trait souverain, le hasard demeuré aux termes malgré l’artifice de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité, et vous cause cette surprise de n’avoir ouï jamais tel fragment, ordinaire, en même temps que la réminiscence de l’objet nommé baigne dans une neuve atmosphère11.
29Claudel fait allusion à ce texte, mais loin de placer l’accent (à l’instar de toute une tradition moderne) sur « l’isolement de la parole » entendu à la manière derridéenne comme suspension de toute référence, négation de « l’objet nommé », refus de donner à la littérature aucun fondement hors d’elle-même12, sa lecture, on le voit, préserve une antériorité : l’antériorité de ce que Mallarmé (ou Claudel reformulant Mallarmé) appelle tout simplement ça : « Qu’est-ce que ça veut dire ?». Et permettez-moi d’attirer l’attention sur ce pronom, non pas ceci, non pas cela, mais ça, très constamment, très régulièrement, (presque) chaque fois que Claudel mentionne la question, cette forme familière. Je n’en dis pas plus pour l’instant, je reviendrai tout à l’heure sur ça.
30Je note seulement pour l’instant qu’un peu plus bas dans « La Catastrophe », afin de préciser sa pensée touchant l’analogie entre le vers et le schéma des savants, Claudel met une note :
Le physicien lord Kelvin disait qu’il ne comprenait réellement un phénomène que quand il en avait construit au moyen d’un appareil une représentation mécanique13.
31Le schématisme et l’abréviation pourraient s’interpréter comme réduction à une essence, à une structure, à ce que la philosophie thomiste dont Claudel se réclame appelle la quiddité, ou encore la « forme substantielle », débarrassée de la « matière individuelle ». Cependant j’observe, et chacun peut observer avec moi, que Claudel ne dit rien de tout cela. Il s’abstient de faire donner ici cette artillerie conceptuelle ; et il modernise, il actualise ses références possiblement médiévales par la mention du modèle mécanique de Kelvin. Cette actualisation se retrouve lorsque Claudel définit le Coup de dés comme une « équation typographique ». Ceci peut rappeler le portrait de Mallarmé en poète ingénieur qu’on rencontre chez Valéry, à propos de ce même poème.
323. Volonté
33Je voudrais, il est temps, en venir à la question telle qu’on peut la rencontrer (rarement) dans l’œuvre écrite de Mallarmé.
34La formulation la plus proche de celle que rapporte Claudel se trouve dans « Ballets » (qui date de 1886). Le texte de « Ballets » (dans lequel, soit dit en passant, J.-P. Richard a désigné un des modèles de sa propre herméneutique14) convie le client des « lieux de danse »
sans visée quelconque préalable, patiemment et passivement à se demander devant tout pas, chaque attitude si étranges, ces pointes et taquetés, allongés ou ballons. « Que peut signifier ceci ? », ou mieux, d’inspiration, le lire15.
35La formulation est extrêmement proche, on le voit, de celle que rapporte Claudel. Extrêmement proche, mais pas tout à fait identique. « Que peut signifier ceci? » n’est pas exactement : « Qu’est-ce que ça veut dire? ». Le ceci n’est pas le ça, l’abréviation familière du pronom neutre installe un ton nettement différent de celui de Ballets.
36J’observe d’ailleurs que c’est cette même forme qui a servi aux traducteurs de Freud, pour rendre le das Es emprunté à Groddeck, en 1923, trois ans avant la rédaction, en avril 1926, à Tokyo, de « La catastrophe d’Igitur ». Rapprochement arbitraire? Peut-être. Mais il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je fasse dire à Claudel : Wo Es war, soll Bedeutung werden, « là où ça était, du sens doit advenir ». « Ça », c’est ce qui est, l’étant présent opaque en deçà du langage. Car tout n’est pas langage : avant le langage, avant le sens, il y a ça. « Ça », je le définirais en prenant le contre-pied de Derrida lorsqu’il écrit, dans La Dissémination, que la littérature ne repose que sur elle-même « à l’écart de l’être16 » : ça, c’est précisément le fondement de la littérature hors d’elle-même, le pré-texte. Il y a un monde avant le langage, un monde opaque, aphone, et qui réclame des mots.
37Ceci pour ça. Mais pour ceci ? Il me paraît évident que la valeur du « ceci » dans « Ballets » est bien différente. Le ceci vise moins une opacité qu’une trace, un tracé, un délié, mot qui vient du latin delicatus, dont nous avons fait délicat, et qui est en tout cas déjà une ligne, comme « l’horizon » de « Bucolique », déjà une sorte de tracé, déjà une sorte d’écriture. Chacun voit bien par surcroît que la modalité potentielle du questionnement mallarméen diffère franchement de ce que l’interrogation claudélienne comporte de direct, sinon de brutal et de mal élevé ; et « veut dire » n’est pas « signifier ».
38On jugera peut-être que j’appuie un peu lourdement sur ces différences ; mais c’est que le commentaire de Claudel, dans les Mémoires improvisés, invite à appuyer.
39Lorsqu’Amrouche lui rappelle la formule de Valéry définissant la poésie un effort pour exprimer « ce qu’il semble que veuillent dire les choses », Claudel répond que Valéry, en effet, « se figurait qu’il était devant un spectacle qui n’a pas beaucoup de sens » ; mais lui, Claudel, il est « persuadé qu’elles ont un sens, un sens comme celui du Sphinx : « “Devine ou je te dévoreˮ, enfin…17 ». « Ou je te dévore » : ce membre de phrase est saisissant, très exactement il est renversant : il renverse les positions. Voilà le questionneur, l’herméneute, mis à la question, et en grand danger d’être dévoré. Quelques pages plus haut, déjà, même inversion :
Ce mot de « veut dire » est extrêmement frappant en français, parce que « veut dire » ça exprime une certaine volonté. Cet arbre comme le banyan ou ce spectacle tel que je vois a une espèce de volonté secrète, de volonté latente qui nous pose une question somme toute – et à cette question nous sommes sommés de répondre : « Qu’est-ce que ça veut dire18 ? ».
40On voit bien comment Claudel s’approprie la question que nous pouvons lire dans « Ballets », pour lui imprimer une valeur qui est évidemment absente du texte de Mallarmé, sinon de sa conversation.
41Il y a bien sûr la question du sens, c’est l’herméneutique ; mais il y a aussi le sens de la question, qui relève d’une agonistique. Il s’agit d’un sens à trouver ; mais bien davantage d’un sens qui vous cherche. Le sujet, disait Barthes, « se débat avec le sens ». Hé bien, c’est exactement ça. Et dans un tel débat, ce qui compte ce n’est pas tant la forme du sens que sa force, pas tant son sémantisme que son avidité.
42On peut le dire autrement : « moi je suis persuadé », il s’agit de foi. Claudel poursuit en effet :
Et alors, j’ai trouvé plus tard, dans un texte de l’apôtre saint Jacques, un passage qui répond exactement à cette question de Mallarmé. Il dit que les choses sont soumises à la vanité, ne le voulant pas, n’est-ce pas ? Ça prouve qu’elles veulent par conséquent autre chose, et ce mot français « qu’est-ce que ça veut dire » prend par conséquent une extrême importance : les choses sont soumises à la volonté, à la vanité, ne le voulant pas : ça veut dire qu’elles ont un sens, une signification, pour le contemplateur somme toute de l’idée. Et alors pour répondre à cette question, j’ai trouvé plus tard un grand appui dans la philosophie de saint Thomas d’Aquin19.
43On pourra se trouver surpris de ce destin de la question, de la suite que Claudel lui donne et de cette conversion de la formule mallarméenne. Mais ceci demanderait du temps et je n’en ai plus guère. Je me bornerai à deux remarques, qui me fourniront ma conclusion.
441. Il n’est pas nécessaire d’arriver à saint Paul (saint Jacques est un lapsus) pour percevoir la différence entre les deux questions : différence qui affecte moins leur sémantisme que leur ethos, leur accent, le ton sur lequel elles sont proférées, la tension qui les traverse. Différence que suggère du reste ce qui sépare la chose claudélienne de la danseuse mallarméenne, la voracité de l’une et le sourire de l’autre. Herméneutique de part et d’autre, sans doute : mais d’un côté l’herméneutique est un « commerce dont paraît [un] sourire verser le secret », « la nudité » du concept s’entrevoit à travers « le voile dernier qui toujours reste », aucune étreinte n’est possible ni peut-être même désirée, l’immédiateté est hors sujet. De l’autre, pas question de voile ni de sourire, plus question de regard ni même de lecture, plus question de « vision » ni de concepts, mais question de corps à corps et de dévoration.
452. La violence de l’herméneutique claudélienne n’est là que pour répondre à la brutalité de ce qui est en manque de sens : ce monde opaque, sauvage, antérieur, et qui exige. La pensée de Claudel s’oriente dans le sens d’un vitalisme et d’un primitivisme. Pour lui comme pour la phénoménologie, le monde est antéprédicatif et le poème ne vise au fond que cette antériorité : celle que Husserl appelle Leben, que Merleau appelle corps, que Claudel ici appelle ça. Son œil est celui du vitaliste décrit par Canguilhem, qui « cherche une certaine naïveté de vision antétechnologique, antélogique, une vision de la vie antérieure aux instruments créés par l’homme pour étendre et consolider la vie20 ».
46Certes, chez Mallarmé aussi, la ballerine est « illettrée ». Mais au lieu de cette sorte de panique, ou de rage, qui anime les choses chez Claudel, voici des roses et du satin, la « soumission » jouée du poète jetant aux pieds de la danseuse « la Fleur de [son] poétique instinct ». De l’interprétant à l’interprété, la relation rêvée est tout autre. À la sommation claudélienne (« nous sommes sommés de répondre ») répond chez Mallarmé une rêverie et un jeu. Jeu aimable, et savant : mais, à moins de posséder « l’impersonnel regard absolu » qui appartient au seul génie, le client des lieux de danse ne lit jamais que « ses concepts », ne voit rien d’autre que « sa vision ». La danseuse illettrée ne lui livre que ce qui vient de lui. Ce client-ci n’a pas d’autrui.
47Bien sûr, puisqu’il sait que tout est fiction, il se gardera « d’écarter le leurre », ce qui ne ferait qu’ « accuser [son] inconséquence », ruiner le plaisir que chacun peut prendre. Cependant, il sait à quoi s’en tenir sur « la pièce principale, ou rien21 ». Sur la scène du solipsisme, la seule herméneutique possible est une herméneutique pour rire, ou pour sourire, une supercherie plaisante, un plus ou moins « glorieux mensonge », un simulacre ou un jeu.
1 Friedrich Wolf, Encyclopedie der Philologie (1831), cité dans Jean Starobinski, La Relation critique, Paris, Gallimard, « Tel », 2001, p. 27.
2 Mémoires improvisés, Paris, Gallimard, « Idées Gallimard », 1969, p. 78.
3 Ibid., p. 79.
4 « La catastrophe d’Igitur », dans Paul Claudel, Œuvres en prose, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 511.
5 Balzac, Œuvres, t. XII, Paris, Club Français du Livre, p. 338.
6 Baudelaire, « Victor Hugo », dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 133.
7 Selon Edmond et Jules de Goncourt, Journal, mardi 5 août 1873.
8 L’Enthousiasme, Œuvres en prose, éd. citée, p. 1396 (1953).
9 Œuvres en prose, éd. citée, p. 514.
10 Ibid., p. 511.
11 Crise de vers, Œuvres complètes, éd. Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, tome II, p. 213.
12 Jacques Derrida, « La Double séance », dans La Dissémination, Paris, Seuil, « Points », 1993, passim ; voir par exemple p. 340.
13 La citation de Kelvin vient d’un livre de Bernard Brunhes sur La Dégradation de l’énergie (Paris, Flammarion, 1909) que Claudel a lu fin 1923 et il enregistre des notes de lecture assez fournies dans son journal (I, 613). La question de la science, l’analogie science / poésie, est récurrente chez lui.
14 Voir L’Univers Imaginaire de Mallarmé, Paris, Seuil, 1961, p. 16.
15 Ballets, dans Mallarmé, Œuvres complètes, éd. citée, p. 307.
16 Derrida, La Dissémination, éd. citée, p. 340.
17 Mémoires Improvisés, éd. citée, p. 84.
18 Ibid., p. 79.
19 Ibid. La formule attribuée à saint Jacques se trouve en fait chez saint Paul (Rom., 8, 19-22) : « la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu : si elle fut assujettie à la vanité (non qu’elle l’eût voulue, mais à cause de celui qui l’y a soumise) c’est avec l’espérance d’être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu’à ce jour gémit en travail d’enfantement. »
20 Georges Canguilhem, La Connaissance de la vie, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1985, p. 88. Il écrit encore : « L’homme peut considérer la nature de deux façons. D’abord il se sent un enfant de la nature et éprouve à son égard un sentiment d’appartenance et de subordination, il se voit dans la nature et il voit la nature en lui. Ou bien, il se tient face à la nature comme devant un objet étranger, indéfinissable. Un savant qui éprouve à l’égard de la nature un sentiment filial, un sentiment de sympathie, ne considère pas les phénomènes naturels comme étranges et étrangers, mais tout naturellement, il y trouve vie, âme et sens. Un tel homme est fondamentalement un vitaliste. Platon, Aristote, Galien, tous les hommes du Moyen Âge et en grande partie les hommes de la Renaissance étaient, en ce sens, des vitalistes. Ils considéraient l’univers comme un organisme, c’est-à-dire un système harmonieux réglé à la fois selon des lois et des fins. Ils se concevaient eux-mêmes comme une partie organisée de l’univers, une sorte de cellule de l’univers organisme; toutes les cellules étaient unifiées par une sympathie interne, de sorte que le destin de l’organe partiel leur paraissait avoir naturellement affaire avec les mouvements des cieux ». En ce sens, la conception de Claudel est foncièrement vitaliste.
21 La Musique et les Lettres, dans Mallarmé, Œuvres complètes, éd. citée.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2013, publiés par Thierry Roger (CÉRÉdI)
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 10, 2014
URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=614.
Quelques mots à propos de : Claude-Pierre Perez
Aix Marseille Université
CIELAM
Claude-Pierre Perez est Professeur à l’Université d’Aix-Marseille. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Paul Claudel et Jean Paulhan. Dernier ouvrage paru : Les Infortunes de l’imagination : aventures et avatars d’un personnage conceptuel de Baudelaire aux postmodernes, P.U. Vincennes, « L’imaginaire du texte », 2010.
Concernant Paul Claudel : Le Défini et l’inépuisable. Essai sur Connaissance de l’Est, de Paul Claudel, Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, Besançon-Paris, 1995 (distrib. Les Belles Lettres) ; Le Visible et l’invisible, pour une archéologie de la poétique claudélienne, Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, Besançon-Paris, 1998.
